-
Carl Schmitt
Carl Schmitt : État, Nomos et “grands espaces”
 La maison d'édition berlinoise Duncker & Humblot, qui publie l'essentiel de l'œuvre de Carl Schmitt, a eu le mérite l'an passé d'avoir publié une anthologie d'articles définitionnels fondamentaux du juriste et politologue allemand (CS, Staat, Großraum, Nomos – Arbeiten aus den Jahren 1916-1969), magistralement préfacés par Günter Maschke. Ce fut sans doute, à nos yeux, le nouveau livre le plus important en philosophie politique exposé à la Foire de Francfort en octobre 1995. Mais c'est aussi un livre fondamental pour comprendre dans tous ses rouages le monde d'après la Guerre Froide. G. Maschke, un des plus grands spécialistes allemands de Carl Schmitt, mérite nos éloges pour avoir annoté avec une remarquable précision tous ces articles et surtout les avoir resitués dans leur vaste contexte. Maschke fournit en effet au lecteur — à l'étudiant comme à l'érudit — des commentaires et des analyses très méthodiques et très fouillées. Staat, Großraum, Nomos est divisé en quatre parties : 1. Constitution et dictature ; 2. Politique et idée ; 3. Grand-Espace et Droit des gens et 4. Du Nomos de la Terre. À notre avis, l'essentiel pour notre monde en effervescence depuis la chute du Mur réside dans les deux dernières parties.
La maison d'édition berlinoise Duncker & Humblot, qui publie l'essentiel de l'œuvre de Carl Schmitt, a eu le mérite l'an passé d'avoir publié une anthologie d'articles définitionnels fondamentaux du juriste et politologue allemand (CS, Staat, Großraum, Nomos – Arbeiten aus den Jahren 1916-1969), magistralement préfacés par Günter Maschke. Ce fut sans doute, à nos yeux, le nouveau livre le plus important en philosophie politique exposé à la Foire de Francfort en octobre 1995. Mais c'est aussi un livre fondamental pour comprendre dans tous ses rouages le monde d'après la Guerre Froide. G. Maschke, un des plus grands spécialistes allemands de Carl Schmitt, mérite nos éloges pour avoir annoté avec une remarquable précision tous ces articles et surtout les avoir resitués dans leur vaste contexte. Maschke fournit en effet au lecteur — à l'étudiant comme à l'érudit — des commentaires et des analyses très méthodiques et très fouillées. Staat, Großraum, Nomos est divisé en quatre parties : 1. Constitution et dictature ; 2. Politique et idée ; 3. Grand-Espace et Droit des gens et 4. Du Nomos de la Terre. À notre avis, l'essentiel pour notre monde en effervescence depuis la chute du Mur réside dans les deux dernières parties.Cette nouvelle anthologie a l'immense mérite de concentrer toute son attention sur un aspect moins connu, mais toutefois déterminant, de la pensée et de l'œuvre de C. Schmitt : la géopolitique. Notre “Centre de Recherches en Géopolitique” avait jadis déjà mentionné quelques-uns de ces textes fondamentaux, mais le vaste ensemble d'articles et d'essais sélectionnés par Maschke permet de jeter, sur cette géopolitique schmittienne, un regard beaucoup plus synoptique.
Le “Grand-Espace”
Notre Centre a publié depuis 1988 un certain nombre de textes de géopolitique ; depuis 1991, nous réfléchissons intensément sur le nouvel ordre mondial après l'effondrement de l'Union Soviétique. L'ère nouvelle sera très vraisemblablement marquée par la notion de “Grand-Espace”, toutefois dans un sens peut-être différent de celui que lui donnait C. Schmitt. Commençons notre analyse par une citation de Joseph Chamberlain qui illustre bien l'intention des géopolitologues et de Schmitt lui-même : « L'ère des petites nations est révolue depuis longtemps. L'ère des empires est advenue » (1904). Mais l'effondrement de l'URSS nous enseigne que l'ère des empires traditionnels est elle aussi révolue, si l'on considère toutefois que le dernier des empires traditionnels a été l'Union Soviétique. À la place des empires, nous avons désormais les “Grands-Espaces”. Dans son essai Raum und Großraum im Völkerrecht, Schmitt définit clairement le concept qu'il entend imposer et vulgariser : « Le “Grand-Espace” est l'aire actuellement en gestation, fruit de l'accroissement à l'œuvre à notre époque, où s'exercera la planification, l'organisation et l'activité des hommes ; son avènement conduira au dépassement des anciennes constructions juridiques dans les petit-espaces en voie d'isolement et aussi au dépassement des exigences postulées par les systèmes universalistes qui sont liés polairement à ces petits-espaces ».
Schmitt cite Friedrich Ratzel et montre, en s'appuyant sur ces citations, comment, à chaque génération, l'histoire devient de plus en plus déterminée par les facteurs géographiques et territoriaux. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui pour notre génération, car la bipolarité d'après 1945 fait place à une multipolarité, dont on ne connaît pas encore exactement le nombre de protagonistes.
Maschke, dans ses commentaires sur l'article intitulé Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, mentionne à juste titre la théorie de Haushofer qui envisageait de publier un Grundbuch des Planeten, un livre universel sur l'organisation territoriale de la planète. La géopolitique, selon Haushofer, ne devait pas servir des desseins belliqueux — contrairement à ce qu'allèguent une quantité de propagandistes malhonnêtes — mais préparer à une paix durable et éviter les cataclysmes planétaires du genre de la Première Guerre mondiale. Ce Grundbuch haushoférien devait également définir les fondements pour maintenir la vie sur notre planète, c'est-à-dire la fertilité du sol, les ressources minérales, la possibilité de réaliser des récoltes et de pratiquer l'élevage au bénéfice de tous, de conserver “l'habitabilité” de la Terre, etc., afin d'établir une quantité démographique optimale dans certains espaces. Les diverses puissances agissant sur la scène internationale pratiqueraient dès lors des échanges pour éviter les guerres et les chantages économiques. Certes, on peut reprocher à ce Grundbuch de Haushofer, un peu écolo avant la lettre, d'être utopique et irénique, mais force est de constater que ses idées étaient fondamentalement pacifistes et qu'elles ne coïncidaient pas avec les projets agressifs de l'Allemagne nationale-socialiste. Pourtant, Maschke rappelle que Schmitt et Haushofer ne correspondaient apparemment pas et ne s'étaient jamais vus.
Cet article sur le völkerrechtliche Großraumordnung… constituaient une tentative d'introduire en Europe une “doctrine de Monroe” au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans son commentaire, Maschke rappelle les thèses d'un géographe américain, Saul Bernard Cohen, qui a eu le mérite de maintenir à flot les idées géopolitiques avant leur retour à l'avant-plan. Le concept cohenien de “région géopolitique”, développé depuis les années 60 et actualisé aujourd'hui, s'avère pertinent dans le contexte actuel de “fin de millénaire”. Ces idées de “grand-espace” et de “région géopolitique” se retrouvent également chez les deux experts espagnols de droit international, fortement influencés par Schmitt : Camilo Barcia Trelles et Luis Garcia Arias.
L'étude de Schmitt Das Meer gegen das Land (La mer contre la terre) de 1941 contient le noyau essentiel du futur livre de Schmitt Land und Meer. Maschke pense que Schmitt a été influencé par la lecture de Vom Kulturreich des Meeres (1924) de Kurt von Boeckmann, et de Vom Kulturreich des Festlandes (1923) de Leo Frobenius.
Une recension écrite par Schmitt en 1949 garde toute sa pertinence aujourd'hui, souligne Maschke. Elle s'intitule Maritime Weltpolitik. Schmitt y écrit : « La domination de l'espace aérien et la possession de moyens de destruction modernes pourront à elles seules s'assurer la domination sur la terre et sur la mer. [Par ces moyens techniques], notre planète est encore devenue plus petite. En comparaison avec les structures qu'érige la technique moderne sur la planète, la Tour de Babel apparaît comme une entreprise très modeste. La Mer a perdu sa puissance en tant qu'élément et notre Terre est devenue un aérodrome » (p. 479 de l'édition de Maschke).
Quelques années après la Seconde Guerre mondiale déjà, Schmitt tire la conclusion : dans le futur, le contrôle de la planète s'exercera par le biais des communications aériennes (et plus tard spatiales) ; la Terre et la Mer perdront de l'importance. Le nouvel espace — jeu de mot ! — sera l'espace.
Schmitt mentionne l'œuvre de l'Américain Homer Lea (1876-1913) dans sa recension. Lea avait terminé sa carrière comme conseiller militaire de Sun Yat Sen en Chine. Il avait écrit des livres importants, largement oubliés aujourd'hui : The Day of the Saxon (1912) et The Valor of Ignorance (1909). Le polémologue suisse Jean-Jacques Langendorf, ami et complice de Maschke, avait préfacé une réédition allemande de The Day of the Saxon et prépare actuellement une vaste étude sur le écrits militaires et géopolitiques de Lea.
Le Nomos
Penchons-nous maintenant sur la quatrième partie de cette anthologie, qui commence par la définition que donne Schmitt du “nomos” : « Il est question d'un Nomos de la Terre. Ce qui signifie : je considère la Terre — l'astéroïde sur lequel nous vivons — comme un Tout, comme un globe et je recherche pour elle un ordre et un partage globaux. Le terme grec “nomos”, que j'utilise pour désigner ce partage et cet ordre fondamental, dérive de la même étymologie que le mot allemand “nehmen” (prendre). Nomos signifie dès lors en première instance, la “prise”. Ensuite, ce terme signifie, le partage et la répartition de la “prise”. Troisièmement, il signifie l'exploitation et l'utilisation de ce que l'on a reçu à la suite du partage, c'est-à-dire la production et la consommation. Prendre, partager, faire paître sont les actes primaires et fondamentaux de l'histoire humaine, ce sont les trois actes de la tragédie des origines » (Maschke, p. 518).
Dans une étude datant de 1958 et intitulée Die geschichtliche Struktur des Gegensatzes von Ost und West (La structure historique de l'opposition entre l'Est et l'Ouest), Schmitt mentionne quelques-unes des théories géopolitiques de base énoncées par Sir Halford John Mackinder. Il se réfère au géographe britannique quand il affirme que l'opposition entre puissances continentales et puissances maritimes constitue la réalité globale de la guerre froide. Quand il commente cette étude, Maschke commet la seule erreur que j'ai pu trouver dans son travail par ailleurs exemplaire. “L'Île du monde” selon Mackinder est l'Europe + l'Asie + l'Afrique et non pas “l'hémisphère oriental” comme le dit Maschke (p. 546). Celui-ci affirme également que Mackinder avait été influencé par le géographe allemand Joseph Partsch. Je ne prétends pas être un expert dans l'œuvre de Mackinder, mais c'est bien la première fois que je lis cela…
Nous avions déjà eu l'occasion de recenser un ouvrage important de Schmitt, Gespräch über den neuen Raum (Conversation sur le nouvel espace). C'est l'une des contributions les plus pertinentes de Schmitt à la géopolitique depuis 1945. Le message de Schmitt dans ce travail (et dans d'autres), c'est un appel à la constitution de différents “Grands-Espaces”, ce qui semble advenir aujourd'hui, surtout depuis la Guerre du Golfe. La théorie du pluralisme des Grands-Espaces, Schmitt l'a bien exprimée dans un autre texte figurant dans l'anthologie de Maschke : Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg (L'Ordre du monde après la Seconde Guerre mondiale). Schmitt y écrivait : « De quelle manière se résoudra la contradiction entre le dualisme de la Guerre Froide et le pluralisme des Grands-Espaces… ? Le dualisme de la Guerre Froide s'accentuera-t-il ou bien assistera-t-on à la formation d'une série de Grands-Espaces, qui généreront un équilibre dans le monde et, par là même, créeront les conditions premières d'un ordre pacifique stable ? » (Maschke, p. 607).
En 1995, nous connaissons la réponse à la question que posait Schmitt en 1962. Le dualisme n'est plus et nous pouvons assister à l'émergence (timide) de Grands-Espaces, qui pointent à l'horizon. Nous ne pouvons toujours pas deviner quelle sera l'issue de ce processus. Des changements surviendront indubitablement dans le cours des choses mais nous pouvons d'ores et déjà penser que l'ALENA et l'UE seront deux de ces Grands-Espaces, et ils coopéreront sans doute avec le Japon. Le Lieutenant-Général William E. Odom de l'US Army, aujourd'hui à la retraite, a lancé quelques éléments dans le débat visant à structurer le système qui prendra le relais de celui de la Guerre Froide dans son ouvrage How to Create a True World Order (Comment créer un véritable Ordre Mondial ?, Orbis, Philadelphia, 1995). La Russie, la Chine, l'Inde, le Sud-Est asiatique et le monde musulman pourraient bien devenir des Grands-Espaces autonomes. L'Afrique continuera à végéter dans la misère, sauf peut-être le Nigéria et l'Afrique du Sud. L'attitude agressive croissante de la Chine aura sans doute pour résultat d'avertir les petites puissances d'Asie ; elles prépareront dès lors leur défense contre l'impérialisme chinois à venir.
Dans la quatrième partie de l'anthologie de Maschke, nous trouvons encore un texte fondamental, Gespräch über den Partisanen (Conversation sur la figure du partisan) (1). Au départ, il s'agissait d'un débat radiodiffusé en 1960 entre Schmitt et un maoïste allemand, Joachim Schickel. ce débat était bien entendu marqué par la grande question de cette époque : l'insurrection croissante au Vietnam. Il n'en demeure pas moins vrai que la question de la guerilla (ou du Partisan) demeure. Le Law Intensity Warfare (guerre à basse intensité) continuera à faire rage sur la surface du monde et influencera les processus politiques. Résultat : le terme de “Guerre civile mondiale” acquerra sans cesse de l'importance (2).
Carl Schmitt n'était pas en première instance un géopolitologue. Il était un expert en droit constitutionnel et international. Toutefois, au moment où nous allons aborder le nouveau millénaire, il est temps, me semble-t-il, de remettre sur le métier les approches schmittiennes en matières géopolitiques et géostratégiques globales. Même si Schmitt reste une personnalité controversée (à cause des opinions qu'il a émises au début des années 30), il est devenu impossible de l'ignorer quand on élabore aujourd'hui des scénarii pour l'avenir du monde.
◘ Références du livre de Maschke : Carl SCHMITT, Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969. herausgegeben, mit einem Vorwort und mit Anmerkungen versehen von Günter Maschke, Duncker & Humblot, Berlin, 1995.
► Theo Hartman, Nouvelles de Synergies européennes n°20, 1996.
[« State, Nomos and Greater Space. Carl Schmitt on Land, Sea and Space », in Center for Research on Geopolitics (CRG), Special Report n°4, Helsingborg/Sweden, 1996. Adresse : CRG, P.O.Box 1412, S-251.14 Helsingborg/Suède ; tr. fr. RS]
• Notes :
(1) Tr. fr. : Conversation sur le partisan (1969) in La guerre civile mondiale, essais 1943-1978 (éd. Ère, nov. 2007).
(2) Pour une analyse complète de la notion de “Guerre civile mondiale”, cf. le manuscrit impublié de Bertil Haggman, directeur du CRG suédois, intitulé Global Civil War - A Terminological and Geopolitical Study, 1995).
***
◘ À lire : Impérialisme et droit international : le point de vue de Carl Schmitt (D. Cumin).

• recension : Der Fürst dieser Welt, Carl Schmitt und die Folgen, Jacob Taubes (dir.), Band 1 der Reihe “Religionstheorie und Politische Theologie”, Ferdinand Schoningh / Wilhelm Fink Verlag, Paderborn/München, 1983.
Sur la couverture : une reproduction de l'édition latine du Léviathan, “figure représentant le dieu mortel, au corps faits d'hommes, figure à laquelle nous devons paix et protection sous le regard du Dieu immortel” (Hobbes). Der Fürst dieser Welt (Le Prince de ce monde) est le premier volume d'une collection prestigieuse qui explorera l'océan quasi insondable de la “théologie politique”. L'éditeur reste modeste : il avoue ne reconnaître aucune terre fixe dans cet océan, autrement dit aucun socle méthodologique solide pour cerner cette discipline, aujourd'hui largement évacuée des programmes de sciences-po'. Dès l'abord, avec pareil avertissement, le lecteur risque d'abandonner l'ouvrage à la poussière des bibliothèques, de le percevoir comme une tentative vaine, prétentieuse et inutile. La première chose qu'il convient de faire, pour lui faciliter l'accès de ce monde aussi étrange que fascinant, c'est de définir ce qu'est la “théologie politique”.
Première définition
La Stoa, déjà, distinguait aux côtés de la théologie physique et de la théologie mythique, une théologie politique, chargée de répondre à une question fondamentale : “Quels dieux le citoyen moyen doit-il honorer pour le compte de l'État et quels actes sacrés, quels sacrifices doit-il consentir ?”. Dans cette optique, il s'agit des composantes théologiques et cultuelles de l'État, que l'on retrouve aujourd'hui encore, sous une forme édulcorée, dans la “civil religion” américaine.
Deuxième définition
”Théologie politique” est un concept forgé en 1922 par Carl Schmitt dans un ouvrage portant le même titre. Le troisième chapitre du livre commence par une phrase-clef : “Tous les concepts marquants des doctrines modernes de l'État sont des concepts de la théologie qui ont été sécularisés”. Quant au premier chapitre, il commence par une phrase tout aussi déterminante : “Est souverain, celui qui décide de l'état d'exception”. Schmitt opère là un parallèle entre le miracle, qui transgresse, par définition, les lois de la nature, et l'intervention du souverain dans l'ordre du droit en vigueur au sein d'un État. Catholique (ou plutôt “catholisant”), Schmitt, en se réclamant des philosophes politiques contre-révolutionnaires (XVIIIe et XIXe siècles) et surtout de l'Espagnol Donoso Cortès, réintroduit, dans le discours intellectuel sur le politique, l'antithèse théologique opposant immanence et transcendance. Dans le sens où l'entend Carl Schmitt, la “théologie politique”, c'est le retour des concepts et des représentations théologiques dans la pensée politique concrète. La tâche du politologue sera alors de repérer les “théologies cachées” qui truffent les discours théoriques sur le politique. Toute approche scientifique de la démocratie relève ainsi, selon Carl Schmitt, du domaine de la théologie politique.
Troisième définition
Aujourd'hui, tout un éventail de doctrines et d'idéaux se proclament être des “théologies politiques”. Des auteurs allemands comme Metz, Moltmann, Gollwitzer, Sölle, les théologies dites de la “Révolution” ou de la “Libération”, etc. veulent justifier par la théologie, par des arguments théologiques, des engagements politiques divers. Les sceptiques, quant à eux, voient, dans ces spéculations, “un conformisme pour le futur où règnera la prochaine répression” (Odo Marquard). Le volume édité par Jacob Taubes vogue entre ces trois formes de théologie politique. li ressemble à ces “mélanges” offerts à l'occasion d'anniversaires de professeur d'université. Parmi les textes rassemblés, on trouve une brève évocation de Fritz Leib, un théologien “compagnon de route” de Staline ; une analyse de la vision constantinienne d'Augustin ; une recherche sur Hans Blumenberg et Peterson (deux auteurs abordés par Schmitt dans Politische Theologie II, recueil de répliques à son ouvrage de 1922) ; une étude sur Kierkegaard, etc. Le volume ne comprend que des fragments d'analyse, sans fil conducteur, puisque les collaborateurs de Taubes ne cherchent pas à construire ensemble une théologie politique.
Seule exception, Odo Marquard, qui nous définit une théologie politique du polythéisme. L'actuelle philosophie de l'histoire, avancée par les “révolutionnaires” (ou plutôt les penseurs révolutionnaires en chambre) n'est qu'un monothéisme sécularisé, un monomythe, un récit à conter à tous et à chacun. Avant 1750, écrit Marquard, il existait plusieurs récits qui, par un processus de “singularisation”se sont mués en un récit unique auquel personne ne peut plus se soustraire. “La philosophie révolutionnaire de l'histoire est, sur le mode monomythique, le monothéisme politique actuel. Il est l'auto-corroboration non plus d'un seul empereur (ou monarque) mais d'une seule histoire, d'une seule révolution”. Et à côté de cette unique philosophie de l'histoire se serait operé un “retour du refoulé”, c'est-à-dire une recherche de la “polymythie” perdue, recherche qui se révèle dans l'orientalisme du XIXe siècle et dans le culte naïf et agressif voué à la Chine de Mao et au Vietnam de Hồ Chí Minh chez les gauchistes d'il y a dix ans. Un cheminement des Hafis à Hô Chi Minh… Si l'orientalisme est, pour Marquard, une impasse, il s'est quand même jeté les fondements d'un polythéisme politique éclairé et sérieux, comme, par exemple, le système de la séparation des pouvoirs. Ce système correspondrait au monde d'Homère, où les dieux comme les Princes grecs, sont des oligarques. Le polythéisme est dès lors un oligothéisme qui, contrairement au monothéisme orgueilleux et sûr de lui, peut mettre son propre déclin en perspective.
Notre époque, toutefois, a scellé l'assomption du pluralisme authentique et inauguré l'âge de l'intégralisme où, tant sur le plan théologique que sur le plan politique, l'on n'a plus le choix qu'entre le monopole et la “commune”, entre César et le “royaume de LA Liberté”, entre les adeptes de l'autocratie et les libéraux. Dans le domaine de la théologie politique, jadis espace intellectuel quasi réservé aux contre-révolutionnaires (surtout catholiques), s'affrontent aujourd'hui “libéraux” et “révolutionnaires de gauche”. Les adeptes de Joseph de Maistre, de Bonald, de Donoso Cortès et de Carl Schmitt, résolument campés ailleurs, regardent le spectacle de ce pugilat et lisent attentivement le livre édité par Taubes. L'intérêt de cette lecture, c'est de se plonger dans un univers étranger aux préoccupations macabrement juridiques ou stupidement économistes qui font de la politique théorique un pensum difficile à s'administrer. L'univers des théologies politiques nous permet de prendre distance vis-à-vis des obsessionnels du statu quo et de leurs platitudes.
► Caspar von Schrenck-Notzing, Vouloir n°10, 1984.

La figure du “Katechon” chez Schmitt
Dans sa Théologie politique (1922), la figure du katechon est celle qui, par son action politique ou par son exemple moral, arrête le flot du déclin, la satanisation totale de ce monde de l'en-deçà. Catholique intransigeant, lecteur attentif du “Nouveau Testament”, Schmitt construit sa propre notion du katechon au départ de la Deuxième Lettre aux Thessaloniciens de Paul de Tarse. Le Katechon est la force (un homme, un État, un peuple-hegemon) qui arrêtera la progression de l'Antéchrist. Schmitt valorise cette figure, au contraire de certains théologiens de la haute antiquité qui jugeaient que la figure du katechon était une figure négative parce qu'elle retardait l'avènement du Christ, qui devait survenir immédiatement après la victoire complète de l'Antéchrist. Schmitt fonde justement sa propre théologie civile, après avoir constaté cette différence entre les théologiens qui attendent, impatients, la catastrophe finale comme horizon de l'advenance de la parousie, d'une part, et, ceux qui, par le truchement d'une Theologia Civilis tirée en droite ligne de la pratique impériale romaine, veulent pérenniser le combat contre les forces du déclin à l'œuvre sur la Terre, sans trop se soucier de l'avènement de la parousie. Les sociétés humaines, politiques, perdent progressivement leurs valeurs sous l'effet d'une érosion constante. Le katechon travaille à gommer les effets de cette érosion. Il lutte contre le mal absolu, qui, aux yeux de Schmitt et des schmittiens, est l'anomie. Il restaure les valeurs, les maintient à bout de bras. Le Prof. Fabio Martelli a montré comment la notion de Katachon a varié au fil des réflexions schmittiennnes : il rappelle notamment qu'à l'époque de la “théologie de la libération”, si chère à certaines gauches, où un Dieu libérateur se substituait, ou tentait de se substituer, au Dieu protecteur du statu quo qu'il avait créé, Schmitt sautait au-dessus de ce clivage gauche/droite des années 60-70, et aussi au-dessus des langages à la mode, pour affirmer que les pays non-industrialisés (du tiers-monde) étaient en quelque sorte le katechon qui retenait l'anomie du monde industriel et du duopole USA/URSS. Finalement, Schmitt a été tenté de penser que le katechon n'existait pas encore, alors que l'anomie est bel et bien à l'œuvre dans le monde, mais que des “initiés” sont en train de forger une nouvelle Theologia Civilis, à l'écart des gesticulations des vecteurs du déclin. C'est de ces ateliers que surgira, un jour, le nouveau katechon historique, qui mènera une révolution anti-universaliste, contre ceux qui veulent à tout prix construire l'universalisme, arrêter le temps historique, biffer les valeurs, et sont, en ce sens, les serviteurs démoniaques et pervers de l'Antéchrist.
► intervention du Prof. Dr. Fabio Martelli - Université d'été de la FACE, 1995. Publié dans : Nouvelles de Synergies Européennes n°12, 1995.
(résumé de Robert Steuckers ; ce résumé ne donne qu'un reflet très incomplet de la densité remarquable de la conférence du Prof. Fabio Martelli, alors Président de Synergies Européennes-Italie)
• note en sus : Si Schmitt donne une coloration théologique à la “résistance” à la Catastrophe, sous le thème de l’Antéchrist et du katechon [voir l’édition de Ex captivitate salus par A. Doremus, Vrin, 2003, not. p. 341 et suivant : annexe par A. Doremus sur le concept de katechon], il importe de garder présente la motivation juridique, comme le rappelle JF Kervegan : « La critique qui m’est faite à propos de la théorie du katechon m’a surpris. En effet, je me démarque constamment des lectures « théologiques » de Schmitt qui se sont multipliées ces vingt ou trente dernières années, dans lesquelles cette thématique occupe effectivement une place de choix. Ma lecture de Schmitt est clairement « antithéologique » et prend au sérieux l’affirmation de Ex Captivitate Salus : « je suis juriste, et non théologien ». J’ai donc proposé de considérer que ce motif un peu nébuleux (qui repose sur une interprétation contestable d’une phrase de la deuxième Épître de Paul aux Thessaloniciens) recouvre en réalité une thèse : celle du primat de la légitimité sur la légalité du point de vue d’une philosophie de l’histoire qui, selon moi, a ses racines chez Schelling ou Friedrich Schlegel plutôt que chez Hegel ou Kant. Mon interprétation du katechon schmittien est donc plutôt à chercher dans le chapitre V (« Légitimité ») que dans le chapitre III (« Théologie »). C’est un choix qui me semble clairement déflationniste. Je ne crois donc pas que le « catéchisme apocalyptique » dont parle R. Baumert joue un rôle décisif dans la structure profonde de la pensée de Schmitt ; mais, en tout cas, on ne saurait y voir un simple instrument tactique en vue de justifier un coup d’État » (extrait de : « Lire Schmitt en philosophe »)

Une première biographie de Carl Schmitt

• Analyse : Paul NOACK, Carl Schmitt : Eine Biographie, Ullstein/Propyläen, Berlin, 1993.
Si les exégèses de l'œuvre de Carl Schmitt [1888-1985] sont fort nombreuses à travers le monde depuis quelques années, si les interprétations de sa notion de “décision” ou de sa “théologie politique” se succèdent à un rythme ahurissant, personne ne s'était encore attelé à écrire une biographie personnelle du prince des politologues européens.Paul Noack (1925-2003), germaniste, romaniste et historien, ancien rédacteur des rubriques politiques de la Frankfurter Allgemeine Zeitung et du Münchener Merkur, actuellement professeur d'université à Munich, vient de combler cette lacune, en suivant chronologiquement l'évolution de Schmitt, en révélant sa vie de famille, en évoquant ses souvenirs personnels, consignés dans des journaux, des lettres et des entretiens inédits, et en replaçant l'émergence des principaux concepts politologiques dans le vécu même, dans l'existentialité intime, de l'auteur. Noack sait qu'il est difficile de périodiser une existence, a fortiori quand elle s'étend presque sur tout un siècle, entrecoupé de guerres, de bouleversements, de violences et d'effondrements.
Mais dès le départ, toutes les tranches de la première moitié de la longue vie de Schmitt sont marquées par des coupures : l'enfance (1888-1890) par l'arrachement à la patrie de ses ancêtres, l’Eifel mosellan profondément catholique, et l'exil en Sauerland ; l'adolescence (1900-1907), elle, est imprégnée d'une éducation humaniste dans une ambiance cléricale édulcorée, qui a abandonné cette “totalité” mobilisatrice et exigeante, propre du catholicisme intransigeant ; la jeunesse (1907-1918) de Schmitt baigne, quant à elle, dans une Grande Prusse dés-hégélianisée, de facture wilhelmienne, où l'engouement philosophique dominant va au néo-kantisme ; le premier âge adulte (1919-1932) se déploie dans une germanité dé-prussianisée, où règne la démocratie parlementaire de Weimar contestée par les divers mouvements nationaux et par la gauche musclée.
Contre l'occasionalisme
Bref, cette périodisation claire, qu'a choisie Noack, indique que les bouleversements, les abandons, les relâchements se succèdent pour aboutir au chaos des dernières années de la République de Weimar et du grand “Krach” de 1929. Cette effervescence, de la Belle Époque au Berlin glauque où s’épanouissent au grand jour toutes les perversités, est peut-être féconde sur le plan des ruptures, des idées, des modes, des variétés, des innovations artistiques, des audaces théâtrales : elle plaît assurément aux Romantiques de tous poils qui aiment les originalités et les transgressions. Mais Schmitt reproche aux Romantiques, ceux de la première vague comme leurs héritiers à son époque, de s'engouer temporairement pour telle ou telle beauté ou telle ou telle originalité : ils sont “occasionalistes”, “irresponsables”, incapables de développer, affirmer et approfondir des constantes politiques ou conceptuelles. Toute pensée fondée sur le goût ou le plaisir lui est étrangère : il lui faut de la clarté et de l'efficacité. Sa conviction est faite, il n'y changera jamais un iota : le “moi” n'est pas, ne peut pas être, un objet du penser. Celui qui hisse le “moi” au rang d'objet du penser, participe à la dissolution du monde réel. Ne sont réels et dignes de l'attention du penseur que les hommes qui s'imbriquent dans une histoire, s'en déclarent les héritiers et sont porteurs d'une attitude immuable, éternelle, qui incarnent des constances, sans lesquelles le monde et la cité tombent littéralement en quenouille.
Cette option, constate Noack, est le meilleur antidote contre le nihilisme et le désespoir. Pour y échapper, l'homme Schmitt entend ne pas être autre chose que lui-même et ses circonstances, notamment un Catholique impérial et rhénan, comme l'ont été ses ancêtres. C'est dans ces circonstances-là que Schmitt s'imbrique pour ne pas être emporté par le flot des modes de la Belle Époque ou du Berlin décadent des années 20. La politique, dès lors, doit être servie par une philosophie du droit fondée sur des concepts durs, impassables, éprouvés par les siècles, comme l'ont été ceux de la théologie jadis. Les concepts politiques qu'il s'agit d'élaborer pour sortir de l'ornière doivent être résolument calqués sur ceux de la théologie, s'ils n'en sont pas des reflets résiduaires, inconscients ou non. Schmitt, au seuil de sa maturité, demeure quelque peu en marge de la Révolution conservatrice, dont l'objectif majeur, dans le sillage de Moeller van den Bruck et des autres nationalistes de tradition prusso-protestante, était d'approfondir les fondements de l' « idéologie allemande », née dans le sillage du romantisme et de la guerre de libération anti-napoléonienne. Cette « idéologie allemande » véhicule, aux yeux de Schmitt, trop de linéaments de ce romantisme et de cet occasionalisme qu'il abomine.
Ses références seront dès lors romanes et non pas germaniques, plus exactement franco-espagnoles : Donoso Cortès, de Bonald, de Maistre. C'est dans leurs œuvres que l'on trouve les matériaux les plus solides pour critiquer et déconstruire la modernité, pour jeter bas les institutions boiteuses et délétères qu'elle a générées, responsables des bouleversements et des arrachements que Schmitt a toujours ressenti dans son propre vécu, quasiment depuis sa naissance. Ces institutions libérales, insuffisantes selon Schmitt, sont défendues avec brio, à la même époque, par Hans Kelsen et son école positiviste. Schmitt juge ce libéral-positivisme d'une manière aussi pertinente que lapidaire : « Kelsen résout le problème du concept de souveraineté en le niant. La conclusion de ses déductions est la suivante : le concept de souveraineté doit être radicalement refoulé ». S'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de souverain, c'est-à-dire plus de pouvoir personnalisé par des hommes charnellement imbriqués dans une continuité historique précise. par le truchement de ce positivisme froid, le pouvoir devient abstrait, incontrôlable, incontestable. Son épine dorsale n'est plus une forme héritée du passé, comme la forme catholique pour laquelle opte Schmitt. Sans épine dorsale, le pouvoir chavire dans l'« informalité » : il n'a plus de conteneur, il s'éparpille. Dans ce contexte, quelle est la volonté de Schmitt ? Forger un nouveau conteneur, créer de nouvelles formes, restaurer ou re-susciter les formes anciennes qui ont brillé par leur rigueur et leur souplesse, par leur solidité et leur adaptabilité.Ernst Jünger
Quand paraît le « concept du politique » en 1927, il est aussitôt lu par un autre maître des formes et des attitudes, Ernst Jünger, tout aussi conscient que Schmitt de la liquéfaction des formes anciennes et de la nécessité d'en restaurer ou, mieux, d'en forger de nouvelles. Enthousiasmé, Ernst Jünger écrit une lettre à Schmitt le 14 octobre 1930, qui sera l'amorce d'une indéfectible amitié personnelle. Pour Jünger, l'homme des “orages d'acier” de 1914-1918, la démonstration de Schmitt dans le concept du politique est une « évidence immédiate » qui « rend toute prise de position superflue » et balaie « tous les bavardages creux qui emplissent l'Europe ». « Cher Professeur », ajoute Jünger, « vous avez réussi à découvrir une technique de guerre particulière : la mine qui explose sans bruit ». « Pour ce qui me concerne, je me sens vraiment plus fort après avoir ingurgité ce repas substantiel ».
Les deux hommes étaient pourtant fort différents : d'une part le guerrier décoré de l’Ordre Pour le Mérite ; de l'autre, un pur intellectuel qui n'avait jamais livré d'autres batailles que dans les livres. Jünger essaiera avec un indéniable succès d'introduire la clairvoyance de Schmitt dans les cercles néo-nationalistes, notamment les revues Die Tat, de Hans Zehrer et Erich Fried, et Deutsches Volkstum de Wilhelm Stapel. La participation des deux hommes aux activités littéraires, philosophiques et journalistiques de la Konservative Revolution n'efface par leurs différences : Armin Mohler, nous rappelle Paul Noack, écrit très justement qu'ils sont demeurés chacun dans leur propre monde, qu'ils ont continué à chasser chacun dans leur propre forêt. Césure qui s'est bien visibilisée à l'époque du national-socialisme : retrait hautain et aristocratique de l'ancien combattant, engagement sans résultat du juriste.
Walter Benjamin
Mais, souligne P. Noack, une grande figure de la gauche, en l'occurrence Walter Benjamin, écrivit aussi à Schmitt en 1930, quelques semaines après le “néo-nationaliste” Jünger, exactement le 9 décembre. Benjamin envoyait ses respects et son nouveau livre au juriste catholique et conservateur, admirateur de Mussolini! Il soulignait dans sa lettre des similitudes dans leur approche commune du phénomène du pouvoir. Cette approche est interdisciplinaire et c'est l'interdisciplinarité qui doit, aux yeux du Benjamin lecteur de Schmitt, transcender certains clivages et rapprocher les hommes de haute culture. Effectivement, l'interdisciplinarité permet seule de pratiquer un véritable “gramscisme”, non un “gramscisme de droite” ou un “gramscisme de gauche”, mais un gramscisme anti-établissement, anti-installations.
Noack écrit : « [Schmitt et Benjamin] sont tous deux adversaires de la pensée en compromis. Benjamin disait que tout compromis est corruption. Tous deux sont aussi adversaires du parlementarisme, du libéralisme politique et du système politique qui en procède. Tous deux pensent que ce n'est que dans l'état d'exception de l'esprit d'une époque se dévoile véritablement ; tous deux manifestent une tendance pour l'absolu et la théologie ». Et de citer Rumpf : « Benjamin et Schmitt se rencontrent dans leur rejet et leur mépris d'une bourgeoisie qui s'encroûte dans ce culte générateur du Moi ». Ce rapport entre Schmitt et l'un des plus éminents représentants de la “Nouvelle Gauche”, voire de “l'École de Francfort”, permet d'accréditer la thèse longtemps contestée d'Ellen Kennedy, spécialiste américaine de l'œuvre de Schmitt, qui a toujours affirmé que ce dernier a bel et bien influencé en profondeur cette fameuse “École de Francfort” en dépit de ce que veulent bien avouer ses tristes légataires contemporains.
La parenthèse nationale-socialiste
Avec l'avènement du national-socialisme, les positions vont se radicaliser. L'effondrement de la République de Weimar laisse un vide : Schmitt croit pouvoir instrumentaliser le nouveau régime, sans assises intellectuelles, s'en servir comme d'un Cheval de Troie pour introduire ses idées dans les hautes sphères de l'État. Ses anciennes accointances avec le Général von Schleicher, liquidé lors de la “Nuit des longs couteaux” en juin 1934, la nationalité serbe de son épouse Duchka Todorovitch (les services secrets se méfiaient de tous les Serbes, accusés de fomenter des guerres depuis l'attentat de Sarajevo) et son catholicisme affiché (son « papisme » disaient les fonctionnaires du “Bureau Rosenberg”) : autant de “tares” qui vont freiner son ascension et même précipiter sa chute. Schmitt laisse des textes compromettants, qui le marqueront comme autant de stigmates, mais échoue face à ses adversaires dans les rangs du nouveau parti au pouvoir. Pire, à cause de son zèle intempestif, il traîne parfois aussi une réputation de naïf ou, plus grave encore, d'opportuniste sans scrupule qui souhaite toujours et partout être le Kronjurist, le “juriste principal”.
Plus tard, en 1972, dans un interview à la radio, Schmitt a avoué avoir agi sous l'impulsion d'un bon vieil adage français : « On s'engage et puis on voit ». Noack croit déceler dans cette attitude collaborante une certitude de type hégélien : Schmitt, l'homme des livres, l'homme de culture, était persuadé, est demeuré persuadé, qu'au bout du compte, l'esprit finit toujours par triompher de la médiocrité. Le national-socialisme, pour ce catholique de Prusse, pour ce catholique frotté à une idéologie d'État de facture hégélienne, était une de ces médiocrités propre de l'homme pécheur, de l'homme imparfait : elle devait forcément succomber devant la lumière divine de l'esprit. Erreur fatale et contradiction étonnante chez ce pessimiste qui n'a jamais cru en la bonté naturelle de l'homme, commente Noack.
La notion de “Grand Espace”
À partir de 1939, Schmitt aborde une nouvelle dimension du droit international, qui ne se focalise plus sur l’État, forme du politique arrivée à la fin de son cycle, mais sur des groupes d’États et de nations ou sur des continents circonscrits par la géographie. Les ordres politiques ne seront plus stato-nationaux, comme au XIXe siècle, mais continentaux et pluri-nationaux. Ces ordres complexes et pluriels ne pourront s’affirmer et organiser les peuples que si l’on pose comme préalable que les puissances extérieures à cet espace ne peuvent y intervenir. En gros, Schmitt propose une doctrine de Monroe pour l’Europe, unie de force par la poigne allemande. Dans les Amériques, cette stratégie adoptée par les États-Unis a réussi depuis 1823. L’Europe doit à son tour la pratiquer, en suggérant un ordre social différent, non libéral.
Prononcée le 1er avril 1939, cette conférence de Schmitt sur l’ordonnancement du monde en “grands espaces” et sur l’interdiction d’intervention pour les puissances hors-espace, déclenche rapidement un scandale. Ébranlés et méfiants, les juristes nationaux-socialistes, qui l’avaient exclu de leurs cercles en 1936, voyaient advenir un “Reich” européen, si bien que l’institution “Reich” n’aurait plus été détenue en monopole par le seul peuple allemand (Romisches Reich Deutscher Nation). Pour eux, un tel Reich aurait été une abstraction, puisqu’il n’y aurait plus eu d’hegemon, de peuple porteur de la substance impériale, car il n’existe pas de “peuple européen” dans le concret. Ensuite, dès la mi-avril, les journaux britanniques, Times et Daily Mail, évoquent, inquiets, ce discours du juriste isolé et ostracisé qu’ils croient encore parfaitement inféodé à la machine étatique nationale-socialiste. Schmitt, pensent les observateurs anglais, a prononcé le programme officieux du gouvernement hitlérien. La Weltwoche de Zurich va plus loin : Schmitt jouerait le rôle du Rousseau de la “révolution allemande” ! Et puis, coup de théâtre : le 29 avril 1939, Hitler, dans un discours adressé à Roosevelt, réclame haut et clair une Doctrine de Monroe pour l’Allemagne qui s’appliquerait à l’Europe. Interrogé à Nuremberg sur l’éventuelle influence qu’il aurait exercé sur Hitler en cette matière, Schmitt n’a pas eu de difficultés à se défendre : le terme de “grand espace”, les spéculations sur la Doctrine de Monroe, étaient monnaie courante à cette époque, il n’en avait nullement le monopole. Günter Maschke, rappelle Noack, écrit que des centaines de livres ont été écrits à l’époque sur le même thème (songeons aux publications de l’école de Haushofer, aux spéculations d’économistes tels Alfred Oesterheld ou Emil Maurer, etc.). Mais c’est la qualité et la clarté de la démonstration schmittienne qui ont permis à ce discours d’avoir un tel retentissement. Une fois de plus, comme l’a un jour écrit Günter Maschke, la précision des concepts de Schmitt se profilait sur l’imprécision du réel.
L’après-guerre
Après les deux purgatoires, l’exil intérieur et la dénazification, Schmitt vit ostracisé à Plettenberg, tiraillé entre sa nostalgie des formes fortes qui ont laissé des traces ineffaçables, indélébiles dans les paysages, les âmes, les cerveaux, et sa volonté projectuelle d’en recréer après les phases de déclin, après les arrachements et les dissolutions. L’amertume le tenaille. Il prend conscience que sa politesse, sa courtoisie traditionnelle, sa réticence à se faire valoir, à se porter en avant, lui a joué des tours ; dans son journal personnel, il écrit, le 12 janvier 1950 : « N’as-tu pas honte ? Tu écris d’aimables lettres à des collègues qui ne cessent de te faire des crocs-en-jambe… Mon inébranlable politesse cause ma perte… Je ne pouvais m’empêcher d’être poli quand d’abord les nazis puis les dénazificateurs organisaient autour de moi la farandole de leurs folkloriques saltimbanques… Que veux-tu, pauvre homme, que l’on fasse de ta politesse ? Tu es tout-à-fait démodé, pré-industriel, tu n’es pas social, pas démocratique, pour ainsi dire tu n’es pas intégrable, pas européen ». L’époque de Schmitt était passée, l’américanisme — avec ses jurons de cow-boy, son langage relâché, ses gommes à mâcher, ses pin-ups fardées, ses forteresses volantes qui carbonisaient les musées, les opéras, les maisons de Goethe et de Mozart —, avait bouleversé de fond en comble le vieux monde européen, le monde de la guerre maîtrisée, de la guerre en dentelles, du jus publicum europaaum, dont Schmitt a tant eu la nostalgie…
Réhabilitation par la “Nouvelle Gauche”
Schmitt traversait un purgatoire. On lui tournait le dos. On lui attribuait des péchés qu’il n’avait pas commis. Il était un réprouvé. Mais en 1975 quand paraissent sous une forme définitive deux conférences de 1962 sur la Figure du Partisan, la “Nouvelle Gauche”, qui est alors au pinacle de son succès, le réhabilite, d’abord modérément, puis avec de plus en plus d’enthousiasme : Schmitt est un critique du libéralisme (bourgeois et capitaliste), de l’État de droit bourgeois (considéré comme répressif), de la technomanie et de la croyance progressiste en la faisabilité de toute chose en ce monde. À la suite de l’engouement pour Marcuse et sa critique de l’homme unidimensionnel, la nouvelle gauche avant-gardiste, celle qui voulait révolutionner le monde mais tout en demeurant collée au concret, s’intéresse à Schmitt et l’inclut progressivement dans son panthéon de références : ce travail, la revue américaine Telos le mènera jusqu’au bout. Paul Noack estime que ce retour de Schmitt par la gauche de l’échiquier politico-idéologique est dû à l’intemporalité de ses formules, répétées inlassablement, sous tous les angles, sous toutes leurs facettes. Chacun de ses livres était une variante complémentaire tournant toujours autour des mêmes évidences immuables.
Si l’on parlait naguère de “schmittiens de gauche” et de “schmittiens de droite”, voire de “schmittiens du centre”, il faudra dorénavant parler de “schmittiens” tout court. Car la précision des concepts de Schmitt, leur intemporalité, leur clarté, leur supériorité au-delà de tous les engouements idéologiques provisoires, servent tous les clairvoyants qui aperçoivent, avant les autres, vers quelles impasses nous mènent les pouvoirs de gauche comme de droite. Et ces schmittiens de toutes provenances formeront une phalange redoutable qui concentrera ses énergies pour abattre le système.
Paul Noack nous livre encore une quantité de détails sur la biographie de Schmitt. Notre recension, sur ce plan, est loin d’être exhaustive.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°8, 1995.

◘ Dossier “Carl Schmitt” – Bibliographie
• Paul NOACK, Carl Schmitt : Eine Biographie, Ullstein/Propyläen, Berlin, 1993, 360 p.
L'ouvrage du Prof. Paul Noack est la première biographie systématique de Carl Schmitt. Elle explore l'enfance, l'adolescence, la jeunesse du juriste et politologue, ses séjours à Munich, Greifswald et Bonn (1922-28). Elle montre l'influence du catholicisme conservateur sur son évolution vers la critique du parlementarisme et son engouement pour Mussolini. Noack n'oublie pas l'impact des 2 mariages de Schmitt, le premier avec Pawla Dorotic et le second avec Douchka Todorovic, toutes deux de nationalité serbe. Ensuite, Noack s'étend longuement sur le séjour à Berlin, sa rencontre et son amitié avec E. Jünger, dont le second fils, Alexander, sera le filleul de Schmitt. Par ses travaux du temps de Berlin, Schmitt influencera également Hermann Heller et Léo Strauss. L'époque nationale-socialiste est marquée pour lui par l'engagement au service du nouveau régime, en vue de faire passer dans les hautes sphères de l'État les idées élaborées depuis la parution de Théologie politique. Noack mène l'enquête sur l'éviction de Schmitt, à la suite d'articles diffamatoires parus dans la presse nazie, puis ses déboires avec les alliés et les dénazificateurs. Il nous montre qu'en dépit de sa mise à l'écart à partir de 1936, en dépit des menaces proférées contre lui, Carl Schmitt parvient à revenir sous les feux de la rampe en 1939 en formulant brillamment sa théorie du "Grand Espace". Après guerre, Noack retient surtout le long exil intérieur, l'ostracisme subi par le politologue, ostracisme levé, curieusement, par la nouvelle gauche, qui découvre en lui le critique le plus pertinent du libéralisme et le théoricien le plus fin de la figure du partisan. Noack suit donc pour nous l'homme de chaire Schmitt jusqu'à sa mort, au grand âge de 97 ans, toujours lucide mais très fatigué. Il nous explique les circonstances dans lesquelles il a écrit son dernier texte important, à 91 ans ("Die legale Weltrevolution"). De manière poignante, il relate l'impact de la mort prématurée de sa fille Anima, en 1983. Deux ans plus tard, le vieux père brisé suivait sa fille bien aimée dans la tombe.
• Matthias KAUFMANN, Recht ohne Regel ? Die philosophische Prinzipien in Carl Schmitts Staats- und Rechtslehre, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1988, 422 p.
Matthias Kaufmann, docteur en philosophie et en mathématiques, conseiller académique à l'Université d'Erlangen-Nürnberg, nous livre un panorama complet des concepts manipulés par Schmitt : il nous entretient sur leur origine et sur leur fonction. Tour à tour, il nous explique l'anti-universalisme fondamental de Schmitt (et son pari pour le pluriversum contre l'universum), sa conception négative de la morale en laquelle il perçoit une "inhumanité" (parce qu'elle fige les comportements jusqu'au fanatisme ou jusqu'à la caricature inopérante). L'hypermoralisme est une tyrannie des valeurs, disait Schmitt, et tout fixisme en ce sens, ajoute Kaufmann, conduit à des absoluisations où l'objectif de la morale, c'est d'extirper le mal, d'anéantir "ce qui n'a nulle valeur" (pour les tenants de la valeur dominante, bien entendu). La critique schmittienne du moralisme, écrit Kaufmann (p. 127), n'est pas pour autant une critique de la moralité, mais une critique de l'hypocrisie et du fanatisme idéologiques, qui conduisent à commettre des horreurs dans la guerre (blocus qui affament les civils, massacres d'indigènes dans les colonies, etc.). Ensuite, Kaufmann montre comment Schmitt, à l'ère fasciste, considérait que la dictature, parce qu'elle est en quelque sorte acclamative, est la véritable démocratie. Les parlements, disait Schmitt, confisquent et musèlent les "sphères publiques", jugement qui le rapproche tout de même, en dépit de sa proximité avec le fascisme, des théories formulées dans les années 60 et 70 par la nouvelle gauche américaine, critique à l'égard de la "démocratie bourgeoise". Enfin, point fort de l'argumentaire de Kaufmann : l'œuvre de Schmitt constitue toute entière une protestation contre l'identification du droit et de la règle, propre du positivisme juridique, dont Hans Kelsen est le représentant le plus éminent. Si la règle ne permet pas de trancher, il faut qu'une personne digne d'estime, compétente, et douée d'un charisme inhérent à sa fonction ou non, décide.
• Heinrich MEIER, Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar, 1994, 267 p.
Carl Schmitt, dans l'espace linguistique francophone, n'est guère connu mais ceux qui ont entendu évoquer son œuvre retiennent surtout sa conceptualisation du politique, sa théorie du partisan, à la rigueur son plaidoyer pour la constitution de grands espaces. Jusqu'à la publication récente de Théologie politique chez Gallimard à Paris, la dimension religieuse de Schmitt demeurait largement ignorée. Pourtant, la théologie politique de Schmitt conduit à affirmer une théorie politique qui, en dernière analyse, repose, en toute confiance, sur une foi en la révélation divine. Heinrich Meier explore cette dimension religieuse et estime qu'elle a été et demeure véritablement centrale chez Schmitt en dépit des vicissitudes de son époque, et des réaménagements qu'il a successivement apportés à ses idées. Le théologien politique, en tant qu'homme de foi, pose la question "Comment dois-je vivre ?". Il sait, par le truchement de sa foi, dans quel sens il doit orienter son existence, il sait où et comment il peut pécher ou faillir. En prenant en compte les ressorts de la théologie politique, la philosophie politique acquiert une conscience nettement plus précise de ce qu'elle est ou peut être elle-même, du fait que, pour Schmitt, tous les concepts de la philosophie politique dérivent, en ultime instance, de concepts théologiques antérieurs et "neutralisés" à l'époque moderne, laquelle tournait le dos aux guerres de religion. La pensée politique européenne a des racines théologiques et il s'agit d'en être conscient, pour ne pas dé-substantialiser le politique. de ce fait, l'identité de la philosophie politique, écrit Meier dans sa conclusion, n'est ni déterminée ni hypothéquée par la théologie politique — elle a toute son autonomie —, mais, en se souvenant de ses racines théologiques, elle acquiert des contours plus précis, et peut dès lors voir ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle ne peut pas être et ce qu'elle ne veut pas être. Cette clarification, poursuit Meier, que nous apporte la théologie politique de Schmitt, est pour nous la principale de ses leçons : Inter auctoritatem et philosophiam nihil est medium. Entre l'autorité ultime du divin et la philosophie, il n'y a pas d'intermédiaire.
Notons que Meier est également l'auteur d'un livre sur les rapports entre Carl Schmitt et Leo Strauss (Carl Schmitt, Leo Strauss und "Der Begriff des Politischen" : Zu einem Dialog unter Abwesenden, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Leipzig, 1988, 142 p.), traduit en français et publié auprès des éditions Julliard en 1990 (Carl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique. Trois lettres inédites à Carl Schmitt des années 1932-1933 – Un dialogue entre absents). Cet ouvrage revêt une importance nouvelle, sept ans après sa parution, dans la mesure où Leo Strauss comme Carl Schmitt, est désormais considéré aux États-Unis comme un penseur "anti-libéral" donc "politiquement incorrect". Stephen Holmes, dans The Anatomy of Antiliberalism (Harvard Univ. Press), écrit que Strauss "était une fleur exotique transplantée d'Europe Centrale dans les plaines du Midwest américain". Strauss, poursuit Holmes, était un humaniste de l'ancienne école, qui savait que l'on trouvait la sagesse dans les textes antiques (par ex. ceux de Thucydide), que les lumières menaient à l'horreur (not. à l'horreur hitlérienne qu'il craignait par dessus tout en tant que Juif) et que ce n'était pas l'insuffisance de lumières qui conduisaient à la pratique de la dépopulation en Vendée, aux Goulags staliniens ou à Auschwitz. Strauss ne rejette pas pour autant la philosophie des Lumières : mais elle ne peut pas être vulgarisée, elle doit rester l'apanage des seuls philosophes qui connaissent ses limites et savent l'utiliser à bon escient. Si elle devient vulgate, l'idéologie des Lumières croit pouvoir éradiquer le Mal dans le monde. En voulant faire l'ange, elle fait la bête… L'inégalité, autre mal à biffer aux yeux des fondamentalistes libéraux, est inscrite dans le tissu même de la nature, pense Strauss. Quant à l'hédonisme, gâterie pour les individus qui sortent du commun, il ne peut pas être démocratisé. La critique radicale de la modernité que nous propose Léo Strauss, sans pour autant rejeter en bloc la philosophie des Lumières et sans revenir à un fidéisme fondamentaliste, fonde son "incorrection" au regard des camelots de la démagogie contemporaine. H. Meier a eu le mérite d'explorer en premier les rapports féconds qui unissent et séparent à la fois nos deux philosophes. Mais Strauss, l'émigré juif, chassé de sa patrie centre-européenne, glisse depuis peu dans le purgatoire des réprouvés, au même titre que Schmitt, accusé, lui, de "nazisme". Triste signe des temps.
► Robert Steuckers, 1995.
***
L'Europe entre déracinement et réhabilitation des lieux : de Schmitt à Deleuze
L'Europe d'aujourd'hui est contrainte de répondre à un double défi :
- a) s'unifier au-delà de tous les vieux antagonismes stato-nationaux, pour survivre en tant que civilisation, et
- b) renouer avec son tissu pluriel, extrêmement bigarré, dans un jeu permanent d'ancrages, de réancrages et d'arrachements projectuels.
Cette pluralité est, concrètement parlant, une pluralité de paysages, de sites où se sont effectués des processus de sédentarisation dense et pluriséculaire. L'unification européenne est projet, elle anticipe un avenir qu'elle construit à l'aide d'organigrammes et de plans, tandis que le maintien de sa pluralité originelle et originale implique de conserver et d'entretenir des legs du passé. L'équilibre entre le projet d'avenir et la gestion des legs du passé est difficile à tenir. Nous sommes effectivement habitués à des clivages qui privilégient unilatéralement soit l'avenir (le camp "progressiste") soit le passé (le camp "conservateur"). Les progressistes se veulent accélérateurs, les conservateurs se veulent en quelque sorte "katechons".Cette difficulté de penser tout à la fois l'avenir et le passé dans la simultanéité et l'harmonie a marqué la pensée de Carl Schmitt. Celui-ci en effet a d'abord, dans les années 20 et 30, voulu être un accélérateur (Beschleuniger). Pour échapper à la "cage d'acier" qu'était la légalité bourgeoise, wilhelminienne et puis surtout weimarienne, il fallait à ses yeux dynamiser à outrance les potentialités techniques de l'État dans les domaines des armements, des communications, de l'information, des mass-media, parce que tout accroissement en ces domaines augmentait la puissance de l'État, puis la dépassait pour se hisser à un seuil nouveau, celui du Großraum. L'accélération continuelle des dynamiques à l'œuvre dans la société allemande des premières décennies de ce siècle a poussé Schmitt à abandonner son étatisme classique, de type européen et prussien, au nom de la sauvegarde, du maintien et du renforcement de la "souveraineté".
Schmitt : du futurisme au tellurisme
Les États européens, dont la population oscille entre 3 et 80 millions d'habitants, sont de dimensions insuffisantes face aux géants américain, soviétique ou chinois, pensait Carl Schmitt. Contrairement au label de “réactionnaire” qu'on lui a collé sur le dos, Schmitt a bel et bien participé à cette idéologie des “ingénieurs”, moderniste et techniciste, qui s'est ancrée dans l'Allemagne de Weimar, notamment par le biais des écrits de Rathenau. Mais après 1945, ce futurisme schmittien se dissipe. Si Schmitt retient l'idée d'un “grand espace”, il n'est plus fasciné par la dynamique industrielle-technique. Il se rend compte qu'elle conduit à une horreur qui est la "délocalisation totale", le "déracinement planétaire", surtout si elle est portée par la grande thalassocratie américaine, victorieuse des puissances européennes de l'Axe et opposée à l'Union Soviétique stalinienne et continentale.
En Europe, pensait Schmitt, la dynamique industrielle-technique était tempérée et freinée par une conception implicite du droit qui n'existe qu'en vertu d'un ancrage dans un sol, comme l'ont admirablement démontré Savigny et Bachofen. L'ancrage dans le territoire modérait le cinétisme frénétique de l'ère industrielle-technique. Mais si le cinétisme et le dynamisme sont désormais véhiculés par une thalassocratie qui n'est pas motivée en ultime instance par un ancrage dans un sol, ils perdent toute retenue et précipitent l'humanité dans le chaos. La présence ou le retour nécessaires aux “ordres élémentaires de nos existences terrestres” postule chez Schmitt un nouveau pathos : celui du tellurique. Sans espace habitable — et la mer n'est pas un espace habitable — il n'y a pas de droit et sans droit il n'y a aucun continuum possible. Das Recht ist erdhaft und auf Erde bezogen (Le droit est tellurique et lié à la Terre), écrit Schmitt dans son journal, intitulé Glossarium. La mer ne connaît pas l'unité de l'espace et du droit, elle échappe à toute tentative de codification. Elle est a-sociale et an-écouménique. La logique de la mer, constate Schmitt, transforme tout en flux délocalisés : les flux d'argent, de marchandises ou de désirs (véhiculés par l'audio-visuel). Ces flux, déplore Schmitt, recouvrent les "machines impériales". Il n'y a plus de Terre : nous naviguons sans cesse, sans pouvoir plus mettre pied au sol et tous les livres que philosophes et juristes peuvent écrire deviennent, volens nolens, autant de logbooks, de livres de bord, se bornant à rendre compte des événements ponctuant ce perpétuel voyage de l'humanité, condamnée à rester accrochée à son "bâteau ivre".
Une horreur de la logique de mer
Cette horreur de toute “logique de la mer”, nous la retrouvons également chez le poète et philosophe Rudolf Pannwitz (1881-1969) : pour Pannwitz la Terre est substance, gravité, intensité et cristallisation. L'Eau (et la Mer) sont mobilités dissolvantes. Parler de "Continent", dans cette géophilosophie ou cette géopoésie implicites, signifie invoquer la "substance", la “concrétude” incontournable de la Terre et du droit. L'Europe qu'espèrent donc Schmitt et Pannwitz est "la forme politique du culte de la Terre", car elle est la dépositaire de cultures (au pluriel !), issues de la glèbe, comme par définition et par force des choses toute culture est issue d'une glèbe. Ce travail de production de sens et de substance a été interrompu par le triomphe de la logique de la Mer. Il faut dès lors procéder à une “re-territorialisation” de ce qui peut être reterritorialisé. Pour un exégète de Schmitt comme le philosophe deleuzien allemand Friedrich Balke, le monde contemporain est un vaste jeu de flux de tous ordres où plus aucune stabilité ni aucune représentation rigide n'a sa place. Le conservateur, fasciné par la figure du Katechon, dira : il faut reterritorialiser, réhiérarchiser, restaurer l'approche classique du politique, c'est-à-dire se donner "la possibilité de faire des distinctions univoques et claires", bloquer les flux, rigidifier et coaguler partout, colmater les brèches.
Entre forme et non-forme
En avançant cette définition classique du politique, Schmitt appelait de ses vœux une revisibilisation fixe et nette du souverain et de la souveraineté, des formes sévères du politique, alors justement que les victoires des thalassocraties sur les dictatures de l'Axe, en imposant une logique fluide de la Mer, rendaient impossible à jamais le retour de ces représentations hiératiques de l'État et de la chose politique. Sommes-nous dès lors condamnés à "naviguer" sans repos, sans jamais rejoindre un port d'attache ? Oui, mais si et seulement si on reste dans la logique de la Mer en ignorant délibérément la Terre. Si l'on tient compte à la fois de la Terre et de la Mer, on pensera simultanément le voyage, la croisière ou le raid, d'une part, et l'accostage, le débarquement, le port d'attache, la crique accueillante, l'hinterland fascinant, d'autre part.
Pour Deleuze et Balke, rien n'est plus fixe, mais non pas parce que nous naviguons sans aucun port d'attache. Rien n'est fixe parce qu'en marge des représentations, désormais toujours grosses de caducité, nous avons des "zones d'indécision", des "zones entre forme et non-forme", où grouillent de potentielles innovations ou fulgurances, qui feront immanquablement irruption un jour pour recouvrir les formes figées, tombées en désuétude. Deleuze nous dit dès lors, comme une sorte de réponse à Schmitt et aux étatistes classiques : il ne s'agit plus de savoir si l'on va produire ou reproduire des formes, mais si l'on va réussir ou non à capter des forces. Et éventuellement à les chevaucher (Evola !) temporairement, le temps de repérer et d'emprunter une autre monture.
Par conséquent, la forme “État”, de modèle classique, est obsolète. Schmitt l'avait déjà perçu, mais ne l'avait pas systématiquement théorisé. Il avait déploré l'effacement graduel de la forme “État”, au profit de la société, plus bigarrée et moins clairement appréhendable de par la multiplicité de ses expressions. Avec l'État, au stade de sa rigidification suprême telle que l'a imaginée un Kafka dans Le Château, nous avions une "unité de communication bureaucratique", où les représentants de l'État étaient d'office placés au-dessus de ceux qui ne représentaient que des formations sociales subordonnées. Dans un monde de moins en moins déterminé par les formes et de plus en plus par les flux, l'État apparaît comme une “instance sublime de surcodage”, qui a soumis à son autorité des formations sociales déjà elles-mêmes codées, comme la famille, les tribus, les états (tiers-état, etc.), les communautés religieuses, les classes. Nous assistons aujourd'hui, à la suite de l'effritement de la forme et de l'hyper-fluidification qui s'ensuit, à un retour en force des formations de moindre codage. Car l'instance surcodée, le "Code", l'État classique, l'appareil, la bureaucratie étatique, etc. n'ont au fond pas de substance propre et ne se nourrissent que des substances réelles présentes, uniquement dans les corps sociaux, voire les "corps intermédiaires" dont Bodin avait revendiqué l'élimination en même temps que celle des religiosités parallèles ou résiduaires (sorcelleries, paganismes).
Le retour des ethno-nationalismes (dans les Balkans ou ailleurs), des revendications régionales (Lombardie, Savoie, Catalogne, biorégionalisme américain, etc.), des impératifs religieux (dans les fondamentalismes de diverses moutures), des conflits sociaux (comme en France en 1995 ou en Belgique aujourd'hui), des revendications communautaires (le communautarisme américain), des "marches blanches" contre l'appareil judiciaire accusé de fermer les yeux sur la pédophilie et les violences faites à l'enfant (Belgique, 1996), sont autant de signes d'une rébellion généralisée des groupes sociaux, auparavant surplombés par l'instance étatique "surcodifiante", trop rigide dans sa représentation et incapable, justement, de "capter des forces", parce que trop occupée à soigner, produire et reproduire son "look", sa "représentation". Dans un monde réagencé à la suite de la victoire écrasante d'une thalassocratie marchande, l'insatiable répétition "psittaciste" d'un modèle invariable fait scandale, même si l'extrême fluidité que la puissance maritime dominante impose par ailleurs au monde ne provoque pas outre mesure l'adhésion des masses ou des ressortissants des groupes sociaux soumis préalablement au “Surcode”.
À la fois voyages et ports d'attache
Nous découvrons donc une problématique ambivalence dans l'appréhension par nos contemporains de la sphère du politique : d'une part, ils tentent de se débarrasser du “surcode” étatique classique, car celui-ci est trop peu à même de “capter les forces” qui les interpellent dans leurs vies quotidiennes ; d'autre part, ils réclament du repos et tentent aussi d'échapper à ce voyage sans fin, à ce voyage permanent sur le “bâteau ivre”. Nos contemporains veulent à la fois voyage et ports d'attache. Aventure (ou distraction) et ancrage (et repos). Ils veulent un va-et-vient entre dé-territorialisation et re-territorialisation, dans un contexte où tout retour durable du politique, toute restauration impavide de l'État, à la manière du Léviathan de Hobbes ou de l'État autarcique fermé de Fichte, est désormais impossible, quand tout est "mer", "flux" ou "production".
Deleuze, Guattari et Balke acceptent le principe de la navigation infinie, mais l'interprètent sans pessimisme ni optimisme, comme un éventail de jeux complexes de dé-territorialisations (Ent-Ortungen) et de re-territorialisations (Rück-Ortungen). Le praticien du politique traduira sans doute cette phrase philosophique par le mot d'ordre suivant : “Il faut re-territorialiser partout où il est possible de reterritorialiser”, tout en sachant que l'État classique, rigide et représentatif, surcodifiant et surplombant les grouillements sociaux, n'est plus la seule forme de reterritorialisation possible pour nos contemporains. Il y a mille et une possibilités de micro-reterritorialisations, mille et une possiblilités d'injecter provisoirement de “l'anti-production”, c'est-à-dire des “jets de stabilisation coagulante” dans le flux de flux contemporain, que Deleuze & Guattari avaient nommé la “production” dans L'Anti-Œdipe et dans Mille Plateaux. Ainsi, la nécessité des formes ou des "stabilisations coagulantes" ne s'estompe pas mais change d'aspect : elle n'est plus surcodage rigide mais stabilisation provisoire et captation de forces réellement existantes que l'on chevauchera ou canalisera.
Quelle bonne politique ?
Face à ce constat des philosophes, quelle pourrait être la “bonne politique” dans l'Europe contemporaine ? Elle me semble devoir osciller d'une part, entre un “grand-espace”, une instance "grand-spatiale" souple et flexible, légère, svelte et forte, remplaçant et dépassant l'État classique pour reprendre sur une plus grande échelle le rôle d'un "converteur continental", d'un capteur-dynamiseur de forces réelles diverses, et d'autre part, une mosaïque effervescente de sites réels et repérables dans leur identité que rien ne viendra mutiler ou handicaper. Nous aurions une instance de représentation non surcodante, mais au contraire captatrice, sorte de nouveau Saint-Empire (Heiliges Reich) dynamiseur et généreux, et un tissu de patries charnelles, de sites originaux, de villes, de provinces et de pays typés, qui se regrouperont et se sépareront au gré des forces fluides à l'œuvre partout, à la manière de ces initiatives audacieuses qu'on a vu s'épanouir récemment : les coopérations transrégionales, au-delà des frontières des vieux États, coopérations qui fonctionnent au nom même du site, de la terre que ses contractants occupent, au nom du paysage montagnard qui les unit plus qu'il ne les sépare, au nom du bassin fluvial qui les irrigue, au nom de la mer qui les baigne. Au nom du réel tellurique. Immanent. Immanent de par son extra-philosophicité. De par sa présence vitale. Car l'immanence est vie et rien d'autre, alors que la représentation est toujours vision sans grouillement vital.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies européennes n°27, 1997.
• Sources :
• Friedrich BALKE, « Beschleuniger, Aufhalter, Normalisierer : Drei Figuren der politischen Theorie Carl Schmitts », in F. BALKE, E. MÉCHOULIAN & B. WAGNER, Zeit der Ereignisses – Ende der Geschichte ?, Wilhelm Fink Verlag, München, 1992.
• Friedrich BALKE, Joseph VOGL, « Einleitung : Fluchtlinien der Philosophie », in F. BALKE u. J. VOGL (Hrsg.), Gilles Deleuze – Fluchtlinie der Philosophie, W. Fink Verlag, München, 1996.
• Friedrich BALKE, « Fluchtlinie des Staates : Kafkas Begriff des Politischen », in F. BALKE u. J. VOGL, op. cit., 1996.
• Robert STEUCKERS, « La décision dans l'œuvre de Carl Schmitt », in Vouloir n°3/1995.
• Robert STEUCKERS, « Rudolf Pannwitz : "Mort de la Terre", Imperium Europæum et conservation créatrice », in Nouvelles de Synergies Européennes n°19, 1996.
◘ Regard critique : “Entre territoires et réseaux”
La fin des territoires, effacés par les réseaux, n'a pas eu lieu. En fait, la géographie montre combien les derniers peuvent contribuer à la vitalité des premiers.Depuis les années 1990, le territoire a fait une entrée remarquée en géographie. Tout est devenu territoire. « Chaque jour, l'humanité crée des villes, des routes, des contrées, des paysages, sans oublier du langage, des croyances, des lois…, bref du territoire », souligne ainsi Roger Brunet (Le Développement des territoires, L'Aube, 2004). Le territoire était associé à l'idée d'appropriation du sol, à la localisation d'activités économiques, culturelles, et progressivement à l'idée de région. C'est alors qu'est arrivé Internet, perçu comme un immense défi aux territoires, au point que certains politistes comme Bertrand Badie ont pu prédire leur fin dès 1995 (La Fin des territoires, Fayard, 1995). Les réseaux, fondés sur l'horizontalité des relations, les jeux d'acteurs, les échanges, etc., ont bien semblé remettre en cause les frontières matérielles tenues par la hiérarchie pyramidale des États et des institutions, grands producteurs de territoires. Mais à côté du modèle de territoire figé, qui a prévalu jusque dans les années 1960, d'autres ont émergé, plus souples, moins définitifs, comme celui, individuel, des multiples endroits fréquentés dans la journée par une même personne, ou celui également multiforme de l'entreprise…
Vivre ensemble
Les réseaux de villes européennes ou d'entreprises, les pôles de compétitivité, les districts industriels, etc. sont autant d'exemples de production quotidienne et évolutive de nouveaux territoires. Plus qu'une confrontation entre réseaux et territoires, c'est plutôt un ajustement mutuel que l'on observe. Loin de les opposer, la géographie réunit donc les deux concepts sur un même terrain, celui des rapports de l'individu au collectif. Elle les réunit aussi autour d'une problématique commune, celle du vivre ensemble. Comme le rappelle Jean-Yves Piot, « les géographes se sont saisis précocement de la question à travers la notion "d'habitabilité" de la terre ». Un monde en réseau ne contrarie donc pas forcément l'existence de territoires. « C'est même, déclare R. Brunet, la production de territoires qui fonde la liberté. Elle nous distingue de l'animal qui n'a qu'un seul territoire à défendre contre tout intrus. » Et les réseaux de contribuer à structurer les territoires selon de nouvelles lignes de force qui ont aussi leurs enjeux, par ex. ceux de la gouvernance et du développement.
► B. Richard, Sciences humaines n°167, 2006.

pièces-jointes :
 Hier encore ignorée, quand elle n’était pas caricaturée et vouée aux gémonies, la pensée de Carl Schmitt s’impose peu à peu comme une référence incontournable du droit public et de la politologie. Elle considère la notion de souveraineté comme un des concepts-clés de l’État moderne. Renouant avec la tradition de Machiavel et de Jean Bodin, elle montre la signification profonde du célèbre axiome de Thomas Hobbes : auctoritas non veritas facit legem (c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi). L’une de ses formules les plus connues relie cette notion de souveraineté à l'état d'urgence : "Est souverain celui qui décide lors d’une situation exceptionnelle". De cet esprit de décision émerge la figure du partisan qui se lève quand l'État délaisse le politique et se fige dans une légalité vide de sens profond et de perspective historique. Prenons par ex. Lucius Quinctius Cincinnatus, paysan et dictateur de la Rome antique : les licteurs venus lui remettre les pleins pouvoirs devaient le trouver occupé à labourer lui-même son champ, le bien de la Cité nécessitant autant à œuvrer pour sa terre qu'à défendre les institutions. Si C. Schmitt oppose la "dictature" antique à la "tyrannie" moderne, souvent plus oppressive et parfois déguisée en démocratie, ce serait contresens de voir ce penseur de la Révolution conservatrice acquiescer au folklore du nazisme qui caricature la mobilisation de tout un peuple derrière ses chefs pour la défense de ses valeurs essentielles. Confondant légalité et légitimité, préférant l'exercice de la morale à celui de la puissance politique, les démocraties sont mal protégées contre les formes modernes de tyrannie, qu'elles soient totalitaires ou plus sournoisement économiques ou technocratiques. Dès lors rétablir la souveraineté en appelle à un grand espace européen. L’originalité de la pensée de Schmitt est porteuse d'avenir, elle nous fait comprendre en quoi sans Empire l’Europe ne fait qu’entériner sa sortie de l’histoire. Nous ouvrons ce dossier par l’article de Robert Steuckers et de Guillaume Faye paru dans la revue éléments n°39 (été 1981).
Hier encore ignorée, quand elle n’était pas caricaturée et vouée aux gémonies, la pensée de Carl Schmitt s’impose peu à peu comme une référence incontournable du droit public et de la politologie. Elle considère la notion de souveraineté comme un des concepts-clés de l’État moderne. Renouant avec la tradition de Machiavel et de Jean Bodin, elle montre la signification profonde du célèbre axiome de Thomas Hobbes : auctoritas non veritas facit legem (c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi). L’une de ses formules les plus connues relie cette notion de souveraineté à l'état d'urgence : "Est souverain celui qui décide lors d’une situation exceptionnelle". De cet esprit de décision émerge la figure du partisan qui se lève quand l'État délaisse le politique et se fige dans une légalité vide de sens profond et de perspective historique. Prenons par ex. Lucius Quinctius Cincinnatus, paysan et dictateur de la Rome antique : les licteurs venus lui remettre les pleins pouvoirs devaient le trouver occupé à labourer lui-même son champ, le bien de la Cité nécessitant autant à œuvrer pour sa terre qu'à défendre les institutions. Si C. Schmitt oppose la "dictature" antique à la "tyrannie" moderne, souvent plus oppressive et parfois déguisée en démocratie, ce serait contresens de voir ce penseur de la Révolution conservatrice acquiescer au folklore du nazisme qui caricature la mobilisation de tout un peuple derrière ses chefs pour la défense de ses valeurs essentielles. Confondant légalité et légitimité, préférant l'exercice de la morale à celui de la puissance politique, les démocraties sont mal protégées contre les formes modernes de tyrannie, qu'elles soient totalitaires ou plus sournoisement économiques ou technocratiques. Dès lors rétablir la souveraineté en appelle à un grand espace européen. L’originalité de la pensée de Schmitt est porteuse d'avenir, elle nous fait comprendre en quoi sans Empire l’Europe ne fait qu’entériner sa sortie de l’histoire. Nous ouvrons ce dossier par l’article de Robert Steuckers et de Guillaume Faye paru dans la revue éléments n°39 (été 1981).Suivra un article-hommage de Julien Freund, pudique, probe et fidèle en amitié [éléments n°54-55, été 1985]. On y mesure en quoi le spectacle décadent de Weimar a puissamment contribué à sa vision du politique, la Constitution de 1918 évacuant purement et simplement le politique. On comprend par là en quoi il reconnaissait en De Gaulle l'homme des "situations exceptionnelles" car capable de faire prévaloir les prérogatives du politique. Enfin Freund conclut subtilement par une anecdote faite philosophique : Schmitt, en donnant à sa demeure le nom de la localité où le florentin Machiavel en exil avait écrit Le Prince, rappelait que la sécularisation du politique est corrélative d'une histoire assumée comme destin des hommes.
La leçon de Carl Schmitt
C'est dans son village natal de Plettenberg où il a fait retraite, en Westphalie, que nous avons rencontré Carl Schmitt. Quatre heures d'une étonnante conversation avec celui qui demeure sans doute le plus grand politologue et le plus grand juriste de notre temps : « Nous en sommes maintenant au stade du paître, nous dit Carl Schmitt, nous sommes comme des animaux domestiques qui jouissent des bienfaits du champ clôturé qui leur est attribué. L'espace est conquis. Les frontières sont fixées. Plus rien à découvrir. C'est le règne du statu quo… »
Cet ordre glacé, qui s'étend sur la Terre et qui ruine les souverainetés politiques, a toujours fait l'objet des mises en garde du politologue. Déjà en 1928, dans Der Begriff des Politische, il décèle dans les idéologies universalistes, celles "du Droit, ou de l'Humanité, ou de l'Ordre, ou de la Paix", le projet de transformation de la planète en une sorte d'agrégat économique dépolitisé qu'il compare à un "autobus avec ses voyageurs" ou à un "immeuble avec ses locataires". Et cette vision prémonitoire d'un monde où se meurent les peuples et les cultures, ce n'était pas au marxisme qu'il en attribuait la responsabilité mais aux démocraties libérales et marchandes. C. Schmitt apparaît dès lors comme un des critiques les plus perspicaces et les plus aigus du libéralisme, autrement profond et original que les "antidémocrates" de la vieille droite réactionnaire.
Il apparaît également comme le continuateur du courant d'analyse "réaliste" du politique et de l'État, dans la lignée de Bodin, Hobbes et Machiavel. Aussi éloignées du libéralisme que des théories totalitaires modernes (bolchevisme et fascismes), la profondeur et la modernité de ses vues en font le plus important politologue et juriste constitutionnel contemporain. C'est à ce titre que nous pouvons le suivre, sans nous priver cependant de tenter de dépasser certaines de ses analyses, comme a su le faire d'ailleurs son disciple français Julien Freund, dont l'œuvre, en pleine éclosion (1), tend déjà à surpasser celle de Carl Schmitt.
L'itinéraire intellectuel du politologue rhénan commence par une réflexion sur le droit et sa pratique politique auxquels il consacre 2 ouvrages, en 1912 et en 1914, à la fin de ses études universitaires accomplies à Strasbourg. Après la guerre, devenu juriste aux universités de Berlin et de Bonn, sa réflexion s'oriente vers la politologie. C. Schmitt, en rupture avec les philosophies libérales du Droit, se refuse alors à séparer celui-ci du politique.
Son premier ouvrage de théorie politique, Politische Romantik (1919), est consacré à une critique du romantisme politique qu'il oppose au réalisme. Idéaux millénaristes des communistes révolutionnaires ou rêveries völkisch des réactionnaires lui apparaissent également impropres au gouvernement des peuples. Quant à Die Diktatur, son deuxième grand ouvrage théorique (1921), il constitue, comme l'écrit Julien Freund, "une des études les plus complètes et les plus pertinentes sur cette notion dont l'histoire est analysée depuis l'époque romaine jusqu’à Machiavel et Marx" (2).
C. Schmitt distingue la "dictature" de la "tyrannie" oppressive. La dictature apparaît comme une méthode de gouvernement destinée à faire face aux urgences. Dans l'héritage romain, le dictateur avait pour fonction d'affronter les états d’exception. Mais Machiavel introduit à une pratique différente ; il contribue à envisager "l’État moderne", fondé sur le rationalisme, la technicité et le rôle puissant d'un exécutif complexe : cet exécutif ne s'appuie plus sur le seul souverain. Schmitt montre qu'avec le juriste français Jean Bodin, la dictature prend la forme d'une "praxis des commissaires" qui s'installe aux XVIe et XVIIe siècles. Les "commissaires" sont les délégués omnipotents du pouvoir central. L'absolutisme royal, assis sur les intendants, comme le modèle rousseauiste du contrat social qui délègue le pouvoir absolu aux détenteurs de la "volonté générale" mis en place par la Révolution française, constitue le fondement des formes contemporaines de dictature. Celle-ci ne peut pas, dans cette perspective, s'apparenter à un seul type d'idéologie politique ; contrairement aux analyses des constitutionnalistes actuels, Maurice Duverger not., la "démocratie" n'est, pas plus qu'une autre forme de pouvoir étatique, exempte de l'usage dictatorial. Simplement, elle s'illusionne en se croyant à l'abri du recours à la dictature et en prétendant concilier un pouvoir exécutif réel avec le pragmatisme et les transactions des systèmes parlementaires.
Dans une étude fondamentale sur le parlementarisme (Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Munich-Leipzig, 1923), C. Schmitt tente une réflexion sur l'identification entre démocratie et parlementarisme. La démocratie lui apparaît comme un principe idéologique et abstrait qui masque des modalités particulières de pouvoir ; position proche de celles de Vilfredo Pareto et de Gaetano Mosca. L'exercice du pouvoir en "démocratie" est soumis à une conception rationaliste de l'État qui fonde par ex. l'idée de division des pouvoirs, de dialogue supposé harmonieux entre les partis et de pluralisme idéologique. C'est aussi la rationalité, celle de l'histoire, qui fonde la dictature du prolétariat. À l'opposé du courant démocratique et du parlementarisme, C. Schmitt place les courants "irrationalistes", not. Georges Sorel et sa théorie de la violence, ainsi que tous les critiques non marxistes du bourgeoisisme, Max Weber par ex.
Ce bourgeoisisme libéral illusionne les peuples en envisageant toute activité politique selon les catégories de l'éthique et de l'économie. Illusion commune, d'ailleurs, aux idéologies socialistes libérales ou marxistes : la fonction de la puissance publique n'est plus qu'économique et sociale. Les valeurs spirituelles, historiques, militaires ne sont plus légitimes. Seule est morale l'économie, ce qui permet de valider l'individualisme marchand, et de se réclamer, dans le même temps d'idéaux humanitaires : Bible and business. Cette moralisation de la politique non seulement détruit toute vraie morale mais transforme l'unité politique en "société" neutralisée où la fonction souveraine n'est plus capable de défendre le peuple dont elle a la charge.
À l'inverse, la démarche de C. Schmitt consiste à analyser le phénomène politique indépendamment de tout a priori moral. Il renonce, comme Machiavel et Hobbes, auquel on l'a comparé, à utiliser les bons sentiments et la sotériologie des fins dernières. Sa philosophie s'oppose globalement, et à l'idéologie des Lumières (Locke, Hume, Montesquieu, Rousseau, etc.), et aux divers socialismes marxistes, comme à l'humanisme politique chrétien. Pour lui, ces idéologies se méfient utopiquement du pouvoir et tentent d'évacuer le politique assimilé au Mal, quitte à l'admettre provisoirement - c'est le cas du marxisme.
Mais l'essentiel de la critique de Schmitt porte sur le libéralisme et l'humanisme, accusés d'illusionnisme et d'hypocrisie. Ces théories envisagent l'activité de la puissance publique comme purement gestionnaire tournée vers la réalisation du bonheur individuel et de l'harmonie sociale. Elles tablent sur la disparition du politique en tant que tel et sur la fin de l'histoire. Voulant dédramatiser la vie collective, elles ne parviennent qu'à construire des jungles sociales dominées par l'exploitation économique et incapables de surmonter les aléas. Les gouvernements soumis à ce type de libéralisme voient toujours démentis leurs rêves de transformer la politique en administration pacifique : d'autres États, animés d'intentions hostiles, ou une subversion politique interne, surgissent toujours au moment imprévu. Un État qui renonce, par idéalisme ou par moralisme mal compris, à placer au-dessus de tout sa volonté politique souveraine, lui préférant la rationalité économique ou la défense d'idéaux abstraits, renonce aussi à son indépendance et à sa survie.
C. Schmitt ne croit pas à la disparition de la catégorie politique. Elle peut s'investir dans tout type d'activité. Elle constitue une notion qui relève de l'anthropologie collective. À ce titre, l'activité politique peut être qualifiée de substance. L'État, en revanche, qualifié d'instance, c-à-d. de forme contingente de la souveraineté, peut disparaître ou se dépolitiser sans que le politique - comme substance - ne disparaisse. Mais l'État ne peut se maintenir que s'il conserve le monopole du politique, qui suppose, par ex., qu'il soit le seul à définir les valeurs et les idéaux pour lesquels les citoyens accepteront de donner leur vie ou de tuer légalement leur prochain - cas de la guerre. Sinon des partisans reprendront à leur compte l'activité politique et tenteront de se constituer en nouvelle légitimité. Ce risque menace particulièrement les États bureaucratiques produits par les social-démocraties libérales modernes et où seule l'anémie de la société de consommation évite la guerre civile.
Ces idées sont exprimées dans La notion de politique, le texte le plus fondamental de Carl Schmitt, publié pour la 1ère fois en 1928, remanié en 1932 et éclairé en 1963 par son corollaire la Théorie du partisan. L’activité politique y est définie comme le produit d'une polarisation autour d'une relation d'hostilité. Un des critères fondamentaux d'un acte politique est sa faculté de mobiliser une population en lui désignant un ennemi, ce qui peut concerner un parti comme un État. Omettre une telle désignation, par idéalisme not., c'est renoncer au politique. Le jeu d'un État conséquent sera donc d'éviter que des partisans ne s'arrogent le pouvoir de désigner des ennemis intérieurs à la collectivité, voire même l'État lui-même. En aucun cas, le politique ne peut se fonder sur l'administration des choses ou renoncer à sa dimension polémique. Toute souveraineté, comme toute autorité, est contrainte à désigner un ennemi pour faire aboutir ses projets ; les thèses de C. Schmitt rejoignent là les recherches des éthologues sur le comportement humain inné, Konrad Lorenz not.
Cette conception "classique" et machiavélienne du politique valut à Carl Schmitt les persécutions et les menaces qu'il dut subir de la part des nazis, pour qui le politique était au contraire la désignation du camarade" (Volksgenosse).
La définition schmittienne du politique nous permet de comprendre que le débat politicien contemporain est dépolitisé et s’apparente à un spectacle électoral. Est réellement politique la valeur pour laquelle on est prêt à sacrifier sa vie ; ce peut fort bien être sa langue et sa culture. C. Schmitt écrit à ce propos qu'un "système d’organisation sociale orienté uniquement vers le progrès de la civilisation" ne possède pas "de programme, d'idéal, de norme ou de finalité qui puisse conférer le droit de disposer de la vie physique d'autrui". La société libérale, fondée sur la consommation de masse, ne peut exiger que l'on meure et que l'on tue pour elle. Elle repose sur une forme apolitique de domination : "C'est précisément quand elle demeure apolitique, écrit C. Schmitt, qu'une domination des hommes reposant sur une base économique, en évitant toute apparence et toute responsabilité politique, se révèle être une terrible imposture".
L'économisme et le "pluralisme" des libéraux masquent l'incurie de l'État, la domination des castes marchandes et la destruction des peuples ancrés dans une culture et une histoire. En accord avec Sorel, C. Schmitt plaide pour une forme de pouvoir qui ne renonce pas à son plein exercice, qui manifeste son autorité politique avec les moyens normaux qui y sont afférents, la puissance, la contrainte et, dans les cas exceptionnels, la violence. C'est pour avoir méconnu ces principes que la République de Weimar a laissé s'installer Hitler ; c'est également sur un rejet idéologique de l'idée de puissance étatique que s'appuient les totalitarismes techno-économiques du capitalisme moderne, incontournables parce que proclamés humanitaires et fondés sur la double idée de pluralisme et d'individualisme sociaux qui mettent les nations à la merci des dominations technocratiques.
La critique schmittienne du pluralisme interne, au sens où Montesquieu, Locke, Laski, Cole et toute l'école libérale anglo-saxonne l'ont conçu, a pour objet de défendre l'unité politique des nations, seule garante de la protection civique et des libertés. Le pluralisme interne débouche sur la guerre civile larvée ou réelle, le corporatisme sauvage des groupes et des factions d’intérêts économiques et au final réintroduit à l'intérieur de la société la distinction ami-ennemi que les États européens avaient su, depuis Bodin et Hobbes, reporter à l'extérieur.
Un tel système se réclame naturellement, pour se débarrasser des unités politiques, de l'idée d'Humanité. « L'Humanité n'est pas un concept politique » écrit C. Schmitt qui ajoute :
« L'Humanité des doctrines fondées sur le Droit naturel, libérales et individualistes, est une construction sociale idéale de caractère universel, c-à-d. englobant tous les hommes de la terre (…), qui ne sera pas réalisée avant que ne soit éliminée l'éventualité effective du combat et que soit rendu impossible tout regroupement en amis et ennemis. Cette société universelle ne connaîtrait plus de peuples (…) Le concept d'Humanité est un instrument idéologique particulièrement utile aux expansions impérialistes, et sous sa forme éthique et humanitaire, il est un véhicule spécifique de l'impérialisme économique (…) Étant donné qu'un nom aussi sublime entraîne certaines conséquences pour celui qui le porte, le fait de s'attribuer ce nom d'Humanité, de l'invoquer et de le monopoliser, se saurait que manifester une prétention effrayante à faire refuser à l'ennemi sa qualité d’être humain, à la faire déclarer hors la loi et hors l'Humanité et partant à pousser la guerre jusqu'aux limites extrêmes de l'humain ».
Définir le politique sous la catégorie de l'ennemi, refuser l'égalitarisme humanitaire n'aboutit absolument pas au mépris de l'homme ou au racisme. Bien au contraire. Reconnaître la dimension polémique des rapports humains et l'homme comme "un être dynamique et risqué", c'est garantir le respect de tout adversaire conçu comme l'Autre dont la cause n'est pas moins légitime que la sienne propre.
Cette idée revient souvent dans la pensée de C. Schmitt : les idéologies modernes qui prétendent détenir une vérité universelle et qui, de ce fait, envisagent l'ennemi comme absolu, comme une "non-valeur absolue", débouchent sur des génocides. Elles sont toutes d'ailleurs inspirées du monothéisme : chrétien, lui aussi pacifiste et prosélyte. C. Schmitt soutient avec raison la conception européenne classique qui validait l'existence de l'ennemi et qui admettait la légitimité de la guerre — non pour la défense d'une cause "juste" mais comme nécessité éternelle des rapports humains — provoquait moins de guerres et induisait un respect de l'ennemi envisagé comme adversaire (comme hostis et non comme inimicus).
Les successeurs de C. Schmitt, précisant et prolongeant sa pensée, ont forgé avec Rüdiger Altmann la notion d'Ernstfall (cas d'urgence), qui constitue un autre critère fondamental du politique. La souveraineté politique ou la crédibilité d'une nouvelle instance politique se fondent sur leur capacité à affronter et à résoudre les cas d'urgence. Les idéologies politiques dominantes, toutes pénétrées d'hédonisme et volontiers sécurisantes, veulent ignorer d'urgence, le coup du sort, l'aléa. Le politique digne de ce nom - et cette idée pulvérise les catégories idéologiques et abstraites de "droite" et de "gauche" - est celui qui, secrètement, répond au défi du cas d'urgence, tire la collectivité du mauvais pas imprévu ou de la tempête et par-là autorise une mobilisation totale du peuple et une intensification de ses valeurs. Les conceptions libérales du politique ne voient dans l'Ernstfall que l'exception, et dans la "normalité juridique", la règle. Cette vision des choses, inspirées de la philosophie téléologique de l’histoire de Hegel, correspond à la domination de la bourgeoisie qui place la sécurité avant le dynamisme historique et le destin du peuple. Selon C. Schmitt, au contraire, la fonction du souverain est sa capacité de décider de l'état d'exception, qui ne constitue nullement une anomalie mais une éventualité permanente. Cet aspect de la pensée de C. Schmitt traduit ses inspirations essentiellement françaises et espagnoles (Bonald, Donoso Cortès, Bodin, Maistre, etc.) et permet de le situer, à égalité avec Machiavel, dans la lignée de la grande école latine des sciences politiques.
Dans Legalität und Legitimität (1932), C. Schmitt, en disciple de Hobbes, invite à considérer que la légitimité prime la notion abstraite de légalité. Est légitime un pouvoir qui peut protéger par la force la collectivité dont il a la charge. La conception idéaliste et "juridiste" de la légalité, déplore C. Schmitt, a, par ex., autorisé Hitler à parvenir au pouvoir. Le légalisme débouche sur le renoncement à la puissance, ce que C. Schmitt appelle la "politique de la non-politique" (Politik des Unpolitischen), celle qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne formule pas de choix concernant le destin collectif. "Celui qui ne possède pas la puissance de protéger quelqu'un, écrit C. Schmitt dans La Notion de politique, n'a pas non plus le droit d'exiger l'obéissance. Et inversement, celui qui cherche et accepte la puissance n'a pas le droit de refuser l'obéissance".
Cette dialectique de la puissance et de l'obéissance est refusée par les tenants du dualisme social, qui opposent arbitrairement la société et la fonction souveraine en s'imaginant, contre toute expérience, que l'exploitation et la domination sont le fait politique du "pouvoir" alors qu'elles ressortissent beaucoup plus fréquemment aux féodalités économiques.
C. Schmitt élabore ainsi une critique de l’État dualiste du XIXe siècle fondé sur les conceptions de John Locke et de Montesquieu visant à une séparation entre la sphère de l'État et la sphère privée. De fait, les technocraties modernes, historiquement issues des institutions de représentativité parlementaire, connaissent des interpénétrations et des oppositions entre le privé et le public, comme l'a montré Jürgen Habermas. Une telle situation déstabilise l'individu et affaiblit l'État. C'est cette faiblesse des démocraties qui permit, selon C. Schmitt, l'établissement des régimes à parti unique, comme il l'explique dans Staat, Bewegung, Volk (3). Ce type de régime constitue la révolution institutionnelle du XXe s. ; de fait, c'est aujourd'hui celui qui est le plus répandu dans le monde. Seule l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord ont conservé la structure pluraliste de la démocratie traditionnelle, maintenue d'ailleurs comme une fiction, puisque le véritable pouvoir est économique et technique. L'État à parti unique tente de reconstituer l'unité politique de la nation, selon une triple structure : l'État proprement dit regroupe les fonctionnaires et l'armée ; le Peuple n'est pas une population statistique mais une entité politisée et fortement organisée en institutions intermédiaires ; Le Parti met cet ensemble en mouvement (Bewegung) et constitue un sas de communication entre l'État et le Peuple.
C. Schmitt, qui renvoie dos à dos nazisme, stalinisme, théocraties et totalitarismes humanitaires, n'avalise évidemment pas les régimes de parti unique. Il ne prône pas de "régime" particulier. Ce qu'il demande, c'est, selon la vieille tradition réaliste latine héritée de Rome, un exécutif puissant et légitime, qui n'"idéologise" pas l'ennemi et puisse, dans les cas réels, faire usage de la force, qui sache faire de l'État "l'auto-organisation de la société".
La guerre devient alors objet d'étude pour le politologue. Esprit universel, C. Schmitt s'intéresse ainsi à la géopolitique comme prolongement naturel de la politique. La vraie, la grande politique, pour lui, c'est la politique extérieure, qui trouve son aboutissement dans la diplomatie. Dans Der Nomos der Erde (1951), il montre que l'État répond à la conception européenne de la politique depuis le XVIe s. Or l'Europe est entrée en décadence : l'État bureaucratique se dépolitise et ne permet plus le maintien dans l'histoire des peuples européens ; le jus publicium europaeum qui déterminait les relations inter-étatiques décline au profit d'idéologies mondialistes et pacifistes incapables de fonder un droit international efficace. L'idéologie des droits de l'homme et l'humanitarisme affiché des institutions internationales préparent paradoxalement un monde où la force prime le droit. À l'inverse, une conception réaliste des rapports inter-étatiques, qui admet et norme le conflit, qui reconnaît la légitimité des volontés de puissance, tend à civiliser les rapports entre les nations.
C. Schmitt est, avec Mao-Tsé-Toung, le meilleur théoricien moderne de la guerre révolutionnaire et de la figure énigmatique du partisan qui, en cette ère de dépolitisation des États, reprend à son compte le politique, désigne "illégalement" ses ennemis et fait s'estomper la distinction entre guerre et paix (4).
Un tel "faux pacifisme" est bien celui d'un monde où les instances politiques et les souverainetés indépendantes s'effacent devant une civilisation mondiale plus aliénante que toutes les tyrannies. C. Schmitt, qui influença les rédacteurs de la constitution de la Ve République, la plus intelligente, la plus politique et la moins inspirée de l'idéalisme des Lumières que la France ait connue, nous délivre ce message : la Liberté, l'Humanité, la Paix ne sont que des chimères qui préparent d’invisibles oppressions. Seules comptent les libertés, celles des peuples ou des individus : elles ne peuvent être garanties que par la force légitime d'une instance politique qui s'érige en règle et fonde le droit.
Il manque évidemment à Carl Schmitt de définir pour quelles valeurs le politique mobilise et légitime sa désignation de l'ennemi. Ces valeurs doivent être, non pas des idéologies, toujours abstraites et lourdes de totalitarisme, mais des mythologies. C'est en ce sens que la fonction gouvernementale, purement politique, ne suffit pas. Il faut lui adjoindre sa dimension "religieuse" de première fonction, telle qu'elle se trouve définie dans la tripartition indo-européenne. Telle nous paraît être la voie selon laquelle il faudrait compléter la politologie de Carl Schmitt. Car si celui-ci bâtit un pont entre l'anthropologie et le politique, il reste à en constituer un autre entre le politique et l'histoire.
► Robert Steuckers & Guillaume Faye, éléments n°39, 1981.
• Notes :
- Cf. J. Freund, L'Essence du politique, Sirey, 1965, et La Fin de la Renaissance, PUF, 1980.
- Dans sa préface à La notion de politique, Calmann-Lévy, 1972.
- Il s'agit d'une série d'études sur les régimes à parti unique, marxistes not., parue en 1932.
- Cf. L'Ère des neutralisations, texte publié en 1972 chez Calmann-Lévy dans le même ouvrage que La notion de politique et Théorie du partisan.
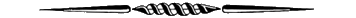
Mon ami Carl Schmitt
 Carl Schmitt est mort cette année, le jour de Pâques, à quelques semaines de son 97ème anniversaire. Depuis 1946 il vivait retiré dans son bourg natal de Plettenberg (Sauerland), d'abord dans la maison paternelle occupée par sa sœur, puis dans un petit hameau tout proche, à Pasel, sous la surveillance attentive et affectueuse de sa gouvernante, Mlle Anny. Par ses origines il fut cependant un Mosellan, de la région de Trêves. Une partie de sa famille était française. Il me parlait souvent de sa tante, Mme Soissong de Sarrebourg, qui tenait un café à quelques 50 mètres de l'endroit où j'ai passé quelques années de mon enfance. Évidemment, j'ignorais alors jusqu'au nom de Schmitt, mais j'ai encore souvenir de cette tante qui arrangeait les fins de mois de son neveu lorsqu'il fut étudiant à l'Université de Strasbourg. Un de ses cousins, qui l'a conduit en voiture un jour jusque chez moi à Villé, était notaire à Vic-sur-Seille, aux confins des départements de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle. On ne saurait donc s'étonner si C. Schmitt possédait de façon remarquable le français et n'ignorait rien de notre littérature.
Carl Schmitt est mort cette année, le jour de Pâques, à quelques semaines de son 97ème anniversaire. Depuis 1946 il vivait retiré dans son bourg natal de Plettenberg (Sauerland), d'abord dans la maison paternelle occupée par sa sœur, puis dans un petit hameau tout proche, à Pasel, sous la surveillance attentive et affectueuse de sa gouvernante, Mlle Anny. Par ses origines il fut cependant un Mosellan, de la région de Trêves. Une partie de sa famille était française. Il me parlait souvent de sa tante, Mme Soissong de Sarrebourg, qui tenait un café à quelques 50 mètres de l'endroit où j'ai passé quelques années de mon enfance. Évidemment, j'ignorais alors jusqu'au nom de Schmitt, mais j'ai encore souvenir de cette tante qui arrangeait les fins de mois de son neveu lorsqu'il fut étudiant à l'Université de Strasbourg. Un de ses cousins, qui l'a conduit en voiture un jour jusque chez moi à Villé, était notaire à Vic-sur-Seille, aux confins des départements de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle. On ne saurait donc s'étonner si C. Schmitt possédait de façon remarquable le français et n'ignorait rien de notre littérature.Je voudrais rappeler qu'il fut lié un certain temps avec Capitant, Maritain, F. Perroux et d'autres. Dînant un soir à Kolbsheim, près de Strasbourg, en compagnie de N. Sombart et de J.P. Faye, il a refusé de rencontrer Maritain qui se promenait à quelques 30 mètres de nous. Par discrétion, je ne l'ai jamais interrogé sur ce refus.
La correspondance que j'ai échangée avec lui comporte une masse importante de lettres que je n'ai pas encore dénombrées. La grande majorité est écrite en français car il mettait son point d'honneur à me répondre dans ma langue. Très dense pendant de longues années, cette correspondance est devenue plus mince depuis quelque temps. Lors de mon dernier séjour à Plettenberg, il m'avait averti qu'il ne répondrait plus que parcimonieusement aux lettres de ses amis, mais il me priait en même temps de continuer à lui écrire de temps à autre, même s'il ne donnait pas de réponse. C'est ce que j'ai fait. Néanmoins, l'une ou l'autre fois, il m'a fait le plaisir de m'adresser un court billet. Le grand âge l'incitait sans doute à se retirer davantage sur lui-même.
C. Schmitt a été mis d'office à la retraite en 1946, au lendemain de la défaite allemande. Il avait enseigné auparavant aux universités de Greifswald, de Bonn et de Berlin. Tout donne à penser que la mesure prise à son encontre fut extrêmement injuste, parce qu'elle fut inspirée par l'idéologie dominante à cette époque. Je rêve parfois aux décombres que laissera notre siècle d'intellectualisation idéologique, qui le caractérise jusque dans ses lubies. Passons ! C. Schmitt avait refusé de répondre, tout comme von Salomon, au questionnaire de dénazification, que lui avait soumis son collègue de l'Université de Berlin, Ed. Spranger, philosophe et (déjà) spécialiste en pédagogie. Spranger avait accepté cette tâche, alors qu'il connaissait bien C. Schmitt dans l'intimité, puisqu'ils se rencontraient souvent du fait qu'ils habitaient à proximité. Notre ignorance de ce qui se passait alors en Allemagne est telle que nous justifions l’injustifiable et honorons le moins honorable.
C. Schmitt a exposé sa position dans un petit ouvrage, Ex captivitate Salus, qui fait ainsi allusion à son internement au lendemain de la défaite de l'Allemagne. Ce que Spranger lui demandait, c'était de se "déculotter", de devenir transparent aux yeux de Spranger, qui l'était moins que tout autre. Spranger le sollicitait de répondre à la question : qui es-tu ? Voici la réponse de Schmitt : "Je regardais mon interrogateur dans les yeux et me disais : qui es-tu donc toi qui m'interroges, toi qui me mets en cause ? D’où vient ta supériorité ? Quelle est la nature de la puissance qui te donne pouvoir et t'encourage à me poser cette question ?" Tout aussi significatif est le commentaire que Schmitt a ajouté : "Mon être peut ne pas être transparent, néanmoins je suis sur la défensive. Je suis un homme de contemplation et j'ai tendance à formuler les choses de façon tranchante, mais non en vue de l'offensive, ni même de la contre-offensive. Mon être est fait de lenteur, d’absence de tumultes et de souci de la conciliation, tout comme un fleuve tranquille, à la manière de la Moselle, tacito rumore Mosella".
Ce texte me semble typique de l’orientation de C. Schmitt. Il n'avait pas le goût de procureur d'un quelconque "J'accuse" mais il n'était pas non plus l'homme de la résignation intellectuelle. Il fut le théoricien de la situation exceptionnelle, qui pose politiquement la validité du droit et que, peut-être pour cette raison, les juristes négligent. Son problème fut de comprendre les chances qu'un tel état de fait, qui échappe à la juridiction ordinaire, peut révéler pour le développement de l'ordre social concret. "Je ne suis pas un Prométhée révolutionnaire, me disait-il, mais un Epiméthée conscient des folies et des contraintes humaines". On comprend dès lors son intérêt pour Hobbes. Ce souci de découvrir les éléments positifs d'une situation exceptionnelle lui fut personnellement fatal, parce qu'on le présenta, durant les années 1934-35, comme le Kronjurist (le juriste par excellence) du nazisme. Il vaut la peine de parler de cette période.
Schmitt fut un adversaire de la Constitution de Weimar, dont il me disait qu'elle était juridiquement parfaite, à cette réserve essentielle prés qu'elle avait évacué le politique. Or une constitution est d'abord un acte politique et non juridique, les juristes ayant pour tâche de l'interpréter une fois qu'elle est adoptée. Un État de droit demeure un État politique, il n'est pas un simple organisme juridique". On comprend dans ces conditions l'admiration qu'il portait au général de Gaulle, qui a su marquer l'aspect politique de la Constitution de la Ve République par l'introduction de l’article 16. Il fut également l'un des avocats au procès de Leipzig, en 1932, contre Gœring et l'État de Prusse, l'année suivante le conseiller politique du dernier chancelier avant Hitler, le général von Schleicher. Il serait trop long d'exposer ici les tribulations qui lui valurent une solide inimitié de la part des centristes qui négociaient secrètement avec Hitler.
C'est en 1934 que se situe le moment qui valut à Schmitt la réputation de juriste du nazisme. Au lendemain de la Nuit des Longs Couteaux, il publiait l'article tant controversé : Der Führer schützt das Recht (le Führer protège le droit). Fidèle à sa conception, Schmitt estimait que, en liquidant des chefs de son propre parti, Hitler choisirait l'État contre le parti et mettrait fin à la situation exceptionnelle par l'instauration d'un état juridique normal et la collaboration avec l'armée et l'administration régulière. Ce fut, de la part de Schmitt, une erreur de calcul qui lui valut une double compromission : d'une part aux yeux des opposants du régime nazi, d'autre part aux yeux des nazis mêmes, qui le lui firent savoir très rapidement, en 1936, par un violent article, menaçant pour sa personne, paru dans te journal des S.S., Schwarze Korps. À partir de cette date, il se réfugia dans le silence, s'adonnant uniquement à son activité de professeur et de chercheur.
Il était juriste d'origine et c'est à cette discipline qu'il a consacré ses premiers ouvrages. Très rapidement cependant il étendit le champ de sa réflexion. Tout d'abord à la littérature et à l'art, par ex. avec ses Schattenrisse (1913), puis à la politique et à la philosophie. Rappelons les ouvrages essentiels dans ces ordres : Politische Romantik (1919), Die Diktatur (1921), Politische Theologie (1922), Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff (1938). Il ne négligeait pas pour autant le travail juridique : Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (1934) et Verfassungslehre (1928). Une fois à la retraite il se préoccupa toujours davantage de philosophie, de théologie, mais surtout du problème de l’ordre mondial, amorcé dans Land und Meer (1942). Parmi les principaux écrits il faut citer : Der Nomos der Erde (1950), Die Tyrannei der Werte (1960), Politische Theologie II (1970) et Theorie des Partisanen (1963). Il est difficile de retracer ici la variété de ses préoccupations, ainsi que le montrent ses articles sur Machiavel, Don Quichotte, Descartes, J.J. Rousseau, Tocqueville, D. Cortès, F. Blei, etc. P. Tommissen a établi sa bibliographie dans Festschrifft für C. Schmitt (1959), Epirrhosis II (1968) et Miroir de C. Schmitt (1978).
Quelle place occupe-t-il dans la pensée ? Si l'on fait abstraction des écrivains qui savent s'adapter au goût du jour, les autres sont de 2 types. Les premiers sont des auteurs qui dérangent, sans cependant effaroucher, de sorte que, malgré un refus plus ou moins long de les écouter, ils arrivent à la longue, comme R. Aron, à briser la résistance. Il s'agit en général d'auteurs qui donnent une réponse différente de celle qu'on aime entendre à une période donnée. Il en est d'autres comme Machiavel qui déroutent et même effraient, parce qu'ils déplacent la question, de sorte qu'ils suscitent un malaise, voire l'inquiétude, à la fois par la réponse et par la question. Ils deviennent des écrivains maudits, ou du moins on essaie de les frapper d'ostracisme, à défaut de pouvoir exorciser leur pensée. C. Schmitt appartient à cette dernière catégorie. Il en avait conscience. En effet, n'a-t-il pas donné à la maison qu'il habitait à Pasel le nom de San Casciano, en souvenir de la localité où Machiavel fut exilé et où il a écrit Le Prince et les Discorsi ? Ce type d'auteurs ne tourmente pas seulement de leur vivant mais ils demeurent les trublions de l'histoire de la pensée.
► Julien Freund, éléments n°54-55, 1985.
---------------------------------------
Actualité de Carl Schmitt
Armée prussienne à la fin du XIXe siècle. De la fin du Moyen Âge à l'époque moderne, la belligérance fut limitée par la non-criminalisation de l'ennemi.
 La réception de l'œuvre de Carl Schmitt (1888-1985) en France vient de prendre une nouvelle ampleur avec la parution quasi simultanée de La Dictature (1ère édition allemande, 1921) et du Nomos de la Terre (1ère édition allemande, 1950) (…) Le personnage, quelque controversé qu'il fût, apparaît ainsi dans toute son envergure intellectuelle : tour à tour ou à la fois constitutionaliste, théologien politique, philosophe du droit, théoricien du politique, de l'État et de la guerre, analyste géopolitique. (…)
La réception de l'œuvre de Carl Schmitt (1888-1985) en France vient de prendre une nouvelle ampleur avec la parution quasi simultanée de La Dictature (1ère édition allemande, 1921) et du Nomos de la Terre (1ère édition allemande, 1950) (…) Le personnage, quelque controversé qu'il fût, apparaît ainsi dans toute son envergure intellectuelle : tour à tour ou à la fois constitutionaliste, théologien politique, philosophe du droit, théoricien du politique, de l'État et de la guerre, analyste géopolitique. (…)Comme l'indique leur intitulé fort dissemblable, La Dictature et Le Nomos de la Terre sont des ouvrages très différents, l'un centré sur l'évolution des pouvoirs extraordinaires de l'État, l'autre sur l'histoire du droit des gens européen. Pour fortuite qu'elle soit, leur sortie au même moment s'avère extrêmement intéressante, car elle révèle à la fois le champ d'étude du publiciste [au sens de spécialiste de droit public] allemand et la singularité de son itinéraire personnel, en pleine « Guerre de trente ans » du XXe siècle (1914-1945).
La dictature est le premier livre de droit constitutionnel publié par Schmitt, alors jeune professeur en pleine ascension. Il fait suite à deux articles de 1916 consacrés à l'état de siège ; il précède la Théologie politique de 1922, ainsi que « La dictature du président du Reich d'après l'article 48 de la constitution de Weimar » (opuscule publié en 1924 à l'issue du congrès de l'Association Allemande des professeurs de droit public, qui figure en appendice de la présente traduction française).
Le Nomos de la Terre est le dernier livre de droit international publié par Schmitt, alors professeur mis à la retraite anticipée après avoir été arrêté (en 1945) et interrogé à Nuremberg (en 1947). Il fait suite aux ouvrages des années 1938-1942 consacrés au droit de la guerre, au « grand espace » et à l'opposition terre-mer ; il précède l'approfondissement de la réflexion sur le nomos menée tout au long de la décennie 1950.
Un même objet d'étude : la généalogie de l'État
Ouvrages très différents par leur contenu, La Dictature et Le Nomos de la Terre ont néanmoins des points communs essentiels. Ils sont tous deux rédigés dans un contexte « catastrophique » : après deux défaites militaires et après la fondation de 2 Républiques, celle de Weimar puis de Bonn, la première issue d'une révolution intérieure, la seconde, d'une occupation internationale. Par rapport au « pessimisme » du Nomos de la Terre, qui correspond à l'écrasement de l'Allemagne et à l'assujettissement de l'Europe, toutes deux écartelées entre l'Est et l'Ouest, La Dictature apparaît plus « optimiste » : le fameux article 48 de la Constitution weimarienne, qui donne au président du Reich les pleins pouvoirs, not. celui de requérir l'armée, permettait à l'Allemagne en proie à la guerre civile larvée de vaincre la menace révolutionnaire, d'en finir avec le régime des partis et de retrouver sa puissance. Les 2 ouvrages sont également caractérisés par la même érudition historiographique et philosophique, et par une très grande culture juridique. Enfin et surtout, on y retrouve la même perspective de l'« exception » - la crise derrière La Dictature, la guerre derrière Le Nomos de la Terre - et, sous cet angle, le même objet d'étude : la généalogie de l'État, en tant que forme moderne d'unité politique en Europe.
Le livre de 1921 ne fait pas que retracer l'histoire de la dictature, en tant que concept de droit public, de Machiavel à Marx, en passant par Clapmar, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu et Rousseau, de la monarchie absolue à la Constitution de Weimar en passant par la Révolution française et la Restauration. Il ne se borne pas non plus à suggérer que la dictature présidentielle ou militaire est la solution à la crise révolutionnaire de l'Allemagne. Il dévoile la genèse et la formation de l'État. Le livre de 1950, lui, ne fait pas que retracer l'histoire du droit des gens classique, en tant que droit géopolitique, de Vitoria à Hegel, en passant par Ayala, Gentili, Grotius, Zouch, Vattel et Kant, de la conquête du Nouveau Monde et des guerres de religion jusqu'au diktat de Versailles et au tribunal de Nuremberg, en passant par le traité de Westphalie (1648), le congrès de Vienne (1815) et la conférence de Berlin (1885). Il ne se borne pas non plus à critiquer l'évolution universaliste et discriminatoire du droit international et du droit de la guerre. Il dévoile la trajectoire et le déclin de l'État du jus publicum europaeum.
La traduction française de Die Diktatur contient les préfaces de l'auteur aux éditions de 1927, 1963 et 1978. Il y est à chaque fois question de la situation d'exception en droit, depuis l'état de siège classique, policier et militaire, jusqu'à l'état d'urgence financier, économique et social. Le publiciste confirme ainsi que le thème de la dictature relève de sa « méthodologie de l'exception », révélatrice du fond des choses. « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle », écrira-t-il en 1921. « Celui qui maîtrise l'état d'exception a la maîtrise de l'État », écrit-il en 1922. L'exception renvoie à la décision et celle-ci, à la dictature, en tant que forme exceptionnelle de décision dérogeant aux règles.
La Dictature est l'ouvrage « décisionniste » par excellence. Schmitt s'y révèle un expert du « droit d'exception ». Il donne à cet égard une véritable leçon d'histoire des institutions, de philosophie politique et de droit constitutionnel comparé. Il montre not. l'étendue de sa connaissance de l'histoire révolutionnaire française, de 1789 à 1848, époque où justement les « pouvoirs exceptionnels » furent à la fois l'instrument et l'enjeu des luttes. Il rappelle ainsi que toute Constitution contient des modalités d'exception car, en cas d'urgence, aucun État ne saurait s'en passer. Précisément, il fera l'exégèse de l'article 48 de la Constitution de Weimar, en 1924. À travers cet article, le président du Reich exerce une « dictature commissariale » : il détient une charge extraordinaire — sauvegarder l'ordre constitutionnel en situation de péril — et il dispose à cette fin d'une habilitation discrétionnaire pour mettre en œuvre des compétences extraordinaires : dérogations aux lois et suspension des droits fondamentaux. Plus largement, Schmitt voit dans les « pouvoirs d'exception » à la fois l'origine et l'essence de l'État moderne. Il part de la guerre et de l'armée, concrètement de l'action des commissaires princiers chargés de l'action militaire, pour retracer la généalogie de l'État.
Après Otto Hinze, Charles Tilly dira en historien ce que Carl Schmitt dit en juriste : l'édification de l'État a commencé par la création d'armées permanentes financées par l'impôt ; ce type d'armée étant supérieur aux autres, les États, en concurrence, durent les uns après les autres envisager leur réorganisation militaire ; pour réussir cette réorganisation, ils passèrent du gouvernement indirect au gouvernement direct. Auparavant, les souverains s'appuyaient sur des autorités intermédiaires dotées d'une large autonomie : l'aristocratie, les parlements des provinces, les conseils municipaux des villes, les corps de métiers, l'Église. Dorénavant, ils s'attachèrent à créer des appareils d'État leur permettant de gouverner directement, non sans conflits avec les anciens pouvoirs nobiliaires, municipaux, corporatifs ou ecclésiastiques. Ces conflits, ils les tranchèrent en usant de leur pouvoir d'exception, c'est-à-dire de leur droit de déroger aux droits. À cet égard, la page 84 de La Dictature est remarquable. Elle contient tout ce que développera l'historiographie de l'État, de la guerre et de l'armée : l' « historiographie de l'exception », qui considère le conflit comme la perspective déterminante pour comprendre la politique ou le droit (1).
La mission des commissaires princiers était de s'occuper de l'équipement et de l'approvisionnement de l'armée. Pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs, il fallut étendre leurs compétences à l'administration fiscale, parce que l'entretien de l'armée dépendait du recouvrement des impôts. Pour pouvoir parvenir à ce résultat, il fallait augmenter le potentiel fiscal du pays, donc développer l'activité économique, ce qui impliquait d'améliorer l'administration intérieure. L'accroissement des pouvoirs de l'appareil d'État se heurtait aux « droits acquis » des ordres, des provinces, des corps ; aussi ne put-il s'imposer que par le recours à une « légalité d'exception » dérogeant aux droits existants. C'est en ce sens que l'histoire de la dictature est parallèle à celle de l'État, car c'est à travers le droit d'exception que l'État moderne s'est édifié, ou plus précisément que l'ancien ordre médiéval, avec sa hiérarchie d'ordres et de charges, a été aboli par le nouvel État monarchique, s'appuyant sur ses commissaires qui devinrent ses fonctionnaires. Contre la puissance de l'État se dressèrent les monarchomaques hier, les libéraux aujourd'hui.
Du destin de l'Empire au destin de l'Allemagne
 Pour illustrer le passage du Moyen Âge à la modernité, Schmitt prend l'exemple de la reformatio de l'Église au XIVe siècle. Il se livre à une longue analyse de la lutte entre le pape, appuyé sur ses légats, et les conciles, la victoire pontificale imposant à l'institution ecclésiale un caractère monarchique. À cette « théologie politique » - l'analogie systématique entre l'État et l'Église - succède l'analyse juridique de la construction historique de l'armée moderne. Plus précisément, Schmitt s'intéresse aux tentatives d'instaurer une armée impériale qui aurait pu servir à transformer le vieil empire germanique en État national. Il entame une longue digression sur Wallenstein [1583-1634, ci-contre], qu'il a toujours admiré car il voyait en lui le chef militaire qui aurait réalisé l'unité nationale allemande. Au lendemain de la guerre de 14-18, cette digression est l'occasion pour Schmitt de développer un parallèle implicite entre la situation de Wallenstein durant la guerre de Trente ans et celle de l'état-major durant la Première Guerre mondiale.
Pour illustrer le passage du Moyen Âge à la modernité, Schmitt prend l'exemple de la reformatio de l'Église au XIVe siècle. Il se livre à une longue analyse de la lutte entre le pape, appuyé sur ses légats, et les conciles, la victoire pontificale imposant à l'institution ecclésiale un caractère monarchique. À cette « théologie politique » - l'analogie systématique entre l'État et l'Église - succède l'analyse juridique de la construction historique de l'armée moderne. Plus précisément, Schmitt s'intéresse aux tentatives d'instaurer une armée impériale qui aurait pu servir à transformer le vieil empire germanique en État national. Il entame une longue digression sur Wallenstein [1583-1634, ci-contre], qu'il a toujours admiré car il voyait en lui le chef militaire qui aurait réalisé l'unité nationale allemande. Au lendemain de la guerre de 14-18, cette digression est l'occasion pour Schmitt de développer un parallèle implicite entre la situation de Wallenstein durant la guerre de Trente ans et celle de l'état-major durant la Première Guerre mondiale.Schmitt fut le « Kronjurist » de la Reichswehr : c'est ainsi que l'on peut résumer sa biographie politique et intellectuelle. La Dictature le confirme. Évoquer le destin de l'Empire, de l'empereur Ferdinand ou de Wallenstein, est pour lui une façon déguisée de parler du destin de l'Allemagne, du Kaiser Guillaume II ou de Hindenburg-Ludendorff. Wallenstein ne fut pas dictateur car l'empereur Ferdinand ne lui donna pas des pouvoirs discrétionnaires pour suspendre des droits qui auraient pu faire obstacle à sa mission militaire. En invoquant la situation exceptionnelle, Ferdinand aurait pu essayer de transformer le simulacrum potestatis en plenitudo potestatis, de retrouver la puissance impériale minée par la « confédéralisation » de l'Empire ; c'est précisément ce qu'il ne fit pas. L'empereur « n'a pas osé profiter de la situation de guerre pour étendre son pouvoir politique » face aux princes électeurs et à la Diète ; disparut alors « l'ultime possibilité de créer un pouvoir central fort grâce à l'état d'exception ». Existait bien la pratique consistant à prélever des contributions ou à opérer des confiscations pour la conduite de la guerre. Cette dernière présentait une « extensibilité illimitée », puisqu'elle englobait non seulement la direction stratégique et tactique des opérations, mais aussi tout ce qui avait trait à l'entretien et au moral des troupes. Avec l'extension du cadre de l'action militaire, c'est finalement l'État tout entier qui pouvait être mis au service de la fin militaire. Le parallèle avec la situation de 14-18 est patent (2).
Après la généalogie de l'État, qui voit le jus dominationis du souverain s'imposer aux « droits acquis » des ordres et des corps, Carl Schmitt passe à la généalogie de la révolution, qui voit le « pouvoir constituant » du peuple s'imposer à la plenitudo potestatis du monarque. La « dictature commissariale » et la « dictature souveraine » — les 2 formes que le publiciste distingue fondamentalement — prennent alors leur sens contemporain. La première, contre-révolutionnaire, fait face à une situation exceptionnelle en vue de restaurer la Constitution, provisoirement suspendue ; son titulaire tient son pouvoir d'une habilitation constitutionnelle (exemple du président du Reich muni de l'article 48). La seconde, révolutionnaire, crée une situation exceptionnelle en vue d'instaurer une Constitution nouvelle ; son titulaire tient son pouvoir d'une auto-proclamation constituante (exemple de l'Assemblée nationale constituante de Weimar). La dictature commissariale est la dictature absolue du pouvoir constitué, lié à des règles et à des formes ; la dictature souveraine est la commission absolue d'un pouvoir constituant, jure solutus.
Quand l'idée libertaire justifie la dictature
De la philosophie des Lumières à la Révolution française, en passant par Rousseau, apparaît donc la dictature souveraine, dont le dernier avatar est la « dictature du prolétariat » de Marx à Lénine. Le juriste contre-révolutionnaire élabore la théorie juridique de la révolution. Il part du « holisme du contrat » chez Rousseau (3) pour montrer comment l'individualisme radical peut basculer en absolutisme radical. « On ne peut faire valoir aucun droit contre le peuple souverain ». Tel est le retournement de l'idée libertaire en justification de la dictature. De même que Dieu, source de tout pouvoir selon la théologie chrétienne, n'agit qu'à travers l'Église et le pape, de même que l'État, source de toute autorité selon le droit public moderne, n'agit qu'à travers l'administration et le gouvernement, la nation, source de toute légitimité selon la doctrine démocratique, n'agit qu'à travers l'assemblée et ses mandataires. Si le peuple est tout-puissant, sa représentation le sera aussi. Si la représentation délègue tout pouvoir à l'exécutif, alors celui-ci exercera la dictature, c'est-à-dire l'exercice immédiat du pouvoir sans séparation des pouvoirs législatif et exécutif. Tel est le noyau de la dictature au sens moderne : la concentration des pouvoirs afin de combattre un ennemi.
L'année 1793 fut éminemment révélatrice : l'assemblée (la Convention) domine le peuple, la commission de l'assemblée (le Comité de Salut Public) domine l'assemblée, le chef de la commission (Robespierre) domine la commission. Le pouvoir constituant se résorbe dans le pouvoir exécutif, la dictature révolutionnaire devient celle des commissaires, chargés de combattre l'ennemi intérieur et extérieur au moyen de procédures expéditives ou de tribunaux spéciaux. Édifier un gouvernement fort appuyé sur une machine administrative efficace et centralisée, éliminer les obstacles à cette édification, approvisionner l'armée, briser la sédition, vaincre l'ennemi : telle fut l'œuvre des commissaires de la Révolution, dont le plus illustre fut Carnot, avant qu'ils ne remettent le nouvel État au nouveau souverain : Napoléon Bonaparte.
Comment la Constituante, la Convention, le Directoire ont-ils combattu leurs ennemis ? Comment les révolutionnaires, une fois au pouvoir, ont-ils pu réprimer les masses en usant de pouvoirs extraordinaires ? Schmitt passe en revue toute la « légalité d'exception » de la période révolutionnaire, de 1789 à 1848. Dans une situation de guerre civile, la question concrète est de réprimer l'émeute par des moyens militaires. Le problème juridique central concerne donc l'intervention de l'armée. La situation est toute particulière, puisque l'action de l'État se tourne contre ses propres citoyens, ceux-ci ayant en quelque sorte déclaré la guerre à l'État existant. De même qu'en droit international, les pouvoirs d'exception de l'État, autrement dit son droit de faire la guerre, sont régulés par le jus ad bellum et le jus in bello (4), en droit interne, les pouvoirs d'exception de l'État, autrement dit son droit de réprimer, sont réglementés par le droit constitutionnel et le droit pénal, qui convergent dans l'institution de l'état de siège. Avec l'état de siège, le pouvoir exécutif est transféré à l'armée et une partie du pouvoir judiciaire, aux tribunaux militaires ; mais l'action de l'armée reste soumise au contrôle du gouvernement, du Parlement et du juge administratif, sans concentration du législatif et de l'exécutif, sans extension du pouvoir exécutif ni du pouvoir judiciaire ; autrement dit, l'armée et les tribunaux militaires ne peuvent modifier les lois en vigueur, mais seulement y déroger.
Schmitt pense donc aux moyens juridiques de faire face à la révolution prolétarienne. L'état de siège paraissant insuffisant, il se tourne vers la dictature commissariale. Sur quels fondements légaux agit l'armée lorsqu'elle réprime une insurrection — ainsi en Allemagne entre 1918 et 1923 ? Sur l'article 48 de la Constitution. Face à la puissance des partis marxistes, il n'y a de recours que la puissance de l'armée dirigée par le président du Reich élu au suffrage universel direct. La possibilité de la dictature commissariale, constitutionnellement prévue, doit s'opposer à la menace de la dictature révolutionnaire, qui invoque de manière abusive le pouvoir constituant du peuple. Certes, l'article 48 peut être détourné par le Reichspräsident ; mais ce risque est limité par l'existence des autres autorités constitutionnelles, gouvernement, parlement, tribunaux.
Le dernier théoricien du « jus publicum europaeum »
Le Nomos de la Terre est une rétrospective du jus publicum europaeum, dont C. Schmitt se veut « le dernier théoricien ». Avec la Théorie de la Constitution et La notion de politique, cet ouvrage est l'un des sommets de l'œuvre schmittienne, une référence incontournable pour qui veut comprendre l'histoire du droit international, not. l'époque cruciale 1919-1946. Il contient 2 thèmes principaux : « l'ordre spatial » et « la guerre juste ». Deux thèmes conçus comme les 2 grandes parties de toute réflexion sur le droit international public. Il commence par une réflexion sur le droit comme nomos, c'est à dire « unité d'ordre et de localisation ». Il retrace ensuite l'histoire du droit des gens, de la Respublica christiana à la « République européenne », puis de la « République européenne » à la dissolution du jus publicum europaeum (XIVe-XXe siècles). Cette dissolution est la conséquence d'un double tournant, de 1890 à 1946 : du droit européocentré à l'universalisme, de la reconnaissance de l'ennemi à sa criminalisation sous l'influence de l'« hémisphère occidental ». Enfin, la récusation du tribunal de Nuremberg constitue l'arrière-plan de l'ouvrage.
Après 1945, Schmitt est dans la situation d'un vaincu, en tant que conservateur, Allemand et Européen. Prenant la forme d'une « guerre civile internationale », le second conflit mondial a vu le triomphe de l'Amérique libérale et de la Russie soviétique. Le publiciste, chassé de l'Université, est donc réduit à la « défensive ». Aussi réinterprète-t-il son œuvre sous l'angle d'une catégorie de la théologie de l'histoire (5), celle du « Kat-echon », en s'identifiant lui-même à un catéchonte : ce qui importe, dit-il, c'est de « résister », de « résister » à la culpabilisation et à l'américanisation. Cette posture « défensive » ne l'empêche cependant pas de proposer un contre-modèle au droit international contemporain en rédigeant un elogium du droit des gens classique. La réécriture du jus publicum europaeum n'a pas qu'un intérêt historique. Elle a un intérêt pleinement politique : en retournant aux principes fondamentaux de l'ancien droit des gens, C. Schmitt propose de re-substituer la souveraineté de l'État aux constructions universalistes et supranationales, de re-substituer les concepts non discriminatoires de guerre, de neutralité et d'« ennemi juste » à la criminalisation de la belligérance, à la « police internationale » et au procès pénal. Il s'agit aussi pour Schmitt de disculper l'Allemagne et d'accuser les Alliés d'avoir déchaîné, au nom de la « guerre juste », une « guerre totale » qui a détruit le droit des gens européen.
Un nouveau droit des gens planétaire et océanique
Avant les Grandes Découvertes, le droit des gens était un « droit des empires », dont l'horizon était limité. À partir de la fin du XVe siècle, la conquête européenne du Nouveau Monde, puis du globe tout entier, engendra un nouveau droit des gens, à la fois planétaire et océanique. Ce droit des gens était européocentré et universel. Il reposait sur une double distinction et un double équilibre : distinction entre la terre et la mer, entre l'Europe et le reste du monde ; équilibre entre la terre et la mer, entre les États du continent européen. Tel était son « ordre spatial » global. La Grande-Bretagne, maîtresse des océans, était à la fois le maillon des deux organisations terrestre et maritime de l'espace planétaire et la garante de l'équilibre des États sur le continent européen. Le jus publicum europaeum avait un caractère inter-étatique, puisqu'il reposait sur la souveraineté territoriale des États, et transnational, puisqu'il s'articulait sur la liberté de la navigation et de l'économie. Le droit international public, en tant que « droit commun des États », comportait un régime-type commun aux États reconnus — l'absolutisme au XVIIIe siècle, le constitutionnalisme au XIXe — et un droit international privé — régissant les transports trans-étatiques du commerce et du marché — qui avaient au moins autant d'importance que la souveraineté de l'État.
Le jus publicum europaeum avait son propre droit de la guerre, basé sur le justus hostis, par opposition au droit de la guerre médiéval, basé sur la justa causa, et au droit de la guerre contemporain, qui discrimine les belligérants selon qu'il sont ou non coupables d'« agression ». Dans le droit des gens classique, la guerre est « juste » dès lors qu'elle est livrée par des États détenteurs du jus belli et par des armées régulières sur un theatrum belli. Telle fut l'essence du jus publicum europaeum : la limitation de la belligérance par la reconnaissance de l'ennemi (concept de guerre inter hostes aequaliter justi). Telle fut la distinction cruciale, tel fut le véritable progrès moral : ne pas voir en l'ennemi un criminel, donc admettre l'antagonisme des intérêts ou des valeurs sans le métamorphoser en antagonisme du « bien » face au « mal ». À partir de ce relativisme, dont notre juriste catholique se félicite, la guerre put être réglée et limitée. Enfin, le jus publicum europaeum conciliait les deux fonctions de tout droit international, à savoir : la garantie de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États, et l'aménagement des modifications territoriales et politiques rendues inévitables par l'évolution des rapports de force entre États. C'est le principe fondamental de l'équilibre, qui fut le critère de légitimité aussi bien de la garantie que de la révision du statu quo. Cette révision s'opérait à travers la pratique de la conquête, de la succession d'États, de l'occupation militaire. Elle devait être consacrée par une reconnaissance — autre concept fondamental — en droit international.
Schmitt termine Le Nomos de la Terre en retraçant la dissolution du jus publicum europaeum. Il s'attaque à la doctrine kantienne, à l'origine philosophique du droit international contemporain. Il développe l'analyse critique de l'influence de « l'hémisphère occidental ». Il déplore le tournant du droit européocentré à l'universalisme de l'International law. Il dénonce la criminalisation de la guerre par le tribunal de Nuremberg, récusé comme étant contraire au principe de légalité des délits et des peines, aucun texte antérieur à 1939 ne pouvant incriminer les auteurs individuels de la guerre. Pour mener à bien cette récusation, le publiciste repense l'évolution du droit de la guerre. D'abord de la justa causa médiévale au justus hostis classique, d'Ayala à Alphonse Rivier, en passant par Gentili, Vattel et Hegel. Puis de l'ennemi juste à la criminalisation de l'ennemi, de la déclaration du président Wilson aux conventions de Londres, en passant par le traité de Versailles, le pacte de la SDN et le pacte Briand-Kellog. Ce tournant révolutionnaire de l'histoire du droit des gens voit la réintroduction du concept discriminatoire de « guerre juste » fondé sur la notion d'agression et mis au service de la garantie du statu quo.
Face à une doctrine du droit international qui prétend abolir la guerre, Schmitt prétend qu'une telle prétention conduit à exacerber la guerre, alors que le droit a pour finalité la limitation de la belligérance, non son élimination. De la SDN à l'ONU apparaît l'idée d'une interdiction du recours à la force armée, sanctionnée par la punition de l'agresseur. La conséquence en est qu'il faut considérer que l'une des deux parties au conflit n'est pas seulement un adversaire qui doit être vaincu, mais un coupable qui doit être châtié. D'où l'exacerbation de la guerre, rendue inexpiable par la non-reconnaissance des belligérants. Cette évolution s'effectue parallèlement à l'accroissement des moyens de destruction et à la globalisation du theatrum belli.
Seule la disqualification morale et juridique de l'ennemi permet de légitimer l'application d'une violence aussi radicale que, par ex., les bombardements aériens sur les villes. La transformation de la belligérance en « opération de police », précipitant la dérive de la guerre étatique en guerre civile internationale, justifie les méthodes de « police bombing » contre les gouvernements « coupables », même si les populations « innocentes », incitées à se soulever, en subissent les effets (6). L'orientation vers un concept discriminatoire de guerre est ainsi « un épiphénomène idéologique de l'évolution […] technique des moyens de destruction ». Seule la guerre juste peut donner un sens à la montée aux extrêmes de la violence. Le « juste » peut employer tous les moyens contre l'« injuste » : telle est la relation entre bellum justum et total warfare.
Les États-Unis considérés comme l'adversaire principal
L'Europe se situe entre l'Est et l'Ouest ; mais c'est à partir de l'Ouest que le jus publicum europaeum fut détruit par l'introduction des guerres discriminatoires. Le Nouveau Monde est ainsi au commencement et à la fin du droit des gens classique. En portant ce jugement, Carl Schmitt confirme qu'il considère alors les États-Unis — puissance porteuse de l'idéologie du One World et du jus contra bellum — comme l'adversaire principal. Il lui importe donc d'élucider la situation « spirituelle » de l'Amérique, comme « métapolitique » de l'ennemi. Plus particulièrement, il entreprend d'examiner la relation, non plus entre l'Amérique et l'Angleterre — la translatio imperii — mais entre l'Amérique et la France — la translatio civilisationis.
Empire universel ou monde multipolaire ?
L'universalisme américain apparaît alors comme le stade suprême de l'impérialisme américain. De 1890 à 1945, les États-Unis balancèrent de l'isolationnisme à l'interventionnisme, sur la base d'une même idéologie morale. Ils tentèrent de résoudre cette contradiction par un mélange d'absence officielle et de présence effective, durant l'entre-deux-guerres. De 1914 à 1917, puis de 1935 à 1941, les présidents Wilson et Roosevelt passèrent donc de la neutralité intégrale à la guerre totale, l'impérialisme économique stimulant l'intervention militaire. Le nomos européocentré du globe fut détruit par les guerres mondiales. Il a été remplacé, à l'époque où écrit Schmitt, par la division Est/Ouest. États-Unis et Union Soviétique se sont partagé le monde et ont transformé l'Allemagne et l'Europe en objet de leur politique internationale.
L'issue de la guerre froide verra-t-elle l'avènement de « l'empire universel » (le monde unipolaire américanocentré) ou celui des « grands espaces équilibrés » (le monde multipolaire et multicivilisationnel) ? Telle était la question que posait Schmitt. Elle reste d'actualité.
► David Cumin, éléments n° 101, 2001. [version légèrement abrégée]
• Notes :
- 1 : Selon Raymond Aron, « la manière dont les hommes se sont combattus a toujours été aussi afficace pour déterminer la structure de la […] société que la manière dont les hommes ont travaillé » (« Une sociologie des relations internationales », in Revue française de sociologie, 1963, p. 311).
- 2 : Il suffit de remplacer Wallenstein par Hindenburg-Luddendorf, Ferdinand par Guillaume II, « confédération » par « parlementarisation ».
- 3 : « Chacun de nous met en commun sa personne sous la suprême direction de la volonté générale, et [la communauté] reçoit en corps chaque membre comme partie indivisible du tout ».
- 4 : Rappelons que le jus ad bellum, ou droit de la guerre au sens large, règle le concours à la force armée (quand a-t-on le droit de recourir à la force ?) et que le jus in bello, ou droit de la guerre au sens strict, règle l'usage de la force armée (comment a-t-on le droit d'user de la force ?).
- 5 : Empruntée à la seconde Épître aux Thessaloniens de Saint Paul (2, 6).
- 6 : Dix ans après la guerre du Golfe et deux ans après celle du Kosovo, les pages consacrées à la guerre aérienne dans Le Nomos de la Terre sont particulièrement à méditer (op. cit., pp. 310-320).
◘ LIENS :
- Schmitt penseur de la souveraineté
- Théories du conflit
- Un penseur conservateur
- Destin de l'antilibéralisme schmittien (S. Baume)
- Thalassopolitique selon Schmitt
- La politique de l'inimitié (L. Jaume)
- CS, la fédération et l'UE (C. Houchard)
- Dans le ventre du Léviathan (M. Stolleis, revue Asterion n°4)
- Hobbes, les pirates et les corsaires. Le « Léviathan échoué » selon CS (D. Weber)
- Libres propos d'un commentateur hégélianisant (JF Kervegan)
-
L'ère de la calomnie (Herte)
-
Une polémique sur CS (A de B.)
-
Une campagne contre CS (A. de B.)
-
Carl Schmitt et les sagouins (A. de B.)
◘ À LIRE :
 Nouvelle École n°44 (épuisé) : un dossier de référence
Nouvelle École n°44 (épuisé) : un dossier de référence- Le Droit, le politique et la guerre (Norbert Campagna)
- CS, biographie intellectuelle et politique (D. Cumin) [cf. recension inquisitoriale de Lire]
- Sous l'œil du Grand Inquisiteur (T. Paléologue)
- La guerre juste, essais contre le retour d’une idée (C. Schmitt)
- Du politique, "Légalité & légitimité" et autres essais (C. Schmitt) : À lire ces 15 textes qui s'échelonnent de 1919 à 1952, on mesure la richesse et la diversité de l'apport de CS à la pensée politique européenne. La plupart des idées-force du juriste se trouvent ici exposées : jus publicum europaeum, distinction ami-ennemi, démocratie et homogénéité politique, le libéralisme comme antipolitique, la dictature et l'État total… Préface d'A. de Benoist.
 Tags : Weimar
Tags : Weimar



