-
Cioran
S'il s'avère difficile d'écrire un article pour défendre Cioran (Cioran a-t-il besoin d'être défendu ?), les problèmes s’accroissent encore si l'on tente le contraire, si l'on veut l'attaquer, soumettre sa pensée aux feux de la critique : il faut s'armer de courage pour s'en prendre à celui qui, sans nul doute, est à la mode depuis plus de dix ans. Lui présenter des « objections », c'est aller à contre-courant. Mais les reproches qu'on lui a adressés, reproches qui ont servi à mythifier à outrance cet « hétérodoxe de l'hétérodoxie » n'allaient-ils pas, eux, à contre-courant.

Un brillant anti-système
Toute personne qui éprouve de la difficulté à se prononcer en toute sincérité contre Cioran n'a qu'une solution : tenter d'imiter ces hérétiques qui, soumis à la torture, ne persistaient dans leur hérésie que par bon goût. Et se répandre en louanges à l'endroit de Cioran pourrait sembler d'un mauvais goût comparable à celui qui tenterait d'ordonner en un système cohérent les écrits et les interjections mentales de celui qui a affirmé que « la pire forme de despotisme est le système, en philosophie et en tout ». L'avantage de l'anti-système est sa maigre vulnérabilité à toute attaque consistant en objections organisées systématiquement. On ne pourrait réfuter Cioran que de manière a-systématique et toujours dans l'hypothèse douteuse que cette réfutation dépasse le discours du Roumain sur le point précis grâce auquel il arrive justement à séduire : « l'éclat ».
On peut être brillant au départ de la « lucidité » et également au départ de la « foi », et même des deux à la fois (à la condition que cette cohabitation soit possible), du moment que l'on soit suffisamment subjectif. L'objectivité est rarement brillante et ne parvient jamais à être géniale. Installé dans la lucidité, Cioran a le privilège de devoir être subjectif par la force. La lucidité et la subjectivité déployées par Cioran lui donner la force suffisante pour faire face à ce qui se trouve devant lui, sans aucune aide ou échappatoire possible. Avec une sincérité qui épouvante, Cioran paraît même jouir de cette manière tourmentée par laquelle il s'inflige l'atroce nécessité de remâcher sans cesse ses interrogations — et même ses obsessions — essentielles : l'histoire, Dieu, la barbarie, le suicide, le scepticisme et autres labyrinthes. Ceux-ci sont brillamment exposés comme les dépouilles tirées d'un immense dépeçage où l'on aurait séparé les ordures philosophiques pour laisser, dénudé, ce que personne n'aurait imaginé être essentiel.
Volonté de style
« Mystère. Parole que nous utilisons pour tromper les autres, pour leur faire croire que nous sommes plus profonds qu'eux » (Syllogismes de l’amertume, 1952). Les grands négociateurs professionnels se distinguent avant tout par leur immense clarté dans la façon d'exposer leurs hypothèses, à l'écart de la complexité de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils prétendent. Idem avec le style concis et simple de Cioran. Il ne perd pas son temps dans les arcades du langage et dans un discours prétendument « profond », et il va droit au but avec une précision de scalpel, dont on ne peut que faire l'éloge. Ayant perdu la foi dans la grammaire (« Nous continuons à croire en Dieu parce que nous croyons encore en la Grammaire »), le Roumain connait bien les limites du langage auquel il doit forcément recourir. Aussi le domine-t-il. Le français n'est pas sa langue maternelle et cependant peu d'écrivains vivants le manient avec tant d'efficacité. La proposition de Wittgenstein — « tout ce que l'on peut exprimer, il est possible de l'exprimer clairement » — voilà ce qu'auraient dû méditer avec une plus grande attention ceux qui prétendent snober le style “superficiel” de Cioran.
Indépendance
 Avec une sincérité totale, Cioran accepte le défi d'être inclassable. Un poids plus lourd qu'on ne pourrait l'imaginer : il n'est pas facile d'être apatride et, à la longue, rares sont ceux qui survivent « sans profession ou métier connu ». “Lunatique”, “hétérodoxe” : voilà, entre autres, les qualificatifs qui ont été appliqués à Cioran. par ceux qui sont parvenus, tant bien que mal, à le “classifier”. Ce sont également les étiquettes qu'acceptent bon gré mal gré ces rares personnages de la vie réelle qui, tirant orgueil de leur extrême lucidité, doivent maintenir coûte que coûte leur acharnement rester digne d'éloges précisément parce qu'ils sont acharnés plus que de raison, demeurer indépendants, ne pas s'imposer ou ne pas accepter de se voir imposer une limite quelle qu'elle soit. Pendant la Renaissance, on appelait “humaniste” l'homme non unidirectionnel. Cioran rejetterait sans aucun doute cette désignation avec véhémence ; de la même façon, il se moquerait très probablement de tout qui tenterait de le classer comme “réactionnaire”, ou comme “sceptique”, comme “païen” ou lui attribuerait d'autres étiquettes simplificatrices du même genre.
Avec une sincérité totale, Cioran accepte le défi d'être inclassable. Un poids plus lourd qu'on ne pourrait l'imaginer : il n'est pas facile d'être apatride et, à la longue, rares sont ceux qui survivent « sans profession ou métier connu ». “Lunatique”, “hétérodoxe” : voilà, entre autres, les qualificatifs qui ont été appliqués à Cioran. par ceux qui sont parvenus, tant bien que mal, à le “classifier”. Ce sont également les étiquettes qu'acceptent bon gré mal gré ces rares personnages de la vie réelle qui, tirant orgueil de leur extrême lucidité, doivent maintenir coûte que coûte leur acharnement rester digne d'éloges précisément parce qu'ils sont acharnés plus que de raison, demeurer indépendants, ne pas s'imposer ou ne pas accepter de se voir imposer une limite quelle qu'elle soit. Pendant la Renaissance, on appelait “humaniste” l'homme non unidirectionnel. Cioran rejetterait sans aucun doute cette désignation avec véhémence ; de la même façon, il se moquerait très probablement de tout qui tenterait de le classer comme “réactionnaire”, ou comme “sceptique”, comme “païen” ou lui attribuerait d'autres étiquettes simplificatrices du même genre.L'indépendance, comprise comme élimination progressive de tous points de référence, est un exercice douloureux, dont les douleurs ne disparaissent jamais. Difficile, par ailleurs, d'évaluer jusqu'à quel point le résultat obtenu compense le prix payé. De tous les génies du XIXe siècle, seul Wagner et Goethe se sont « bien débrouillés ». Nietzsche, Hölderlin, Rilke et d'autres, nombreux, ont produit des écrits que l'on peut qualifier d'enviables. Et bien qu'ils puissent tous affirmer, avec Cioran, que « naître, vivre et mourir trompés, c'est ce que font les hommes », aucun d'entre eux, à l'évidence, n'a atteint l'indépendance à laquelle ils prétendaient parvenir ; peut-être s'en sont-ils approchés, certains plus que d'autres, mais il ne s'y sont jamais installés, n'ont pas eu les pleins pouvoirs de l'homme réellement indépendant.
Par rapport au XIXe siècle, le XXe siècle offre peut-être l'avantage d'être réellement plus indépendant (bien que cela soit également difficile). Mais les hommes moyens continuent encore à exiger de tout un chacun des “étiquettes”, des “professions” ou des “métiers”. Ces hommes moyens font montre d'une attitude proche de celle de ces États qui aspirent à tout contrôler dans la société. Ils ne se sentent à l'aise, face à une personne ou à une phénomène que s'ils peuvent le classer, lui donner un titre ou une étiquette, le conceptualiser. Titre, étiquette ou concept qui déterminera, par déduction, le type de relation qu'il faut avoir, au nom des conventions, avec l’étiqueté, le titré, le conceptualisé. « Les hommes ont besoin de points d'appui, ils veulent la certitude, quoi qu'il en coûte, même aux dépens de la vérité ».
Le médiocre de notre temps tente d'ôter de sa vue, de ses pensées, tout ce qu'il ne comprend pas. Tout ce qu'il est incapable de comprendre. “Je suis comptable”, “je suis avocat”, “je suis vendeur” (parfois, plus souvent que nous ne l'imaginons, on recourt à l'euphémisme pour rendre digne un métier dont on perçoit bien les misères). Voilà donc les déclarations officielles à faire obligatoirement de nos jours en société. Que des hérétiques comme Cioran ne confient pas au Saint Office Collectif leur titre de dépendance ou leurs numéros d'identification sociale, voilà que les soumettra irrémédiablement à la réprobation générale et même à l'isolement. Ils ne réveilleront que la curiosité du petit nombre, ou la sympathie de personnalités plus rares encore, mais ils devront constater et accepter d'être toujours observés (et même jugés) avec la même colère critique que l'on appliquait jadis aux pires des hérétiques. L'indépendance coûte cher.Cioran, l'Anti-Faust
On a parlé de Cioran comme du porte-drapeau de la philosophie du renoncement, de la “non-action” et du désistement. Ceux qui décrivent Cioran de la sorte prétendant rapprocher notre exilé roumain de son maître Bouddha et n'oublient généralement pas de mentionner son célèbre adage : « Plus on est, moins on veut ». Ou de nous rappeler, en guise de plaisanterie, sa description fort crue de l'acte d'amour : il s'agirait « d'un échange entre deux êtres de ce qui n'est rien d'autre qu'une variété de morve ». Le rapport qui existe entre Cioran et l'idée d'action (ou si l'on préfère, le désir) est un rapport de conflit. Personne ne niera que le principe faustien de la souveraineté de l'action soit radicalement opposé au scepticisme féroce de celui qui élève l'inaction au rang de catégorie divine. Et même si l'action et le goût pour l'action sont compatibles avec la lecture de Cioran, nous nous trouvons néanmoins en présence de deux extrêmes irréconciliables. Un livre de Cioran est inimaginable sur la table d'un broker de New York. Et personne n'aura l'idée saugrenue d'emmener des livres de Cioran lors d'une régate de voiliers, d'une expédition dans l'Himalaya ou d'une escapade avec une belle femme dont on vient de faire la connaissance. Cependant, les fanatiques de l'action les plus intransigeants pourront se lancer dans une activité exceptionnelle, où ne détonneraient absolument pas certains pages de Cioran : traverser un désert.
Le poignard et les passions
 Il n'y a pas de meilleure recette que le « désintérêt » pour « triompher » dans notre civilisation. Après avoir abjuré l'ambition de triompher, Cioran fonce avec autant de passion contre les créatures pétries d'illusions et contre les sous-produits du désintérêt. Le prix à payer, terrible, c'est « l'échec » sur le terrain des valeurs vitales. Et Cioran exhibe cet échec avec une ostentation impudique, au point d'insister sur le fait — sans nous convaincre, ceci dit pour faire son éloge — qu'il n'y a rien, pas même la publication et le succès de ses œuvres, qui compense son échec. Alors qu'il est parvenu à dire que « l'élégance morale authentique consiste en l'art de déguiser les victoires en déroutes ». Le verbe de Cioran distille la passion tous azimuts et même une véhémence manifeste. « Dans la colère, on se sent vivre », nous fait-il remarquer : mais c'est plus un conseil qu'une menace, car « si devant l'affront qui nous a été fait, en réfléchissant aux représailles, nous avons hésité entre la gifle et le pardon, cette hésitation, nous faisant perdre un temps précieux, aura consacré notre lâcheté. Il s'agit d'une hésitation aux conséquences graves, d'un maque qui nous écrase, alors qu'une explosion, même si elle se termine en quelque chose de grotesque, nous aurait soulagés. Aussi pénible que nécessaire, la colère nous empêche d'être prisonnier d'obsessions et nous épargne le risque de complications sérieuses : c'est une crise de démence qui nous préserve de la démence ».
Il n'y a pas de meilleure recette que le « désintérêt » pour « triompher » dans notre civilisation. Après avoir abjuré l'ambition de triompher, Cioran fonce avec autant de passion contre les créatures pétries d'illusions et contre les sous-produits du désintérêt. Le prix à payer, terrible, c'est « l'échec » sur le terrain des valeurs vitales. Et Cioran exhibe cet échec avec une ostentation impudique, au point d'insister sur le fait — sans nous convaincre, ceci dit pour faire son éloge — qu'il n'y a rien, pas même la publication et le succès de ses œuvres, qui compense son échec. Alors qu'il est parvenu à dire que « l'élégance morale authentique consiste en l'art de déguiser les victoires en déroutes ». Le verbe de Cioran distille la passion tous azimuts et même une véhémence manifeste. « Dans la colère, on se sent vivre », nous fait-il remarquer : mais c'est plus un conseil qu'une menace, car « si devant l'affront qui nous a été fait, en réfléchissant aux représailles, nous avons hésité entre la gifle et le pardon, cette hésitation, nous faisant perdre un temps précieux, aura consacré notre lâcheté. Il s'agit d'une hésitation aux conséquences graves, d'un maque qui nous écrase, alors qu'une explosion, même si elle se termine en quelque chose de grotesque, nous aurait soulagés. Aussi pénible que nécessaire, la colère nous empêche d'être prisonnier d'obsessions et nous épargne le risque de complications sérieuses : c'est une crise de démence qui nous préserve de la démence ».Un Cioran passionné est l'unique contre-poids qu'il a lui même inventé, dans la mesure où quelques-unes de ses propositions (voire la plupart d'entre elles) peuvent paraître inhumaines. Mais, qui plus est, sa passion est prétexte à justifier son comportement ; ainsi, l'écrivain garde toute sa souveraineté, ce qui le rend plus accessible : « Il est déshonorant, il est ignoble de juger les autres ; cependant, c'est ce que tout le monde fait et s'en abstenir revient à se trouver en dehors de l'humanité ». Cioran, passionné, qui connaît les forces que produit toute passion, cite le roi Ménandre quand il demande à l'ascète Nâgasena [cf. Milindapañha] ce qui distingue l'homme sans passion de l'homme passionné : « L'homme passionné, ô roi, quand il mange, aime la saveur et a la passion de la saveur ; et l'homme sans passion goûte la saveur mais ne se passionne pas pour la saveur. Tout le secret de la vie et de l'art, tout ce qui est ici bas réside dans cette « passion de la saveur ». Pour la même raison, Cioran s'ingénie à rechercher des forces chez l'ennemi, celui dont il prendra soin et essaiera de ne pas perdre, celui qu'il — une fois et essaiera de ne pas perdre, celui qu'il — une fois de plus, tout comme Nietzsche — situera au même niveau qualitatif que l'ami, seul l'ennemi est digne de notre haine, cette haine précieuse « qui n'est pas un sentiment, mais une force, un facteur de diversité qui fait progresser les êtres aux dépends de l'être ».
Nietzsche et Cioran
 Après avoir bu jusqu'à satiété aux sources de la philosophie, Cioran lui tourne le dos mais sans l'abjurer complètement : « je ne suis pas philosophe », essaie-t-il de nous dire, en ajoutant encore que les sources de tout écrivain « sont ses hontes » (peut-être parce qu'il est conscient qu'on peut facilement le coincer : le renoncement, il le doit à Bouddha, aux gnostiques, à la mystique et surtout à Nietzsche, philosophe qu'il tente difficilement de renier).
Après avoir bu jusqu'à satiété aux sources de la philosophie, Cioran lui tourne le dos mais sans l'abjurer complètement : « je ne suis pas philosophe », essaie-t-il de nous dire, en ajoutant encore que les sources de tout écrivain « sont ses hontes » (peut-être parce qu'il est conscient qu'on peut facilement le coincer : le renoncement, il le doit à Bouddha, aux gnostiques, à la mystique et surtout à Nietzsche, philosophe qu'il tente difficilement de renier). La parenté de Cioran avec Nietzsche relève de ces choses que l'on cache sans pourtant cesser d'en être fier. Tous deux enfants de prédicateurs, confrontés à la mort contre la Croix. Tous deux s'auto-proclamant “non-philosophes” : Nietzsche préférait qu'on l'appelle « psychologue [des profondeurs] », Cioran préfère qu'on ne lui donne pas de nom. Leurs itinéraires vitaux (séparés dans le temps par un peu plus d'un demi-siècle) sont tous deux presque aussi pénibles. Bien que nous nous imaginions Nietzsche en train de concevoir ses écrits lors de longues promenades dans les lumineuses Alpes italiennes (« n'ont de valeur que les pensées faites en chemin ») et bien que nous sachions que Cioran accède à la lucidité au fond de son obscure retraite parisienne, aucun des deux ne peut échapper à la malédiction paternelle : condamnés qu'ils sont à être, malgré eux, des « écrivains religieux ». Perdus de manière irrémissible par un excès de sincérité, seul le rire les rachète tous deux, bien que de façon différente chez chacun d'eux. Nietzsche, en Allemand, nous parle sur un ton sérieux pour invoquer le rire (« nous devons considérer comme suspecte toute pensée qui ne nous ait pas fait rire ») et accéder aux hautes sphères de la pensée. Cioran, dont la sourire se trouve dans le texte, se précipite de temps en temps dans les abîmes du doute et du scepticisme sans vouloir gagner ni hauteur ni monde : « Gagner le monde, perdre l'âme ! J'ai atteint quelque chose de mieux : j'ai perdu les deux ».
Rire souverain
« Pourquoi ne me suis-je pas tué ? Si je savais exactement ce qui m'en empêche, je n'aurais plus de questions à me poser puisque j'aurais répondu à toutes » (Le Mauvais Démiurge). Il ne manque pas de raisons à ceux qui évitent Cioran de “le voir tout en noir”. Il est certain que Cioran est un râleur, qu'il est tout sauf optimiste. Mais ce n'est pas une raison pour le considérer comme un écrivain “négatif”. Parce que Cioran affirme. Il affirme de manière répétée et accablante, bien que ce soit ex negatione, bien que ce soit en reniant. Cioran est le type du parfait pleurnicheur, bien sûr, mais à regarder de plus près, le rire n'est-il pas par hasard la musique de fond de tout son discours ? Celui qui parvient à affirmer que « renier rajeunit », ou qui loue le « supplément d'anxiété » qui enrichit toute négation, ne cesse cependant pas de se délecter de temps en temps de l'ironie intentionnellement amère, au départ de laquelle il nous parle.
« À peine adolescent, la perspective de la mort me jetait dans ses transes ; pour y échapper, je me précipitais au bordel où j'invoquais les anges. Mais, avec l'âge, on se fait à ses propres terreurs, on n'entreprend plus rien pour s'en dégager, on s'embourgeoise dans l'Abîme. Et s'il fut un temps où je jalousais ces moines d'Égypte qui creusaient leurs tombes pour y verser des larmes, je creuserais maintenant la mienne que je n'y laisserais tomber que des mégots » (Syllogismes de l'amertume).
Le sens de l'humeur est évident dans ce paragraphe comme dans beaucoup d'autres. Mais le rire de Cioran est également présent dans presque tout le reste de ses textes ; il est audible des profondeurs pour le lecteur à l'oreille fine, capable de ressentir, avec Cioran, la souveraineté indiscutable du rire sur tout autre état de pensée.
Le païen, le réactionnaire
Évidemment, la différence fondamentale existant entre ce qu'écrit Cioran et ce que l'on écrit sur Cioran est que sa pensée est originale. Alors, que dire du paganisme de Cioran ? Et quel objet aurait une réflexion portant sur les éléments “réactionnaires” de son discours ? Ces deux facettes du sceptique, apparemment contradictoires, sont l'envers et le revers d'une même pièce de monnaie avec laquelle Cioran joue à pile ou face en énonçant ses propositions. Cioran joue, avant tout ; qui est, au fait que sa méthodologie soit fondamentalement ludique, il faut ajouter que son attitude face à ce jeu est la plus positive que l'on puisse imaginer (qui accusait Cioran être négatif/ négativiste ?). En effet, c'est là l'attitude de celui qui ne cache nullement son propre jeu. Pour cette raison même, faire l'apologie de ce que Cioran apporte à la sensibilité païenne (spécialement dans son Mauvais Démiurge) ou à la pensée réactionnaire (surtout dans son Essai sur la pensée réactionnaire et ses réflexions sur Joseph de Maistre), ou s'en prendre à ce double apport, sera toujours une tâche nettement moins digne que celle de transcrire, sans plus, quelques-unes de ses réflexions les plus éloquentes.
Voici donc deux commentaires sommaires. Le premier présente de l'intérêt pour le lecteur espagnol (en Espagne, croyants ou non, nous sommes tous catholiques) et désire souligner de quelle manière Cioran met en évidence les éléments salutaires du paganisme qui ont perduré dans le catholicisme orthodoxe. Il n'attaque pas les protestants avec la même virulence que Nietzsche mais l'on ressent très bien sa répulsion face au plus monothéiste des monothéismes, au moins méditerranéen des christianismes. On pourrait esquisser un autre commentaire réservé, cette fois, aux sympathisants de la “nouvelle droite” ou de la “nouvelle culture” (qui peuvent être des Espagnols ou d'autres Européens) en affirment que, en matière de paganisme, Cioran ré-ouvre à nos investigations des galeries entières de la pensée qui ne s'étaient jamais fréquentées, étaient restées hermétiquement fermées les unes aux autres, du moins au niveau de l'écrit. Ces lieux de la pensée, laissés en jachère et redécouverts par Cioran, bénéficient de la publicité faite par ses partisans, notamment ceux des “nouvelles droites” ; du coup, ils n'ont pas tardé à recevoir la visite de nombreux “touristes intellectuels”, originaires de diverses “nouvelles” idéologies. Bon nombre des apports doctrinaux dus aux autres auteurs de la “nouvelle droite” ou “nouvelle culture” doivent reconnaître leur filiation par rapport aux œuvres de Cioran. Filiation partagée notamment par un païen comme Pessoa.
Des paroles de plus…
En toute vraisemblance, Cioran parviendra à exercer, qu'il le veuille ou non, une influence croissante sur les « cultures de la nouvelle barbarie » qui paraissent désormais s'établir en Europe. Parallèlement — bien que de manière asymétrique — à Nietzsche qui annonçait avec fracas le “surhomme” aristocratique. Cioran ne se contente pas de prophétiser une nouvelle barbarie, également anti-messianique et de vocation païenne, mais, dirait-on, semble vouloir lui donner de l'essor. Il limite en cela une technique de prophète, ressemblant tellement à celle du conseiller en bourse qui raconte que telle ou telle action va monter, conscient que son pronostic poussera à acheter la valeur dont la cotation monte. Dans le dernier tiers du XXe siècle, la cote de valeurs comme « la nouvelle barbarité » ou « le nouveau nomadisme » commence à augmenter et pourrait bientôt s'emballer. Mais peu de gens savent déjà où obtenir des informations à leur sujet, quels signes les définissent et quels événements les précèdent. Cioran est un de ceux, très rares, qui ont interprété certaines notes relatives à ces nouvelles valeurs.
Interpréter : voilà ce que fait Cioran. Et le fait en utilisant le code du scepticisme. Scepticisme pour partie double. Scepticisme qui n'est plus seulement un exercice de dé-fascination mais en plus, en toute conscience, un jeu. Mais comme tout jeu, celui de Cioran manque d'une finalité qui ne soit pas celle de son propre jeu. Pour cette raison, en annonçant la « nouvelle barbarie », Cioran ne prophétise pas. Il propose. Il existe une phrase de Cioran, annonçant cette nouvelle barbarie. Une phrase qui synthétise en une ligne tous les textes sensés et toutes les réflexions ennuyeuses des aspirants à la philosophie, qu'ils soient bien ou mal intentionnés. C'est une phrase inquiétante… Un éclair de lucidité que Cioran parvient à articuler en mots, en un torrent de sincérité démultipliée. On ne doit pas épargner au lecteur la citation de cette phrase, qui met un point final de manière catégorique et immédiate à cet article sur l'écrivain, le penseur, le mystique, qui a affirmé que : « toute parole est une parole de plus ».
► Luis Fraga, Orientations n°13, 1991.
(texte paru dans Punto y Coma n°10, 1988 ; tr. fr. : Nicole Bruhwyler)
[Habillage musical : Napissunu Mutumma - Herbst9, 2011]

En arriver à ne plus apprécier que le silence, c’est réaliser l’expression essentielle du fait de vivre en marge de la vie. Chez les grands solitaires et les fondateurs de religions, l’éloge du silence a des racines plus profondes qu’on ne l’imagine. Il faut pour cela que la présence des hommes vous ait exaspéré, que la complexité des problèmes vous ait dégoûté au point que vous ne vous intéressiez plus qu’au silence et à ses cris.
La lassitude porte à un amour illimité du silence, car elle prive les mots de leur signification pour en faire des sonorités vides ; les concepts se diluent, la puissance des expressions s’atténue, toute parole dite ou entendue repousse, stérile. Tout ce qui part vers l’extérieur, ou qui en vient, reste un murmure monocorde et lointain, incapable d’éveiller l’intérêt ou la curiosité. Il vous semble alors inutile de donner votre avis, de prendre position ou d’impressionner quiconque ; les bruits auxquels vous avez renoncé s’ajoutent au tourment de votre âme. Au moment de la solution suprême, après avoir déployé une énergie folle à résoudre tous les problèmes, et affronté le vertige des cimes, vous trouvez dans le silence la seule réalité, l’unique forme d’expression.
► Cioran, Sur les cimes du désespoir, 1934.
[Ci-dessus : Path to the Gothic Choir, Raphaël Lacoste, 2009]
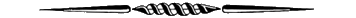
 Mystiques et Conquérants : Cioran et l'histoire d'Espagne
Mystiques et Conquérants : Cioran et l'histoire d'EspagneAnti-dogmatique, Cioran ne cache pas sa répugnance à « l'esprit de système » et aux idéologies en vigueur. Nihiliste, il professe un pessimisme anthropologique radical qui se traduit par un mépris pour la conception linéaire de l'Histoire, pour l'idéologie du Progrès et pour les Utopies consolatrices. Viscéralement contradictoires, il concilie son paganisme avec une admiration pour les mystiques. Face aus despotisme de la Raison, il préfère le combat jusqu'à l'exaltation du Héros. Il avoue sa faiblesse pour les vieilles dynasties et les empires, tronc réel de l'Être des peuples. Dans ce sens, l'Espagne comme peuple Élu, celle des Conquérants et des Mystiques, est le paradigme d'inadaptation face au courant actuel de la civilisation. Elle incarne la tragédie, le vertige devant le néant et le non-sens face à l'optimisme hédoniste et sédatif de l'Occident. Terre des paradoxes vierges, l'Espagne est le dernier bastion de la Liberté.

Rares sont les auteurs qui, comme Cioran, se sont vus qualifier de nihiliste avec tant de force et d'insistance par les philosophes bien-pensants. Ce Roumain établi en France est, en réalité, l'un des esprits les plus libres de notre époque. Un homme qui parvient à criminaliser le fait même de la naissance (« tout être venu au monde est un maudit ») et pour qui la vie est « extraordinaire et nulle », un homme dont les livres s'intitulent, par ex., De l'inconvénient d'être né ou Précis de décomposition, sera toujours éloigné des idéologies en vigueur. « Plutôt dans un égout que sur un piédestal », voilà son choix. Lire Cioran est une expérience cathartique ; il nous pose simplement les questions que seuls nous ne nous serions jamais posées : « Penser, c'est creuser, se creuser ». On trouve chez Cioran une multitude de sujets qui l'obsèdent. Mais il les aborde tous de la même façon : « Être un agent de la dissolution d'une philosophie, d'un pouvoir, peut-on, s'imaginer orgueil plus triste et plus majestueux ? » Le thème de la décadence des civilisations est cependant celui qu'il absorbe le plus souvent. Avec au départ son pessimisme anthropologique radical, sa perte de foi en l'Homme en tant qu'être prométhéen — parce qu'il s'est éclipsé —, possédé par la « douleur de l'être », notre auteur se moque, sans pitié, de l'idée de Progrès, de « l'œcuménisme de l'illusion » qui s'ensuit et il ne voit dans l'Histoire qu'un « cloaque d'utopies ». Mais même de cette façon, il cultive avec passion tant la philosophie de l'histoire que l'histoire des civilisations dont il tire une bonne partie de sa philosophie : « À cause de mon préjugé pour tout ce qui termine bien, m'est venu le goût des lectures historiques » (De l'inconvénient d'être né [1973], désigné ensuite par IEN). Et dans se cadre, il a rapidement découvert sa « faiblesse pour les dynasties condamnées, pour les empires qui s'écroulent » (IEN).Rageusement contradictoires
Il est certainement difficile d'exposer clairement les idées contenues dans l'œuvre de Cioran : « la pire forme de despotisme est le système, en philosophie et en tout » (IEN). Ce qu'il dit au sujet de Nietzsche, on peut également le lui appliquer : « Rien de plus irritant que ces œuvres dans lesquelles se coordonnent les idées frondeuses d'un esprit qui a aspiré à tout, sauf au système. À quoi sert de donner une apparence de cohérence à celles de Nietzsche (…) ? Nietzsche est un ensemble d'attitudes et chercher en lui une volonté d'ordre, une préoccupation pour l'unité implique qu'on le diminue » (La Tentation d'exister [1956], désigné ensuite par TE). Nous trouvons dans son œuvre des prises de position franchement contradictoires. Rageusement contradictoires. Prenons comme exemple son attitude vis-à-vis du christianisme : « Tout ce qui demeure encore vivant dans le folklore est antérieur au christianisme, c'est la même chose pour tout ce qui demeure encore vivant en nous » (IEN). Mais ce critique féroce du christianisme, dominé par la nostalgie des dieux païens, fait preuve d'une admiration illimitée pour les mystiques espagnols et il arrive à écrire : « Si j'avais vécu aux débuts du christianisme, je crains que j'aurais subi sa séduction » (IEN). Contradiction insoluble ? Peut-être pas. Cioran n'évalue pas le christianisme comme une ensemble idéologique dans ces manifestations historiques mais comme la forme par laquelle ces idées ont été vécues chez les premiers chrétiens et chez les mystiques.
Éloge de l'irrationalisme
 Retournons maintenant au fil de l'argumentation. En dépit de sa complexité et de sa contradiction, il faut énoncer quelques postulats fondamentaux de la philosophie de Cioran avant d'aborder notre sujet, du moins telles que se présentent pour moi ces idées-forces. « Créateur de valeurs, l'homme est l'être délirant par excellence » (Précis de décomposition [1949], désigné ensuite par PD), écrit Cioran. Il maudit ce délire ? Oui et non. « La vie se crée dans le délire et se défait dans la dégoût » (PD). Sans doute, comme on l'a déjà vu, son pessimisme anthropologique est-il radical : « La science prouve notre néant ». Mais « qui en a tiré la dernière leçon » ? (PD). De là sa dévotion manifeste pour Diogène. Le seul philosophe qui mérite toutes ses louanges : « Il fut le seul à nous révéler le visage répugnant de l'homme » (PD).
Retournons maintenant au fil de l'argumentation. En dépit de sa complexité et de sa contradiction, il faut énoncer quelques postulats fondamentaux de la philosophie de Cioran avant d'aborder notre sujet, du moins telles que se présentent pour moi ces idées-forces. « Créateur de valeurs, l'homme est l'être délirant par excellence » (Précis de décomposition [1949], désigné ensuite par PD), écrit Cioran. Il maudit ce délire ? Oui et non. « La vie se crée dans le délire et se défait dans la dégoût » (PD). Sans doute, comme on l'a déjà vu, son pessimisme anthropologique est-il radical : « La science prouve notre néant ». Mais « qui en a tiré la dernière leçon » ? (PD). De là sa dévotion manifeste pour Diogène. Le seul philosophe qui mérite toutes ses louanges : « Il fut le seul à nous révéler le visage répugnant de l'homme » (PD).Mais, Cioran maudit-il tous les types d'hommes ? Seul le Héros mérite son estime car c'est une figure humaine que notre civilisation occidentale a éliminée : « La psychologie est la tombe du héros. Les milliers d'années de religion et de raisonnement ont affaibli les muscles, la décision et l'impulsivité aventureuse » (PD). Face au philosophe et à l'écrivain, face à l'homme raffiné qui vitupère, Cioran s'émerveille du « vrai héros qui combat et meurt au nom de son destin, non pas au nom d'une croyance » (PD). Cette estimation du rôle du héros repose sur l'idée que la vie est inconcevable sans lutte. la lutte constitue l'essence de la vie, tant des peuples que des hommes : « Lorsque les animaux cessent de ressentir une crainte mutuelle, ils tombent dans le stupidité et acquièrent cet aspect déprimé que présentent les parcs zoologiques. Les individus et les peuples offriraient le même aspect si un jour ils parvenaient à vivre en harmonie » (IEN). On trouve donc chez Cioran une nostalgie du Héros et des temps de lutte, une nostalgie que lui-même vit intérieurement : « Être de nature combative, agressive, intolérante et ne pouvoir se réclamer d'aucun dogme ! » (Le Mauvais Démiurge [1959], désigné ensuite par MD). Les idéaux disparaissent, tout comme ceux qui luttaient pour eux, mais jamais n'arrivera pour cela la paix utopique universelle : « Et qui veut encore combattre ? Le héros est dépassé, seul la boucherie est en cours » (Contre l'Histoire [titre français : La Chute dans le temps, 1964], désigné ensuite par CT). Le passage de guerrier des Croisades au soldat manipulant des missiles intercontinentaux : voilà le fruit de la civilisation occidentale qui en prétendant éradiquer le conflit, a instauré l’extermination.
Pour Cioran, toute la décadence de notre civilisation a une origine claire : « La raison (est) la rouille de notre vitalité » (TE). Mais ce n'est pas tout. Cioran ne voit nulle part les avantages de cette civilisation construite sur le rationalisme : « Nos vérités n'ont pas plus de valeur que celles de nos ancêtres. Après avoir remplacé leurs mythes et leurs symboles, nous nous croyons plus avancés ; mais ces mythes et ces symboles n'expriment pas moins que nos concepts (…) et si les dieux n'interviennent plus dans les événements, ces événements n'en son pas plus explicables ou moins déconcertants pour cela (…) car la science ne les capte pas plus intimement que les récits poétiques » (PD). Par conséquent, Cioran rejette toutes les tromperies du Progrès, ce fruit de la raison : « Hegel est le grand responsable de l'optimisme moderne. Comment ne vit-il pas que la conscience change seulement de formes et de modalités mais ne progresse en rien ? » De ce fait, il ne croit pas dans la linéarité et dans le finalisme historiques ; le devenir est innocent : « Que l'Histoire n'ait aucun sens est quelque chose qui devrait nous réjouir » (PD).
Contre le système
 [Ci-contre : sculpture de Michel Gérard] Chaque culture, chaque peuple, doit exprimer un ensemble organique de valeurs, celui qui lui est propre. Tout universalisme moral finit par corroder le peuple qui le pratique. Voilà la tragédie de l'Europe : « Depuis le siècle des Lumières, l'Europe n'a pas cessé de détruire ses idoles au nom de l'idée de tolérance (…). En effet, les préjugés — fictions organiques d'une civilisation — en assurent la durée, en conservent la physionomie. Elle doit les respecter, sinon tous, du moins ceux qui lui sont propres et qui, dans le passé, avaient pour elles l'importance d'une superstition ou d'un rite » (TE). Dans un monde comme le nôtre, qui bafoue les mythes et les rites, quels que soient ceux-ci, Cioran adopte la position : « Une civilisation commence dans le mythe et finit dans le doute » (CT) en passant par le rationalisme corrosif. Donc sans ces mythes, les peuples perdent le nord. Sans leurs propres dieux, les civilisations perdent le sens de leur existence. Rome déjà a payé cher cette erreur : « Abandonner les dieux qui firent Rome, c'était abandonner Rome elle-même » (MD). Il serait intéressant de signaler que dans la substitution du paganisme par le monothéisme judéo-chrétien, Cioran voit, précisément, une des causes de la décadence de notre civilisation, à laquelle le polythéisme donnait une expression authentique : « plus on reconnait de dieux, mieux on sert la Divinité (…) Le polythéisme correspond mieux à la diversité de nos tendances et de nos élans (…). Le dieu unique rend la vie irrespirable (…) le monothéisme contient en germe toutes les formes de tyrannie » (MD).
[Ci-contre : sculpture de Michel Gérard] Chaque culture, chaque peuple, doit exprimer un ensemble organique de valeurs, celui qui lui est propre. Tout universalisme moral finit par corroder le peuple qui le pratique. Voilà la tragédie de l'Europe : « Depuis le siècle des Lumières, l'Europe n'a pas cessé de détruire ses idoles au nom de l'idée de tolérance (…). En effet, les préjugés — fictions organiques d'une civilisation — en assurent la durée, en conservent la physionomie. Elle doit les respecter, sinon tous, du moins ceux qui lui sont propres et qui, dans le passé, avaient pour elles l'importance d'une superstition ou d'un rite » (TE). Dans un monde comme le nôtre, qui bafoue les mythes et les rites, quels que soient ceux-ci, Cioran adopte la position : « Une civilisation commence dans le mythe et finit dans le doute » (CT) en passant par le rationalisme corrosif. Donc sans ces mythes, les peuples perdent le nord. Sans leurs propres dieux, les civilisations perdent le sens de leur existence. Rome déjà a payé cher cette erreur : « Abandonner les dieux qui firent Rome, c'était abandonner Rome elle-même » (MD). Il serait intéressant de signaler que dans la substitution du paganisme par le monothéisme judéo-chrétien, Cioran voit, précisément, une des causes de la décadence de notre civilisation, à laquelle le polythéisme donnait une expression authentique : « plus on reconnait de dieux, mieux on sert la Divinité (…) Le polythéisme correspond mieux à la diversité de nos tendances et de nos élans (…). Le dieu unique rend la vie irrespirable (…) le monothéisme contient en germe toutes les formes de tyrannie » (MD).Au milieu d'une civilisation que s'auto-corrode dans sa niaiserie, Cioran, clairvoyant, émet un verdict brutal sur notre culture : « L'Occident, une pourriture qui sent bon, un cadavre parfumé » (IEN). La nostalgie est un sentiment capital chez Cioran. Nostalgie du héros, du mythe et également d'une Europe qui a disparu. Le Christianisme et les Lumières ont annihilé sa vitalité, lui ont arraché sa force et le sens de son existence. « L'Occident ? Un possible sans lendemain » (CT). Évidemment, Cioran ne pèche pas par ethnocentrisme. L'influence de la philosophie des religions orientales est palpable dans ses livres et en divers endroits de son œuvre. Il affirme que l'Européen-occidental, sa philosophie, sa science, sa morale, ne se situent pas au-dessus des autres peuples (Une seule exception : il pense que rien n'est supérieur à la musique européenne). Mais ce polycentrisme culturel ne constituera pas un obstacle (peut-être s'agit-il plutôt de sa conséquence) à l'expression de son angoisse face à la décadence de l'Europe et des Européens, « acculés à l'insignifiance, Helvètes en puissance » (CT). Finalement, L'Europe a créé quelque chose de fondamental pour Cioran : la Liberté. Une Liberté qui était complète dans le paganisme, quand les humains étaient des dieux mortels et les dieux, des hommes immortels ; quand l'homme par conséquent pouvait essayer de se dépasser puisque rien, au-dessus de lui ne pouvait l'arrêter. Aujourd’hui, de cette idée païenne de la Liberté, il ne reste qu'une ombre pâlie : la démocratie parlementaire : « Merveille qui n'a plus rien à offrir, la démocratie est à la fois le paradis et la tombe d'un peuple » (CT).
Il ne reste aujourd'hui de l'Europe qui a vécu la Liberté que son reflet dans un verre déformant : le consumérisme hédoniste et vide de l'American Way of Life : « L’Amérique se dresse devant le monde comme un néant impétueux, comme une fatalité sans substance » (TE). Qui donc viendra en Europe, qui prendra la relève ? « Tant de conquêtes, d'acquisitions, d'idées, où vont-elles se perpétuer ? En Russie ? En Amérique du Nord ? L'une et l'autre ont déjà tiré les conséquences du pire de l'Europe… L'Amérique latine ? L'Afrique du Sud ? L'Australie ? C'est de ce côté qu'il faut, semble-t-il, attendre la relève. Relève caricaturale. L'avenir appartient à la banlieue du Globe » (TE).
Peuples possédant un destin
Cioran a analysé avec passion le destin historique des grands peuples européens : la Grèce, Rome, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Russie,… En tant que Roumain, membre d'un « peuple sans destin » (PD), il a toujours vécu, comme il l'écrit dans IEN : « en révolte perpétuelle contre mon ascendance, toute la vie j'ai désiré être autre ; Espagnol, Russe, (…), tout, excepté ce que je suis ». L'Espagne a particulièrement attiré l'attention de Cioran. Quelle en est la raison ? Peut-être son ascension fulgurante et sa longue décadence sont-elles destinées à captiver tout spécialement cet amoureux des crépuscules : « La lumière se prostitue à mesure qu'elle s'éloigne de l'aube et que le jour avance et elle ne se rachète — éthique du crépuscule — qu'au moment de disparaître » (IEN). Peut-être est-ce parce que l'Espagne a su créer les mythes littéraires qui l'ont captivé le plus :
« Vivre signifie : créer et espérer, mentir et se mentir. Pour cette raison l'image la plus véridique qui se soit jamais créée de l'homme est encore celle du Chevalier à la triste Figure (…). Poussière éprise de fantasmes, tel est l'homme : son image absolue, d'idéal ressemblant, s'incarnerait dans un Don Quichotte vu par Eschyle » (PD).
Ou c'est peut-être la vigueur extraordinaire dont a fait preuve un pays pauvre en ressources, presque vide d'habitants, situé à la périphérie de l'Europe et qui, pourtant, fut près de conquérir le monde entier au nom de ses idéaux.
« Chaque peuple traduit dans le devenir et à sa manière les attributs divins ; l'ardeur de l'Espagne demeure pourtant unique ; eût-elle été partagée par le reste du monde que Dieu serait épuisé, démuni et vide de Lui-même. Et c'est pour ne pas disparaître que dans ses pays [qu'] il fait prospérer — par autodéfense — l'athéisme (…) Il redoute l'Espagne comme il redoute la Russie : il y multiplie les athées. (…) Toute Sainteté est plus ou moins espagnole : si Dieu était Cyclope, l'Espagne lui servirait d'œil » (PD).
Ou peut-être simplement parce que le cycle historique d'apogée et de décadence de l'Espagne, qui dépasse celui de l'Europe dans son ensemble, a pour lui une valeur paradigmatique, maximale lorsque l'Espagnol est pleinement conscient de sa décadence, ce qui n'arrive pas avec les autres Européens.
« Une civilisation, en fin de parcours, d'anomalie heureuse qu'elle était, en vient à se faner dans la règle (…) elle se roule dans l'échec et transforme son destin en problème unique. De cette obsession de soi-même, l'Espagne offre le modèle parfait. Après avoir connu, au temps de Conquistadores, une surhumanité bestiale, elle s'est mise à remâcher son passé, (…), à laisser moisir ses vertus et son génie ; au contraire, amoureuse de son crépuscule, elle l'a adopté comme nouvelle suprématie. Comment ne pas pas percevoir que ce masochisme historiques cesse d’être une singularité espagnole, pour se transformer en climat et en recette de caducité d'un continent ? » (CT).
Espagne, splendeur et délire
Les deux peuples européens qui obsèdent Cioran sont les peuples russe et espagnol, car tous deux « sont tellement obsédés par eux-mêmes qu'ils s'érigent en problème unique » (TE). Cioran est spécialement fasciné par l'attitude des Espagnols face à la décadence de leur pays :
« L'Espagne se penche sur soi (…) Elle eut, elle aussi, des débuts fulgurants, mais ils sont bien lointains. Venue trop tôt, elle a bouleversé le monde, puis s'est laissé choir : cette chute, j'en eus un jour la révélation. C'était à Valladolid, à la Maison Cervantès. Une vieille, d'apparence quelconque, y contemplait le portrait de Philippe III : “C'est avec lui qu'a commencé notre décadence !”. J'étais au vif du problème. “Notre décadence !” Ainsi donc, pensais-je, la décadence est en Espagne, un concept courant, national, un cliché, une devise officielle. La nation qui, au XVIe siècle, offrait au monde un spectacle de magnificence et de folie, la voilà réduite à codifier son engourdissement. S'ils en avaient eu le temps, sans doute, les derniers Romains n'eussent-ils pas procédé autrement ; remâcher leur fin, ils ne pouvaient : les Barbares les cernaient déjà. Mieux partagés, les Espagnols eurent le loisir (trois siècles !) de songer à leurs misères et de s'en imprégner. Bavards par désespoir, improvisateurs d'illusions, ils vivent dans une sorte d'âpreté chantante, de non-sérieux tragique, qui les sauve de la vulgarité, du bonheur et de la réussite. Changeraient-ils un jour leurs anciennes marottes contre d'autres plus modernes, qu'ils resteraient néanmoins marqués par une si longue absence. Hors d'état de s'accorder au rythme de la “civilisation”, calotins ou anarchistes, ils ne sauraient renoncer à leur inactualité. Comment rattraperaient-ils les autres nations, comment seraient-ils à la page, alors qu'ils ont épuisé le meilleur d'eux-mêmes à ruminer sur la mort, à s'y encrasser, à en faire une expérience viscérale ? Rétrogradant sans cesse vers l'essentiel, ils se sont perdus par excès de profondeur. L'idée de décadence ne les préoccuperait pas tant si elle ne traduisait en termes d'histoire leur grand faible pour le néant, leur obsession du squelette. Rien d'étonnant que pour chacun d'eux, son pays soit son problème. En lisent Ganivet, Unamuno ou Ortega, on s'aperçoit que pour eux l'Espagne est un paradoxe qui les touche intimement et qu'ils n'arrivent pas à réduire à une formule rationnelle. Ils y reviennent toujours, fascinés par l'attraction de l'insoluble qu'il représente. Ne pouvant le résoudre par l'analyse, ils méditent sur Don Quichotte, chez lequel le paradoxe est encore plus insoluble, puisque symbole… On ne se figure pas un Valéry ni un Proust méditant sur la France pour se découvrir eux-mêmes : pays accompli, sans ruptures graves qui sollicitent l'inquiétude, pays non-tragique, elle n'est pas un cas : ayant réussi, ayant conclu son sort, comment serait-elle “intéressante” ? » (TE).
Cependant, notre pays et la Russie n'intéressent pas Cioran uniquement parce que « l'évolution normale de la Russie et de l'Espagne les a donc amenées à s'interroger sur leur propre destin » ; cette question présente beaucoup d'intérêt pour celui qui, comme lui, s'interroge sans cesse sur le destin de notre civilisation européenne. Ce n'est pas uniquement notre décadence qui le fascine. L'Espagne Impériale, celle des Conquistadors et des Mystiques, lui offre d'exemple le plus achevé d'une époque remplie où il aurait aimé vivre :
« C'est le mérite de l'Espagne de proposer un type de développement insolite, un destin génial et inachevé. (On dirait un Rimbaud incarné dans une collectivité). Pensez à la frénésie qu'elle a déployée dans sa poursuite de l'or, à son affalement dans l'anonymat, pensez ensuite aux conquistadors, à leur banditisme et à leur piété, à la façon dont ils associèrent l'évangile au meurtre, le crucifix au poignard. À ses beaux moments, le catholicisme fut sanguinaire, ainsi qu'il sied à toute religion vraiment inspirée » (TE).
À propos de ces dernières lignes, il convient de signaler que, contrairement aux moralistes en vogue, Cioran ne va pas condamner ni la volonté d'expansion ni l'esprit agressif des peuples et des cultures : « Une civilisation n'existe et ne s'affirme que par des actes de provocation. Commence-t-elle à s'assagir ? Elle s'effrite » (TE).
Conquête et Inquisition, vices grandioses
 Alors que philosophes et historiens, nationaux et étrangers, nous décrivent avec horreur la Conquête de l’Amérique ou la répression religieuse de l'Espagne de la Contre-Réforme, Cioran prend une attitude radicalement opposée :
Alors que philosophes et historiens, nationaux et étrangers, nous décrivent avec horreur la Conquête de l’Amérique ou la répression religieuse de l'Espagne de la Contre-Réforme, Cioran prend une attitude radicalement opposée :« La conquête et l'Inquisition, — phénomènes parallèles issus des vices grandioses de l'Espagne. Tant qu'elle fut forte, elle excella au massacre, et y apporta non seulement son souci d'apparat, mais aussi le plus intime de sa sensibilité. Seuls les peuples cruels on l'heur de se rapprocher des sources mêmes de la vie, de ses palpitations, de ses arcanes qui réchauffent : la vie ne dévoile son essence qu'à des yeux injectés de sang… Comment croire aux philosophes quand on sait de quel regards pâles elles sont le reflet ? L'Habitude du raisonnement et de la spéculation est l'indice d'une insuffisance vitale et d'une détérioration de l'affectivité. Pensent avec méthode ceux-là seuls qui, à la faveur de leurs déficiences, parviennent à s'oublier, à ne plus faire corps avec leurs idées : la philosophie, apanage d'individus et de peuples biologiquement superficiels » (TE).
C'est la perte de leur capacité de dominer, de leur disposition à s'imposer, au delà des conceptions humanitaristes, au delà de rêves irénistes, qui ruine les civilisations :
« Depuis qu'une (nation) a abandonné ses desseins de domination et de conquête, le cafard, ennui généralisé, la mine. Fléau des nations en pleine défensive, il dévaste leur vitalité ; plutôt que de s'en garantir, elle le subissent et s'y habituent au point de ne plus pouvoir s'en dispenser. Entre la vie et la mort, elles trouveront toujours assez d'espace pour escamoter l'une et l'autre, pour éviter de vivre, pour éviter de mourir. Tombées dans une catalepsie lucide, rêvant d'un statu quo éternel, comment réagiraient-elles contre l'obscurité qui les assiège, contre l'avance de civilisations opaques ? La tension spirituelle et physique des époques de conquête, comme celle des instants créatifs, épuise rapidement les énergies des peuples et des hommes : Pourquoi la peinture hollandaise ou la mystique espagnole ont-elles été florissantes un instant ? (…) Des tribus aux instincts impérieux s'agglutinent pour former une grande puissance ; arrive le moment où, résignés et titubants, elles aspirent à un rôle subalterne. Quand on ne sait plus être l'envahisseur on accepte d'être invalide » (CT).
Cioran admire deux choses en Espagne : sa période de splendeur et sa décadence. Il est arrivé à notre patrie comme « à tout peuple (qui), à un moment déterminé de sa course, croit être choisi. Cependant c'est quand il donne le meilleur et le pire d'eux-mêmes » (IEN). Et parmi les meilleures choses que l'Espagne ait données, on trouve sa mystique religieuse chrétienne même si cela paraît bizarre chez un Cioran agnostique et paganisant. Évidemment ce n'est pas le contenu chrétien qui l'intéresse mais l'intensité du sentiment, sa volonté de conquête :
« Mais se méprendre sur la mystique que de croire qu'elle dérive d'un amollissement des instincts, d'une sève compromise. Un louis de Léon, un Saint Jean de la Croix couronnèrent une époque de grandes entreprises et furent nécessairement contemporains de la Conquête. Loin d'être des déficients, ils luttèrent pour leur foi, attaquèrent Dieu de front, s’approprièrent le ciel. Leur idolâtrie du non-vouloir, de la douceur et de la passivité les garantissait contre une tension à peine soutenable, contre cette hystérie surabondante dont procédait leur intolérance, leur prosélytisme, leur pouvoir sur ce monde et sur l'autre. Pour les deviner, que l'on se figure un Fernand Cortès au milieu d'une géographie invisible » (TE).
On l'a déjà vu, Cioran est captivé par l'image de la décadence. « Comment ne pas s'éprendre des grands couchers de soleil ? L'enchantement moribond qui entoure une civilisation, après qu'elle ait abordé tout les problèmes et les ait faussés merveilleusement, offre plus d'attraits que l'ignorance inviolée par laquelle elle a débuté » (PD). La longue agonie de l'Espagne, sa “sortie de l'Histoire” a modelé un type humain :
« Il est à peu près impossible de parler avec un Espagnol d'autre chose que de son pays, univers clos, sujet de son lyrisme et de ses réflexions, province absolue, hors du monde. Tour à tour exalté et abattu, il y porte des regards éblouis et moroses ; l'écartèlement est sa forme de rigueur. S'il accorde un avenir, il n'y croit pas réellement. Sa trouvaille : l'illusion sombre, la fierté de désespérer ; son génie : le génie du regret. Quelle que soit son orientation politique, l'Espagnol ou le Russe qui s'interroge sur son pays aborde la seule question qui compte à ses yeux. On saisit la raison pour laquelle ni la Russie ni l'Espagne n'ont produit aucun philosophe d'envergure. C'est que le philosophe doit s'attaquer aux idées en spectateur ; avant de les assimiler, de les faire siennes, il lui faut les considérer du dehors, s'en dissocier, les peser et, au besoin, jouer avec elles ; puis, la maturité aidant, il élabore un système avec lequel il ne se confond jamais tout à fait. C'est cette supériorité à l'égard de leur propre philosophie que nous admirons chez les Grecs. Il en va de même pour tous ceux qui s'attachent au problème de la connaissance et en font l'objet essentiel de leur méditation. Ce problème ne trouble ni les Russes ni les Espagnols. Impropres à la contemplation intellectuelle, ils entretiennent des rapports assez bizarres avec l'Idée. Combattent-ils avec elle ? Ils ont toujours le dessous ; elle s'empare d'eux, les subjugue, les opprime ; martyrs consentants, ils ne demandent qu'à souffrir pour elle. Avec eux, nous sommes loin du domaine où l'esprit joue avec soi et les choses, loin de toute perplexité méthodique » (TE).
D'après Cioran, la pensée faible (soft), les idées froides ne sont pas faites pour les Espagnols. « Avant, quand Sainte Thérèse, patronne de l'Espagne et de ton âme, te prescrivait un trajet de tentations et de vertiges, l'abîme transcendant t'émerveillait comme une chute des cieux. Mais ces cieux ont disparu — comme les tentations et les vertiges — et les fièvres d'Avila se sont éteintes dans son cœur froid » (PD). Nous savons que Cioran est un pessimiste presque absolu. Mais lui, qui a écrit que « l'arbre de la Vie ne connaîtra plus le printemps, est désormais une souche sèche » (PD), a dit aussi que « vivre équivaut à l'impossibilité de s'abstenir » (CT). Voilà la grande angoisse qui l'accable. Qui nous accable : « Comment se mettre à réparer les dommages quand, comme Don Quichotte sur son lit de mort, nous avons perdu — au bout de la folie, épuisés — vigueur et illusion pour affronter les chemins, les combats et les échecs » (PD). L'histoire seulement donne raison au pessimisme : « Ma mémoire accumule des horizons engloutis » (MD). Le christianisme, qui nous a parlé de notre salut en termes moralisateurs humanitaristes et comme un fait individuel, nous a écartés des grands destins collectifs et de la possibilité de dépasser notre condition trop humaine en établissant une frontière absolue entre l'humain et le divin. Les lumières de la Raison, celle de l'Aufklärung, nous ont uniquement dévoilé les ténèbres. Cioran a osé appeler les problèmes par leur nom. L'homme européen sera-t-il capable de dépasser son nihilisme et son angoisse, d'abandonner la nostalgie pure ?
► Carlos Caballero, Orientations n°13, 1991.
(texte paru dans Punto y Coma n°10, 1988 ; tr. fr. : NB)
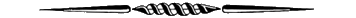
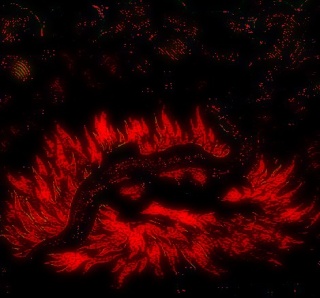 La découverte de Cioran en Allemagne
La découverte de Cioran en AllemagneCioran, inclassable philosophe, Roumain exilé à Paris, sceptique et mystique à l'écriture limpide, n'a pas encore trouvé beaucoup de biographes. Outre-Rhin, il commence à intriguer ; il devient l'objet d'études minutieuses, de spéculations audacieuses. Parmi celles-ci, l'œuvre de Cornelius Hell, natif de Salzbourg, formé dans l'université de sa ville natale. Hell a enseigné à Vilnius en Lithuanie soviétique et est l'auteur d'un livre consacré à la mystique, au scepticisme et au dualisme de Cioran.
Difficile à cerner, la pensée de Cioran se situe in toto dans ces trois univers dualiste, mystique et sceptique. À la question que lui posaient des journalistes allemands du Süddeutsche Zeitung : « Êtes-vous un sceptique ou un mystique ? », Cioran répondit : « Les deux, mon ami, les deux ». Comment décortiquer cet entrelacs philosophique et métaphysique ? Hell croit pouvoir apporter une réponse. La pensée dualiste de Cioran lui donne les catégories nécessaires à décrire le monde en tant que situation, à saisir la condition humaine. Le scepticisme indique la voie pour trouver la thérapeutique. La mystique, pense Hell, sert à déterminer les objectifs positifs (pour autant que l'on trouve des objectifs positifs à déterminer dans l'œuvre de Cioran).
Cette tripartion de l'œuvre de Cioran peut nous apparaître assez floue. Le Maître parvient à échapper à toutes les classifications rigides. Reste une tâche à accomplir, à laquelle Hell s'essaie : repérer les influences philosophiques que Cioran a reçues. Pour lui, l'homme a tout de l'animal et rien du divin mais le théologien analyse mieux notre condition que le zoologue. L'homme a échappé à l'équilibre naturel, par le biais de l'esprit, ce trouble-fête. L'homme est donc tiraillé entre deux ordres irréconciliables. Pour Hell, cette vision de la condition humaine se retrouve chez Kleist, dans son Marionettentheater et, plus récemment, chez cet héritier de la tradition romantique que fut Ludwig Klages. Pour ce dernier aussi, la conscience, l'esprit, trouble l'harmonie vitale. Klages comme Cioran partagent la nostalgie d'une immersion totale de l'être humain dans un principe vital supra-personnel. Klages comme Cioran critiquent tous les deux la fébrilité, la vanité et la prétention activiste de l'homme, notamment dans la sphère politique.
On pourrait, poursuit Hell, rapprocher Schopenhauer de Cioran car les deux philosophes rejettent la volonté et la thématique du péché originel. Hell mentionne également les influences de Simmel, de Spengler, d'Elias Canetti et d'Adorno. Les sources françaises de la pensée de Cioran doivent être recherchées, elles, chez Montaigne et Pascal. Face à Sartre et Camus, ses contemporains, la position de Cioran se résume en une phrase : « Pour moi, Sartre n'a rien signifié. Son œuvre m'est étrangère et sa parution ne m'intéresse pas… Il serait pour un existentialisme objectif. Dans ce cas, je qualifierai le mien de “subjectif”. J'ai, moi, une dimension religieuse. Lui n'en a certainement aucune ». Quant à Camus, sa conclusion dans La Peste se situe aux antipodes de la pensée de Cioran, puisqu'il affirme qu'il y a davantage à admirer chez l'homme qu'à mépriser.
Pour Hell, c'est le néo-conservatisme allemand d'un Gerd-Klaus Kaltenbrunner et d'un Armin Mohler qui a contribué à mettre l'œuvre de Cioran en valeur Outre-Rhin. Ce néo-conservatisme et cette “Nouvelle Droite”, issue de sa consœur parisienne, ont attiré les regards sur ce marginal des années 50 et 60.
En résumé, une analyse philosophique profonde et une mise en perspective prometteuse.
► Luc Nannens (pseud. RS), Vouloir n°25/26, 1986.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
J'ai rencontré Cioran dans son petit appartement du Quartier latin, à deux pas du théâtre de l'Odéon. Gabriel Matzneff s'était joint à nous. Autour d'un verre de vin, nous avons agité nos chimères communes : la décadence, les vieux Romains, la philosophie tragique, le suicide… Cioran nous dominait de ses élans sans passion. Il est revenu de plus de choses que nous. Il est revenu de tout. Dans sa jeunesse, il fut l'arrogance philosophique personnifiée. Il est revenu de la philosophie. Mais aussi du romantisme et du bouddhisme. Il est retourné au scepticisme de ses débuts. Il pense que le monde est horrible, que cette horreur nous remplit. Que ce qui pourrait nous en consoler, nous en distraire au sens propre, n'est qu'illusion ou supercherie. Depuis trente ans, des Syllogismes de l'amertume à La Tentation d'exister, il ne cesse d'approfondir le même sillon avec toute une série de textes et surtout d'aphorismes, où « le mot est dieu », qui représentent le minimum du compromis avec l'écriture, le minimum de trahison par rapport au silence. Le même sillon en effet. Tout projet est une « forme camouflée d'esclavage » ; toute conviction, une « folie ». La vie est « le plus grand des vices » : c'est « pourquoi on a tant de peine à s'en débarrasser». La mort est « un état de perfection, le seul à la portée d'un mortel » ; la vieillesse, « la punition d'avoir vécu ». Cioran écrit : « Même quand rien ne se passe, tout me semble de trop », « tout est rien, y compris la conscience du rien » ; « l'unique frénésie dont nous soyons capables est la frénésie de la fin » ; « soyons confiants, misons sur la catastrophe ». Il cite un auteur japonais : « Seule une fleur qui tombe est une fleur totale » — avec ce commentaire : « On est tenté d'en dire autant d'une civilisation ».
Le pire est urgent
Du pessimisme ? Nullement. Cioran n'a pas le complexe de Cassandre. Le pessimisme consiste à prévoir le pire. Cioran ne fait qu'en proclamer l'urgence. Ce sont les choses elles-mêmes, non le cours qu'elles suivent, qui sont insupportables. De vains moralistes ont reproché à Cioran de désespérer les esprits faibles. Quelle erreur ! On ne désespère jamais que les désespérables. Les autres, de la vue des abîmes, peuvent tirer des forces nouvelles. Et puis, quelle sottise de toujours raisonner par les conséquences. Cioran a choisi pour maxime : « Détachement du fruit de l'acte ». Ce qui, selon les tempéraments, peut conduire à s'abstenir de l'action ou, au contraire, à les multiplier — sans s'inquiéter de leurs effets. Croire que l'absence d'illusions équivaut au désespoir jette vraiment un jour révélateur sur la nature des idées qu'on porte… À l'écart de la versatilité française, EM Cioran, fils d'un pope orthodoxe roumain, fait partie de ces auteurs secrets dont le public, lui aussi, est secret. Son style admirable, son éloignement des factions, lui ont valu des complicités très diverses. La gauche elle-même, rassurée (bien à tort) par son apologie du détachement, a fini par entrouvrir ses portes à ce grand penseur réactionnaire qui ose écrire : « Dès qu'on sort dans la rue, à la vue des gens, “extermination” est le premier mot qui vient à l'esprit ». Ou bien : « La tolérance n'est, en dernier ressort, qu'une coquetterie d'agonisants. » Ou encore : « Serf, ce peuple bâtissait des cathédrales ; émancipé, il ne construit que des horreurs !»
Contre Babylone
On est frappé des convergences de cette pensée avec celle, plus strictement philosophique, d'un auteur comme Clément Rosset, qui, lui aussi, proclame la nécessité de penser le pire et de se défaire des illusions qui sont autant de « doubles » du réel. Pour Rosset, le « discours du pire » est reconnu d'emblée comme le seul discours à la fois nécessaire et possible. Nihilisme positif, qui repose sur l'affirmation du rien, non sur la négation du tout — et qui fonde la possibilité même d'une philosophie tragique. Enfin et surtout, la pensée de Cioran, comme toute autre pensée un peu forte, est essentiellement contradictoire. Cela apparaît clairement dans son dernier livre, intitulé Écartèlement [1979.] D'un côté, par ex., Cioran dénonce l'histoire et aspire puissamment à sa fin. L'histoire est pour lui l'« abominable Clio » : une « odyssée inutile », un « paradis de somnambules ». De l'autre, il s'en prend à la décadence contemporaine sans dissimuler combien elle est liée au dépérissement de l'énergie orgueilleuse qui, de tous temps, fut le moteur de l'histoire. Avec un brin d'amertume, Cioran me dit : « La Roumanie n'eut pas d'histoire » (De l'inconvénient d'être né). Mais si l'histoire n'a pas de sens, comme il le souligne également, comment être sûrs que nous allons vers sa fin ?
Même contradiction en ce qui concerne la vie. Cioran semble affirmer qu'on ne peut avoir à la fois l'intelligence et la vigueur. La maladie lui apparaît comme un début de sagesse : le plus sot des malades, du fait de son état, est tenu à un minimum de réflexion. Mais en même temps, il professe une évidente nostalgie de la « grande santé », de ces forces vitales que le développement du savoir n'a pas encore paralysées. Il cite ce mot de Carl Gustav Carus : « Si l'on pouvait enseigner la géographie au pigeon voyageur, du coup son vol inconscient, qui va droit au but, serait chose impossible ». Jusque dans ces contradictions, Cioran s'inscrit en fait dans tout un courant de « pessimisme culturel », qui va de Gobineau à Montherlant en passant par Spengler. Sa pensée est gouvernée par le dégoût : « un dégoût à en perdre l'usage de la parole et même de la raison ». Comment, dès lors, ne pas évoquer l’œuvre de Montherlant ? Caton, dans La Guerre Civile, « regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde en haut, il regarde en bas, et il ne trouve que de l'horrible ». Alvaro, dans La Reine morte, s'exclame : « Mon pain est le dégoût. » Comment ne pas évoquer Montherlant, qui déclarait en mars 1971 au journal Matulu :
« Je suis indigné par le peu que je vois, le peu que je lis, le peu que j'entends du monde extérieur. Un monde que j'écarte de moi le plus possible, sinon je vivrais dans un dégoût perpétuel. » Ou le Drieu qui écrivait en 1934 : « Je souffre pour le corps des hommes… Horrible de se promener dans les rues et de rencontrer tant de déchéances, de laideurs ou d'inachèvements. »
Quand il se promène dans les rues, Cioran y voit des « gorilles » qui semblent en avoir assez d'imiter les humains. Ce sera bientôt, en déduit-il, « l'heure de la fermeture » dans les jardins d'Occident. Et de dénoncer une planète « babylonisée », une société bigarrée :
« La possibilité même d'une multitude si hétéroclite suggère que dans l'espace qu'elle occupe n'existe plus, chez les autochtones, le désir de sauvegarder ne fût-ce que l'ombre d'une identité. À Rome, au IIIe siècle de notre ère, sur un million d'habitants, soixante mille seulement auraient été des Latins de souche. Dès qu'un peuple a mené à bien l'idée historique qu'il avait mission d'incarner, il n'a plus aucun motif de préserver sa différence, de soigner sa singularité, de sauvegarder ses traits au milieu d'un chaos de visages… ».
Dans une serre
 Rome, bien sûr. Et l'on n'a pas de peine à retrouver dans le monde antique, avec Épicure, avec le stoïcisme, avec les présocratiques, les racines profondes de cette pensée qui n’a que l’apparence du désespoir. Entre ce monde et le nôtre, Cioran fait d'ailleurs un parallèle constant. Il écrit : « Le monde antique devait être bien atteint pour avoir eu besoin d'un antidote aussi grossier que celui qu'allait lui administrer le christianisme. » Du coup, La Croix le somme de s’expliquer (dans ce journal, on ne doute vraiment de rien). Parallèle enfin entre la physiologie des sociétés, celle de l'homme, et la sienne propre. (« Les individus, comme les empires, affectionnent une longue fin douteuse »). Ces comparaisons reviennent sans cesse sous sa plume : notre dépendance par rapport aux organes ! Et aussi l'aveu d'une piètre santé, d'innombrables nuits blanches. Avec une autre physiologie, Cioran eût sans doute écrit sur un autre ton. Il s'exclame : « Être un Barbare et ne pouvoir vivre que dans une serre ! » Ce mot explique peut-être toutes ses contradictions. On voit bien que Cioran « fanatique sans credo », homme de passion qui ne se passionne pour rien, se bride à chaque instant, et ne lance l'anathème que pour mieux faire taire ce qu'il sent en lui. Il n'a jamais été, dit-il, que le « secrétaire de ses sensations ». Qui ne l'est pas ? Tout discours est une projection de nous-mêmes, tout discours prolonge notre être : corps, âme et esprit liés — même et surtout les discours indirects. C'est aussi pour cela que Cioran écrit des livres : « Pour me libérer, affirme-t-il, pour me décharger de ce qui me pèse sur le cœur et l'esprit. » Publier un livre, c'est objectiver son contenu. « Cela m'indiffère de voir à la devanture d'une librairie un ouvrage où j'ai confié des secrets, ajoute Gabriel Matzneff, et pourtant j'aurais hésité avant même qu'il ne fût paru, à en confier le manuscrit même à un ami très cher. »
Rome, bien sûr. Et l'on n'a pas de peine à retrouver dans le monde antique, avec Épicure, avec le stoïcisme, avec les présocratiques, les racines profondes de cette pensée qui n’a que l’apparence du désespoir. Entre ce monde et le nôtre, Cioran fait d'ailleurs un parallèle constant. Il écrit : « Le monde antique devait être bien atteint pour avoir eu besoin d'un antidote aussi grossier que celui qu'allait lui administrer le christianisme. » Du coup, La Croix le somme de s’expliquer (dans ce journal, on ne doute vraiment de rien). Parallèle enfin entre la physiologie des sociétés, celle de l'homme, et la sienne propre. (« Les individus, comme les empires, affectionnent une longue fin douteuse »). Ces comparaisons reviennent sans cesse sous sa plume : notre dépendance par rapport aux organes ! Et aussi l'aveu d'une piètre santé, d'innombrables nuits blanches. Avec une autre physiologie, Cioran eût sans doute écrit sur un autre ton. Il s'exclame : « Être un Barbare et ne pouvoir vivre que dans une serre ! » Ce mot explique peut-être toutes ses contradictions. On voit bien que Cioran « fanatique sans credo », homme de passion qui ne se passionne pour rien, se bride à chaque instant, et ne lance l'anathème que pour mieux faire taire ce qu'il sent en lui. Il n'a jamais été, dit-il, que le « secrétaire de ses sensations ». Qui ne l'est pas ? Tout discours est une projection de nous-mêmes, tout discours prolonge notre être : corps, âme et esprit liés — même et surtout les discours indirects. C'est aussi pour cela que Cioran écrit des livres : « Pour me libérer, affirme-t-il, pour me décharger de ce qui me pèse sur le cœur et l'esprit. » Publier un livre, c'est objectiver son contenu. « Cela m'indiffère de voir à la devanture d'une librairie un ouvrage où j'ai confié des secrets, ajoute Gabriel Matzneff, et pourtant j'aurais hésité avant même qu'il ne fût paru, à en confier le manuscrit même à un ami très cher. »Consolant suicide
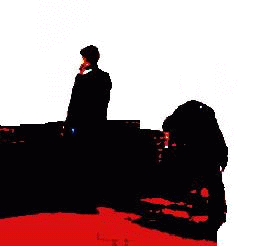 Tout naturellement, nous en venons à parler du suicide. Cioran y voit le « seul acte vraiment normal ». Il parle du « désir légitime » de se tuer. Pline voyait dans la faculté de se donner la mort « le plus grand bienfait qu'ait reçu l'homme » et plaignait les dieux de ne pas posséder un tel privilège. « S'apitoyer sur l'Être suprême parce qu'il n'a pas la ressource de se donner la mort ! — s'écrie Cioran. Idée incomparable, idée prodigieuse, qui à elle seule consacrerait la supériorité des païens sur les forcenés qui devaient bientôt les supplanter. » Je pose à Cioran cette question brutale : pourquoi ne se tue-t-il pas ? En une phrase, il me donne une vraie réponse : « Sans l’idée du suicide, je me serais tué depuis toujours. » C’est seulement par le suicide, explique-t-il, que l’homme peut vraiment, en toute liberté, décider lui-même de son sort. Et seule cette idée, par un paradoxe qui n'en est pas un, permet de supporter la vie. Ainsi le suicide est doublement une solution : on se tue quand on ne peut plus vivre — et si l'on peut vivre encore, c'est toujours l'idée du suicide qui vous soutient : l'idée qu'au milieu de tant de boue, cette issue-là, au moins, peut vous appartenir. Ce qui rejoint ces mots de Nietzsche, placés par Matzneff en tête de son essai sur le suicide chez les Romains (Le Défi, Table ronde, 1965 et 1977) : « La pensée du suicide est une puissante consolation ; elle aide à passer mainte mauvaise nuit ». Les chrétiens ont leurs livres d'humilité. Moi, quand le cœur me gonfle, je relis du Cioran. Et d'abord cette phrase, qui me convient si bien : « Ma mission est de tuer le temps et la sienne, de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins ».
Tout naturellement, nous en venons à parler du suicide. Cioran y voit le « seul acte vraiment normal ». Il parle du « désir légitime » de se tuer. Pline voyait dans la faculté de se donner la mort « le plus grand bienfait qu'ait reçu l'homme » et plaignait les dieux de ne pas posséder un tel privilège. « S'apitoyer sur l'Être suprême parce qu'il n'a pas la ressource de se donner la mort ! — s'écrie Cioran. Idée incomparable, idée prodigieuse, qui à elle seule consacrerait la supériorité des païens sur les forcenés qui devaient bientôt les supplanter. » Je pose à Cioran cette question brutale : pourquoi ne se tue-t-il pas ? En une phrase, il me donne une vraie réponse : « Sans l’idée du suicide, je me serais tué depuis toujours. » C’est seulement par le suicide, explique-t-il, que l’homme peut vraiment, en toute liberté, décider lui-même de son sort. Et seule cette idée, par un paradoxe qui n'en est pas un, permet de supporter la vie. Ainsi le suicide est doublement une solution : on se tue quand on ne peut plus vivre — et si l'on peut vivre encore, c'est toujours l'idée du suicide qui vous soutient : l'idée qu'au milieu de tant de boue, cette issue-là, au moins, peut vous appartenir. Ce qui rejoint ces mots de Nietzsche, placés par Matzneff en tête de son essai sur le suicide chez les Romains (Le Défi, Table ronde, 1965 et 1977) : « La pensée du suicide est une puissante consolation ; elle aide à passer mainte mauvaise nuit ». Les chrétiens ont leurs livres d'humilité. Moi, quand le cœur me gonfle, je relis du Cioran. Et d'abord cette phrase, qui me convient si bien : « Ma mission est de tuer le temps et la sienne, de me tuer à son tour. On est tout à fait à l'aise entre assassins ».► Alain de Benoist, Orientations n°13, 1991.

Cioran : martyr ou bourreau ?
Réflexions sur le renversant faux-pas d'un politicien libéral
 Cioran. Que n'aura-t-on pas dit de Cioran ? Pour certains commentateurs, ce n'est qu'un écrivain qui publie des aphorismes médiocres, ce n'est que l'auteur d'une « philosophie pour concierges » ; pour d'autres, il est le meilleur écrivain vivant de langue française. Entre ces deux extrêmes, on trouve un immense éventail d'opinions de valeurs diverses. Ce que l'on n'avait jamais dit de Cioran, c'est qu'il était fasciste. Mais aujourd'hui, c'est fait ; on ne voit pas bien pourquoi, mais un politicien libéral espagnol lui a attribué la paternité idéologique du phénomène Le Pen !
Cioran. Que n'aura-t-on pas dit de Cioran ? Pour certains commentateurs, ce n'est qu'un écrivain qui publie des aphorismes médiocres, ce n'est que l'auteur d'une « philosophie pour concierges » ; pour d'autres, il est le meilleur écrivain vivant de langue française. Entre ces deux extrêmes, on trouve un immense éventail d'opinions de valeurs diverses. Ce que l'on n'avait jamais dit de Cioran, c'est qu'il était fasciste. Mais aujourd'hui, c'est fait ; on ne voit pas bien pourquoi, mais un politicien libéral espagnol lui a attribué la paternité idéologique du phénomène Le Pen ![Ci-contre : Cioran à Paris en 1949, au moment où venait de paraître son premier ouvrage en français, le Précis de décomposition. Cioran a appris le français grâce à un invalide de la Grande Guerre, virtuose de la langue basque et de la langue française, érotomane délicat qui arpentait les boulevards de Montparnasse. Cet homme l'a exhorté à relire les auteurs du XVIIe siècle, à imiter leur perfection. Dans un interview accordé au philosophe allemand Gerd Bergfleth, Cioran rend hommage à cet invalide du Pays Basque, ce puriste de la langue et de la grammaire (Emil M. Cioran, Ein Gespräch, geführt von Gerd Bergfleth, Rive Gauche/Konkursbuchverlag, Tübingen, 1985 ; Cioran a donné cette entrevue en langue allemande ; le texte original en est donc le texte allemand).]

Le renversant faux-pas du politicien libéral
Ce n'est pas une blague. Cette opinion a bien été émise : par Lorenzo Bernaldo de Quirós, membre de la Junta Directiva del Club Liberal de Madrid qui fait bruyamment état de ses opinions philosophiques très particulières dans le supplément « Papeles para la Libertad » publié chaque semaine par le quotidien Ya (1). Dans l'un de ses articles, intitulé « Plus jamais Auschwitz », paru le 12 janvier 1988, Bernaldo de Quirós lançait un avertissement au monde libre, menacé par un danger imminent : Le Pen, locomotive d'un fascisme populiste, inspiré à son tour par un autre fascisme, plus dangereux, le fascisme intellectuel dont Bernardo de Quirós attribuait la responsabilité à une constellation étrange d'auteurs très différents les uns des autres : « Montherland » (il veut sans doute dire Montherlant), Fernando Savater (2), Alain de Benoist et le penseur roumain Emil Cioran. Et de citer en note l'œuvre de ce dernier El aciago domingo (il se réfère peut-être à El aciago Demiurgo, Le mauvais démiurge en trad. esp.). Par le biais d'une opération grossière d'amalgame des concepts, Bemaldo de Quirós les rend tous responsables (de façon plus ou moins importante) de la paternité des idées anti-chrétiennes, tragiques et anti-libérales qui menacent le bon ordre régnant en Occident : l'ordre libéral.
Le raisonnement de Bemaldo de Quirós n'est pas habituel. Peut-être plus accoutumé au tissu grossier des discours économistes qu'aux subtilités et aux clairs-obscurs de la pensée philosophique, le madrilène libéral confond tout avec tout pour élaborer vaille que vaille la réflexion suivante (qui n'est pas toujours explicite) dans son article : 1) le phénomène du populisme xénophobe devient à la mode (?) en France ; 2) en réalité, il y a plus important que cette vague politique immédiatement perceptible : l'existence en coulisse de penseurs comme Montherlant ou Alain de Benotst qui défendent des idées anti-chrétiennes et « aristocratisantes » ; 3) or, de Benoist « copie Cioran » ; et Savater aurait sa part de responsabilités dans la popularisation de Cioran en Espagne ; 4) ces auteurs s'appuient sur les thèses des historiens révisionnistes (?) qui nient l'holocauste juif (des références, svp…) ; 5) comme on ne peut plus défendre aujourd'hui une xénophobie antijuive, on prêche pour une xénophobie anti-africaine, et nous voici revenus à Le Pen, la boucle est bouclée. Naturellement, Bemaldo de Quirós n'écrit pas « Cioran est fasciste » mais son discours implicite est transparent lorsqu'il dit que de Benoist (qui, par conséquent, serait aussi « fasciste ») copie Cioran.
Si nous devions juger la pensée libérale en nous basant sur des opinions comme celle-là, nous devrions conclure que le libéralisme espagnol ne peut générer qu'une pensée malade, peureuse et hystérique devant tout ce qui s'oppose à l'empire du burger et de Superman. En effet, ni de Benoist ni Savater ni probablement Cioran, ne sont d'accord avec l'empire du dollar. Mais ce n'est pas une raison pour les prendre pour des confrères en conspiration et, moins encore, d'en faire les maîtres occultes de Le Pen qui, lui, par contre, ne manifeste guère son désaccord à l'égard de la domination du dollar, du nationalisme jacobin, du christianisme à la française et de Superman.
Le bourreau
Mais la question que pose directement l'article de notre libéral madrilène n'est pas aussi intéressante que la question de fond de tout ce problème : qu'est-ce qui les irrite ? Qu'est ce qui les rend nerveux ? Qu'est ce qui les dérange tant dans le discours de Cioran, eux, les défenseurs du statu quo ? Il ne s'agit pas ici de défendre Cioran. Dans un article consacré au philosophe roumain, Savater écrivait : « Comment défendre les idées d'une personne qui soutient que s'accrocher à une idée, c'est se construire un échafaud dans le cœur, de celui qui défend les droits de la divagation contre les certitudes du système et propose comme unique fondement de ses opinions, l'humour momentané et spontané qui les suscite ? » (3). Non, Cioran est drôlement indéfendable. Et c'est sa première grande vertu, sa première grande opposition à l'ordre qui juge tout selon que c'est bon ou mauvais pour le futur historique (et hypothéqué) de l'ordre libéral. C'est probablement bien malgré lui qu'Emil Cioran se mue en bourreau cruel du système qui l'entoure. Il ne pouvait en être autrement. Le courageux apatride roumain vit dans une civilisation qui adore l'homme, qui idolâtre le sens de l'histoire, qui s'enfonce confortablement dans le coussin de l'Occident. Cioran méprise l'homme, l'histoire et l'Occident. Voilà ses trois péchés capitaux.
L'avenir du cyanure
« L'homme sécrète du désastre » écrit Cioran (SA 801), et il affirme « Je crois au salut de l'humanité, à l'avenir du cyanure… » (SA 806). Le mépris de l'humain, la conviction que l'homme, cette « unité de désastre » (PD 602), a déjà donné le « meilleur » de lui-même, voilà une constante qui se répète de manière insistante dans l'œuvre de Cioran. « Engagé hors de ses voies, hors de ses instincts — écrit-il dans le Précis de décomposition —, l'homme a fini dans une impasse. Il a brûlé les étapes… pour rattraper sa fin ; animal sans avenir, il s'est enlisé dans son idéal, il s'est perdu à son propre jeu. Pour avoir voulu se dépasser sans cesse, il s'est figé ; et il ne lui reste comme ressource que de récapituler ses folies, de les expier et d'en faire encore quelques autres » (PD 736). Dans Valéry face à ses idoles (1970), il insiste : « Quand l'homme aura atteint le but qu'il s'est assigné : asservir la Création — il sera complètement vide : dieu et fantôme » (EA 1568). « Il n'est absolument pas nécessaire d'être prophète — écrit-il ailleurs — pour discerner clairement que l'homme a déjà épuisé le meilleur de lui-même, qu'il est en train de perdre sa contenance, s'il ne l'a déjà pas perdue » (4). L'humanité, par ses propres mérites, est « éjectée enfin de l'histoire » (CT 1157).
Histoire : banalité et apocalypse
La passion moderne pour l'histoire est précisément une autre des cibles préférées de Cioran. Pour lui, l'histoire est un « mélange indécent de banalité et d'apocalypse » (PD 582). Le progrès et la modernité, formes de civilisation construites sur le culte de l'histoire et de sa contemplation utopique dans l'attente d'une fin heureuse, sont autant de bourbiers où naufrage la consternante espérance humaine. « Tout pas en avant — écrit Cioran —, toute forme de dynamisme comporte quelque chose de satanique : le “progrès” est l'équivalent moderne de la Chute, la version profane de la damnation » (CT 1087). La même logique de la chute obscurcit le fantôme de la modernité : « être moderne, c'est bricoler dans l'Incurable » (SA 753). Inéluctabilité de la marche de l'histoire ? « Quiconque, par distraction ou incompétence, arrête tant soit peu l'humanité dans sa marche, en est le bienfaiteur » (SA 774), affirme Cioran, en lançant un voile de terreur sur les consciences de ceux qui croyaient avoir construit la meilleure civilisation qui ait jamais existé sur terre.
Le spectre de l'Occident
Cette civilisation, c'est l'Occident, « un possible sans lendemain » (SA 773), une civilisation née sur les dogmes de l'humanisme et de l'historicisme. Tous deux nous apparaissent aujourd'hui comme de vieux squelettes décharnés.
« Les vérités de l'humanisme — dit Cioran —, la confiance en l'homme et le reste, n'ont encore qu'une vigueur de fictions, qu'une prospérité d'ombres. L'Occident était ces vérités : il n'est plus que ces fictions, que ces ombres. Aussi démuni qu'elles, il ne lui est pas donné de les vérifier. Il les traîne, les expose, mais ne les impose plus ; elles ont cessé d'être menaçantes. Aussi, ceux qui s'accrochent à l'humanisme se servent-ils d'un vocable exténué, sans support affectif, d'un vocable spectral » (SA 774).
Image de ce spectre : l'homme occidental, un homme tourmenté, qui « fait penser à un héros dostoïevskien qui aurait un compte en banque » (SA 748). De la même façon, tous les philosophes utopiques qui prétendirent trouver dans l'histoire un sens positif, une direction linéaire vers le meilleur, périssent : « Il y a plus d'honnêteté et de rigueur dans les sciences occultes que dans les philosophies qui assignent un “sens” à l'histoire » (SA 804) ; le matérialisme historique ne suppose pas en réalité un changement qualitatif quant à la providence divine : « c'est changer simplement de providentialisme » (EA 1524). L'Occident meurt, installée à cheval sur ces deux spectres. « C'est en vain que l'Occident se cherche une forme d'agonie digne de son passé » (SA 769) ; mais personne n'a intérêt à s'éveiller : « l'Europe, indifférente aux Cassandres, persévère allègrement dans son agonie, et cette agonie, si obstinée, si durable, équivaut peut-être à une nouvelle vie » (EA 1547). Cette féroce réalité que Cioran nous dévoile dans l'Occident contemporain, éclaire d'une nouvelle lumière des aspects plus quotidiens comme celui du colonialisme occidental dans ce qu'on appelle le Tiers Monde :
« L'intérêt que le civilisé porte aux peuples dits arriérés est des plus suspects. Inapte à se supporter davantage, il s'emploie à se décharger sur eux du surplus des maux qui l'accablent, il les engage à goûter à ses misères, il les conjure d'affronter un destin qu'il ne peut plus braver seul » (CT 1084).
On comprend que, considérée de manière superficielle, cette thèse de Cioran puisse rappeler des filons bien précis de la pensée « réactionnaire » ou « traditionnelle ». En effet, il connaît les mystiques et se méfie des utopies ; il pense que l'homme est plus un animal qu'un saint, mais il croit que le théologien nous comprend mieux que le zoologiste ; on pourrait donc le considérer comme un de Maistre tourmenté et faible (au sens postmoderne de l'expression). Il contribue également à la confusion quand il écrit : « Tout semble admirable et tout est faux dans la vision utopique ; tout est exécrable, et tout a l'air vrai, dans les constatations des réactionnaires » (EA 1544) ; et quand il voit dans la politique « la malédiction par excellence d'un singe mégalomane » (EA 1598). Mais il faut laisser cette impression immédiatement de côté si nous voulons comprendre le reste de la férocité cioranesque. Cioran est, en effet, un bourreau aux yeux du troupeau occidental, et d'une certaine façon, un « réactionnaire » au sens pur du terme, cependant toute sa violence ne provient pas d'une foi, elle est le résultat d'une immense déception, d'une condition angoissante, celle de l'« arrêté » à perpétuité au-dessus de l'abîme du monde. Dans cette perspective, Cioran n'est plus un bourreau, mais un martyr ; dans ce cas, il faut écarter de ce terme tout ce qui pourrait nous suggérer héroïsme, ascèse et salut. Lui-même se définit comme « un parvenu de la névrose, un Job à la recherche d'une lèpre, un Bouddha de pacotille, un Scythe flemmard et fourvoyé » (SA 784).
Entre le dilettantisme et la dynamite
Élément déterminant dans l'angoisse de Cioran : sa condition d'apatride. « Un penseur — écrit-il — s'enrichit de tout ce qui lui échappe, de tout ce qu'on lui dérobe : s'il vient à perdre sa patrie, quel aubaine ! » (EA 1523). Orphelin de son appartenance et d'un enracinement, Cioran ne doit défendre aucune vision du monde, aucun préjugé, aucune certitude. Savater a tort d'y voir une libération ; pour Cioran, oui, ça l'est, mais à un prix très élevé : le droit au Temps et à l'histoire : « Les autres tombent dans le temps ; je suis, moi, tombé du temps » (CT 1152). Léger, détaché du temps et de l'espace, Cioran ne trouve pas d'appui non plus dans les idéologies. Ici aussi, après avoir connu la fascination des extrêmes, il s'est « arrêté quelque part entre le dilettantisme et la dynamite » (SA 759). Ni Dieu ni vie n'existent dans cet endroit. La vie est une « combinaison de chimie et de stupeur » (SA 756), qui fait de la leucémie « le jardin où fleurit Dieu » (SA 764). Quant à Dieu lui-même…
Face à l'orgueil divin
« L'odeur de la créature nous met sur la piste d'une divinité fétide » (SA 780). Ce cruel aphorisme de Cioran peut résumer toute l'amertume de celui qui estime inconcevable une divinité seulement intelligible au départ de l'humain. Cioran se rebelle contre la bonté du créateur du mal :
« L'idée de la culpabilité de Dieu n'est pas une idée gratuite, mais nécessaire et parfaitement compatible avec celle de sa toute-puissance : elle seule confère quelque intelligibilité au développement historique, à tout ce qu'il contient de monstrueux, d'insensé et de dérisoire. Attribuer à l'auteur du devenir la pureté et la bonté, c'est renoncer à comprendre la majorité des événements, et singulièrement le plus important : la Création » (EA 1528).
Face à l'orgueil divin, Cioran n'hésite pas à s'inscrire sur les listes du diable :
« J'ai eu beau fréquenter les mystiques, dans mon for intérieur j'ai toujours été du côté du Démon : ne pouvant pas l'égaler par la puissance, j'ai essayé de le valoir du moins par l'insolence, l'aigreur, l'arbitraire et le caprice » (EA 1628).
Et cependant celui qui croit voir en Cioran une nostalgie du sacré ne se trompe pas : « Quel dommage que, pour aller à Dieu, il faille passer par la foi ! » (SA 783) ; il écrit et ajoute : « Si je croyais en Dieu, ma fatuité n'aurait pas de bornes : je me promènerais tout nu dans les rues… » (SA 786). Nostalgie ou furie — chez Cioran, c'est la même chose — l'écueil divin est probablement la raison ultime de sa pensée, de son attitude devant la vie et de son attitude face à sa propre œuvre. Une œuvre à laquelle Cioran accorde une importance énorme, non à cause de son contenu mais à cause de son effet cathartique, de sa fonction matérialisatrice de la rébellion intime. Et c'est ici, dans cette révolte, que l'on doit s'installer pour comprendre Cioran, pour situer sa férocité et son désir délibéré du scandale.
Vengeance en paroles
Mais avant tout : devons-nous comprendre Cioran ? Il est difficile d'aborder avec bonne conscience l'épineux Roumain. Dans Syllogismes de l'amertume, il prévient les audacieux : « Tout commentaire d'une œuvre est mauvais ou inutile, car tout ce qui n'est pas direct est nul » (SA 751). Et dans une lettre à Savater, il affirme à propos de Borgès une chose qui pourrait bien s'appliquer à lui-même : « À partir du moment où tout le monde le cite, on ne peut plus le citer, ou, si on le fait, on a l'impression de venir grossir la masse de ses “admirateurs”, de ses ennemis » (EA 1605). Faisons donc abstraction de la vantardise bien compréhensible de l'analyste, car nous ne pouvons éviter de commenter l'auteur. Et signalons, qu'en écrivant, Cioran se libère, se rebelle, se venge, se drogue ; c'est là la raison de son œuvre :
« J'écris pour ne pas passer à l'acte, pour éviter une crise. L'expression est soulagement, revanche indirecte de celui qui ne peut digérer une honte et qui se rebelle en paroles contre ses semblables et contre soi. (…) Je n'ai pas écrit une seule ligne à ma température normale. (…) Écrire est une provocation, une vue heureusement fausse de la réalité qui nous place au-dessus de ce qui existe et de ce qui nous semble être. Concurrencer Dieu, le dépasser même par la seule vertu du langage, tel est l'exploit de l'écrivain, spécimen ambigu, déchiré et infatué qui, sorti de sa condition naturelle, s'est livré à un vertige superbe, déconcertant toujours, quelquefois odieux » (EA 1625).
En dernière extrémité, nous pourrions dire que Cioran écrit selon sa mauvaise humeur : « Je n'ai rien inventé — écrit-il —, j'ai été seulement le secrétaire de mes sensations » (Écartèlement). Et il ne s'agit pas d'un faux jugement mais d'un jugement insuffisant. Les grogneries littéraires de Cioran ont porté une certaine critique, globale et aimable, si bien qu'en réalité, toute sa férocité n'est qu'un simple exercice de style ; il refuse ainsi toute espèce de vraisemblance avec la passion de l'apatride roumain, il réduit tout son discours à une simple pratique ludique ; il insulte par conséquent le fustigateur de la condition humaine et il méprise le contenu de l'hérésie pour faire l'éloge de son expression propre. Banal. La littérature carnivore de Cioran est volontairement hérétique ; mais même si elle ne l'était pas, toute sa capacité subversive s'y trouve, c'est indéniable, elle fait son effet et parvient à convaincre ceux qui ne sont pas d'accord car, comme l'écrit Cioran, « l'hérésie représente l'unique possibilité de revigorer les consciences, […] en les secouant, elle les préserve de l'engourdissement où les plonge le conformisme » (EA 1549). En tout cas, ce ne sera pas l'auteur qui nous enlèvera ce doute. Cioran juge délibérément avec cette ambivalence, avec cette ambiguïté. Il sait que c'est la seule façon de durer. Dans son essai sur Joseph de Maistre, il écrit quelque chose qu'il semble dire à propos de lui-même :
« sans ses contradictions, sans les malentendus qu'il a, par instinct ou calcul, créés à son propre sujet, son cas serait liquidé depuis longtemps, sa carrière close, et il connaîtrait la malchance d'être compris, la pire qui puisse s'abattre sur un auteur » (EA 1520).
Qu'ils s'alarment…
C'est évident : face à une réalité aussi complexe que celle de l'écrivain Cioran, les propos de tous les Bernaldos de Quirós circulant dans ce vaste monde ne sont que des mesquineries pour feuilletons américains. Autre évidence : impliquer l'apatride tourmenté dans ce genre de questions politiciennes soulevées par exemple par un Le Pen relève de la plus solennelle des bêtises. Les racines de la philosophie de Cioran, cette philosophie tragique et anti-humaniste, qui semble tellement effrayer nos bons libéraux espagnols, véhicule une culture qui est européenne jusque dans la moelle, depuis 5.000 ans au moins ! Et confondre cette philosophie plurimillénaire avec un politicien français de cette fin de siècle, peu porté par ailleurs sur les excès intellectuels, est une exagération un peu alarmante. Mais c'est peut-être de cela qu'il s'agit : alarmer les gens. Non pas d'alarmer les gens parce que telle ou telle philosophie existe envers et contre la volonté des conformistes, mais d'alarmer les bonnes consciences, couleur de rose, parce qu'un Cioran, génial et cruel, récupère, illustre, diffuse et affirme la seule chose qui, aujourd'hui, peut conjurer le fantasme de l'Occident : la tragédie, l'anti-humanisme, l'éloge de la Chute, toutes sorties valables pour une civilisation qui, en effet — bien qu'elle ne veuille pas s'en rendre compte — est déjà tombée. Qu'ils s'alarment. Peu importe. Plus personne n'écoute. Pendant ce temps, la pensée de Cioran, une pensée barbare, éloignée des chaires et des conférences mondaines, devenue paradoxalement dangereuse parce qu'elle est désormais commercialisable (et peut-être commercialisable aujourd'hui précisément parce qu'elle est barbare), mine convictions et bétonnages. Cette « herméneutique des larmes » (ainsi Cioran définit-il son style dans Des larmes et des saints) paraît s'emboîter à la perfection dans les angoisses contemporaines.
En 1934, dans une œuvre encore écrite en roumain, Pe culmile disperării (Sur les cimes du désespoir), Cioran écrivait : « Celle-ci [l'existence] serait-elle pour nous un exil, et le néant une patrie ? » (CD 90). Aujourd'hui, nous avons tous déserté l'existence ; aujourd'hui nous habitons tous le néant. Devons-nous nous étonner que l'angoisse de Cioran nous apparaisse comme sœur jumelle de notre propre angoisse ? Les réactionnaires du XIXe siècle ont réagi contre le XVIIIe siècle en proposant un retour au XVIe siècle. Si aujourd'hui, en fin de modernité, il faut être réactionnaire (et soyons provocant : il n'est jamais mauvais d'être « réactionnaire », de réagir face aux phénomènes de déclin), seul peut l'être — et l'être dignement — le style de Cioran : sans propositions, sans alternatives. Le néant contre le vide ; l'angoisse doublée du râle face à la mort de toute illusion. C'est cela, finalement, la véritable dimension de Cioran : l'esthétique — puisqu'il n'y a plus d'éthique — menaçante d'une barbarie, en apparence fondée sur les Lumières, qui, seule, peut mettre un point final tragique à plus (ou beaucoup plus) de deux cents ans de civilisation à l'enseigne de l'Aufklärung.
► José Javier Esparza, Orientations n°13, 1991.
◘ Nota bene : abréviations pour les titres : SA pour Syllogismes de l'amertume, PD pour Précis de décomposition, EA pour Exercices d'admiration, CD pour Sur les cimes du désespoir. Le nombre qui suit renvoie à la pagination des Œuvres parues chez Gallimard, coll. Quarto (1995).
• Notes :
(1) Malgré son caractère superficiel fréquent, la lecture de ce supplément est à recommander. On y découvre tous les préjugés classiques de la droite libérale espagnole qui, aujourd'hui, affectée par la « vague Reagan », tente de remplir sa malle doctrinale de thèses réductionnistes et économicistes, propres à l'anti-pensée libérale. Antérieurement, ce même supplément avait consacré à la post-modernité, nouveau monstre à trois têtes, une série d'opinions vraiment délirantes.
(2) La persécution de Femando Savater parait s'être transformée en nouveau sport national. L'année passée et au cours d'un hommage rendu à Ché Guevara, Savater fut durement apostrophé et qualifié de « fasciste » par une partie du public présent, tout cela pour avoir dit que le Ché était « comme un bon Rambo ». Peu après, le politicien démocrate-chrétien et historien pro-américain Javier Tussell s'en prenait à l'auteur de La Tarea del héroe (La Tâche du héros) en l'accusant d'« irresponsabilité intellectuelle » à cause de ses déclarations critiques envers la fièvre monarchique espagnole. Aujourd'hui, Bemaldo de Quirós le rend en partie responsable du parrainage de Le Pen parce qu'« il copie Cioran » (?), Sans doute, la pensée de Savater est très critiquable mais, à notre avis, pas à cause de ces trois « crimes de pensée » qu'on lui impute à droite comme à gauche et qui constituent, justement, autant d'élans de lucidité chez ce philosophe qui suscite la polémique.
(3) F. Savater, « El indefendibile e indefenso Cioran », in Quimera, 4, febrero 1981.
(4) « L'enfer du corps », essai paru dans Le Monde, 3 février 1984.
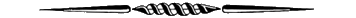
Au beau milieu de notre société de consommation et de plaisir, il était le héraut du déclin et du doute. L'écrivain roumain Emil Cioran est mort à Paris, à l'âge de 84 ans, le 20 juin 1995. Rien que les titres de ses livres, Précis de décomposition, Syllogismes de l’amertume ou De l'inconvénient d'être né, pourraient déclencher une dépression. Face à un homme comme Cioran, qui, selon sa propre confession, considère toute rencontre avec un autre homme est une sorte de « crucifixion », on est en droit de se poser la question que Nietzsche lui-même nous a suggérée : comment est-il devenu ce qu'il était ?
Déjà à l'âge de dix ans, Cioran a vécu une sorte d'exclusion du Paradis. Il a dû quitter le monde de son enfance pour s'en aller fréquenter le lycée de Sibiu. Cioran décrit ce grand tournant de sa vie d'enfant : « Quand j'ai dû quitter ce monde j'avais le net pressentiment que quelque chose d'irréparable venait de se produire ». Cet « irréparable » était très étroitement lié au monde simple des paysans et des bergers de son village natal. Plus tard, Cioran s'est exprimé sans ambigüité sur le monde de son enfance : « Au fond, seul le monde primitif est un monde vrai, un monde où tout est possible et où rien n'est actualisable ».
Autre expérience décisive dans la vie de Cioran : la perte de la faculté de sommeil à l'âge de 20 ans. Cette perte a été pour lui « la plus grande des tragédies » qui « puisse jamais arriver à un homme ». Cet état est mille fois pire que purger une interminable peine de prison. Voilà pourquoi son livre Sur les cimes du désespoir a été conçu dans une telle phase de veille. Cioran considérait que ce livre était le « testament d'un jeune homme de vingt ans » qui ne peut plus songer qu'à une chose : le suicide. Mais il ne s'est pas suicidé, écrit-il, parce qu'il ne pouvait exercer aucune profession, vu que toutes ses nuits étaient blanches. Elles ont été à l'origine de sa vision pessimiste du monde. Et jamais, dans sa vie, Cioran n'a été contraint de travailler. Il a accepté toute cette « peine », cette « précarité », cette « humiliation » et cette « pauvreté » pour ne pas devoir renoncer à sa « liberté ». « Toute forme d'humiliation » est préférable « à la perte de la liberté ». Tel a été le programme de sa vie, aimait-il à proclamer.
Avant d'émigrer en France en 1937, Cioran écrivait Larmes et Saints, un livre qu'il considérait être le résultat de sept années d'insomnie. Ce que signifie l'impossibilité de dormir, Cioran l'a exprimé : la vie ne peut « être supportable » que si elle est interrompue quotidiennement par le sommeil. Car le sommeil crée cet oubli nécessaire pour pouvoir commencer autre chose. Ceux qui doivent passer toutes leurs nuits éveillés finissent par segmenter le temps d'une manière entièrement nouvelle, justement parce que le temps semble ne pas vouloir passer. Une telle expérience vous modifie complètement la vie. Tous ceux qui veulent pénétrer dans l'œuvre de Cioran, doivent savoir qu'il a été un grand insomniaque, qu'il en a profondément souffert.
Les nuits de veille de Cioran sont aussi à l'origine de son rapport particulier à la philosophie. Celle-ci ne doit pas aider Cioran à rendre le vie « plus supportable ». Au contraire, il considère que les philosophes sont des « constructeurs », des « hommes positifs au pire sens du terme ». C'est la raison pour laquelle Cioran c'est surtout tourné vers la littérature, surtout vers Dostoïevski, le seul qui aurait pénétré jusqu'à l'origine des actions humaine. La plupart des écrivains de langues romanes ne sont pas parvenu à une telle profondeur, écrivait Cioran. Ils sont toujours resté à la surface des choses, jamais ils n'ont osé s'aventurer jusqu'aux tréfonds de l'âme, où l'on saisit à bras de corps le « démon en l'homme ».
1937 a aussi été l'année où Cioran a dû reconnaître que la voie religieuse et mystique lui était inaccessible. Comme il le constatait rétrospectivement, il n'était tout simplement « pas fait pour la foi ». Car avoir la foi était au fond un don, écrivait Cioran, et on ne peut pas vouloir croire, ce serait ridicule.
Quand on prend connaissance de cet arrière-plan, on ne s'étonnera pas que Cioran revient sans cesse sur son expérience de « néant », du « néant » qui ne devient tangible que par « ennui ». Du point de vue de Cioran, on ne peut supporter la vie que si l'on cultive des illusions. Et si l'on atteint la « conscience absolue »,« lucidité absolue », alors on acquiert la « conscience de néant » qui s'exprime comme « ennui ». Cependant, l’expérience de l'ennui découle d'un doute, d'un doute qui porte sur le temps. C'est à se sentiment fondamental que pensait Cioran quand il disait qu'il s'était « ennuyé » pendant toute sa vie.
On ne s'étonne pas que Cioran avait un faible pour les cimetières. Mais ce faible n'a rien à voir avec les attitudes prises aujourd'hui par les Grufties [équivalent de l’appellation “corbeaux” en France : nom donné à la fin des années 80 à la mouvance “gothique” mâtinée de romantisme noir, aujourd'hui appelée dark culture]. Pour notre auteur, il s'agissait surtout d'un changement de perspective. C'est justement dans une situation de douleur de l'âme, d'une douleur qui semble immense, démesurée, que le changement de perspective constitue la seule possibilité de supporter la vie. Quand on adopte la perspective du « néant », tout peut arriver. Dans une certaine mesure, on en arrive à considérer comme parfaitement « normal » la plus grande des douleurs, à exclure toutes les « déformations par la douleur » qui conduisent au « doute absolu ».
Au cours des dernières années de sa vie, Cioran n'a plus rien écrit. Il ne ressentait plus « l'impérativité de la souffrance » qui fut toujours le moteur de sa production littéraire. Peut-être a-t-il tiré les conséquences de ses propres visions : nous vivons effectivement dans une époque de surproduction littéraire, surproduction absurde, totalement inutile.
► Michael Wiesberg, Nouvelles de Synergies européennes n°13, 1995.
(article issu de Junge Freiheit n°27/1995)
 pièces-jointes :
pièces-jointes : Cioran, le mystique des Carpathes
Cioran, le mystique des Carpathes[ci-contre : Untitled, Rockwell Kent, n.d.]
La sécheresse et l'inexactitude du bois qui brûle. Ainsi pourrait-on qualifier la manière d'Emil Cioran, dont l'édition des Œuvres (Gallimard, coll. Quarto, 1995) rappelle opportunément qu'il fut, avec Beckett et Valéry, l'un des plus flamboyants stylistes de la langue française au XXe siècle, et, avec Maurice Blanchot, l'un des plus solitaires, tant dans sa vie personnelle que dans celle des Lettres. Les solitaires attirent par une fascination de couleuvre, le premier des pièges qu'ils tendent à leur lecteur, et qui fait croire en une force. Mais, moins qu'un héros, Cioran fut plus fragile que quiconque dans son fanatisme de l'inessentiel. De cette fragilité même il a fait vertu : quand il emmène vers la plongée des vertiges qu'il sait, comme nul autre, construire à la croisée de toutes les précarités, c'est pour laisser à quiconque attend de le suivre et pour répudier toute vérité autre que l'expérience même de ce vertige.
Né en 1911 d'un père prêtre orthodoxe, puis collégien en Transylvanie, étudiant à Bucarest, diplômé de philosophie avec un mémoire sur Bergson, Cioran entame son œuvre d'écrivain à 21 an, en roumain, avec Sur les cimes du désespoir. Reliquat romantique que cette évocation des cimes, mais une entrée fracassée dans l'expérience de l'écriture ; en-deçà de la philosophie et du jeu des concepts, il éprouve que seule l'esthétique peut imposer la perception des plus fortes contradictions de l'existence, dont cette première : « Le monde aurait dû être n'importe quoi, sauf ce qu'il est ». Le désespoir, qu'il cultive une seconde fois en roumain avec Le livre des Leurres (1936), ne se confond pas chez lui avec l'imbécillité diététique d'une déficience telle que le malheur, cette sorte de théâtre prolongé en aspiration fidéiste, avec, en revers, une promesse de bonheur du monde, dégoûtée ou non, acceptée ou refusée, affirmée ou niée. Cioran agit d'emblée le désespoir en son acception la plus exacte, l'acte de ne pas espérer. Si le monde n'est, en nous, qu'image, celle fabriquée par une chimie organique où la sensibilité a sa part, force est de constater que l'espérance et son contraire, avec leurs métaphysiques calculées, ne résultent elles-mêmes que d'une imagination déviée de sa course. Plus que sens ou non-sens, être ou non-être, la vie en son pressentiment le plus intime relève de son acte propre. Lui donner sens ou non-sens a priori serait lui refuser de se bâtir elle-même, la contraindre dans l'écheveau de significations préalables où s'instille sa perte.
Par son renoncement hypnotique à l'égard de tout ce qui séduit l'intellect ou la sensibilité, et par la forme artistique — qui seul subsiste de son aventure, personnelle, corporelle, et comme hallucinée — donnée à un détachement durement conquis et sans cesse remis à plat dans ses représentations, Cioran est entré de plain-pied dans la catégorie des inactuels. II a couru le risque de se statufier vivant, au plus près de l'extrême, d'une inacceptable conciliation avec ses propres vérités. Des larmes et des saints (1938) puis Le Crépuscule des pensées (1940) réinvestissent le paradoxe des deux premiers livres, et l'écrivain y côtoie les tentations du narcissisme. « Le monde est un non-lieu universel », écrit-il. Est-ce si assuré ? Ce monde, en effet, y réclame son lieu d'aventure, il y charge sa propre quête. Le Bréviaire des vaincus, écrit en roumain à Paris entre 1941 et 1944, publié en français quarante ans plus tard, comprend le risque du faux-pas : « Ma faute : j'ai détroussé le réel. J'ai mordu dans toutes les pommes des espérances humaines (…). Dévoré par le péché de nouveauté, j'aurais bien retourné le ciel comme un gant ». Cioran perçoit combien le comble du rien exige une présence, ou alors, il n'est plus D'où cette prudente résolution du Bréviaire : « Entre l'âme du vide et le cœur du néant ! ».
Difficile tactique à l'égard de soi-même sur le chemin du dépouillement : Cioran délaisse sa langue maternelle et entreprend d'écrire en français. Il s'y invente l'obligation d'un ramassement, la multiplication de raccourcis dont la fascination exercée sur le lecteur tient à sa manière rigoureuse de refuser ce qu'elle affirme, d'acquiescer à ce qu'elle manque et de se déprendre de ce qu'elle vise. La vie comme coup du sort, l'inaptitude de la volonté, un regard morgue sur les leurres du bonheur et du malheur, tous les thèmes d'un stoïcisme dépouillé des revendications de l'imposture, Cioran va les pousser comme des fleurs d'opium rejetées vers l'avant d'une écriture sobre, sans fin révoquée dans sa tentation d'avoir sais ou possédé, ou fixé une illumination. De la vieille maxime d’Épictète conseillant à la raison triomphante d'en rabattre dans ses prétentions et de mieux distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, il retiendra la seconde injonction, qui lui fait plier toute son énergie à se convaincre que rien ne dépend de lui, sauf l'illusion de ne dépendre de rien. Emil Cioran, ou le maximalisme de l'infortune.
Comment se donner matière à vivre ? Le Précis de décomposition, premier livre écrit en français, publié en 1949, fixe quelques règles : se défaire de l'histoire, des vérités, des doutes, pratiquer l'envers des choses, l'ironie, la distance habitée, ne pas se venger du néant en l'érigeant en loi et conserver, par la-dessus, la politesse de vivre malgré un dénouement « prévu, effroyable et vain ». Rien, évidemment, dans tout cela, qui rassurerait une troupe sociale, ardente au salut du monde ou au bonheur des hommes. De ce versant antipolitique de son œuvre, Cioran n'a cure ; ou plutôt est-ce là son souci constant, de se défaire d'un tel souci. Réduit à une logique, le Précis montrerait une addition d'impasses et de contradictions ; mais lu dans son mouvement même, haché, désarchitecturé, il déploie une expérience mystique provocante qui tente de maintenir l'acte de vivre en-deçà de toutes les consolations que lui proposent les arts ou les croyances. La vie commune en société s'ébroue certes à l'inverse et fabrique toutes sortes d'idées propres à rassurer. Au jugement de Cioran, elle a tort. À refuser l'insatisfaction, on trouve facilement matière à croire ; mais à croire en quoi que ce soit, on se défausse de l'immédiateté de la vie, on masque la brutalité de ce qui n'est jamais advenu : soi-même, pour l'endiguer dans l'erreur et retourner vers l'ennui. Contre la seule ligne de la logique, étouffante de certitudes toujours contredites par l'expérience, la cohérence de la sagesse impose d'autres dimensions d'examen : il faut qu'en chaque acte ou pensée soit impliquée la totalité de ce qu'ils accomplissent, et surtout, négativement, la globalité de ce qu'ils manquent, de ce qui reste hors de portée. De là cette écriture si particulière à Cioran, où concourent tous les moyens de la rhétorique : l'affirmation brève, le syllogisme détourné, la harangue, le précepte, la citation qui cheville sans démontrer, la négation des vérités ordinaires, le retournement des croyances religieuses, l'aménagement des contraires, l'exaltation des contradictoires. Ce mouvement toujours tremblé emmène de l'intellect au sensible, puis du sensible à l'intellect, dessinant un abîme entre ce que la raison dévoie de l'expérience en se faisant maxime, et ce que l'expérience ignore d'elle même en échouant à instituer la raison de ses raisons. Ce qui est à saisir, la ponctualité instantanée de l'existence, cela échappe au langage, mais dans le mouvement même où l'instant qui passe ourdit l'impératif de s'exprimer, auquel on n'échappe pas. Autant dire que ce qui fait vivre est « au-delà de tout, au-delà de l'être lui-même », selon la leçon de Grégoire de Nazianze. S'il n'en a pas gardé le Dieu, Cioran a conservé de son éducation orthodoxe un dépôt sensible, une part de théologie négative qui exacerbe chez lui la désignation de ce qui cause l'étrange agitation d'exister : l'impossible clôture de soi sur soi, de soi sur le monde, du monde sur lui-même. De quoi se déduit la seule vérité possible : que toute vérité, toute espérance, toute croyance relèvent d'une imposture comparable à celle d'un tranquillisant pharmaceutique ; le seul apprentissage possible du monde et de la vie, de l'existence même et de son sens, se passe de toute érudition, qu'elle soit biologique, philosophique ou littéraire ; c'est « un savoir sans connaissances » (1) qui nous met en présence permanente de notre radicale destructibilité, laquelle contredit l'indestructible envie de vivre que promènent tous ceux qui ne se suicident pas.
C'est le privilège des poètes de s'adosser ainsi à l'incompréhensible pour relancer sans cesse, en travers de leur propre route, le défi de ne pas s'y perdre, et celui d'y faire apparaître une clairière, fût-ce pour l'embraser aussitôt d'un feu dévastateur. Cioran ne s'est senti chez lui ni dans sa société, ni dans la culture usuelle. À Maistre et à l'Hindouisme, à Chestov, aux moralistes français, à Pascal et à Nietzsche, à tous ceux qui, éconduits de la mémoire ordinaire, ne furent pas tenus par l'époque pour des maîtres à méditer, il demanda des conseils pour vivre un peu. Il a brandi avec une sérénité intransigeante non point l'orgueil d’être soi-même dans une société morte, ni l'exaspération, jusqu'au tournis, de la fascination du vide, mais la simple revendication d'échouer dans la rédaction de tout dernier mot possible. Autant dire que sa seule loi fut de n'en avoir jamais fini avec la répudiation du verbe, avec les facilités tressées par toute société entre tout homme et l'illusion balkanique d'avoir raison devant l'histoire, face à un salut dévitalisé qui n'existe jamais.
L'ambiguïté de l’œuvre de Cioran, affinée dans les volumes ultérieurs, des Syllogismes de l'amertume (1952) aux Aveux et anathèmes (1987) en passant par De l'inconvénient d'être né (1973), tient à son contenu même, à son obstination souterraine au tête-à-tête renversé en exercice de métaphysique. S'il se fait moraliste, c'est pour soustraire l'étude des mœurs à la tentation des psychologues dont la science éteint les ténèbres et l'amertume qui tourmentent toute existence. Savoir vivre se passe, chez lui, de savoir-vivre en bonne compagnie : l'esprit rumine l'épreuve solitaire avec plus de violence que la pratique sociale des semblables. Il faut, disait-il de Pascal — et il en faisait la matière de sa propre expérience —, payer pour la moindre des affirmations ou des négations qu'on s'autorise, et non simplement se rémunérer à la monnaie des certitudes commodes de l'aigreur. Là où le cynisme consiste en une dénégation sans scrupules de la condition humaine, Cioran remue jusqu'au désabusement, se compromet dans l'irritation, sabote les systèmes et renverse leur ruine en une pleine acceptation du laconisme d'un monde incurable. Emil Cioran aura réussi une œuvre dont l'unité paradoxale consiste en une constante versatilité. Toutes les pistes explorées, qu'elle fussent artistiques, philosophiques ou littéraires, l'anathème, la malédiction et la virulence, l'espérance, l'apaisement ou la consolation, il en aura monté et démonté les beautés, les leurres et les impasses. Il ne cesse de changer de sujet ou d'objet pour retourner le même terreau : les mots ne sont utiles qu'à dissoudre les vérités qu'ils permettent d'arranger. Nul autre que lui n'a mené aussi loin cette difficile expérience. Le livre,dans la tradition occidentale, est le livre du maître. Les écrits du pyromane Cioran, quant à eux, ne délivrent aucune assurance magistrale ; ce sont des recueils d'exercices ne valant que pour ceux, sans se contenter de les lire, qui les appliquent à la déprise de soi, qui les tiennent pour autant d'occasions offertes de se pencher sur son propre cas et de devenir son propre maitre en calcination. Sous la réserve exigeante d'y pourvoir effectivement. Car les incendies allumés par Cioran ne se propagent pas aux bibliothèques ; ils s'attaquent aux traces que les bibliothèques ont laissées en nous, qui furent, en leur temps, bien nécessaires à l'affermissement de soi, et dont il faut savoir se défaire lors de cures régulières, sauf à se résigner à l'esclavage des systèmes et des pensées rassurantes.
► Jean-François Gautier, Antaïos n°12, 1997.
• note en sus :
1. « La séduction de certains problèmes vient de leur défaut de rigueur, comme des opinions discordantes qu'ils suscitent : autant de difficultés dont s'entiche l'amateur d'Insoluble. Pour me “documenter” sur la mort, je n'ai pas plus de profit à consulter un traité de biologie que le catéchisme : pour autant qu'elle me concerne, il m'est indifférent que j'y sois voué par suite du péché originel ou de la déshydratation de mes cellules. Aucunement liée à notre niveau intellectuel, elle est réservée, comme tout problème privé, à un savoir sans connaissances. J'ai approché nombre d'illettrés qui en parlaient plus pertinemment que tel métaphysicien ; ayant décelé par expérience l'agent de leur destruction, ils y consacraient toutes leurs pensées, de sorte que la mort, au lieu d'être pour eux un problème impersonnel, était leur réalité, leur mort. Mais parmi ceux-là mêmes qui, illettrés ou non, y songent constamment, la plupart ne le font qu'atterrés par la perspective de leur agonie, sans s'apercevoir un moment que, dussent-ils vivre des siècles, des millénaires, les raisons de leur terreur ne changeraient en rien, l'agonie n'étant qu'un accident dans le processus de notre anéantissement, processus coextensif à notre durée. La vie, loin d'être, comme pensait Bichat, l'ensemble des fonctions qui résistent .à la mort, est plutôt l'ensemble des fonctions qui nous y entraînent. Notre substance diminue à chaque pas ; cette diminution pourtant, tous nos efforts devraient tendre à en faire un excitant, un principe d'efficacité. Ceux qui ne savent tirer bénéfice de leurs possibilités de non-être demeurent étrangers à eux- mêmes : des fantoches, des objets pourvus d'un moi, endormis dans un temps neutre, ni durée ni éternité. Exister, c'est mettre à profit notre part d'irréalité, c'est vibrer au contact du vide qui est en nous. Le fantoche, lui, reste insensible au sien, l'abandonne, le laisse dépérir… » (La tentation d'exister, 1956).

[Ci-contre : ill. de de Zdzisław Beksiński. Monde abject qui n'a jamais vécu que l'érotisme des charniers. Sans lui, la mort n'aurait jamais commencé », Artaud, Suppôts et Supplications, 1947]
Voici en français le deuxième des 4 ouvrages que Cioran écrivit dans sa langue natale, en 1936, à l’âge de 24 ans : Le livre des leurres (Gallimard, coll. Arcades, 1992). Avant qu’il ne devienne l’écrivain français qui, après dix ans de séjour à Paris, se forgerait un style (1) soustrait par la mesure aux flammes et aux coups de vent caractérisant ses livres roumains — dans lesquels il prônait l’élan barbare de l’inspiration, le « chant du sang, de la chair et des nerfs » du lyrisme (2), considérant l’état « chaotique et maladif » comme indispensable à la création, pour s’écrier enfin : « Vivons dans l’extase de l’illimité, aimons tout ce qui ne connaît pas de bornes, détruisons les formes et créons le seul culte qui en soit exempt : celui de l’infini ». Ceux qui admirent en Cioran un sceptique professionnel — dont, au reste, l’ingénieux pessimisme produit sur l’esprit, comme celui de Voltaire, le contraire de l’abattement — croient pouvoir imputer à son passage d’une langue à une autre certaine métamorphose concernant aussi bien son écriture que sa pensée. En fait, ce qu’un esprit hâtif pourrait désigner comme une rupture ou un véritable changement dans son œuvre, n’est qu’une toute naturelle évolution. Celle-ci apparaît déjà évidente dans la période roumaine de l’écrivain, une discipline s’imposant, peu à peu, livre après livre, à la véhémence et à l’ivresse de l’expression, en même temps que se produit un déplacement du point de vue, en regard de hantises que l’écriture, au lieu d’atténuer, rendra indélébiles. Car, soit dit par parenthèse, Cioran est, plus que celui des idées, l’homme de quelques obsessions, qu’il serait vain de classer parmi les philosophes, ces « pauvres agents de l’absolu (qui) font profession de prendre le monde “au sérieux” ».
Ainsi, celui qui naguère appelait la musique et la mystique « ces deux excuses de l’homme », ne faisait que résumer les thèmes majeurs qui se trouvent à l’origine du Livre des leurres, où ils s’entrelacent et se répondent sans cesse au fil des pages, ouvrant, ici et là, des percées dans le tréfonds de l’être et, par moment, dans une sorte d’impossible au-delà.
La musique, qui désagrège et réduit notre substance à un rythme pur, nous faisant parvenir à une immatérialité douce « où chercher encore le moi n’a plus aucun sens » ; qui, avec Bach, « donne un contour sonore à la conception chrétienne du désaccord absolu entre temps et éternité » ; et, avec Mozart, nous apporte « la preuve de l’existence du paradis par le “désir” ». Alors que d’autres compositeurs suscitent en nous une manière de remords métaphysique, une inquiétude morale en marge de la vie : « Vous n’avez aucune faute à regretter, vous ne vous souvenez de rien, mais le passé vous envahit d’un infini de douleur ». Puisque si la lutte contre nos propres afflictions est si difficile, c’est parce qu’il existe en nous un fond de tristesse indépendant des causes extérieures, un socle impossible à desceller. Et qu’« il n’y a pas de destin sans le sentiment d’une condamnation et d’une malédiction ».
Quant à la mystique, que Cioran considère comme une irruption de l’absolu dans l’Histoire — et dont les derniers bredouillages lui semblent plus proches de Dieu que la Somme théologique —, elle flambe et clame et gémit dans ces pages. Surtout à travers l’évocation des mystiques femmes, davantage dans leur rôle, à ses yeux, que les hommes, à cause sans doute du rapport amoureux, plus naturel, que les uns et les autres établissent avec le Christ (2). Certes, l’œuvre de Thérèse d’Avila — la seule, parmi les femmes, à avoir vraiment analysé ses visions pour dénicher la part d’imaginaire qui aurait pu s’y mêler — aura compté pour Cioran presque autant que le Livre de Job ou l’Ecclésiaste, et pas moins, en tout cas, que les ouvrages de Kierkegaard. Mais, ici, on le sent surtout fasciné par ces folles de leur âme que sont les Angèle de Foligno, les Maria Maddalena dei Pazzi, et bien d’autres que l’Église a toujours regardées avec suspicion ; parce qu’elle, l’Église, se méfie de la chair, et qu’elles, elles affirment, faisant bloc avec leur corps, leur ignorance de l’obstacle les séparant de Dieu — ce Dieu qu’elles ont trouvé et vu et entendu, alors que les théologiens, de leur côté, cherchent, vaille que vaille, à le rendre possible. C’est qu’elles captent des images sans relation avec les dogmes et, par conséquent, peu utilisables pour étayer la doctrine ; et que leur émotion, en outre, suffit à les renseigner sur l’objet qui la provoque : Dieu en personne. Aussi bâtissent-elles une connaissance par elles-mêmes, n’essayant pas d’expliquer l’inconnu, du moment où elles s’identifient à celui-ci. Mais ce qui effare encore plus l’Église, c’est la jouissance latente des corps ainsi confrontés : le leur, et celui du dieu incarné, le Fils : leur corps, comme dans l’érotisme, n’a fait que poursuivre le moment extrême où le plaisir ridiculise la pensée et où, le temps d’une extase, il a contenu l’infini.
Or — et cela a dû combler Cioran — la traversée de la Divinité par ces mystiques, débouche souvent dans le plus pur néant. Angèle de Foligno le chante : « Oh ! néant inconnu ! L’âme ne peut jouir d’une plus belle vue en ce monde qu’en observant son propre néant, tout en restant dans sa prison ». Tandis que Maria Maddalena dei Pazzi — laquelle, revenue sur terre, ne se souvenait de rien — soutient pour sa part que l’amour suprême de Dieu est l’amour mort, lequel ne désire, ni ne cherche, ni ne convoite rien : « ni Le connaître, ni Le comprendre, ni en jouir ». Et Cioran d’en jubiler : « Gâcher sa vie pour rien, toucher au sublime dans l’inutile absolu ! », disait-il alors, tout jeune homme, dans ce livre où, pour ce qui touche au style, on voit bien qu’il incline déjà à condenser ses hantises en aphorismes — ce “genre” où il excelle, non sans le décrier : n’assure-t-il pas qu’il est cultivé uniquement par ceux qui ont connu la peur au milieu des mots, la peur de crouler « avec tous les mots » ? C’est juste, mais c’est aussi vouloir oublier — par modestie — que l’âme s’émerveille que le mot juste et la phrase brève et pure lui fassent entendre le long discours antérieur de la pensée. Car l’aphorisme est cette concrétion précieuse, ce diamant dans le chaos, auquel, seule, la vraie littérature est en mesure d’aboutir. Et d’où elle peut renaître, émoustillée, éprise d’un autre songe, pour exploser, gerbe d’étoiles soudaines, dans un secret lendemain.
► Hector Bianciotti, Le Monde [des Livres] n°14884 (4 déc. 1992).
• notes en sus :
1. « Rompus à un art de penser purement verbal, les sophistes s'employèrent les premiers à réfléchir sur les mots, sur leur valeur et leur propriété, sur la fonction qui leur revenait dans la conduite du raisonnement : le pas capital vers la découverte du style, conçu comme but en soi, comme fin intrinsèque, était franchi. Il ne restait plus qu'à transposer cette quête verbale, à lui donner pour objet l'harmonie de la phrase, à substituer au jeu de l'abstraction le jeu de l'expression. L'artiste réfléchissant sur ses moyens est donc redevable au sophiste, il lui est organiquement apparenté. L'un et l'autre poursuivent, dans des directions différente, un même genre d'activité. Ayant cessé d’être “nature”, ils vivent en fonction du mot. Rien d'originel en eux : aucune attache qui les relie aux sources de l'expérience ; nulle naïveté, nul “sentiment”. Si le sophiste pense, il domine tellement sa pensée qu'il en fait ce qu'il veut ; comme il n'est pas entraîné par elle, il la dirige suivant ses caprices ou ses calculs ; à l'égard de son propre esprit, il se comporte en stratège ; il ne médite pas, il conçoit, selon un plan aussi abstrait qu'artificiel, des opérations intellectuelles, ouvre des brèches dans les concepts, tout fier d'en révéler la faiblesse ou de leur accorder arbitrairement une solidité ou un sens. La “réalité”, il ne s'en soucie guère : il sait qu'elle dépend des signes qui l'expriment et dont il importe d’être maître.
L'artiste va, lui aussi, du mot au vécu : “l'expression” constitue la seule expérience originelle dont il soit capable. La symétrie, l'agencement, la perfection des opérations formelles, représentent son milieu naturel : il y réside, il y respire. Et comme il vise à épuiser la capacité des mots, il tend, plus qu'à l'expression, à l'expressivité. Dans l'univers fermé où il vit, il n' échappe à la stérilité que par ce renouvellement continuel que suppose un jeu où la nuance acquiert des dimensions d'idole et où la chimie verbale réussit des dosages inconcevables à l'art naïf. Une activité aussi délibéré, si elle se situe aux antipodes de l'expérience, s'approche, en revanche, des extrémités de l'intellect. Elle fait de l'artiste qui s'y voue un sophiste de la littérature. Dans la vie de l'esprit il arrive un moment où l'écriture, s'érigeant en principe autonome, devient destin. C'est alors que le Verbe, tant dans les spéculations philosophiques que dans les productions littéraires, dévoile et sa vigueur et son néant. » (La Tentation d'exister, 1956).
2. Dans une méditation aux réminiscences pascaliennes pour impersonnaliser son inquiétude, Cioran interpelle le lyrisme, et plus largement le pourquoi du besoin d'expression, dans cette interrogation liminaire et fondatrice, lourde de l'œuvre qu'elle annonce et déjà pleine du regret de n'avoir pu s'abstenir :
« Pourquoi ne pouvons-nous demeurer enfermés en nous ? Pourquoi poursuivons-nous l'expression et la forme, cherchant à nous vider de tout contenu, à organiser un processus chaotique et rebelle ? Ne serait-il pas plus fécond de nous abandonner à notre fluidité intérieure, sans soucis d'objectivation, nous bornant à jouir de tous nos bouillonnements, de toutes nos agitations intimes ? Des vécus multiples et différenciés fusionneraient ainsi pour engendrer une effervescence des plus fécondes, semblable à un raz-de-marée ou un paroxysme musical. Être plein de soi, non dans le sens de l'orgueil, mais de la richesse, être travaillé par une infinité intérieure et une tension extrême, cela signifie vivre intensément, jusqu'à se sentir mourir de vivre. Si rare est ce sentiment, et si étrange, que nous devrions le vivre avec des cris. Je sens que je devrais mourir de vivre et me demande s'il y a un sens à en rechercher l'explication. Lorsque le passé de l'âme palpite en vous dans une tension infinie, lorsqu'une présence totale actualise des expériences enfouies, qu'un rythme perd son équilibre et son uniformité, alors la mort vous arrache des cimes de la vie, sans qu'on éprouve devant elle cette terreur qui en accompagne la douloureuse obsession. Sentiment analogue à celui des amants lorsque, au comble du bonheur, surgit devant eux, fugitivement mais intensément, l'image de la mort, ou lorsque, aux moments d'incertitude, émerge, dans un amour naissant, la prémonition de la fin ou de l'abandon.
Trop rares sont ceux qui peuvent subir de telles expériences jusqu'au bout. Il est toujours dangereux de contenir une énergie explosive, car le moment peut venir où l'on n'aura plus la force de la maîtriser. L'effondrement alors naîtra d'un trop-plein. Il existe des états et des obsessions avec lesquels on ne saurait vivre. Le salut ne consiste-t-il pas dès lors à les avouer ? Gardées dans la conscience, l'expérience terrible et l'obsession terrifiante de la mort mènent à la ruine. En parlant de la mort on a sauvé quelque chose de soi-même, et pourtant dans l'être quelque chose s'est éteint. Le lyrisme représente un élan de dispersion de la subjectivité, car il indique, dans l'individu, une effervescence incoercible qui prétend sans cesse à l'expression. Ce besoin d'extériorisation est d'autant plus urgent que le lyrisme est intérieur, profond et concentré. Pourquoi l'homme devient-il lyrique dans la souffrance et dans l'amour ? Parce que ces deux états, bien que différents par leur nature et leur orientation, surgissent du tréfonds de l'être, du centre substantiel de la subjectivité, en quelque manière. On devient lyrique dès lors que la vie à l'intérieur de soi palpite à un rythme essentiel. Ce que nous avons d'unique et de spécifique s'accomplit dans une forme si expressive que l'individuel s'élève au plan de l'universel. Les expériences subjectives les plus profondes sont aussi les plus universelles en ce qu'elles rejoignent le fond originel de la vie. La véritable intériorisation mène à une universalité inaccessible à ceux qui en restent à l'inessentiel et pour qui le lyrisme demeure un phénomène inférieur, produit d'une inconsistance spirituelle, alors que les ressources lyriques de la subjectivité témoignent, en réalité, d'une fraîcheur et d'une profondeur intérieures des plus remarquables.
Certains ne deviennent lyriques que dans les moments décisifs de leur existence ; pour d'autres, ce n'est qu'à l'instant de l'agonie, où tout le passé s'actualise et déferle sur eux comme un torrent. Mais, dans la majorité des cas, l'explosion lyrique surgit à la suite d'expériences essentielles, lorsque l'agitation du fond intime de l'être atteint au paroxysme. Ainsi, une fois prisonniers de l'amour, des esprits enclins à l'objectivité et l'impersonnalité, étrangers à eux-mêmes comme aux réalités profondes, éprouvent un sentiment qui mobilise toutes leurs ressources personnelles. Le fait qu'à peu d'exceptions près tous les fassent de la poésie lorsqu'ils sont amoureux montre bien que la pensée conceptuelle ne suffit pas à exprimer l'infinité intérieure ; seule une matière fluide et irrationnelle est capable d'offrir au lyrisme une objectivation appropriée. Ignorant de ce qu'on cache en soi-même comme de ce que cache le monde, on est subitement saisi par l'expérience de la souffrance et transporté dans une région infiniment compliquée, d'une vertigineuse subjectivité. Le lyrisme de la souffrance accomplit une purification intérieure où les plaies ne sont plus de simples manifestations externes sans implications profondes, mais participent à la substance même de l'être. Il est un chant du sang, de la chair et des nerfs. Aussi presque toutes les maladies ont-elles des vertus lyriques. Seuls ceux qui se maintiennent dans une insensibilité scandaleuse demeurent impersonnels face à la maladie, toujours source d'un approfondissement intérieur.
On ne devient vraiment lyrique qu'à la suite d'un profond trouble organique. Le lyrisme accidentel est issu de déterminants extérieurs et disparaît avec eux. Pas de lyrisme sans un grain de folie intérieure. Fait significatif, les psychoses se caractérisent, à leur début, par une phase lyrique où les barrières et les obstacles s'effondrent pour faire place à une ivresse intérieure des plus fécondes. Ainsi s'explique la productivité poétique des psychoses naissantes. La folie : un paroxysme du lyrisme ? Bornons-nous donc à écrire son éloge pour éviter de récrire celui de la folie. L'état lyrique est au-delà des formes et des systèmes : une fluidité, un écoulement intérieurs mêlent en un même élan, comme en une convergence idéale, tous les éléments de la vie de l'esprit pour créer un rythme intense et parfait. Comparé au raffinement d'une culture ankylosée qui, prisonnière des cadres et des formes, déguise toutes choses, le lyrisme est une expression barbare : sa véritable valeur consiste, précisément, à n'être que sang, sincérité et flammes. »
(extrait de : Sur les cimes du désespoir, Herne, 1990, réédité en Livre de poche, 1991).

« Je pense, dit quelque part Cioran, à un moraliste idéal — mélange d'envol lyrique et de cynisme — exalté et glacial, diffus et incisif, tout aussi proche des Rêveries que des Liaisons dangereuses, ou rassemblant en soi Vauvenargues et de Sade, le tact et l'enfer. » On dirait là d'un autoportrait ou d'un art poétique, tant ces lignes le définissent lui-même merveilleusement. Le tact et l'enfer, en effet. Sous le couvert d'un style qui a les charmes et les gracieusetés de l'Ancien Régime, sous la mousse légère des aphorismes et des pensées qui évoquent l'univers suranné d'un Chamfort ou d'un Joubert, il y a dans son œuvre, tapis et terribles, non pas une banale éthique, mais la dérision systématique, le « précis de décomposition » des systèmes de valeur de l'homme moderne et de la civilisation occidentale.
Ni poète, ni philosophe, ni sociologue, aussi secret que Michaux, son frère en « connaissance par les gouffres », aussi téméraire que Blanchot dans l'expérience suicidaire de l'écrire, c'est sur lui-même d'abord que Cioran semble expérimenter la volonté iconoclaste qui génère ses ouvrages. Né en 1911 en Roumanie, où il publie ses premiers livres, écrits en roumain (Sur les cimes du désespoir, 1934 ; Des larmes et des saints, 1937), il soutient une thèse sur Bergson, va étudier la philosophie à Berlin avant de venir en 1937 à Paris grâce à une bourse d'études et s'y fixe définitivement. C'est en 1947 qu'il abandonne sa langue maternelle pour apporter au français, tout comme Ionesco sur le plan du verbe, une espèce de délire de la réflexion dont la première expression sera son Précis de décomposition (1949). Authentique bergsonien au terme d'études supérieures de philosophie, il se tourne ensuite vers Nietzsche auquel il reprochera bien vite de « n'avoir démoli les idoles que pour les remplacer par d'autres » et préférera Marc Aurèle, Chamfort, voire Joseph de Maistre dont il tracera un portrait éblouissant (Essai sur la pensée réactionnaire, 1957, repris dans Exercices d'admiration, 1986, qui rassemble les textes consacrés à des écrivains).
Décapante, corrosive, maniant les figures logiques du paradoxe, du syllogisme ou de l'aporie que pour mieux exprimer l'absurdité, empruntant les ressources de la vocifération, du juron, de l'épitaphe et presque du borborygme, l'œuvre de Cioran ne s'érige que contre soi, l'humain et le monde. Se souvenant des écrits gnostiques qui disent la mauvaiseté substantielle du monde, elle s'organise comme une manière de contre-Évangile, comme un discours unanimement dévastateur qui prétend ne rien laisser réchapper.
Tout découle d'un constat fondamental : mieux aurait valu le non-être que l'existence, car tous nos maux viennent de ce que nous soyons et qu'il y ait quelque chose. « N'être pas né, rien que d'y songer, quel bonheur, quelle liberté, quel espace ! » (De l'inconvénient d'être né, 1973.) De là, tout s'ensuit. Qu'a-t-on à faire de la divinité et de la religion, quand on entend encore résonner « le rire des dieux au sortir de l'épisode humain » ? « La Création fut le premier acte de sabordage », à quoi bon dès lors se préoccuper de celui qui n'a jamais été qu'un triste plaisantin ? (Le Mauvais Démiurge, 1969). Faut-il croire en l'histoire ? Celle-ci n'est productrice que d'utopies et les utopies ne provoquent que le Mal, se retournent dans les aberrations de la tyrannie et de la servitude (Histoire et utopie, 1960). « Ce n'est qu'un défilé de faux absolus, une succession de temples élevés à des prétextes, un avilissement de l'esprit devant l'improbable. » Doit-on faire confiance au progrès et à la civilisation ? Combattre l'anthropophagie et l'analphabétisme ? Multiplier les illusions sociales et les mythologies ? Cioran, derechef, vient mettre son grain de sable : « Toute idée devrait être neutre ; mais l'homme l'anime, y projette ses flammes et ses démences : le passage de la logique à l'épilepsie est consommé […] Ainsi naissent les mythologies, les doctrines et les farces sanglantes. Point d'intolérance ou de prosélytisme qui ne révèle le fond bestial de l'enthousiasme. » (Précis de décomposition, 1949 ; La Chute dans le temps, 1964.) Nul recours, alors, que de faire le panégyrique de la vis inertiae et que de revendiquer, à cor et à cri, le néant auquel nous aurions dû avoir droit (Syllogismes de l'amertume, 1952), sans succomber à la « tentation d'exister ».
Reste à dire que cette œuvre — et c'est peut-être là sa plus grande force —, bien loin de faire de sa propre existence une valeur ultime, rescapée du désastre général, déjoue constamment l'assertion et la thèse par le recours aux formes brèves qui n'ont pas le temps de « prendre », par le travail continu de la dérision et de l'auto-ironie, toujours plus féroce, plus acharnée à se défaire dans l'instant où elle se formule (Écartèlement, 1979 ; Aveux et anathèmes, 1987). Car « un livre qui, après avoir tout démoli, ne se démolit pas lui-même, nous aura exaspérés en vain ». Les Carnets 1952-1972 de Cioran ont fait l'objet d'une publication posthume en 1997.
► Philippe Dulac, Dictionnaire de la littérature française du XXe siècle, Encyclopædia Universalis, 2013 (pp. 324-325).

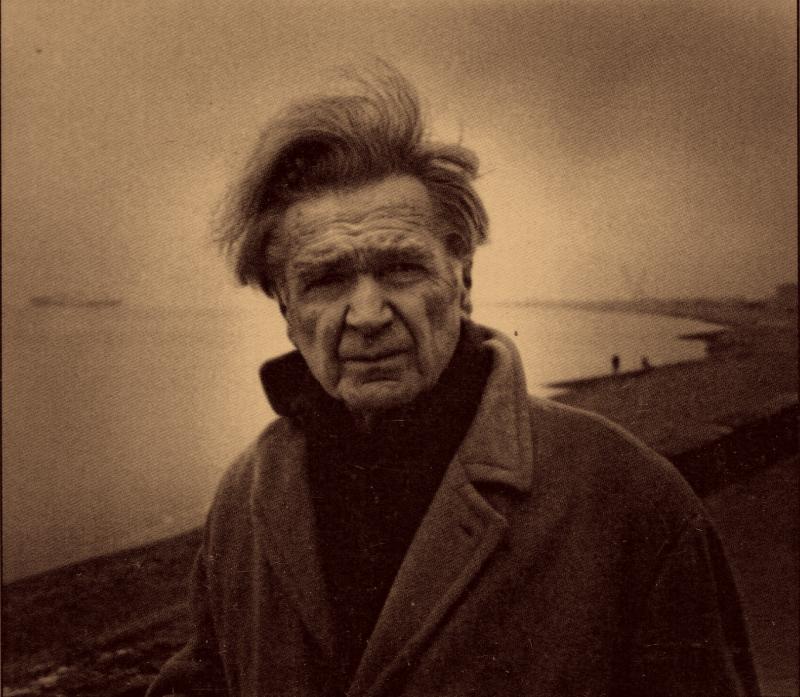 Comment peut-on être français ?
Comment peut-on être français ?« Comment peut-on être persan ? », se demandait Montesquieu. Toutes les nations devraient susciter la même ironie. Être bulgare, américain, polonais, japonais, guatémaltèque ou suédois, tout cela revêt, au fond, quelque chose de saugrenu, de pittoresque et de déraisonnable, sous le regard d’autrui… Mais le cours de l’Histoire et la cruauté des circonstances ont voulu qu’une des questions de notre époque soit sans doute : “Comment peut-on être roumain ?” Cioran avait répondu à sa manière, dès 1937. Il avait fait le voyage Bucarest-Paris. Il s’était exilé de son pays et de sa langue. Il avait alors 26 ans. Il allait traverser, à bicyclette, une partie de la France et visiter les moindres villages. Il désirait probablement savoir comment on pouvait être français.
Vingt ans après, il s’est interrogé sur cet exil, dans une lettre à son ami le philosophe roumain Constantin Noïca : « De ce pays qui fut le nôtre et qui n’est plus à personne, vous me pressez, après tant d’années de silence, de vous donner des détails sur mes occupations, ainsi que sur ce monde merveilleux que j’ai, dites-vous, la chance d’habiter et de parcourir. Je pourrais vous répondre que je suis un homme inoccupé, et que ce monde n’est point merveilleux ».
Cioran mesurait ensuite les efforts qu’il avait accomplis pour se familiariser avec la langue française. La peine que cela lui avait coûtée. La « consommation de cafés, de cigarettes et de dictionnaires ». Il opposait la distinction de cet “idiome d’emprunt” et “le superbe débraillement” de sa langue natale. Cependant, il n’y reviendrait pas, en raison même de la peine qu’il avait prise. Tant pis si Constantin Noïca le voyait sous les traits d’un “renégat”. Cioran lui répondait avec une maxime tibétaine : « La patrie n’est qu’un campement dans le désert ».
Plus tard, dans un autre texte, il allait faire cet aveu : « Le français est aux antipodes de ma nature, de mes débordements, de mon moi véritable et de mon genre de misères ». C’était pourtant “cette incompatibilité” qui rendait Cioran amoureux de la langue de Voltaire, et qui le faisait écrire aussi bien que nos meilleurs moralistes. La syntaxe française avait enfermé et dominé les intempérances roumaines. Dans le même texte, Cioran déclarait se méfier désormais de “l’effusion”. Il recherchait à présent “la sécheresse, le laconisme”. Car il avait eu sa période romantique. Elle avait coïncidé, justement, avec ses années de jeunesse à Bucarest. Il avait commencé d’écrire à 21 ans. Son premier ouvrage s’appelait Sur les cimes du désespoir. Il se jura de ne pas en écrire d’autre. Mais, par bonheur, il n’a pas tenu sa promesse. Les écrivains sont comme les joueurs ou les fumeurs. Leur vice les guette, les sollicite en silence et les reprend.
Jusqu’à une date récente, nous ne connaissions pas les textes roumains de Cioran. Depuis 1986, on a traduit Des larmes et des saints et Sur les cimes. Voici maintenant Le Crépuscule des pensées. Ces titres “enflammés” contrastent avec l’austérité des titres “français” : Syllogismes de l’amertume ou De l’inconvénient d’être né. Cioran a souvent évoqué le « lyrisme échevelé » de sa jeunesse. Sombre lyrisme d’ailleurs, qui servait à dépeindre le monde sous son aspect le plus désolant. “Toutes les eaux” prenaient “la couleur de la noyade”. Et la neurasthénie, « moment slave de l’âme », recouvrait toutes les pensées. Cioran se demandait comment on pouvait être un homme. C’était une bizarrerie métaphysique, une aberration de l’univers. Car « Dieu (semblait) avoir tous ses papiers en règle, et l’homme aucun »…
Dès cette époque, Cioran se rangeait dans la tradition des grands pessimistes. Ces gens ont la réputation de porter atteinte au moral de l’espèce humaine. Il en existe de diverses sortes : l’Ecclésiaste, Mme du Deffand, Schopenhauer… Mais ces prophètes du pire, ces drôles d’oiseaux pratiquent tous une philosophie “valétudinaire”. Je veux dire qu’ils regardent notre condition comme une maladie. “La maladie humaine”, selon les mots du romancier italien Ferdinando Camon.
Cioran appartient à la catégorie des pessimistes rageurs. Leurs états d’âme sont des mouvements de colère. Ils veulent avoir “une explication décisive avec l’existence”. Ils demandent des comptes à l’univers. Ils le font passer devant le tribunal de la philosophie. Et leurs jugements ressemblent à des “ultimatums” que l’on adresse à Dieu. Celui-ci, naturellement, ne répond pas. Sa vocation, c’est le silence. Et l’impolitesse divine fâche encore davantage nos pessimistes.
Pendant sa période “roumaine”, lorsqu’il empêchait de dormir ses parents avec sa vision du monde, Cioran préférait les “lumières crépusculaires” à cette “clarté” française qui avait triomphé dans les salons du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ensuite, après qu’il eut adopté la langue de La Rochefoucauld, il a mieux aimé la seconde sorte de lumière. Il a choisi d’être “français” en devenant l’héritier de Pascal, de Mme du Deffand, de Vauvenargues et de Chamfort. Il a donné de l’urbanité à ses fureurs, et de la civilité à son désespoir. Aussi, cet “homme des Balkans”, qui aime beaucoup les marquises, il est facile de l’imaginer chez Mme du Châtelet, causant avec Voltaire, ou chez Mme de Tencin, s’enquérant de la santé de Fontenelle.
« De tous les êtres, les moins insupportables sont ceux qui haïssent les hommes. Il ne faut jamais fuir un misanthrope », écrivait Cioran dans ses Exercices d’admiration. Il parlait de l’auteur italien Guido Ceronetti, mais on peut affirmer la même chose à son propos. C’est l’homme le plus agréable à rencontrer. Il mêle le savoir, la générosité, l’ironie et cette vraie bienveillance fort éloignée des grimaces de la petite Babylone littéraire. Les misanthropes sont, en effet, la seule espèce fréquentable… Vous me direz que Cioran donne de l’existence une image très défavorable, et que celle-ci risque de déprimer les populations. Je crois que c’est l’inverse qui se produit. La vertu d’une langue souveraine, c’est de raffermir l’âme et le cœur, même si elle exprime une philosophie morose. Lire le docteur Cioran, c’est roboratif. C’est la meilleure médecine pour combattre les pensées trop misérables. Et réparer les mesquineries de la vie.
Constantin Noïca avait raison d’écrire que « la façon même dont Cioran écrase la beauté du monde et de la culture finit par en être l’éloge ». Il est peut-être l’un des derniers représentants de ce modèle d’humanité que notre époque paraît avoir oublié : je veux dire l’homme de culture.
► François Bott, Le Monde [des Livres] n°14580 (13 déc. 1991).

[Ci-contre : Twilight of Man, Rockwell Kent, 1926]
La marquise du Deffand soignait ses insomnies en lisant Voltaire, et Cioran se distrayait des siennes en lisant Mme du Deffand. « Mon Dieu, que vous êtes heureux et que vous êtes en bonne compagnie, étant seul avec vous-même ! », écrivait-elle à son (très illustre) correspondant. Car, très loin de Ferney, dans sa chambre de la rue Saint-Dominique, elle était rattrapée, sans cesse, par cette mauvaise bête, ce monstre sans visage qu’on appelle l’ennui et qui entraîne à la fois le vide et le surmenage des pensées. Cioran a probablement éprouvé la même jalousie que la marquise à l’égard de Voltaire. « Ma vie a été dominée par l’expérience de l’ennui. J’ai connu ce sentiment dès mon enfance », confiait-il en 1977. Il ajoutait que c’était une sorte de « vertige » : « La révélation de l’insignifiance universelle »…
La pensée du malaise conduit-elle au malaise de la pensée ? Le renversement des génitifs était la spécialité des professeurs de philosophie dans la France des années 50. Mais ils connaissaient à peine Cioran, qui venait d’entrer dans la république parisienne des lettres, avec son Précis de décomposition, et qui allait très bien se classer dans les championnats de pessimisme, juste après l’Ecclésiaste et Schopenhauer. Le désespoir arrivait, en effet, de Bucarest. C’est souvent comme cela dans la géographie des sentiments : les grandes mélancolies viennent de l’Est, et les promesses brillent à l’Ouest. Une sorte de Pascal roumain s’était établi sur les bords de la Seine. Il rencontrait quelquefois un autre émigré très sombre, originaire d’Irlande, mais qui « donnait toujours l’impression de tomber de la lune ». Ce passant distrait, qui s’appelait Samuel Beckett, annonçait une mauvaise nouvelle : ce n’était pas la peine d’attendre Godot…
C’est pendant l’été 1947, à Dieppe, que Cioran avait pris la décision d’écrire en français. Il y voyait le meilleur moyen de « s’émanciper ». Et puis il considérait la langue de Voltaire comme l’« idiome idéal pour traduire délicatement des sentiments équivoques ». L’adoption du français devait lui procurer autant de bonheur que de tourments. « Je suis un étranger pour la police, pour Dieu, pour moi-même », dirait-il, estimant que sa seule « patrie » était la langue dans laquelle il s’exprimait. Cependant, le sixième arrondissement revêtit, pour lui, des airs de province, et le jardin du Luxembourg devint son propre jardin. Cioran s’est beaucoup promené dans Paris. Il a continué la tradition de la littérature qui déambule. Car les pensées ou les réminiscences viennent en marchant. Par exemple, ce proverbe chinois : « Quand un seul chien se met à aboyer à une ombre, dix mille chiens en font une réalité ».
Voici tout Cioran, depuis les textes de sa jeunesse roumaine jusqu’à son dernier livre, Aveux et Anathèmes. Cela peut se lire, entre autres, comme une épopée de l’insomnie : « La seule forme d’héroïsme compatible avec le lit ». Cioran, c’est le paradoxe perpétuel, le tiraillement entre « la tentation d’exister » et l’envie ou le vertige du contraire. « Toutes les fois que quelque chose me semble encore possible, dit-il, j’ai l’impression d’avoir été ensorcelé ». Jadis, il s’était guéri (provisoirement) de ses idées noires « en parcourant la France » à bicyclette. Le vélo comme médecine… Mais aussi l’humour qui « dévaste les anges », la musique, cette « illusion » qui console de tout le reste, et la littérature, dernière « ressource » de l’espèce humaine lorsqu’elle ne fréquente pas nécessairement les pharmacies. Pour Cioran, chaque livre a été « une victoire sur le découragement ».
Autre paradoxe : cet homme qui n’a cessé de dénigrer l’existence s’est livré à de brillants « exercices d’admiration » sur les gens les plus divers, de Joseph de Maistre à Francis Scott Fitzgerald, en passant par Paul Valéry, Samuel Beckett, Saint-John Perse, Mircea Eliade, Roger Caillois, Henri Michaux, Benjamin Fondane et Jorge Luis Borges. Et puis il y a cet étonnant portrait d’une jeune femme qui séduisait le pauvre monde « par son air d’absence et de dépaysement ». Elle semblait ne pouvoir renseigner les autres sur elle- même « tant elle se confondait avec son mystère ou répugnait à le trahir ». Cioran suppose qu’« elle n’était pas d’ici et qu’elle ne partageait notre déchéance que par politesse ». Car la demoiselle paraissait être « solidaire de l’invisible ». On croirait un de ces personnages de Jean Cocteau, qui trompent les douaniers les plus rigoureux et traversent les miroirs comme nous allons de France en Italie…
Quel raffinement, quelle richesse et que de trouvailles ! Les insomnies excitaient sans doute la verve de Cioran. « Passé la trentaine, écrit-il, on ne devrait pas plus s’intéresser aux événements qu’un astronome aux potins ». Il affirme ensuite préférer les peuples qui, « par goût du ciel, firent faillite dans l’Histoire ». Pourtant, quelle compassion chez ce misanthrope ! Voyez, notamment, la peinture qu’il fait de ces sourires qui ne s’effacent pas, sur les figures « guettées par la folie » : « Lumière fugitive, émanée de nous-même, notre sourire à nous dure ce qu’il doit durer », tandis que « le sourire suspect survit à l’événement qui le fit naître, s’attarde, se perpétue, ne sait comment s’évanouir. (…) Sourire en soi, sourire terrifiant, masque qui pourrait recouvrir n’importe quel visage : le nôtre par exemple ».
Revenant sur la folie, Cioran la décrit (ou la résume) comme une sorte de « chagrin » que le temps ne modère ni ne transforme. Philosophe de l’anxiété ce « fanatisme du pire » , il a le secret de ces raccourcis vertigineux qui donnent parfois le sentiment qu’une personne s’est jetée par la fenêtre. « La pâleur, disait-il, nous montre jusqu’où le corps peut comprendre l’âme ».
► François Bott, Le Monde [des Livres] n°15617 (12 mai 1995).

[Ci-contre : Sibiu, ville natale de Cioran qui y connut ses premières pérégrinations d'insomniaque, photographiée par Grigore Bogdan]
La fadeur du suicide
Au cours de ces nuits blanches à Sibiu, Cioran se fit le géographe de ses propres effondrements, il apprit à saisir en lui-même le démon. Sa philosophie, « infestée » par son moi, se devait désormais d’être une exploration des trois grandes hantises de l’homme : la maladie, la solitude et la folie (« Le pressentiment de la folie se double de la peur de la lucidité dans la folie, la peur des moments de retour à soi, où l’intuition du désastre risque d’engendrer une folie encore plus grande. C’est pourquoi il n’y a pas de salut par la folie. On aimerait le chaos, mais on a peur de ses lumières. »)
Après un tel rugissement de désespoir, même le suicide paraît plein de fadeur. Exacerbée, la lucidité va plus loin que le suicide : elle crucifie celui qui se donne à elle, mais elle lui laisse la vie sauve et des nuits blanches pour laver ses blessures.
Cioran voulait être le cobaye de sa philosophie. C’est cette hâte de s’écorcher, cette impatience de découvrir le pire, qui donnent à son premier livre une « sincérité infernale ». Sur les cimes du désespoir est à l’œuvre de Cioran ce que les Mémoires écrits dans un souterrain sont à celle de Dostoïevski : le récit d’un ratage qui sauve. La formule de l’homme souterrain : « Une conscience clairvoyante, je vous assure, messieurs, c’est une maladie, une maladie très réelle », on croit entendre Cioran la prononcer avec l’accent des Carpates.
Commencer une œuvre par l’affirmation : je suis perdu pour la vie et j’ai perdu foi en la philosophie, tel est le paradoxe de Cioran. C’est pourtant ce reniement de soi, ce geste d’autodestruction, qui permet l’œuvre à venir. Le sentiment de rupture totale, la négativité forcenée, le désir inouï de dévastation, ouvrent la voie au détachement.
Plus tard, quand il commença d’écrire en français, Cioran loua, chez le moraliste idéal, l’homme capable de lyrisme et de cynisme, d’exaltation et de froideur, habile à rassembler sous les mêmes cieux Rousseau et Laclos, Vauvenargues et Sade.
Aux nuits blanches de Sibiu devaient succéder les nuits blanches du Luxembourg. Cioran abandonna le roumain. Sur les cimes du désespoir, ce suicide halluciné, lui avait permis de faire la connaissance des gouffres. Si, tel un fauve qui se camoufle, il adopta la langue française, ce fut, de son propre aveu, dans le souci de concilier l’enfer et le tact.► Roland Jaccard, Le Monde [des Livres] n°14050 (30 mars 1990).

Sur l'insomnie
Cioran : (…) C’est à peu près à vingt ans que j’ai perdu le sommeil et je considère cela comme le plus grand drame qui puisse arriver. (…) Regardez, la vie est très simple : les gens se lèvent, passent la journée, travaillent, sont fatigués, ensuite ils se couchent, ils se réveillent et recommencent une autre journée. L'extraordinaire phénomène de l'insomnie fait en sorte qu'il n'y ait pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais l'insomniaque est lucide au milieu de la nuit, à n'importe quel moment, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est une sorte de temps interminable.
• M. J. : L'insomniaque vit-il dans une autre temporalité ?
Absolument ; c'est un autre temps et un autre monde, puisque la vie n'est supportable qu’à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi est-ce que l’on dort ? Non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après une nuit de sommeil a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. À huit heures du matin vous êtes dans le même état qu'à huit heures du soir et toute la perspective sur les choses change nécessairement. Je pense que si je n'ai jamais cru au progrès, si je n'ai jamais été dupe de cette duperie, c'est aussi à cause de ça.
• M. J. : S'agit-il d'un temps où l'on voit le monde au négatif ?
Oui, au négatif ou au positif, comme on veut, mais on a un autre sentiment du temps. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Et ça change votre vie. C'est pour cela que je considère que les nuits blanches sont la plus grande expérience que l'on peut faire dans la vie, elles vous marquent pour le reste de votre existence. On comprend bien pourquoi autrefois la torture — maintenant je crois que cela n'existe plus — consistait à empêcher les accusés de dormir : au bout de quelques nuits ils avouaient tout !
Le secret de l'homme, le secret de la vie, c'est le sommeil. C'est ça qui rend la vie possible. Je suis absolument persuadé que si l'on empêchait l'humanité de dormir, il y aurait des massacres sans précédent, l'histoire finirait. Ce phénomène m'a ouvert les yeux pour toujours, pour ainsi dire. Ma vision des choses est le résultat de ces veilles, j'ose dire les “veilles de l'esprit”, c'est prétentieux, mais enfin c'est un peu ça. Et, phénomène très curieux, mon adoration pour la philosophie, pour le langage philosophique – j'étais fou de la terminologie philosophique – eh bien, cette superstition, car c'en est une, a été balayée par les veilles. Parce que j'ai vu que ça ne pouvait pas m’aider ; ça ne me faisait pas supporter la vie, surtout pas les nuits. C'est ainsi que j'ai perdu ma foi dans la philosophie.
► Cioran, Entretiens, extrait du dernier entretien de 1994, Gallimard, 1995, p. 287 et 290.
***
• G. L. : Mais qu'est-ce qui vous tourmentait au juste ?
EMC : Une tension nerveuse extrême, due à mes insomnies. J'étais quelqu'un de presque normal avant cela. Le fait de perdre le sommeil a été pour moi une révélation, je me suis alors rendu compte que le sommeil est une chose extraordinaire, que la vie n'est supportable que grâce à lui : chaque matin, on commence une nouvelle aventure, ou bien on poursuit la même, mais après une interruption. L'insomnie, en revanche, supprime l'inconscience, elle vous contraint à endurer 24 heures sur 24 de lucidité, ce qui est au-dessus de nos forces. L’insomnie est une forme d'héroïsme, car elle transforme chaque nouvelle journée en un combat perdu d'avance. La vie n'est possible que grâce à l'oubli : il faut oublier tous les soirs pour entretenir l'illusion que notre vie se renouvelle tous les matins. L’insomnie vous obligé à faire l’expérience de la conscience ininterrompue. Vous entrez en conflit avec tout le monde, avec l'humanité dormante. Vous n'avez plus la sensation d'être un homme comme les autres, puisque les autres vivent dans l'inconscience. On se met alors à développer un orgueil dément. On se dit : « Mon destin est différent, je connais l'expérience de la veille ininterrompue. » Seul l'orgueil, l'orgueil de la catastrophe vous redonne alors courage. On cultive le sentiment extraordinairement flatteur de ne plus faire partie de l'humanité ordinaire. On se sent à la fois flatté et puni. L’orgueil qui m'a habité toute ma vie — l'orgueil de la lucidité — remonte peut-être à cette époque. Je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'un homme est intelligent, extraordinaire ou même génial, qu'il est forcément lucide. Or moi, je m'étais arrogé la lucidité, je m'en étais attribué le monopole. Aujourd’hui, je ne vois plus les choses ainsi. Je crois qu'en définitive la lucidité est le propre de tout homme malheureux. (…) Au fond, l’homme est un être qui veille. (…) Celui qui n’a pas connu le drame de la conscience me paraît infiniment naïf. (…) Lorsque je souffrais d’insomnies, je méprisais absolument tout le monde, mes semblables passaient pour des animaux à mes yeux. (…) La veille, la conscience ininterrompue, c’est l’homme porté à sa limite.
► Extrait de : Itinéraire d’une vie : E. M. Cioran, entretien avec Gabriel Liiceanu, Michalon, 1990, p. 92.

 Cioran, esthète de l’Apocalypse
Cioran, esthète de l’ApocalypseGrâce aux Cahiers qu'il a tenus de 1957 à 1972 et qu'il souhaitait voir détruits, on peut se promener à loisir dans les coulisses du théâtre intime de ce magicien du néant.
[Ci-contre : La Mort et le fossoyeur, Carlos Schwabe, 1895-1900]
Cioran rappelle dans ses journaux cette promenade avec une amie qui affirmait doctement que le « divin » était présent en chaque créature. L’écrivain désigne une mégère insupportablement vulgaire : « Dans celle-là aussi ? » Elle ne sait que répondre, tant il est vrai que la théologie et la métaphysique abdiquent devant l’autorité du détail mesquin. « Je n’ai jamais rencontré personne, écrit-il ; je n’ai fait que trébucher sur des ombres simiesques ».
Las de régler ses comptes avec l’humanité et avec lui-même , il avoue que ce qui le comblerait, ce serait de voir le soleil exploser et s’émietter, disparaître à jamais. « Aussi, ajoute-t-il, avec quelle impatience et quel soulagement j’attends et je contemple les couchants ! »
Deux hommes se disputent l’âme de Cioran : un moine et un esthète. Le moine a pris pour patrons le Bouddha et Job. L’esthète, lui, flirte avec l’idée du suicide et rêve de l’extermination de l’humanité. Il se découvre une parenté avec Hitler, mais un Hitler aboulique. « Hitler, écrit-il, qui est arrivé en tout point à la négation de ce qu’il avait projeté, pourrait bien être le symbole de l’homme en général ». Par ailleurs, Cioran se proclame volontiers métaphysiquement juif (1), ce qui n’est qu’un paradoxe de plus de la part d’un homme qui en était prodigue.
Chaque fois qu’on lui demande sa profession, il se retient pour ne pas répondre : « Escroc en tout genre ». Sa lucidité rageuse ne l’épargne pas. Il explique même pourquoi aujourd’hui un écrivain ou un philosophe se doivent de tricher : « Un rien de feinte dans le tragique, un soupçon d’insincérité jusque dans l’incurable, telle m’apparaît la marque distinctive du moderne ». Il note qu’en Inde un Schopenhauer ou un Rousseau n’auraient jamais été pris au sérieux, parce qu’ils vécurent en désaccord avec les doctrines qu’ils professaient ; pour nous, c’est là précisément la raison de l’intérêt que nous leur portons.
Le journal intime est une arme redoutable, car elle se retourne presque infailliblement contre celui qui se soumet à sa loi. Aussi les carnets que Cioran a tenus de 1957 à 1972, soit de sa 47ème à sa 72ème année, sont-ils fascinants : on s’y promène dans le bric-à-brac de ce magicien du néant plus épris de la vie qu’il ne veut bien le concéder, de ce solitaire très entouré, de cet hypocondriaque redoutablement résistant, de cet ermite un peu trop soucieux de sa notoriété. On comprend que, sur la couverture de ses Cahiers, tenus pour se dégourdir la plume et servir de laboratoire à ses essais, il ait écrit : « À détruire ! » Sa compagne, Simone Boué, décédée accidentellement le 11 septembre 1997, en a jugé autrement et on se gardera bien de l’en blâmer. D’une part, parce que si Cioran avait vraiment voulu les détruire, il lui eût été loisible de le faire de son vivant. Et d’autre part, parce que rien ne nous touche plus que la vérité nue d’un être.
Disons d’abord ce qu’on ne trouvera pas dans ce journal ; le sexe, la vie amoureuse. Cioran reconnaît d’ailleurs que dans tout ce qu’il a écrit, il n’a pas rendu à la sexualité l’hommage qu’elle méritait. Une anecdote cependant: dans un train, il observe une jeune fille. Elle l’attire. Alors, il l’imagine morte à l’état de cadavre avancé, ses yeux, ses joues, son nez, ses lèvres, tout en pleine putréfaction. « Rien n’y fit, confesse-t-il. Le charme qu’elle dégageait s’exerçait toujours sur moi. Tel est le miracle de la vie ». Nous n’en saurons pas plus.
Sur l’amitié, il est plus prolixe. Il n’y croit pas. Il va de soi pour lui que nous haïssons tout le monde : amis et ennemis, avec toutefois cette différence que nous ne savons pas que nous haïssons nos amis. Mais nous les haïssons d’une certaine façon.
À propos d’ennemis, il revient à plusieurs reprises sur celui qu’il considère comme son « détracteur en titre » et comme un « calomniateur professionnel » : le philosophe marxiste Lucien Goldmann, l’auteur du Dieu caché, roumain comme lui, juif, qui l’aurait poursuivi de sa vindicte jusqu’à sa mort, en 1970. « N’importe qui, à ma place, aurait eu des réactions à la Céline, écrit Cioran, mais j’ai réussi à surmonter une tentation aussi basse qu’explicable et humaine. »
RÉVÉLATION
De fait, il pense que Goldmann, en lui barrant l’accès à une carrière universitaire, lui a rendu service. Il l’a amené, plutôt que de croupir au CNRS et à publier de stériles travaux universitaires, à écrire des livres pour lui seul. « Il faut toujours savoir gré à un ennemi de vous ramener à vous-même, de vous sauver de la dispersion et du délayage, de travailler malgré tout pour votre plus grand bien ». Sans doute est-ce la révélation la plus surprenante de ces carnets de Cioran : la place, celle du mauvais démiurge, qu’y tient Goldmann.
Mais ces calomnies ? Étaient-elles fondées ? Cioran n’y fait guère allusion. Il note bien que son admiration maladive pour l’Allemagne a empoisonné sa vie, qu’elle a été la pire folie de sa jeunesse, mais il n’en dit guère plus. On trouve cependant une réflexion assez curieuse, mais bien dans sa manière, sur le fait que ce qu’il ne pardonnait pas aux nazis, c’était moins de tuer les juifs que de les humilier : l’étoile jaune était une abomination à ses yeux. Il revient souvent sur Hitler (« avec lui, le néant a une voix »), l’homme qu’il prétend haïr le plus, mais aussi il se demande si, sous certains aspects, il ne lui ressemble pas. Mais qui ne ressemble pas à Hitler ? « À la fin de la dernière guerre, écrit-il encore, tout le monde lui ressemblait, même les vainqueurs, surtout eux. D’ailleurs, ils n’ont pu le vaincre qu’en l’imitant de plus en plus, qu’en s’identifiant à lui. Jamais ils n’auraient pu l’écraser avec des méthodes démocratiques, humaines, libérales. Quand vainqueurs et vaincus emploient les même procédés, ils se valent et aucun d’eux n’a l’autorité morale de parler au nom du Bien. »
En face de Hitler, Cioran place Freud. Et on ne sera guère surpris de voir que si la psychanalyse l’irrite il assistera cependant aux séminaires de Lacan à l’École normale, Freud, en revanche, lui en impose. Il admire son courage, il partage son refus de la métaphysique, de toute métaphysique. Refus caractéristique également du Cercle de Vienne et, d’une manière plus générale, de toute la philosophie autrichienne.
Cioran, par son goût de la dérision, par sa haine de soi, par son sens inné de l’exagération, par sa volonté de provoquer, appartient à cette tradition austro-hongroise. Il est aux antipodes de philosophes comme Heidegger ou Sartre, d’essayistes comme Barthes ou Blanchot pour prendre quelques-unes des cibles de ses sarcasmes. Il est même prêt à pardonner à Bertrand Russell son humanisme et son progressisme dont Wittgenstein déjà se gaussait après avoir lu que, très jeune encore, Russell avait écrit qu’il fallait exterminer le plus grand nombre de gens possible, pour que la somme de conscience diminue dans l’univers.
Commentaire de Cioran : « Il aurait dû mourir après ce coup d’inspiration. Avec une “pensée” pareille, on ne peut faire une œuvre. Mais qu’importe une œuvre ? La vie n’a d’excuse que par des éclairs qui la dépassent ou la nient. Avoir un de ces éclairs nous rachète et nous justifie ». Toute l’éthique de Cioran tient en ces quelques remarques. On peut les juger odieuses, farfelues ou sublimes. Elles émanent d’un homme qui, toute sa vie durant, a râlé contre l’inconvénient d’être né. Qui a cherché, sans le trouver, dans la pire des politiques un remède à cette déchéance. Qui a ressassé, parfois jusqu’à l’écœurement, son méli-mélo funèbre. D’un homme qui se qualifiait volontiers de « raté » pour avoir reculé face au seul acte éthique : le suicide. Mais sans doute avait-il encore trop de réserves d’ironie pour ne pas vouloir jouir de l’ampleur de son naufrage.
► Roland Jaccard, Le Monde [des Livres] n°16416 (7 nov. 1997).
note en sus :
1. Sur le rapport ambivalent que Cioran a toujours nourri vis-à-vis des Juifs, lire : « Cioran et les Juifs » (M. Finkenthal, 1997), « Cioran et les juifs » (C. Valcan, Europa n°11, 2013). On pourra aussi consulter « L'éloge fait aux Juifs » (S. Lotringer, Pardès n°38, 2005) et Les transfigurations de Cioran (L. Nicorescu, thèse, 2006) faisant référence au fameux texte « Un peuple de solitaires » (publié dans La Tentation d'exister, 1956).

 Cioran ou la spiritualité de la décadence
Cioran ou la spiritualité de la décadence« Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c’est qu’il existe… La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou anti-naturelles des utopistes ne pourra être comparé à ses résultats positifs… Quant à moi, qui sens quelquefois en moi le ridicule d’un prophète, je sais que je n’y trouverai jamais la charité d’un médecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoyé par les foules, je suis comme un homme lassé dont l’œil ne voit en arrière, dans les années profondes, que désabusement et amertume, et devant lui qu’un orage où rien de neuf n’est contenu, ni enseignement, ni douleur. » Baudelaire, Fusées.
Il semblait, après Précis de décomposition (1949), que Cioran eût épuisé les ressources de mélancolie dont il avait extrait ce somptueux recueil de proses amères et nocturnes. Trente ans ont passé, et huit fois déjà, y compris le récent Écartèlement (1979), notre bibliothèque Cioran s’est enrichie d’un volume nouveau : Neuf titres en trente ans : c’est peu si l’on songe à l’abondance qui sert d’alibi à la stérilité contemporaine ; c’est d’autant moins que chaque livre a la brièveté des Pensées de Marc-Aurèle ou des Maximes de la Rochefoucauld. C’est beaucoup, toutefois, lorsque l’on vient de relire le Précis, qui avait tous les traits d’un testament personnel, résumant de surcroît tous les signes d’une imminente fin des temps. On est d’ordinaire tenté de faire de Cioran le dernier des moralistes classiques. Un recueil comme Syllogismes de l’amertume, alliant l’ironie froide à la brièveté de l’aphorisme, incite à le ranger dans cette lignée, apparentée à celle des mémorialistes. Plus d’un fragment d’Écartèlement retrouve le caractère de théorème que revêt chez les moralistes l’analyse des replis les plus cachés du cœur de l’homme : « L’amitié est un pacte, une convention. Deux êtres s’engagent tacitement à ne jamais claironner ce que chacun au fond pense de l’autre. Une espèce d’alliance à base de ménagements. Quand l’un d’eux signale publiquement les défauts de l’autre, le pacte est dénoncé, l’alliance rompue. Aucune amitié ne supporte une dose exagérée de franchise ».
Mais imagine-t-on un moraliste ou un mémorialiste classique autrement que l’homme d’un seul livre ? C’est là son signe distinctif. La Rochefoucauld est en ce sens exemplaire, il s’y est repris à deux fois, mais en passant du genre des Maximes au genre des Mémoires, et en donnant à chacun d’eux un chef-d’œuvre unique. Parmi nous, le beau recueil de Georges Roditi, L’esprit de perfection, vérifie cette loi. Le nombre — bien que tout relatif — des œuvres de Cioran suffirait à lui épargner le titre d’héritier des moralistes. Il le récuse lui-même dans Écartèlement. : « Le moraliste est naturellement bien élevé, et il le prouve en exécrant ses semblables avec élégance et, détail plus important, en écrivant peu. Est-il meilleur signe de « civilisation » que le laconisme ? ».
À cette raison tout externe, il faut en ajouter une autre, qui tient cette fois à la substance : les œuvres de Cioran sont une série de variations sur le thème de la décadence. Or les moralistes classiques, pas plus d’ailleurs que les mémorialistes, n’abordent jamais ce thème. Il se prêtait pourtant, à première vue, à leur génie chagrin. Même chez Retz, même chez Saint-Simon, que Cioran range au côtés de Tacite parmi les rares « profonds penseurs », chez ces violents qui décrivent leur échec politique comme l’ultime barrage opposé au torrent du dérisoire et de l’odieux, la décadence est peut-être narrée, elle demeure implicite. Ni le mot ni l’idée n’étaient pourtant inconnus. Est-ce le « ridicule du prophète » dont parle Baudelaire qui arrêta ces gens du monde, par ailleurs peu suspects de « la charité du médecin » ? Est-ce l’honneur de Dieu et de sa Providence qu’ils tinrent à mettre à l’abri en ne montrant le pire que dans la nature humaine, et en épargnant la nature des choses ? Le fait est qu’il y a là une sorte de frontière que les classiques, même les plus noirs, n’ont pas voulu franchir. Ils s’en tinrent à ce qu’ils avaient vu. Ils ne spéculaient pas sur le destin de l’espèce. Il y a d’ailleurs quelque prudence à ne pas trop s’éloigner de la narration ou de la maxime. Traiter de la décadence expose à la prophétie, et il n’est pas facile de survivre à celle-ci. Cioran rappelle la « vive déception » des premiers chrétiens qui, « friands du pire », durent se rendre à l’évidence : « Le nouvel avènement n’aurait pas lieu, la parousie était différée ». Lui-même conjure le péril en laissant du jeu chronologique à ses prévisions d’apocalypse : « La consommation du processus historique est désormais inexorable, sans qu’on puisse dire pour autant si elle sera traînante ou fulgurante ». Il ironise même tout le premier sa déconvenue de trente années : « Il se peut que l’accident survienne moins vite que nous l’espérions. M ais il est exclu qu’il n’ait pas lieu… À tout le monde ne fut pas donné d ’observer de près le Déluge. On imagine l’humeur de ceux qui, l’ayant pressenti, ne vécurent pas assez pour pouvoir y assister ! ». Toute “bonne éducation” et tout scrupule chrétien rejetés, Cioran s’est donc installé au cœur de cette “explosante fixe”, la décadence, il est notre Cassandre. Cassandre éloquente qui, dans le Précis, entrait déjà dans le détail des “orages désirés” : « Nous sommes les grands décrépits, accablés d’anciens rêves, à jamais inaptes à l’utopie, techniciens des lassitudes, fossoyeurs du futur, horrifiés des avatars du vieil Adam. L’Arbre de Vie ne connaitra plus de printemps : c’est du bois sec ; on en fera des cercueils pour nos os, nos songes et nos douleurs. Notre chair hérita le relent de belles charognes disséminées dans les millénaires, leur gloire nous fascina : nous l’épuisâmes. Dans le cimetière de l’Esprit, reposent les principes et les formules : le Beau est défini, il y est enterré. Et comme lui le Vrai, le Bien, le Savoir et les Dieux. Ils y pourrissent tous (l’histoire : cadre où se décomposent les majuscules. et avec elles ceux qui les imaginèrent et les chérirent) ».
Moins juvénile, dans une sorte de compétition visionnaire avec soi-même, le Cioran d’Écartèlement n’est pas moins prophétique : « Après tant de conquêtes et de performances de toute sorte, l’homme commence à se démoder. Il ne mérite encore intérêt que dans la mesure où il est traqué et coincé, où il s’enlise de plus en plus… Quelle ineptie de soutenir qu’il ne fait que commencer ! En réalité, épave presque surnaturelle, il va vers une condition limite : un sage rongé par la sagesse. Il est pourri, oui, il est gangrené, et nous le sommes tous. Nous avançons en masse vers une confusion sans analogue, nous nous dresserons les uns contre les autres comme des minus convulsifs, comme des fantoches hallucinés, parce que, tout étant devenu impossible et irrespirable pour tous, plus personne ne daignera vivre, si ce n’est pour liquider et se liquider. L’unique frénésie dont nous soyons capables est la frénésie de la fin. Viendra ensuite la forme suprême de stagnation quand, les rôles joués, la scène abandonnée, nous pourrons à loisir remâcher l’épilogue ».
L’ascendance littéraire de cette œuvre singulière n’est pas douteuse : elle remonte à Baudelaire. Sa généalogie intellectuelle renvoie au romantisme tardif qui, de 1848 à la fin du siècle, a promu la Décadence, jusque-là débat d’historiens sur la fin du monde romain, au rang de philosophie, de spiritualité, et enfin de Muse moderne par excellence de la pensée, des lettres et des arts. Un des mérites de Cioran est de nous rappeler que le « décadentisme » n’est qu’un des avatars de la Décadence, que celle-ci n’a pas cessé de régner, fût-ce par les réactions qu’elle a suscitées contre son empire, sur la conscience occidentale, et qu’elle y règne plus que jamais aujourd’hui.
La Décadence, Muse du XIXe siècle
« Every age of mankind has increased and still increases, the real wealth, the happiness, the knowledge and perhaps the virtue of the human race. » Gibbon, Decline and Fall, IV
« Le genre humain ne reverra plus les alternatives d’obscurité et de lumière auxquelles on a cru longtemps que la nature l’avait éternellement condamné. Il n’est plus au pouvoir des hommes d’éteindre le flambeau allumé par le génie et une révolution dans le globe pourrait seule y ramener les ténèbres. » Condorcet, Discours de réception à l’Académie française
« La civilisation peut mourir, puisqu’elle est déjà morte une fois. » Wilamowitz (1897).
Cela avait discrètement commencé au XVIIIe siècle : au moment où l’on se persuadait du “progrès des Lumières” et où l’on inventait le mot de “perfectibilité” (1), Montesquieu s’interrogeait sur les « causes » de la décadence romaine, et Gibbon, reprenant le problème, écrivait The Decline and Fall of the Roman Empire (2). Cela s’était esquissé dès le XVIe siècle, avec ce qui est peut-être, plus que Le Prince, le vrai chef-d’œuvre de Machiavel : ses commentaires sur la Ière Décade de Tite-Live. Là, déjà, au détour d’un paragraphe, un des arguments de l’analyse de Gibbon est énoncé : c’est la religion chrétienne, en rendant les hommes incapables de la vertu civique et de la vertu militaire, qui a rendu possible la stagnation et la dispersion de l’Italie moderne. Il fallut deux siècles, après l’effort de la Réforme catholique pour faire mentir cette accusation digne de Celse, pour que celle-ci devînt l’armature d’un chef-d’œuvre de la littérature historique, et s’élargît de l’Italie à l’Europe. Étudiant les causes de la décadence exemplaire et originaire, celle de Rome, Gibbon était conduit à une profession de foi dans le progrès : le déclin du fanatisme dans l’Europe des Lumières, l’essor depuis la Renaissance des sciences, des lettres, des arts, des mœurs polies, tout semblait indiquer qu’aucun obstacle majeur ne s’opposait plus, sauf accidents réparables, à l’expansion et au développement de l’Europe civilisée. Toutefois la peinture éloquente d’un précédent si prestigieux, les aperçus inquiétants que celui-ci révélait sur les possibilités de la nature humaine, dont Gibbon n’admettait guère la « perfectibilité », devaient faire une impression durable sur l’imagination du XIXe siècle, frappée entre-temps par la chute de l’Ancien Régime et celle de l’Empire napoléonien. La tradition du catholicisme libéral, fondée par Chateaubriand (3) et par Ballanche, eut beau faire pour plaider la cause du christianisme, et lier celui-ci au principe de progrès, c’était en quelque sorte accepter le terrain de l’adversaire, et faire de l’histoire profane, de ses réussites ou de ses échecs humains, un critère de vérité pour la foi religieuse.
« La pensée du progrès — écrira Antoine-Frédéric Ozanam — n’est pas une pensée païenne. Au contraire, l’antiquité païenne se croyait sous une loi de décadence irréparable… C’est avec l’évangile qu’on voit commencer la doctrine du progrès. L’évangile n’enseigne pas seulement la perfectibilité humaine, il en fait une loi : Estote perfecti, soyez parfaits, et celle parole condamne l’homme à un progrès sans fin, puisqu’elle en met le terme dans l’infini… » (4). Ozanam ne se contente pas de faire du progrès des sciences, des arts, de la politesse des mœurs une preuve de l’efficacité historique, et donc de la Vérité du christianisme, il emprunte aux Lumières la notion de perfectibilité et la christianise ! Il est difficile de surévaluer les risques d’une telle historicisation de l’apologétique, et d’une interprétation aussi pélagien ne du dogme du péché originel. Mais c’est aussi un signe des temps : la conscience européenne a déplacé son foyer de réflexion de la théologie spéculative et morale, qui avait absorbé le meilleur de ses forces au XVIIe siècle, dans le grand débat sur la Grâce et sur le probabilisme, à cette nouvelle théologie positive qu’est l’interprétation critique de l’histoire. Même le catholicisme, en tout cas son aile libérale, est emporté par cette irrésistible mutation. Celle-ci contamine désormais tous les domaines de la culture (5) : la polémique entre romantiques et classiques renvoie sans cesse à l’histoire (6), les romantiques accusant les classiques de perpétuer une langue et des formes exténuées, caduques, spectrales, les classiques accusant les romantiques d’introduire dans l’imagination, avec leur primitivisme, leur exotisme, leur pathos de la violence et de l’horrible, les ferments d’une dégénérescence barbare. Dans les deux cas, l’archétype fixé par Gibbon du Decline and Fall, ravivé par les images de la Révolution et des guerres de l’Empire, soutient l’argumentation des adversaires, angoissés par l’approche d’une nouvelle « barbarie » ou exaltés par l’imminence de nouveaux « rédempteurs ». Les luttes politiques se déroulent elles aussi sur fond d’optimisme ou de pessimisme historique, les uns cherchant les nouveaux barbares du côté des démocrates égalitaristes, du prolétariat industriel, du socialisme et du communisme, les autres les trouvant dans la bourgeoisie marchande et industrielle, dans les rémanences de l’Ancien Régime et de l’Église catholique. Les métaphores organiques empruntées à la pathologie médicale orchestrent cette recherche passionnée des causes de “dissolution”, et des éventuels remèdes ramenant à la “santé” le cours des choses.
La relative stabilité de la nature humaine, même corrompue, et de la Grâce divine, même avare, cessent d’être perçues sous les vicissitudes des événements : le Temps de l’histoire devient la seule évidence troublante, portant les uns à l’espérance, les autres au désespoir, mais finissant par réconcilier tout le monde, l’âge, les circonstances et les déceptions aidant, autour d’un sentiment de désastre plus ou moins imminent. Il devait revenir à la génération post-quaranthuitarde et à ses successeurs immédiats de faire coaguler ces idées et émotions d’origine très diverse, et souvent très contradictoires, en une constellation saturnienne qui préside toujours à notre Weltanschauung, la Décadence. Forgée à partir d’éléments de provenance aussi disparate, réussissant à contenir à la fois l’espoir et le désespoir, le pessimisme et l’optimisme, la réaction passéiste et le progressisme utopique, cette constellation oscillante et mouvante n’a jamais cessé de favoriser les retournements les plus inattendus, les échanges et emprunts d’idées d’un « parti » à l’autre qui rendent si « insaisissable » l’analyse de la scène intellectuelle moderne. Mais enfin, s’il faut la réduire à son noyau essentiel, la Décadence, depuis Baudelaire jusqu’à nous, vit et prospère du paradoxe suivant : l’époque contemporaine — tel le Ve siècle de l’Empire romain — est corrompue, cadavéreuse, elle court à sa perte fatale, les barbares l’assiègent de toutes parts et l’occupent de l’intérieur ; et, en même temps, cette agonie nauséeuse est l’instant suprême, pour les happy few, de la lucidité, de l’inspiration, voire de la jouissance. Décadence et modernité sont l’avers et le revers, l’un déprimant, l’autre exaltant, d’une même monnaie qui peut être frappée aux armes d’idéologies, voire de régimes apparemment incompatibles, mais dont les emblèmes antithétiques restent les mêmes. Des Esseintes — haïssant l’humanité moderne et se livrant solitairement à des orgies de modernité — demeure secrètement le maître et le modèle très actuel du clergé « intellectuel » qui, en dépit de ses querelles de surface, et après avoir absorbé dans ses rangs prêtres, gens de lettres, artistes, voire hommes d’État, partage au fond un même credo en deux articles : tout va vers sa fin ; j’en tire le meilleur parti. La force de Cioran, sa rigueur singulière, est de refuser le paradoxe de la Décadence comme calcul, et de le vivre — tant d’autres en vivent ! — comme martyre, dans ce qu’il appelle « l’écartèlement ».
De l’angoisse à l’extase
À propos de Bach, Cioran écrit : « J’aime en musique, comme en philosophie et en tout ce qui fait mal par l’insistance, par la récurrence, par cet interminable retour qui touche aux dernières profondeurs de l’être et y provoque une délectation à peine soutenable ». C’est en fait sa propre poétique. Inlassablement, il revient sur l’aporie qui l’obsède : l’heure de l’éveil est aussi celle de l’impuissance mortelle, l’heure de l’émancipation est aussi celle de la capitulation , les dogmes naissants inspirent la terreur, les dogmes « flageolants », dont on s’accommoderait, inspirent une autre terreur, celle de leur déliquescence qui favorise l’expansion de dogmes naissants. L’histoire est un rouet dérisoire, et une roue de tortionnaire. Entre la vigueur des Barbares et la lâcheté des civilisés, la conscience hantée par l’histoire ne peut que se révulser dans le doute, l’insomnie, l’ennui. Çà et là apparaissent tous les thèmes de la Décadence remâchés par le XIXe siècle : les Romains de l’Empire finissant ; l’horreur de la face humaine dans les grandes métropoles « babyloniennes » ; la confusion ethnique que celles-ci favorisent ; le XVIIIe classique « produit de serre, exsangue, artificiel » ; l’intelligence triomphant, pour sa perte, de l’instinct ; la vérité ruinant, aux dépens de la vitalité, l’illusion ; la France, théâtre par excellence de cette auto-dévoration. Mais surtout, la note caractéristique du XIXe siècle final, celle de Des Esseintes, revient obstinément : « Nous autres, en revanche, nous pactisons avec ce qui nous menace, nous soignons nos anathèmes, sommes avides de ce qui nous broie, nous ne renoncerions pour rien au monde à notre cauchemar à nous ».
Bref, « complices de (notre) déchéance », notre étrange joie de vivre est taillée dans notre horreur même de la vie. Que d’autres soient les idéologues, voire les philosophes de la Décadence, au prix d’en masquer « la contrariété » essentielle, ils la diluent, ils la privent de son sel le plus amer et le plus âpre. Cioran, dans la lignée du Baudelaire de Fusées, du Nietzsche de Ecce Homo, veut être le Pascal de la Décadence, son moraliste, bien qu’il s’en défende, son prophète, bien qu’il en sente le ridicule, et surtout son apologiste mystique. Par fragments, par éclairs, par versets, la spiritualité de la Décadence initie chez Cioran aux ténèbres d’un univers manqué, livré à une souffrance inutile, mais calculée avec une précision d’horlogerie sadique, par u n tyran longtemps masqué, mais qui s’enhardit enfin à montrer sa face haineuse, et où tout acte, à plus forte raison tout choix, toute conviction, toute opinion même, équivaut à collaborer avec le bourreau : « Tout projet est une forme camouflée d ’esclavage » ; « Fuir les dupeurs, ne jamais proférer un oui quelconque » ; « Toute utopie en voie de se réaliser ressemble à un rêve cynique ».
Ce fils de pope est probablement te moins chrétien de tous les modernes. Il est aussi parmi nous une des âmes les plus intimement religieuses, oscillant donc de l’angoisse du doute à l’extase. Bouddhiste à ses heures, dans la tradition ·de Schopenhauer, te maître du dernier fin-de-siècle, il ne voit de salut que dans l’intuition du vide antérieur, pur du temps, de l’espace, des stigmates du créé. Écrire, depuis le lieu trop plein et corrompu où l’âme, complice, est attachée à un cadavre en sursis, c’est scander une via negativa acharnée, c’est déployer toutes les sautes d’ironie, de doute, de mépris, de méfiance, de méchanceté même dont l’âme est capable, et qui par leur tension, leur excès, l’aigu de leur pointe, préparent l’instant rare, indicible, anticipant « la paix d’outre-tombe », où l’écartèlement devient déchirement des derniers voiles et laisse percer la foudre de la vérité. L’analyse morale de la décadence, la prophétie apocalyptique étendue à l’espèce entière, la méditation des grands intercesseurs, Héraclite, Diogène, Épicure, Pyrrhon, Tacite, Marc-Aurèle, Saint-Simon, Nietzsche, la culture de la répulsion, et jusqu’à ces visitations imprévisibles du « suspens », difficilement assignables à telle ou telle sagesse antique, autant d’exercices spirituels qui extraient du mal le peu de remède dont il est susceptible, qui l’exténuent du moins à force de le traquer sous couleur de lui obéir : « On n’écrit pas parce qu’on a quelque chose à dire, mais parce qu’on a envie de dire quelque chose ». D’où : « Un livre doit remuer des plaies, en provoquer même. Un livre doit être un danger ».
Cette poétique du Pecca fortiter (7) nous ramène à Baudelaire et à la littérature. Et sur ce plan, l’œuvre de Cioran pourrait bien être le résumé et l’apocalypse — à l’image de son obsession métaphysique — de la prose inaugurée en notre langue par le poète des Fleurs du Mal, par le maître de style et le directeur de conscience du Huysmans d’À Rebours et du Barrès du Culte du Moi. Si l’art de l’aphorisme, chez Cioran, peut se réclamer de Pascal et de Nietzsche, ses petits poèmes en prose, et plus encore ses échappées éloquentes de longue haleine, recueillent non seulement les thèmes, la gamme des tons, mais le style distinctif d’une lignée qui, par delà Baudelaire, remonte à Chateaubriand, père du catholicisme libéral, mais père aussi, littérairement, de ses pires contempteurs. Ce n’est pas le moindre paradoxe de la Décadence que ses stridences les plus cruelles aient pu donner lieu à une pareille plénitude du bonheur d’expression : « Au mur, une gravure représentant la pendaison de partisans armagnacs, dont le regard est fait de ricanements, d’hilarité, et d’extase. On dirait qu’ils ne redoutent rien tant que de voir leur supplice finir le spectacle de ce bonheur indicible et provocant. on n’arrive pas à s’en rassasier ».
► Marc Fumaroli, Commentaire n°11, 1980.
Notes :
• 1. [note en sus] Voir « L'idée de perfectibilité infinie : noyau de la pensée révolutionnaire et libérale », Robert Steuckers, Vouloir n°65/67, 1990.
• 2. Sur ce livre, voir Michel Baudon, Edward Gibbon et le mythe de Rome : Histoire et idéologie au siècle des Lumières, Serv. Reprod. Lille, 1975, 2 vol. Sur la polémique au sujet de Rome, des Barbares et du christianisme, voir Santo Mazzarino, La fin du monde antique : avatars d’un thème historiographique, Gallimard, Bibl. des Histoires, 1979, et les mises au point d’Henri-Irénée Marrou, Décadence romaine ou antiquité tardive ?, Seuil, 1977 et d’A. Momigliano, « After Gibbon’s Decline and Fall », ASBSP, 1978, p. 435-454.
• 3. [note en sus] Chateaubriand, à la suite de Boulainvilliers, de Saint-Simon et de Fénelon, appartient à l'école qui restera toujours minoritaire dans l'opinion française, celle du libéralisme aristocratique (défini parfois comme libéral-conservatisme). Il ne cesse d'invoquer les vertus de la noblesse et, disons même, sa supériorité morale, manifeste par le goût de l'indépendance, l'honneur, des « mœurs ingagnables » ; fille du temps, force sociale enracinée dans l'histoire, la noblesse est la mieux à même de défendre les libertés publiques. L'exaltation des valeurs aristocratiques va de pair avec une vive critique de l'absolutisme monarchique, dont il fait une des causes majeures de la Révolution. Le Malouin issu d'une famille « chalotiste », attachée bec et ongles aux libertés traditionnelles « bretonnes » face à l'absolutisme royal, met en lumière, bien avant Tocqueville, le rôle joué par l'État capétien, rôle qu'il explicitera dans les articles du Conservateur (1818-1820), puis, de manière plus ample, dans ses Études historiques (1831), où il décrit la marche incessante de la monarchie vers l'absolutisme : la Révolution est très largement l'œuvre de la monarchie ; elle procède de son génie, essentiellement autoritaire et centralisateur. Dans son étude consacrée au grand écrivain, M. Fumaroli regrette, sans toutefois pleinement convaincre, que la réhabilitation de la pensée politique de Chateaubriand n'ait pas encore été accompagnée d'une réévaluation de son action politique. Ce qui n'enlève rien à la qualité de sa méditation historique sur le vicomte : « Sur un mode érudit et poétique à la fois, Marc Fumaroli entreprend une plongée dans l'une des heures les plus déchirantes de l'histoire : son monumental Chateaubriand : Poésie et Terreur (Fallois, 2003 ; Tel/Gal., 2006) forme un dialogue avec la France à travers l'un de ses meilleurs artistes. Immense chant funèbre, écrit dans une prose aujourd'hui improbable, cet essai médite sur le royaume de France en exaltant les libertés aristocratiques qui ont été fondatrices de la civilisation de l'esprit » (S. Giocanti, Une histoire politique de la littérature, 2009).
• 4. Antoine-Frédéric Ozanam, La civilisation au Ve siècle, introduction à une histoire de la civilisation aux temps barbares, Lecoffre, Paris, 1862 (2e éd.) : « Avant propos : Dessein d’une histoire de la Civilisation aux temps barbares » (réponse à Gibbon) et « Introduction : Du progrès dans les siècles de décadence », p. 18. L’ouvrage est évidemment dans la lignée du Génie du Christianisme et des Études historiques de Chateaubriand.
• 5. Voir, au titre surtout de bibliographie commentée, K.W. Swart, The sense of decadence in nineteenth œntury France, Nijhoff, La Haye 1964.
• 6. Sur l’arrière-plan historiographique du débat Classiques-Romantiques, et les origines du sens littéraire du mot “décadence”, voir Désiré Nisard, Études de mœurs et de critiques sur les poètes latins de la décadence, Hachette, 1834 ; J.J. Ampère, Histoire littéraire de la France avant le XIIe siècle, Hachette, 1839, 3 vol. [tome I / II / III]
• 7. Expression latine signifiant “sans retenue”. Elle fait allusion ici à cette secrète inclination au mal et cette connivence naturelle avec lui dans l'univers baudelairien. L'expression est empruntée au réformateur allemand Martin Luther : Esto peccator et pecca fortiter (sois pécheur et pèche fortement). Cette formule provient de la lettre écrite de la Wartbourg à Philippe Melanchton le 1er août 1521 : « Si tu es prédicateur de la grâce, ne prêche pas une grâce feinte, mais véritable. Si elle est véritable, tu dois porter un péché vrai et non imaginaire. Dieu ne sauve pas les faux pécheurs. Tu peux commettre le péché si tu le veux, et le commettre sans retenue, mais crois plus fort encore, et réjouis-toi en Christ, qui est vainqueur du péché, de la mort et du monde. (Deus non salvit peccatores. Pecca fortiter sed fortius fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et mundi). Il faut pécher tant que nous sommes ainsi. Cette vie n'est pas la demeure de la justice, mais nous attendons, dit Pierre, de nouveaux cieux et une terre nouvelle où la justice habitera. Il nous suffit de reconnaître par les richesses de la gloire divine l'agneau qui enlève les péchés du monde. Le péché ne nous arrachera pas de lui, même si mille fois, mille fois par jour, nous commettons la fornication ou l'homicide. Crois-tu si petit le prix de rachat donné pour nos péchés par un agneau si grand ? Prie beaucoup, car tu es très grand pécheur ». Luther ne conseillait pas par là à son ami de se livrer à la débauche, mais voulait lui signifier que la grâce qu'il faut prêcher doit être une grâce réelle, qui doit rédimer des péchés réels.

Souffrance de la France et appel de l’Empire
Cioran ausculte notre patrie
Un ennui tient à la clarté. C’est l’ennui qui tient au trop de clarté. « Je ne crois pas que je tiendrais aux Français [au sens d’être attaché à] s’ils ne s’étaient pas tant ennuyés au cours de leur histoire. Mais leur ennui est dépourvu d’infini. C’est l’ennui de la clarté. C’est la fatigue des choses comprises. » (Cioran, De la France, 1941). La France, dit-il encore, c’est la sociabilité, l’amour de la conversation. « C’est une culture a-cosmique, non sans terre mais au-dessus d’elle ».
Sur la fin de la France comme peuple, Cioran livre cette prodigieuse analyse, indépassée : « Un peuple sans mythes est en voie de dépeuplement. Le désert des campagnes françaises est le signe accablant de l’absence de mythologie quotidienne. Une nation ne peut vivre sans idole, et l’individu est incapable d’agir sans l’obsession des fétiches. Tant que la France parvenait à transformer les concepts en mythes, sa substance vive n’était pas compromise. La force de donner un contenu sentimental aux idées, de projeter dans l’âme la logique et de déverser la vitalité dans des fictions – tel est le sens de cette transformation, ainsi que le secret d’une culture florissante. Engendrer des mythes et y adhérer, lutter, souffrir et mourir pour eux, voilà qui révèle la fécondité d’un peuple. Les “idées” de la France ont été des idées vitales, pour la validité desquelles on s’est battu corps et âme. Si elle conserve un rôle décisif dans l’histoire spirituelle de l’Europe, c’est parce qu’elle a animé plusieurs idées, qu’elle les a tirées du néant abstrait de la pure neutralité. Croire signifie animer. Mais les Français ne peuvent plus ni croire ni animer. Et ils ne veulent plus croire, de peur d’être ridicules. La décadence est le contraire de l’époque de grandeur : c’est la re-transformation des mythes en concepts. […] Les Français se sont usés par excès d’être. Ils ne s’aiment plus, parce qu’ils sentent trop qu’ils ont été. Le patriotisme émane de l’excédent vital des réflexes ; l’amour du pays est ce qu’il y a de moins spirituel, c’est l’expression sentimentale d’une solidarité animale. Rien ne blesse plus l’intelligence que le patriotisme. L’esprit, en se raffinant, étouffe les ancêtres dans le sang et efface de la mémoire l’appel de la parcelle de terre baptisée, par illusion fanatique, patrie. […] La France n’a plus de destin révolutionnaire, parce qu’elle n’a plus d’idées à défendre. Les peuples commencent en épopées et finissent en élégies. »
Cioran évoque l’appel de l’Empire : « Lorsque se défont les liens qui unissaient les congénères dans la bêtise reposante de leur communauté, ils étendent leurs antennes les uns vers les autres, comme autant de nostalgies vers autant de vides. L’homme moderne ne trouve que dans l’Empire un abri correspondant à son besoin d’espace. C’est comme un appel à une solidarité extérieure dont l’étendue l’opprimerait et le libérerait en même temps. » Et l’on comprend alors ce qu’on n’avait peut-être jamais compris avant : l’Empire est femelle, l’Empire, c’est la protection de la femme, de la mère, c’est le ventre. C’est la part féminine d’une aspiration au politique. D’où sa légitimité, d’où, aussi, la nécessité que cette part féminine ne s’exprime pas trop fémininement. En d’autres termes, l’Empire doit être républicain avant d’être démocratique (la République est la condition de la démocratie). Si c’est le contraire, on ajoute de la féminité à de la féminité, on ajoute de la domesticité à de la domesticité, de la protection à la protection, et c’est alors un déficit de masculinité qui se manifeste. Avec un très gros risques : ce sont les empires faibles qui sont les plus bellicistes (Russie et Autriche-Hongrie en 1914). Le Japon de 1941 n’est pas un contre-exemple : ce n’était pas un empire fort dans la mesure où le Japon était fort mais n’était aucunement un Empire, c’était une nation avec un Tenno, ce qui n’est pas du tout la même chose.
► Pierre Le Vigan, site Europe maxima, déc. 2009.
***
 ♦ Cioran, Entretiens avec Sylvie Jaudeau & Sylvie Jaudeau, Cioran ou le dernier homme, José Corti, 1990.
♦ Cioran, Entretiens avec Sylvie Jaudeau & Sylvie Jaudeau, Cioran ou le dernier homme, José Corti, 1990.Au moment où Cioran décide de ne plus écrire, voici que José Corti publie deux volumes sur la pensée et l’œuvre de ce penseur roumain vivant en France le destin d'un exilé volontaire. Ces deux publications se complètent en ce sens que la première est de nature analytique lorsque la deuxième propose une synthèse. Les entretiens constituent le dernier mot du penseur dont l’œuvre dès lors peut être considérée comme achevée et close. Il doit donc être possible de dégager le sens de cette œuvre. La question se pose de savoir quel est le rôle de l'élaboration de l'œuvre dans le destin de son auteur. La réponse nous confronte avec ce paradoxe que Cioran a écrit pour se guérir de la passion morbide d'écrire. Du coup ce n'est plus l'écrivain qui est interrogé mais bien le lecteur. Voilà en tout cas la conclusion à laquelle arrive Sylvie Jaudeau à la fin de son étude. Celle-ci, avant d'aborder les paradoxes de l'écrivain, s'organise selon une logique de la chute et de l'envol. Tout d'abord Cioran est un émigré qui est tombé dans le temps, notre temps post-historique ; ayant traversé le scepticisme il aboutira à un mysticisme et à une sagesse qui lui permettent de tomber hors du temps, l'écoute de la musique offrant la possibilité de vivre l'éternité dans le temps. Chez Cioran le paradoxe n'est pas une figure de pensée, mais l'expression même d'une situation existentielle, celle d'un gnostique athée, d'un mystique qui ne croit en rien, d'un écrivain qui prend la plume pour désapprendre à écrire. Dans ce sens, l'expérience de Cioran est concluante. Les Entretiens concernent le cheminement intellectuel du penseur qui se situe par rapport à l'époque où il a été forcé de vivre. Ces deux volumes proposent donc une bonne initiation à l’œuvre de Cioran. On regrettera seulement que, dans son étude de synthèse, Sylvie Jaudeau ait souvent omis de donner des références précises pour certaines citations importantes dans lesquelles la pensée de Cioran est confrontée avec celle de ses contemporains dans le temps et dans la réflexion.
► Leopold Peeters, Revue d'Histoire littéraire de la France n°2, 1992.
***
Biographie : Searching for Cioran, Ilinca Zarifopol-Johnston, Indiana Univ. Press, 2008 (recension)
Documentaire Cioran, (Un siècle d'écrivains, 1999)
Dossier Cioran, Magazine Littéraire n°327, 1994

• Incipit du Précis de décomposition :
♦ Généalogie du fanatisme
 En elle-même, toute idée est neutre, ou devrait l’être ; mais l’homme l’anime, y projette ses flammes et ses démences ; impure, transformée en croyance, elle s’insère dans le temps, prend figure d’événement : le passage de la logique à l’épilepsie est consommé… Ainsi naissent les idéologies, les doctrines, et les farces sanglantes.
En elle-même, toute idée est neutre, ou devrait l’être ; mais l’homme l’anime, y projette ses flammes et ses démences ; impure, transformée en croyance, elle s’insère dans le temps, prend figure d’événement : le passage de la logique à l’épilepsie est consommé… Ainsi naissent les idéologies, les doctrines, et les farces sanglantes.Idolâtres par instinct, nous convertissons en inconditionné les objets de nos songes et de nos intérêts. L’histoire n’est qu’un défilé de faux Absolus, une succession de temples élevés à des prétextes, un avilissement de l’esprit devant l’Improbable. Lors même qu’il s’éloigne de la religion, l’homme y demeure assujetti ; s’épuisant à forger des simulacres de dieux, il les adopte ensuite fiévreusement : son besoin de fiction, de mythologie triomphe de l’évidence et du ridicule. Sa puissance d’adorer est responsable de tous ses crimes : celui qui aime indûment un dieu, contraint les autres à l’aimer, en attendant de les exterminer s’ils s’y refusent. Point d’intolérance, d’intransigeance idéologique ou de prosélytisme qui ne révèlent le fonds bestial de l’enthousiasme.
Que l'homme perde sa faculté d'indifférence : il devient assassin virtuel ; qu'il transforme son idée en dieu : les conséquences en sont incalculables. On ne tue qu'au nom d'un dieu ou de ses contrefaçons : les excès suscités par la déesse Raison, par l’idée de nation, de classe ou de race sont parents de ceux de l’Inquisition ou de la Réforme. Les époques de ferveur excellent en exploits sanguinaires : sainte Thérèse ne pouvait qu’être contemporaine des autodafés, et Luther du massacre des paysans. Dans les crises mystiques, les gémissements des victimes sont parallèles aux gémissement de l’extase… Gibets, cachots, bagnes ne prospèrent qu’à l’ombre d’une foi, — de ce besoin de croire qui a infesté l’esprit pour jamais.
Le diable paraît bien pâle auprès de celui qui dispose d'une vérité, de sa vérité. Nous sommes injustes à l’endroit des Nérons, des Tibères : ils n’inventèrent point le concept d’hérétique : ils ne furent que des rêveurs dégénérés se divertissant aux massacres. Les vrais criminels sont ceux qui établissent une orthodoxie sur le plan religieux ou politique, qui distinguent entre le fidèle et le schismatique.
Lorsqu'on se refuse à admettre le caractère interchangeable des idées, le sang coule… Sous les résolutions fermes se dresse un poignard ; les yeux enflammés présagent le meurtre. Jamais esprit hésitant, atteint d'hamlétisme, ne fut pernicieux : le principe du mal réside dans la tension de la volonté, dans l'inaptitude au quiétisme, dans la mégalomanie prométhéenne d'une race qui crève d'idéal, qui éclate sous ses convictions et qui, pour s'être complu à bafouer le doute et la paresse — vices plus nobles que toutes ses vertus —, s'est engagée dans une voie de perdition, dans l'histoire, dans ce mélange indécent de banalité et d’apocalypse…
Les certitudes y abondent : supprimez-les, supprimez surtout leurs conséquences : vous reconstituez le paradis. Qu'est-ce que la Chute sinon la poursuite d'une vérité et l'assurance de l'avoir trouvée, la passion pour un dogme, l'établissement dans un dogme ? Le fanatisme en résulte — tare capitale, qui donne à l'homme le goût de l'efficacité, de la prophétie, de la terreur, — lèpre lyrique par laquelle il contamine les âmes, les soumet, les broie ou les exalte… N'y échappent que les sceptiques (ou les fainéants et les esthètes), parce qu'ils ne proposent rien, parce que — vrais bienfaiteurs de l'humanité — ils en détruisent les partis pris et en analysent le délire. Je me sens plus en sûreté auprès d'un Pyrrhon que d'un saint Paul, pour la raison qu'une sagesse à boutades est plus douce qu'une sainteté déchaînée.
Dans un esprit ardent on retrouve la bête de proie déguisée ; on ne saurait trop se défendre des griffes d'un prophète… Que s'il élève la voix, fût-ce au nom du ciel, de la cité ou d'autres prétextes, éloignez-vous-en : satyre de votre solitude, il ne vous pardonne pas de vivre en deçà de ses vérités et de ses emportements ; son hystérie, son bien, il veut vous le faire partager, vous l'imposer et vous défigurer. Un être possédé par une croyance et qui ne chercherait pas à la communiquer aux autres, — est un phénomène étranger à la terre, où l'obsession du salut rend la vie irrespirable.
Regardez autour de vous : partout des larves qui prêchent ; chaque institution traduit une mission ; les mairies ont leur absolu comme les temples ; l'administration, avec ses règlements, — métaphysique à l'usage des singes… Tous s'efforcent de remédier à la vie de tous : les mendiants, les incurables même y aspirent : les trottoirs du monde et les hôpitaux débordent de réformateurs. L'envie de devenir source d’événements agit sur chacun comme un désordre mental ou comme une malédiction voulue. La société, — un enfer de sauveurs ! Ce qu'y cherchait Diogène avec sa lanterne, c'était un indifférent…
Il me suffit d'entendre quelqu'un parler sincèrement d'idéal, d'avenir, de philosophie, de l'entendre dire “nous” avec une inflexion d'assurance, d'invoquer les “autres”, et s'en estimer l'interprète, — pour que je le considère mon ennemi. J'y vois un tyran manqué, un bourreau approximatif, aussi haïssable que les tyrans, que les bourreaux de grande classe. C'est que toute foi exerce une forme de terreur, d'autant plus effroyable que les “purs” en sont les agents.
On se méfie des finauds, des fripons, des farceurs ; pourtant on ne saurait leur imputer aucune des grandes convulsions de l'histoire ; ne croyant en rien, ils ne fouillent pas vos cœurs ni vos arrière-pensées ; ils vous abandonnent à votre nonchalance, à votre désespoir ou à votre inutilité ; l’humanité leur doit le peu de moments de prospérité qu'elle connut : ce sont eux qui sauvent les peuples que les fanatiques torturent et que les “idéalistes” ruinent. Sans doctrine, ils n'ont que des caprices et des intérêts, des vices accommodants, mille fois plus supportables que les ravages provoqués par le despotisme à principes ; car tous les maux de la vie viennent d'une “conception de la vie”. Un homme politique accompli devrait approfondir les sophistes anciens et prendre des leçons de chant ; — et de corruption…
Le fanatique, lui, est incorruptible : si pour une idée il tue, il peut tout aussi bien se faire tuer pour elle ; dans les deux cas, tyran ou martyr, c'est un monstre. Point d'êtres plus dangereux que ceux qui ont souffert pour une croyance : les grands persécuteurs se recrutent parmi les martyrs auxquels on n'a pas coupé la tête. Loin de diminuer l'appétit de puissance, la souffrance l'exaspère ; aussi l'esprit se sent-il plus à l'aise dans la société d'un fanfaron que dans celle d'un martyr ; et rien ne lui répugne tant que ce spectacle où l'on meurt pour une idée… Excédé du sublime et du carnage, il rêve d'un ennui de province à l'échelle de l'univers, d'une Histoire dont la stagnation serait telle que le doute s'y dessinerait comme un événement et l'espoir comme une calamité…
 Tags : France, Roumanie
Tags : France, Roumanie










