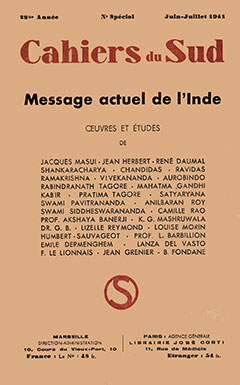-
Aurobindo
 Aurobindo Ghose (1872-1950) : Fils d'une riche famille de Calcutta, il fait des études complètes en Angleterre afin de devenir administrateur civil de l'Empire britannique. Rentré en Inde et engagé dans le mouvement d'indépendance, il le quitta en réponse à un appel spirituel. Il se réfugie en avril 1910 à Pondichéry (alors comptoir français). Ses expériences et un approfondissement de la tradition indienne le conduisirent à la conception de l'évolution humaine qu'il expose dans ses livres, en particulier la Vie divine, et à la discipline spirituelle qu'il appelle le yoga Intégral ; celui-ci associe le développement intérieur et le développement extérieur de l'homme, dont toute la nature, selon sa doctrine, est essentiellement divine. Il vécut d'abord dans la retraite, avec quelques disciples (qui ajoutèrent à son nom Shrî, titre de révérence). Le groupe augmentant en nombre, il en confia la direction spirituelle et matérielle à la Mère, une Française qui était venue une première fois en 1914 et avait rejoint Aurobindo en 1920. Ainsi en 1926, à Pondichéry, fut fondé l'Ashram, la communauté.
Aurobindo Ghose (1872-1950) : Fils d'une riche famille de Calcutta, il fait des études complètes en Angleterre afin de devenir administrateur civil de l'Empire britannique. Rentré en Inde et engagé dans le mouvement d'indépendance, il le quitta en réponse à un appel spirituel. Il se réfugie en avril 1910 à Pondichéry (alors comptoir français). Ses expériences et un approfondissement de la tradition indienne le conduisirent à la conception de l'évolution humaine qu'il expose dans ses livres, en particulier la Vie divine, et à la discipline spirituelle qu'il appelle le yoga Intégral ; celui-ci associe le développement intérieur et le développement extérieur de l'homme, dont toute la nature, selon sa doctrine, est essentiellement divine. Il vécut d'abord dans la retraite, avec quelques disciples (qui ajoutèrent à son nom Shrî, titre de révérence). Le groupe augmentant en nombre, il en confia la direction spirituelle et matérielle à la Mère, une Française qui était venue une première fois en 1914 et avait rejoint Aurobindo en 1920. Ainsi en 1926, à Pondichéry, fut fondé l'Ashram, la communauté. ***
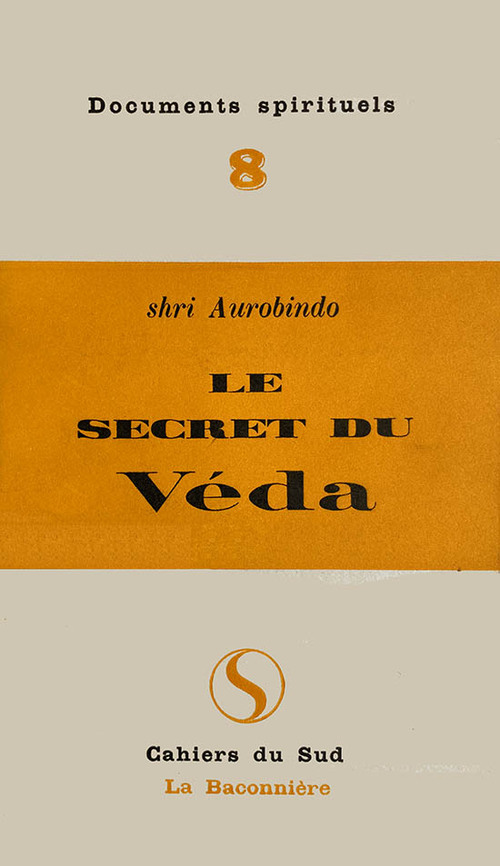 Le secret du Véda selon Aurobindo
Le secret du Véda selon AurobindoDe 1914 à 1916, le périodique Arya [en sanskrit signifie noble] — imprimé à Pondichéry en un nombre limité d'exemplaires et maintenant quasiment introuvable — publia une série d'essais de Srî Aurobindo sur le secret du Véda. Ces essais ont été réédités en un volume sous le même titre, Le secret du Véda (Cahiers du Sud, 1954) [réédité par Fayard en 1975].
Ces essais tentent d'éclairer l'enseignement caché des Védas, en partant de l'idée qu'ils contiennent des mythes susceptibles d'interprétation spirituelle. Il est évident que l'objectif principal d'Aurobindo est de contester l'interprétation matérialiste qui prévalait chez de nombreux érudits indianistes à l'époque où ces essais ont écrits. Selon une réception bien établie, les Védas traiteraient avant tout de la projection superstitieuse d'un caractère divin sur les phénomènes et les forces de la nature, des prières des conquérants indiens pour s'assurer pouvoir, richesse et prospérité, ainsi que des reflets mythifiés des luttes des Aryens contre les peuples indigènes des territoires dans lesquels ils avaient pénétré.
Contre cette approche, qui n'est plus si largement acceptée aujourd'hui, Aurobindo avait la tâche facile. Tout mythe, autrement dit toute structure traditionnelle des origines, présente de par sa nature de multiples aspects, de sorte qu'il admet toujours aussi, en puissance ou en fait, une interprétation spirituelle. L'intention d'Aurobindo est de contester l'existence d'un véritable hiatus entre la phase védique “naturaliste” de la tradition hindoue et sa phase philosophique et métaphysique ultérieure, qui se concrétise surtout dans les Upanishads. Son interprétation, à partir de nombreuses observations finement détaillées et exposées, de certains épisodes typiques et de quelques-uns des hymnes védiques, nous montre comment, sous l'habillage mythique, cette doctrine secrète de l'éveil spirituel et de la nature supérieure de l'être conscient, qui devait constituer le centre de la doctrine des Upanishads, était déjà contenue dans les Védas.
Néanmoins, notre impression est qu'en partie Aurobindo est passé d'un excès à un autre. Alors que l'école naturaliste ne considérait que les aspects extérieurs et rudimentaires des Védas, Aurobindo pour sa part insiste peut-être trop sur leur aspect intérieur, comme si le reste n'était qu'une forme contingente, aboutissant ainsi sur un plan trop unilatéralement spiritualiste. À notre avis, lorsque les traditions concernant les origines, y compris les Védas, sont examinées, nous devrions adopter un point de vue plus global ; c'est-à-dire qu'il faut considérer que le cosmique et le spirituel sont intimement liés, dans la mesure où, selon la formule heureuse de Mircea Eliade, pour l’homme au temps des origines « la nature n'a jamais été naturelle », et dans les représentations matérielles et les vicissitudes réelles un sens supérieur et caché a été inclus, parfois de manière instinctive comme un pressentiment, parfois délibérément de manière à fortifier l'activité d’une élite. Mais cela ne doit pas nous conduire à ignorer l’aspect “cosmique” en privilégiant une interprétation purement “psychologique”.
Un autre point sur lequel nous ne pouvons tout à fait suivre Aurobindo est sa tendance à atténuer l'antithèse entre l'héritage spirituel des Aryens et celui des civilisations aborigènes de l'Inde pré-aryenne.
Par contre un chapitre très important est le cinquième, car il nous donne la clé d'une nouvelle ligne de recherche. Il esquisse quelques principes systématiques dans le domaine de la philologie. Ici aussi, il s'agit de plusieurs significations. Il existe des expressions verbales originales, se référant avant tout aux racines des mots, indiquant pour ainsi dire une “tendance” ou une “structure élémentaire”, qui, selon les circonstances, est susceptible de se traduire en des significations appartenant à des plans très différents, qu'ils soient matériels ou spirituels. Cela donne lieu, par adaptation et spécification, à des expressions qui, objectivement, en raison de ces différences de plan, peuvent paraître sans rapport, alors qu'elles sont associées par d'intimes analogies.
Un exemple donné par Aurobindo est aswa, dont le sens habituel est cheval mais qui est aussi utilisé comme symbole du prana, la force vitale. Sa racine peut également suggérer, entre autres, les notions d'impulsion, de pouvoir, de possession et de jouissance. Ces différentes notions sont associées dans la figure du destrier afin d'en décrire les traits caractéristiques du prana. L'importance, d'un point de vue systématique et épistémologique, de reconnaître cet état de fait est évidente. Aurobindo l'a constaté à propos de l'analyse de certaines expressions védiques ; mais une extension de ce principe, si elle est élaborée par des savants qualifiés, ne peut manquer d'ouvrir des horizons nouveaux et intéressants pour la science de la religion en général.
► Julius Evola, recension parue dans la revue East and West n°2/1955. [version anglaise]
• Autres recensions :
— Cet ouvrage [Fayard, 1975] regroupe une série d'articles publiés par Srî Aurobindo à Pondichéry, dans la revue Arya, de 1914 à 1916. Srî Aurobindo tente d'y rétablir ce qui est, selon lui, le sens véritable du Véda. Non seulement les orientalistes européens, mais déjà les anciens commentateurs hindous, se sont trompés dans leur compréhension des textes védiques, les uns en versant dans la philologie et la mythologie comparées ou dans les explications naturalistes, les autres en se cantonnant dans une exégèse ritualiste. Les chants du Rig-Véda ne sont donc pas les hymnes d'une société primitive et barbare et l’époque du Rig-Véda est dans son essence semblable à celle des mystères orphiques et éleusiniens. Si les textes védiques offrent tant de difficultés de compréhension, c'est qu'ils rendent compte d'expériences difficilement accessibles à l'humanité ordinaire et qui exigent des facultés psychiques aujourd'hui peu développées. C'est donc à la lumière de son expérience mystique — unique — que Srî Aurobindo dévoilera le sens véritable du Véda. Ce sens est un sens intérieur, psychologique, qui ne doit rien aux conceptions ritualistes traditionnelles. Ainsi le ghrita n'est pas le beurre clarifié donné en offrande aux dieux, mais « la lumière de la connaissance consciente formée dans le mental » (p. 116) ; le soma n'est pas une liqueur enivrante, mais la « béatitude », et quand le Véda parle du sacrifice, il veut entendre par là « le don fait par l'homme de ce qu'il possède en lui à la nature supérieure ou divine ». Une bonne partie de ce livre est consacrée à l'application de cette méthode exégétique à des exemples concrets (hymnes ou fragments d'hymnes) tirés du Rig-Véda. (R. Stehly, RHPR n°1/1978)
— Ce travail d'Aurobindo, rédigé entre 1914 et 1916, prétend jeter les bases d'une nouvelle interprétation, « enfin cohérente », des hymnes du Rig-Veda. Ces hymnes auraient trait à la fois aux puissances naturelles, extérieures, et aux réalités spirituelles, intérieures. Le second aspect toutefois dominerait le premier. L'hypothèse implique que certains termes védiques sont employés dans des sens nouveaux, à découvrir et à identifier intuitivement, et d'autres dans des acceptions délibérément ambiguës. (CA Keller, RTP n°2/1981)
• Lire un extrait.
• Pour prolonger : Çrî Aurobindo philosophe du Yoga intégral, Robert Sailley, Maisonneuve & Larose, 1970. Recension : M. Sailley a choisi pour sujet de sa thèse de doctorat la vie et l’œuvre de Çrî Aurobindo, le fondateur de l'ashram de Pondichéry et l'un des plus célèbres penseurs de l'Inde contemporaine. Dans le premier chapitre, il raconte la vie de celui-ci en montrant comment son éducation tout anglaise, puis son adaptation tardive à la civilisation indienne ont déterminé son activité politique d'abord, sa philosophie et son activité religieuse et sociale ensuite. Les quatre autres chapitres traitent des principaux aspects de la pensée d'Aurobindo : une théorie de la connaissance fondée sur l'interprétation symbolique et spiritualiste des Écritures sacrées de l'Inde, en particulier des Veda et de la Gîlâ ; une ontologie évolutionniste et foncièrement moniste ; une psychologie et une éthique basées sur la synthèse des diverses formes de Yoga ; une sociologie elle aussi évolutionniste et spiritualiste, résolument optimiste. Dans une brève conclusion, M. Sailley montre ce qu'a d'original la philosophie d'Aurobindo, comment elle se situe par rapport aux principaux courants de la pensée indienne et de la pensée occidentale dont il présente une intéressante synthèse. L'ouvrage est pourvu d'une bonne bibliographie et d'un index fort complet. On saura gré à son auteur de nous présenter et de nous expliquer clairement, en un format commode, l'essentiel de la vie et de l’œuvre d'Aurobindo, dont il analyse et cite abondamment les livres. Pourtant, M. Sailley, dont l'admiration pour Aurobindo est manifeste, ne paraît pas dominer son sujet comme il conviendrait : il expose, analyse et explique, mais, sauf en de très rares endroits, il manque d'esprit critique. (André Bareau, RHR n°2/1972)
• nota bene : D'un point de vue philosophique, le Veda, au XXe siècle, a été aussi l'objet des travaux de maîtres tels que Ramana Maharshi et Sri Aurobindo entre autres. Le premier est moins connu, parce qu'il n'a écrit qu'en tamoul, mais il est le plus proche de la tradition du Veda et du Vedânta. Aurobindo au contraire a composé directement en anglais et son interprétation est très personnelle et indépendante. En tout cas, l'un et l'autre ont suscité en France un grand intérêt dans divers milieux. Deux livres ont paru sur Ramana Maharshi, en 1975 et en 1978. Le premier par Maria Burgi-Kyriazi ; le second comme œuvre posthume d'un bénédictin, Henri Le Saux : Souvenirs d'Arunâchala : Récit d'un ermite chrétien en terre hindoue. Quant à Aurobindo, son œuvre considérable comporte entre autres Le secret du Véda. Les philologues et les linguistes en Occident font généralement peu de cas de cette survie du Veda dans la pensée contemporaine. En effet, elle n'apporte rien à l'interprétation du texte original. En Occident, surtout en Europe et aussi dans les milieux indiens orientalistes, le Veda est essentiellement étudié dans ses origines et dans sa préhistoire. Il est la mine précieuse de la grammaire comparée et de la mythologie comparée, dont la tâche indispensable est l'investigation de la préhistoire, mais non celle de l'histoire évolutive. Même la tradition classique est de peu d'usage pour l'investigation des origines, à plus forte raison la part du Veda dans les spéculations modernes paraît-elle inutile. Aussi les bibliographies savantes négligent-elles les publications qui ne sont pas d'intérêt scientifique. Mais, par ailleurs, ces publications témoignent d'une présence védique dans l'esprit d'une fraction importante du peuple indien vivant. Elles méritent qu'on prenne au moins conscience de leur existence et il faut savoir que la Radio indienne diffuse des récitations védiques. (Jean Filliozat, « La vie historique et actuelle du Veda », in : Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres n°3/1980)
• pour information : Le SABDA (service librairie de l'Ashram de Pondichéry) vend ouvrages, compilations et études.

Pièces-jointes :
[…] Les disciples d’Aurobindo ont exprimé en termes émouvants le souvenir qu’ils gardent de leur maître. Ils ont célébré la majesté surhumaine de chacun de ses regards, de chacun de ses mouvements, de chacune de ses attitudes, en dépit de l’expression modeste et bienveillante que, volontairement, il s’imposait, sa voix mélodieuse, à la fois énergique et douce. L’un d’eux écrit, dans un numéro spécial du Sunday Times de Madras (17 décembre 1950) : « Il est difficile de le décrire ; mais il est facile de l’adorer ». En tout cas, à ce grand homme s’applique admirablement une formule du philosophe anglais Alexandre Bain : « Un grand homme, c'est plusieurs hommes en un ». Aurobindo a été, parfois tour à tour, parfois en même temps, un professeur, un journaliste, un conférencier, un orateur, un yogi, un grand prosateur, un grand poète, un grand critique littéraire, un grand historien de la philosophie, un grand philosophe. Certains Indiens admirent particulièrement le poème philosophique où il a repris un beau récit ancien, exaltant la femme aimante qui, n’acceptant point de se séparer du mari enlevé par la mort, a fini par se le faire rendre et par le ramener vivant sur la terre : Savitri, une légende et un symbole. Cependant, c'est surtout comme historien de la philosophie, et plus encore comme philosophe, qu’Aurobindo mérite l’admiration. À juste titre, Romain Rolland l’a appelé « le plus grand penseur, le plus grand esprit philosophique et religieux de l’Inde actuelle ».
Dans l’œuvre extrêmement abondante d’Aurobindo, il faut signaler, d’abord, les ouvrages consacrés à l’étude de textes anciens. Il a commenté les principales Écritures sacrées hindoues : les Védas, dans un certain nombre de chapitres parus en la revue Arya (1914-1916), mais qui n’ont pas encore été réédités ; Trois Upanishads (Albin Michel, 1949), dont la plus importante, l’Isha Upanishad, traduite en français, avait paru dès 1939 chez Maisonneuve (« un des livres-rois de l’esprit humain », selon Romain Rolland) ; enfin et surtout, la Bhagavad Gîtâ (édition française abrégée chez Maisonneuve, 1942). Ces textes anciens apportent leur contribution à la « nouvelle synthèse » que recommande Aurobindo. Mais celui-ci y fait aussi une grande place aux sciences et philosophies occidentales. Il est remarquable que ce penseur profondément religieux reconnaisse quelque valeur au rationalisme et même au matérialisme modernes. Il signale « le profit considérable résultant pour l’esprit de la période de matérialisme rationaliste qu’il a traversée. Il fallait obliger l’intelligence à une discipline sévère qui la mette à l’abri des imaginations irrationnelles du passé, afin de préparer le chemin à un nouveau progrès. Il faut à la connaissance ascendante la base d’un intérêt pur, clair et discipliné… Le suprasensible n’est saisi dans sa plénitude que lorsque nous fixons fermement nos pieds sur le terrain des choses sensibles ».
Il énumère et il approuve les progrès accomplis sous l’influence de l’esprit moderne : les conquêtes de la science, l’évolution économique et sociale qui en résulte, la multiplication des machines économisant l’effort humain, la diffusion de l’instruction, l’ascension des classes déshéritées, le relèvement des races retardataires. Il conclut sur ce point : « Si les moyens employés sont contestables, le but véritable est la santé du corps social et des corps individuels, la satisfaction des besoins légitimes de la mentalité la plus matérielle : confort, loisirs, certaine équivalence de conditions qui permette à tout homme de développer dans sa plénitude toutes ses facultés de vie esthétique, émotive, intellectuelle. La préoccupation économique, matérielle, aujourd’hui prime toute autre ; mais, derrière, veille et agit une aspiration plus haute et plus intégrale ». Quelle aspiration ? L’aspiration à la vie divine. Celle que doit réaliser le yoga intégral d’Aurobindo.
La doctrine du grand philosophe est exprimée surtout — pour ne citer ici que des œuvres traduites en français — dans sa Synthèse des yogas (Maisonneuve, 1939) et en de brefs ouvrages tels que La Mère (Maisonneuve, 1938) et La Vie divine (Pondichéry, Aurobindo Ashram, 1947). Citons aussi Aperçus et Pensées (Maisonneuve, 1943). Le but d’Aurobindo étant de réaliser « la conversion de l’âme humaine en une âme divine, et de la vie naturelle en une divine existence », il convient, d’abord, de savoir quelle idée le philosophe se fait de Dieu, et comment il se représente le rapport de Dieu et du monde. Si nous devons donner à Dieu tout notre être et tout notre devenir, nous ne les apportons point en offrande à « une divinité secrète et distante, dans un ciel lointain », ni à « un immobile Absolu. […] Le Divin que nous adorons n’est pas seulement une Réalité extra-cosmique et lointaine, mais une manifestation à demi-voilée, présente et proche de nous dans l’univers ». Dieu est à la fois un et multiple, transcendant et immanent, personnel et impersonnel.
Aurobindo reprend à son compte les hautes spéculations de l’Ishâ Oupanishad. Unité et multiplicité représentent les deux aspects de l’Être Infini : « L’unité est le fait éternel et fondamental sans lequel toute multiplicité serait irréelle, impossible, illusoire… La multiplicité est le fait ou le jeu par lequel l’Unique se perçoit lui-même, dans son expansion propre, comme changeant et divisible, et, par suite, comme occupant de nombreux centres de conscience, de nombreuses formes d’énergie, se mouvant dans l’universel mouvement. La multiplicité est en puissance ou en acte dans l’unité. Sans elle, l’unité ne serait que non-être ou vide stérilité d’un état d’inerte et indiscernable absorption de soi… Multiple, il n’est point cependant lié par sa propre multiplicité. Au sein de toutes les variations, il demeure l’éternel Un ». Et encore : « Un calme, une passivité, une pureté et une égalité parfaits au dedans ; une souveraine et intarissable activité au dehors ; tel est le double aspect du brahman manifesté dans l’univers ».
L’Être Infini « se présente à nous sous deux différents côtés de lui-même, recto et verso par rapport l’un à l’autre » : divine Transcendance, d’une part, et, de l’autre, Conscience cosmique se manifestant dans l’espace et dans le temps universels. L’Être Infini est à la fois personnel et impersonnel : une Personne illimitée, la substance de toutes les substances, le Soi de tous les “soi”. « Il est personnel parce qu’il est le Divin conscient, la Personne infinie qui projette quelques réflexions morcelées d’elle-même dans les myriades de personnalités divines et non divines de l’univers. Il est impersonnel parce qu’il nous apparaît comme existence infinie, conscience et ânanda (béatitude suprême), et parce qu’il est la source, la base et le constituant de toutes les existences et de toutes les énergies, la substance même de notre être mental, vital et corporel, de notre esprit et de notre matière ». Et encore : « L’Existant en soi est lumineusement conscient de Soi et plein de Son propre délice ».
Empruntons aux Aperçus et Pensées d’Aurobindo quelques formules à la fois profondes et jolies : « L’univers…, c’est la joie d’un Dieu amoureux de lui-même, le jeu d’un enfant, l’inépuisable multiplication de soi d’un poète enivré par l’extase de son propre pouvoir de création sans fin… La conscience d’être et la joie d’être sont les premiers parents. Elles sont aussi les ultimes transcendances… La joie d’être n’est pas limitée dans le temps ; elle est sans fin ni commencement. Dieu sort d’une forme seulement pour entrer dans une autre. Après tout, qu’est-ce que Dieu ? Un enfant éternel jouant à un jeu éternel dans un éternel jardin ».
Quand nous envisageons Dieu comme une personne, nous disons : “Lui”. Quand nous considérons son aspect impersonnel, nous disons : “Cela”. Mais « aucune des deux conceptions ne se suffit à elle-même ». Cette thèse synthétique sur la Divinité peut exalter tout particulièrement la piété. « Si nous voulons nous essayer à un yoga intégral, il sera mieux de partir avec une idée du Divin qui soit elle-même intégrale ». « Le cœur peut se consacrer à Lui, peut s’en approcher comme du suprême Bien-Aimé ; il peut battre et se mouvoir en Lui comme dans une douceur d’amour universel et une mer vivante de délices… Il est le Divin Amant qui, avec son amour et sa félicité infinis, attire toutes choses par ses propres chemins vers son heureuse unité… Dans la personnalité, c’est le Maître du yoga, omniscient et omnipotent, que rien ne peut empêcher de mener ce yoga à son but ».
Le « chercheur du yoga intégral [découvre], même dans la disharmonie de la vie terrestre », cet Être divin : derrière toutes les choses, il sent « une Divinité qui est toutes ces choses, le Porteur de lumière, le Guide, Celui qui sait tout, le Maître de la force, le Donneur de félicité, l’Ami, l’Aide, le Père, la Mère, le Compagnon dans le jeu mondial, le Maître absolu de son être, l’Amant et l’Aimé de son âme. Toutes les relations connues de la personnalité humaine sont là, dans le contact de l’âme avec le Divin ; mais elles s’élèvent à des niveaux surhumains et lui imposent une nature divine ». « En tout est le Soi unique ; l’unique Divin est tout ; tous sont dans le Divin, tous sont le Divin, et il n’y a rien d’autre dans l’univers ».
Entre l’Un éternel et la Multiplicité manifestée, il y a un intermédiaire, ou plutôt « une médiatrice » : « la Mère du monde ». C’est Elle qui est descendue dans le monde afin que le monde puisse remonter à Dieu. « D’un côté, par le jeu des énergies qu’elle apporte de l’Unique, elle manifeste le Divin multiple dans l’univers, involuant et évoluant ses apparences sans fin hors de sa substance révélatrice. De l’autre côté, par le courant remontant des mêmes énergies, elle reconduit le tout à Cela d’où a a émané, de sorte que l’âme, dans sa manifestation évolutive, puisse, de plus en plus, retourner là vers la Divinité, ou revêtir ici son divin caractère ». Quand l’homme a réussi à s’élever au divin, c’est qu’à sa foi pure et candide a répondu la grâce de la Mère Universelle. « Seule, la puissance de la Mère, et non aucun effort humain, peut briser le couvercle, déchirer le voile, façonner le vaisseau et amener dans ce monde d’obscurité, de mensonge, de mort et de souffrance, la Vérité, la Lumière, la Vie divine et l’ânanda des immortels ».
Il y a eu, il y a dans le monde un double mouvement de descente ou d’involution, d’ascension ou d’évolution. L’involution, c’est la descente de l’Esprit dans le mental (ce terme désigne l’intelligence individuelle, la vie psychologique des consciences distinctes), puis dans la vie, enfin dans la matière, qui représente le plus bas degré de l’être. L’évolution, c’est « un voyage de retour de la matière vers l’Esprit ». La matière contient en elle la vie, et l’on peut dire qu’elle l’appelle. La vie contient en elle le mental, et l’appelle aussi. Mais le mental ne se suffit pas à lui-même. Jusqu’ici, il est la plus haute des réalités ; mais il n’est pas la plus haute réalité concevable. « Tout comme la Nature physique recelait un secret la dépassant elle-même, qu’elle a libéré en créant l’homme, l’homme, lui aussi, recèle un secret le dépassant lui-même, qu’il doit à son tour libérer à la lumière. Telle est sa destinée ».
Le mental humain contient en soi quelque chose qui le dépasse, et que l’on peut provisoirement appeler le Supramental. Comme la matière est imprégnée de la substance même de la vie, et la vie imprégnée de la substance même du mental, « le mental aussi est imprégné de la substance même du Supramental : sympathies, unités, intuitions, émergences de connaissance préexistante, auto-efficiences inhérentes « la volonté et déguisées sous une forme mentale ». Le mental, en une conscience finie, est basé sur la limitation et la division : c’est à tâtons, par le moyen de la sympathie, qu’il peut atteindre à l’ensemble. Le Supramental, procédant de l’unité, part de l’ensemble, et c’est en cet ensemble qu’il voit des parties ; c’est dans l’universel qu’il aperçoit l’individuel. Il est « en communion consciente avec une source éternelle transcendante par delà les formations de l’univers ».
Ainsi, le cours de l’évolution ne doit pas trouver en l’homme son point final. On peut prévoir, on doit annoncer « l’élévation de l’humanité dans son ensemble à un niveau supérieur. Car l’homme, le premier parmi les enfants de la nature, a montré la capacité de se changer soi-même par son propre effort et l’aspiration consciente à se dépasser soi-même ». La fonction du yoga, c’est d’« accomplir l’évolution de la conscience en accélérant le procédé de la nature par la volonté consciente de soi de l’homme ». « Voici — écrit Aurobindo — la complète définition du but du yoga intégral : la manifestation, dans l’expérience personnelle, de la vérité que la Nature Universelle a cachée au-dedans d’elle-même, et à la découverte de laquelle elle travaille. C’est la conversion de l’âme humaine en une âme divine, et de la vie naturelle en une divine existence ».
Aurobindo appelle sâdhanâ la pratique du yoga, et sâdhak celui qui applique cette discipline. Éliminons d’abord, en ce qui concerne la pratique du yoga, quelques confusions possibles. Fidèle à l’esprit de la Gîtâ, Aurobindo n’admet pas les excès de l’ascétisme. « L’ascétisme n’est pas, en lui-même, l’idéal de notre yoga… Négliger le corps et le laisser s’épuiser est une erreur : le corps est l’instrument de la sâdhanâ et doit être gardé en bon état. Il ne faut pas avoir d’attachement pour lui, mais pas de mépris non plus, ni de négligence pour la partie matérielle de notre nature ». On peut, à ce propos, signaler ce fait curieux qu’Aurobindo et “la Mère” ont publié à l’Ashram de Pondichéry, depuis février 1949, en anglais et en français, un Bulletin d’éducation physique, plein d’utiles conseils.
L’effort pour supprimer par la violence les désirs humains peut arriver à les exaspérer. Par exemple, le jeûne présente un avantage momentané pour des hommes énergiques ; mais, pour d’autres, il peut être périlleux. Il ne faut pas attacher une importance exagérée au problème de la nourriture. Et ce n’est pas une faute de sentir qu’un aliment est agréable au palais. L’une des déesses indiennes qui représente un des grands aspects de la Mère Divine, la Déesse de la Beauté, Mahâlakshmî, est particulièrement hostile à l’ascétisme. « Le dénuement et la sévérité ascétique ne lui sont pas agréables, non plus que la suppression des émotions les plus profondes du cœur, et que la répression rigide des éléments de beauté de l’âme et de la vie. Car c’est par l’amour et la beauté qu’elle place sur les hommes le joug du Divin ». Il ne faut pas fuir la vie : il faut l’accepter et la transformer. S’il faut renoncer à tout désir égoïste, c’est pour mieux jouir de tout l’univers. Le sâdhak du yoga intégral accepte toute l’existence : il doit harmoniser toutes les parties de son être. Comment y arriver ?
On peut, pour la commodité de l’exposé, distinguer deux étapes en ce yoga, à condition de ne pas exagérer leur séparation ; car l’une déborde souvent sur l’autre : la période de l’effort personnel, et celle de l’épanouissement spontané du Divin en l’homme. Dans la première période, l’homme, concentrant tout son être sur le Divin, doit s’attacher à refuser, rejeter tout ce qui s’opposerait à l’action divine. Aurobindo emploie ici le mot grec signifiant purification : catharsis. Même en condamnant le principe de l’ascétisme, il faut reconnaître la valeur de certaines de ses prescriptions : « Une discipline ascétique est plus favorable à notre dessein qu’une molle absence de vraie maîtrise ». Il faut éviter d’attacher quelque importance à la nourriture. Il faut, aussi, maîtriser l’impulsion sexuelle, s’abstenir de l’acte auquel elle pousse, sans y voir cependant « un péché à la fois horrible et attrayant » : c’est seulement « une erreur et un faux mouvement de la nature inférieure ». Avant tout, il faut établir dans l’âme la quiétude, le calme, la paix, le silence ; éviter, en ces débuts, le découragement et l’impatience. En une formule magnifique, Aurobindo déclare : « Pour celui qui est résolu à atteindre le but, il ne peut y avoir d’échec définitif sur le chemin qui mène au Divin ». Éliminant l’égoïsme sous toutes ses formes, il faut atteindre au détachement ; à un « détachement sans indifférence ». Il faut concentrer toute sa pensée sur l’idée de l’Un Divin ; tout son cœur sur la possession, dans une sorte d’extase, du Tout-Merveilleux ; toute sa volonté sur l’accomplissement de ce qu’il veut manifester en nous. Telle est « la triple voie du yoga ».
La pensée découvrira au fond du moi le grand Soi. Elle apercevra le Divin dans le monde, « derrière le démenti apparent offert par son arrangement et ses formes ». Le cœur pourra, à travers les amours humaines et les idolâtries, s’élever jusqu’à l’adoration de l’ineffable. L’homme échappe aux limites de son moi par la sympathie, par la bonne volonté, par la bienveillance et la bienfaisance universelles, par l’amour du genre humain et l’amour de toutes les créatures, par l’art de goûter toutes les formes et toutes les présences qui nous entourent : ainsi se prépare l’amour pour le Divin. « Une joie universelle de sa manifestation sans fin coule à travers nous ». Le cœur « est plus proche du Divin que l’intellect humain dans son orgueil de connaissance ». Enfin, nous devons consacrer volontairement à Dieu tout notre être et tout notre devenir, toutes nos actions. « Un yoga des œuvres, une union avec le Divin dans notre volonté et nos actes, et non pas seulement dans la connaissance et le sentiment, est l’élément indispensable et inexprimablement important d’un yoga intégral ». La première étape aboutit à ce point culminant : « Une complète consécration de tout ce que nous sommes, pensons, sentons et faisons ; un don de soi intégral au Divin ».
Le sacrifice est la grande loi : c’est lui qui corrige les effets de la fragmentation caractérisant notre monde, de « l’égoïsme primaire et de son erreur séparative ». Au début, l’abnégation nécessaire peut être pénible ; mais, sans rien réclamer, l’âme obtient plus qu’elle ne donne, puisqu’elle « reçoit les richesses infinies de la puissance et de la présence divines ». Ainsi, « la vraie essence du sacrifice n’est pas l’immolation de soi, c’est le don de soi ; son objet n’est pas l’effacement, mais l’accomplissement de soi ; sa méthode n’est pas la mortification, mais une plus grande vie ». Le yoga est « une nouvelle naissance » : le passage d’une vie matérielle et mentale égoïste à une plus grande et plus divine existence. « Le secret du succès dans le yoga est de le considérer, non comme un des buts à viser dans la vie, mais comme la vie tout entière ». « Nous connaissons le Divin et devenons le Divin parce que nous le sommes déjà dans notre nature intime ». C’est la Puissance suprême qui agit en nous. Sentir cette Présence ; accueillir cette grâce ; se placer « comme un enfant entre les mains de la Mère divine » : cette « croissante passivité purifiée et vigilante » caractérise la seconde étape du yoga intégral.
L’effort s’atténue, puis disparaît ; il est remplacé par « un épanouissement spontané, simple, puissant et heureux de la fleur du Divin, hors du bourgeon d’une nature terrestre purifiée et perfectionnée ». L’amour divin émerge en notre cœur. Désormais, c’est en nous « une extase active ». L’âme, unie au Divin, se sent unie à toutes les créatures. Toutes les relations humaines, délivrées de leur caractère mesquin, deviennent « des matériaux heureux pour une vie divine » ; car elles contribuent à « rendre l’unité plus parfaite ». En toute émotion, en toute recherche d’amour ou de beauté, l’âme perçoit l’Un éternel. Elle « se joint à l’Un divin dans toutes les choses et dans toutes les créatures ». Les choses les plus simples, les plus ordinaires se transforment ; elles deviennent merveilleuses dès qu’elles suggèrent l’intuition de l’Unité. « La vie est changée en une riche œuvre d’art céleste, et toute existence en un poème de délice sacré ». L’absolu renoncement à tout désir égoïste aboutit à un divin bonheur.
Cependant, Aurobindo soulève, ici, une grave objection. La doctrine qui vient d’être exposée, et qui est surtout inspirée par les Oupanishads, ne risque-t-elle pas d’apparaître comme étant exclusivement « un Évangile de salut individuel » ? S’il en était ainsi, nous conviendrait-elle, à « nous, les hommes d’aujourd’hui, de plus en plus conscients de l’avertissement intérieur de ce qui nous a créés, Nature ou Dieu, de plus en plus conscients qu’il existe une tâche pour la race, un dessein divin dans sa création, qui dépasse le salut de l’individu » ? Aurobindo — qui n’a jamais opposé ni voulu séparer (selon le titre donné à l’une de ses études) la Société et la Spiritualité — ne se résigne pas à cette solution trop individualiste. En effet, « la promesse pour l’individu est bonne, mais la promesse pour la race aussi est nécessaire. Notre Père le Ciel doit rester éclairé par l’espoir de la délivrance, mais notre Mère la Terre ne doit point se sentir à jamais maudite… Nul salut ne doit avoir de prix qui nous dérobe à l’amour de Dieu en l’humanité et à l’aide que nous pouvons donner au monde. S’il le faut, enseignons : Plutôt l’enfer avec le reste de nos frères malheureux qu’un salut solitaire ! »
Heureusement, la Kéna Oupanishad suggère une solution plus nuancée du problème : « L’homme qui connaît et possède le Suprême Brahman comme Béatitude transcendante devient un centre de ce délice vers quoi viendront tous ses compagnons, un puits où ils peuvent puiser les eaux divines ». Nous tenons désormais « le fil conducteur » qui nous manquait. « Double est donc l’objet de l’âme qui atteint les plans supérieurs : parvenir au Suprême et se dévouer à jamais au bien du monde entier comme Brahman lui-même. Ici-bas ou ailleurs ; mais là où la lutte est la plus acharnée, là doit être le héros de l’esprit ; telle doit être, assurément, la préférence la plus haute pour le fils de l’Immortalité. Pour celui qui est devenu un avec l’univers, c’est de la terre que vient l’appel le plus fort, parce que c’est elle qui a le plus besoin de lui ». Cette conception de la spiritualité sera le principal apport de l’Inde dans la synthèse nouvelle dont a besoin l’humanité d’aujourd’hui. « Dieu garde toujours pour lui-même une contrée élue en laquelle la plus haute connaissance se maintient dans les élites ou dans les masses, à travers tous les hasards ou tous les dangers. Dans le cas présent, il semble que cette contrée soit l’Inde ». En tout cas, les penseurs indiens d’aujourd’hui n’ont pas tort de penser que la sublime philosophie d’Aurobindo n’aurait pu naître hors de leur patrie, vouée depuis le plus lointain passé à la spiritualité la plus haute.
► Félicien Challaye, Hommes et Mondes n°56, 1951. [version pdf]
• nota bene : Ce texte de présentation sera repris et augmenté dans le chapitre XVI des Philosophies de l'Inde (1956).
***
 • Recension : De la Grèce à l’Inde, Albin Michel, coll. Spiritualités vivantes, 1976.
• Recension : De la Grèce à l’Inde, Albin Michel, coll. Spiritualités vivantes, 1976. Peu à peu l’œuvre de Shrî Aurobindo est accessible au plus grand nombre, permettant la rencontre des cultures, ainsi que la réflexion sur la différence de ces cultures. On trouvera ici trois textes difficilement accessibles avant cette édition. Le premier rappelle la parenté de l’œuvre d’Héraclite avec la pensée de l’Inde, prenant prétexte d’une étude de R.-D. Ranade sur Héraclite. Le second texte “Aperçus et pensées”, sous forme d’aphorismes, montre comment la sagesse de l’Inde peut être vécue par un occidental. Le troisième texte, “La Mère”, montre le sens du divin et la transformation que l’homme doit accomplir en lui. Ces études sont complétées par un glossaire. On trouvera aussi dans ce volume une présentation d’Héraclite due à Mario Meunier et une introduction à l’œuvre de Shrî Aurobindo due à M. Jean Herbert, son disciple. Ouvrage de réflexion et de méditation, ce livre sera utile en raison de la curiosité actuelle pour la culture de l’Inde et aussi en raison du regain d’intérêt pour les présocratiques.
► Michel Adam, Revue Philosophique de la France et de l'Étranger n°4 / 1977.
♦ Pour prolonger :
• L'Un en Grèce et aux Indes (J. Monchanin, 1953)
• Rencontre d'Homère et de Sri Aurobindo (G. Germain, 1973)
• Interprétation d'Héraclite par Aurobindo (R. Untereiner, 1956)***
 • Recension : Métaphysique et psychologie, textes groupés, traduits et préfacés par J. Herbert, Albin Michel, 1976.
• Recension : Métaphysique et psychologie, textes groupés, traduits et préfacés par J. Herbert, Albin Michel, 1976. Ce penseur, qui est l'un des maîtres de la philosophie hindoue, fit ses études en Angleterre. C'est dire qu'il joint la connaissance de la spiritualité de son pays à une formation puisée dans la culture occidentale. Son œuvre, qui est vaste, est constituée d'abord par des commentaires de grands textes hindous. Il aborde les problèmes les plus fondamentaux de la métaphysique. Il fut aussi l'un des plus grands yogins. Son anthropologie s’enracinera donc dans son expérience spirituelle. Ce livre réunit des extraits de son abondante production, à l'exception de son enseignement sur le yoga qui fera l'objet d'un autre volume. Les passages retenus ici, plus de 1.500, rappellent les sources de la pensée hindoue et ses différentes approches. Puis on trouvera des textes précieux sur la conception de la vérité, l’être, l’esprit et la matière. Les passages concernant l’évolution, puis le divin renouvellent les idées que les Occidentaux se font sur ces questions. La nature et le cosmos, l’homme réel et l’homme apparent, l’homme et la société font l’objet des chapitres suivants. Les derniers chapitres sont consacrés à l’anthropologie ; ils étudient le corps, le désir, les vies successives, la connaissances humaine et ses différents niveaux, ainsi que l'aptitude au dépassement de l'être humain mental actuel. Ce livre est particulièrement utile, grâce à un glossaire, une bibliographie et un index.
On retiendra d'abord la préface écrite par Jean Herbert, qui fut le disciple de Shri Aurobindo. En trente précieuses pages, les thèmes principaux de sa pensée se trouvent exposés et mis en valeur. On suit ainsi le souci de cette métaphysique pour cerner et ce monde-ci et le réel occulté par les apparences, notre être et notre existence secrète, cette vie de la conscience où s'enracinent les expériences mystiques. Il y a l’infini, mais le multiple d'une part et l’unité d'autre part en sont les aspects fondamentaux. Cette saisie de l’intérieur exige des disciplines appropriées, car la vérité est moins à connaître qu’à vivre. Il y a dans chaque démarche religieuse une approche du divin, valide, vraie, mais fragmentaire, qui demande conciliation réciproque. De même, entre le Divin et la Nature, leurs épistémologies respectives, il y a continuité et harmonie. Maya est l’aspect non différencié du pouvoir de l’Être divin. On suivra progressivement le sens donné à la Matière, à la Vie, au Mental qui se prolonge par le Supramental, principe de volonté et de connaissance actives, précédé par le Surmental, principe de division et d'interaction. Le mental lui-même peut être étudié par niveaux selon ses points d’application. Ce sera la tâche du yoga de faire émerger le supramental du mental ; ainsi l’homme trouve en lui le calme du Brahman et la possibilité d'une activité inépuisable.
► Michel Adam, Revue Philosophique de la France et de l'Étranger n°1 / 1977.
***
• Recensions : Thérèse Brosse, Sri Aurobindo-Mère : Shiva-Shakti ou le laboratoire de l’homme de demain, Dervy, 1984. Lettres sur le yoga, I, Buchet-Chastel,1984. Pensées et aphorismes, II, traduits et commentés par la Mère, Buchet-Chastel.
La pensée de S.A. ne laisse pas d’être fortement teintée d’occidentalisme, particulièrement d’idéalisme, comme cela se voit par ex. dans La vie divine, qui demeure une grande œuvre de la philosophie contemporaine. La synthèse du yoga fait encore la part très belle à une recherche spirituelle issue directement du kantisme, bien que mélangée des eaux vives de l’hindouisme. Ne peut-on dire que, chez l’auteur, un courant de spiritualité hindoue recouvre une armature logicienne ? Çankara et le Vedanta prennent un vêtement européen. D’où, sans doute, l’extraordinaire succès d’une œuvre qui s’éloigne sensiblement de l’hindouisme. Les deux livres que nous citons illustrant fort bien cette situation. La séduction aurobindienne ne doit pas cacher la difficulté de gravir les massifs avant d’atteindre les sommets spirituels qui marque le but de l’aventure du yoga intégral. Philosophie des œuvres qui n’offre qu’une liberté exigeante. La grâce nous choisit, mais il nous faut repérer les étapes. Les questions sont donc innombrables. S. A. y répond par ces lettres, ces pensées et ces aphorismes, selon un schéma classique : la connaissance, les œuvres et l’amour. Le yoga intégral est ici examiné sous divers angles : l’évolution supramentale ; religion, morale, idéalisme et yoga ; raison, science et yoga. Les thèmes sont repris et précisés sur un ton familier. L’évolution tend toujours vers le haut. C’est vrai également pour l’homme. L’Intuition au-dedans se développe selon le niveau qu’elle atteint dans son progrès. Elle est présente au commencement, au milieu des choses et à leur consommation. Le Supramental est une Lumière. L’annulation de l’ego dans le Divin, tel est l’idéal spirituel. Donc le Supramental n’est qu’un aspect du pouvoir du Divin. Et la Matière est une force et une conscience involuées qui travaillent en elle. Nous n’avons ici que des découpages de lettres, rassemblés dans un arrangement préconçu. Les Aphorismes, quant à eux, exposent une morale au plan de l’expérience quotidienne. En définitive, « Tout est le Divin et le Divin seul existe ». S. A. retrouve d’une certaine manière le fond et le sens de la religion hindoue qui est spécifiquement une religion philosophique. Mais lui-même est un grand spirituel qui voit « la seule sécurité de la vie... (dans) le développement intérieur permettant l’union consciente avec la Présence divine (qui est) le seul guide efficace, la Vérité de notre être et de tout être ». Nous sommes à la fois très près et très loin des Sermons de Maître Eckhart.
► André Reix, Revue Philosophique de la France et de l'Étranger n°3 / 1985.
***
Recensions par René Guénon dans Études Traditionnelles
— Octobre 1937
• Shrî Aurobindo - Aperçus et Pensées. Préface de J. Herbert (Union des Imprimeries, Frameries, Belgique)
Ce petit livre est la première œuvre de Shrî Aurobindo Ghose qui soit publiée en français : c’est un recueil d’aphorismes et de courts fragments sur des sujets divers, tels que le but réel de l’existence, la nature de l’homme et sa relation avec le monde et avec Dieu, les “chaînes” qui empêchent l’être d’atteindre à la libération, et d’autres encore ; tout cela, qu’il est évidemment impossible de résumer, est à lire et surtout à méditer. Il faut espérer que cette traduction sera suivie de celle d’ouvrages plus importants d’un homme qui, bien qu’il présente parfois la doctrine sous une forme un peu trop “modernisée” peut-être, n’en a pas moins, incontestablement, une haute valeur spirituelle ; mais nous ne pensons certes pas qu’il soit souhaitable, comme le dit l’auteur de la préface, qu’il trouve un Romain Rolland pour écrire sa biographie… et pour le défigurer par sa sentimentalité incompréhensive et bien occidentale !— Juin 1938
• Shrî Aurobindo - The Mother (Arya Publishing House, Calcutta)
Ce petit livre traite de la divine Shakti et de l’attitude que doivent avoir envers elle ceux qui visent à une réalisation spirituelle ; cette attitude est définie comme un « abandon » total, mais il ne faut pas se méprendre sur le sens qu’il convient d’attacher à ce mot. En effet, il est dit expressément, dès le début, que la collaboration de deux pouvoirs est indispensable, « une aspiration fixe et sans défaillance qui appelle d’en bas, et une suprême Grâce qui répond d’en haut », et, plus loin, que, « tant que la nature inférieure est active (c’est-à-dire, en somme, tant que l’individualité existe comme telle), l’effort personnel du Sâdhaka demeure nécessaire ». Dans ces conditions, il est évident qu’il ne saurait aucunement s’agir d’une attitude de “passivité” comme celle des mystiques, ni, à plus forte raison, d’un “quiétisme” quelconque ; cet “abandon” est bien plutôt comparable, sinon même tout à fait identique au fond, à ce qui est appelé, en termes islamiques, et-tawkîl ala 'Llah. Le dernier chapitre, particulièrement important et intéressant, expose les principaux aspects de la Shakti et leurs fonctions respectives par rapport au monde manifesté.— Novembre 1938 :
• Shrî Aurobindo - Lights on Yoga (Shrî Aurobindo Library, Howrah)
Ce livre, composé d’extraits de lettres écrites par Shrî Aurobindo à ses disciples en réponse à leurs questions, précise la façon dont il envisage la voie et le but du Yoga : pour lui, il s’agit « non seulement de s’élever de l’ignorante conscience mondaine ordinaire à la conscience divine, mais encore de faire descendre le pouvoir supramental de cette divine conscience dans l’ignorance du mental, de la vie et du corps, de les transformer, de manifester le Divin ici même et de créer une vie divine dans la matière ». En somme, cela revient à dire que la réalisation totale de l’être ne comprend pas seulement le « Suprême », mais aussi le « Non-Suprême », les deux aspects du non-manifesté et du manifesté s’y unissant finalement de façon indissoluble, comme ils sont unis dans le Divin. Peut-être l’insistance que met l’auteur à marquer en cela une différence avec « les autres Yogas » risque-t-elle de donner lieu à une interprétation inexacte ; en fait, il n’y a là aucune « nouveauté », car cet enseignement a été de tout temps celui de la tradition hindoue, aussi bien d’ailleurs que des autres traditions (le taçawwuf islamique, notamment, est fort explicite à cet égard).Si cependant le premier point de vue semble généralement plus en évidence que le second dans les exposés du Yoga, il y a à cela plusieurs raisons de divers ordres, que nous examinerons peut-être quelque jour ; qu’il suffise ici de faire remarquer d’abord que l’« ascension » doit nécessairement précéder la « redescente », et ensuite que l’être qui a véritablement réalisé l’« Identité Suprême » peut dès lors, et par là même, « se mouvoir à volonté » dans tous les mondes (ceci excluant, bien entendu, qu’il doive, dans la « redescente », se trouver de nouveau enfermé dans les limitations individuelles). Il ne s’agit donc, en tout cas, que d’une simple question de « modalité », et non pas d’une différence réelle quant au but, ce qui serait proprement inconcevable ; mais il n’est pas inutile de le souligner, trop de gens ayant actuellement tendance à voir des innovations là où il n’y a qu’une expression parfaitement correcte ou une adaptation légitime des doctrines traditionnelles, et à attribuer en cela aux individualités un rôle et une importance qu’elles ne sauraient avoir en aucune façon.
Un autre point à noter est celui qui concerne la méthode de réalisation (sâdhana) préconisée par Shrî Aurobindo : elle procède dit-il, « par aspiration, par concentration vers l’intérieur ou vers le haut, par ouverture à l’influence divine » ; c’est là en effet l’essentiel dans tous les cas, et l’on peut seulement se demander si, en paraissant écarter des moyens qui, quel que soit leur caractère « accidentel », n’en constituent pas moins une aide non négligeable, on n’augmente pas les difficultés de cette réalisation, du moins dans la généralité des cas, car bien peu nombreux (et surtout dans les conditions de notre époque) sont ceux à qui la voie la plus directe est immédiatement accessible. On ne doit pas conclure de là que cette voie ne puisse convenir à certains, mais seulement que, à côté d’elle, les autres mârgas conservent toute leur raison d’être pour ceux à la nature et aux aptitudes desquels ils sont plus conformes ; du reste, l’exclusivité sous le rapport de la méthode n’a jamais été dans l’esprit d’aucune tradition, et, assurément, aucun Yogî ne contestera que la voie qu’il a suivie et dans laquelle il guide ses disciples soit en réalité une voie parmi beaucoup d’autres, ce qui, comme nous le disons par ailleurs, n’affecte en rien ni l’unité du but ni celle de la doctrine. Nous ne pouvons insister sur les points de détail, tels que ceux qui se rapportent à la distinction des divers éléments de l’être ; mais nous devons exprimer le regret que la terminologie qui y est adoptée ne soit pas toujours aussi claire qu’on pourrait le souhaiter : il n’y a sans doute aucune objection de principe à élever contre l’emploi de mots tels qu’Overmind et Supermind, par ex., mais, comme ils ne sont point d’usage courant, ils demanderaient une explication ; et, au fond, la simple indication des termes sanscrits correspondants eût peut-être suffi à remédier à ce défaut.
• Shrî Aurobindo - Bases of Yoga (Arya Publishing House, Calcutta)
Cet ouvrage, composé de la même façon que le précédent, apporte de nombreux éclaircissements sur divers points, notamment sur les difficultés qui peuvent se présenter au cours du travail de réalisation et sur le moyen de les surmonter. Il insiste spécialement sur la nécessité du calme mental (qui ne doit point être confondu avec la “passivité”) pour parvenir à la concentration et ne plus se laisser troubler par les fluctuations superficielles de la conscience ; l’importance de celles-ci, en effet, ne doit pas être exagérée, car « le progrès spirituel ne dépend pas tant des conditions extérieures que de la façon dont nous y réagissons intérieurement ». Ce qui n’est pas moins nécessaire est la “foi” (il s’agit ici, bien entendu, de tout autre chose que d’une simple “croyance”, contrairement à ce que pensent trop souvent les Occidentaux), impliquant une adhésion ferme et invariable de l’être tout entier ; de là l’insuffisance de simples théories, qui ne requièrent qu’une adhésion exclusivement mentale.Signalons aussi, parmi les autres questions traitées, celles de la régulation des désirs et du régime de vie à suivre pour obtenir le contrôle de soi-même ; il est à peine besoin de dire que nous ne trouvons là aucune des exagérations qui ont cours à cet égard dans certaines écoles pseudo-initiatiques occidentales, mais, au contraire, une mise en garde contre l’erreur qui consiste à prendre de simples moyens pour une fin.
La dernière partie du livre est consacrée à l’examen des différents degrés de la conscience, avec la distinction essentielle du “superconscient” et du “subconscient”, qu’ignorent les psychologues, à des aperçus sur le sommeil et les rêves et sur leurs différentes modalités, et sur la maladie et la résistance qui peut y être opposée intérieurement. Il y a, dans cette dernière partie, quelques passages qui ont un rapport si étroit avec ce que nous avons écrit nous-même au sujet du “psychologisme” qu’il ne nous semble pas inutile de les citer un peu longuement : « La psychanalyse de Freud est la dernière chose qu’on devrait associer avec le Yoga ; elle prend une certaine partie, la plus obscure, la plus dangereuse et la plus malsaine de la nature, le subconscient vital inférieur, isole quelques-uns de ses phénomènes les plus morbides, et leur attribue une action hors de toute proportion avec leur véritable rôle dans la nature… Je trouve difficile de prendre ces psychanalystes au sérieux quand ils essaient d’examiner l’expérience spirituelle à la lueur vacillante de leurs flambeaux ; il le faudrait peut-être cependant, car une demi-connaissance peut être un grand obstacle à la manifestation de la vérité.
Cette nouvelle psychologie me fait penser à des enfants apprenant un alphabet sommaire et incomplet, confondant avec un air de triomphe leur “a b c” du subconscient et le mystérieux superconscient, et s’imaginant que leur premier livre d’obscurs rudiments est le cœur même de la connaissance réelle. Ils regardent de bas en haut et expliquent les lumières supérieures par les obscurités inférieures ; mais le fondement des choses est en haut et non en bas, dans le superconscient et non dans le subconscient… Il faut connaître le tout avant de pouvoir connaître la partie, et le supérieur avant de pouvoir vraiment comprendre l’inférieur. C’est la promesse d’une plus grande psychologie attendant son heure, et devant laquelle tous ces pauvres tâtonnements disparaîtront et seront réduits à néant ». On ne saurait être plus net, et nous voudrions bien savoir ce que peuvent en penser les partisans des fausses assimilations que nous avons dénoncées à diverses reprises.
• Shrî Aurobindo - Lumières sur le Yoga (Union des Imprimeries, Frameries, Belgique)
C’est la traduction française, qui vient de paraître, du premier des deux volumes dont nous avons parlé ci-dessus ; cette traduction, d’ailleurs approuvée par l’auteur, est très exacte dans son ensemble, et nous ne ferons de réserves que sur un point : le mot mind a été traduit le plus souvent par “esprit”, et quelquefois aussi par “intellect”, alors que ce n’est en réalité ni l’un ni l’autre, mais bien le “mental” (marias) ; on a du reste jugé utile, en quelques endroits, de l’indiquer en note ; n’eût-il pas été à la fois plus simple et plus satisfaisant de mettre le terme correct et exact dans le texte même ?— Janvier 1940
• Shrî Aurobindo - Les Bases du Yoga (précédé d’une étude de Nolini Kanta Gupta sur le Yoga de Shrî Aurobindo) (Union des Imprimeries, Frameries, Belgique)
Nous avons déjà parlé de l’édition anglaise de ce livre ; nous n’aurions donc qu’à signaler simplement la publication de cette traduction française, si on n’avait fait précéder celle-ci d’une introduction qui, il faut bien le dire, n’est pas sans appeler certaines réserves. D’abord, quand Shrî Aurobindo lui-même dit « notre Yoga », cela peut s’entendre, en un sens tout à fait légitime, du Yoga qu’il pratique et enseigne ; mais quand d’autres parlent du “Yoga de Shrî Aurobindo”, ils le font parfois d’une façon telle qu’ils semblent vouloir par là lui en attribuer la propriété, ou revendiquer pour lui une sorte de “droit d’auteur” sur une forme particulière de Yoga, ce qui est inadmissible, car nous sommes ici dans un domaine où les individualités ne comptent pas ; nous voulons d’ailleurs croire que Shrî Aurobindo lui-même n’y est pour rien, et qu’il ne faut voir là que la manifestation, de la part de certains de ses disciples, d’un zèle quelque peu indiscret et plutôt maladroit. Ce qui est peut-être plus grave au fond, c’est que l’introduction dont il s’agit est fortement affectée de conceptions “évolutionnistes” ; nous citerons seulement deux ou trois phrases caractéristiques à cet égard : « Jusqu’à présent, la mortalité a été le principe dirigeant de la vie sur la terre ; elle sera remplacée par la conscience de l’immortalité. L’évolution s’est réalisée par des luttes et des souffrances ; désormais, elle sera une floraison spontanée, harmonieuse et heureuse… L’homme est déjà vieux de plus d’un million ou deux d’années ; il est pleinement temps pour lui de se laisser transformer en un être d’ordre supérieur ». Comment de pareilles affirmations peuvent-elles se concilier avec la moindre notion de la doctrine traditionnelle des cycles, et plus particulièrement avec le fait que nous sommes présentement dans la plus sombre période du Kali-Yuga ?
• Shrî Aurobindo - La Synthèse des Yogas. Volume I : Le Yoga des Œuvres divines (Union des Imprimeries, Frameries, Belgique)
Cet ouvrage, qui parut en anglais dans la revue Arya, de 1914 à 1921, comprend quatre parties : 1° Le Yoga des Œuvres divines ; 2° Le Yoga de la Connaissance ; 3° Le Yoga de la Dévotion ; 4° Le Yoga de la Perfection ; le présent volume contient seulement la traduction des six premiers chapitres, revus et augmentés par l’auteur. Comme le titre et les sous-titres l’indiquent, il s’agit d’une vue d’ensemble dans laquelle les différentes formes du Yoga sont réunies ou combinées pour concourir à la perfection (siclclhï) du « Yoga intégral », dont elles ne sont en réalité qu’autant de branches ; la première partie est consacrée au Karma-Yoga. L’auteur, naturellement, y insiste principalement sur le détachement du fruit des œuvres, suivant la doctrine enseignée dans la Bhagavad-Gîtâ ; il présente surtout ce détachement comme « don de soi » et comme « sacrifice », et ce dernier mot est peut-être un peu équivoque, car, dans son sens propre, il implique essentiellement un élément rituel qui n’apparaît pas très clairement ici, malgré l’allusion qui est faite au « sacrifice du Purusha », envisagé comme la « divine action commune qui a été projetée dans ce monde à son commencement, comme un symbole de la solidarité de l’univers ».Du reste, d’une façon générale, tout ce qui se rapporte au côté proprement “technique” de la question est quelque peu laissé dans l’ombre ; il se peut que ce soit volontairement, mais cela n’en donne pas moins parfois une certaine impression de “vague” qui risque de déconcerter le lecteur ordinaire, nous voulons dire celui qui n’a pas les données nécessaires pour suppléer à ce qu’il y a là d’incomplet. D’autre part, il faut aussi se méfier de n’être pas induit en erreur par la terminologie adoptée, car certains mots sont pris en un sens fort éloigné de celui qu’ils ont habituellement ; nous pensons notamment, à cet égard, à l’expression d’« être psychique », dont l’auteur semble faire presque un synonyme de jîvâtmâ ; un tel emploi du mot “psychique” est non seulement inaccoutumé, mais encore nettement contraire à sa signification originelle, et nous ne voyons vraiment pas comment on pourrait le justifier. Tout cela, assurément, ne diminue en rien l’intérêt des considérations exposées dans ce livre, même s’il ne donne pas une vue complète du sujet, ce qui serait d’ailleurs sans doute impossible ; mais ces remarques montrent qu’il ne doit pas être lu sans quelque précaution.
• Shrî Aurobindo - L’lsha Upanishad (Union des Imprimeries, Frameries, Belgique)
Ce volume contient le texte sanscrit et la traduction de l'Isha Upanishad, suivis d’un commentaire ; il avait paru en partie dans l’édition française de la revue Arya, qui eut seulement quelques numéros, en 1914-1915 ; la traduction de l’original anglais, restée alors inachevée, a été terminée par M. Jean Herbert. L’auteur, au début de son commentaire, fait remarquer que « les Upanishads, étant destinées à illuminer plutôt qu’à instruire, sont composées pour des chercheurs déjà familiarisés, au moins dans l’ensemble, avec les idées des voyants védiques et vêdântiques, et possédant même quelque expérience personnelle des réalités auxquelles elles se réfèrent. Leurs auteurs se dispensent donc d’exprimer les transitions de pensée et de développer des notions implicites ou secondaires… Les conclusions seules s’expriment, et le raisonnement sur lequel elles reposent demeure sous-entendu ; les mots le suggèrent, mais ne le communiquent point ouvertement à l’esprit ». Cela est parfaitement exact, et nous pensons d’ailleurs qu’il y a, dans cette façon de procéder, quelque chose qui est inhérent à la nature même de l’enseignement traditionnel dont il s’agit ; Shrî Aurobindo estime cependant qu’« une telle méthode n’est plus applicable pour la pensée moderne ». Mais celle-ci mérite-t-elle qu’on lui fasse des concessions, alors que, en tant qu’elle est spécifiquement moderne, elle se montre trop manifestement incapable de recevoir et de comprendre un enseignement traditionnel quel qu’il soit ?On peut assurément chercher à rendre les idées plus explicites, ce qui est en somme le rôle et la raison d’être de tout commentaire ; mais il est vraiment bien dangereux de vouloir les “systématiser”, puisque précisément un des caractères essentiels des idées d’ordre métaphysique est de ne pouvoir se prêter à aucune “systématisation” ; et, au surplus, faut-il supposer un “raisonnement sous-entendu” dans un texte énonçant des vérités dont la source réelle est purement intuitive ? Ces observations portent surtout sur “l’arrangement” du commentaire dont il s’agit : sa division en différents “mouvements de pensée” (expression qui est d’ailleurs bien loin d’être claire) peut paraître assez artificielle, du moins à qui n’est pas exclusivement habitué à l’usage des formes particulières de la “pensée moderne”. Cependant, ces réserves faites, les divers paragraphes du commentaire, pris en eux-mêmes et indépendamment du cadre trop “rationnel” dans lequel on a voulu les insérer, n’en contiennent pas moins un grand nombre de vues fort intéressantes, et qu’on ne saurait lire et méditer sans profit, surtout si l’on possède déjà une certaine connaissance de la doctrine hindoue.
— Décembre 1948
• Shrî Aurobindo - L’Énigme de ce Monde (Adrien Maisonneuve, Paris)
Cette brochure est la traduction d’un article écrit en anglais en 1933, en réponse à une question assez « sentimentale » posée par Maurice Magre sur le pourquoi de la souffrance et du mal en ce monde. Il y est très justement répondu que toutes les possibilités doivent se réaliser, et que c’est la division et la séparation qui ont donné naissance au mal, en tant que ces possibilités sont envisagées isolément les unes des autres et de leur principe ; en somme, ce que nous considérons comme le mal, c’est-à-dire comme une négation, n’est tel qu’en conséquence de notre ignorance et de notre horizon limité. Ce qui est plus contestable, c’est que Shrî Aurobindo semble admettre, non pas seulement une évolution spirituelle pour chaque être, mais aussi une évolution au sens d’une “progression” du monde dans son ensemble ; c’est là une idée qui nous semble bien moderne, et nous ne voyons pas trop comment elle peut s’accorder avec les conditions mêmes du développement de toute manifestation.D’autre part, si nous comprenons bien ce qui n’est pas exprimé d’une façon très explicite, il paraît considérer la “réalisation ascendante” comme ne se suffisant pas à elle-même et comme devant être complétée par la “réalisation descendante” ; du moins certaines expressions permettent-elles d’interpréter ainsi sa pensée ; seulement, pourquoi opposer alors la libération telle qu’il l’entend à ce qu’il appelle une “évasion hors du monde” ? Tant que l’être demeure dans le Cosmos (et par là nous n’entendons pas seulement ce monde, mais la totalité de la manifestation), si élevés que soient les états qu’il peut atteindre, ce ne sont pourtant toujours que des états conditionnés, qui n’ont aucune commune mesure avec la véritable libération ; celle-ci ne peut être obtenue dans tous les cas que par la sortie du Cosmos, et ce n’est qu’ensuite que l’être pourra “redescendre”, en apparence du moins, sans plus être aucunement affecté par les conditions du monde manifesté. En d’autres termes, la “réalisation descendante”, bien loin de s’opposer à la “réalisation ascendante”, la présuppose au contraire nécessairement ; il aurait été utile de le préciser de façon à ne laisser place à aucune équivoque, mais nous voulons croire que c’est là ce que Shrî Aurobindo veut dire lorsqu’il parle d’« une ascension d’où l’on ne retombe plus, mais d’où l’on peut prendre son vol dans une descente ailée de lumière, de force et d’Ananda ».
• P. B. Saint-Hilaire et G. Monod-Herzen - Le Message de Shrî Aurobindo et son Ashram (Adrien-Maisonneuve, Paris)
Ce petit volume, fort bien édité, est divisé en deux parties, dont la première est une sorte de résumé des principaux enseignements de Shrî Aurobindo ; il semble qu’on se soit plu à y insister surtout sur leur « adaptation aux conditions du moment », adaptation qui nous paraît décidément aller parfois un peu trop loin dans le sens des concessions à la mentalité actuelle. La seconde partie est une description de l’Ashram de Pondichéry et de ses diverses activités ; cette description et surtout les photographies qui l’accompagnent donnent aussi une impression de “modernité” qui, il faut bien le dire, est quelque peu inquiétante ; on s’aperçoit à première vue que des Européens ont passé par là.
► René Guénon, Études Traditionnelles.• nota bene : Lumières sur le Yoga et Les Bases du Yoga ont été réunis par Albin Michel sous le titre Le Guide du yoga.

 Billet sur Herbert et Aurobindo
Billet sur Herbert et AurobindoDepuis longtemps le mysticisme hindou exerce chez nous une forte attraction. Beaucoup de chrétiens instruits qui sont intellectuellement détachés des dogmes traditionnels, mais qui ont été trop pénétrés par la foi ancestrale pour ne pas en garder un certain résidu, se rallient volontiers à cette religion sans Église importée d'un Orient mystérieux, qui se réclame d'une longue série de révélations sans en imposer aucune et qui fait appel au sentiment plutôt qu'à la raison. Dans le trouble social de l'après-guerre, ils trouvent là une sorte de havre, où ils peuvent échapper à la tourmente et suivre sans émoi le déchaînement des tempêtes. Ainsi s'expliquent l'abondance et le succès des publications destinées à la propagation de cette foi exotique.
Après Romain Rolland, qui leur fraya la voie, par son Mahatma Gandhi (1924), son Essai sur la mystique et l'action de l'Inde vivante (1929), la Vie de Ramakrishna (1930), La vie de Vivekânanda et l’Évangile universel (1930), un autre Français, Jean Herbert, qui a fait de longs séjours dans l'Inde et qui s'en est assimilé la spiritualité, s'applique inlassablement à en assurer la diffusion. Nombreuses sont les traductions de livres sapientiaux effectuées ou inspirées par lui. Telle est celle de l'Enseignement de Ramakrishna, comme celle des Conférences de Vivekânanda sur le Bhakti-Yoga et le Inana-Yoga. À cela s'ajoutent des travaux personnels où les doctrines orientales s'adaptent à l'esprit de l'Occident : La notion de la vie future dans l'Hindouisme, Introduction à l'étude des Yogas hindous, Quelques grands penseurs de l'Inde moderne, Quelques tendances de la philosophie hindoue moderne, Études et Portraits, Védantisme et vie pratique, Comment se préparer à la méditation ?
Un nouvel ouvrage qui vient de paraître sous le titre de Spiritualité hindoue s'applique à nous présenter l'Hindouisme d'après les explications de ses principaux docteurs et à le mettre ainsi à la portée de tous. Après une Introduction générale qui en délimite le cadre, Jean Herbert étudie tour a tour les “théories”, la “vie matérielle, intellectuelle et artistique”, la “vie morale et sociale”, la conception de “Dieu”, la “religion”, la “vie spirituelle”. L'exposé abonde en renseignements variés. Il se concentre autour d'un thème unique, qu'on peut formuler ainsi : tout vient de l'un, de “Brahman”, et tout doit revenir à lui, en se libérant des obstacles qui l'en écartent. C'est ce principe qui fait l'unité de l'Inde à travers sa multiplicité apparente dans le temps et dans l'espace. M. Herbert n'admet pas d'évolution du “Védisme” au “Brahmanisme” et ensuite à “l'Hindouisme”. Pour lui, cette thèse, devenue classique en Occident, est arbitraire. La pensée de l'Inde n'a pas varié en substance au cours des âges. Elle n'offre pas plus de divergence d'une région à l'autre de ce vaste pays. Pour mieux dire, elle résume toutes les expériences passées de l'humanité et elle est en mesure de satisfaire toutes ses aspirations, en Occident comme en Orient.
Vraiment, dans cette réduction du multiple à l'un, M. Herbert exagère et la vision qu'il nous présente est bien schématique et outrancière. Il n'a perçu la spiritualité hindoue qu'à un moment tardif de sa durée et dans une portion réduite de son domaine. Il l'a observée surtout dans notre colonie, déjà francisée, de Pondichéry, à travers la personne de Sri Aurobindo, qui la représente sans doute avec beaucoup de distinction, mais qui a subi dans une large mesure l'influence de l'Occident. Gardons-nous de considérer ce mysticisme de forme récente, à demi exotique, comme celui de l'Inde antique qui se serait maintenu intact, à travers les siècles, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Défions-nous surtout de la propagande qui est faite pour répandre chez nous la spiritualité de l'Inde comme un modèle d'humanisme. M. Herbert lui-même constate (p. 35) que seul est “hindou orthodoxe” celui qui “se soumet au système des castes”. Cela revient à dire que l'hindouisme est la forme mystique d'un système social où le clergé “brahmana”, la noblesse “kshatriya” et la bourgeoisie “vaishya” forment un monde clos bien supérieur à celui des “shûdras” ou artisans et surtout à celui des “parias”, gens de rebut dont tout homme bien né doit éviter le contact. Le caractère aristocratique de l'hindouisme assure son succès auprès des gens sélects qui tiennent à se distinguer de la masse et à maintenir les barrières traditionnelles. Il dressera contre lui le bloc, toujours plus puissant, des travailleurs qui se soucient fort peu des rapports de l'un et du multiple, mais qui se passionnent pour la révolution sociale destinée à leur assurer un avenir meilleur.
Sri Aurobindo, né en 1872 à Calcutta, de père et mère bengalis, s'est formé de 1879 à 1893 en Angleterre, a occupé ensuite dans l'Inde divers emplois administratifs jusqu'au jour où, s'étant placé en tête du mouvement nationaliste, il a été poursuivi, arrêté, incarcéré. Il s'est finalement retiré dans l'Inde française, à Pondichéry, où il a résidé depuis lors. Il s'y est consacré à l'étude des Sages de l'Inde, avec d'anciens compagnons de lutte, auxquels se sont bientôt adjoints des disciples en nombre grandissant. Ainsi s'est formée autour de lui une communauté mystique, un “Ashram”, dont il a été d'abord le père spirituel et dont il a plus tard confié la direction à une collaboratrice française devenue “la Mère”, pour se consacrer exclusivement à son œuvre doctrinale.
Dans une première partie d'une brochure qui lui est consacrée, un ancien polytechnicien, Philippe Barbier-Saint-Hilaire, expose à grands traits son “Message”. On y voit l'Un originel s'épanouissant dans l'univers par étages superposés, le physique, le vital, le mental et le supramental ou spirituel. Dans ce dernier se forme un véritable surhomme par une pénétration intime du Divin. L'on y accède par trois stades graduels, dont chacun prépare le suivant. Dans une seconde partie, M. Gabriel Monod-Herzen nous décrit l'Ashram de Pondichéry. Curieux petit monde, très différent des anciens monastères. Ceux-ci s'appliquaient à freiner les tendances naturelles. La nouvelle mystique, au contraire, tend à les développer en une sorte de transsubstantiation. La culture physique y alterne avec l'étude et les travaux manuels, en un magnifique immeuble dû à la générosité d'un donateur. Aucune règle stricte, mais une soumission filiale à l'autorité providentielle de la “Mère”. C'est le triomphe du paternalisme, mué ici en “maternalisme”. C'est dans les ateliers de l'Ashram qu'a été imprimée la brochure qui lui est consacrée.
De là nous vient aussi la traduction française d'une brève dissertation, de Sri Aurobindo, écrite en 1932, sur L'Énigme de ce monde. C'est une réponse à une objection, de Maurice Magre opposant aux mystiques l'existence du mal. C'est aussi pour réfuter une critique analogue de Bayle que Leibnitz a écrit sa Théodicée. Le rapprochement n'est pas fortuit. Si l'on suit avec attention l'exposé ondoyant et un peu vaporeux du Maître hindou, l'on s'aperçoit qu'il ne fait que reprendre et transposer à sa manière sur le plan de sa propre dialectique l'argumentation de son devancier germanique.
La doctrine personnelle de Sri Aurobindo s'affirme plus nettement dans une étude volumineuse de la Bhagavad Gitâ, dont une rédaction, faite par un de ses disciples pour les lecteurs occidentaux, a paru d'abord en anglais, puis dans une traduction française de Camille Rao et Jean Herbert. Qu'on ne cherche pas là une nouvelle interprétation du sens originel de ce texte archaïque, aussi obscur que renommé. Sri Aurobindo déclare une telle tentative à peu près irréalisable et d'ailleurs assez vaine. À travers la forme de l'écriture, valable seulement pour une époque et un pays, c'est la vérité ainsi exprimée, “applicable à tous les pays et à toutes les époques”, qu'il veut atteindre. Son commentaire est à la Bhagavad Gitâ ce qu'est au Cantique des Cantiques celui de Saint Bernard. Il vaut comme pensée vivante plutôt qu'à titre d'exégèse, et cette pensée tend à une “harmonisation nouvelle et compréhensive” des textes sacrés avec les révélations puissantes quoique limitées dont le terme final est l'union avec “l'Esprit suprême et universel”. On éprouve du regret à voir se diluer ainsi dans un rêve mystique une belle et noble intelligence, qui, sur le plan des réalités matérielles, eût pu servir utilement la cause du progrès véritable.
► Prosper Alfaric, La Pensée (revue du rationalisme moderne) n°26, 1949. [version pdf]
***
Jean Herbert (1897-1980) est né à Paris dans une famille de confession protestante par son père, professeur d’anglais à l’École des sciences politiques, et catholique par sa mère. Licencié d’anglais, il a fait une carrière d’interprète international, notamment auprès de la Société des Nations. Ayant « toujours été assez préoccupé de questions spirituelles », Herbert a « cherché longtemps dans le cadre du Christianisme » en particulier dans le mouvement de la science chrétienne (Christian Science), une réponse à ses questions, avant de découvrir l’islam à l’occasion d’un voyage en Turquie en 1925. Cette « première découverte d’un pays en dehors de la Chrétienté a été (…) une véritable révélation ». Puis, au milieu des années 1930, il rencontre des disciples de Ramakrishna, lit les essais de Vivekananda et, de passage à Pondichéry, il fait la connaissance personnelle d’Aurobindo qui lui demande « de traduire tous ses ouvrages en français et de les faire traduire en d’autres langues ». Sa première traduction d’un ouvrage de Vivekananda, « qu’aucun éditeur ne voulait publier car personne ne s’intéressait à des gens "aux noms impossibles à prononcer” », a été financée par Joséphine McLeod, une disciple de Vivekananda et proche de Romain Rolland à qui elle présenta Jean Herbert. Celui-ci, sur les encouragements de Rolland, décide alors de poursuivre le travail de vulgarisation des courants néo-hindous, déclarant : « L’hindouisme m’a accroché par sa catholicité absolue ». Mais dépourvu, comme Romain Rolland, de compétences indianistes érudites, il dit de son travail : « Au début, je me suis heurté à une opposition considérable de ceux qui étaient les meilleurs orientalistes qui n’aimaient pas qu’on aille voir les grands représentants de la religion hindoue, ou bouddhique, ou musulmane pour leur demander à eux ce que cette religion était pour eux-mêmes. D’ailleurs, lorsque j’ai publié les commentaires de Shrî Aurobindo sur un des textes sacrés de l’Inde, j’ai envoyé un exemplaire de ma traduction à un célèbre professeur du Collège de France [Sylvain Lévi]. Il m’a répondu aimablement en ajoutant pourtant : "Je ne comprends pas l’intérêt que vous portez à ce commentateur indigène” » [entretien, mars 1974].
► Roland Lardinois, L'invention de l'Inde : entre ésotérisme et science, 2007.
***♦ Pour prolonger :
• On pourra trouver quelques remarques biographiques sur Jean Herbert dans la thèse de Guex Fanny : Passeurs entre l'Inde et la Suisse romande (2018).• Entretien avec Jean Herbert (Bruno Sourdin, novembre 1979)

 Évolution créatrice chez Aurobindo
Évolution créatrice chez AurobindoL’œuvre monumentale de Shrî Aurobindo trouve son équilibre entre l’exposé doctrinal et la description de pratiques yoguiques. La doctrine se fonde sur les données de la métaphysique hindoue, principalement celle des Vêda et des Upanishad, traduites dans un langage adapté à l’homme moderne et auxquelles vient s’ajouter l’éclairage de la science occidentale. Elle prend d’abord en considération les trois plans de la Réalité, le Divin, l’Univers et l’Homme.
Le Divin — Brahman — est le Principe suprême, l’Absolu transcendant, indifférencié et impersonnel. Vérité totale intégrant toutes les vérités partielles, il est, par-delà l’Un et le Multiple, le Purushottama [Âme suprême de l'univers]. Mais il peut se manifester en tant que Dieu personnel susceptible de s’incarner dans les Avatâra, ou Descentes divines. Il est aussi l’âtmâ, le principe spirituel, caché au cœur de l’être humain.
L’Univers, ou Macrocosme, assure le passage du Brahman au plan phénoménal. Ce déploiement s’opère sur sept plans.
Les trois plans supérieurs — Sat-Chit-Ananda (Être-Conscience-Béatitude) —, en lesquels n’est encore nulle distinction séparatrice, constituent un Principe supracosmique, unitaire, immuable. Sat est l’essence de l’Être infini et indivisible, Chit, l’Énergie illimitée de la Conscience divine, Ânanda, la Félicité de la pure existence, composée d’Amour, de Beauté et de Joie. Sat-Chit-Ananda est porté par la Mère cosmique, l’éternelle Shakti, qui se tient au-dessus des mondes et se manifeste en eux à travers toutes sortes d’émanations, de pouvoirs et de signes que l’on nomme les “dieux”.
Les trois plans inférieurs, d’ordre mental, vital et matériel, qui s’interpénètrent, sont animés par le jeu des guna, ou “tendances” — ascendante (de nature lumineuse) : sattwa ; expansive (de nature cinétique) : rajas ; descendante (de nature obscure) : tamas. La Matière — Conscience-Énergie condensée — est le degré le plus bas de la Manifestation, faite de densifications graduées. Le niveau matériel correspond à une descente de Sat, comme le niveau vital, à une descente de Chit, la Force universelle qui érige les formes (Brahma) les maintient (Vishnou), les détruit pour les reconstruire (Shiva). Cette force dynamisante se manifeste dans la Vie en tant que “jeu” cosmique (lîlâ), échange d’actions et de réactions. La mort elle même en fait partie, qui est désintégration de la substance en vue de son renouvellement. Le niveau mental correspond à une descente de la “Conscience cosmique” — ou “Mental universel” —, l’Esprit qui est à l’origine d’une Loi éternelle, et convertit l’Un en multiple sans nuire en rien à sa propre unité. Le Surmental dépasse les divergences inconciliables du mental et les envisage intrinsèquement comme corrélatives et complémentaires. Tout en s’appuyant sur le multiple, le Surmental reste directement relié au Supramental.
Entre les plans supérieurs et les plans inférieurs, le Supramental est le point de jonction de l’Un et du multiple. “Principe de Volonté et de Connaissance”, il exclut toute division et transcende toute dualité, crée et soutient les mondes. Il est la “Vérité Conscience”, qui maintient l’unité dans l’extrême diversité, la stabilité dans l’extrême muabilité, insiste sur l’harmonie dans cette apparence de lutte et de conflit qui pénètre tout.
L’Homme, ou Microcosme, est le reflet le plus direct et le plus complet du suprême Brahman et de l’Univers.
En Sat-Chit-Ananda, l’homme (âtmâ) n’est pas encore dissocié de l’Absolu (Brahman). Mais il apparaît corps physique au niveau matériel, jeu d’énergies au niveau vital, où s’expriment la pensée et la parole, les sentiments, les aspirations et les réactions, les besoins et les désirs ; au niveau mental, instrument de réflexion et d’imagination, et, à un plus haut degré, lieu de prémonitions, réminiscences, illuminations pouvant déboucher sur des visions supramentales. À ces différents éléments s’ajoute le niveau psychique, domaine de “l’âme” individuelle, jivâtmâ, — l’élément immortel, qui transmigre dans des corps différents.
Telle se présente l’anatomie spirituelle de l’être humain, qui fait que nous ne sommes pas seulement ce que nous connaissons de nous-mêmes, mais infiniment plus, que nous ne connaissons pas. Descendus dans les plans inférieurs, les plans supérieurs s’y trouvent involués, mais susceptibles d’y être éveillés. De même que la matière est sortie de la vie, et le mental, de la matière, il est, de même, possible de faire sortir du mental le supramental. Tel est le but du Yoga intégral de Shrî Aurobindo, synthèse des différents yoga.
Le Yoga des Œuvres (karma) fait accomplir l’action comme un sacrifice offert au Seigneur suprême. L’ego agissant s’efface devant le Divin et n’attend nul profit personnel d’une action totalement désintéressée. À travers nous, c’est le Divin qui agit ; peu à peu se réalise l’union par identité.
Le Yoga de la Connaissance (jñâna) a pour but l’accession à la Vérité par le rejet du mental discursif, la pratique de la concentration et du silence dans la méditation, le complet renoncement à tout ce qui est autre que la réalisation divine. Il conduit à la désidentification d’avec les éléments du moi par l’esprit de discernement.
Le Yoga de la Dévotion (bhakti) est l’amour envers le Divin pris dans son aspect personnel ; amour inconditionnel, fait d’abandon et de don de soi, ayant pour instrument privilégié l’invocation d’un Nom divin (japa-yoga). Le Divin est ici perçu comme l’Enfant, l’Ami, l’Amant, et l’univers, comme l’expression de son Jeu et de sa Joie.
Le Yoga de la Perfection de soi (raja) consiste dans la spiritualisation de l’être psychique, vital et mental, dans la maîtrise de soi dépassant attractions et répulsions, dans l’impassible contemplation de la lutte des opposés, dans la parfaite égalité d’âme devant les événements et les créatures, dans le détachement, enfin, et le renoncement, y compris celui de la Libération elle-même.
Le Yoga intégral s’accompagne d’un certain nombre d’obligations : une aspiration sans réserve au spirituel, l’absence de tout découragement — “le difficile n’est pas l’impossible”, la sincérité dans l’effort, la chasteté, et l’exercice des vertus inhérentes à toute vie intérieure véritable.
Il constitue pour Shrî Aurobindo le seul moyen susceptible de préparer une nouvelle humanité. Après le constat d’échec des solutions politiques, sociales, philosophiques, religieuses — le “fiasco des religions prêchant fanatisme et mortifications” — et celui de la civilisation qui a créé beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en peut résoudre, le seul moyen consiste en un changement de conscience, premier échelon d’une mutation radicale. Car l’homme atteindra une humanité supérieure, “supramentale”, ou connaîtra un lent suicide. Et, ajoute Shrî Aurobindo, “si ce n’est pas là le chemin, alors, il n’y a pas de chemin pour l’espèce humaine”.
Dans cette vision évolutionniste, l’homme, tel qu’il se présente actuellement, n’est qu’un être transitoire, dont “toute la nature consiste à devenir plus que lui-même”. Mais il porte en lui les potentialités, non encore utilisées, pour accéder à un autre état, celui de “l’être gnostique”, capable d’instaurer “l’Âge subjectif”, transformant l’humanité, mais aussi, l’ensemble du milieu où il vit en faisant descendre de la Conscience dans la Matière-Énergie. Il s’agit pour ce faire de transformer la substance corporelle en transformant chaque cellule. L’être gnostique sera spiritualisé jusque dans son tissu cellulaire ; affranchi de toute limite, ignorance et servitude. Ses centres de conscience subtils remplaceront les organes en irradiant leurs énergies. Ainsi, la crise contemporaine, si elle marque la fin d’un cycle — le Kali-yuga —, ouvre en même temps “une perspective immense de développement et de surpassement”, et conduit à l’avènement d’un Âge spirituel, ou Satya-yuga, sur terre. Le mal n’est rien d’autre que le bien qui se désintègre pour préparer un bien supérieur.
Pour Shrî Aurobindo, l’avènement du Supramental ne surviendrait pas avant plusieurs siècles. Il a même spécifié que l’humanité nouvelle pourrait ne jamais apparaître. Si l’homme n’accomplissait pas le travail, la Grande Nature susciterait une autre espèce qui le supplanterait, comme l’homme a supplanté l’anthropoïde. Le Surhomme aurobindien a été hâtivement rapproché de celui de Nietzsche. Mais il ne s’exalte nullement dans la volonté de puissance, dominatrice, destructrice de Dieu, ni dans l’instauration d’une religion idolâtrique de l’Homme. Il s’agit bien de laisser au Divin sa pleine liberté d’action et d’expression en l’homme. De même l’évolutionnisme du sage hindou a été comparé à celui de Teilhard de Chardin. Celui-ci croit en la technique de l’Occident et a une vision collective. Il ne propose pas de “yoga” spécifique, ni de méthode d’exploration intérieure ; il n’envisage pas de rencontre possible entre l’homme et Dieu sur cette terre. Il est juste de dire qu’“un monde les sépare”.
En dépit d’un style que certains considèrent comme vague, délayé ou trop olympien, et quoique considéré comme hétérodoxe par beaucoup d’hindous, le maître de Pondichéry est en droit d’apparaître comme l’un des esprits les plus déterminants de l’Inde moderne, et comme un exemple idéal de réconciliation entre l’Orient et l’Occident, le passé primordial et le futur lointain. Par cela même, il apparaît comme destiné à rapprocher les opposés, à concilier rationalité et mysticité, science et sagesse, immanence et transcendance, à rappeler que “le ciel n’annule pas la terre, il l’accomplit”. Le Vaste, le Profond, le Grandiose, le Sublime ne sont pas les contrées qui lui sont les moins familières. D’aucuns ont voulu voir en ce poète védique du XXe siècle le héraut du prochain cycle.
► Jean Biès, Les Grands Initiés du XXe siècle, 1998.
***
♦ Pour prolonger :
• L'Homme après l'Homme (D. Montemurri, documentaire, 1981) : « On n’est pas dans une crise morale, on n’est pas dans une crise politique, financière, religieuse, on est dans une crise évolutive. On est en train de mourir à l’humanité pour naître à autre chose… » C’est ainsi que Satprem répond à David Montemurri qui lui pose, au cours de cette interview, un certain nombre de questions concernant la crise de civilisation que nous traversons actuellement et l’avenir du monde moderne. Si ce film, tourné il y a presque 40 ans, se réfère à des événements politiques et sociaux qui sont de ce fait un peu dépassés, les réponses de Satprem, elles, demeurent d’une actualité brûlante : Après cet homme douloureux et insensé que nous sommes et qui semble courir à sa perte, y aura-t-il autre chose, ou bien faut-il nous résigner à la catastrophe et à la disparition de l’espèce humaine ? C’est la Question que pose ce documentaire accessible à tous les publics : que sera l’Homme après l’homme ?• La pensée de Sri Aurobindo, Jean-Pierre Béchu, Entremises, 2022.
• Le Nouvel Homme selon Sri Aurobindo et Krishnamurti, Dominique Schmidt, 2009, 2e éd. 2018.
• Ramana Maharshi talks about Aurobindo [trad. fr. in Cahiers de l'Unité n°24, 2021]

La mentalité européenne normale se distingue par deux traits spécifiques — il est certes des exceptions, de grandes âmes et de grands penseurs, ou des moments de l’histoire, voire des époques entières, où se manifeste une ferveur religieuse “anormale“, mais il nous faut ici considérer la tendance dominante. Ces deux caractères spécifiques sont d’une part le culte de la raison pratique, efficace, qui investigue et définit, et, d’autre part, le culte de la vie. Les plus hautes marées de la civilisation européenne — la culture grecque, le monde romain d’avant Constantin, la Renaissance, l’âge moderne avec ses deux idoles colossales : l’Industrialisation et la Science physique — ont été portées par le flux de cette double énergie. Et chaque fois que ces pouvoirs ont reflué, le mental européen est entré dans une grande confusion, une profonde obscurité, et il s’est considérablement affaibli. Le christianisme n’a pas réussi à spiritualiser l’Europe, même s’il a contribué à l’humaniser sous certains aspects éthiques, parce qu’il allait à l’encontre de deux instincts fondamentaux : il niait la suprématie de la raison et jetait son anathème sur tout ce qui concourait à la plénitude heureuse ou dynamique de la vie.
En Asie, par contre, jamais la raison ni le culte de la vie n’ont joui d’une telle prédominance, et jamais non plus ces deux pouvoirs n’ont été jugés incompatibles avec l’esprit religieux. Les plus grandes époques qu’ait connues l’Orient, les plus puissants accomplissements de sa civilisation et de sa culture — en Inde, la sublime naissance de l’âge védique, le grand frémissement spirituel des Upanishads, l’immense fleuve du bouddhisme, du Védânta, du Sânkhya, les religions purâniques et tantriques, l’épanouissement du vishnouïsme et du shivaïsme dans les royaumes du Sud — sont venus eux aussi portés par les flots d’une puissante lumière spirituelle, par l’ascension massive ou intense du mental religieux ou philosophique vers ses propres cimes, vers ses plus nobles réalités, ses plus amples richesses de vision et d’expérience. C’est à de telles époques que l’intellect, la pensée, la poésie, les arts, la vie matérielle ont brillé de toute leur splendeur. Et les reflux de la spiritualité n’ont jamais manqué d’affaiblir ces autres pouvoirs, et furent suivis par une période de fossilisation ou en tout cas de dépression de la force de vie, par de profondes marques de déclin, et même par un début de décadence. C’est là un point qu’il ne faut pas oublier si nous voulons comprendre dans ses grandes lignes la différence entre l’Orient et l’Occident.
L’homme, s’il ne veut pas manquer la courbe puissante de son ascension, doit au moins tendre vers l’esprit, à défaut de gravir jusqu’à ses plus hauts sommets. Cependant, il y a différentes voies d’approche pour qui veut découvrir ces forces secrètes de l’esprit. L’Europe semble appelée à suivre le chemin de la vie et de la raison et, par leur aide, à trouver la vérité spirituelle finalement révélée, qui en est le couronnement ; elle ne peut d’emblée, et de force, s’emparer du Royaume des cieux, comme une parole du Christ y exhorte les hommes. Une telle tentative trouble et obscurcit sa raison ; combattue par son instinct de vie, elle mène à la révolte, au reniement, à un retour à sa loi naturelle. L’Asie, en revanche, ou en tout cas l’Inde, vit naturellement par l’énergie spirituelle qui se déverse des plans supérieurs et qui seule rend possible l’évocation spirituelle des pouvoirs plus élevés de son mental et de sa vie. Ces deux continents représentent les deux faces de l’orbe intégrale de l’humanité, et jusqu’à ce qu’elles se rapprochent et se fondent, chacune doit aspirer au progrès ou à l’accomplissement le plus haut que l’esprit recherche à travers elle, en suivant la loi de son être, son propre Dharma.
Si le monde n’avait eu qu’un unique visage, il eût été appauvri par cette uniformité, et par la monotonie d’une seule culture ; il est nécessaire que notre marche suive des routes divergentes, jusqu’à ce que nous puissions lever la tête vers cette infinité de l’esprit où se trouve une lumière assez vaste pour tout embrasser et tout harmoniser, englober tous les plus hauts modes de pensée, de sentir et de vivre. C’est là une vérité qu’ignorent aussi bien les Indiens qui s’en prennent violemment à l’Europe matérialiste, que les ennemis pleins de mépris ou les froids contempteurs de la culture asiatique ou indienne — sur ce point au moins, ils sont d’accord. En fait, il ne s’agit pas réellement d’un conflit entre barbarie et civilisation, car l’humanité entière n’est qu’une masse de barbarie qui fait effort pour se civiliser. Et nous n’avons encore mis en lumière qu’une seule des différences dynamiques nécessaires à la plénitude de la culture humaine, dont la sphère ne cesse de s’élargir.
Pour l’heure, cette divergence engendre malheureusement une guerre constante entre des points de vue opposés, sur la religion et sur presque toutes les autres questions — opposition qui est à l’origine de cette incapacité plus ou moins grande de se comprendre, et suscite même parfois une véritable inimitié ou une antipathie viscérale. Le mental de l’Occident met l’accent sur la vie, surtout sur la vie extérieure, sur les choses que l’on peut saisir concrètement, sur tout ce qui est visible et tangible. La vie intérieure n’est tenue que pour le reflet intellectuel du monde extérieur, tandis que la raison modèle puissamment les choses, fait office de critique perspicace, de constructeur, affinant les matériaux extérieurs que lui fournit la Nature. La vie est faite pour un usage immédiat — il faut la vivre ici et maintenant, entièrement, et ne vivre que pour elle : telle est la préoccupation majeure de l’Européen. Celui-ci s’intéresse presque exclusivement à la vie présente de l’individu, au maintien de l’existence physique et au développement du mental et de la connaissance de l’humanité. L’Occidental peut même demander à la religion de subordonner son but ou sa pratique à cette fonction utilitaire et immédiate dans le monde sensible. Les Grecs et les Romains considéraient le culte religieux comme une garantie de la survie de la « polis », ou comme une force assurant le juste maintien et la stabilité de l’État. Le Moyen Âge, à l’époque où l’idéal chrétien atteignit son apogée, fut un interrègne ; durant cette période, le mental occidental essaya d’assimiler, en son cœur et son intelligence, un idéal oriental, mais jamais il ne parvint à le vivre vraiment, et il dut en fin de compte le rejeter, ou ne lui rendit plus hommage que du bout des lèvres.
L’âge présent est aussi, pour l’Asie, un interrègne ; elle s’efforce d’assimiler, dans son intellect comme dans sa vie — bien que son âme et sa nature se révoltent —, le point de vue occidental et son idéal bien terrestre. Et l’on peut prédire sans crainte de se tromper que l’Asie, elle non plus, ne réussira pas à vivre vraiment ou pour longtemps selon cette loi étrangère. En Europe, même le pur idéal chrétien, introspectif et radicalement extra-mondain, dut faire des compromis et se plier aux exigences du tempérament occidental ; ce faisant, il perdit son propre royaume intérieur, et le vrai tempérament occidental finit par l’emporter, rationalisant, laïcisant et anéantissant presque l’esprit religieux. La religion devint une ombre de plus en plus pâle et évanescente, rejetée dans un petit coin de la vie, et dans un coin plus exigu encore de la nature, attendant la sentence de mort ou d’exil, tandis qu’hors des murs de l’Église vaincue les glorieux et laïques cortèges de la vie extérieure, de la raison positive et de la science matérialiste marchaient en grande pompe vers la victoire.
► Aurobindo Ghose, Les fondements de la culture indienne [partie II, ch. 4], 1918-1921.

Une société fondée sur la spiritualité différera sur deux points essentiels de la société humaine normale, qui commence et finit avec la nature inférieure de l’homme. La société humaine normale a pour point de départ la diversité des intérêts et leur antagonisme, le heurt des égoïsmes, le conflit des idées, des tendances et des principes ; elle s’efforce en premier lieu de concilier, tant bien que mal, les intérêts, et d’apaiser nos discordes par un traité de paix qui repose sur une série de contrats ; à ces contrats elle donne le nom de loi sociale. En développant — au préjudice des intérêts qui sont sources de conflits — les intérêts qui nécessitent l’association et l’assistance mutuelle, elle fait naître des sympathies et des habitudes d’entr’aide qui donnent à son mécanisme de lois et de contrats un soutien et une sanction psychologiques. Elle justifie la masse des institutions sociales et des coutumes qu’elle crée ainsi par la plus grande satisfaction et la plus grande efficience qui en résultent, qui en sont l’aboutissement dans la vie physique, vitale et mentale de l’homme, en un mot par le développement de la civilisation et ses avantages. Il est vrai que ces profits nous coûtent aussi bien des pertes, mais celles-ci doivent être acceptées comme le prix que nous payons pour la civilisation.
La société normale traite l’homme essentiellement comme un être physique, vital et mental ; la vie, le mental et le corps sont en effet les trois termes d’existence pour lesquels elle a quelque compétence. Elle développe un système de croissance et d’efficience mentales, une culture intellectuelle, esthétique et morale. Elle met en relief le côté vital de l’existence humaine et crée un appareil toujours croissant d’efficience économique et de jouissances vitales, appareil qui devient à la fois de plus en plus riche, encombrant et complexe, au fur et à mesure que la civilisation s’élève. Puisque, par son excès de croissance mentale et vitale, elle affecte la vigueur naturelle de l’homme physique et animal, elle essaie de compenser ce déséquilibre par des systèmes de culture physique, par une science compliquée d’habitudes et de remèdes pour guérir les maux qu’elle a créés, et aussi par la plus grande amélioration qu’elle puisse apporter aux formes artificielles que revêt nécessairement la vie dans son système social. À la fin, cependant, l’expérience prouve que la société tend à mourir de son propre développement, signe certain qu’il existe dans son système quelque vice fondamental, que son idée de l’homme et sa méthode de développement ne correspondent pas à la réalité de l’être humain et au but de vie qu’impose cette réalité.
Le processus de vie d’une société humaine normale conduit à un épuisement de sa vitalité et à un refus de la Nature, qui ne veut plus continuer de soutenir une telle progression. Lorsque, pour son plus grand profit, cette société a troublé l’équilibre du système humain, son mental découvre finalement qu’elle a épuisé et détruit ce qui la nourrissait et qu’elle perd son pouvoir d’agir et de produire sainement. On s’aperçoit que la civilisation a créé beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en peut résoudre, a multiplié des besoins qu’elle n’a pas assez de force vitale pour satisfaire, a fait jaillir toute une jungle de revendications et d’instincts artificiels au milieu desquels la vie s’égare et perd de vue le but qui est le sien.
Les esprits les plus avancés commencent à proclamer que la civilisation a échoué, et la société commence à sentir qu’ils ont raison, Mais le remède proposé est, soit une halte, ou même une régression, ce qui amène finalement plus de confusion, la stagnation et la décadence, — soit un retour à la “nature”, ce qui est impossible sans un cataclysme et une désintégration de la société, — soit même une tentative de cure par remèdes artificiels portés à leur intensité maximum, par exemple la science et l’organisation scientifique de la vie, ce qui signifie que le moteur remplacerait la vie, que la raison arbitraire logique se substituerait à la nature complexe et que l’homme serait sauvé par la machine.
On peut émettre l’opinion que le défaut radical de tous nos systèmes est qu’ils développent insuffisamment cela même que la société a le plus négligé dans l’homme : l’élément spirituel, l’âme, qui est l’être véritable. Même un corps sain, une forte vitalité, un esprit actif et clair, et un champ pour les exercer et en jouir, ne font pas faire à l’homme plus qu’un certain parcours ; après quoi il ralentit et se fatigue, faute d’une véritable découverte de soi-même, faute d’un but satisfaisant pour son action et sa progression. Ces trois éléments réunis ne forment pas la totalité d’un homme complet ; ils sont des moyens pour parvenir à un but ultérieur et ne peuvent pas toujours être traités comme des buts en soi. Si l’on y ajoute une riche vie émotive dirigée par un système éthique bien ordonné, on sent qu’il manque encore quelque chose : un bien suprême que ces choses représentent, mais auquel elles ne parviennent pas en elles-mêmes, qu’elles ne découvrent pas avant de se dépasser elles-mêmes. Que l’on y ajoute encore un système religieux et un esprit étendu de foi et de piété et l’on n’aura toujours pas trouvé les moyens du salut social. Toutes ces choses, la société humaine les a développées, mais aucune ne l’a sauvée de la désillusion, de la lassitude et de la décadence. Les anciennes cultures intellectuelles de l’Europe se sont éteintes dans le doute destructeur et l’impuissance sceptique, les piétés de l’Asie dans la stagnation et le déclin. La société moderne a découvert un nouveau principe de survivance, le progrès, mais ce qu’elle n’a jamais découvert, c’est le but de ce progrès, à moins que ce ne soit plus de connaissance, plus d’outillage, plus de jouissance, une complexité plus grande et toujours plus grande de l’économie sociale. Mais tout cela conduira forcément, pour finir, où conduisait l’ancien système, car ce n’est que la même chose sur une plus grande échelle ; ces systèmes nous font tourner en rond, c’est-à-dire ne nous conduisent nulle part, ils ne rompent pas le cercle de la naissance, de la croissance, de la décrépitude et de la mort ; ils ne trouvent pas véritablement le secret de la prolongation de soi par un constant renouvellement de soi, qui est le principe de l’immortalité ; s’ils semblent un instant le trouver, c’est par le leurre d’une série d’expériences dont chacune se termine par une déception. Telle a été jusqu’ici la nature du progrès moderne. On ne voit luire un meilleur espoir que dans sa nouvelle orientation vers l’intérieur, vers une plus grande subjectivité, car par cette orientation nouvelle — qui ne fait que commencer — on pourra découvrir que la vérité réelle de l’homme se trouve en son âme.
On dira que c’est là une découverte déjà ancienne qui, sous le nom de religion, régissait déjà la société de jadis. Mais ce n’est là qu’une apparence. La découverte avait bien été faite, mais uniquement pour la vie de l’individu, et même dans ces limites, elle n’attendait sa réalisation que dans l’au-delà, ne voyait dans la terre qu’un lieu où l’individu prépare son salut solitaire. La société humaine elle-même ne s’est jamais emparée de la découverte de l’âme conçue comme loi de son être ou moyen de perfection sur terre. Si nous considérons les anciennes religions sous l’aspect de la société et non de l’individu, nous voyons que la société utilisa seulement leurs parties les plus “a-spirituelles”, ou en tous cas les moins spirituelles. Elle les employa pour conférer une sanction auguste, terrible et réputée éternelle à la masse de ses coutumes et de ses institutions ; elle les tendit comme un voile de mystère devant les questions de l’homme, comme un bouclier de ténèbres devant les novateurs. Dans la mesure où elle vit en la religion un moyen de salut humain et de perfection humaine, elle s’en empara aussitôt pour la mécaniser, pour saisir l’âme de l’homme et l’attacher à la roue de ce mécanisme socio-religieux. Elle harnacha la religion d’une église, d’un clergé, d’une masse de cérémonies, et elle la fit garder par toute une meute de credos et de dogmes — dogmes que l’on devait accepter et observer sous peine à être condamné dans l’au-delà à un enfer éternel, par un juge éternel, tout comme il faut accepter et observer les lois de la société sous peine d’être condamné ici-bas à la prison ou à la mort par un juge mortel. Cette fausse socialisation de la religion a toujours été la principale causé de son impuissance à régénérer l’humanité.
Rien, en effet, ne saurait être plus fatal à la religion que de voir son élément spirituel écrasé ou étouffé sous les formules par ses appuis extérieurs, ses formes et son organisation. Les résultats de cette ancienne utilisation sociale de la religion en prouvent la fausseté. L’histoire nous montre que, plus d’une fois, la plus grande piété et la plus grande ferveur religieuse ont coïncidé avec l’ignorance la plus noire, la misère et la stagnation sordide des masses, le règne sans appel de la cruauté, de l’injustice et de l’oppression, et qu’en général la fin de tout cet ensemble s’est accompagnée d’une vaste révolte contre la religion imposée. Un autre signe en est que l’observation trop scrupuleusement exacte d’un système socio-religieux, de ses rites et de ses formes — qui, par cela même, commencent à perdre leur sens et leur véritable valeur religieuse — devient la loi de la religion, plutôt que la croissance spirituelle de l’individu et de la race. Un grand signe de cet échec de la société est que l’individu soit obligé de la fuir pour trouver un lieu où se développer spirituellement ; trouvant la vie humaine abandonnée au mental, à la vie et au corps non régénérés, trouvant le lieu de liberté spirituelle occupé par les chaînes de la forme, de l’église et des Écritures, il est obligé de rompre avec tout cela pour chercher un lieu de croissance spirituelle dans le monastère, les montagnes, les cavernes, le désert ou la forêt. Quand une telle séparation existe entre la vie et l’esprit, la vie humaine est condamnée. Ou bien elle continue à tourner en rond dans sa fausse routine, ou bien même elle est méprisée, comme dépourvue de valeur, perd confiance en soi-même et en son but, perd cette shraddhâ [intime conviction] sans laquelle elle ne peut arriver à rien, et glisse vers les ténèbres et la poussière. (Il peut y avoir une magnifique floraison de saints et d’ascètes sur ce sol trop riche, mais la race, la société, la nation vont vers la petitesse, la faiblesse, la stagnation). Ou bien encore l’on se tourne vers l’intellect pour réclamer du secours et l’on arrive, par une période de rationalisme, à un nouvel effort pour rétablir la vérité spirituelle, à une nouvelle tentative pour spiritualiser la société.
Dans la société, le But spirituel sera de considérer l’homme non comme un mental, une vie et un corps, mais comme une âme qui cherche son divin accomplissement sur terre et non pas seulement au ciel, dans un au-delà, qu’après tout rien ne l’obligeait à quitter si elle n’avait pas un travail divin à accomplir ici-bas dans le monde de la nature physique, vitale et mentale. Ce But ne considérera par conséquent la vie, le mental et le corps, ni comme des buts en soi, qui suffisent à leur propre satisfaction, ni comme des composants mortels pleins de maladies qu’il suffit d’abandonner pour que l’esprit libéré s’enfuie dans ses propres régions de pureté : il les considérera comme les premiers instruments de l’âme. Il croira en leur destinée et les aidera à croire en soi, mais, pour cette raison même, ce sera une croyance en leurs possibilités les plus hautes, non en des possibilités inférieures ni à plus forte raison en les plus basses. À son avis, leur destinée sera de se spiritualiser afin de se transformer en membres visibles de l’esprit, en moyens lucides, et eux-mêmes spirituels, de sa manifestation. En effet, puisqu’il acceptera la vérité de l’âme humaine comme une chose entièrement divine en son essence, il admettra de même qu’il soit possible à cet être tout entier de devenir divin malgré ses premières contradictions dans la Nature, et même en les prenant comme nécessaire point de départ terrestre. Et tout comme il considérera l’homme en tant qu’individu, il considérera également l’homme en tant que collectivité, en tant qu’âme collective qui cherche sur terre un accomplissement divin dans ses multiples relations. Par conséquent, dans la vie de l’homme, il tiendra pour sacrées, toutes les parties différentes qui correspondent aux parties de son être physique, vital, dynamique, émotif, esthétique, éthique, intellectuel et il verra en elles les instruments d’une croissance orientée vers une vie plus divine. Il considérera aussi du même point de vue toute société humaine, toute nation, tout peuple, tout autre groupement organique, comme des “sous-âmes” en quelque sorte, comme les moyens d’une manifestation complexe, d’un “accomplissement de soi” de l’Esprit, de la divine Réalité, en l’homme sur la terre. Son seul et unique dogme et credo sera la possibilité pour l’homme d’atteindre à la divinité, puisque, intérieurement, il est du même être que Dieu.
Et pourtant il ne cherchera même pas à imposer ce dogme, par une contrainte extérieure, aux représentants inférieurs de l’être humain, car ce serait nigraha [coercition], une contradiction répressive de la nature qui peut conduire à une suppression apparente du mal, mais non à une saine et réelle croissance du bien. Il en fera plutôt pour eux une lumière et une inspiration qu’il leur tendra pour que, de l’intérieur d’eux-mêmes, ils croissent en la divinité. Ni dans l’individu, ni dans la société, il ne cherchera à emprisonner, emmurer, réprimer, appauvrir ; il voudra au contraire laisser pénétrer l’air le plus libre et la lumière la plus haute. La loi d’une société spirituelle sera une large liberté : l’accroissement de cette liberté sera un signe de la croissance de la société humaine vers la possibilité d’une réelle spiritualisation. Tenter de spiritualiser dans ce sens une société composée d’esclaves — esclaves du pouvoir, esclaves de l’autorité, esclaves de la coutume, esclaves du dogme, esclaves de toutes sortes de lois imposées sous lesquelles ils vivent au lieu de vivre par elles, esclaves intérieurement de leur propre faiblesse, de leur ignorance et de leurs possessions, dont ils cherchent à éviter, ou ont besoin d’éviter les pires conséquences par un autre esclavage, extérieur celui-là — ne saurait jamais aboutir au succès. Il faut que ces esclaves d’abord brisent leurs chaînes afin de devenir capables d’une liberté plus haute. Non pas que l’homme ne doive se plier sous plus d’un joug dans sa marche ascendante, mais seul lui sera entièrement utile celui qu’il accepte parce que représentant de la façon la meilleure et la plus parfaite la loi intérieure et l’aspiration de sa nature. Les bons résultats qu’on obtient en se pliant sous les autres jougs se paient fort chers et ralentissent le progrès de l’homme autant et même plus qu’ils ne l’accélèrent.
Le But spirituel reconnaîtra que l’homme se développant en son être doit disposer d’autant d’espace libre que possible pour que tous les composants de cet être croissent en leur propre force, se découvrent eux-mêmes et découvrent leurs possibilités latentes. Dans leur liberté, ils commettront des erreurs, parce que l’expérience s’acquiert par beaucoup d’erreurs, mais puisque chacun d’eux a en soi un principe divin, ils découvriront ce principe au fur et à mesure que leur expérience d’eux-mêmes s’approfondira et s’accroîtra. Ainsi ce But spirituel n’essaiera pas de juguler la science et la philosophie ou de les obliger à faire concorder leurs conclusions avec un exposé quelconque de vérité religieuse ou spirituelle, comme s’efforcent de le faire les vieilles religions. Chaque partie de l’être humain à son propre dharma qu’elle doit suivre et qu’elle finira certainement par suivre, quelles que soient les chaînes qu’on lui impose. La science, la pensée et la philosophie ont pour dharma de chercher la vérité par la voie de l’intellect, sans passion, sans prévention, sans préjugé, sans aucun autre axiome de départ que ce qui impose la loi même de la pensée et de l’observation. Elles ne sont pas forcées de faire cadrer leurs observations et leurs conclusions avec des idées courantes provenant d’un dogme religieux, d’une règle éthique ou d’un préjugé esthétique. Si on les laisse libres dans leur action, elles finiront par trouver l’unité de la Vérité avec le bien, avec la Beauté et avec Dieu, et par donner à tout cela un sens plus grand que ne saurait le faire une religion dogmatique, une éthique formelle ou une conception esthétique étroite. Mais en attendant, il faut les laisser libres, même de nier Dieu et le bien et le beau si elles le veulent et si leur sincère observation des choses les conduit à le faire. À la fin, en effet, toutes ces dénégations aboutiront au retour, à une vérité plus vaste des choses qui ont été niées. C’est ainsi que nous voyons souvent l’athéisme, chez l’individu comme dans la société, être une transition nécessaire pour arriver à une religion et à une vérité spirituelle plus profondes ; il faut parfois nier Dieu pour arriver à Le trouver ; la découverte se réalise inévitablement à la fin de toute négation et de tout scepticisme sincères.
Il en est de même pour l’art, pour l’être esthétique de l’homme. Le but suprême de l’être esthétique est de trouver le Divin à travers la beauté. L’art suprême est celui qui, par l’emploi de la forme, ouvre les portes scellées de l’esprit. Mais afin qu’il puisse le faire largement et sincèrement, l’art doit d’abord s’efforcer de voir et de dépeindre l’homme, la nature et la vie pour eux-mêmes, dans leurs propres beauté et vérité caractéristiques : derrière celles-ci en effet se trouve toujours la Beauté du Divin en elles, et c’est par elles, bien qu’au début voilée par elles, que celle Beauté doit être révélée. Le dogme d’après lequel l’Art doit être religieux ou ne pas être est faux, tout comme la prétention de subordonner l’art à l’éthique, à l’utilité, à la vérité scientifique ou à la philosophie. L’art peut utiliser tout cela, mais il a son propre svadharma [champ d’action propre] et il s’élèvera à la spiritualité la plus vaste en le suivant jusqu’au bout, sans accentuer aucun autre joug que celui de sa propre loi d’existence.
Même dans l’être inférieur de l’homme — bien qu’ici nous soyons naturellement amenés à supposer que la coercition est le seul remède — le But spirituel cherchera une libre règle autonome et un développement d’origine intérieure plutôt qu’une répression de l’être dynamique et vital qui vienne de l’extérieur. Toute l’expérience nous montre qu’il faut laisser à l’homme une certaine liberté de pécher dans l’action, et aussi de s’égarer dans la connaissance, tant qu’il n’a pas obtenu de l’intérieur sa libération du péché et de l’erreur ; sans cela il ne peut se développer. La société, dans son propre intérêt, exerce nécessairement sur l’homme dynamique et vital une certaine coercition, mais celle-ci ne fait qu’enchaîner le démon, ou tout au plus modifier sa forme d’action en des mouvements plus mitigés et plus civilisés ; elle n’élimine pas le démon et elle en est incapable. La vertu réelle de l’homme dynamique et vital ne peut apparaître que lorsqu’il trouve en soi une loi et un esprit supérieurs pour sa propre activité ; les lui faire découvrir est le moyen spirituel de le régénérer.
Ainsi la spiritualité respectera la liberté des composants inférieurs, mais elle ne les abandonnera pas à eux-mêmes. Elle leur présentera la vérité de l’esprit en soi et traduite dans leurs champs d’action respectifs, sous un jour qui éclairera toute leur activité et leur montrera la loi supérieure de leur propre liberté. Par exemple, elle ne s’échappera pas du matérialisme scientifique par le mépris ou la né galion de la matière, mais elle suivra ce matérialisme dans ses propres affirmations et négations et lui montrera que là aussi est le Divin. Si elle ne pouvait le faire, c’est qu’elle serait elle-même non éclairée ou déficiente dans sa lumière, parce qu’incomplète. Elle n’essaiera pas d’abattre la vitalité en niant la vie, mais elle montrera à la vie le divin qui est en elle. Si elle ne pouvait le faire, c’est qu’elle-même n’aurait pas encore pénétré jusqu’au fond le sens de la création et le secret de l’Avatar.
Le But spirituel cherchera donc à s’accomplir l’individu et dans la race, plénitude qui sera la base par une plénitude de la vie et de l’être humains dans pour les sommets de l’esprit, et la base sera de la même substance que les cimes. Il ne procédera ni par mépris et négligence du corps, ni en affamant l’être vital jusqu’à l’anémier et le dessécher, ni par rejet puritain de l’art, de la beauté et de la joie esthétique dans la vie, ni par dédain de la science et de la philosophie considérées comme des gymnastiques intellectuelles négligeables ou captieuses bien que l’on ne puisse mettre en doute l’utilité temporaire de ces exagérations elles-mêmes, en opposition aux excès inverses. Il sera toutes choses pour tout, mais il sera à la fois le but et le sens suprême, en chaque chose son expression la plus complète, en laquelle tout ce qu’elle est se réalisera. Il cherchera à établir dans la société la véritable théocratie intérieure, non pas la fausse théocratie d’une église établie ou d’un clergé officiel, mais celle du Prêtre, Prophète et Roi intérieur. Il révélera à l’homme la divinité en lui comme Lumière, Force, Beauté, Joie, Immortalité qui habite au dedans de lui ; il construira également dans la vie extérieure de l’homme le royaume de Dieu que nous découvrons d’abord au dedans de nous. Il montrera à l’homme le moyen de chercher le Divin en chaque manière de son être, sarvabhávena [de toutes les manières possibles], et ainsi de Le trouver et de vivre en Lui ; il montrera à l’homme que, de quelque façon qu’il puisse vivre et agir, il vivra et agira en Cela, en le Divin, en l’Esprit, en l’ultime Réalité de son être.
► Shri Aurobindo, Cahiers du Sud, numéro spécial “Message actuel de l’Inde”, 1941. [trad. J. Herbert]
• Note : Ce texte, constituant le chapitre XXI de The psychology of social development (La psychologie du développement social), parut en 1914-1915 dans la revue Arya. L’ensemble fut révisé et remanié dans les années 30 et réédité en 1949 sous le titre Le Cycle humain.
— Au sujet de cet article, René Guénon, dans une recension lapidaire de décembre 1946, note : « Dans la même revue également [France-Orient] (n° de juin 1945) un article publié sous la signature de Shrî Aurobindo nous a causé un pénible étonnement ; nous disons seulement sous sa signature, parce que, jusqu’à nouvel ordre, nous nous refusons à croire qu’il soit réellement de lui, et nous préférons supposer qu’il ne s’agit que d’un “arrangement”, si l’on peut dire, dû à l’initiative de quelque disciple mal avisé. En effet, cet article, intitulé “La Société et la spiritualité”, ne contient guère que de déplorables banalités “progressistes”, et, s’il ne s’y trouvait çà et là quelques termes sanscrits, il donnerait assez exactement l’impression d’un prêche de quelque pasteur “protestant libéral” imbu de toutes les idées modernes ! Mais, pour dire toute la vérité, il y a déjà longtemps que nous nous demandons quelle peut être au juste la part de Shrî Aurobindo lui-même dans tout ce qui paraît sous son nom ». Pierre Feuga, dans son article « René Guénon et l'hindouisme », précise ce rapport :
« Pour ce qui est d’Aurobindo, l’appréciation de Guénon fut assez mouvante, très favorable au début, plus réticente à la fin (et sans doute fût-elle devenue franchement réprobatrice après la mort du maître, à l’endroit de la “Mère” et de ceux qui prétendaient prolonger son enseignement). “L’évolutionnisme” d’Aurobindo, pour être plus lumineux que celui de Nietzsche et plus intelligent que celui de Teilhard de Chardin, n’en était pas moins difficilement conciliable, pour Guénon, avec la doctrine authentique des cycles cosmiques. Enfin la terminologie lourde et filandreuse que le sage de Pondichéry crut bon de réinventer pour exposer des conceptions souvent traditionnelles ne pouvait que gêner Guénon, si rigoureux et si net quant à lui dans son vocabulaire. Au fond Aurobindo n’aurait-il pas été le premier Indien à créer un “système philosophique”, ce que n’étaient point les darshanas avant lui ? Cette marque d’individualisme expliquerait l’attrait qu’il exerce sur les intellectuels occidentaux, outre l’aspect “progressiste” auxquels ils sont généralement sensibles. Mais, d’un autre côté, on observera que, depuis la mort d’Aurobindo (qui se produisit la même année que celle de Ramana Maharshi, dernier grand sage traditionnel de l’Inde (*), aucun effort spéculatif d’envergure n’est apparu dans ce pays. Et cet “essoufflement” spirituel, sur lequel nous reviendrons, ne laisse pas d’inquiéter.
* : Tous deux disparurent en 1950 et Guénon (dont on sait qu’il naquit l’année de la mort de Râmakrishna) les suivit de très près. On ne peut nier la valeur de certains maîtres hindous plus récents (par ex. Shri Nisagardatta Maharaj ou W.L. Poonja) mais ils se situent, pour parler vite, dans la lignée “néo-védantine” de Ramana Maharshi, en y ajoutant une certaine tendance “psychologisante” (et même franchement “psychanalysante” chez un Swami Prajnanpad). Ces modernes gurus, comme beaucoup de lamas tibétains, répondent moins à un besoin doctrinal qu’à une angoisse existentielle, plus térébrante encore aujourd’hui qu’il y a cinquante ans, et il est frappant que même la méditation soit utilisée désormais dans un but thérapeutique, alors qu’on n’y accédait pas autrefois avant que le “mental” ne fût complètement purifié. » (Connaissance des religions n°65/66, 2002).
Le dernier point soulevé par P. Feuga rejoint la réserve de l'indianiste André Padoux (dans une recension sur une étude du néo-hindouisme occidental) : « si les adeptes et membres de ces mouvements cherchent à trouver, avec une religiosité intérieure rejetant doctrine et rituels, une vision qui donnerait de la cohérence au monde, les méthodes d'auto-perfectionnement qu'ils suivent ont une visée beaucoup plus intra-mondaine que transcendante. C'est à trouver un confort personnel en ce monde grâce à l'appui d'une vague métaphysique et à des méthodes pratiques que servirait bien souvent le néo-hindouisme ; il aiderait au développement d'un sujet adaptable au monde, résilient, efficace tout en étant détaché sinon affranchi du social — idéal (en Inde actuelle autant qu'en Occident) d'un certain yoga moderne. Confort social à base métaphysique… ». On prendra donc garde à distinguer le néo-hindouisme actuel et celui du début du XXe siècle. Dans une étude parue dans un recueil sur les nouveaux mouvements religieux (Diritti dell'uomo e libertà, dei gruppi religiosi, 1989), Jean-François Mayer resituait le contexte de ce dernier :
« Le phénomène interculturel que représentent les nouveaux mouvements religieux orientaux ne doit pourtant pas être analysé comme un processus à sens unique : historiquement, il est aussi un résultat du bouleversement provoqué en Orient par l'irruption des valeurs occidentales. Il ne peut en outre être séparé d'évolutions plus larges dans les pays orientaux. (…) Prenons l'exemple de l'Inde : au XIXe siècle, non seulement elle subissait le poids de l'impérialisme occidental, mais les traditions religieuses hindoues rencontraient de plus en plus la propagande chrétienne. Sans cette rencontre forcée avec la civilisation occidentale et le christianisme, la “renaissance” hindoue et la prise de conscience d'une “mission de l'Inde” eussent été impensables, estime Reinhart Hummel. Nous voyons donc naître au XIXe siècle toute une série de mouvements qui s'efforçaient de répondre à des situations nouvelles et, dans ce but, de réformer l'hindouisme — soit en le modernisant, soit en développant le mythe d'un retour à la pureté des sources.
Cette réflexion ne pouvait manquer d'affronter le problème de la crédibilité d'une religion “ethnique” dans le monde moderne : ainsi commencèrent à s'exprimer des tendances universalistes. Une approche inclusiviste, par ex., pouvait permettre ce développement : des expériences mystiques convainquirent Ramakrishna que toutes les religions étaient fondamentalement “vraies”, et il intégra donc le christianisme dans son approche en “hindouisant” le Christ. À partir de ce moment, la divinité du Christ fut reconnue par un nombre croissant de gourous, mais en assimilant la figure de Jésus à celle d'un “avatar” hindou. Étape suivante : lorsque Vivekananda se rendit en Amérique, il n'avait apparemment pas encore des objectifs “missionnaires” ; mais son expérience occidentale le persuada vite que l'Occident avait quelque chose à apprendre de l'Orient. Par la suite, il ne se trouvera guère de gourou qui ne répétera pas cette profession de foi, et l'idée est si répandue qu'on la découvre même dans de récents propos tenus par le premier ministre Rajiv Gandhi à un journaliste européen : “l'élément unificateur de notre nation, c'est la spiritualité innée des Indiens, voilà notre génie. Sri Aurobindo, le grand sage et philosophe bengali, estimait que l'Inde pouvait beaucoup apporter au monde de par sa spiritualité, et je pense comme lui” (Journal de Genève, 1988). L'inclusivisme évoqué plus haut à propos de l'attitude de Ramakrishna doit retenir notre attention, car il ne conduit pas à une dilution de l'hindouisme dans une entreprise syncrétique, mais plutôt à une affirmation de sa valeur universelle et englobante : cela révèle la fonction revitalisatrice de ces nouveaux courants religieux. (…) Cela suffit cependant à montrer comment, consciemment ou non, de nouveaux messages religieux universalistes, donc adaptés aux exigences d'une époque de rencontre des cultures, peuvent en même temps réussir à sauvegarder l'héritage national en le revitalisant et en le réinterprétant — en lui donnant une nouvelle dimension ».
***
♦ Pour prolonger :
Sri Aurobindo : Une philosophie politique spiritualiste, Jérôme Ballet, Harmattan, 2011.
La Grande Illusion : le nihilisme postmoderne à la lumière du Vedānta, Renaud Fabbri, Archè, 2022, not. pp. 90-97.

 Les méthodes de la connaissance védantique
Les méthodes de la connaissance védantiqueLa vérité des choses échappe toujours aux sens. Et pourtant c’est une bonne règle inhérente à la structure même de l’existence universelle que lorsqu’il y a des vérités accessibles à la raison, il doit y avoir quelque part dans l’organisme doué de cette raison un moyen de parvenir à ces vérités ou de les confirmer par l’expérience. Le seul moyen dont dispose encore notre mentalité est une extension de cette forme de connaissance par identité qui nous fait prendre conscience de notre propre existence. C’est en réalité un sentiment de soi plus ou moins conscient, plus ou moins présent à notre conception, qui sert de base à la connaissance du contenu de notre moi. Ou, pour employer une formule plus générale, la connaissance du contenant contient la connaissance du contenu.
Si donc nous sommes capables d’étendre notre faculté de conscience mentale de soi jusqu’à la conscience du Moi qui est au delà de nous et hors de nous, l’Atman ou Brahman des Upanishads, nous pouvons devenir possesseurs, par expérience, des vérités qui forment le contenu de l’Atman ou Brahman dans l’univers. C’est cette possibilité que le Védânta indien a prise pour base. Il a voulu trouver, par la connaissance du Moi, la connaissance de l’univers. Mais il a toujours considéré l’expérience mentale et les concepts de la raison, même à leur degré suprême, comme un reflet dans les identifications mentales et non comme l’identité suprême existant en soi. Il nous faut dépasser le mental et la raison. La raison active en notre conscience de veille n’est que la médiatrice entre le Tout subconscient d’où nous sommes venus en notre évolution ascendante, et le Tout supraconscient vers quoi nous contraint cette évolution. Le subconscient et le supraconscient sont deux formules différentes du même Tout. Le maître-mot du subconscient est Vie, le maître-mot du supraconscient est Lumière. Dans le subconscient, la connaissance ou conscience est involuée dans l’action, car l’action est l’essence de la Vie. Dans le supraconscient, l’action retourne en la Lumière et ne contient plus de connaissance involuée, mais est elle-même contenue dans une conscience suprême.
La connaissance par intuition est l’élément qui est commun aux deux ; son fondement est l’identité consciente et effective entre ce qui connaît et ce qui est connu ; c’est cet état de commune existence en soi où le connaissant et le connu sont un par la connaissance. Mais dans le subconscient l’intuition se manifeste dans l’action, en efficience, et la connaissance ou identité consciente est soit entièrement, soit plus ou moins cachée dans l’action. Dans le supraconscient, au contraire, la Lumière étant la loi et le principe, l’intuition se manifeste, en sa vraie nature comme connaissance émergeant de l’identité consciente, et l’efficience de l’action est plutôt l’accompagnement, la conséquence nécessaire et ne se donne plus comme fait primaire. Entre ces deux états, la raison et le mental agissent comme des intermédiaires qui rendent l’être capable de dégager la connaissance de son emprisonnement dans l’acte, et le préparent à recouvrer la primauté qui est de son essence. Quand la conscience de soi dans le mental s’appliquant à la fois au contenant et au contenu, au moi propre et au moi-autrui, s’exalte jusqu’en la lumineuse identité auto-manifestée, la raison, elle aussi, revêt la forme de la connaissance par intuition (1), lumineuse en soi. C’est le plus haut état possible de notre connaissance, ou le mental s’accomplit dans le supramental.
Tel est le système de l’entendement humain sur quoi furent érigées les conclusions du plus ancien Védânta. Il n’est pas dans mon dessein de décrire longuement les résultats où sont parvenus, sur ces bases, les anciens Sages ; mais il est nécessaire de passer brièvement en revue quelques-unes de leurs principales conclusions, dans 1a mesure où elles affectent le problème de la Vie divine qui seul nous occupe ici. Car c’est dans ces idées que nous allons trouver les meilleures fondations déjà existantes de ce que nous cherchons maintenant à reconstruire, et bien que comme pour toute connaissance l’expression ancienne doive être remplacée dans une certaine mesure par une expression nouvelle adaptée à une mentalité ultérieure, et que la lumière ancienne doive se fondre en la lumière nouvelle comme se succèdent les aurores, c’est cependant avec, pour capital initial, le trésor ancien ou du moins tout ce que nous en pouvons recouvrer, que nous serons le mieux à même d’accumuler les plus grands profits dans notre commerce nouveau avec l’Infini toujours inchangé et toujours changeant.
Sad Brahman, l’Existence pure, indéfinissable, infinie, absolue, est le concept dernier auquel arrive l’analyse védântique en sa vision de l’univers, la Réalité fondamentale que l’expérience védântique découvre derrière tout le mouvement et tout l’aspect de forme qui constituent la réalité apparente. Il est évident que, lorsque nous postulons cette conception, nous allons tout à fait au delà de ce que contiennent ou certifient notre conscience ordinaire, notre expérience normale. Les sens et le mental-sens ne savent absolument rien d’une expérience pure ou absolue. Tout ce dont nous parle notre expérience sensorielle est forme et mouvement. La forme existe, mais d’une existence qui n’est pas pure, qui bien plutôt est toujours mêlée, combinée, agrégée, relative. Quand nous pénétrons en nous-même, nous pouvons bien nous débarrasser de la forme précise, mais nous ne pouvons nous débarrasser du mouvement, du changement. Mouvement de matière dans l’espace, mouvement de changement dans le temps, telle semble être la condition de l’existence. Certes on peut dire, si l’on veut, que l’existence, c’est ce dont nous avons ici l’expérience courante et que l’idée d’existence-en-soi ne correspond à aucune réalité discernable. Tout au plus entrevoyons-nous parfois, dans le phénomène de conscience de soi ou derrière ce phénomène, quelque chose d’immobile et d’immuable, quelque chose que nous percevons vaguement — ou imaginons — que nous sommes, par delà toute vie et toute mort, par delà tout changement, toute formation, toute action. C’est la seule porte qui parfois en nous soudain s’ouvre grande sur la splendeur d’une vérité au delà, et, avant de se refermer, laisse un rayon nous frôler — signe lumineux que nous pouvons étreindre en notre foi, si nous avons assez de force et de fermeté, et prendre pour tremplin d’un jeu de conscience autre que celui du mental-sens le jeu de l’intuition.
Car si nous y regardons avec soin, nous verrons que l’intuition est notre premier instructeur. L’intuition est là toujours, voilée, derrière nos opérations mentales. C’est l’intuition qui apporte à l’homme ces fulgurants messages de l’Inconnu qui sont le début de sa plus haute connaissance. La raison n’intervient qu’ensuite, pour voir quel profit elle peut tirer de la lumineuse moisson. C’est l’intuition qui nous donne cette idée de quelque chose qui est derrière et par delà tout ce que nous savons et tout ce que nous semblons être, cette idée qui poursuit l’homme, tout en étant en conflit incessant avec sa raison inférieure et toute son expérience ordinaire, et qui le contraint à traduire cette perception sans forme en idées plus positives : Dieu, immortalité, Ciel, et tout ce par quoi nous tâchons de l’exprimer à notre mental. Car l’intuition est aussi forte que cette Nature de l’âme même de qui elle a jailli, et elle n’a nul souci des contradictions de la raison, des démentis de l’expérience. Elle connaît ce qui est, parce qu’elle est, parce qu’elle- même est de cela et vient de cela, et ne veut point livrer cela au jugement de ce qui ne fait que devenir et paraître. Ce dont nous parle l’intuition, c’est moins l’Existence que l’Existant, car elle procède de cet unique point de lumière en nous qui favorise son jeu, cette porte parfois ouverte dans notre propre conscience de nous. L’antique Védânta a saisi ce message de l’intuition et l’a formulé dans les trois affirmations fondamentales [mahāvākya] des Upanishads : “Je suis Lui”, “Tu es Cela, ô Shvétaketu”, “Tout Ceci est le Brahman ; ce Moi est le Brahman”.
Mais l’intuition — en raison de la nature même de son action en l’homme, œuvrant comme elle le fait de derrière le voile, principalement active dans les éléments qui en l’homme sont les moins éclairés, les moins capables de s’exprimer et parce qu’elle n’est servie, de ce côté-ci du voile, dans l’étroite lumière qui est notre conscience de veille, que par des instruments inaptes à assimiler pleinement ces messages — ne peut nous donner la vérité sous cette forme ordonnée et explicite que réclame notre nature. Pour pouvoir réaliser en nous une telle plénitude de connaissance directe, elle devrait au préalable s’organiser dans notre être de surface et y assumer le rôle directeur. Mais dans notre être de surface, ce n’est pas l’intuition, c’est la raison qui est organisée et qui nous aide à ordonner nos perceptions, nos pensées et nos actions. Aussi l’âge de la connaissance intuitive, représenté par l’ancienne pensée védântique des Upanishads, a-t-il dû faire place à l’âge de la connaissance rationnelle ; l’Écriture inspirée a cédé le pas à la philosophie métaphysique, comme ensuite la philosophie métaphysique a dû céder le pas à la science expérimentale. La pensée intuitive, qui est une messagère du supraconscient et par conséquent notre faculté la plus haute, a été supplantée par la raison pure qui n’est qu’une sorte de substitut appartenant aux hauteurs moyennes de notre être ; la raison pure à son tour a été supplantée pendant quelque temps par l’action mêlée de la raison qui occupe les plaines et les basses altitudes, et dont la vision ne dépasse pas l’horizon de l’expérience que peuvent nous apporter les sens et le mental physiques et tout ce que nous pouvons inventer pour les aider. Et ce processus qui semble être une régression est en vérité un cycle de progrès. Car dans chaque cas la faculté inférieure est contrainte de prendre tout ce qu’elle peut assimiler dans ce qu’avait déjà donné la faculté supérieure et de chercher à le rétablir par ses propres méthodes. Par cette tentative, elle acquiert elle-même une portée plus vaste et arrive enfin à s’adapter de façon plus souple et plus large aux facultés supérieures. Sans cette succession et ces tentatives d’assimilation par chaque faculté, nous serions obligés de demeurer sous la domination exclusive d’une partie de notre nature tandis que le reste demeurerait ou bien sans vigueur et indûment asservi, ou bien confiné en son propre domaine et par suite piètrement développé. Avec cette succession et ces tentatives séparées l’équilibre est rétabli ; il se prépare une harmonie plus complète de nos éléments de connaissance.
Nous trouvons cette succession dans les Upanishads et les philosophies indiennes ultérieures. Les sages du Vêda et du Védânta s’en remettaient entièrement à l’intuition et à l’expérience spirituelle. C’est par erreur que les érudits parlent quelquefois de grands débats ou discussions dans les Upanishads. Chaque fois qu’il semble y avoir controverse, ce n’est pas par la discussion, la dialectique ou l’emploi du raisonnement logique qu’on procède, mais par une comparaison d’intuitions et d’expériences où le moins lumineux s’efface devant le plus lumineux, le plus étroit, le plus défectueux ou le moins essentiel devant le plus vaste, le plus parfait, le plus essentiel. La question qu’un penseur pose à un autre est : “Que connais-tu ?” et non “Que penses-tu ?” ni “À quelle conclusion ton raisonnement t’a-t-il conduit ?”. Nulle part dans les Upanishads nous ne trouvons trace d’un raisonnement logique invoqué pour étayer les vérités du Védânta. L’intuition, semblant avoir soutenu les sages, doit être corrigée par une intuition plus parfaite ; le raisonnement logique ne peut en être juge.
Et cependant la raison humaine tient à avoir satisfaction par sa propre méthode. C’est pourquoi, lorsque a commencé l’âge de la spéculation rationaliste, les philosophes indiens, respectueux de l’héritage du passé, ont adopté une double attitude à l’égard de la vérité qu’ils cherchaient. Ils reconnaissaient en la Shruti [textes révélés] — premier fruit de l’intuition ou, comme ils préféraient l’appeler, de la révélation inspirée — une autorité supérieure à la raison. Mais en même temps, ils partaient de la raison et mettaient à l’épreuve les résultats qu’elle leur donnait, ne tenant pour valables que les conclusions confirmées par l’autorité suprême. Ainsi ils ont évité dans une certaine mesure le vice coutumier de la métaphysique, sa tendance à batailler dans les nuages parce qu’elle prend les mots pour des faits impératifs et non pour des symboles qu’il faut toujours scruter avec soin et constamment ramener au sens de ce qu’ils représentent. Leurs spéculations tendirent d’abord, au centre, à rester proches de l’expérience la plus haute et la plus profonde, puis à procéder avec la double sanction des deux grandes autorités, raison et intuition. Néanmoins, la tendance naturelle de la raison à affirmer sa propre suprématie triompha en fait de la théorie de sa subordination. D’où la naissance d’écoles adverses, dont chacune se basait en théorie sur le Vêda et en employait les textes comme arme contre les autres écoles. Car l’intuition voit les choses comme un tout, dans leur ensemble, et les détails comme des aspects seulement du tout indivisible ; elle tend vers la synthèse et l’unité de la connaissance. La raison, au contraire, procède par analyse et division, et assemble ses faits pour former un tout ; mais dans l’assemblage ainsi formé il y a des opposés, des anomalies, des incompatibilités logiques, et la tendance naturelle de la raison est d’en affirmer certains et de nier ceux qui s’opposent aux conclusions qu’elle a choisies, afin de former un système impeccablement logique. L’unité de la première connaissance intuitive fut ainsi brisée, et l’ingéniosité des logiciens a toujours su découvrir des expédients, des méthodes d’interprétation, des critères à valeurs variables pour pouvoir pratiquement annuler les textes gênants de l’Écriture et se livrer dans une entière liberté à des spéculations métaphysiques.
Néanmoins, les conceptions principales du premier Védânta ont subsisté en partie dans les différents systèmes philosophiques et l’on s’est efforcé périodiquement de les combiner à nouveau en quelque image de la catholicité, de l’unité qu’avait jadis la pensée intuitive. Et à l’arrière-plan de la pensée de tous, présenté sous des formes diverses, a survécu, comme la conception fondamentale, Purusha, Atman ou Sad Brahman, le pur Existant des Upanishads, souvent rationalisé en une idée ou un état psychologique, mais portant encore un peu de son ancienne charge d’inexprimable réalité. Quel peut être le rapport entre le mouvement de devenir qui est ce que nous appelons le monde et cette Unité absolue? comment l’égo, qu’il soit produit du mouvement ou cause du mouvement, peut-il retourner à ce Moi, cette Divinité ou Réalité véritable proclamée par le Védânta ? — telles sont les questions spéculatives et pratiques qui ont toujours occupé la pensée de l’Inde.
► Aurobindo Ghose, in : Approches de l’Inde : Tradition et incidences, 1949.
(Traduction française de Camille Rao, Suzanne Forgues et Jean Herbert, révisée par l’auteur)
1. J’emploie le mot “intuition” à défaut d’un meilleur. À vrai dire, c’est un pis-aller, et il n’exprime pas exactement le sens que je lui assigne. Il en est de même du mot “conscience” et de plusieurs autres dont notre pauvreté nous force d’étendre illégitimement le sens.
♦ nota bene : Texte tiré de La Vie divine (I, 8).
♦ pour rappel : la plupart des contributions de ce recueil sont lisibles sur l'entrée Hindouisme (voir aussi Tantrisme).

 Connaissance intellectuelle et vérité spirituelle
Connaissance intellectuelle et vérité spirituelleLa pensée métaphysique européenne ne dépasse pas l'intellect, ni dans sa méthode ni dans ses résultats — même chez les penseurs qui essaient de prouver ou d'expliquer la naissance et la nature de Dieu ou de l'Absolu. Or l'intellect est incapable de connaître la Vérité suprême ; il ne peut qu'errer tout alentour en la cherchant, en saisir des représentations fragmentaires — non la chose même — et essayer de les relier entre elles. Le mental ne peut pas atteindre la Vérité ; il ne peut que construire des schémas qui ont pour but de le représenter. C'est pourquoi la pensée européenne aboutit forcément et toujours à l'agnosticisme, déclaré ou implicite.
L'intellect, s'il va sincèrement jusqu'à sa propre fin, doit revenir en rapportant ceci : “Je ne puis pas savoir ; il y a, ou du moins il me semble qu'il peut y avoir ou même qu'il doit y avoir Quelque Chose au-delà, quelque ultime Réalité, mais je ne puis que spéculer sur sa vérité ; ou bien elle est inconnaissable, ou elle ne peut être connue de moi”. Ou, s'il a reçu sur le chemin quelque lumière de ce qui est au-delà de lui, il peut aussi dire : “Il y a peut-être une conscience au-delà du Mental, car il me semble que j'en saisis des lueurs et même que j'en reçois des suggestions. Si cela est en rapport avec l'Au-Delà, ou si c'est une conscience de l'Au-Delà et que vous pouvez trouver un moyen de l'atteindre, alors ce Quelque Chose pourra être connu, mais pas autrement”.
Toute recherche de la Vérité suprême par le seul moyen de l'intellect aboutit nécessairement soit à un agnosticisme de ce genre, soit à un système intellectuel ou à une formule construite mentalement. Il y a eu des centaines de ces systèmes et de ces formules et il peut y en avoir des centaines d'autres, mais aucun ne peut être définitif. Chacun a peut-être valeur pour le mental, et divers systèmes dont les concluions sont contradictoires peuvent avoir un attrait égal pour des intelligences également puissantes et compétentes. Tout ce travail de spéculation a son utilité, par le fait qu'il exerce le mental humain et l'aide à conserver la notion de Quelque Chose au-delà et d'un Absolu vers lequel il doit se tourner. Mais la Raison intellectuelle ne peut que l'indiquer vaguement, le chercher à tâtons ou essayer de tracer des aspects partiels ou même contradictoires de sa manifestation ici ; elle ne peut y pénétrer ni le connaître. Tant que nous demeurons dans le domaine du seul intellect, une réflexion impartiale sur tout ce qui a été pensé et recherché, un jaillissement constant d'idées, de toutes les idées possibles, l'élaboration de telle ou telle croyance, opinion ou conclusion philosophique, est tout ce qui peut être fait. Cette sorte de recherche désintéressée de la vérité serait la seule attitude possible pour une intelligence vaste et plastique. Mais toute conclusion ainsi atteinte ne serait que spéculative ; elle ne pourrait avoir aucune valeur spirituelle ; elle ne donnerait pas l'expérience décisive ni la certitude spirituelle que recherche l'âme. Si l'intellect est notre instrument le plus élevé et qu'il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à la Vérité supraphysique, alors notre ultime attitude doit être un sage et vaste agnosticisme. Les objets dans la manifestation peuvent être connus jusqu'à un certain point, mais le Suprême et tout ce qui existe au-delà du Mental doit demeurer à jamais inconnaissable.
S'il y a une conscience plus grande au-delà du Mental, et si cette conscience nous est accessible, alors seulement pouvons-nous connaître la Réalité ultime et y pénétrer. La spéculation intellectuelle, le raisonnement logique sur le point de savoir si cette conscience plus grande existe ou non ne peut nous mener très loin. Ce qu'il nous faut, c'est un moyen d'en avoir l'expérience, de l'atteindre, d'y pénétrer, de la vivre. Si nous pouvons le trouver, la spéculation et le raisonnement intellectuel doivent nécessairement reculer à une place très secondaire et même perdre leur raison d'exister. La philosophie, l'expression intellectuelle de la Vérité peuvent subsister, mais principalement comme des moyens d'exprimer cette découverte plus grande et ce qui, de son contenu, peut être exprimé en termes mentaux pour ceux qui vivent encore dans l'intelligence mentale.
Vous verrez que cela répond à votre argument sur les penseurs occidentaux, Bradley et autres, qui sont arrivés par la pensée intellectuelle à l'idée d'un “Autre Chose au-delà de la Pensée” ou qui ont même, comme Bradley, essayé d'exprimer leurs conclusions à ce propos dans des termes qui rappellent certaines des expressions de l'Ârya. L'idée en elle-même n'est pas nouvelle, elle est aussi ancienne que les Véda. Elle a été répétée sous d'autres formes dans le bouddhisme, le gnosticisme chrétien, le soufisme. À l'origine, elle n'a pas été découverte par la spéculation intellectuelle, mais par les mystiques qui observaient une discipline spirituelle intérieure. Quand, quelque part entre le VIIe et le Ve siècle avant JC, les hommes commencèrent, en Orient comme en Occident, à intellectualiser la connaissance, cette Vérité survécut en Orient ; en Occident, où l'intellect commençait à être admis comme le seul ou le plus haut instrument de découverte de la Vérité, elle commença à s'estomper. Et pourtant là aussi elle a tenté constamment de revenir ; le néo-platonisme l'a ramenée, et maintenant elle apparaît : les néo-hégéliens et d'autres (par ex. le Russe Ouspensky et un ou deux penseurs allemands, je crois) semblent chercher à l'atteindre. Il y a cependant une différence.
En Orient, et particulièrement en Inde, les penseurs métaphysiques ont essayé, comme en Occident, de déterminer par l'intellect la nature de la plus haute Vérité. Mais en premier lieu, ils ont donné à la pensée mentale, non pas la place suprême comme instrument de découverte de la Vérité, mais seulement un statut secondaire. La première place a toujours été donnée à l'intuition spirituelle, à l'illumination et à l'expérience spirituelle ; une conclusion intellectuelle qui contredit cette autorité suprême est tenue pour non valable. En second lieu, chaque philosophie s'est armée d'un moyen pratique d'atteindre l'état suprême de conscience, si bien que même lorsqu'on part de la pensée, le but est de parvenir à une conscience au-delà de la pensée mentale. Chaque philosophe fondateur (et aussi ceux qui perpétuent son travail ou son école) a été un penseur métaphysique doublé d'un yogi. Ceux qui n'étaient que des philosophes intellectuels étaient respectés pour leur érudition mais ne prenaient jamais rang de découvreurs de la vérité. Et les philosophies qui manquaient de moyens suffisamment puissants pour atteindre l'expérience spirituelle s'éteignaient et devenaient des choses du passé, parce qu'elles ne contenaient pas le dynamisme nécessaire à la découverte et à la réalisation spirituelles.
En Occident, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La pensée, l'intellect, la raison logique vinrent à être considérées de plus en plus comme le moyen le plus élevé et même la fin la plus élevée ; en philosophie, la Pensée est l'alpha et l'oméga. C'est par la réflexion intellectuelle et la spéculation que la vérité doit être découverte ; l'expérience spirituelle elle-même a été sommée de se soumettre aux épreuves de l'intellect, si elle voulait être tenue pour valable — à l'inverse de l'attitude indienne. Même ceux qui voient que la Pensée mentale doit être dépassée et qui admettent un “Autre Chose” supramental ne semblent pas échapper au sentiment que c'est par la Pensée mentale, se sublimant et se transmuant, que cette autre Vérité doit être atteinte et substituée à la limitation et à l'ignorance mentales. Et une fois de plus la pensée occidentale a cessé d'être dynamique ; elle a recherché une théorie des choses, non une réalisation. Elle était encore dynamique chez les anciens Grecs, mais à des fins morales et esthétiques plutôt que spirituelles. Plus tard, elle est devenue encore plus purement intellectuelle et académique ; elle est devenue une spéculation uniquement intellectuelle, sans aucun moyen pratique d'atteindre la Vérité par l'expérience spirituelle, par la découverte spirituelle, par une transformation spirituelle. Sans cette différence, il n'y aurait pas de raison que des chercheurs comme vous se tournent vers l'Orient pour y trouver un guide ; car dans le domaine purement intellectuel, les penseurs occidentaux sont aussi compétents que n'importe quel sage oriental. C'est la voie spirituelle, la route qui mène au-delà des niveaux de l'intellect, le passage de l'être extérieur au Moi le plus profond, que le mental de l'Europe a perdu en se surintellectualisant.
Dans les extraits de Bradley et Joachim que vous m'avez envoyés, c'est encore l'intellect qui réfléchit à ce qui est au-delà de lui-même et parvient à une conclusion intellectuelle spéculative, raisonnée, sur ce sujet. Ces textes ne contiennent pas le dynamisme nécessaire au changement qu'ils tentent de décrire. Si ces écrivains exprimaient en termes mentaux une réalisation, même mentale, une expérience intuitive de cet “Autre Chose que la Pensée”, alors quelqu'un qui serait prêt la sentirait à travers le voile du langage qu'ils emploient et se rapprocherait de la même expérience. Ou si, étant parvenus à la conclusion intellectuelle, ils étaient passés à la réalisation spirituelle, trouvant la voie ou empruntant une voie déjà découverte, alors en suivant leur pensée, on pourrait se préparer à la même transition. Mais il n'y a rien de tel dans toute cette pensée ardue. Elle reste dans le domaine de l'intellect et dans ce domaine elle est sans aucun doute admirable ; mais elle n'atteint pas le dynamisme nécessaire à l'expérience spirituelle.
Ce n'est pas en “réfléchissant” à la réalité totale, mais par un changement de conscience qu'on peut passer de l'ignorance à la Connaissance — la Connaissance par laquelle nous devenons ce que nous connaissons. Passer de la conscience extérieure à une conscience directe et intimement intérieure ; élargir la conscience hors des limites de l'ego et du corps ; l'élever par une volonté et une aspiration intérieures et une ouverture à la Lumière jusqu'à ce qu'elle passe, dans son ascension, au-delà du Mental ; amener une descente du Divin supramental par le don de soi et la soumission avec pour conséquence une transformation du mental, de la vie et du corps — telle est la voie intégrale vers la Vérité (1). C'est ce que nous appelons ici la Vérité et c'est le but de notre yoga.
► Shri Aurobindo, Lettre du 15 juin 1930.
1 : J’ai dit que l’idée du supramental existait déjà depuis les temps anciens — il y a eu, en Inde et ailleurs, des tentatives pour l’atteindre en s’y élevant ; mais ce qui manquait était la manière de l’intégrer à la vie et de le faire descendre pour que la nature entière soit transformée, jusqu’à la nature physique.
***
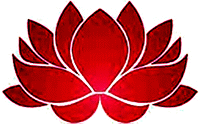 La Mère ne vous a pas dit que l'amour n'est pas une émotion, mais que l'Amour divin n'est pas une émotion ; c'est tout différent. L'amour humain est fait d'émotion, de passion et de désir ; tous ces mouvements appartiennent au vital et sont par conséquent liés aux incapacités de la nature vitale humaine. L'émotion est une excellente chose, elle est indispensable à la nature humaine en dépit de toutes ses imperfections et de tous ses dangers, tout comme les idées mentales sont excellentes et indispensables dans leur domaine propre, au stade humain. Mais notre but est de dépasser les idées mentales pour entrer dans la lumière de la Vérité supramentale qui existe non par l'idéation, mais par la vision directe et l'identité ; de même notre but est de dépasser l'émotion pour parvenir à l'élévation, à la profondeur et à l'intensité de l'Amour divin et d'y ressentir, par le cœur psychique intérieur, une inépuisable unité avec le Divin que nous sommes incapables d'atteindre ou de ressentir dans les soubresauts des émotions vitales. La Vérité supramentale n'est pas seulement une sublimation de nos idées mentales ; de même, l'Amour divin n'est pas seulement une sublimation des émotions humaines ; c'est une conscience différente dont la qualité, la substance et les mouvements sont différents. [l'Amour divin] existe en lui-même, indépendamment du contact extérieur ou de l'expression extérieure. S'exprimera-t-il extérieurement et comment ? cela dépend de la vérité spirituelle qui devra se manifester. (Lettres sur le yoga)
La Mère ne vous a pas dit que l'amour n'est pas une émotion, mais que l'Amour divin n'est pas une émotion ; c'est tout différent. L'amour humain est fait d'émotion, de passion et de désir ; tous ces mouvements appartiennent au vital et sont par conséquent liés aux incapacités de la nature vitale humaine. L'émotion est une excellente chose, elle est indispensable à la nature humaine en dépit de toutes ses imperfections et de tous ses dangers, tout comme les idées mentales sont excellentes et indispensables dans leur domaine propre, au stade humain. Mais notre but est de dépasser les idées mentales pour entrer dans la lumière de la Vérité supramentale qui existe non par l'idéation, mais par la vision directe et l'identité ; de même notre but est de dépasser l'émotion pour parvenir à l'élévation, à la profondeur et à l'intensité de l'Amour divin et d'y ressentir, par le cœur psychique intérieur, une inépuisable unité avec le Divin que nous sommes incapables d'atteindre ou de ressentir dans les soubresauts des émotions vitales. La Vérité supramentale n'est pas seulement une sublimation de nos idées mentales ; de même, l'Amour divin n'est pas seulement une sublimation des émotions humaines ; c'est une conscience différente dont la qualité, la substance et les mouvements sont différents. [l'Amour divin] existe en lui-même, indépendamment du contact extérieur ou de l'expression extérieure. S'exprimera-t-il extérieurement et comment ? cela dépend de la vérité spirituelle qui devra se manifester. (Lettres sur le yoga) 
À plus d’une reprise, il est arrivé que l'on ait associé le yoga à la psychanalyse, et certains psychologues occidentaux se sont efforcés de rechercher entre eux des points de contact, considérant le yoga comme l’ancêtre des techniques modernes de la Psychologie analytique sous toutes ses formes. Quelques-uns ont même voulu construire de toutes pièces un syncrétisme englobant des méthodes prises chez l’un et chez l’autre. D'autres cependant (1) ont sérieusement mis en garde les trop zélés simplificateurs qui, dans une hâte de néophytes, voudraient rabaisser une science de l’esprit à une investigation des plus basses régions de la subconscience. Il ne manque pas d’intérêt de donner l’opinion d’un maitre hindou en cette matière. Nous la trouvons chez Shri Aurobindo :
Je trouve difficile de prendre les psychanalystes au sérieux quand ils essayent de sonder l’expérience spirituelle à la lueur vacillante de leurs lampes de poche ; et cependant on devrait peut-être le taire, car le demi-savoir est peut-être un grand obstacle à la venue à la surface de la vérité. Cette nouvelle psychologie me fait l’effet d’enfants qui apprendraient un alphabet sommaire et pas très adéquat, et qui triompheraient en juxtaposant l’A.B.C. du subconscient avec le mystérieux super-ego souterrain et en imaginant que leur premier livre de débuts obscurs : b, a, ba, est le cœur même de la réelle connaissance. Ils regardent de bas en haut et expliquent les lumières les plus hautes par les obscurités inférieures ; mais les fondements de ces choses sont en haut et non en bas. Le supra-conscient, et non subconscient, est le vrai fondement de tout. On ne peut trouver la signification du lotus en analysant les secrets de la vase où il pousse ; son secret doit être trouvé dans l’archétype céleste du lotus qui s’épanouit à jamais dans la lumière d’en haut. De plus, le champ que ces psychologues ont choisi pour eux-mêmes est pauvre, obscur et limité : vous devez connaitre le tout avant de pouvoir connaitre la partie, et le supérieur avant de pouvoir vraiment comprendre l’inférieur. Telle est la promesse de la plus grande psychologie qui attend son heure, et devant laquelle ces pauvres tâtonnements disparaitront sans aboutir à rien.
La psychanalyse de Freud est la dernière chose que l’on devrait associer au yoga. Elle se saisit d’une certaine partie de la nature, la plus sombre, la plus périlleuse, la plus malsaine : la région subconsciente du vital inférieur, isole ses phénomènes les plus morbides et leur attribue une action hors de toute proportion avec leur vrai rôle dans la nature. La psychologie moderne est une science dans l’enfance, à la fois inconsidérée, maladroite et mal ébauchée. Comme dans toute science au début, le mental humain se livre ici sans contrainte à son habitude universelle de se saisir d’une vérité partielle ou locale, de la généraliser indûment et d’essayer d’expliquer tout un champ de la nature en ses termes étroits. De plus, l’exagération attribuée aux complexes sexuels réprimés est un mensonge dangereux ; elle peut avoir une influence néfaste et tend à rendre le mental et le vital, non pas moins, mais plus foncièrement impurs qu’auparavant.
Il est vrai que le subliminal est la partie la plus importante de la nature humaine et qu’il contient le secret des dynamismes invisibles qui expliquent ses activités de surface. Mais le subconscient vital inférieur qui est tout ce que la psychanalyse de Freud semble connaitre (et elle ne connait de cela que quelques coins mal éclairés) n’est rien de plus qu’une portion bornée et très inférieure de l’ensemble subliminal. Le moi subliminal se tient en arrière et soutient tout l’homme superficiel ; il contient un mental plus large et plus efficace derrière le mental de surface, un vital plus vaste et plus puissant derrière le vital de surface, une conscience physique plus subtile et plus libre derrière l’existence corporelle de surface. Et au-dessus d’eux il s’ouvre à des régions supra-conscientes supérieures, de mème qu’il s’ouvre au-dessous d’eux à des régions subconscientes inférieures. Si l’on veut purifier ou transformer la nature, il faut s’ouvrir au pouvoir de ces régions supérieures, s’élever jusqu’à elles et par elles changer à la fois l’être subliminal et celui de surface. Même cela doit être fait avec soin, pas prématurément ni imprudemment, en suivant une direction supérieure et en gardant la bonne attitude ; car autrement la force attirée peut être trop forte pour le cadre d’une nature obscure et faible. Mais commencer par ouvrir le subconscient inférieur, en risquant de soulever tout ce qui est malpropre et obscur en lui, c’est sortir de son chemin pour s’attirer des tourments. D’abord, on doit rendre le mental supérieur et le vital forts, fermes et pleins de la lumière et de la paix d’en haut ; ensuite, on peut ouvrir le subconscient et mème se plonger en lui, avec plus de sécurité et quelque chance d’un changement rapide et heureux.
(…) pour rejeter quoi que ce soit de l’être, on doit d’abord en devenir conscient, avoir une claire expérience intérieure de son action, et découvrir sa place réelle dans les œuvres de la nature. Alors on peut agir sur lui pour l’éliminer si c’est un mouvement néfaste, ou le transformer si c’est seulement une dégradation d’un mouvement supérieur et vrai. C’est cela ou quelque chose de ce genre qu’on a essayé grossièrement et improprement, avec une connaissance rudimentaire et insuffisante, dans le système de la psychanalyse.
Soulever les mouvements inférieurs jusque dans la pleine lumière de la conscience, afin de les connaitre et de s’occuper d’eux, est un procédé inévitable : un changement ne peut s’accomplir sans cela. Mais on ne peut réussir vraiment que si une lumière et une force supérieures sont à l’œuvre pour surmonter, plus ou moins vite, la force de la tendance offerte à la transformation. Bien des gens, sous prétexte d’“expérience”, non seulement soulèvent le mouvement adverse, mais le soutiennent de leur consentement, au lieu de le rejeter, trouvent des justifications pour le prolonger ou le répéter, et ainsi jouent avec lui, se plaisent à son retour et l’éternisent ; ensuite, quand ils veulent s’en débarrasser, il a une telle emprise sur eux qu’ils se trouvent impuissants dans ses griffes et ne peuvent être libérés que par un terrible conflit ou une intervention de la Grâce divine.
(…) aucune partie n’est plus ignorante, plus périlleuse, plus déraisonnable, plus obstinée dans ses répétitions que le subconscient vital inférieur et ses mouvements. Le soulever prématurément ou mal à propos par l’expérience, c’est risquer de baigner aussi les parties conscientes dans son flot sombre et sale, et ainsi d’empoisonner le vital tout entier et même la nature mentale. On devrait donc toujours commencer par une expérience positive, non par une négative, et faire descendre dans les parties de l’être conscient qui sont à changer quelque chose de la nature divine ; c’est seulement quand ceci a été fait suffisamment, et qu’il y a une ferme base positive, qu’on peut avec sécurité faire lever les éléments adverses cachés dans le subconscient, afin de les détruire et de les éliminer par la puissance de la tranquillité, de la lumière, de la force et de la connaissance divines.
► Aurobindho Ghose, in : Yoga, science de l'homme intégral, 1953. [texte tiré de : Les Bases du Yoga, 1945]
1. Par ex. CG Jung. Cf. « Le Yoga et l’Occident », in : Approches de l'Inde, éd. Cahiers du Sud, 1950.

La clef du Véda Dans les temps anciens, le Véda était vénéré comme un livre de Sagesse sacrée, comme un vaste ensemble de poèmes inspirés ; c’était l’œuvre des Rishis, les voyants et les sages qui reçurent en leurs esprits illuminés, plutôt qu’ils ne conçurent mentalement, la Grande Vérité universelle, éternelle et impersonnelle, qu’ils incorporèrent dans des stances révélées et efficaces : les Mantras d’inspiration et de sources divines et non-humaines. On donnait à ces sages le nom de kavi, qui servit par la suite à désigner n’importe quel poète, mais qui, à l’époque, avait aussi le sens de “voyant de la vérité”. Le Véda lui-même les désigne sous le nom de kavayah satyashrutah : “les voyants qui entendent la Vérité”, et le Véda, lui aussi, fut appelé Shruti, mot qui prit ensuite le sens d’“Écriture révélée”.
Dans les temps anciens, le Véda était vénéré comme un livre de Sagesse sacrée, comme un vaste ensemble de poèmes inspirés ; c’était l’œuvre des Rishis, les voyants et les sages qui reçurent en leurs esprits illuminés, plutôt qu’ils ne conçurent mentalement, la Grande Vérité universelle, éternelle et impersonnelle, qu’ils incorporèrent dans des stances révélées et efficaces : les Mantras d’inspiration et de sources divines et non-humaines. On donnait à ces sages le nom de kavi, qui servit par la suite à désigner n’importe quel poète, mais qui, à l’époque, avait aussi le sens de “voyant de la vérité”. Le Véda lui-même les désigne sous le nom de kavayah satyashrutah : “les voyants qui entendent la Vérité”, et le Véda, lui aussi, fut appelé Shruti, mot qui prit ensuite le sens d’“Écriture révélée”.Les voyants de l’Upanishad se faisaient la même idée du Véda et firent souvent appel à son autorité pour justifier les vérités qu’ils énoncèrent à leur tour ; vérités qui, par la suite, furent aussi considérées comme Shruti, comme Écriture révélée, et incluses dans le canon sacré.
Cette tradition fut perpétuée dans les Brahmanas et elle continua à se maintenir en dépit des efforts des commentateurs ritualistes, les Yajnikas, qui expliquaient tout au moyen des rites et des mythes, et malgré la division établie par les Pandits qui distinguaient entre la section des œuvres, Karmakanda, et la section de la connaissance, ou Jnânakanda, identifiant la première aux hymnes et la seconde aux Upanishads. Cet étouffement de la connaissance par les rites fut sévèrement critiqué dans l’une des Upanishads et dans la Gîtâ, pour lesquelles le Véda est avant tout le livre de la Connaissance. La Shruti, qui comprenait le Véda et les Upanishads, était même pour la connaissance spirituelle, regardée comme l’autorité suprême, infaillible.
Tout ceci n’est-il que légendes et rêveries, tradition sans fondement et absurdité ? Ou est-ce le fait que quelques rares idées élevées ont été formulées dans certains hymnes tardifs qui aurait donné naissance à cette théorie ? Les rédacteurs des Upanishads, abusés par leur imagination ou une exégèse fantaisiste, ont-ils glissé dans les Riks un sens qui ne s’y trouvait pas ? Les savants européens de notre époque insistent pour qu’il en soit ainsi et ils en ont persuadé jusqu’aux esprits de l’Inde moderne. À l’appui de cette théorie il y a le fait que les Rishis du Véda étaient non seulement des voyants mais des chantres et les prêtres du sacrifice, que leurs hymnes furent écrits pour être chantés pendant les sacrifices, qu’ils se réfèrent constamment aux rites habituels et semblent demander les objets extérieurs de ces cérémonies : la richesse, la prospérité, la victoire sur les ennemis.
Le grand commentateur, Sâyana, nous donne des Riks une interprétation ritualiste et, quand besoin est, il essaie d’une interprétation mythique ou historique ; il met très rarement en avant un sens plus élevé, bien que parfois il le laisse transparaître ou le suggère à titre de variante et comme s’il lui en coûtait de ne pouvoir donner une interprétation ritualiste ou mythique. En tout cas, il ne rejette pas l’autorité spirituelle du Véda et ne nie pas que les Riks contiennent une vérité supérieure. Cette façon d’envisager le Véda subsista jusqu’à notre époque et fut popularisée par les érudits occidentaux.
Les savants européens adoptèrent la tradition ritualiste mais rejetèrent les autres interprétations de Sâyana ; ils continuèrent à expliquer à leur manière l’étymologie des mots et à accumuler leurs significations hypothétiques des poèmes védiques auxquels ils donnèrent une nouvelle présentation souvent arbitraire et imaginaire. Ce qu’ils cherchaient surtout dans le Véda, c’étaient les débuts historiques de l’Inde, sa société, ses institutions, ses coutumes, bref, le tableau d’une civilisation ancienne. En se basant sur la différence des langues, ils imaginèrent la théorie d’une invasion aryenne venue du Nord, et l’invasion d’une Inde dravidienne, dont les Indiens eux-mêmes n’ont conservé ni souvenir, ni tradition et dont il n’existe aucun récit dans leur littérature épique ou classique. Selon cette théorie, la religion védique se réduisait à un culte des Dieux de la Nature, encombré de mythes solaires, consacré par des sacrifices et une liturgie sacrificatoire assez primitive, tant sous le rapport des idées que du contenu, et ce sont ces prières barbares qui constitueraient le Véda tant vanté, tant auréolé, tant glorifié !
Il est certain qu’on commença par adorer les Puissances du monde physique : le Soleil, la Lune, le Ciel et la Terre, le Vent, la Pluie et la Tempête, etc., les Fleuves sacrés et un certain nombre de Dieux présidant aux œuvres de la Nature. Ce sont là des traits généraux des anciens cultes en Grèce, à Rome, dans l’Inde et ailleurs. Mais dans tous ces pays, ces dieux assumèrent bientôt une fonction plus élevée, plus psychologique. Pallas Athénê qui a peut-être été à l’origine une Déesse de l’Aurore, jaillissant en flammes de la Tête de Zeus, le Dieu du Ciel (le Dyaus du Véda) eut dans la Grèce classique une fonction plus élevée et elle fut identifiée par les Romains à leur Minerve, Déesse du Savoir et de la Sagesse. De même, Saraswati, une Déesse des fleuves, devint dans l’Inde, la Déesse de la Sagesse, de la connaissance, des arts et des métiers. Toutes les divinités grecques se sont transformées dans un sens analogue : Apollon, le Dieu-Soleil, est devenu le Dieu de la Poésie et de la Prophétie ; Héphaïstos, le Dieu du Feu, devint un forgeron divin, Dieu du Travail. Dans l’Inde, la transformation s’est arrêtée à mi-chemin. Les Dieux védiques remplirent leurs fonctions psychologiques mais sans rien perdre de leurs caractères extérieurs et, pour tout ce qui leur était supérieur, firent place à un nouveau Panthéon. Ils durent s’effacer devant les divinités pouraniques qui appartenaient à l’ancien groupe des dieux, mais qui exerçaient des fonctions plus largement cosmiques : Vishnu, Rudra, Brahmâ — issus du Brihaspati védique, ou Brahmanaspati, — Shiva, Lakshmi, Durgâ. Ainsi, dans l’Inde, la métamorphose des dieux fut moins complète ; les divinités anciennes devinrent les divinités inférieures du Panthéon pouranique. Il faut en attribuer la cause à la survivance du Rig Véda dans lequel leur fonction psychologique et leur fonction extérieure coexistent avec une égale importance. Il n’y eut pas de texte ancien similaire pour préserver les traits primitifs des Dieux de la Grèce ou de Rome.
Ce changement fut évidemment provoqué par le développement culturel de ces peuples qui, progressivement, s’intellectualisèrent et furent moins absorbés par la vie physique à mesure que leur civilisation se raffinait. Ils ressentirent le besoin de découvrir dans leur religion et leurs divinités, des aspects plus délicats et plus subtils en rapport avec leurs idées et leurs goûts plus intellectuels, et de reconnaître une véritable essence spirituelle ou forme céleste justifiant l’autorité de leur religion et l’existence de leurs divinités. Mais cette disposition fut, pour la plus grande part, déterminée et approfondie par les Mystiques, lesquels ont eu une énorme influence sur les civilisations antiques. En vérité, il y eut partout une époque de mystère durant laquelle des hommes, qui surpassèrent les autres par leur savoir éminent et une connaissance plus profonde, établirent leurs pratiques, leurs rites significatifs, leurs symboles, leur science ésotérique à l’intérieur ou en marge d’une religion extérieure et primitive. Cela se fit de différentes manières, selon les pays : la Grèce eut les mystères orphiques et éleusiniens, l’Égypte et la Chaldée eurent leurs prêtres, leur science et leur magie occultes, la Perse a eu les Mages, et l’Inde, les Rishis.
Ce qui préoccupait surtout les Mystiques, c’étaient la connaissance de soi-même et une compréhension moins superficielle du monde. Ils découvrirent que dans l’homme, derrière l’apparence corporelle, il y a un moi plus profond, un être plus intime, que l’homme a pour tâche suprême de chercher et de trouver. “Connais-toi toi-même” fut leur grand précepte ; tout comme dans l’Inde, la connaissance du grand Soi, de l’Atman, devint la grande nécessité spirituelle, le but le plus élevé pour l’homme. Ils découvrirent aussi une Vérité, une Réalité sous les aspects visibles de l’univers et, poursuivre cette Vérité, s’y attacher et la réaliser fut leur grande préoccupation. Ils décelèrent dans la Nature des secrets et des pouvoirs qui n’étaient pas ceux du monde physique mais qui pouvaient procurer la domination occulte de l’univers et des choses sensibles. Systématiser cette science et ces pouvoirs occultes fut également pour eux une préoccupation majeure. Mais tout cela ne pouvait être accompli sans danger qu’au moyen d’une préparation poussée, d’une discipline ardue et d’une purification rigoureuse. Le vulgaire ne pouvait y prétendre. Si des hommes s’étaient mêlés de ces choses sans avoir passé par des épreuves et un entraînement sévères, c’eût été dangereux autant pour eux-mêmes que pour les autres. Ils auraient pu faire un mauvais usage de cette connaissance et de ces pouvoirs, les dénaturer, changer la vérité en erreur et le bien en mal. C’est pourquoi le secret le plus total fut observé et la connaissance transmise d’une façon mystérieuse, de maître à disciple. On créa un voile de symboles pour envelopper ces mystères, ainsi que des expressions compréhensibles pour les initiés mais que les autres ignoraient ou prenaient dans leur sens littéral, qui dissimulait soigneusement leur signification et leur secret véritables. Telle fut, en tous lieux, l’essence du mysticisme.
Il est de tradition dans l’Inde, depuis les temps les plus reculés que les Rishis, les voyants-poètes du Véda, furent des hommes de cette sorte, doués d’un grand savoir spirituel et occulte, inaccessible au vulgaire, et qu’ils transmirent ce savoir et ces pouvoirs au moyen d’une initiation secrète à leurs descendants et à des disciples choisis. On a supposé gratuitement que cette tradition ne reposait sur rien, qu’elle n’était qu’une superstition surgie brusquement ou formée lentement, chimérique et sans aucun fondement. Cette tradition doit pourtant en avoir un, si fragile ou si déformé qu’il soit par les légendes et les apports des siècles. Et s’il en est ainsi, alors, inévitablement, les voyants-poètes ont dû livrer dans leurs écrits une parcelle de leur savoir secret, de leur science mystique ; et si cet élément s’y trouve, si bien caché qu’il soit sous un vocabulaire occulte ou sous la technique des symboles, on doit pouvoir dans une certaine mesure, le découvrir. Il est vrai qu’un langage archaïque, des mots désuets — Yaska en dénombre plus de quatre cents dont le sens lui échappe —, mots dont la signification est encore obscurcie par une diction souvent difficile et surannée, la méconnaissance des symboles dont les mystiques n’ont pas divulgué le glossaire, ont rendu le sens du Véda inintelligible aux générations récentes. Même au temps des Upanishads, les chercheurs spirituels de l’époque durent recourir à l’initiation et à la méditation pour pénétrer ces arcanes, tandis que par la suite les savants déroutés et livrés aux suppositions durent forger mentalement des interprétations ou tout expliquer au moyen des mythes et des légendes tirés des Brahmanas, qui sont eux-mêmes souvent symboliques et obscurs.
Pourtant faire cette découverte sera le seul moyen de connaître la signification et la valeur véritables du Véda. Nous devons prendre au sérieux les allusions de Yaska, admettre avec les Rishis que les Védas contiennent la “Sagesse des voyants”, sont les “paroles des voyants” et rechercher tout ce qui peut nous servir de guide pour comprendre cette sagesse antique. Sinon le Véda restera toujours un Livre scellé — les grammairiens, les étymologistes, les hypothèses des savants, seront impuissants à ouvrir pour nous la chambre close. Car c’est un fait que la tradition d’un sens secret et d’une sagesse mystique contenus dans les Riks du Véda, est aussi ancienne que le Véda lui-même. Les Rishis védiques pensaient que leurs Mantras jaillissaient des plans supérieurs et cachés de la conscience et contenaient ce savoir secret. Les paroles du Véda ne pouvaient être comprises dans leur sens véritable que par un homme qui était lui-même un voyant ou un mystique, tandis qu’elles dérobaient aux autres leur savoir caché.
Dans l’un des hymnes de Vâmadêva, du quatrième Mandala (IV, 3, 16), le Rishi se désigne lui-même comme un illuminé exprimant par sa pensée et son discours, des paroles de bon conseil, des “paroles secrètes” (ninya vacâmsi) — « paroles de poète inspiré qui livrent leur signification intérieure à l’inspiré » (kâvyâni kavaye nivachanâ). Le Rishi Dîrghatamas dit que les Riks, les Mantras du Véda, existent dans « un éther suprême, impérissable et immuable où se trouvent tous les dieux » et il ajoute : « que peut faire avec le Rik celui qui ne connaît pas Cela ? » (I, 164, 39). Il fait ensuite allusion aux quatre plans d’où jaillit la parole. Trois d’entre eux sont enfouis dans le silence, tandis que le quatrième est humain et c’est en lui que se situe le langage ordinaire ; mais les paroles et la pensée du Véda appartiennent aux plans supérieurs (I, 164, 46). Ailleurs, dans les Riks, la Parole védique est désignée (X, 71) comme la Parole suprême, le discours le plus élevé, le meilleur, le plus parfait. Elle est cachée dans les régions secrètes d’où elle sourd et se manifeste. Elle a pénétré dans l’esprit des voyants de la Vérité, les Rishis, et on la découvre en se conformant à leurs paroles. Mais tous ne peuvent pénétrer son secret. Ceux qui ne connaissent pas le sens intérieur sont pareils à des hommes qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des oreilles et n’entendent pas ; la Parole ne se livre qu’à un homme parmi d’autres, qu’elle désire comme une épouse magnifiquement vêtue, offrant son corps à son mari. D’autres qui sont incapables de boire avec persévérance le lait de la Parole de la Vache védique, se comportent avec elle comme si elle ne donnait pas de lait et pour eux la Parole est semblable à un arbre sans fleurs et sans fruits.
Il s’ensuit sans aucun doute que déjà à l’époque où l’on comprenait le Véda, les Riks étaient censés recéler un sens secret qui n’était pas accessible à tous. Il y avait un savoir occulte et spirituel dans les hymnes sacrés et ce n’est qu’en possédant ce savoir, est-il dit, qu’on peut connaître la vérité et s’élever à une existence supérieure. Cette croyance n’est pas de tradition récente, mais elle a été soutenue par tous et, évidemment, par quelques-uns des plus grands Rishis, comme Dîrghatamas et Vâmadéva. Ainsi, la tradition existait et elle se maintint après les temps védiques. Yaska parle de plusieurs écoles d’interprétation du Véda. Il y eut l’interprétation sacrificatoire et ritualiste, l’explication historique ou plutôt mythologique, l’explication donnée par les grammairiens et les étymologistes, par les logiciens, et une interprétation spirituelle. Yaska lui-même déclare que la connaissance est triple, que par conséquent les hymnes védiques ont une triple signification : qu’il y a une connaissance sacrificatoire et ritualiste, une connaissance des dieux et enfin une connaissance spirituelle, mais la dernière nommée est la seule vraie et, lorsqu’on y parvient, on peut négliger et éliminer les autres.
C’est ce sens spirituel qui délivre. Les autres sont extérieurs et secondaires. Il est dit aussi que : “les Rishis ont vu la Vérité, la vraie loi des choses, directement, par une vision intérieure”. Ensuite le savoir et le sens intérieur du Véda furent à peu près perdus et les Rishis qui le connaissaient encore durent le sauver en le transmettant par initiation à des disciples ; en dernier lieu, il fallut user de moyens extérieurs et mentaux, tels que le Nirukta et autres Védângas, pour en retrouver le sens. Mais même alors, ajoute Yaska, « le véritable sens du Véda peut être retrouvé directement par la méditation et l’ascèse (tapasya), ceux qui peuvent recourir à ces moyens n’ont pas besoin d’une aide extérieure pour parvenir à cette connaissance ». Ceci aussi est suffisamment clair et positif.
La tradition selon laquelle on trouve dans le Véda un élément mystique qui est la source de la civilisation indienne, de sa religion, de sa culture, est plus en accord avec les faits historiques que le rejet méprisant de cette idée par les Occidentaux. Les érudits européens du XIXe siècle, écrivant à une époque de rationalisme matérialiste, se figuraient que la race débutait dans l’histoire avec un état de barbarie ou semi-barbarie primitive, une vie sociale et une religion grossières, remplies de superstitions, d’où la tirait l’évolution des institutions, des mœurs et habitudes propres à une civilisation de progrès matériels et grâce au perfectionnement de l’intellect et de la raison, de l’art, de la philosophie, de la science et d’une intelligence plus claire, plus logique et aussi plus pratique. L’ancienne conception que l’on avait du Véda ne cadrait pas avec cette description. On le regardait plutôt comme un résidu de vieilles croyances, comme une aberration des premiers âges. Mais nous pouvons, à présent, nous faire une idée plus exacte de l’évolution de la race. Les civilisations anciennes les plus frustes contenaient en elles les éléments de leur développement ultérieur, mais leurs premiers sages ne furent ni des savants, ni des philosophes, ni des hommes doués d’une raison très intellectuelle. C’étaient des mystiques et même des hommes de mystères, des occultistes, des chercheurs de vérités religieuses ; ils étaient en quête d’une vérité cachée sous les choses et non d’un savoir extérieur. Les savants et les philosophes ne vinrent qu’après ; — ils furent précédés par les mystiques et souvent certains d’entre eux, comme Pythagore et Platon, furent, jusqu’à un certain point, des mystiques eux-mêmes ou bien empruntèrent aux mystiques maintes idées.
Dans l’Inde, la philosophie doit son origine aux recherches des mystiques. Elle maintint et développa leurs buts spirituels et conserva quelque chose de leur méthode dans les disciplines spirituelles plus récentes, ainsi que dans le Yoga. La tradition védique, le fait que le Véda contient un élément mystique, s’adapte parfaitement à cette vérité historique et s’insère dans l’histoire de la culture indienne. La tradition selon laquelle le Véda est la base même de la civilisation indienne et non simplement une barbare liturgie de sacrifices, est plus qu’une tradition, c’est véritablement un fait historique.
Mais, même si les hymnes portent la marque d’une haute connaissance spirituelle et des passages remplis d’idées élevées, on pourrait supposer qu’ils sont en très petit nombre, tandis que tout le reste se bornerait à une liturgie de sacrifice, à des formules de prières et des louanges destinées à inciter les dieux à répandre sur les sacrificateurs des biens matériels tels qu’abondance de vaches, de chevaux, de soldats, de nourriture, de richesses de toutes sortes, la protection, la victoire dans le combat ; ou bien à faire tomber la pluie, dégager le soleil des nuages ou de l’étreinte de la nuit, permettre aux sept rivières de couler librement, défendre le bétail contre les Dasyus (ou les Dravidiens) et faire obtenir ici-bas toutes les faveurs qui semblent être l’objet de ce culte rituel. Les Rishis seraient alors des hommes qui détenaient un certain savoir spirituel ou mystique mais qui étaient aussi dominés par toutes les idées populaires de leur temps. Ils auraient marié intimement ces deux éléments dans leurs hymnes. Cela expliquerait, du moins en partie, l’obscurité et le méli-mélo plutôt étrange et parfois absurde que l’interprétation traditionnelle nous présente. Mais si, d’un autre côté, nous voyons apparaître clairement un ensemble considérable de pensées élevées et une grande quantité de vers et d’hymnes qui ne peuvent avoir qu’un caractère et un sens mystiques ; si, pour finir, nous nous apercevons que les détails ritualistes et extérieurs prennent fréquemment l’apparence de symboles semblables à ceux qu’utilisent toujours les mystiques, et si l’on trouve des indications nombreuses et claires et même quelques déclarations explicites sur cette signification dans les hymnes eux-mêmes, alors tout change. Nous sommes en présence d’un grand ouvrage écrit par des mystiques, possédant une double signification, l’une exotérique l’autre ésotérique, les symboles eux-mêmes ont un sens qui les fait participer à la signification ésotérique, ils sont un élément de l’enseignement et du savoir secrets.
L’ensemble du Rig Véda, à l’exception peut-être d’un petit nombre d’hymnes, devient par son sens caché un Écrit sacré de ce genre. En même temps il n’est pas nécessaire que le sens exotérique soit simplement un masque. Les Riks ont peut-être été considérés par leurs auteurs comme des paroles dont l’efficacité s’appliquait non seulement aux choses intérieures mais aussi aux choses extérieures. Un ouvrage purement spirituel ne s’occuperait que de significations spirituelles mais les anciens mystiques étaient ce que nous appellerions maintenant des occultistes, des hommes qui croyaient que les moyens intérieurs pouvaient avoir des résultats aussi bien extérieurs qu’intérieurs, que la pensée et les mots pouvaient être utilisés pour n’importe quelle réalisation, humaine ou divine, selon l’expression familière du Véda lui-même.
Mais où gît dans le Véda ce corps de doctrines ésotériques ? Il ne se montrera que si nous donnons un sens constant et direct aux mots et aux formules employés par les Rishis, surtout aux mots-clefs, qui supportent comme des clefs de voûte toute la structure de leur doctrine. Un de ces plus grands mots est Ritam, la Vérité : la Vérité était le but suprême que poursuivaient les mystiques, une vérité spirituelle ou intérieure, la vérité qui est en nous, la vérité des choses, la vérité du monde et des dieux, la vérité qui est cachée derrière tout ce que nous sommes et derrière tout ce que les choses sont. Dans l’interprétation ritualiste ce maître-mot de la science védique a été interprété de toutes les façons, selon la convenance ou la fantaisie du commentateur. Il a pris ainsi le sens de vérité, de “sacrifice”, d’“eau”, de “celui qui est parti”, et même de “nourriture”, sans parler de bien d’autres significations. Si nous les acceptons, tout ce que nous dirons à propos du Véda restera incertain. Mais donnons à ce mot le même sens supérieur et aussitôt un résultat étonnant mais clair apparaît.
Si nous procédons de même avec les autres termes importants du Véda, si nous conservons leur sens ordinaire, naturel et direct, constamment et congrûment, sans travestir leur signification et sans en faire des expressions purement rituelles ; si nous accordons à certains mots importants comme shravas, kratu le sens psychologique dont ils sont susceptibles et qu’ils ont, sans aucun doute, dans certains passages (tel celui où le Véda désigne Agni sous le nom de kratu hridi), alors le résultat devient on ne peut plus clair, plus important et plus convaincant. Si, de plus, nous suivons les indications qui abondent, comme les déclarations explicites des Rishis sur le sens intérieur de leurs symboles, et interprétons de la même façon les légendes et les personnages significatifs sur lesquels ils reviennent sans cesse : la conquête de Vritra, la bataille avec les Vritras, leur puissance, la reconquête du Soleil, des Eaux, des Vaches sur les Panis et autres Dasyus, — alors le Rig Véda tout entier se révèle comme un corps de doctrines et de pratiques ésotériques, occultes, spirituelles, que des mystiques de n’importe quel pays ancien auraient pu constituer mais qui, en fait, ne survit pour nous que dans le Véda. Il y est volontairement caché sous un voile mais celui-ci n’est pas aussi épais que nous l’imaginions au premier abord. Nous n’avons qu’à nous servir de nos yeux et le voile disparaît : la substance de la Parole, la Vérité surgissent devant nous.
Bien des vers et même des hymnes entiers du Véda ont visiblement une portée mystique. Ils sont, de façon évidente, une forme occulte du discours et possèdent un sens intérieur. Quand le voyant parle d’Agni comme du “gardien lumineux de la Vérité qui resplendit dans sa propre demeure”, ou de Mitra et de Varuna, ou d’autres dieux qui sont en “contact avec la Vérité et qui la font s’épanouir” ou qui sont “nés dans la Vérité”, ce sont là les paroles d’un poète mystique qui pense à cette Vérité intérieure que les choses dissimulent et que les premiers sages recherchèrent. Il ne pense pas à la Puissance de la Nature qui préside à l’élément extérieur du feu ou au feu du sacrifice rituélique. Ou bien il parle de Saraswati comme d’une déesse qui fait sourdre les paroles de Vérité, qui éveille aux pensées justes, qui est riche de pensée : Saraswati ouvre à la conscience ou nous rend conscients du “grand océan et illumine toutes nos pensées”. Ce n’est sûrement pas la Déesse des fleuves qu’il glorifie ainsi dans son hymne mais la Puissance ou, si vous voulez le fleuve d’inspiration, la parole de Vérité qui illumine nos pensées, et qui édifie en nous cette Vérité comme une connaissance intérieure.
Les dieux ne laissent pas de garder leurs fonctions psychologiques ; le sacrifice est le symbole extérieur d’un travail intérieur, c’est un échange intime entre les dieux et les hommes. L’homme donne ce qu’il a, les dieux lui donnent, en récompense, les chevaux du pouvoir, les troupeaux de lumière, les héros de la Force qui forment son cortège et gagnent pour lui la victoire dans le combat contre les hôtes de l’obscurité : Vritras, Dasyus, Panis. Quand le Rishi dit : “Rends-nous conscients grâce aux chevaux de la guerre, ou grâce à la Parole de la Puissance qui dépasse les hommes”, ses mots ont une signification mystique, ou bien ils n’ont absolument aucun sens cohérent.
On trouve beaucoup de poèmes mystiques et même des hymnes entiers qui déchirent le voile des images extérieures du sacrifice qui recouvrait le sens réel du Véda. “La Pensée — dit le Rishi — a nourri pour nous les choses humaines au sein de l’Immortalité ; dans les Cieux supérieurs elle est la vache d’abondance qui donne le lait de la richesse sous toutes ses formes”, les multiples sortes de richesses : vaches, chevaux et le reste, pour lesquelles prie le sacrificateur. Manifestement, il ne s’agit pas ici d’une richesse matérielle, mais de ce quelque chose que la Pensée incorporée dans le Mantra peut octroyer et c’est l’effet de cette même Pensée qui nourrit les choses humaines au sein de l’Immortalité dans les Cieux supérieurs.
Il est fait allusion à un processus de divinisation, à l’obtention de richesses importantes et éclatantes, de trésors gagnés auprès des dieux grâce à l’œuvre intérieure du sacrifice, en termes nécessairement couverts mais qui, cependant, pour ceux qui savent lire ces mots secrets : ninyâ vachâmsi, sont suffisamment expressifs, kavaye nivachanâ. Ainsi, la Nuit et l’Aube, sœurs éternelles, sont pareilles à “des femmes qui tissent joyeusement la trame de nos travaux accomplis sous la forme d’un sacrifice”. Ce sont, là encore, des mots qui ont une forme et un sens mystiques car on pourrait difficilement établir avec plus de netteté le caractère psychologique du sacrifice, la signification réelle de la Vache, des richesses que l’on recherche et de la plénitude du Grand Trésor.
Dans la nécessité de masquer leur intention avec des symboles et des paroles symboliques — car il fallait observer la loi du secret — les Rishis eurent recours à des termes ayant un double sens, dessein facile à réaliser en sanskrit, où un mot a souvent des sens différents, mais difficile à reprendre en anglais ou même souvent impossible. C’est ainsi que le mot désignant la vache, go, signifie aussi lumière ou rayon de lumière — sens qu’on retrouve dans le nom de certains Rishis : Gotama (le plus rayonnant), Gavishthira (ferme dans la lumière). Les vaches du Véda devinrent les Troupeaux du Soleil, familiers aux mythes et aux mystères grecs, les Rayons du Soleil de la Vérité, de la Lumière et de la Connaissance : cette acception qui se dégage de certains passages peut être retenue congrûment partout où elle fournit un sens cohérent.
Le mot ghrita est l’équivalent de ghee ou beurre clarifié, un des principaux éléments du rite sacrificatoire, mais ghrita peut aussi signifier lumière, avec la racine ghri, briller, et c’est avec ce sens-là qu’il est employé dans de nombreux passages. Ainsi il est dit que les chevaux d’Indra sont ruisselants de lumière, ghrita-snu [1]. Cela ne signifie certainement pas que le beurre clarifié suintait de leur corps pendant leur course, bien que tel soit le sens de cette épithète lorsqu’elle est appliquée au grain que les chevaux d’Indra sont invités à manger quand ils viennent au sacrifice. Il est évident que ce sens de lumière accompagne celui de beurre clarifié dans le symbolisme du sacrifice. La pensée ou le mot exprimant la pensée est comparée au pur beurre clarifié. On retrouve des expressions comme dhiyam ghritâchim, la pensée ou compréhension lumineuse. Dans un des hymnes, il y a un curieux passage qui invoque le Feu comme prêtre du sacrifice et lui demande d’imbiber l’offrande avec un esprit répandant le ghrita (ghritaprusha manasa) et de manifester ainsi les séjours (“cieux” ou “plans”), chacun des trois mondes spirituels et les dieux [2].
Mais qu’est-ce qu’un esprit qui répand le “beurre clarifié” et comment un prêtre, en répandant du beurre clarifié, peut-il manifester l’existence des dieux et des Trois mondes spirituels ? Qu’on admette l’acception mystique et ésotérique et le sens devient clair. Le Rishi veut parler de l’esprit qui répand la lumière, de la clarification opérée par un esprit éclairé, illuminé ; il ne s’agit pas d’un prêtre humain ni du feu du sacrifice, mais de la Flamme intérieure, de la Volonté mystique du voyant, kavi kratu, qui peut certainement manifester de cette façon les Dieux, les mondes et tous les plans de l’existence.
Les Rishis, il faut le rappeler, étaient des voyants autant que des sages ; ils étaient des visionnaires qui, dans leur méditation, voyaient les choses sous forme d’images, souvent symboliques, et ces images pouvaient accompagner ou précéder leur expérience, la rendre concrète, lui donner un aspect occulte ou l’annoncer. Ainsi, il n’est nullement impossible qu’ils voyaient simultanément l’expérience intérieure et, dans une image, sa réalisation symbolique ; le flot de lumière purifiante et le prêtre divin qui répand ce beurre clarifié sur celui qui s’offre intérieurement en sacrifice au cours de l’expérience. Cela peut paraître étrange à un Occidental, mais pour un Hindou, habitué aux traditions de l’Inde ou capable de méditation et de vision occultes, c’est parfaitement intelligible.
Les mystiques furent et sont naturellement des symbolistes. Ils savent considérer comme symboles de vérités et de réalisations intérieures toutes les choses et événements du monde physique, leur individualité, les faits extérieurs de leur existence et tout ce qui les entoure. C’est ce qui rend aisée leur identification, autrement dit l’association de la chose et de son symbole, et possible son habitude.
D’autres mots et symboles importants du Véda incitent à une interprétation analogue de leur sens. Comme la vache védique est le symbole de la lumière, le cheval védique est le symbole du pouvoir, de la force spirituelle, de la force de tapasya. Quand le Rishi demande à Agni de lui envoyer en don des chevaux précédés par des vaches, il ne demande pas réellement un certain nombre de chevaux constituant le gros du cadeau et augmentés de quelques vaches : il demande un vaste pouvoir spirituel conduit par la lumière ou, ainsi que nous pouvons le traduire, “avec le Rayon-Vache marchant en avant” [3]. De même, un des hymnes célèbre la reconquête, sur les Panis, de la masse des rayons (les vaches, les troupeaux lumineux — gavyam). Un autre hymne demande à Agni une masse ou abondance ou pouvoir de chevaux — ashvyam. De même également, le Rishi demande parfois les héros ou les guerriers comme escorte et une autre fois, dans un langage plus abstrait et sans aucun symbole, il demande la force totale du héros — suvîryam. Ailleurs, il combine le symbole avec la chose. De même encore, les Rishis sollicitent un fils ou des fils, des descendants — apatyam — comme un élément de la richesse qu’ils prient les Dieux de leur accorder. Ici aussi un sens ésotérique peut être perçu, car dans certains passages la naissance d’un fils est le clair symbole d’une naissance intérieure. Agni lui-même est notre fils, l’enfant de nos œuvres, l’enfant qui est, comme le Feu Universel, le père de ses pères. Et c’est en entreprenant des choses qui portent de beaux fruits que nous créons ou découvrons un chemin vers le monde supérieur de la Vérité.
L’eau est aussi utilisée comme symbole. Le Véda parle de l’océan d’inconscience, salîlam apraketam, dans lequel la Divinité est plongée et d’où elle surgit dans toute sa grandeur. Il parle aussi du grand océan — maho arnas, les eaux supérieures que Saraswati, suivant un des hymnes, rend conscientes pour nous ou dont elle nous rend conscients par le rayon de l’intuition — prachetayati ketunâ.
Les sept rivières semblent être les rivières de l’Inde du Nord, mais le Véda parle des sept puissantes rivières célestes qui tombent du ciel — ce sont les eaux de la connaissance, les eaux qui connaissent la vérité — ritajña — et quand elles sont lâchées, elles nous montrent la voie des cieux supérieurs. Parasara, lui aussi, parle de la Connaissance et de la Vie universelle “dans la demeure des eaux”. Indra délivre la pluie en tuant Vritra, mais cette pluie est aussi la pluie du Ciel et permet aux fleuves de couler. Ainsi, la légende de la délivrance des eaux, qui occupe une si grande place dans le Véda, revêt l’aspect d’un mythe symbolique. En même temps apparaît une autre légende : celle de la découverte et de la délivrance, dans la caverne profonde de la montagne, du Soleil, des vaches ou des troupeaux du Soleil (ou du monde du Soleil, svar) par les Dieux et les Angiras Rishis.
Le symbole du Soleil est constamment associé à la Lumière et à la Vérité supérieures. C’est au sein d’une vérité cachée par une vérité inférieure que sont dételés les chevaux du Soleil. C’est au Soleil, dans son rayonnement suprême, que le grand Mantra, la Gâyatrî, demande de stimuler nos pensées. Ainsi, dans le Véda, des ennemis sont appelés des voleurs, dasyus, qui dérobent les vaches, ou Vritras, et on les considère comme des ennemis des hommes au sens ordinaire du mot, mais Vritra est un démon qui recouvre et retient la Lumière et les eaux — et les Vritras sont les forces qui accomplissent cette fonction. Les dasyus, voleurs et exterminateurs, sont les puissances des ténèbres, les adversaires de ceux qui cherchent la Lumière et la Vérité. Il y a toujours des indications qui nous conduisent du sens extérieur et exotérique au sens intérieur et ésotérique.
En connexion avec le symbole du Soleil, on peut citer ici un poème remarquable et hautement significatif d’un hymne du cinquième Mandala. Il montre non seulement le profond symbolisme mystique des poètes védiques mais aussi comment les rédacteurs des Upanishads comprenaient le Rig Véda et il justifie leur croyance en la connaissance inspirée de leurs prédécesseurs. « Il y a une Vérité cachée par une (autre) Vérité — dit le passage du Véda — où ils détèlent les chevaux du Soleil ; où les mille chevaux se tenaient assemblés, là était cet Un [4] ; j’ai vu la plus grande, la meilleure, la plus glorieuse forme des dieux » [5]. Remarquez comment le voyant de l’Upanishad traduit cette pensée ou cette expérience mystique dans son propre style plus récent : en conservant le symbole central du Soleil mais sans intention secrète. Voici le passage de l’Upanishad : « Le visage de la vérité est caché par un couvercle d’or. Ô Pushan (nourricier), toi ôtes-le pour (permettre) la vision de la loi de la Vérité [6]. Ô Pushan (nourricier), toi qui es le seul voyant. Ô Yama, Ô Soleil, Ô Enfant du Père des êtres, disposes et rassembles tes rayons ; je vois la Lumière qui est la plus belle, la plus favorable de Tes formes. Celui qui est ce Purusha, je suis Lui ». Le couvercle d’or signifie la même chose que la vérité inférieure et couvrante, ritam, dont parle le poème védique. “La meilleure forme des Dieux” est l’équivalent de “la plus belle forme du Soleil” : c’est la Lumière suprême qui est autre et plus grande que toute lumière extérieure. La grande formule de l’Upanishad : “Je suis Lui” correspond au “Cet Un” (tad ekam) du poème védique. La réunion des mille chevaux (les rayons du Soleil, dit Sayana, est évidemment le sens de l’expression) se retrouve dans la prière au soleil “qu’il dispose et rassemble ses rayons” afin qu’on puisse voir la forme suprême. Le Soleil, dans ces deux passages, comme c’est constamment le cas dans le Véda (et fréquemment dans l’Upanishad), est la Divinité de la Vérité et de la Connaissance suprême et ses rayons sont la lumière qui émane de cette suprême Vérité ou Connaissance. Il est clair, d’après cet exemple — et il y en a d’autres — que le voyant de l’Upanishad avait une notion plus exacte de la signification de l’ancien Véda que le commentateur ritualiste du moyen âge avec son érudition gigantesque [7] mais cependant beaucoup plus exacte que l’opinion des savants européens, dont l’esprit moderne est si différent.
Il y a certains termes psychologiques qui doivent être pris congrûment dans leur vrai sens si nous voulons découvrir leur signification intérieure ou ésotérique. En dehors du mot Vérité, Ritam nous devons toujours prendre au sens de pensée le mot dhî qui revient à tout instant dans les hymnes. Tel est le sens naturel de dhî qui correspond au mot plus récent de Buddhi ; il signifie pensée, compréhension, intelligence. Au pluriel, pensées se dit : dhiyah. Dans l’interprétation habituelle, on lui donne toutes sortes significations : “eau”, “travail”, “sacrifice”, “nourriture”, aussi bien que Pensée. Mais, dans notre investigation, nous devons le considérer congrûment dans son sens habituel et naturel, et voir ce qui en résulte.
Le mot Ketu signifie généralement rayon, mais il a aussi le sens d’intellect, de jugement ou de perception intellectuelle. Si nous comparons les passages du Véda dans lesquels on le rencontre, nous pouvons en conclure qu’il a signifié : rayon de perception ou intuition : ainsi, c’est par intuition, ketunâ, que Saraswatî nous rend conscients de l’existence des grandes eaux. Telle est aussi probablement la signification des rayons qui viennent de la Puissance suprême au-dessus de nous et se dirigent vers la terre. Les intuitions de la connaissance sont les rayons du Soleil de la Vérité et de la Lumière. Le sens habituel du mot kratu est travail ou sacrifice mais il signifie aussi intelligence, puissance ou résolution et en particulier la force d’intelligence qui détermine l’acte de la volonté. C’est avec ce dernier sens que nous pouvons l’interpréter dans l’expression ésotérique du Véda. Agni est la volonté du voyant, kavi-kratu, il est la “volonté du fond du cœur”, kratu hridi.
Enfin, le mot shravas, qui est constamment employé dans le Véda, signifie renommée ; les commentateurs lui donnent aussi le sens de nourriture, mais ces sens ne conviennent pas à tous les passages du texte et manquent en général d’à-propos et de force appropriée. Mais la racine de shravas est shru : entendre. Shravas est employé avec le sens d’oreille ou d’hymne et de prière — sens accepté par Sâyana — et nous pouvons en déduire que le mot signifie aussi “chose entendue” ou la connaissance qui nous est transmise par l’audition. Les Rishis se désignent eux-mêmes comme ceux qui entendent la Vérité, satyashrutah, et la connaissance reçue par cette audition se nomme Shruti. C’est cette acception de l’inspiration ou de connaissance inspirée qui doit être gardée dans la signification ésotérique du Véda et dans ce cas nous constaterons qu’elle s’adapte au texte avec une parfaite cohérence. Ainsi lorsque le Rishi parle de shravâmsi pour désigner ce qui monte vers le Ciel ou ce qui en descend vers nous, cela ne peut s’appliquer à la nourriture ni à la renommée, mais l’expression est parfaitement adéquate et significative s’il veut parler de l’inspiration qui s’élève vers la vérité suprême ou qui nous apporte, à nous, la Vérité.
Telle est la méthode qu’il convient d’appliquer d’un bout à l’autre, mais nous ne pouvons poursuivre plus avant ce sujet ici. Dans les brèves limites de cette introduction, ces quelques indications doivent suffire, elles ont pour but de donner au lecteur un premier aperçu de la méthode ésotérique pour l’interprétation du Véda.
Mais alors quelle est, au juste, la signification secrète, le sens ésotérique que révèle cette manière de comprendre le Véda ? Ce qu’on doit attendre de la recherche de n’importe quel mystique et aussi ce que l’on peut augurer du développement de la culture indienne, une première forme de la vérité spirituelle, qui atteint son apogée dans les Upanishads. La connaissance secrète contenue dans le Véda est la graine qui se développera plus tard dans les Upanishads, le Védânta, la pensée autour de laquelle est centrée la recherche de la Vérité, de la Lumière, de l’Immortalité. Il y a une Vérité plus profonde et plus élevée que la vérité de l’existence extérieure, une Lumière plus grande et plus élevée que la lumière de la compréhension humaine, qui vient de la révélation et de l’inspiration, et une immortalité vers laquelle l’âme doit s’élever. Nous devons frayer notre chemin dans cette direction afin d’entrer en contact avec cette Vérité et cette Immortalité, sapanta ritam amritam (I, 68, 2) pour naître dans la vérité, nous épanouir en elle, nous hausser en esprit dans le monde de la Vérité et y vivre. Agir ainsi, c’est s’unir à la Divinité et passer de la mortalité à l’immortalité. Tel est l’enseignement primordial et essentiel des mystiques védiques.
Les Platoniciens, développant la doctrine qu’ils tenaient des premiers mystiques, soutenaient que nous sommes, dans notre vie, en relation avec deux mondes : le monde de la vérité suprême que nous pouvons appeler le monde spirituel, et celui dans lequel nous vivons, le monde de l’âme incarnée qui émane du monde supérieur mais qui se dégrade en une vérité et une conscience inférieures. Les mystiques védiques ont soutenu cette doctrine sous une forme plus concrète et plus pragmatique, car ils avaient fait l’expérience de ces deux mondes. Il y a pour eux la vérité inférieure de ce monde, mêlée de beaucoup de fausseté et d’erreur, anritasya bhûreh (VII, 60, 5) et il y a un monde, ou demeure, de la Vérité, sadanam ritasya (I, 164, 47 et IV, 21, 3), la Vérité, la Rectitude, l’Immensité, satyam, ritam, brihat (Atharva, XX, 1. I) où tout est conscience de la Vérité, ritachit (IV, 3, 4). Il y a beaucoup de mondes intermédiaires jusqu’aux Trois Cieux et leurs lumières, mais ce monde-là est celui de la plus grande lumière — le monde du Soleil et de la Vérité, svar, ou le grand Ciel. Nous devons découvrir le chemin qui mène à ce grand Ciel, le chemin de la Vérité, ritasya panthâ (III, 12, 7 et VII, 66, 3), ou, comme on le nomme parfois, la voie des dieux. Telle est la seconde doctrine mystique.
La troisième enseigne que notre vie est un combat entre les puissances de la Lumière et de la Vérité — les Dieux qui sont les Immortels — et les Puissances des Ténèbres. Celles-ci portent des noms divers, tels Vritra et Vritras, Vala et les Panis, les Dasyus et leurs rois. Nous devons appeler à notre secours les Dieux pour détruire ces puissances de Ténèbres qui nous cachent la Lumière ou nous la dérobent, qui entravent le cours des fleuves de la Vérité, ritasya dhârâh (V, 12, 2 et VII, 43, 4), les fleuves du Ciel, et qui empêchent de toutes les manières possibles, l’ascension de l’âme. Nous devons invoquer les Dieux par un sacrifice intérieur et, par la Parole, les faire descendre en nous — tel est le pouvoir particulier du Mantra —, leur offrir les dons du sacrifice et ainsi, s’assurer leurs propres dons afin que nous puissions de cette manière construire la voie de notre ascension et atteindre le but. Les éléments du sacrifice extérieur prescrit par le Véda sont utilisés comme symboles du sacrifice intérieur et de l’offrande de nous-mêmes ; nous donnons ce que nous sommes et ce que nous avons afin que les richesses de la Vérité et de la Lumière divines puissent pénétrer dans notre vie et devenir les éléments de notre naissance intérieure dans la Vérité : une pensée droite, un jugement droit, une action droite doivent actualiser en nous ce qui constitue la pensée, l’impulsion et l’action de cette Vérité supérieure, ritasya preshâ, ritasya dhîti (I, 68, 3) et de cette façon nous devons nous dresser dans cette Vérité. Notre sacrifice est analogue à un voyage, à un pèlerinage et à un combat — un voyage vers les Dieux, et nous le faisons en compagnie d’Agni, la Flamme intérieure, qui est notre éclaireur et notre guide. Les choses humaines sont élevées à l’être immortel par le Feu Mystique, dans le Grand Ciel, et les choses divines s’abaissent jusqu’à nous et en nous. De même que la doctrine du Rig Véda contient en germe l’enseignement du Védânta, de même ses pratiques et sa discipline intérieure sont à l’origine des pratiques et de la discipline ultérieures du Yoga.
Enfin, au sommet de l’enseignement des mystiques védiques se situe le secret de la Réalité unique, ekam sat (I, 164, 46) ou tad ekam (X, 129, 20) qui devint la Parole essentielle des Upanishads. Les Dieux, les puissances de Lumière et de Vérité sont les puissances et les noms de la Réalité unique ; chaque Dieu est à lui seul tous les dieux et les absorbe. Il y a une seule Vérité, tat satyam (III, 39, 5 et IV, 54, 4, aussi VIII, 45, 27) et une seule félicité au niveau desquelles nous devons nous élever. Dans le Véda tout cela transparaît le plus souvent à travers un voile. Il y a encore bien d’autres choses mais ceci est le cœur même de la doctrine. Cette interprétation que nous avons fait ressortir a eu un premier et assez long exposé dans une suite d’articles publiés, il y a trente-cinq ans, sous le titre Le Secret du Véda. Écrit au fur et à mesure que la théorie était en plein développement, il était loin d’épuiser le sujet suivant un plan préconçu et bien ordonné, et comme il n’a pas paru sous forme de livre il n’est pas encore accessible à la masse des lecteurs. À cette occasion nous avions donné du Rig Veda, la traduction d’un certain nombre d’hymnes, traduction qui était plutôt une interprétation et que précédait une introduction explicative concernant la “Doctrine des Mystiques”. Par après, nous avions envisagé une traduction complète et très fidèle de tous les hymnes à Agni qui se trouvent dans les dix mandalas. Mais pour établir sur une base rigoureuse les conclusions de l’hypothèse, il eût été nécessaire de préparer une édition du Rig Véda ou d’une grande partie de celui-ci avec un mot à mot en sanskrit et en anglais ainsi que des notes concernant les points importants, et justifiant l’interprétation des vocables isolés ou de stances entières, le tout suivi d’appendices détaillés pour fixer le sens des mots-clefs tels que ritam, shravas, kratu, ketu, etc. qui sont essentiels pour l’interprétation ésotérique. Ce projet fut envisagé, mais dans l’intervalle survinrent des difficultés assez grandes et durables et il fallut renoncer à une entreprise aussi considérable (8).
► Aurobindo Ghose, in : Approches de l’Inde : Tradition et incidences, 1949.
(Traduit par F. Berys et R. Allar et révisé par l’auteur)
1. Sayana qui, dans plusieurs passages, donne à ghrita le sens de lumière, le rend toutefois ici par eau. Il semble penser que les chevaux divins étaient très fatigués et transpiraient abondamment. Un naturaliste pourrait soutenir que puisque Indra est un Dieu du ciel, le poète primitif pouvait très bien croire que la pluie était la transpiration des chevaux d’Indra.
2. Telle est l’interprétation que donne Sâyana de ce passage et elle ressort directement des termes du texte.
3. Comparez avec l’expression qui désigne les Aryens, le noble peuple conduit par la lumière, jyotir agrâ.
4. Ou bien : Cela (la Vérité suprême) était un.
5. Ou bien cela signifie : “J’ai vu les plus grandes (les meilleures) formes des Dieux”.
6. Ou, pour la Loi de la Vérité, pour la vision.
7. Il s’agit de Sâyana (NDT).
8. Ce texte constitue l’importante introduction aux Hymns to the Mystic Fire, extraits du Rig Veda, traduits par Shri Aurobindo et parus en 1946 (Shri Aurobindo Ashram, Pondichéry).
***
♦ nota bene : les manuscrits inédits sur les Védas ont été rassemblés en 2016 dans le volume 16 des Œuvres complètes : Vedic and Philological Studies.

 Le Rishi ou visionnaire védique
Le Rishi ou visionnaire védiqueLe sens rituel et mythologique donné [aux Védas] depuis l'antiquité est bien connu et n'a pas besoin d'être précisé. En résumé, c'est la célébration d'un culte sacrificiel considérée comme le principal devoir de l'homme pour arriver à jouir de la richesse ici-bas et du ciel dans l'au-delà. Nous connaissons aussi la conception moderne où le Véda est un culte du soleil, de la lune, des étoiles, de l'aurore, du vent, de la pluie, du feu, du ciel, des rivières et d'autres divinités personnifiées de la Nature, culte qui doit rendre ces Dieux propices par le sacrifice, gagner et conserver la richesse dans cette vie-ci, surtout en la prenant à des ennemis dravidiens, contre des démons hostiles et des pilleurs humains, et après la mort permettre de parvenir au Ciel des Dieux.
Nous constatons maintenant que si valables qu'aient pu être ces idées pour le vulgaire, elles n'étaient pas le sens intérieur du Véda pour les visionnaires, les êtres illuminés (kavi, vipra) de l'ère védique. Pour eux, ces objets matériels étaient des symboles de l'immatériel : les vaches étaient les rayons ou les illuminations d'une Aurore divine, les chevaux et les chars des symboles de force et de mouvement, l'or était la lumière, richesse éclatante d'un Soleil divin (ritam jyotih). La richesse obtenue par le sacrifice et le sacrifice lui-même dans tous leurs détails symbolisaient l'effort de l'homme et ses moyens d'aboutir à un résultat plus grand, l'acquisition de l'immortalité.
Ce à quoi aspirait le visionnaire védique, c'était l'enrichissement et l'expansion de l'être de l'homme, la naissance et la formation des Dieux dans le sacrifice de sa vie, l'accroissement de la Force, la Vérité, la Lumière, la Joie dont ils sont les Puissances jusqu'à ce qu'à travers les mondes toujours plus vastes et plus ouverts de son être, l'âme de l'homme s'élève, voie s'ouvrir à son appel les portes divines (devir, dvârah) et pénètre en la divine félicité d'une existence divine au-delà du ciel et de la terre.
Le système ritualiste reconnu par Sayana peut rester valable dans ses formes extérieures. La signification naturaliste découverte par les savants européens peut être acceptée dans ses lignes générales, mais derrière tout cela il y a toujours le vrai secret, encore celé, du Véda, les paroles secrètes, ninyà vachamsi, qui furent prononcées pour des hommes à l'âme pure et à la connaissance éveillée. […]
Ces Écritures anciennes ont été livrées à des savants [modernes] laborieux, audacieux dans leurs spéculations, ingénieux dans les envolées de leur imagination, consciencieux selon leurs propres lumières, mais peu capables de comprendre la méthode des vieux poètes mystiques. Car ils n'éprouvaient aucune sympathie pour cet ancien tempérament, leur propre environnement intellectuel ou spirituel ne leur fournissait aucune clé pour les idées cachées dans les figures et les paraboles védiques.
La conséquence en fut double. D'une part, ce fut le début d'une recherche plus minutieuse, plus approfondie, plus soigneuse et aussi plus libre dans les problèmes d'interprétation védique. D'autre part, pour finir, une exagération du sens matériel apparent et une obscuration totale du vrai secret intérieur… Dans ce nouvel éclairage, l'hymnologie védique en vint à être interprétée comme une allégorie mi-superstitieuse et mi-poétique de la Nature, avec un élément astronomique important, le reste n'étant qu'en partie de l'histoire contemporaine et en partie les formules et pratiques d'un ritualisme superficiel, non pas mystique, mais simplement primitif et superstitieux.
L'hypothèse à la base de nos recherches est que le Véda a deux aspects qu'il faut séparer bien qu'ils soient étroitement reliés. Les rishis [Poètes voyants] ont organisé la substance de leur pensée en un système de parallélisme selon lequel les mêmes Divinités sont des Pouvoirs à la fois intérieurs et extérieurs de la Nature universelle, et ils sont arrivés à l'exprimer par un système de doubles valeurs selon lequel le même langage servait pour leur culte sous les deux aspects. Mais la signification psychologique prédomine ; elle est omniprésente, plus homogène et plus cohérente que la signification physique.
Tout le Véda est pratiquement une variation constante sur un double thème : la préparation de l'être humain dans son mental et dans son corps et la réalisation en lui du Divin ou de l'Immortalité par le développement et l'obtention de la Vérité et de la Béatitude.
À la fois dans sa signification exotérique et ésotérique, le Rig-Véda est le Livre des Œuvres, du sacrifice extérieur et du sacrifice intérieur ; c'est le champ de bataille et de victoire de l'esprit qui découvre et dans son ascension atteint des plans de pensée et d'expérience inaccessibles à l'homme naturel ou animal, c'est la louange humaine à la Lumière divine, au Pouvoir et à la Grâce qui sont à l'œuvre chez le mortel. C'est donc loin d'être une tentative d'exposer les résultats de spéculations intellectuelles ou imaginatives, et ce n'est pas non plus les dogmes d'une religion primitive. D'une uniformité d'expérience et de l'impersonnalité de la connaissance reçue se sont formés un ensemble de conceptions constamment répétées et un langage symbolique fixe. Celui-ci est devenu pour les rishis une sorte d'algèbre divin transmettant les formules éternelles de la Connaissance à la succession continue des initiés.
► Shri Aurobindo, in : L'Interprétation psychologique du Véda selon Shri Aurobindo, Jean Herbert, Dervy, 1979.
***
 • Recension : Il y a d'abord les hymnes védiques, l’un des textes les plus anciens de l'humanité, base de l’hindouisme, où chaque verset est à considérer comme une formule sacrée. Il y a ensuite Shri Aurobindo qui travaille en profondeur ce texte, techniquement, psychologiquement, symboliquement. Il y a, enfin, Jean Herbert qui, par ce livre, nous guide en ordonnant et schématisant les interprétations de Sbri Aurobindo. L’esprit général du Véda est d'abord présenté dans les directions de l'illumination spirituelle et de la recherche du vrai. Un second chapitre est consacré aux symboles qui éclairent la vie de l'homme, sacrifice, voyage et. combat Le chapitre suivant présente les dieux et les démons, en des rubriques brèves et précises. Enfin est rappelé le thème central, la conquête de la vérité et de la béatitude. Un précieux lexique termine ce volume. De format pratique, ce livre, par sa concision même, rendra de grands services aux curieux des religions orientales, car il permet d'accéder à un texte hermétique, grâce à une interprétation utile qui conjoint la psychologie et la spiritualité. (M. Adam, Rev. Phil. de la France et de l'étranger n°4/1980)
• Recension : Il y a d'abord les hymnes védiques, l’un des textes les plus anciens de l'humanité, base de l’hindouisme, où chaque verset est à considérer comme une formule sacrée. Il y a ensuite Shri Aurobindo qui travaille en profondeur ce texte, techniquement, psychologiquement, symboliquement. Il y a, enfin, Jean Herbert qui, par ce livre, nous guide en ordonnant et schématisant les interprétations de Sbri Aurobindo. L’esprit général du Véda est d'abord présenté dans les directions de l'illumination spirituelle et de la recherche du vrai. Un second chapitre est consacré aux symboles qui éclairent la vie de l'homme, sacrifice, voyage et. combat Le chapitre suivant présente les dieux et les démons, en des rubriques brèves et précises. Enfin est rappelé le thème central, la conquête de la vérité et de la béatitude. Un précieux lexique termine ce volume. De format pratique, ce livre, par sa concision même, rendra de grands services aux curieux des religions orientales, car il permet d'accéder à un texte hermétique, grâce à une interprétation utile qui conjoint la psychologie et la spiritualité. (M. Adam, Rev. Phil. de la France et de l'étranger n°4/1980)***
 Il faut être prêt à laisser derrière soi sur le chemin, non seulement le mal que nous stigmatisons, mais aussi ce qui nous semble être bien. Certaines choses furent bienfaisantes, utiles et, peut-être, en un temps, parurent la seule chose désirable, et cependant, lorsque leur œuvre est faite, lorsqu’elles ont été conquises, elles deviennent des obstacles et même des forces hostiles si nous sommes appelés à avancer plus loin. Certains états d’âme sont désirables, et, pourtant, il est dangereux de s’y attarder une fois qu’ils ont été maîtrisés, parce que, alors, nous n’avançons plus vers les royaumes de Dieu plus vastes par-delà. Il ne faut s’accrocher à rien, sauf au Tout ; nulle part, sauf à la suprême Transcendance. Et si nous pouvons être ainsi libres en l’Esprit, nous découvrirons toute la merveille des œuvres de Dieu ; nous verrons qu’en renonçant intérieurement à tout, nous n’avons rien perdu. “Ayant tout abandonné, dit l’Écriture, tu en viens à jouir du Tout”. Car tout est gardé intact pour nous et nous est rendu, mais avec un merveilleux changement, transfiguré en la Toute-Bonté et la Toute-Beauté, la Toute-Lumière, la Toute-Félicité de Celui qui est à jamais pur et infini, car Il est le mystère et le miracle qui ne cessent point à travers les âges. (La Synthèse des Yoga)
Il faut être prêt à laisser derrière soi sur le chemin, non seulement le mal que nous stigmatisons, mais aussi ce qui nous semble être bien. Certaines choses furent bienfaisantes, utiles et, peut-être, en un temps, parurent la seule chose désirable, et cependant, lorsque leur œuvre est faite, lorsqu’elles ont été conquises, elles deviennent des obstacles et même des forces hostiles si nous sommes appelés à avancer plus loin. Certains états d’âme sont désirables, et, pourtant, il est dangereux de s’y attarder une fois qu’ils ont été maîtrisés, parce que, alors, nous n’avançons plus vers les royaumes de Dieu plus vastes par-delà. Il ne faut s’accrocher à rien, sauf au Tout ; nulle part, sauf à la suprême Transcendance. Et si nous pouvons être ainsi libres en l’Esprit, nous découvrirons toute la merveille des œuvres de Dieu ; nous verrons qu’en renonçant intérieurement à tout, nous n’avons rien perdu. “Ayant tout abandonné, dit l’Écriture, tu en viens à jouir du Tout”. Car tout est gardé intact pour nous et nous est rendu, mais avec un merveilleux changement, transfiguré en la Toute-Bonté et la Toute-Beauté, la Toute-Lumière, la Toute-Félicité de Celui qui est à jamais pur et infini, car Il est le mystère et le miracle qui ne cessent point à travers les âges. (La Synthèse des Yoga)***
♦ Pour prolonger :
Introduction au Véda, Kireet Joshi, Auroville éd., 2001.
« Les pouvoirs de la parole dans les hymnes védiques », Louis Renou, in : L’Inde fondamentale : études d’indianisme, Hermann, 1978.
 Tags : Inde
Tags : Inde