-
Dennis
 ◊ Avertissement : Cette entrée pédagogique ne se contente pas seulement de pallier un oubli dans l’historiographie des idées politiques, elle reste aussi fidèle à sa vocation : inspirer & fortifier une conscience européenne, plus encore au moment où le continent divisé interroge notre avenir : l’ingérence américaine entérine l’impuissance européenne.
◊ Avertissement : Cette entrée pédagogique ne se contente pas seulement de pallier un oubli dans l’historiographie des idées politiques, elle reste aussi fidèle à sa vocation : inspirer & fortifier une conscience européenne, plus encore au moment où le continent divisé interroge notre avenir : l’ingérence américaine entérine l’impuissance européenne. Lawrence Dennis, figure iconoclaste de l’ère Roosevelt, nous offre à cet égard une leçon de lucidité. Il préfigure ce que Michel Foucault nommera un “intellectuel spécifique” : à une posture surplombante et universaliste il privilégie prise en compte du temps politique et situation historique, autrement dit l’interaction entre théorie et pratique. Il ne pouvait en effet considérer l’économie politique de manière externe, et se conforter dans une compréhension dépolitisée du devenir. La Grande Dépression, qui ébranla fortement l’optimisme américain, ne pouvait être traversée en tant que situation-limite historique qu’en assumant le risque de se réinventer, laissant pour cela une place à la contingence, contre la nécessité, au transitoire, contre la permanence, au devenir inconnu, contre la providence et l’eschatologie. S’il a tenté dans le champ des débats d’actualiser par le planisme une troisième voie, entre modernité libérale et bolchevisme, entendue sous le vocable “fascisme américain” en 1935-1936, ce fut pour répondre aux défis de son époque et de son pays. C’est là son originalité et aussi la cause que sa pensée fut mise sous le boisseau après-guerre. Sa rupture avec une carrière dans la diplomatie et la haute finance, en raison de leur collusion, est emblématique de ce “moment machiavélien” (Pocock, 1975) antagoniste à la tradition libérale (ascendance lockienne de la Révolution américaine).
La démarche de Dennis fut celle non d’un publiciste agitateur mais d’un éducateur politique attaché à la vox populi. La radicalité ne se résume pas à un anti-capitalisme pieux mais associe le geste à la parole, l’expression du réalisme politique à une forme de résistance. Nulle illusion idéaliste ne peut trouver la moindre emprise quand est pris le risque de plonger “au cœur des ténèbres” du siècle. La “pensée opérative” défendue par Dennis, à la différence de la pensée idéologique, suit cette ligne de front qui est frontière du réel ; elle rejoint l'exigence machiavélienne de suivre la verità effettuale (vérité effective, autrement dit attentive aux faits et aux effets), une vérité en situation car composant avec une histoire et une temporalité conflictuelles. Le défi reste entier : depuis les années 80, avec l’autonomie de la sphère financière, nous sommes entrés dans une mutation du capitalisme, une reconfiguration de la “matrice”, une troisième Révolution industrielle sous-tendue par l’idéologie dominante du néo-libéralisme, qui signe la perte définitive de souveraineté aussi bien des États que des individus, réduits à une artificialité formelle des échanges.
Les enjeux évoqués dans cette entrée gardent une brûlante actualité : impérialisme, spéculation boursière, corruption des institutions, économie de guerre. Cette dernière, comme le note avec pertinence Léo Mira, reste le nœud gordien : “L’entrée dans l’économie de guerre est une constante de la crise cyclique du capitalisme. Elle répond aux demandes de l’industrie de l’armement et des capitaux financiers en quête de nouveaux profits, et s’inscrit dans la perspective d’un conflit armé pour sortir du chaos et de l’impasse dans lesquels l’économie mondiale a été précipitée » (« Où mène l’économie de guerre ? », Mediapart, 2 mars 2023).
[photo par Charles E. Steinheimer pour le magazine Life, 1944]
***
Né en 1893 à Atlanta en Géorgie, Lawrence Dennis étudie à la Philips Exeter Academy et à Harvard. Il sert son pays en France en 1918, où il accède au grade de lieutenant. Après la guerre, il entame une carrière de diplomate qui l’emmène en Roumanie, au Honduras, au Nicaragua (où il observe la rébellion de Sandino) et au Pérou (au moment où émerge l’indigénisme péruvien). Entre 1930 et 1940, il joue un rôle intellectuel majeur. En 1932, paraît son livre Is Capitalism Doomed ? [Le Capitalisme est-il condamné ?] C’est un plaidoyer planiste, contre l’extension démesurée des crédits, contre l’exportation de capitaux, contre le non-investissement qui préfère louer l’argent que l’investir sur place et génère ainsi le chômage. Le programme de Dennis est de forger une fiscalité cohérente, de poursuivre une politique d’investissements créateurs d’emploi et de développer une autarcie américaine. En 1936, un autre ouvrage suscite le débat : The Coming American Fascism. Ce livre constate l’échec du New Deal, à cause d’une planification déficiente. Il constate également le succès des fascismes italien et allemand qui, dit Dennis, tirent les bonnes conclusions des théories de Keynes. Le fascisme s’oppose au communisme car il n’est pas égalitaire et le non-égalitarisme favorise les bons techniciens et les bons gestionnaires (les “directeurs”, dira Burnham). Il y a une différence entre le “fascisme” (planiste) tel que le définit Dennis et le “fascisme” rooseveltien que dénoncent Beard, Villard, Flynn, etc. Ce césarisme / fascisme rooseveltien se déploie au nom de l’anti-fascisme et agresse les fascismes européens.
En 1940, un troisième ouvrage de Dennis fait la une : The Dynamics of War and Revolution [La dynamique de la guerre et de la révolution]. Dans cet ouvrage, Dennis prévoit la guerre, qui sera une “guerre réactionnaire”. Dennis reprend la distinction des Corradini, Sombart, Haushofer et Niekisch, entre “nations prolétariennes” et “nations capitalistes” (haves/have-nots). La guerre, écrit Dennis, est la réaction des nations capitalistes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, nations capitalistes, s’opposeront à l’Allemagne, l’Italie et l’URSS, nations prolétariennes (le Pacte germano-soviétique est encore en vigueur et Dennis ignore encore qu’il sera dissous en juin 1941). Mais The Dynamics of War and Revolution constitue surtout une autopsie du monde capitaliste américain et occidental. La logique capitaliste, explique Dennis, est expansive, elle cherche à s’étendre et, si elle n’a pas ou plus la possibilité de s’étendre, elle s’étiole et meurt. D’où le capitalisme cherche constamment des marchés, mais cette recherche ne peut pas être éternelle, la Terre n’étant pas extensible à l’infini. Le capitalisme n’est possible que lorsqu’il y a expansion territoriale. De là, naît la logique de la “frontière”. Le territoire s’agrandit et la population augmente. Les courbes de profit peuvent s’accroître, vu la nécessité d’investir pour occuper ou coloniser ces territoires, de les équiper, de leur donner une infrastructure, et la nécessité de nourrir une population en phase d’explosion démographique. Historiquement parlant, cette expansion a eu lieu entre 1600 et 1900 : les peuples blancs d’Europe et d’Amérique avaient une frontière, un but à atteindre, des territoires à défricher et à organiser. En 1600, l’Europe investit le Nouveau Monde ; de 1800 à 1900, les États-Unis ont leur Ouest ; l’Europe s’étend en Afrique.
Conclusion de Dennis : l’ère capitaliste est terminée. Il n’y aura plus de guerres faciles possibles, plus d’injection de conjoncture par des expéditions coloniales dotées de faibles moyens, peu coûteuses en matières d’investissements, mais rapportant énormément de dividendes. Cette impossibilité de nouvelles expansions territoriales explique la stagnation et la dépression. Dès lors, quatre possibilités s’offrent aux gouvernants :
- 1. Accepter passivement la stagnation ;
- 2. Opter pour le mode communiste, c’est-à-dire pour la dictature des intellectuels bourgeois qui n’ont plus pu accéder au capitalisme ;
- 3. Créer un régime directorial, corporatiste et collectiviste, sans supprimer l’initiative privée et où la fonction de contrôle politique-étatique consiste à donner des directives efficaces ;
- 4. Faire la guerre à grande échelle, à titre de palliatif.
Dennis est favorable à la troisième solution et craint la quatrième (pour laquelle opte Roosevelt). Dennis s’oppose à la Seconde Guerre mondiale, tant dans le Pacifique que sur le théâtre européen. Plus tard, il s’opposera aux guerres de Corée et du Vietnam, injections de conjoncture semblables, visant à détruire des matériels pour pouvoir en reconstruire ou pour amasser des dividendes, sur lesquels on spéculera et que l’on n’investira pas. Pour avoir pris de telles positions, Dennis sera injurié bassement par la presse du système de 1945 à 1955, mais il continue imperturbablement à affiner ses thèses. Il commence par réfuter l’idée de “péché” dans la pratique politique internationale : pour Dennis, il n’y a pas de “péché fasciste” ou de “péché communiste”. L’obsession américaine de pratiquer des politiques de “portes ouvertes” (open doors policy) est un euphémisme pour désigner le plus implacable des impérialismes. La guerre froide implique des risques énormes pour le monde entier. La guerre du Vietnam, son enlisement et son échec, montrent l’inutilité de la quatrième solution. Par cette analyse, Dennis a un impact incontestable sur la pensée contestatrice de gauche et sur la gauche populiste, en dépit de son étiquette de “fasciste”. En 1969, dans Operational Thinking for Survival, Dennis offre à ses lecteurs sa somme finale. Elle consiste en une critique radicale de l’American way of life.[RS, entrée Roosevelt]
Les années de 1920 à 1940 ont été pour les États-Unis deux décennies de grands travaux d’aménagement, où les principes du libéralisme démocratique pur ont été légèrement battus en brèche. Burnham parle d’une “ère des directeurs”, où le décisionnisme des décideurs prend le pas sur les discussions parlementaires de l’ère libérale classique, tant en Europe, avec le fascisme et le national-socialisme, qu’en URSS, avec les planifications staliniennes, ou qu’aux États-Unis. Lawrence Dennis réclame, à la même époque, un isolationnisme continental, pan-américain, qui se donnerait pour but d’organiser rigoureusement le continent en suivant, pour ce faire, une logique autoritaire. Mais Dennis, contrairement à Roosevelt, veut une autarcie continentale sans la guerre, sans interventions hors de l’espace américain. Les opposants libéraux à Roosevelt stigmatisent le “césarisme rooseveltien”, qui ne réussit que partiellement son projet de ré-aménagement complet du territoire, les traditions libérales classiques jouant le rôle de frein, alors qu’en Europe occidentale et en URSS, ces freins avaient été balayés, permettant un despotisme capable d’asseoir vite la modernité technique et industrielle, de changer d’échelle. Parce que les institutions libérales américaines sont plus solides et rendent impossible un despotisme absolu à la Staline ou une dictature à la Hitler, Roosevelt doit donc susciter une “injection de conjoncture”, pour obtenir les fonds nécessaires à l’achèvement de cet ensemble de macro-projets. Raison pour laquelle il prépare très tôt les guerres contre l’Allemagne et le Japon. L’objectif intérieur de cette double guerre extérieure a donc été de financer l’irrigation définitive du Middle West et de l’Ouest.
[RS, entrée Wittfogel]

Le 25 décembre, jour de Noël, marque également l’anniversaire de l’un des penseurs les plus intransigeants et non-conformistes à avoir jamais traversé la scène politique américaine : Lawrence Dennis. De prime abord il y a déjà trois caractéristiques factuelles que tout le monde peut retenir au sujet de M. Dennis.
Premièrement : il était l’un des principaux théoriciens économiques et politiques de droite des années 1930 et 1940 — un fasciste américain si vous voulez. Et il a été rattrapé par le “Grand Procès en Sédition de 1944” (un procès qui s’est terminé de manière non concluante lorsque le juge Edward Eicher, un ancien membre du Congrès de l’Iowa, est soudainement tombé mort et que personne ne s’est soucié de reprendre la procédure).
Deuxièmement : Lawrence Dennis était en partie afro-américain, un fait qui était légèrement crédible à première vue, étant donné son teint “basané” ou “bronzé” et ses cheveux courts et raides. Dennis pouvait “passer pour blanc” s’il le voulait, et il l’a fait pendant plusieurs décennies. Mais ce fut surtout pour des raisons de commodité. Pendant ses années à Exeter, à Harvard, au corps diplomatique et à Wall Street, parler d’un héritage mulâtre n’aurait été qu’une complication inutile, et il ne l’a donc pas fait. En fin de compte, il n’y a aucune raison de croire qu’il avait honte de son héritage métis ; on dit que lorsqu’il est mort à plus de quatre-vingts ans, il arborait une chevelure frisée.
Le mélange racial de Dennis, associé à sa politique de droite radicale, confond les historiens politiques de gauche. Ils n’ont aucun mal à accepter le fait que W. E. B. Du Bois, un autre mulâtre à la peau claire, est allé à Harvard et a ensuite rejoint le Parti communiste américain. Mais imaginer qu’un autre homme à la peau claire d’origine noire était un fasciste ? Et non seulement un fasciste américain, mais un ancien diplomate et célèbre théoricien de la diplomatie. En 2007, une biographie de Dennis a été publiée sous le titre de La couleur du fascisme [1]. Comme on pouvait s’y attendre avec ce titre tapageur, l’éditeur a érigé la biographie en saga raciale : un récit de vie dans la honte, la “tromperie” et l’hypocrisie parmi de vindicatifs semeurs de haine.
 [Ci-contre : Larney Laurence Dennis à 5 ans, le ‘Negro baby evangelist’ selon le Chicago Tribune, 8 janvier 1899. Le tournant du siècle connaissait alors une forte vogue revivaliste. Il fit des tournées dans les états du Sud et même en Angleterre. À dix ans, il publia son récit auto-biographique : Life-story of the child evangelist Lonnie Lawrence Dennis, The Christian Herald, Londres, 1904]
[Ci-contre : Larney Laurence Dennis à 5 ans, le ‘Negro baby evangelist’ selon le Chicago Tribune, 8 janvier 1899. Le tournant du siècle connaissait alors une forte vogue revivaliste. Il fit des tournées dans les états du Sud et même en Angleterre. À dix ans, il publia son récit auto-biographique : Life-story of the child evangelist Lonnie Lawrence Dennis, The Christian Herald, Londres, 1904]Mais nous arrivons maintenant au troisième fait remarquable à propos de Lawrence Dennis — peut-être le plus étrange de tous. Il avait été un enfant vedette, un angelot prédicateur. À la fin du XIXe siècle, les journaux de New York et de Chicago étaient fascinés par le je-ne-sais-quoi de ce phénomène précoce, “Larney Dennis” — l’enfant prodige de Géorgie, venu pour sauver les âmes en détresse ! Des décennies plus tard, l’usage d’un bambin accrocheur de couleur haranguant les pécheurs deviendrait un élément de routine sur le circuit vaudevillesque des églises (le révérend Al Sharpton a commencé de cette façon). Mais, à la fin des années 1890, ce petit prodige de la prédication au teint mat, drapé dans sa blouse blanche, à la voix énergique, était unique en son genre, autant dire un indéniable atout pour toucher un public : “Priez ! Priez ! Mettez-vous à genoux et priez !” Les tons frémissants d’un enfant, mais animés d’une force de conviction lui apportant gravité. Sur l’estrade, une forme fluette en robe blanche avec une majesté étrange dans le visage solennel en forme d’olive, levant un petit index autoritaire. En dessous, une foule bigarrée de plus de trois mille personnes, mêlant curiosité, cynisme ou dévotion ; pourtant tous, croyants et moqueurs, étaient pareillement tenus en haleine par ce morceau de bravoure. En un mot, Lawrence Dennis, le chérubin nègre évangéliste, était devant son premier public new-yorkais à l’église baptiste Mount Olivet dans la 53e Rue cet après-midi, jouant l’une des scènes les plus pittoresques de la vie trépidante de la grande métropole. Bien avant 4 h, l’heure dévolue à l’office, l’église était pleine à craquer… Le petit Lawrence secoua les boucles noires confinées de chaque côté de sa tête avec un ruban rose et regarda autour de lui avec des yeux remplis d’espoir. “J'ai 5 ans — rétorqua-t-il à la première question — et je suis né le 25 décembre, l’anniversaire du Christ”. “Pourquoi es-tu ici ?” vociféra une négresse du milieu de l’assemblée. “Pour sauver New York”, a clamé le prédicateur. “Je suis venu sauver la brebis égarée en chacun de vous” (Chicago Tribune, 8 janvier 1899).
Un début de vie des plus rocambolesques pour un diplomate, ou un banquier d’investissement de Wall Street, ou un théoricien économique fasciste — tout ce que Dennis serait dans les années 1920 et 1930. Tout semble romanesque dans cette histoire de l’enfant évangéliste tout de blanc vêtu ; il est tellement éloigné de la carrière adulte de Dennis. Un peu comme l’histoire homérique d’Achille à Skyros, déguisé en princesse pour ne pas avoir à mourir dans le conflit avec Troie comme la prophétie l’avait prédit (comme vous vous en souvenez peut-être, cette expérience incita tellement Achille à éprouver sa résistance aux épreuves qu’il partit et périt quand même dans le conflit troyen). La rupture de Lawrence Dennis avec son passé survint au milieu de son adolescence, et elle fut brutale. Il rejoignit la très sélective école préparatoire Phillips Exeter Academy en rangeant au placard sa renommée et sa négritude d’enfance. Il fut un orateur hors pair à Exeter, puis à la prestigieuse université de Harvard, où il suivit un cursus accéléré en arts et sciences de deux ans et demi (c’était plutôt moins difficile qu’il n’y paraît aujourd’hui : pendant la Grande Guerre, Harvard et Yale ont distribué des validations de cours comme des petits pains, afin que les garçons puissent se rendre en France [pour remplir leurs obligations militaires] ou revenir et obtenir leur diplôme sans trop d’efforts).
Après cette période, il travailla au sein du corps diplomatique en Haïti, en Roumanie et en Amérique centrale. Il semble que ce soit son passage au Honduras et au Nicaragua qui ait radicalisé ce jeune diplomate en pleine ascension. Il lui est apparu clairement que l’Amérique centrale et les Caraïbes — la plupart des Amériques en fait — étaient les pions manœuvrés sur un plateau de jeu par le Département d’État américain et, en fin de compte, par Wall Street. Il es a de publier des articles sur les révolutions au Honduras et au Nicaragua dans l’Atlantic Monthly et dans Foreign Affairs, mais Foggy Bottom [surnom de la haute administration à Washington] les interdit [2]. Non sans morgue, Dennis a alors quitté le département d’État et est allé travailler pour la Guaranty Trust Company [3] pendant un certain temps, puis pour la banque d’investissement J. & W. Seligman. Cette dernière envoya Dennis en mission à Lima, en tant que leur représentant. Dennis examina scrupuleusement la situation et rechigna : les prêts de Wall Street au Pérou étaient mal montés dès le début et prédestinés à l’échec. C’était une vieille ruse de Wall Street, remontant au moins au milieu du XIXe siècle. L’intention de départ était que la banque d’investissement fasse des prêts à un pays d’Amérique latine, que le pays ne serait jamais en mesure de rembourser. Lorsque le gouvernement étranger se trouvait en défaut de paiement d’échéance, la banque d’investissement exigeait alors que le département d’État américain et le Trésor interviennent et garantissent les prêts, en réclamant des actifs ou des revenus futurs du pays [4].
Lawrence Dennis quitta alors Seligman et écrivit des articles pour The New Republic exposant ces manigances au Pérou. Dorénavant, il était strictement interdit d’emploi à la fois à Wall Street et au Département d’État. Il ne s’en souciait guère au demeurant. Ce fut en 1932, en pleine acmé de la Grande Dépression, qu’il jeta un pavé dans la mare avec un livre basé sur son expérience diplomatique et bancaire, intitulé Is Capitalism Doomed ? (Le capitalisme est-il condamné ?), livre qui reçut un accueil critique favorable. Le capitalisme auquel Dennis fait référence ici n’est pas la finance internationale en soi, mais plutôt la marque américaine spécifique du capitalisme du laissez-faire propre au “Wild West” (Ouest sauvage), sans contraintes ni surveillance gouvernementales. Établissant un parallèle avec la thèse de Frederick Jackson Turner sur la fermeture de la frontière américaine dans les années 1890, Dennis soutenait que l’époque du capitalisme du “Far West” — spéculation effrénée, emploi ploutocratique de la manière forte par le Congrès et “républiques” étrangères faibles — était révolue [5]. En cette année 1932, un grand nombre poussait des cris d’orfraie quant à l’effondrement de l’économie américaine. Mais l’intempestif Dennis n’a pas hurlé avec la foule. Pour lui, la solution n’était pas une révolution bolchevique qui détruirait la plupart des structures existantes de la société et placerait une classe étrangère au sommet. Il a proposé quelque chose de beaucoup plus simple : un ethos nationaliste qui restreint les capitalistes et place les besoins réels du peuple américain au centre des débats. En d’autres termes, le fascisme américain.
Is Capitalism Doomed ? était principalement chez Dennis le reflet de ses aventures diplomatiques et de celles avec Wall Street. Il lui a fallu quelques années de plus pour mûrir un argumentaire pertinent sur la raison pour laquelle le fascisme, plutôt que le bolchevisme, était le remplacement approprié du capitalisme flibustier de Wall Street. Le résultat fut son traité de 1940, The Dynamics of War and Revolution (La dynamique de la guerre et de la révolution). Is Capitalism Doomed ? avait été publié par Harper & Brothers, ancienne et respectable maison d’édition new-yorkaise grand public. Néanmoins, à la fin des années 30, les relations fascistes de Dennis l’ont placé en situation délicate, et il a dû le distribuer par le biais de sa propre impression privée [6]. En conséquence, ce livre de Dennis n’a jamais été beaucoup distribué. Mais il est clair qu’il atteignait le summum de sa perspicacité politique dans des passages aussi incisifs que ceux-ci :
En 1933 et 1934, j'étais l’un des rares écrivains américains à comprendre que socialisme et nazisme devaient conjointement aboutir à une forme extrême de socialisme en raison des pressions exercées par les tendances inévitables du changement social. J'ai tourné en dérision les interprétations du fascisme et du nazisme faites également par les conservateurs et les communistes à l’époque. Incidemment, il faut remarquer que les communistes américains et leurs compagnons de voyage, qui sont aussi peu versés en politique conséquente que les férus de Wall Street ou Mme Roosevelt, ont tous deux aidé pas mal Mussolini dans les premiers temps en dénonçant les fascistes comme des suppôts du capitalisme. Mon livre The Coming American Fascism, a été considéré par mes nombreux détracteurs comme totalement sans rapport avec le fascisme parce qu’il ne s’accordait pas avec l’interprétation orthodoxe de Moscou de ce nouveau phénomène [7]. Sur ce point, la ligne orthodoxe d’Union Square et de l’Union League Club était la même.
Pour moi, en 1933-1936, comme aujourd’hui, l’idée alors avancée sur Park Avenue et en bas de la Troisième Avenue [quartiers aisés de New York] que le démagogue d’un mouvement national-socialiste populaire avec une milice privée populaire sous ses ordres pourrait être le Charlie McCarthy [ventriloque-marionnettiste] des grands hommes d’affaires était tout à fait absurde. J'ai connu de manière proche trop de grands hommes d’affaires pour avoir le moindre doute quant au rôle qu’ils joueraient dans n’importe quel acte de Charlie McCarthy avec un Hitler. Les hommes d’affaires sont socialement les membres les moins intelligents et les moins créatifs de nos classes dirigeantes.
► Margot Metroland, Counter-Currents Publishing, 2015.
Notes :
1. Gerald Horne, The Colour of Fascism : Lawrence Dennis, Racial Passing, and the Rise of Right-Wing Extremism in the United States (New York University Press, 2007). [lire recension plus bas]
2. Un diplomate plus célèbre radicalisé par des expériences similaires en Amérique latine fut Sumner Welles, sous-secrétaire d’État dans les années Cordell Hull, qui consacra un long livre, Naboth's Vineyard : The Dominican Republic 1844-1924 (Payson et Clarke, 1928) pour détailler l’exploitation de cette nation insulaire par des intérêts bancaires américains.
3. Plus tard, Morgan Guaranty Trust ; actuellement une branche de la holding financière JPMorgan Chase.
4. Barbara Stallings, Banker to the Third World : US Portfolio Investment in Latin America, 1900-1986 (University of California Press, 1987).[Nous renvoyons à cet extrait d'article :
Actuellement, à Washington, la Commission présidée par le sénateur HW Johnson poursuit une enquête sur l'octroi des prêts des États-Unis à l'étranger. La Colombie se trouve spécialement visée. Le Gouvernement de cette République, en effet, a emprunté l'année dernière 20 millions de dollars et M. White, sous-secrétaire d'État, confirmant les déclarations du Président de la République de Colombie, a reconnu que les banquiers nord-américains avaient refusé d'accorder ce prêt tant que la concession pétrolifère Barco, estimée à plus de 300 millions de dollars, n'aurait pas été rétrocédée à la Gulf Oil, société contrôlée par M. Mellon, ministre des Finances des États-Unis. Telle est la diplomatie du dollar (1).
1. Les débats de Washington sont édifiants. Les capitalistes accusent les banques d'avoir placé du papier sud-américain sans valeur pour toucher des commissions, les banques à leur tour accusent le gouvernement de les avoir forcées à consentir ces prêts pour obtenir d'autres avantages. L’affaire des emprunts péruviens paraît être particulièrement scandaleuse. Le sénateur H. W. Johnson, dans l'exposé des résultats de l'enquête de la commission, actuellement publié (milieu du mois de mars), critique vivement les prêts accordés aux républiques sud-américaines, prêts qui allaient de pair avec des concessions et devenaient un moyen d'étendre à l'étranger le commerce et l'influence des États-Unis. Lors des discussions qui ont eu lieu à l’American Economic Association le 29 décembre dernier, M. Lawrence Dennis a démontré que les banquiers nord-américains avaient commis de véritables fraudes et M. Cumberland a rendu les États-Unis responsables de l'abus des emprunts en Amérique latine (overborrowing).
► Louis Baudin, extrait de : « La Colombie et Les États-Unis d'Amérique : à propos d'un ouvrage récent », Revue des sciences politiques n°1/1932, p. 296]
5. Voir le traitement de ce sujet par Keith Stimely [texte ci-dessous].
6. Justus Doenecke, « The Isolationist as Collectivist : Lawrence Dennis and the Coming of World War II », in : Journal of Libertarian Studies n°3/1979.
7. [note en sus] Par “interprétation orthodoxe de Moscou” est entendue une approche du système mondial basée sur la définition marxiste du fascisme comme pouvoir du capital financier — la dictature du capital — sur la société et ses institutions. Elle prolonge la théorie marxiste de l’impérialisme. (cf. « Non-Marxist Theories of Imperialism », Alan Fairgate, in : Reason, février 1976). Elle diffère d’autres approches plus historisantes, comme celle de Roger Griffin, qui définit le fascisme comme une “modernité alternative” enrayant le processus de décadence du monde contemporain. Les études de Griffin sur le fascisme européen font beaucoup pour faire ressortir ce qu’il appelle la “dynamique moderniste” des mouvements fascistes européens et de leurs dirigeants. Mais il choisit de ne pas considérer le fascisme comme une propriété fonctionnelle du capitalisme monopoliste en crise. Pour Griffin, la crise capitaliste est une condition nécessaire mais non suffisante du fascisme. Sur cette base, il définit le fascisme comme “une espèce révolutionnaire de modernisme politique” née au début du XXe siècle dont la mission est de combattre les forces prétendument dégénératives de l’histoire contemporaine (la décadence) en apportant une modernité et une temporalité alternatives (un “nouvel ordre” et une "nouvelle ère") basée sur la renaissance, ou palingénésie, de la nation. Pour Griffin, le fascisme émerge des “conditions de crise aiguë” en tant que mouvement nationaliste dirigé par un leader charismatique “jouant le rôle d’un prophète moderne” qui offre à ses partisans un nouveau “labyrinthe” (vision du monde) pour racheter la nation du chaos et la diriger. dans une nouvelle ère, celle qui s'appuie sur un passé mythifié pour régénérer l’avenir. Ainsi, “le fascisme est une forme de modernisme programmatique qui cherche à conquérir le pouvoir politique pour réaliser une vision totalisante de renaissance nationale ou ethnique. Son objectif ultime est de surmonter la décadence qui a détruit un sentiment d’appartenance communautaire et vidé la modernité de sens et de transcendance et d’inaugurer une nouvelle ère d’homogénéité culturelle et de santé”. Rien de tout cela ne s'applique vraiment à la genèse du fascisme américain dans les années 1920 et 1930, et cela donne ironiquement plus de poids aux écrivains de l’époque qui disaient que cela ne ressemblerait en rien à l’Italie ou à l’Allemagne. Voir Griffin, Modernism and Fascism : The Sense of a Beginning Under Mussolini and Hitler (2007) et mémoire de S. Paillé (2016).*
• codicille : La date de naissance reste hypothétique. L'archiviste et journaliste Robert Nedelkoff, dans le cadre d’un article biographique fouillé pour The Baffler (magazine culturel alternatif du type Actuel), est à notre connaissance le premier journaliste (1) à révéler l'adoption de Lawrence par le couple composé par Green Dennis & Cornelia Walker (information consultable également dans un rapport déclassifié du FBI datant de 1940 qui évoque des origines obscures avec une probable mais non certaine ascendance noire, ce qui explique à cette période l’absence d'attaque publique à ce sujet en transmettant à la presse ces données ou en faisant pression avec, comme ce fut le cas avec le pasteur Martin Luther King pour ses relations inverties. C'est fut d'ailleurs une de ces nombreuses affaires dévoilant la surveillance systématique des citoyens américains, connue grâce à un vol de dossiers du FBI en 1971 transmis au Washington Post qui aboutit, après la mise sur pied en 1975 d’une commission d’enquête parlementaire présidée par le sénateur démocrate Frank Church, à une réforme profonde du mode de fonctionnement de l’agence gouvernementale, même si la CIA également mise en cause dans le scandale du Watergate ne fut guère inquiétée) :
In 1897, a couple in Atlanta, classified “mulatto” by the standards of the day, adopted a three-year-old boy and gave him the name Lonnie Lawrence Dennis. Dennis’s biological mother was black, so far as the laws of the Peach State [surnom de l’État de Géorgie] were concerned. All that is known of his father is that he was probably white. Lonnie showed an early aptitude for reading and public speaking, and by his fifth birthday he was preaching the Gospel before black congregations in Atlanta. Before long Lonnie, billed as “The Mulatto Boy Evangelist”, was touring tent shows from Virginia to Louisiana, appearing at churches across the country and even in England, and speaking before large crowds both white and black. By the age of ten he had written and published his autobiography.
(« Remainder Table : Jack B. Tenney and Lawrence Dennis », in : The Baffler n°13, 1999)
1 : Avant lui, l’historien Steven Leikin (Université d’État de San Francisco) avait déjà abordé avec sérieux ce point biographique occulté lors d'une conférence sur Dennis à l’American Historical Association en décembre 1995. Son portrait intellectuel de Dennis, contrastant avec celui de G. Horne, montre son esprit frondeur non pas comme issu d’une identité problématique (double bind) mais comme provenant d’une rupture avec sa situation (et vocation) de diplomate (celui qui sert son pays aux confins) suivie d’une réinvention en une sorte de “lanceur d'alerte”. À l’instar du cas Julian Assange, c’est à chacun de trancher si Dennis restera vox clamantis in deserto ou question ouverte à l’organisation économique et politique de nos sociétés. Avec Jonathan Swift, nous faisons le pari de cette dernière :
“Le gouvernement des hommes étant en effet une nécessité naturelle, ils [les Lilliputiens] supposent qu’une intelligence normale sera toujours à la hauteur de son rôle et que la Providence n’eut jamais le dessein de rendre la conduite des affaires publiques si mystérieuse et si difficile qu’on la dût réserver à quelques rares génies — tels qu’il n’en naît guère que deux ou trois par siècle. Ils pensent au contraire que la loyauté, la justice, la tempérance et autres vertus sont à la portée de tous, et que la pratique de ces vertus, aidée de quelque expérience et d’une intention honnête, peut donner à tout citoyen capacité pour servir son pays, sauf aux postes qui exigent des connaissances spéciales” (Gulliver’s Travels, 1726).

Lawrence Dennis : une “thèse de la frontière” pour le capitalisme américain
[Ci-dessus : Changing West, Thomas Hart Benton, 1931]
[Ce mémoire de feu Keith Stimely (1957-1992) fut rédigé en 1986 pour un cours d’études supérieures d’histoire auquel il était inscrit à l’Université d’État de Portland dans l’Oregon. Il fut édité pour publication par Samuel Francis (1947-2005), qui en reçut copie d’un ami de l’auteur en 1987. Il n’avait jamais été diffusé auparavant mais constituait alors vraisemblablement l’étude la plus approfondie de la pensée politique et économique de Lawrence Dennis qui n’ait jamais été écrite. Pratiquement toute la mise en page fut appliquée à de menues retouches stylistiques et non au contenu. À l’exception d’une bibliographie appropriée pour un travail de fin d’études, rien de ce que M. Stimely a inclus n’a été retiré du texte original, et tout ce qui a été rajouté consiste en de simples références dans les notes de bas de page à des travaux plus récents en rapport avec le sujet de Stimely. — The Occidental Quarterly]
• Plan :
Préambule
L’homme et l’œuvre
L’économie politique comme destin
Réception critique de Dennis
Une réhabilitation qui tarde
Notes***
Préambule
Surtout connu au plus fort de sa carrière d’écrivain dans les années 1930 comme “le principal fasciste américain” et aussi comme un farouche opposant à l’intervention américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Lawrence Dennis était un économiste et théoricien politique dont les écrits sur le déclin du capitalisme et ses implications sociales et politiques à l’échelle internationale ont reçu une attention large et sérieuse dans les années 1930 et au début des années 1940. En fait, Dennis était bien plus qu’un apologiste du fascisme ou un isolationniste conservateur, et dans certaines de ses idées, il pourrait être considéré comme un précurseur ainsi qu’un contemporain de penseurs plus renommés tels que John Maynard Keynes, Adolf A. Berle, James Burnham, Max Nomad, Charles A. Beard et George Orwell. Il y a quelque chose de chacun de ces penseurs chez Dennis et, étant donné qu’eux et Dennis ont tous traité de préoccupations nouvelles à peu près au même moment, on peut se poser la question de son “rapprochement” intellectuel avec eux [1] dans le champ des controverses, ne serait-ce que pour repérer, dans une cartographie des débats, qui a précédé qui.
La proclamation officielle initiale des idées de Dennis en 1932, dans son livre Is Capitalism Doomed ?, était presque exactement concomitante des déclarations publiées par Berle sur son concept de pouvoir sans propriété [2] et de la conception de Max Nomad sur le retranchement inévitable d’une élite bureaucratique avide de pouvoir même dans les mouvements “ouvriers” et les sociétés proclamant la fin de tous les élitismes [3]. Le livre de Dennis est paru une dizaine d’années avant les travaux de Burnham défendant la thèse d’une nouvelle élite managériale remplaçant les anciennes élites patronales et même gouvernementales [4], et plus longtemps encore avant la description par Orwell d’une préparation psychologique et concrète aux conflits internationaux perpétuellement destinés à servir des fins politiques intérieures [5]. Dennis publiait ainsi deux ans avant que Charles Beard ne plaide en faveur du rejet par l’Amérique des investissements à l’étranger avec leurs compromissions politiques inévitables et ne recommande ce qui équivaudrait à une “autarcie régionale” pour l’économie nationale [6], et quatre ans avant la formulation finalisée par Keynes, dans sa Théorie générale de 1936, de son rejet de l’hypothèse des économistes classiques selon laquelle le cycle économique se corrige toujours de lui-même, prescrivant conséquemment l’intervention des pouvoirs publics quand ce n’est pas le cas [7].
Dennis lui-même était suffisamment honnête pour citer les influences fondamentales sur sa pensée : l’historien Frederick Jackson Turner, les sociologues Vilfredo Pareto et Robert Michels, le philosophe de l’histoire Oswald Spengler, les économistes Thorstein Veblen et Werner Sombart. Fort de sa familiarité avec ces penseurs et de ses propres expérience dans les années 1920 en tant qu’officier du service diplomatique américain et agent bancaire international, il a façonné, vers le milieu des années 1930, une vision synthétique de l’économie, de la politique, de la société et de l’histoire qui frappait au moins par sa finesse ingénieuse et sa clarté et que les commentateurs libéraux et conservateurs de l’époque reconnaissaient comme tels, qu’ils soient d’accord ou non.
 [Ci-contre : Le diplomate américain et consultant Lawrence Dennis, partisan du non-interventionnisme, se rend à la cour à Washington le 9 mai 1944 pour se défendre contre l’accusation de conspiration contre les États-Unis. Photo : Irving Haberman]
[Ci-contre : Le diplomate américain et consultant Lawrence Dennis, partisan du non-interventionnisme, se rend à la cour à Washington le 9 mai 1944 pour se défendre contre l’accusation de conspiration contre les États-Unis. Photo : Irving Haberman]Dennis devint encore plus intempestif après avoir commencé à préconiser des solutions politiques envisageables aux problèmes de la dépression et de la guerre. Bien que les gauche américaine et britannique aient d’abord salué en Dennis un démonstrateur majeur de la sénescence capitaliste [8], elles devinrent de plus en plus méfiantes à son égard (tout en continuant à donner une large place à ses idées) lorsqu’il se tourna vers le fascisme au milieu des années trente et commença à préconiser pour les États-Unis un État corporatiste et collectiviste dans lequel l’entreprise commerciale, tout en conservant ses formes juridiques et son caractère de propriété privée, aurait été obligée, si nécessaire, de se plier aux exigences programmatiques et régulatrices d’un État d’“unité populaire”. Au-delà des similitudes “sombres” entre un tel système et les régimes de l’époque en Allemagne et en Italie, c’était trop peu pour la gauche et trop pour la droite.
Les New Dealers [conseillers du président FDR] en particulier furent furieux lorsque Dennis déclara crânement que les tendances vers un tel système politico-économique étaient déjà bien engagées sous le régime Roosevelt, même en l’absence d’un plaidoyer politique aussi abrupt à sa décharge auquel il veillait [9]. En fin de compte, le Dr New Deal lui-même, qui n’est autre que Franklin Roosevelt, aura fait poursuivre Dennis en vertu du Smith Act pour “sédition”, et l’économiste a rejoint 29 autres non-interventionnistes, de tendances et motivations politiques très diverses, amalgamés sur le banc des accusés lors du “procès en sédition de masse” de 1944. Seul Dennis parmi les accusés osait ridiculiser constamment le procureur, et après une interruption de procès causée par la mort du juge [le 29 septembre], au milieu d’un scepticisme croissant de l’opinion publique à l’égard de toute l’affaire même au sein du la presse pro-administration, le gouvernement enterra l’affaire [10]. [Un non-lieu général fut prononcé le 7 décembre 1944 et le Département de Justice, faisant face aux croissantes tensions de la guerre froide, abandonna toute poursuite en 1947. La peur de la subversion communiste généralisée aboutira au maccarthysme]
À cette époque, les faiseurs d’opinion de l’establishment avaient laissé tomber Dennis, dont les idées étaient considérées comme dépassées et indécentes. L’homme qui jadis avait écrit pour The Nation, The New Republic, Foreign Affairs, les Annals of the American Academy, Saturday Review et Current History, dont les discours et la participation à des tables rondes avaient été couverts par le New York Times, et dont les livres avaient reçu un relatif accueil critique par des sommités telles que Max Lerner, Matthew Josephson, Louis M. Hacker, John Chamberlain, Dwight MacDonald, DW Brogan, William L. Langer, Waldemar Gurian, Francis Coker, Norman Thomas, Owen Lattimore et William Z. Foster, s’est vu refuser tout autre accès ou traitement dans les espaces de débat “respectables” (ou même dans ceux “irrespectables” de la gauche, qui s'adressaient à un vaste public d’intellectuels bien établis) et a donc dû se contenter de publier à titre personnel avec un tirage confidentiel pour pratiquement le reste de ses années productives [11].
Dennis passa ces années — un bon quart de siècle — à s’opposer vigoureusement à la guerre froide et à toute vision de la Russie soviétique comme porteuse d’un “péché” singulier qui devait être éradiqué, tout comme il s’était opposé à l’entrée américaine dans la Seconde Guerre mondiale et à toute vision des nations fascistes comme dépositaires uniques du “péché”. Dans les deux cas, ses positions relèvent moins d’affinités idéologiques que d’un réalisme pur et dur : il met en garde contre “la futilité sanglante de frustrer les forts” (the bloody futility of frustrating the strong). Il a également continué à affirmer que le capitalisme américain, ayant perdu sa “dynamique” essentielle, y compris sa “frontière” nécessaire, ne pouvait pas résoudre ses problèmes endémiques du XXe siècle — sous-consommation et chômage de masse — sans recourir à la guerre ou à la “mobilisation permanente” pour y parvenir. Se moquant de toutes les solutions “classiques”, “autrichiennes” ou “monétaristes” à la crise capitaliste, il a proclamé — comme l’un des principaux “keynésiens pré-Keynes” d’Amérique — que l’intervention gouvernementale de type keynésien, sous une forme ou une autre et à un degré plus ou moins élevé, était là pour durer et n’était pas mauvaise en soi, à condition qu’elle se concentre vers l’intérieur, sur la résolution des problèmes internes de la nation, et ne se disperse pas à l’extérieur, prétextant la “solution” par une guerre étrangère.
En fin de compte, Dennis croyait que les “lois économiques” — qu’elles soient proclamées par les économistes aussi bien classiques que marxistes — devaient inévitablement suivre les mandats politiques, et non l’inverse. À une époque moderne où le capitalisme traditionnel était pris de court, le socialisme n’allait pas du tout être ce que ses théoriciens fondateurs utopiques avaient à l’esprit, et le simple pouvoir d’influnce des élites opérant dans des contextes nationalistes par le biais d’appels psychologiques et culturels discrets restait le facteur décisif pour structurer les rapports économiques. Vers la fin de sa vie, Dennis inaugura l’usage du terme “opérationnel” — par opposition à idéaliste ou chimérique — pour décrire non pas tant en quoi mais comment penser correctement aux problèmes mondiaux, y compris économiques, et il s’est qualifié de “penseur opérationnel”.
Le fait qu’il se soit un jour qualifié de “fasciste” a cependant influencé la majorité des approches de sa pensée jusqu’à aujourd’hui. Toujours indifférent au plus haut point à ce que la plupart des gens, y compris ses collègues intellectuels, pensaient de lui, Dennis dans les années 1930 a franchement revendiqué une variante d’un système qui semblait alors “fonctionner” — alors que le capitalisme américain et la démocratie libérale, incapables de se sortir de la Dépression, ne n’y parvenaient tout simplement pas. Que l’étiquette de “fasciste” (qui, dans son usage courant en Amérique en tant que terme d’invective, a servi à qualifier tout et n’importe quoi jusqu’à ne plus rien signifier) soit restée minorée, cela incombe en partie, mais non exclusivement, à Dennis lui-même. Il s'agit d’une étiquette qui a constitué un obstacle majeur à la prise en compte sérieuse de l’ensemble de ses idées et de leurs mérites évidents, du point de vue de l’histoire depuis qu’elles ont été avancées pour la première fois.
“L’intellectuel fasciste n°1 d’Amérique”, “Le cerveau des forces non-interventionnistes”, “le leader intellectuel et principal conseiller des groupes fascistes” [12] — tels sont les qualificatifs avec lesquels Dennis a fini par être identifié, et est toujours en grande partie identifié. Mais même avec ceux-ci, on peut discerner une nuance qui non seulement s’applique à lui, mais a en fait été formulée juste pour lui — “intellectuel”, “cerveau”, “conseiller”. Même les critiques les plus virulents n’ont pas réussi à enfermer Lawrence Dennis dans les stéréotypes préfabriqués comme “bundiste” fasciste local, “Silver Shirt” (chemise d’argent) ou “Christian Mobilizer” [adepte du Père Coughlin]. En reconnaissant Dennis comme un véritable intellectuel fasciste, ses critiques l’ont à leur insu différencié davantage. Contrairement à la plupart des “théoriciens du fascisme”, qui avaient tendance à limiter toute considération des questions économiques à des analyses situationnelles, Dennis n’a pas ignoré l’économie dans la construction et l’exposition de sa vision du monde historique de grande portée. Bien plutôt, son appréciation du fascisme découlait en grande partie de son orientation économique initiale dans l’approche des problèmes politiques et sociaux, notamment en ce qui concerne sa critique du développement historique capitaliste en Amérique.
Un résumé et une analyse de cette critique et de la carrière de Dennis sont attendus depuis longtemps, de même qu’un examen critique de ses traitements historiographiques et savants qui ont émergé à l’apogée de sa carrière. C’est seulement au moment de son retrait de l’écriture vers 1970 qu’une plus jeune génération d’universitaires a commencé à étudier sa pensée et à le porter à l’attention d’autres encore pour qui il était soit une donnée complètement inconnue soit juste le type brillant des “fascistes locaux des années 1930”. Alors que les considérations plus anciennes sur Dennis, venant des libéraux de la vieille garde, se focalisaient sur son fascisme politique, les études plus récentes, venant après le développement d’une historiographie de la “Nouvelle Gauche” critiquant l’interventionnisme américain à l’étranger et une vague d’écrivains intéressés par l’histoire intellectuelle non consensuelle, ont eu tendance à se concentrer sur sa constance à s’opposer à l’implication américaine à la fois dans la Seconde Guerre mondiale et dans la guerre froide. Aucune étude n’a été consacrée à ses vues économiques ; les traitements les plus approfondis de celles-ci ne se trouvent que dans les critiques de ses trois premiers livres au fur et à mesure de leur parution entre 1932 et 1941. Nous aborderons donc plus loin l’idée économique principale de Dennis — sa “thèse de la frontière” pour le capitalisme américain — mais d’un point de vue purement descriptif qui n’a pas prétention à l’exhaustivité sur le sujet ou à replacer sa pensée économique dans le contexte de sa vision d’ensemble. Au moins ces considérations serviront-elles d’introduction basique en regard de ces exigences de rigueur.

L’homme et l’œuvre
Dennis naît en 1893 à Atlanta, en Géorgie, de parents moyennement aisés [13]. Il fréquente la Phillips Exeter Academy de 1913 à 1915 puis intègre l’Université de Harvard. Ses études interrompues par l’entrée américaine dans la Première Guerre mondiale, il se porte volontaire et reçoit sa promotion d’officier grâce à son assiduité en participant aux novateurs camps d’entraînement d’officiers de Plattsburgh, dans l’État de New York, en 1915 et 1917. Il sert ensuite en France comme lieutenant d’infanterie au sein d’un régiment d’état-major [à Brest, puis dans les American Expeditionary Forces de 1918 à 1919]. Pendant plusieurs mois après la démobilisation, il erre à travers l’Europe en jouant sur le marché des changes avec peu de moyens, puis retourne en Amérique pour terminer ses études à Harvard, obtenant son diplôme en 1920.
 [Ci-contre de g. à d. : le diplomate Lawrence Dennis, envoyé spécial au Nicaragua, le président Adolfo Díaz, son prédécesseur Emiliano Chamorro en nov. 1926. Ayant organisé une conférence de paix sur l'USS Denver, il a rendu possible cette passation, évitant ainsi une intervention américaine]
[Ci-contre de g. à d. : le diplomate Lawrence Dennis, envoyé spécial au Nicaragua, le président Adolfo Díaz, son prédécesseur Emiliano Chamorro en nov. 1926. Ayant organisé une conférence de paix sur l'USS Denver, il a rendu possible cette passation, évitant ainsi une intervention américaine]Dennis intègre le service diplomatique américain et travaille en tant que chargé d’affaires [représentant diplomatique] en Roumanie puis au Honduras. Après cela, il se rend au Nicaragua toujours comme chargé en 1926 et y reste au moment de la guérilla de Sandino et de l’intervention militaire américaine. C’est Dennis qui, sous les ordres du Département d’État, envoie le télégramme “demandant” l’intervention des marines américains au Nicaragua. Il n’a jamais été favorable à l’intervention et, après l’avoir publiquement critiquée en juin 1927 [en raison d’un massacre de population civile par les marines], il démissionne du service diplomatique. Il part alors travailler au Pérou en tant que représentant de la société bancaire internationale J. & W. Seligman & Co., la conseillant sur les prêts péruviens et sud-américains. À ce titre, il en vient à se méfier de plus en plus, et finalement à refuser invariablement, des prêts à des fins privées ou publiques consentis sans garantie sérieuse de remboursement ou des prêts à des pays dont les balances commerciales perpétuellement défavorables rendaient le remboursement pour le moins hasardeux. Il a déconseillé des prêts importants qui ont en fait été consentis et sur lesquels les débiteurs n’ont pas manqué de faire défaut. En 1932, deux ans après avoir démissionné de Seligman pour se retirer dans sa ferme de Becket, dans le Massachusetts, afin de poursuivre une carrière d’écrivain, de conférencier et d’analyste en investissement, il répond comme témoin expert devant le commission Johnson du Sénat américain enquêtant sur les pratiques de prêt internationaux ainsi que sur la défaillance de remboursement par les emprunteurs étrangers. À cette époque, il est en passe de s’imposer dans les cercles intellectuels américains comme un critique acerbe des pratiques des banques d’investissement et de l’ensemble d’un système capitaliste qui qui, de toute évidence, avait provoqué — et par là même ne pouvait pas résoudre — la dépression américaine puis mondiale. Des articles dans des revues de premier plan l’encouragent à poursuivre l’exposé systématique et approfondi de son approche qu’il adoptera pour le reste de sa vie.
***
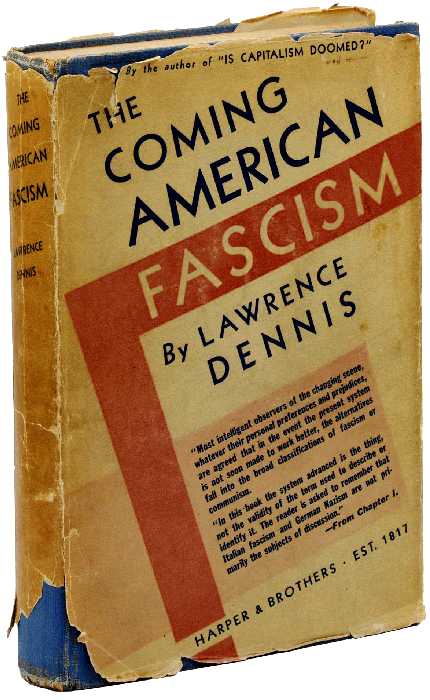 [Ci-contre : The Coming American Fascism, 1936. L'auteur y défend avec ardeur un plan national comme expression de la volonté populaire : « Le libéralisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont largement tributaires de restrictions juridiques puissantes contre les interférences gouvernementales sur l'individu. Le fascisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont principalement assurée par la force, l'efficacité et le succès de l'État dans la réalisation du plan national »]
[Ci-contre : The Coming American Fascism, 1936. L'auteur y défend avec ardeur un plan national comme expression de la volonté populaire : « Le libéralisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont largement tributaires de restrictions juridiques puissantes contre les interférences gouvernementales sur l'individu. Le fascisme suppose que le bien-être individuel et la sécurité sont principalement assurée par la force, l'efficacité et le succès de l'État dans la réalisation du plan national »]La carrière de Dennis en tant que penseur dans les années 1930 et 1940 peut schématiquement être divisée en trois périodes, chacune représentée par un livre. Dans Le capitalisme est-il condamné ? (1932), il fournit sa critique fondamentale de l’entreprise commerciale capitaliste traditionnelle et souligne la nécessité d’une planification gouvernementale. L’un des principaux abus du “leadership” capitaliste privé était l’extension excessive et grotesque du crédit, au niveau interne dans l’agriculture et l’industrie et au niveau externe dans les prêts et le commerce à l’étranger (les prêts n’étant accordés que pour permettre le remboursement des prêts antérieurs, le même processus survenant alors avec ces emprunts ultérieurs ; le commerce n’est en fin compte financé que par les emprunts d’autres commerçants). Non loin derrière dans l’iniquité se trouvait le refus des capitalistes de réinjecter les capitaux, préférant thésauriser, alors que des millions de personnes étaient au chômage faute de dépenses d’investissement. Pas encore prêt à dire ce qui, le cas échéant, pourrait ou devrait remplacer cet ordre commercial dépassé et l’État libéral-démocratique qui le permettait (les deux allant nécessairement de pair, selon lui), Dennis se contente de fournir des “suggestions de modération ou de retenue” — plus précisément, une forte imposition sur les riches (de préférence pour financer des projets de travaux publics créateurs d’emplois), des tarifs douaniers élevés et des dépenses gouvernementales conséquentes pour maintenir l’emploi dans une économie nationale autosuffisante ou autarcique — ce qui pourrait allonger et adoucir les “dernières années” du capitalisme américain.
Dans Le fascisme américain à venir (1936), Dennis est enfin prêt à être encore plus précis tant dans le diagnostic que dans le remède prescriptif. Alors que la Dépression reste traumatique six ans après son commencement et trois ans après l’inauguration de la révolution “sans plan” de Roosevelt [14], Dennis prévoit l’effondrement final du système et ne propose que les alternatives du fascisme ou du communisme pour le remplacer. Il opte franchement pour la première, non seulement parce qu’elle semble avoir fait ses preuves dans certains pays d’Europe, mais parce que la seconde alternative signifierait une “élimination” désastreuse de techniciens d’entreprise de valeur — par opposition à leur recrutement par cooptation et enrôlement au service de la nation par un État fasciste. Dennis décrit longuement ce que serait “le fascisme désirable d’un homme” — mais il prend soin de souligner que tout mouvement fasciste d’ampleur en Amérique ne s’appellerait sans doute pas ainsi et surgirait très probablement sous couvert d’anti-fascisme, peut-être même dans l’appel à la croisade contre le fascisme.
Dans The Dynamics of War and Revolution de 1940 [15], Dennis explore particulièrement ce dernier thème dans le cadre d’un traitement général reliant ses idées à la scène internationale très agitée de l’époque. Il prédit une probable implication américaine dans la guerre européenne pour deux raisons. Elle est le seul moyen pour le capitalisme américain en l’état actuel de sortir enfin de sa Dépression et elle représente au plus haut point l’effort désespéré des pays ploutocrates “nantis” stagnants (Amérique et Grande-Bretagne) pour contrecarrer la montée en puissance économique et politique des dynamiques pays socialistes “démunis” (Allemagne, Italie et Russie). Son identification sans retenue des régimes d’Hitler et de Mussolini avec le camp “socialiste” avait d’ailleurs tendance à exaspérer les critiques communistes ou de gauche du livre.
Mais la guerre des États libéraux pour mettre fin au fascisme, avec sa nécessaire mobilisation des ressources des entreprises sous la direction du gouvernement assurant seul le financement, le tout accompagné de doses massives de propagande gouvernementale aux troupeaux démocratiques, n'aboutirait qu'à un renforcement des tendances “fascistes” dans les structures politiques et commerciales de ces États, et même — surtout — en cas de victoire, il pourrait de nouveau y avoir retour à un laissez-faire dont l’ère était révolue. Dennis estime que la mobilisation étatique de l’économie, qu’il considère comme inévitable et à laquelle il est favorable par principe, pourrait être orientée sur le plan intérieur vers des réformes, des travaux publics et ultimement l’auto-suffisance économique nationale. Si elle devait être dirigée vers l’extérieur dans le cadre d’une autre grande croisade étrangère censée mettre fin au "péché" dans le monde, elle continuerait probablement à suivre cette voie si lucrative pour maintenir la production, conserver un taux d’emploi élevé et conjurer la déflation, et davantage de "péchés" seraient assurément trouvés pour les besoins de la cause, justifiant les dépenses pour éradiquer le “péché originel”. Ainsi, même avant l’intervention américaine dans la guerre (au moment précis de la drôle de guerre, en fait), et sans véritable indice quant à son issue ni même quant à la liste finale des adversaires, Dennis faisait allusion à une guerre froide d’après-guerre pour l’Amérique.
Il complète ses activités d’écrivain politique des années 1930 et du début des années 1940 par des contributions régulières à American Mercury de HL Mencken [sur lui cf The Betrayal of the American Right, M. Rothbard, 2007, ch. 3], où de nombreuses idées de The Coming American Fascism et The Dynamics of War and Revolution ont été avancées à l’origine, des conférences et des débats, des conseils en économie pour EA Pierce & Co. Il rédige et édite son propre bulletin, The Weekly Foreign Letter, qui paraît de 1938 à 1942. Après l’épisode judiciaire pour “sédition” et un long livre à ce sujet, A Trial on Trial [Le procès du procès] (co-écrit avec l’avocat Maximilian St. George), il lance un autre bulletin, The Appeal to Reason, qui durera plus de vingt ans [1946-1972], malgré un tirage qui ne dépassera jamais les 500 abonnés (dont l’ancien président Herbert Hoover, le sénateur Burton K. Wheeler, les généraux Robert E. Wood et Albert C. Wedemeyer, l’ex-colonel Truman Smith et Bruce Barton) [16]. Dennis sert également de conseiller en placements pour le général Wood et lui assure des gains confortables. Partageant son temps après la guerre entre sa ferme du Massachusetts et le Harvard Club de New York, il circonscrit sa vie sociale essentiellement à un petit cercle d’amis et de collègues, qui comprend les historiens révisionnistes Harry Elmer Barnes, Charles Callan Tansill et James J. Martin, le politologue Frederick Lewis Schuman (son voisin dans le Massachusetts — et son homologue de sensibilité différente — ainsi que son beau-frère), l’écrivain et ancien co-accusé de “sédition” George Sylvester Viereck, et le publiciste H. Keith Thompson.
Son dernier livre, Operational Thinking for Survival, paraît en 1969. Bien que l’essentiel du manuscrit ait été achevé à la fin des années 1950, le livre resta en jachère faute d’éditeur [17]. Il y reprend ses convictions fondamentales telles qu’elles s’exprimaient 30 ans auparavant ; il justifie ses explications par le cours des événements d’après-guerre, revendique en étude de cas une pensée “opérationnelle” (ou traitement “rationnel-pratique”), décrit la futilité, le gaspillage et le danger d’une guerre froide qui à la fois résulte d’une stupidité moralisatrice et l’entretient, et trouve même le temps de fustiger les critiques néo-classiques de la “Nouvelle économie” dont il avait été l’un des premiers représentants, quoique des plus inhabituels. Peu de temps après la parution du livre, il subit un accident vasculaire cérébral invalidant et ne reste actif que sporadiquement jusqu’à sa mort en 1977 [le 20 août].

L’économie politique comme destin
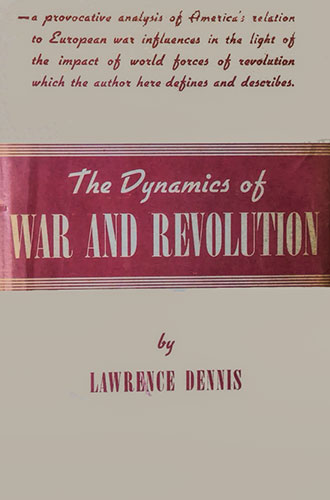 La présentation la plus complète et radicale chez Dennis de son raisonnement mûrement réfléchi sur le déclin du capitalisme se retrouve dans The Dynamics of War and Revolution. Dans la deuxième partie, “La fin de la révolution capitaliste”, composée de cinq chapitres, il pratique son “autopsie” de la dynamique capitaliste en Amérique — sorte de microcosme du monde occidental. Le capitalisme, soutient Dennis, doit toujours s’étendre ou mourir. La dynamique évolutive sous-tendant l’expansion, ce qui lui donne impulsion, se traduit par la quête incessante de marchés (de biens et services et pas seulement de capitaux), quête qui se révèle en fait une course désespérée contre la menace d’un processus linéaire de surproduction, entraînant une sous-consommation, provoquant des réductions de production, engendrant du chômage, causant une perte de pouvoir d’achat, amenant une perte d’incitations à l’investissement — tout cela conduisant à la stagnation et, finalement, à l’effondrement. Le cycle économique ne peut alterner les phases de croissance et de récession qu’à la seule condition qu’une expansion véritable du marché soit assurée.
La présentation la plus complète et radicale chez Dennis de son raisonnement mûrement réfléchi sur le déclin du capitalisme se retrouve dans The Dynamics of War and Revolution. Dans la deuxième partie, “La fin de la révolution capitaliste”, composée de cinq chapitres, il pratique son “autopsie” de la dynamique capitaliste en Amérique — sorte de microcosme du monde occidental. Le capitalisme, soutient Dennis, doit toujours s’étendre ou mourir. La dynamique évolutive sous-tendant l’expansion, ce qui lui donne impulsion, se traduit par la quête incessante de marchés (de biens et services et pas seulement de capitaux), quête qui se révèle en fait une course désespérée contre la menace d’un processus linéaire de surproduction, entraînant une sous-consommation, provoquant des réductions de production, engendrant du chômage, causant une perte de pouvoir d’achat, amenant une perte d’incitations à l’investissement — tout cela conduisant à la stagnation et, finalement, à l’effondrement. Le cycle économique ne peut alterner les phases de croissance et de récession qu’à la seule condition qu’une expansion véritable du marché soit assurée. Mais une telle expansion ne peut se produire que lorsqu’une “frontière” maintenue constante et en avancement est rendue effective. Le tracé de cette frontière mobile renvoie à une spatialité aussi bien géographique qu’économique ou géopolitique. Elle peut désigner une frontière au sens littéral du terme — une limite territoriale (éloignée, contiguë ou même à l’intérieur d’une nation), ou bien ce qui délimite une aire de prospérité — la “frontière de rareté” (frontier of scarcity) fournie par une population croissante de consommateurs, ou encore l’interface avec les zones de prospection — les “frontières” fournies par d’autres nations ou régions dont les marchés peuvent être accaparés sans grand risque politique ou militaire. Les trois siècles de la “Révolution capitaliste”, sommairement de 1600 à 1900, ont satisfait les besoins du capitalisme dans tous ces domaines et ont fourni sa puissance dynamique. La découverte d’un vaste Nouveau Monde a fourni la frontière littérale de l’Europe pour l’expansion de ses marchés (et de sa population), ainsi que des sources de matériaux pour la production et la distribution (les considérations mercantiles étaient en fait le mobile le plus déterminant qui poussait la vague de colonisation). Au sein de ce Nouveau Monde, à la fois avant et après sa constitution en tant que nouvelle nation, la frontière vers l'ouest a fourni le même moteur de dynamisme à la population de base — en particulier dans l’attrait des terres libres. Partout dans le monde, les impérialismes européens ont trouvé des marchés “à prendre” dans des terres qui ne pouvaient résister aux techniques militaires ou à l’attraction commerciale venant d’Europe ; l’Amérique a également élargi ses frontières nationales et commerciales par des “guerres faciles de conquête” — contre le Mexique, contre l’Espagne sur fond de rivalité impérialiste, dans des interventions et “présences” partout dans sa zone de surveillance du sud et même du lointain Pacifique. Les nouveaux processus d’industrialisation et modes de transport fournirent à point nommé les moyens d’exploiter les situations des marchés frontières [marchés émergents] en progression, et tous ces développements ont été accompagnés d'une explosion démographique générale, telle que le monde, dans son histoire, n’en avait jamais connue auparavant.
Ainsi, la “révolution capitaliste” triompha pour des raisons spécifiques et historiquement conditionnées. Mais selon les théoriciens apologistes du capitalisme, ce succès n’était pas historiquement déterminé, et il n’y avait aucune raison pour qu’il ne puisse pas continuer indéfiniment et que la révolution demeure permanente, même si elle était erratique dans son équilibre : les baisses seraient toujours suivies de hausses dans un cycle économique auto-correctif. Une fois la stagnation ou la récession atteintes, les nouvelles demandes des consommateurs “forceraient” bientôt l’investissement et la production à augmenter à nouveau (et donc l’emploi, le pouvoir d’achat, plus d’investissement, et ainsi de suite). Les partisans du capitalisme classique ont continué à affirmer ce droit jusqu’au plus profond de la dépression des années 1930. Pour Dennis, ces théoriciens idylliques avaient tort et avaient été démentis par un cataclysme économique américain (et, par-delà son cas, mondial) dont l’ampleur n’avait jamais été vue auparavant et après lequel les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Les théoriciens fondaient leurs prescriptions et prédictions sur l’historique du cycle économique au cours de trois cents ans de dynamisme capitaliste, comme si des “lois” universelles ou intemporelles du développement commercial pouvaient en être déduites. En fait, par leur focalisation sur les “vagues” du cycle économique dans cette période limitée et dans une configuration historiquement unique, ils manquaient la marée. La grande marée était le fait que la “révolution capitaliste” était finalement en bout de course parce que la frontière — incluant les “frontières” — n’existait plus.
 [Ci-contre : La période où naît Dennis marque un tournant dans les mentalités ; l’esprit pionnier cède le pas à l’esprit des affaires : urbanisation, forte démographie, rattrapage du retard industriel, force militaire mondiale. L’intensité de la croissance des États-Unis entraîne son ascension dans la hiérarchie des puissances. Le poète Walt Whitman, chantant le sens des grands espaces comme esprit de liberté, laissera toutefois une trace durable dans l'imaginaire américain. “En ce temps, l’Ouest était désert, immense, sans frontière. On croyait tout résoudre face à face, d’un coup de revolver : on n’y rencontrait jamais deux fois la même personne. (...) Le pays s’est développé, il a changé... Je ne le reconnais plus. Je m’y sens déjà étranger...” C'est en ces termes mélancoliques que Jack Beauregard, le tireur le plus fin de l’Ouest, fait ses adieux, en cette dernière année du XIXe siècle, à Personne (l’homme aux mille ruses), son admirateur, son fils spirituel, son rival, son successeur. Et c’est dans un film où le tragique le dispute au baroque et l’épique au bouffon, Mon nom est Personne, en cette année 1973 qui marque le crépuscule du western italien, que Sergio Leone fait ses adieux à un genre qu’il a recréé, rénové, transformé, exécuté]
[Ci-contre : La période où naît Dennis marque un tournant dans les mentalités ; l’esprit pionnier cède le pas à l’esprit des affaires : urbanisation, forte démographie, rattrapage du retard industriel, force militaire mondiale. L’intensité de la croissance des États-Unis entraîne son ascension dans la hiérarchie des puissances. Le poète Walt Whitman, chantant le sens des grands espaces comme esprit de liberté, laissera toutefois une trace durable dans l'imaginaire américain. “En ce temps, l’Ouest était désert, immense, sans frontière. On croyait tout résoudre face à face, d’un coup de revolver : on n’y rencontrait jamais deux fois la même personne. (...) Le pays s’est développé, il a changé... Je ne le reconnais plus. Je m’y sens déjà étranger...” C'est en ces termes mélancoliques que Jack Beauregard, le tireur le plus fin de l’Ouest, fait ses adieux, en cette dernière année du XIXe siècle, à Personne (l’homme aux mille ruses), son admirateur, son fils spirituel, son rival, son successeur. Et c’est dans un film où le tragique le dispute au baroque et l’épique au bouffon, Mon nom est Personne, en cette année 1973 qui marque le crépuscule du western italien, que Sergio Leone fait ses adieux à un genre qu’il a recréé, rénové, transformé, exécuté]La frontière américaine au sens propre du terme — qui avait suscité le stimulant essentiel des “profits des terres libres” (à la fois comme appât et, surtout, comme échappatoire) — a cessé d’exister vers 1890. Établissant une équivalence avec l’impérialisme britannique, qui avait atteint son apogée à peu près à la même époque (“la frontière était aux Américains ce que l’empire était aux Britanniques”), Dennis soutenait que les processus d’expansion et d’acquisition, et non la détention proprement dite, constituaient le mécanisme qui donnait sa dynamique au capitalisme ; le premier alimentait le développement capitaliste, le second conduisait inévitablement à la stagnation :
L’empire est un processus d’expansion par la conquête, il ne se résume pas à ses annexions et acquisitions. (…) Le fait socialement déterminant au sujet d’un empire, c’est d’acquérir sa place et de se défaire de sa frontière. Les deux processus sont inséparables. (…) En ce qui concerne l’empire, c’est la croissance, et non l’existence, l’obtention, et non la conservation, qui est historiquement significative et socialement dynamique. Une nation devient grande en bâtissant un empire, elle ne peut le rester simplement en le gardant. En effet, dès qu’il cessera de croître, il commencera à décliner. (…) L’humanité est vouée à vivre de labeur et de lutte, et non de rentes virtuelles. (…) Ce que nous appelons de nos jours le capitalisme, la démocratie et l’américanisme n’était simplement que la formulation du XIXe siècle pour la constitution d’un empire tel qu'il s'est produit au sein de ce pays. Ici, le processus était souvent qualifié de “pionnier” destiné à dépasser ses limites dans les territoires de confins. (…) Maintenant que la construction de l’empire selon la conception du XIXe siècle est achevée, tant pour les Britanniques que pour nous, le capitalisme et la démocratie ne sont plus tels que nous les connaissions à cette époque. (…) Contrairement aux démunis (Have-nots), nous ne nous développerons pas parce que nous sommes affamés de territoires. La faim est un défi. Au XXe siècle, contrairement au XIXe siècle, il n’y a aucun profit à tirer de l’augmentation de l’offre en matières premières et en denrées alimentaires. La rentabilité elle aussi est un défi. Mais, pour enclencher sa dynamique, il faut d’abord que ce soit possible. Les conditions créant cette possibilité sont les dynamismes premiers du capitalisme. (Dynamics, p. 68-69) [chapitre V]
Les conditions qui ont permis le succès du capitalisme ont disparu avec la frontière. Certes, pour Dennis, l’idée centrale de l’historien Frederick Jackson Turner, qu’il cite avec approbation — “L’existence d’une zone de terres libres, son recul constant, et l'avancée de colons américains vers l’Ouest expliquent le développement américain” [18] — éclaire avec évidence le caractère du développement économique américain, tout comme la “frontière mondiale” avec ses terres “gratuites” (ou faciles à acquérir) pour les nations européennes expliquait largement l’essor du capitalisme. Mais la fin du capitalisme pourrait aussi s’expliquer. La fin de la frontière au sens littéral pour l’Amérique et le monde capitaliste peut être rapprochée de la fin de la révolution industrielle, du déclin du taux de croissance démographique et de la fin de possibilités supplémentaires de “guerres faciles de conquête”.
La révolution industrielle — portée par l’essor technologique — avait fait son temps, et il ne pouvait y avoir aucun espoir que l’industrialisme ou la technologie puissent se maintenir indéfiniment, que ce soit par le biais de raffinements évolutifs ajustant techniques et modes de production ou bien en faisant appel au marché financier de mille manières afin de “revigorer” ou “sauver” le capitalisme quand la situation l’exigerait. L’industrialisme s’était essoufflé parce qu’il n’avait jamais été dynamique en soi, plus précisément il ne pouvait l’être qu’à l’ère de la frontière et de la croissance rapide de la population : “Aujourd’hui, en ce qui concerne la stimulation de la croissance commerciale, les changements industriels ne sont pas plus audacieux que le changement de traverses ou de rails en acier sur un chemin de fer. (…) Quant aux produits entièrement nouveaux, ils tendent désormais à remplacer les produits anciens sans aboutir aucunement à une nette augmentation de la consommation ou de la production” (Dynamics, p. 60). L’essence de la révolution industrielle résidait dans le changement en tant que spécifiquement rattachable au contexte de croissance ou d’expansion continue, ce qui induit qu’il ne pouvait s’agir que d’une phase transitoire, quel que soit le moment ou le lieu où elle s'est produite. Cette “série d’événements dans le temps et dans l’espace” constituait une révolution bien réelle, succédant parfaitement à la révolution mercantiliste et nécessaire à la généralisation de la révolution capitaliste — mais elle ne pouvait rester révolutionnaire qu’aussi longtemps qu’elle était expansive.
 [Ci-contre : Jean-Baptiste Say est avec Adam Smith un des premiers économistes à distinguer économie politique et politique, science de la prospérité et art du gouvernement. Se démarquant ainsi des physiocrates par la délimitation du champ de recherches, il ne conçoit pas seulement l’économie politique comme une science utilisant la méthode expérimentale : celle-ci doit être utile à la société. En 1803, il énonce une loi économique, surnommée ensuite “loi de Say”, résumable ainsi : toute offre crée sa propre demande. Cette loi des débouchés fonde la pensée économique dite libérale, selon laquelle le marché s’autorégule. Elle implique un équilibre global entre l’offre et la demande. Il ne peut donc y avoir surproduction mais seulement des déséquilibres passagers rectifiables par le jeu naturel des prix. Il considère ainsi qu’une création monétaire (l’augmentation du volume de monnaie en circulation) supérieure au strict nécessaire pour permettre les échanges de biens et services ne dope pas l’économie. Bien au contraire, elle n’engendre que de l’inflation. La doctrine que développera plus tard Keynes prônant la relance de l’économie par l’injection de monnaie sera en totale opposition avec cette loi. Pour cerner les enjeux : Say’s law and the Keynesian revolution, Steven Kates, 1998, recension]
[Ci-contre : Jean-Baptiste Say est avec Adam Smith un des premiers économistes à distinguer économie politique et politique, science de la prospérité et art du gouvernement. Se démarquant ainsi des physiocrates par la délimitation du champ de recherches, il ne conçoit pas seulement l’économie politique comme une science utilisant la méthode expérimentale : celle-ci doit être utile à la société. En 1803, il énonce une loi économique, surnommée ensuite “loi de Say”, résumable ainsi : toute offre crée sa propre demande. Cette loi des débouchés fonde la pensée économique dite libérale, selon laquelle le marché s’autorégule. Elle implique un équilibre global entre l’offre et la demande. Il ne peut donc y avoir surproduction mais seulement des déséquilibres passagers rectifiables par le jeu naturel des prix. Il considère ainsi qu’une création monétaire (l’augmentation du volume de monnaie en circulation) supérieure au strict nécessaire pour permettre les échanges de biens et services ne dope pas l’économie. Bien au contraire, elle n’engendre que de l’inflation. La doctrine que développera plus tard Keynes prônant la relance de l’économie par l’injection de monnaie sera en totale opposition avec cette loi. Pour cerner les enjeux : Say’s law and the Keynesian revolution, Steven Kates, 1998, recension]Son expansion aurait pu se poursuivre indéfiniment si la “loi de Say” — la production favorise nécessairement le pouvoir d’achat pour payer ce qui est produit — était valide dans l’absolu. Or cela ne fonctionne pas ainsi, car son corollaire principal, la doctrine de la “souveraineté des consommateurs” selon laquelle biens et services sont produits pour un profit en réponse aux besoins et demandes des consommateurs, était “erroné à 100 % : la demande des producteurs, et non celle des consommateurs, est souveraine”. C’est ici que Dennis renverse l’un des préceptes fondamentaux de la théorie libérale :
Les producteurs décident quoi, quand et combien produire, ce qui inclut le volume de production et l’activité de production de biens tels que les nouvelles usines, les immeubles de bureaux, etc. En d’autres termes, le volume et le taux de réinvestissement des bénéfices et du capital épargné conditionnent les variations de la demande des consommateurs. Les producteurs et investisseurs déterminent les variations du volume et la vélocité du flux d’achat des consommateurs. Les hausses de prix du marché sont entraînées par l’optimisme des producteurs et investisseurs et déclinent quand elle sont rattrapées par le pessimisme des producteurs et investisseurs. Les besoins et désirs des consommateurs n’ont pas plus à voir avec les hausses et baisses qu’avec les taches solaires. Lorsque les producteurs décident de réduire leur production, le pouvoir d’achat des consommateurs diminue, ce qui constitue une bonne raison de réduire encore davantage la production, l’emploi et les salaires. Le processus est inversé par un changement dans la psychologie des producteurs et investisseurs. Les décisions des producteurs, comme chacun sait, sont régies principalement par des changements dans les projections de rentabilité. (Dynamics, p. 64) [ch. IV]
La limite de la frontière — et même le simple fait de l’apercevoir avant qu’elle ne soit atteinte — a modifié les attentes des “producteurs souverains”. Plus précisément, cela a exercé une influence sur leur capacité de prise de risque d’investissement. Le trait dominant de l’organisation commerciale américaine, résultant de la révolution industrielle dans un contexte territorial en pleine mutation, était le monopole — à propos duquel, soit dit en passant, “il y a plus d’hypocrisie […] que sur tout autre sujet dans tout le champ économique” [19]. La révolution industrielle et la frontière ont facilité l’émergence de monopoles dans presque toutes les nouvelles industries. Au début et pendant les jours fastes de la révolution, les entités monopolistiques, déjà existantes ou en cours de formation, étaient celles-là mêmes qui se montraient les plus engagées et enthousiastes vis-à-vis de l’investissement et du risque, regimbant à thésauriser et à pratiquer des investissements ou opérations à risque minimal. En dernier lieu, elles tendaient soit à la thésaurisation soit à se renforcer comme “exploitants fiables” en suivant un schéma de concentration verticale ou horizontale, souvent les deux, autrement dit leur volonté de développement était plus orientée vers l’organisation et le contrôle que vers le risque d’investissement ou de marché — parce que les frontières du marché ne s’étendaient plus. Cette situation a entraîné une stagnation progressive et son instabilité, lorsqu’elle s’est combinée à la logique d’expansion “artificielle” au cours des années 1920, a finalement conduit à la Dépression.
Les éphémères moments de reprise économique depuis 1929 — ceux de 1933, de fin 1936/début 1937, de mi-1938 et de fin 1939 — n’ont fait que confirmer que l’expansion industrielle n’était plus un soutien ou une sauvegarde du capitalisme. Ils ont été causés par des craintes d’inflation, et nullement par des attentes de rendement de l’industrie. Au demeurant de telles attentes, susceptibles de provoquer de véritables relances économiques, sans parler d’une véritable fin de la Dépression, ne pouvaient surgir que dans une situation de “frontière” reconnue. Dennis examine longuement, puis rejette en bloc, l’argument (“s'il peut être qualifié ainsi”) selon lequel même avec la fin de la frontière géographique et donc d’une aire de marché physiquement en expansion, il existait néanmoins et existerait toujours une “frontière” illimitée de désirs humains et besoins insatisfaits et de découvertes qui fournirait toutes les incitations et opportunités pour maintenir le capitalisme. Cette argumentation, comme la “loi de Say” et son corollaire, supposait que “le désir du consommateur au lieu de l’avidité du producteur” était le facteur dynamique du capitalisme. Mais la clé était en fait “l’avidité du producteur” — et bien que cela puisse arriver pour satisfaire les désirs et besoins humains, même en grande quantité, au cours de la quête d’une plus-value privée, un tel résultat serait purement occasionnel et, en aucun cas, un facteur dynamique ou déterminant dans ces processus.
Tant que les réserves en terres, main-d’œuvre et ressources naturelles disponibles pour l’exploitation augmentaient rapidement, il y avait une pénurie constante de capitaux, de machines, de logements, de moyens de transport et de moyens de subsistance pour les travailleurs. Cette pénurie constituait une véritable frontière industrielle. C’était une frontière de besoin, pas de luxe. Le capitalisme a besoin d’une frontière de rareté qui maintiendra des taux d’intérêt élevés et des marges bénéficiaires larges. Il ne peut prospérer sur une frontière d’abondance industrielle où les taux d’intérêt tomberaient à zéro et les incitations à l’investissement privé disparaîtraient pratiquement. (Dynamics, p. 77) [chap. V]
L’une des “frontières de rareté” nécessaire à la réussite du capitalisme était simplement la présence de plus en plus nombreuse de corps devant subvenir à leurs besoins alimentaires et matériels. Cette “frontière” pourrait durer éternellement si l’augmentation de la population pouvait être garantie à perpétuité. Or cela ne se pouvait pas. Passant en revue les statistiques démographiques, du premier recensement national en 1790 à celui de 1930, Dennis dressa un constat sans concession : alors que la population américaine augmentait à des taux spectaculaires tout au long du XIXe siècle, à partir de la fin du siècle environ, le taux de croissance (même si on ne peut le superposer avec le taux de croissance économique) avait considérablement diminué [1890-1910]. L’apogée de la croissance démographique avait donc été atteinte avec le passage de la frontière. Si le taux continuait de baisser, et Dennis présumait qu’il le ferait sans interruption significative [20], les conséquences seraient lourdes pour le capitalisme américain — plus qu’elles ne l’étaient déjà. Car le capitalisme, ici comme dans tous les autres domaines, avait besoin de croissance :
La première des fonctions de la croissance démographique est celle d’entretenir une pénurie perpétuelle des biens de première nécessité, si indispensables pour un capitalisme ou un socialisme bien établi. Cette pénurie fournit des incitations pour les dirigeants et des contraintes pour les dirigés. Cette pénurie ne concerne désormais que les pays pauvres ; eux seuls sont donc dynamiques de nos jours. Le capitalisme en Amérique était dynamique tant que l’augmentation de la population mondiale assurait la pénurie alimentaire. Maintenant que nous vivons au milieu de l’abondance alimentaire, le capitalisme n’est plus dynamique. Par conséquent, les chômeurs sont affamés parce que nous manquons désormais de pénurie, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Quitte à heurter, c’est pourtant du même ordre qu’une situation dans laquelle les agriculteurs souffrent du manque d’acheteurs pour leur nourriture et les chômeurs souffrent du manque de nourriture. (…) Pour le XIXe siècle, la seule façon d’éviter le mal de l’abondance était de fonder des familles nombreuses. Pour le XXe siècle, maintenant que nous avons de petites familles, la seule façon est d’organiser un chômage de masse et deux guerres mondiales en une génération. Compte tenu de l’idéologie de la démocratie et du capitalisme faisant de l’épargne une vertu, compte tenu aussi de la réduction de taille des familles, il est difficile d’envisager un autre moyen de restreindre l’abondance que le chômage et la guerre. Et compte tenu de notre modèle culturel, il est difficile d’imaginer comment nous pourrions faire fonctionner la société sans les contraintes d’une pénurie, pour laquelle un taux de natalité élevé, le chômage ou la guerre sont seuls requis pour la maintenir à un niveau suffisant dans notre système. (Dynamics, p. 94-95) [chap. VI]
Le capitalisme “fruit de son époque”, découlant de circonstances historiques particulières qui se sont coalisées pour engendrer une révolution de 300 ans, était insatiable dans sa voracité de marchés, du fait précisément que sa nouvelle puissance productive et distributive était en mesure d’assouvir l’avidité du marché en biens. En conséquence l’atteinte du paroxysme de saturation pouvait être reportée et l’a été. L’autre facteur qui permettait cela, en plus d’une frontière toujours reculée et d’une démographie galopante pour coloniser cette frontière, était l’expansion des marchés au moyen de “guerres faciles de conquête” ; celles-ci pourraient garantir les “pénuries de besoins” exigées pour résister à la stagnation ou sortir de la dépression. Les guerres, bien évidemment, ont toujours été une manne bénie pour le capitalisme en stimulant la production et en absorbant le chômage. En plus de présenter ces avantages immédiats, elles en procuraient aussi à plus long terme par l’accaparement des marchés. Toutefois il entrait dans l’impératif de guerre du capitalisme bien plus que des motivations économiques. En réalité, les “guerres faciles de conquête” répondaient aux besoins non seulement du capitalisme privé mais aussi de la démocratie publique. Le capitalisme n’aurait pas été ce qu’il a été sans la démocratie [libérale], et vice versa.
La démocratie américaine a été fondée sur les deux piliers jumeaux d’une ploutocratie mercantile et d’une slavocratie [pouvoir esclavagiste] agricole. La défaite de cette dernière dans la guerre civile [1861–1865] signifiait seulement son inféodation à un nouveau règne industrialiste des revenus (industrial wage-ocracy). Cette “théocratie salariale” (wage-ocracy), appelée communément “emploi de masse”, dépendait pour son existence même de l’expansion des marchés, c’est-à-dire de la réalité des frontières ; elle a naturellement fait sentir cette dépendance dans ses pressions politiques. Et la foi démocratique américaine qui a été inculquée aux travailleurs de masse tout comme aux employeurs était essentiellement la foi en un boom permanent du foncier. Par ses politiques nationales de peuplement, d’incitations à l’investissement, de commerce et de guerre, la démocratie pouvait “garder la foi”. La démocratie avait aussi ses propres raisons, purement politiques, qui apparaissaient le plus ostensiblement dans sa politique de guerre, pour la conserver. Alors que le capitalisme avait besoin de guerres pour conquérir des marchés étrangers, s'emparer de terres et obtenir des stimuli productifs immédiats, la démocratie avait besoin de guerres pour assurer l'unité sociale et la stabilité à un moment où le capitalisme avait tendance à se détraquer ou à se discréditer :
Dans le cadre d’un bref examen du rôle dynamique des guerres faciles dans l’ascension triomphante du capitalisme et de la démocratie, ce serait une grave omission de ne pas souligner le fait que les guerres nationalistes ont tempéré l’anarchie et les contradictions de la concurrence privée. La guerre comme la religion imposent nécessairement l’unité collective. Leur pratique réunit un grand nombre de personnes partageant intérêts et sensibilité. La concurrence privée, au contraire, a toujours tendance à détruire l’unité sociale. (…) L’ensemble d’une communauté ne peut pratiquer la concurrence de façon ordonnée qu’en temps de guerre ou qu’en concurrence avec une communauté extérieure. Ainsi, en temps de guerre, chaque communauté belligérante opère en interne sur la base de la coopération et en externe sur la base de la compétition. De cette façon, il y a de l’ordre à l’intérieur et de l’anarchie à l’extérieur. C’est évidemment une condition inévitable de toute société de nations souveraines qu’elle soit caractérisée par l’anarchie. Les souverainetés multiples ne sont qu’un synonyme d’anarchie. L’anarchie internationale est un corollaire de la souveraineté nationale. Cette ribambelle d’idéalistes et de théoriciens qui professent vouloir substituer dans la sphère internationale à l’État de droit l’état d’anarchie tout en préservant la souveraineté nationale est composée de personnes soit singulièrement obtuses, soit intellectuellement malhonnêtes. Quiconque ne comprend pas que, dans un État de droit, il ne peut y avoir qu’un seul souverain, et non plusieurs, ne comprend ni le sens du droit ni celui de la souveraineté. Mais, bien que la guerre ait été à travers l’histoire une force d’anarchie entre les nations, elle a aussi été une force de cohésion sociale et d’ordre à l’intérieur des nations. Entre l’anarchie internationale chronique et l’ordre national, il n’y a pas de contradiction nécessaire. Le fait est que les démocraties capitalistes ont eu besoin de la force centripète de la guerre extérieure pour compenser la force centrifuge de la concurrence privée. (…) L’individualisme, ou plutôt la force désagrégeante de la concurrence privée, a rendu d’autant plus grand ce besoin [coutumier] de guerre étrangère. Le libre jeu de l’intérêt personnel d’un individu ou d’un groupe minoritaire tend à faire éclater n’importe quelle communauté. Les contre-forces d’unification nécessaires à l’ordre social sous le capitalisme ont dû être en grande partie générées par la poursuite continue de guerres étrangères faciles et victorieuses. (Dynamics, p. 122-123) [chap. VII]
Ce qui pose encore problème au XXe siècle, c'est la croyance aux “guerres faciles” : si elles avaient suivi le chemin du boom foncier frontalier et du boom démographique qui remplissait les frontières, leur ère était dorénavant révolue. Avec un soin attentif, Dennis fait un rapide retour sur cette époque en présentant des tableaux des guerres et des interventions militaires des trois grandes démocraties capitalistes au cours d’un siècle et demi, jusqu’aux années 1920 incluses. Ses résumés de ces tableaux sont destinés à donner du poids à ses prémisses et conclusions — et à interpeller le lecteur souvent abreuvé de formules convenues telle que “les démocraties éprises de paix”. “Angleterre : 54 guerres, durant 102 ans, soit 68 % du temps. France : 53 guerres d’une durée de 99 ans, soit 66 % du temps. Amérique : En 158 ans, il y a eu la guerre pratiquement tout le temps” (Dynamics, p. 104-108). La fin de l’ère des “guerres faciles”, qui se conclut par la digestion des dernières cibles faciles sur l’échiquier mondial, a parachevé le processus de la “révolution capitaliste”. Les quatre grands piliers fondateurs de la démocratie capitaliste américaine avaient finalement tous été renversés : la frontière, l’industrialisme comme révolution, la croissance démographique, les guerres faciles. Ne reposant plus sur ces bases assurées, la démocratie capitaliste américaine pourrait-elle survivre ? Dennis reste des plus sceptique, et il propose quatre possibilités quant à ce qui lui arriverait :
• 1 : Elle pourrait procéder selon les méthodes et hypothèses habituelles, perpétuant la stagnation, le chômage massif, l’échec total dans tous les domaines économiques et provoquant en bout de course le chaos anarchique.
• 2 : Elle pourrait succomber à une révolution prolétarienne des classes inférieures menée par la classe sociale juste au-dessus d'elle, des bourgeois déclassés et privés de reconnaissance politique, anéantissant toutes les formes de capitalisme, et beaucoup de capitalistes, en instituant la dictature des intellectuels.
• 3 : Elle pourrait être subsumée dans un État intégralement nationaliste, corporatiste et éthiquement collectiviste qui exercerait un contrôle dirigiste autoritaire sur une grande partie de l'appareil commercial, sans toutefois en être le propriétaire à part entière, et qui procéderait à la redistribution et à la hiérarchisation des priorités nécessaires pour mettre fin à la surproduction et au chômage, en particulier par le biais de projets de construction de grande ampleur et de projets sociaux. Il s'agirait en fait de “socialisme”, même si ses partisans ou adversaires se plaisent à le dénommer “fascisme”.
• 4 : Elle pourrait chercher à se prolonger par l’expédient “externe” de la guerre — qui, maintenant qu’il n’y avait plus de "guerres faciles" à mener, devrait être une guerre “dure”, une impressionnante démonstration de force, dont la mise en scène nécessiterait cependant dans une large mesure les démarches organisationnelles et politiques évoquées dans le point trois.
Dennis considérait préférable le troisième point pour l’Amérique, mais il estima le quatrième comme le plus probable. À la fin de 1939 et au début de 1940, comme il l’écrivait, cela commença à être mis en vigueur. Le nouveau style de guerre “dure” s’était déjà manifesté lors de la Première Guerre mondiale, causée en grande partie par le violent désaccord d’impérialismes capitalistes rivaux. Après cette guerre, qui avait favorisé l’émergence de régimes “socialistes” révolutionnaires — qu’ils soient communistes, fascistes ou nazis — parmi les nations qui sortirent du règlement du conflit avec le statut de pays démunis, avait surgi cependant une nouvelle possibilité : la prochaine grande guerre ne serait pas un affrontement entre capitalismes, mais entre un gang des démocraties capitalistes (toutes dans le même bateau de la dépression, après tout) et les nations “socialistes”. Le fait que ces puissances “socialistes” aient leurs propres griefs contre l’ordre démocratique imposé après-guerre, et qu’elles aient été suffisamment dynamiques et agressives pour y remédier, tout cela a contribué à les voir dénoncés aux masses et assemblées démocratiques comme des violateurs de “l’ordre” international et même de la “paix”, pour ne pas dire de la “civilisation” elle-même. Il ne manquerait pas de “causes” à une telle guerre, encore moins de raisons pour la justifier. Les puissances démunies étaient en effet dynamiques — comme seules les nations insatisfaites peuvent l’être — et ne se contentaient pas de redessiner les frontières européennes (et, dans le cas de l’Italie, coloniales), mais sapaient le capitalisme en Europe : réorganisation de systèmes entiers, redistribution des richesses et de l’autorité, politique d’autarcie et sortie du “système international” capitaliste du commerce et de la monnaie. Tout ce dynamisme s'inscrivait dans le cadre d'unités populaires nationalistes, des “socialismes” en fait, peu importe l’appellation, qui ne voyaient plus d'utilité à la subordination des volontés et des destins nationaux vis-à-vis des entreprises privées ou d'autres intérêts. [21].
C’est ainsi que Dennis estimait la grande guerre en gestation à partir de 1940, lorsque Staline, Hitler et Mussolini formaient un vague (mais non moins significatif pour autant) camp “socialiste”, contre lequel se dressaient les démocraties capitalistes ploutocratiques d’Europe, avec la plus ploutocratique de toutes guettant dans les coulisses, passablement irritée, le moment le plus opportun pour entrer en scène. Ce serait une autre croisade, vendue au troupeau américain en des termes choisis de bonne moralité mondiale, même si dans le fond ce n’est qu’un moyen pour le bon vieil ordre bien-de-chez-soi — l’ordre d’un capitalisme épuisé et d’une démocratie désespérée — de s’en tirer à bon compte en combattant la nouvelle révolution à l’étranger :
Partout, la nouvelle révolution est synonyme de redistribution et de réorganisation en phase avec les impératifs technologiques de l’ère de la machine. La cause des Alliés est celle de la contre-révolution. Elle maintient le statu quo et s’oppose à la redistribution selon les indicateurs du besoin, la capacité d’utilisation efficace des ressources et la commodité sociale. Elle vise à inverser en Europe les tendances dominantes, technologiques et politiques, du siècle passé et, plus particulièrement, des deux ou trois dernières décennies. Les démocraties [libérales] ont montré leur incapacité à utiliser leurs ressources de manière à mettre fin au chômage. Mais elles proposent maintenant une croisade au nom des absolus moraux pour empêcher la redistribution mondiale des matières premières et des opportunités économiques. Le véritable dilemme auquel l’Amérique est confrontée peut se résumer ainsi : parvenir à une redistribution dans son pays ou de la combattre à l’étranger. La ploutocratie qui s’oppose à la redistribution chez elle fait tout pour la combattre à l’étranger. Et les masses défavorisées qui ont besoin de redistribution en Amérique sont assez stupides pour mourir en combattant afin de l’empêcher à l’étranger. Il est probable que nous devrons parvenir à la solution du problème intérieur de la distribution par une vaine croisade pour empêcher la redistribution à l’étranger. Si cela se produit, cela enfoncera le dernier clou dans le cercueil de la démocratie dans ce pays. Et cela devrait appeler à une terrible vengeance après-guerre contre les responsables de cette grande tragédie du peuple américain. (Dynamics, p. 216) [chap. XV]
Indépendamment du fait qu’ils aient ou non remporté la victoire lors la croisade annoncée ou que les vainqueurs se soient vengés des vaincus par la suite, le capitalisme américain et sa démocratie allaient sortir de la guerre changés à jamais. Les explosions, celles des profits comme celles des combats, sonnaient véritablement le glas de la “révolution capitaliste”, le produit de 300 ans de frontières qui avaient été atteintes. La révolution qui s’ensuivrait pourrait être ou bien dirigée ou bien indirecte, ou bien spontanée ou bien évolutive — englober soit immédiatement soit progressivement tous les changements d’organisation et de direction politico-sociales que Dennis, pour sa part, trouvait souhaitables ou non. Mais décidément une révolution était en train de se faire, et les historiens finiraient par comprendre l’issue de cette guerre, comme sa genèse, comme différant profondément de celles des autres guerres lorsque le capitalisme était à son apogée. Le point de bascule vers une ère post-capitaliste — peu importe que de nombreux et même importants vestiges du capitalisme puissent subsister encore longtemps — avait été franchi, et ce tournant entraînerait d’énormes changements, dans le domaine de l’économie en particulier, mais également dans de nombreux autres domaines. Cela devrait et pourrait signifier, avant tout, l’effacement des distinctions entre public et privé. Pour Lawrence Dennis, ce n’était ni indésirable ni dangereux en soi, tant que cette hybridation œuvrait essentiellement en faveur de l’intérêt public.
Le spectre contre lequel il mit en garde et combattit par sa prise de parole décisive, et qu’après-guerre il vit se produire manifestement, était celui de cette nouvelle réalité convergente, issue des efforts désespérés de la démocratie capitaliste pour se prolonger, effaçant les différences entre national et international, et ultimement entre guerre et paix. Le capitalisme américain, après une Seconde Guerre mondiale, pouvait-il vraiment permettre une véritable paix ? Le doute persiste toujours quant aux raisons de miser sur sa capacité incertaine à assumer “honnêtement” — ou au moins avec le moindre espoir de réussite — des problèmes d’après-guerre aussi colossaux et persistants que : le piège de la déflation par la dette [22], un gonflement du marché du travail, la perte de l’unité politique interne et de crédibilité à l’étranger, la saturation des marchés intérieurs, la reconversion massive de l’industrie, et bien d’autres encore. Le capitalisme américain continuera probablement à contourner ses problèmes endémiques via le classique “expédient” de la guerre — même si la guerre n’était plus une guerre au sens ancien (pas plus que la paix d’ailleurs). Une guerre “froide” comblerait ce qui lui manque en intensité contenue par d’intermittentes fulgurances d’action de par le monde, entretenant ainsi planétairement un aigle militaire aux ailes déployées et prêt à fondre sur le moindre conflit, une présence politique et économique mondiale comme excuses pour un tel conflit, et une longévité sempiternelle — peut-être même sans fin.
Charles A. Beard, décrivant de façon sardonique et désabusée en 1948 les conséquences pratiques des politiques étrangères de Roosevelt-Truman alors que ces politiques devenaient un “consensus” grâce à l’esprit tant vanté du “bipartisme”, déclara que l’Amérique était désormais engagée dans la poursuite d’une “guerre perpétuelle pour une paix perpétuelle” [23]. Dennis s’accordait sur ce constat et reprit pour lui l’expression (qui s’est largement répandue avec le titre d’une étude révisionniste de la diplomatie rooseveltienne) à l’occasion. Si c’était lui qui dût l’inventer, il aurait pu la tourner ainsi : guerre perpétuelle pour stimuler la production, résorber le chômage, accroître des marchés et se rallier le peuple. Ou, plus brièvement : la guerre perpétuelle comme substitut à la frontière capitaliste perdue.

Réception critique de Dennis
 Il fallut environ une décennie après la Seconde Guerre mondiale pour que Dennis soit à nouveau considéré en termes intellectuels plutôt que polémiques concernant les problèmes de la guerre. En examinant les courants politiques radicaux dans son livre de 1955 American Political Thought (p. 415-428), le politologue Alan Pendleton Grimes traita le « Fascisme américain de Lawrence Dennis » comme une idéologie et un porte-parole exigés par la situation politique et sociale de la Dépression. Grimes s’est focalisé sur l’identification par Dennis du capitalisme à la démocratie non seulement comme modèle de parallèle historique mais aussi comme inscription dans la réalité contemporaine. Contrairement aux réformateurs populistes et progressistes, qui avaient tendance à voir le capitalisme (du moins le “mauvais” capitalisme pratiqué par les barons voleurs [24], les maniganceurs de trusts [trust spinners] et les spécialistes du montage de holdings pyramidales) comme contradictoire, voire antithétique, à la démocratie, Dennis soutenait qu’ils avançaient main dans la main. En tant qu’élitiste, il aspirait à briser les deux, nullement à les réformer. De l’avis de Grimes, la charge principale de la critique fasciste de Dennis ne portait pas tant sur la démocratie que sur le capitalisme du laissez-faire ; la démocratie était critiquée seulement en ce qu’elle permettait les folies du capitalisme, en lâchant la bride aux dirigeants d’entreprises privées. Les motivations de ces dirigeants d’entreprise, purement égoïstes et orientées vers la satisfaction de l'appât du gain, ne pouvaient qu’entrer en conflit avec les exigences normales du développement social et de l’ordre public. Avec le franchissement de la frontière, enrayant les possibilités d’une sorte de croissance socio-spirituelle corrélative à la croissance des entreprises, le conflit inhérent entre société civile et entreprises apparut au grand jour et devait être résolu d’une manière ou d’une autre. L’ère de la frontière, du “nationalisme militant” américain qui avait insufflé un élan spirituel de masse et non mercantile, voire unitaire, à l’expansionnisme lui permettant de se déployer aux côtés de la simple avidité commerciale, avait cédé la place à l’atomisme de masse dans une société désormais totalement dominée par la cupidité des affaires (et dressée pour pâtir de la stupidité des affaires). Le libéralisme économique du laissez-faire en théorie et la démocratie politique telle qu’elle était mise en pratique n’étaient pas adaptés pour faire face à la situation ; ils devaient donc être remplacés.
Il fallut environ une décennie après la Seconde Guerre mondiale pour que Dennis soit à nouveau considéré en termes intellectuels plutôt que polémiques concernant les problèmes de la guerre. En examinant les courants politiques radicaux dans son livre de 1955 American Political Thought (p. 415-428), le politologue Alan Pendleton Grimes traita le « Fascisme américain de Lawrence Dennis » comme une idéologie et un porte-parole exigés par la situation politique et sociale de la Dépression. Grimes s’est focalisé sur l’identification par Dennis du capitalisme à la démocratie non seulement comme modèle de parallèle historique mais aussi comme inscription dans la réalité contemporaine. Contrairement aux réformateurs populistes et progressistes, qui avaient tendance à voir le capitalisme (du moins le “mauvais” capitalisme pratiqué par les barons voleurs [24], les maniganceurs de trusts [trust spinners] et les spécialistes du montage de holdings pyramidales) comme contradictoire, voire antithétique, à la démocratie, Dennis soutenait qu’ils avançaient main dans la main. En tant qu’élitiste, il aspirait à briser les deux, nullement à les réformer. De l’avis de Grimes, la charge principale de la critique fasciste de Dennis ne portait pas tant sur la démocratie que sur le capitalisme du laissez-faire ; la démocratie était critiquée seulement en ce qu’elle permettait les folies du capitalisme, en lâchant la bride aux dirigeants d’entreprises privées. Les motivations de ces dirigeants d’entreprise, purement égoïstes et orientées vers la satisfaction de l'appât du gain, ne pouvaient qu’entrer en conflit avec les exigences normales du développement social et de l’ordre public. Avec le franchissement de la frontière, enrayant les possibilités d’une sorte de croissance socio-spirituelle corrélative à la croissance des entreprises, le conflit inhérent entre société civile et entreprises apparut au grand jour et devait être résolu d’une manière ou d’une autre. L’ère de la frontière, du “nationalisme militant” américain qui avait insufflé un élan spirituel de masse et non mercantile, voire unitaire, à l’expansionnisme lui permettant de se déployer aux côtés de la simple avidité commerciale, avait cédé la place à l’atomisme de masse dans une société désormais totalement dominée par la cupidité des affaires (et dressée pour pâtir de la stupidité des affaires). Le libéralisme économique du laissez-faire en théorie et la démocratie politique telle qu’elle était mise en pratique n’étaient pas adaptés pour faire face à la situation ; ils devaient donc être remplacés.Grimes considère que la critique par Dennis de la société capitaliste-démocratique ressemble à la conception de l’état de nature chez Thomas Hobbes : une guerre de tous contre tous, des parties contre des parties et contre le tout. Le système de laissez-faire par lequel l’État, supposé garant du bien public, n’intervenait pas dans ces luttes — ou n’intervenait qu’occasionnellement parce qu’un groupe d’intérêt avait momentanément réussi à s’imposer au sein de l’État au détriment d’autres groupes — était manifestement irrationnel. De plus, ce chaos avalisé par l’État se déroulait sous couvert éthique de ce qui représentait la fraude et de l’hypocrisie les plus élevées, à savoir le système juridique. Ce système promettait “un gouvernement de lois et non d’hommes”. Pour Dennis, cette notion était une pure fiction. Y croire conduisait à de faux espoirs comme celui que “la volonté des peuples” ne pourrait jamais s’exprimer qu’à travers lui, et maintenait dans l’ignorance du fait que l’interprétation et l’administration des lois, et non les lois elles-mêmes, étaient cela seul qui compte. À tout moment, “la loi” ne devrait et ne pourrait signifier que ce que les élites qui contrôlent son application voulaient qu’elle signifie. En Amérique, et tout au long de l’histoire américaine, les élites au pouvoir étaient généralement les capitalistes et leurs partisans ; le pouvoir judiciaire “indépendant” dans un gouvernement de “séparation des pouvoirs” était une fabulation. Également chimérique était la notion de “liberté” telle qu’elle existe dans le cadre de la loi — la liberté formelle, c’est-à-dire la condition naturelle en l’absence de contrainte gouvernementale. La force et la coercition étaient omniprésentes, et cela faisait peu de différence pour ceux qui étaient contraints que la force soit appliquée par le gouvernement ou par le marché “libre”. Si, par ex., une personne à la recherche d’un emploi ne trouvait aucun emploi à la suite de décisions prises par des capitalistes privés, alors elle était contrainte au chômage comme s’il existait une loi contre l’emploi. Grimes cite Dennis : “La liberté tant vantée du capitalisme moderne est en grande partie une question de liberté des propriétaires fonciers vis-à-vis de la responsabilité sociale des conséquences de leurs décisions économiques” [25].
Grimes consacre environ la dernière moitié de son sous-chapitre sur Dennis à discuter de ses idées plus purement politico-philosophiques sur le pouvoir des élites, en dehors de tout contexte économique. Que Grimes ait commencé sa réflexion sur Dennis par le lien capitalisme-démocratie démontre sa conscience de l’importance de l’économie dans la genèse de la pensée de son sujet. Son traitement de 1955 a représenté la première étape sur la voie pour reconsidérer Dennis aussi sérieusement que les critiques de livres l’avaient fait autrefois, avant l’avènement de la guerre et de la “sédition”.
***
Le collègue politologue de Grimes, David Spitz, dans un sous-chapitre conséquent sur Dennis issu de son Patterns of Anti-Democratic-Thought (1949) (p. 64-92), avait auparavant aussi abordé le sujet avec sérieux. Mais Spitz ne fait aucune mention de l’élément anti-capitaliste dans la pensée politique de Dennis et se concentre plutôt sur sa théorie générale de “l’élite comme pouvoir”. Cette exclusion n’est pas en elle-même critiquable, puisque le livre de Spitz ne traite que de théorie politique. Toutefois ses critiques concernant Dennis auraient été plus abouties si elles avaient traité des fondements pratiques du monde réel, tels que Dennis les voyait et les interprétait, au sein de cette théorie. Les considérations de Dennis sur l’économie et son analyse économique se situent dans cette catégorie, et traiter la théorie de l’élite de Dennis sans discuter de sa critique étendue d’une véritable élite historique au pouvoir — l’élite capitaliste américaine — revient à retirer à l’analyse une part significative de sa raison d’être. Spitz en tout cas, après un examen scrupuleux de la théorie politique de Dennis, la rejette même s’il admet la vérité possible de sa prémisse, à savoir que les élites assoient toujours leur domination. Elles le peuvent, dit Spitz, mais Dennis avait tort de supposer que cela est nécessairement incompatible avec la démocratie, non pas en dépit de leur autorité irresponsable (oligarchique) mais grâce à elle [car leur volonté de puissance est un moyen et non une fin : There is still the crucial consideration that, for the state, as for man, force is essentially an instrument, not end but means]
***
 Pour Arthur M. Schlesinger Jr., rédigeant cela en 1960, Lawrence Dennis “a livré un plaidoyer du fascisme avec une audace saisissante d'intelligence et de style qui a bien failli (mais sans jamais tout à fait réussir à y arriver) lui procurer une audience plus large”. Il lui consacre cinq pages dans le troisième volume de son The Age of Roosevelt (pp. 74-78), dans un chapitre intitulé "The Theology of Ferment" qui traite de diverses manifestations et personnalités radicales, de gauche ou de droite, mis sur le devant de la scène publique pendant la Dépression. Après avoir considéré les “fascistes littéraires” Seward Collins et Ezra Pound comme “des personnages d’un spectacle parallèle, sans réel poids politique en Amérique”, Schlesinger se penche sur Dennis, y voyant le seul penseur fasciste qui possède une réelle importance significative. Admirant visiblement Is Capitalism Doomed ? en y relevant une attaque “finement argumentée” contre les politiques des banques d’investissement, Schlesinger décèle néanmoins dans ce mélange de réalisme froid et d'intellectualisation du combat chez Dennis des notes de “désespoir romantique” [26]. Il l’illustre par un passage appuyé de Dennis sur son pessimisme tiré d’une lettre privée non circonstanciée : “Je suis prêt à payer le prix en partant sur le pavé, ou à la Légion étrangère, ou avec un coup de pistolet dans la bouche… Rien ne me plairait plus que d’être un chef ou un partisan d’un Hitler qui écraserait et détruirait beaucoup de personnes actuellement au pouvoir. J’assume ma part de destinée qui est maintenant de souffrir. Ce sera peut-être un jour leur tour” [27].
Pour Arthur M. Schlesinger Jr., rédigeant cela en 1960, Lawrence Dennis “a livré un plaidoyer du fascisme avec une audace saisissante d'intelligence et de style qui a bien failli (mais sans jamais tout à fait réussir à y arriver) lui procurer une audience plus large”. Il lui consacre cinq pages dans le troisième volume de son The Age of Roosevelt (pp. 74-78), dans un chapitre intitulé "The Theology of Ferment" qui traite de diverses manifestations et personnalités radicales, de gauche ou de droite, mis sur le devant de la scène publique pendant la Dépression. Après avoir considéré les “fascistes littéraires” Seward Collins et Ezra Pound comme “des personnages d’un spectacle parallèle, sans réel poids politique en Amérique”, Schlesinger se penche sur Dennis, y voyant le seul penseur fasciste qui possède une réelle importance significative. Admirant visiblement Is Capitalism Doomed ? en y relevant une attaque “finement argumentée” contre les politiques des banques d’investissement, Schlesinger décèle néanmoins dans ce mélange de réalisme froid et d'intellectualisation du combat chez Dennis des notes de “désespoir romantique” [26]. Il l’illustre par un passage appuyé de Dennis sur son pessimisme tiré d’une lettre privée non circonstanciée : “Je suis prêt à payer le prix en partant sur le pavé, ou à la Légion étrangère, ou avec un coup de pistolet dans la bouche… Rien ne me plairait plus que d’être un chef ou un partisan d’un Hitler qui écraserait et détruirait beaucoup de personnes actuellement au pouvoir. J’assume ma part de destinée qui est maintenant de souffrir. Ce sera peut-être un jour leur tour” [27]. Compulsant ensuite The Coming American Fascism, Schlesinger remarque la facilité avec laquelle Dennis affirme qu’une variété de fascismes pourrait arriver au pouvoir et réussir aux États-Unis : l’organisation des grandes entreprises ainsi que la docilité invétérée, la standardisation et l’embrigadement du peuple américain — qui était déjà le plus grand consommateur de publicité au monde —, la propagande de toutes sortes et la domination de la presse et de la radio, n’ont rendu aucun autre pays “mieux préparé à la normalisation politique et sociale”. Concernant leur coutumière et revendiquée passion pour la “liberté”, 90 % du peuple américain n’aurait aucune compréhension de “quoi que ce soit”, même de ce que leur propre système idéologique était censé être. Ainsi, selon Dennis, “Une dictature fasciste peut très bien être instaurée par un démagogue au nom de tous les slogans du système actuel”. Par conséquent Schlesinger ausculte quelques aspects indicatifs divers et variés de la vision d’une Amérique fasciste selon Dennis. Pour ce qui est de déterminer qui ou quoi pourrait réaliser cette vision et provoquer la révolution, il s’en tient à l’importance que Dennis attache à l’idée de “l’élite”. Toutefois il note que Dennis est tantôt vague, tantôt contradictoire, sur qui constitue exactement “l’élite” fasciste ou, bien plutôt, la “contre-élite” fasciste latente convoitant le pouvoir. Malgré cela, il n’y a guère de doute quant à la constitution du groupe ou de la classe sociale particulière au nom de laquelle l’élite travaillerait : la dynamique révolutionnaire viendrait de “l’élite frustrée de la petite bourgeoisie” menacée de “déclassement” [“In 1935 Dennis found evidences of lower-middle-class insurgency on every side”]. Schlesinger prend Dennis au mot lorsque ce dernier déclare qu’il n’a aucune ambition politique personnelle, mais il voit en lui (et suppose que Dennis se considérait lui-même ainsi) les qualités d’un Goebbels, d’un homme de confiance très intelligent qui pourrait servir un véritable démagogue fasciste pour justifier une révolution :
Son style était habile, désinvolte et incisif. Sa critique a démystifié l’idéalisme angélique avec un effet salutaire. Il s’est efforcé de déplacer l’attention portée aux mots et symboles vers les réalités du pouvoir. Son écriture “réaliste”, malgré un clinquant et manque de tact, avait une acuité analytique qui la rendait plus saisissante que n’importe quelle pensée politique conservatrice ou libérales de l’époque.
Mais aucun démagogue fasciste véritablement influent n’a jamais émergé en Amérique (Huey Long, pour qui Dennis exprima son admiration comme “plus avisé qu’Hitler, même s’il a besoin d’une bonne équipe de conseillers”, aurait pu en devenir un), et Dennis se retrouvait seul à conjurer à l’aide de conjectures intellectuelles sur un fascisme américain mythifié et désiré. “Goebbels, après tout, avait à sa disposition un gouvernement pour transformer les rêves en réalité, et Dennis, seulement le Harvard Club”, conclut lapidairement Schlesinger. Quant à la réalité existante des militants fascistes américains, dont l'esprit contestataire s’accordait avec le sien sans nécessairement pouvoir le comprendre, Dennis a dû “progressivement réduire ses attentes” pour les atteindre. Se considérant comme “le porte-parole sophistiqué d’une élite révolutionnaire à une époque technologique”, Dennis, comme Seward Collins, a découvert à son grand dam que “l’élite qui devait sauver la civilisation s’est finalement avérée être une ribambelle de branquignols et de psychopathes, unis principalement par une peur obsessionnelle d’un complot juif imaginaire. Ce qui avait commencé comme une anticipation de l’apocalypse s’est terminé en sinistre farce”. [“The farceurs — the activists of American fascism — were mostly local adventurers or fanatics hoping somehow to capitalize on anxiety and unrest. Their ambitions gave these years a background of furtive and trivial melodrama”]
***
 Dans ses mémoires, Infidel in the Temple (1967), le journaliste et chroniqueur politique Matthew Josephson consacre quelques pages à sa rencontre avec Dennis au milieu des années 1930 (p. 318-24). Déjà fort intrigué par son rôle de témoin dans les enquêtes financières du Sénat en 1932 ainsi que par ses arguments dans Is Capitalism Doomed ?, et ayant entendu dire que Dennis était l’un des nombreux intellectuels pro-fascistes tenant Huey Long pour le futur Duce d’un fascisme américain, il sollicite Dennis au Harvard Club pour un entretien, dont ses mémoires restituent la teneur. “Tranchant dans le discours et aussi vif que j'avais été amené à m'y attendre”, constate-t-il à propos de Dennis qui se lance dans une discussion franche et sans retenue sur ses convictions et leurs origines. Citant Dennis (apparemment à partir de notes), Josephson divulgue quelques saillies provocatrices :
Dans ses mémoires, Infidel in the Temple (1967), le journaliste et chroniqueur politique Matthew Josephson consacre quelques pages à sa rencontre avec Dennis au milieu des années 1930 (p. 318-24). Déjà fort intrigué par son rôle de témoin dans les enquêtes financières du Sénat en 1932 ainsi que par ses arguments dans Is Capitalism Doomed ?, et ayant entendu dire que Dennis était l’un des nombreux intellectuels pro-fascistes tenant Huey Long pour le futur Duce d’un fascisme américain, il sollicite Dennis au Harvard Club pour un entretien, dont ses mémoires restituent la teneur. “Tranchant dans le discours et aussi vif que j'avais été amené à m'y attendre”, constate-t-il à propos de Dennis qui se lance dans une discussion franche et sans retenue sur ses convictions et leurs origines. Citant Dennis (apparemment à partir de notes), Josephson divulgue quelques saillies provocatrices :Je tiens en piètre estime les banquiers. Il leur suffirait pourtant de ne pas se montrer si suffisants et pétris de morale ! (…) Les affaires seraient bien en peine de reprendre leur allure d’antan surtout quand nous marchons au bord du gouffre, soumis au vent d'une terrible inflation qui balaiera tout dans moins d’une année. (…) Mais Mme Roosevelt, Mlle Perkins et les autres conseillers du New Deal considèrent les États-Unis comme une fructueuse opportunité de “centre culturel” [settlement house] dans laquelle les femmes savantes et les notables diplômés peuvent exercer leur entregent aux frais du contribuable ! (…) Le New Deal n’est qu’un énorme bazar — et pourtant l’ancienne classe commerçante, les banquiers, les marchands, les politiciens et les dirigeants syndicaux restent en place. (…) Cela ne peut tout simplement pas continuer ainsi, pour le dire franco. L’avenir est au moins assuré pour les extrémistes. (…) Mais ici [les communistes] n’ont pas la moindre lueur d'espoir. La classe ouvrière — bah ! L’ascension du prolétariat ? Pas de votre vivant — ce n’est pas encore entré dans les mœurs. Le travailleur américain ne se donnera même pas la peine de prendre fait et cause pour sa classe sociale. Ce dont ce pays a besoin, c’est d’un mouvement radical qui parle américain. Non seulement nos travailleurs ne comprennent pas Marx, mais ils ne peuvent même pas le transposer. (p. 320-21)
Dennis — selon les souvenirs de Josephson — poursuit : seules les classes moyennes frustrées se battront pour le pouvoir ; les riches, confrontés en fin de compte à la menace perceptible du socialisme ou du communisme, se rallieront finalement au fascisme comme seule alternative :
“Après tout, le fascisme appelle à une révolution nationaliste qui laisse les propriétaires dans le même statut social qu’avant, bien qu’il leur interdise de faire entièrement ce qu’ils veulent de leur propriété. Alors, au lieu de détruire les compétences existantes comme le ferait un soulèvement communiste, l’État corporatif préserverait l’élite des experts et gestionnaires, seules personnes qui comprennent la production et peuvent faire fonctionner le système” (p. 323).
Autant Dennis prônait franchement le fascisme, autant il n’était pas du genre à embarquer dans un camion avec des fascistes locaux bagarreurs comme les “Silver Shirts”, ni à se ranger du côté de la bigoterie religieuse ou de la haine raciale primaire, qui ne l’intéressaient manifestement pas. Au contraire, il considérait sa mission comme purement éducative et doctrinale auprès de l’élite frustrée de la classe moyenne, seule à même de former un courant politique populaire défendant un fascisme américain. À propos de Huey Long, Dennis rapporte que “Long lit mes papiers” et lui a même demandé son aide pour écrire un livre sur la redistribution des richesses. Pour couronner le tout, Josephson relate qu’après avoir terminé leur conversation, au moment où Dennis quitte le Harvard Club, il est interpellé par un membre âgé qui s’exclame : “Oui, nous devons tous nous unir et lutter pour les libertés conquises par nos ancêtres qui ont développé la frontière !” La réponse courtoise mais ferme de Dennis tomba sans ambages : “Souvenez-vous Monsieur X, la frontière est terminée ; la liberté est une impasse sans issue”. Josephson conclut à l’époque, et restait du même avis en 1967, que Dennis lui semblait brillant mais perdu dans son obsession pour les questions de pouvoir pur et de stratégie : “Un type étrange et intelligent que ce Dennis, mais avec de grandes lacunes du côté humain”.
***
 Justus Drew Doenecke, historien de l’isolationnisme américain et des mouvements de droite, brise l’exclusion de Dennis comme non-pertinent par la littérature scientifique avec son article de 1972 sur Dennis en tant que “révisionniste de la guerre froide” [28]. Intéressé par la façon dont les isolationnistes pré-Pearl Harbor ont réagi — de différentes manières — à la guerre froide, Doenecke conclut que Dennis constitue un éminent exemple d’isolationniste resté constant dans son opposition aux engagements américains à l’étranger ; seul Dennis, par l’intermédiaire de son bulletin hebdomadaire The Appeal to Reason, “a offert une attaque cinglante contre toute la gamme de la politique américaine de la guerre froide”.
Justus Drew Doenecke, historien de l’isolationnisme américain et des mouvements de droite, brise l’exclusion de Dennis comme non-pertinent par la littérature scientifique avec son article de 1972 sur Dennis en tant que “révisionniste de la guerre froide” [28]. Intéressé par la façon dont les isolationnistes pré-Pearl Harbor ont réagi — de différentes manières — à la guerre froide, Doenecke conclut que Dennis constitue un éminent exemple d’isolationniste resté constant dans son opposition aux engagements américains à l’étranger ; seul Dennis, par l’intermédiaire de son bulletin hebdomadaire The Appeal to Reason, “a offert une attaque cinglante contre toute la gamme de la politique américaine de la guerre froide”.Doenecke accorde une attention particulière aux idées économiques de Dennis, centrales dans l’évolution de ses positions ultérieures. Après avoir passé en revue les arguments de Is Capitalism Doomed ?, The Coming American Fascism et The Dynamics of War and Revolution quant à la montée, la chute et le remplacement inévitable du capitalisme par une structure politique collectiviste, Doenecke remarque la similitude à première vue de cet argumentaire avec la critique marxiste du capitalisme. Pourtant, “l’orientation de la logique de Dennis était loin d’être marxiste ; il y avait de fortes différences”. En premier lieu, son “socialisme” n’est pas du tout utopique et ne postule aucune possibilité d’une société véritablement “sans classes” : il y aurait toujours des dirigeants et des dirigés, et les contestations ne porteraient que sur la façon dont les élites gouvernent, non sur le fait qu’elles gouvernent. Sous le “socialisme”, le prolétariat ne se gouvernerait jamais lui-même mais devrait être encadré par une élite managériale de techniciens et d’experts (Doenecke aurait pu noter ici la marque d’égalitarisme de Dennis : son “socialisme” garantit que toute personne ayant les capacités requises, quelle que soit sa “classe”, peut rejoindre cette “élite managériale” sans que les habituelles interférences économiques ou sociales ne fassent obstruction).
Dennis s’est en outre démarqué de Marx et du marxisme en rejetant les conceptions selon lesquelles tout l’ancien ordre capitaliste de l’entreprise commerciale devrait être renversé par une révolution violente et que, même si un ordre “socialiste mondial” devait remplacer entièrement et universellement le capitalisme, la paix universelle en résulterait : les nations “socialistes” se battraient inévitablement entre elles, tout comme le font les nations capitalistes. De par sa critique de la guerre froide, soulignant la futilité de l’emprise de l’Amérique après l’hégémonie à la fois sur le marché économique mondial et sur le marché des idées, Doenecke trouve en Dennis un des premiers précurseurs des historiens révisionnistes de la “nouvelle gauche” William Appleman Williams, Gabriel Kolko et Lloyd C. Gardner. Dennis a également anticipé la thèse du “fascisme rouge” soutenue par d’autres historiens, notant la facilité avec laquelle “tout ce qui a été énoncé [par l’establishment interventionniste] contre Hitler peut être répété contre Staline et la Russie”.
Le premier numéro de The Appeal to Reason paraît la même semaine en 1946 que celle où Churchill prononce son discours sur le “rideau de fer” à Fulton (Missouri). Moment à la fois critique, décisif, opportun où Dennis prévient qu’une nouvelle intervention américaine dans le monde, cette fois-ci pour arrêter le péché communiste au lieu du péché fasciste, n’entraînerait que la propagation du communisme — et par contrecoup au plan intérieur l’amplification de “l’étatisme” tant déploré par les conservateurs bellicistes. À une époque — celle de la Longue Marche de Mao Tsé-toung vers le pouvoir en Chine — où les conservateurs voyaient le communisme comme un monolithe mondial dirigé depuis Moscou, Dennis prédisait déjà que des divisions se développeraient au sein du “camp” communiste, la plus importante nation le composant étant celle d’Extrême-Orient, où existait “près d’un milliard de personnes dont on ne pourrait jamais faire des marionnettes des Slaves, même s’ils devenaient tous communistes”.
Dennis a souligné l’importance des préoccupations économiques de la “porte ouverte” [Open Door policy] dans la formulation et la mise en œuvre de la doctrine Truman, qui a été élaborée en partie à destination du Moyen-Orient, pour protéger les intérêts de la Standard Oil. Dans l’ensemble, la doctrine a servi l’Amérique (qui refusait d’importer autant qu’elle exportait) comme un substitut aux énormes prêts étrangers que Wall Street consentait dans les années 1920 dans le cadre de ses poussées d’expansion du marché. “Nous aurons — écrivait Dennis en 1947 — un marché illimité pour les produits agricoles ou manufacturés américains ainsi que pour la chair à canon”.
Doenecke a poursuivi avec un exposé — à partir principalement des numéros de The Appeal to Reason — du processus de développement ultérieur de la guerre froide selon Dennis : au plan intérieur l’hystérie de la chasse au rouge (il était contre et soutenait que “tout espion assez stupide se faire prendre par notre FBI est un bon débarras pour les rouges”), l’émergence du Tiers-Monde en tant que force dans les affaires mondiales, enfin les signes d’une “convergence” progressive entre USA capitalistes et Russie communiste (tous deux devenant des États-providence technocratiques et managériaux avec des économies planifiées et des monnaies contrôlées). Avec la débâcle du Vietnam, le temps de l’Amérique était enfin révolu après un “longue et impressionnante liste de succès” dans la construction d’empire ; c’était “le début de la fin de l’intervention américaine et de l’impérialisme d’outre-mer”. Dennis a vu sa propre longue liste d’avertissements et d’observations malheureusement justifiée par les revers désastreux pour l’Amérique dans le monde la plupart du temps.
La critique précoce et continue par Dennis de la guerre froide a démontré la cohérence de sa pensée économique depuis ses débuts. Il considérait la guerre froide comme le soutien d’un capitalisme qui continuait de décliner ; une implication étrangère massive, une production militaire massive et permanente à grande échelle et une course à l’espace ont été les substituts que le capitalisme américain a élaborés pour remplacer la frontière perdue. L’inflation associée à tout cela, que ce soit à des taux plus élevés ou plus bas, empêchait un autre krach, et l’ensemble de l’activité et des dépenses maintenaient le chômage à des niveaux acceptables. Et il ne pouvait se produire une surproduction conséquente dans une guerre froide mondiale, avec ses besoins “illimités” de produits à la fois commerciaux — attractifs pour les “alliés” potentiels — et militaires, si ces attraits commerciaux ne fonctionnaient pas. La guerre froide était donc fonctionnelle pour l’Amérique — mais avec un coût et un risque élevés. Les buts moraux planétaires professés au nom de la lutte ne seraient pas atteints, et la survie de la civilisation ou de la vie elle-même était ce qui était en danger dans ce grand jeu géopolitique.
En conclusion de son étude, Doenecke soulève de nombreux points de prescience et de perspicacité diagnostique dans la critique de Dennis. Il en critique aussi d’autres, notamment la foi persistante de Dennis dans une élite managériale apte à remplacer l’ancienne élite des politiciens capitalistes/démocrates. Sa puissance descriptive (et prédictive) “était intrinsèquement une arme à double tranchant. L’élite bureaucratique sûre de son rôle qui, à ses yeux, devrait calmer l’ardeur de croisade des bellicistes pourrait tout aussi bien se révéler le tenant d’un dogmatisme absurde qu’il a si souvent déploré chez les masses. Bien plutôt, il surdéterminait le bien-fondé du nouveau système de gestion”. En dernier lieu, Doenecke revient sur la place de Dennis dans l’histoire intellectuelle, non tant pour lui donner postérité intellectuelle (Dennis reste encore largement méconnu voire ignoré) que pour saluer son originalité (un homme en avance sur son temps, porté par une écriture aux accents prophètiques pour défier l'horreur du siècle américain) : “Il a établi la relation entre frontières et marchés au moins vingt ans avant que la Wisconsin School en histoire diplomatique ne naisse”. Sans doute son exil intérieur après la Seconde Guerre mondiale a-t-il avivé l'implacabilité de son analyse : en lançant un bulletin d’information polycopié depuis son garage, libre de toute publicité et de toute pression éditoriale ou académique, il pouvait exercer une parole libre. Depuis cette période de confidentialité, plus de personnes, directement marqués par lui ou non, ont sans détour reconnu sa valeur disruptive.
***
 L’historien Ronald Radosh est très proche d’inspiration de Doenecke dans le premier des deux chapitres consacrés à Dennis dans son livre Prophets on the Right : Profiles of Conservative Critics of American Globalism (1975) (p. 275-322) (les autres “prophètes” étant Charles A. Beard, Oswald Garrison Villard, Robert A. Taft et John T. Flynn). Le premier chapitre se concentre sur Dennis en tant que “fasciste dissident américain” et examine ses positions des années 1930 jusqu’au début des années 1940, ainsi que ce qui lui est arrivé pendant la guerre pour les avoir prises. Le traitement du procès pour sédition est d’ailleurs plus fouillé que dans toutes les autres études sur Dennis. Il convient également de noter la scrupuleuse prise en compte par Radosh de la réaction à l’anti-capitalisme mature de Dennis (tel qu’exprimé dans The Dynamics of War and Revolution) de la part des intellectuels communistes américains, qui le prenaient vraiment très au sérieux. Ceux-ci, tout en affirmant que le fascisme prôné par Dennis ne reviendrait qu’à un capitalisme d’État réactionnaire et à la répression des travailleurs, pouvaient néanmoins trouver beaucoup de pertinence à sa critique du capitalisme libéral à l’ancienne et des folies de la démocratie, alors qu’elle était jugée irrecevable par le libéralisme conventionnel ou le conservatisme.
L’historien Ronald Radosh est très proche d’inspiration de Doenecke dans le premier des deux chapitres consacrés à Dennis dans son livre Prophets on the Right : Profiles of Conservative Critics of American Globalism (1975) (p. 275-322) (les autres “prophètes” étant Charles A. Beard, Oswald Garrison Villard, Robert A. Taft et John T. Flynn). Le premier chapitre se concentre sur Dennis en tant que “fasciste dissident américain” et examine ses positions des années 1930 jusqu’au début des années 1940, ainsi que ce qui lui est arrivé pendant la guerre pour les avoir prises. Le traitement du procès pour sédition est d’ailleurs plus fouillé que dans toutes les autres études sur Dennis. Il convient également de noter la scrupuleuse prise en compte par Radosh de la réaction à l’anti-capitalisme mature de Dennis (tel qu’exprimé dans The Dynamics of War and Revolution) de la part des intellectuels communistes américains, qui le prenaient vraiment très au sérieux. Ceux-ci, tout en affirmant que le fascisme prôné par Dennis ne reviendrait qu’à un capitalisme d’État réactionnaire et à la répression des travailleurs, pouvaient néanmoins trouver beaucoup de pertinence à sa critique du capitalisme libéral à l’ancienne et des folies de la démocratie, alors qu’elle était jugée irrecevable par le libéralisme conventionnel ou le conservatisme.Le deuxième chapitre sur Dennis le considère comme “Un critique laissez-fairiste de la guerre froide”. Ce titre n’est pas sans instiller un malaise diffus, que la lecture du chapitre ne suffit pas à dissiper : Radosh affirme que Dennis après la Seconde Guerre mondiale “est revenu” à la théorie économique du laissez-faire et a développé un “laissez-fairisme persistant” (p. 299). Le problème avec cette affirmation est qu’elle se révèle abusive — du moins si on prend “laissez-faire” dans toute l’acception du terme et non en un sens restreint comme Radosh. Il ne cite à cet égard qu’un seul passage (tiré d’un numéro de The Appeal to Reason) pour justifier directement cette affirmation : Dennis y évoque une époque où “les dissidents, les rebelles et les non-conformistes” pour des raisons “d’expression religieuse ou intellectuelle, de liberté et d’indépendance” partageaient la dynamique capitaliste avec les hommes de pure cupidité. À partir de cela et de quelques autres déclarations (où Dennis décrit le complexe militaro-industriel contemporain, contre lequel il est tout à fait opposé, comme “socialiste” ou “socialiste totalitaire”), Radosh tente de montrer que Dennis a non seulement renoncé au fascisme mais a également viré en un libéral économique. La vérité est que Lawrence Dennis est devenu un libéral économique classique à peu près dans la même mesure que Ludwig von Mises est devenu un marxiste. Si Radosh avait effectué une lecture minutieuse d’Operational Thinking for Survival, la somme de 1969 qui a couronné sa réflexion sur l’après-guerre (Radosh ne mentionne ce livre qu’une seule fois, dans une note de bas de page à l’avant-dernière page de son chapitre), il aurait réfléchi au moins deux fois avant de présenter une image de Dennis en partisan du “laissez-faire”. (En particulier, il aurait pu méditer le premier appendice — “Is the ‘New Economics’ a success or a failure ?” — dans lequel les laissez-fairistes sont poliment ridiculisés).
Les propos admiratifs de Dennis pour le capitalisme entrepreneurial à petite échelle et à l’ancienne “des dissidents, des rebelles et des non-conformistes”, auxquels Radosh accorde autant de poids qu’un revirement intellectuel, n’ont en réalité rien de nouveau ou de remarquable dans le corpus des écrits de Dennis. Dennis tenait le même discours — à propos des composantes non économiques ou “spirituelles” de l’activité économique et d’autres activités à l’apogée de la “révolution capitaliste” en Amérique — lorsqu’il enthousiasmait les gauchistes avec ses premières attaques tranchantes contre les entreprises commerciales américaines, et plus tard lorsqu’il proclamait son fascisme. Radosh aurait bien fait de considérer, comme Alan Pendleton Grimes l’avait fait vingt ans plus tôt, la discrète dichotomie que Dennis a toujours opérée entre capitalisme entrepreneurial “indépendant” et “grande” entreprise ou entreprise monopolistique : le premier pouvait être motivé par toutes sortes de motifs (tels que ceux nommés par Dennis dans le passage cité par Radosh), le second était plus susceptible d’être motivé par une pure stratégie de gain — mais à l’ère de la frontière américaine, les tendances des deux réunies pouvaient se compléter et se sont complétés l’une l’autre, se combinant pour remplir un vaste objectif social en développant et définissant la jeune conscience nationale et en façonnant dans le même élan l’ordre concret des affaires. Or le point de vue de Dennis intégrait le fait qu’avec le passage de la frontière, une telle condition ne tenait plus ; le dynamisme social / spirituel des “frontaliers” américains en quête de gloire personnelle ou nationale avait été remplacé par un dynamisme commercial omniprésent ne poursuivant que des résultats comptables. Il n’y avait pas de remplacement pour la frontière, et l’ère du laissez-faire en tant qu’utile et bénéfique socialement et nationalement était révolue et ne reviendrait pas.
Ainsi Radosh, en déclarant que Dennis “est revenu” à son engagement envers le laissez-faire et s’est converti en laissez-fairiste, non seulement mésinterprète complètement la position de Dennis (une erreur qu’il aurait facilement pu éviter en examinant le dernier livre de Dennis) mais se trompe aussi sur le notion de “retour”, tant en ce qui concerne Dennis personnellement (il ne pouvait pas “revenir” à une position qu’il n’avait en fait jamais tenue) qu’en ce qui concerne l’analyse plus large : le point focal de Dennis, un point constant qui a informé ses œuvres de la première à la dernière, s’avère sans appel : concernant l’ère du laissez-faire en Amérique le retour en arrière était impossible.
Radosh mésinterprète similairement les jugements de Dennis quant au caractère “socialiste” de l’économie militaro-industrielle américaine pendant la guerre froide (p. 300). Il semble ne retenir que le fait qu’ici Dennis critique et déplore ce “socialisme” en tant que tel, plutôt que de simplement : a) critiquer les origines et utilisations de ce développement dans l’interventionnisme planétaire, et b) exposer la fraude et l’hypocrisie d’un système qui affirme invariablement son attachement à la “libre entreprise” tout en pratiquant un mode de fonctionnement “socialiste” afin de combattre et endiguer le socialisme ! Dennis manifestait un fort penchant pour l’expression ironique dans ses écrits, souvent proche du sarcasme, et l’un de ses modes favoris d’argumentation pour défier ses adversaires était de mesurer et de considérer leurs actions, ou les résultats de leurs politiques, non pas sur les siens mais sur leurs propres termes professés, trouvant précisément en ceux-ci une défaillance de sens — voire un usage antithétique. [Une erreur, source de toutes les erreurs, et qui semble commune à tous les hommes, c'est de juger le mot au lieu de la chose : ce qu’ils ont condamné sous une dénomination, ils l’approuvent sous une autre, notait déjà Malesherbes] Ce procédé est flagrant dans son brocardage d’un establishment entremêlant politiques et grandes entreprises durant la guerre froide, qui de plus affiche un dévouement au modèle américain de libre entreprise tout en s’efforçant, au nom d’une lutte mondiale contre les opposants à ce modèle, d’éluder sur un plan intérieur la complaisance dans un partenariat subventionné permanent entre grandes compagnies et gouvernement. La dénonciation de l’hypocrisie et la déploration de ses finalités internationalistes étaient les angles d’attaque de Dennis contre ce “socialisme”, et en rien une attaque contre le “socialisme” ou le partenariat public-privé en soi, une subtilité qui semble avoir échappé à Radosh.
Radosh échoue donc dans sa tentative de reconsidérer Dennis en laissez-fairiste repenti, une révision critique qui impliquerait un travail considérable pour établir que Dennis pourrait rejeter allègrement un principe fondamental de sa pensée durant des décennies et apparemment sans même s’en rendre compte. Cela impliquerait également d’expliquer comment il se peut que d’autres commentateurs récents de Dennis, y compris Justus Doenecke — celui qui, pour reprendre Radosh même, a “ouvert la voie à la réévaluation de Lawrence Dennis” — soient passés complètement à côté de cet aspect du sujet.
Pourtant, mis à part le fourvoiement de sa thèse, le chapitre de Radosh reste très estimable. À bien y regarder, la thèse, même si elle apparaît dans le titre du chapitre, n’occupe pas vraiment une place centrale dans l’ensemble de la présentation, qui a le mérite d’offrir la discussion explicative la plus approfondie à ce jour des critiques de Dennis sur la guerre froide. Le problème de Radosh réside simplement dans sa volonté trop rapide d’étiqueter Dennis “comme” quelque chose en termes idéologiques familiers — et ce travers, pour être exact, n’est pas relatif dans cet ouvrage au seul traitement de Dennis [29]. En tout cas, et dans des jugements avec lesquels il ne peut y avoir d’objection, Radosh estime en définitive Dennis “notre critique le plus ancien et le plus cohérent de la guerre froide”, et celui qui le premier, bien avant William Appleman Williams [30], a repris la “thèse de la frontière” de Turner et l’a appliquée aux relations entre la politique, l’idéologie et l’économie en analysant le nouveau rôle activiste de l’Amérique dans les affaires mondiales.

Une réhabilitation qui tarde
J. Doenecke notait déjà en 1972 qu’“une biographie complète [de Dennis] s'avère vraiment indispensable” [31]. En 2001, c’est toujours le cas, et ce qui ressort de prime abord dans les traitements monographiques de Dennis parus depuis 1972, par Doenecke lui-même et par d’autres, c’est qu’ils restent si peu nombreux pour celui qui eut un impact intellectuel et politique indéniable sur son époque, comme en témoigne le volume imprimé de cette époque. Même sur la petite échelle d’une monographie, il n’y a pas encore eu de tentative de traitement mesuré et synthétique de toutes les lignes de pensée de Dennis, aux fins d’une évaluation d’ensemble ; au lieu de cela, il y a eu des traitements consacrés à des domaines particuliers. Sa pensée économique a eu tendance à s’effacer dans ces traitements. Il est certain que tout biographe de Dennis devrait être versé dans l’économie politique et l’histoire économique pour à la fois comprendre et critiquer les thèmes de son sujet [32].
Il est plus que temps de se livrer à une critique majeure de toutes ces idées. Dennis a en effet couvert un vaste domaine de questions dans sa carrière prolifique et diversifiée en tant qu’observateur intellectuel de son temps, une période de bouleversements et de changements politiques, sociaux et économiques considérables dans ce pays et dans le monde. Son parcours fut long et mouvementé : fonctionnaire du Département d’État au cœur d’une révolution précoce du “tiers-monde”, cadre bancaire au début de l’effondrement économique, critique du capitalisme pendant la dépression, partisan du fascisme, opposant à l’intervention lors de la Seconde Guerre mondiale, personnage clé dans l’une des affaires juridiques majeures de notre époque en matière de libertés civiles et de liberté d’expression, analyste de la guerre froide et du “nouveau style” de partenariat entre grandes entreprises privées et gouvernements américains. Son rôle intellectuel fut bien plus que celui d’observateur et de critique. Son impact politique est incontestable, même s’il se limite surtout à la période du New Deal avant et pendant la guerre, et même si ce n’est pas tant à cause de son impact sur la politique gouvernementale qu’en raison de ce qu’on pourrait appeler “l’anti-politique” qu’il a été tenu par les décideurs politiques et partisans du New Deal comme un adversaire contre lequel, de par son influence potentielle, le public devait être mis en garde, et finalement comme un danger réel qui devait, si possible, être muselé par la loi. C’est justement en tant que figure “anti-” qu’on se souvient surtout de lui quand il est évoqué en passant. C’est probablement approprié, car Lawrence Dennis n’a jamais rien remporté.
Le fait qu’une partie au moins de ce qu’il avait à dire aurait pu néanmoins mériter un examen sérieux de la part des décideurs politiques est une possibilité que les universitaires n’ont ouvertement admise que très récemment. Pourtant, tous ceux qui l’ont considéré au fil des ans, qu’il s’agisse d’opposants polémiques des années 1930 et 1940 ou d’universitaires neutres des années 1970 et plus tard, ont partagé avec lui son exigence intérieure résonnant comme un défi à son époque : l’Amérique du XXe siècle n’avait pas eu d'opposition au libéralisme, politique et économique, plus articulée et plus vigoureuse que celle de Lawrence Dennis. C’est ce qui le rend si inclassable : en remettant en question le libéralisme, tant dans sa forme “classique” plus ancienne que dans sa forme moderne, il remettait également en cause à la fois le conservatisme et le libéralisme de son époque, qui régnaient en maître.
► Keith Stimely, The Occidental Quarterly n°1/2001.
[version anglaise : html - autre html / pdf] [pdf VF]
Notes :
 1. James Burnham a été pris ouvertement pour cible en raison de larges “emprunts intellectuels” — qui plus est non attribués. Le politologue David Spitz a démontré de manière convaincante la dette intellectuelle de Burnham envers les écrits publiés antérieurement de Lawrence Dennis autant dans les concepts clés que dans la phraséologie. Voir David Spitz, Patterns of Anti-Democratic-Thought (1949), p. 300 et p. 308-309, ce dernier présentant une comparaison concept par concept et page par page. Max Nomad, dans Aspects of Revolt (1932, p. 15), a affirmé que Burnham avait pris l’idée de la “révolution managériale” des discussions des idées du révolutionnaire polonais du tournant du siècle Jan Waclav Makhaïski [Sur Rizzi et Makhaïski, lire Agone n°41/42, 2009]. Pour lui, Burnham était “un auteur qui n’accordait aucune mention à ses prédécesseurs quand bien même il fut professeur d’éthique” (Apostles of Revolution, 1939). Bruno Rizzi et d’autres ont accusé Burnham d’avoir plagié La Bureaucratisation du Monde de Rizzi (publié sous le diminutif de “Bruno R.”, Les Presses modernes, Paris, 1939) [rééd. partielle, Champ Libre, 1976, recension, où Guy Debord avertit froidement : “L’Américain Burnham fut le premier à se faire un nom, avec L'Ère des organisateurs, en récupérant tout de suite cette critique prolétarienne de la bureaucratie, la travestissant pour son compte en éloge inepte d’une hausse tendancielle du pouvoir de décision et de compétents ‘managers’ dans l’entreprise moderne, au détriment des simples détenteurs de capitaux”], un ouvrage qui figurait de manière importante dans les controverses doctrinales trotskistes de 1939-40, afin de écrire The Managerial Revolution (1941) [trad. fr. : L’Ère des organisateurs, 1947] ; voir Adam Westoby, « Introduction », dans Bruno Rizzi, The Bureaucratization of the World (Free Press, NY, 1985 [recension] ou Tavistock Press, Londres, 1985 [recension]). [voir aussi Samuel Francis, James Burnham, Claridge Press, Londres, 1999, p. 26-27, pour une réfutation des charges de plagiat par Burnham. Précisons que S. Francis y élabore le concept d’État managérial utilisé pour critiquer la démocratie procédurale moderne]
1. James Burnham a été pris ouvertement pour cible en raison de larges “emprunts intellectuels” — qui plus est non attribués. Le politologue David Spitz a démontré de manière convaincante la dette intellectuelle de Burnham envers les écrits publiés antérieurement de Lawrence Dennis autant dans les concepts clés que dans la phraséologie. Voir David Spitz, Patterns of Anti-Democratic-Thought (1949), p. 300 et p. 308-309, ce dernier présentant une comparaison concept par concept et page par page. Max Nomad, dans Aspects of Revolt (1932, p. 15), a affirmé que Burnham avait pris l’idée de la “révolution managériale” des discussions des idées du révolutionnaire polonais du tournant du siècle Jan Waclav Makhaïski [Sur Rizzi et Makhaïski, lire Agone n°41/42, 2009]. Pour lui, Burnham était “un auteur qui n’accordait aucune mention à ses prédécesseurs quand bien même il fut professeur d’éthique” (Apostles of Revolution, 1939). Bruno Rizzi et d’autres ont accusé Burnham d’avoir plagié La Bureaucratisation du Monde de Rizzi (publié sous le diminutif de “Bruno R.”, Les Presses modernes, Paris, 1939) [rééd. partielle, Champ Libre, 1976, recension, où Guy Debord avertit froidement : “L’Américain Burnham fut le premier à se faire un nom, avec L'Ère des organisateurs, en récupérant tout de suite cette critique prolétarienne de la bureaucratie, la travestissant pour son compte en éloge inepte d’une hausse tendancielle du pouvoir de décision et de compétents ‘managers’ dans l’entreprise moderne, au détriment des simples détenteurs de capitaux”], un ouvrage qui figurait de manière importante dans les controverses doctrinales trotskistes de 1939-40, afin de écrire The Managerial Revolution (1941) [trad. fr. : L’Ère des organisateurs, 1947] ; voir Adam Westoby, « Introduction », dans Bruno Rizzi, The Bureaucratization of the World (Free Press, NY, 1985 [recension] ou Tavistock Press, Londres, 1985 [recension]). [voir aussi Samuel Francis, James Burnham, Claridge Press, Londres, 1999, p. 26-27, pour une réfutation des charges de plagiat par Burnham. Précisons que S. Francis y élabore le concept d’État managérial utilisé pour critiquer la démocratie procédurale moderne] 2. L’exposé le plus systématique sur le pouvoir sans propriété se trouve dans Adolf A. Berle, Power Without Property : A New Development in American Political Economy (Harcourt, Brace & World, NY, 1959), mais l’idée avait été ébauchée dans le célèbre ouvrage de Berle avec Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property (1933) [présentation] [rééd. 1968] [analyse] [enjeu], et enfin affiné dans Power (1969). Dennis et Berle ne pouvaient en aucun cas s’entendre sur autre chose que sur le fait que le contrôle dans les sociétés passait rapidement des entrepreneurs-propriétaires aux techniciens-gérants ; voir l’approche de “bonimenteur de foire” par Berle à l’égard de l’entreprise commerciale américaine dans The Twentieth Century Capitalist Revolution (1954) et The American Economic Republic (1965) qui contraste avec celle de “médecin légiste” par Dennis dans toutes ses œuvres.
2. L’exposé le plus systématique sur le pouvoir sans propriété se trouve dans Adolf A. Berle, Power Without Property : A New Development in American Political Economy (Harcourt, Brace & World, NY, 1959), mais l’idée avait été ébauchée dans le célèbre ouvrage de Berle avec Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property (1933) [présentation] [rééd. 1968] [analyse] [enjeu], et enfin affiné dans Power (1969). Dennis et Berle ne pouvaient en aucun cas s’entendre sur autre chose que sur le fait que le contrôle dans les sociétés passait rapidement des entrepreneurs-propriétaires aux techniciens-gérants ; voir l’approche de “bonimenteur de foire” par Berle à l’égard de l’entreprise commerciale américaine dans The Twentieth Century Capitalist Revolution (1954) et The American Economic Republic (1965) qui contraste avec celle de “médecin légiste” par Dennis dans toutes ses œuvres.3. Max Nomad, Rebels and Renegades (1932 ; rééd. Books for Libraries Press, NY, 1968), Apostles of Revolution (1939 ; rééd. Collier Books, NY, 1961), Aspects of Revolt (Bookman Associates, NY, 1959) et Political Heretics (University of Michigan Press, Ann Arbor, 1963).
4. James Burnham, dans The Managerial Revolution (1941), a proposé l’expression “élites managériales”. Il en donne une explication sommaire dans « The Theory of the Managerial Revolution », Partisan Review, VIII (1941), pp. 181-97 ; les premiers échos de cette théorie, issue des controverses de Burnham avec la Quatrième Internationale trotskiste, se retrouvent dans deux textes, “Science et style : une réponse au camarade Trotsky” (1940) et “Lettre de démission de James Burnham au Parti des travailleurs” (1940), reproduits dans Leon Trotsky, in : Defence of Marxism (Pathfinder Press, NY, 1976) [trad. fr. : Défense du marxisme, Edi, 1972]. Une étude sérieuse de l’ensemble de la pensée de Burnham est celle de Samuel T. Francis, Power and History : The Political Thought of James Burnham (1984). Pour un aperçu historique et analytique des applications commerciales du concept associé au nom de Burnham, voir Alfred Chandler, The Visible Hand : The Managerial Revolution in American Business (1977) [trad. fr. : La Main visible des managers, d'Alfred Chandler, Economica, 1989, présentation].
 [Le sociologue Charles Wright Mills se démarqua très tôt de Burnham (le rapprochant de Dennis). Cf « A Marx for the Managers » (Ethics n°2, 1942). Pourtant tous deux cherchaient à approfondir le rapport entre marxisme et élitisme. Pour Mills, Burnham, nonobstant sa radicalité, justifiait la mobilisation pour le capitalisme de son époque, ce qui ne pouvait qu’exhorter Mills à affiner son cadre théorique et sa psychologie des institutions et des rôles sociaux. Dans sa recherche consacrée aux leaders syndicaux aux États-Unis, son objectif est clairement la réfutation de L’Ère des organisateurs. Il ouvre ainsi en son temps un débat au sein de la sociologie politique des élites : Le pouvoir politique des élites ne résulte pas du pouvoir économique (domination des classes dirigeantes selon le marxisme) mais de leur rôle au sein du jeu institutionnel. Dans The Power Elite (1956 ; trad. fr. : L'Élite au pouvoir, Agone, 2012, recension 1, recension 2, recension 3, extrait 1, extrait 2, extrait 3), Mills évoque l’émergence d’un “triangle du pouvoir” entretenant la pérennisation d’une économie de guerre, autrement dit la collusion des militaires, industriels et politiciens dans un “complexe militaro-industriel” (military–industrial complex), dénoncé — ironie de l’histoire — par Eisenhower lui-même dans son discours de fin de mandat présidentiel en 1961]
[Le sociologue Charles Wright Mills se démarqua très tôt de Burnham (le rapprochant de Dennis). Cf « A Marx for the Managers » (Ethics n°2, 1942). Pourtant tous deux cherchaient à approfondir le rapport entre marxisme et élitisme. Pour Mills, Burnham, nonobstant sa radicalité, justifiait la mobilisation pour le capitalisme de son époque, ce qui ne pouvait qu’exhorter Mills à affiner son cadre théorique et sa psychologie des institutions et des rôles sociaux. Dans sa recherche consacrée aux leaders syndicaux aux États-Unis, son objectif est clairement la réfutation de L’Ère des organisateurs. Il ouvre ainsi en son temps un débat au sein de la sociologie politique des élites : Le pouvoir politique des élites ne résulte pas du pouvoir économique (domination des classes dirigeantes selon le marxisme) mais de leur rôle au sein du jeu institutionnel. Dans The Power Elite (1956 ; trad. fr. : L'Élite au pouvoir, Agone, 2012, recension 1, recension 2, recension 3, extrait 1, extrait 2, extrait 3), Mills évoque l’émergence d’un “triangle du pouvoir” entretenant la pérennisation d’une économie de guerre, autrement dit la collusion des militaires, industriels et politiciens dans un “complexe militaro-industriel” (military–industrial complex), dénoncé — ironie de l’histoire — par Eisenhower lui-même dans son discours de fin de mandat présidentiel en 1961]5. Les romans de George Orwell 1984 (1949) et Animal Farm (1946) mettent en scène cette stratégie de la tension. Instructif dans le contexte actuel est le point de vue d’Orwell sur Burnham exposé dans deux articles “James Burnham and The Managerial Revolution” et “Burnham's View of the Contemporary World Struggle”, tous deux dans Sonia Orwell et Ian Angus (dir.), The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Vol. IV : In Front of Your Nose, 1945-1950 (1968) [Trad. fr. : « James Burnham et l’ère des organisateurs », « La lutte pour la domination mondiale selon Burnham », in : Essais, articles, lettres, vol. 4, Ivrea, 1996. Signalons également la recension en 1944 des Machiavéliens de Burnham dans : Écrits politiques 1928-1949, Agone, 2009]. On trouvera par ailleurs une magistrale lecture croisée entre le théme orwellien de la guerre pour relancer l’économie (et la consommation interne) et le monde réel des années 50 dans Harry Elmer Barnes, « How ‘Nineteen Eighty-Four’ Trends Threaten American Peace, Freedom, and Prosperity », écrit en 1953 mais publié pour la première fois 27 ans plus tard dans Barnes, Revisionism : A Key to Peace, and Other Essays (Cato Institute, SF, 1980), pp. 137-76.
 [Getting along with Communism, Stalinist or Maoist, was something which hardly tasked their powers. The English writer George Orwell fully recognized the ability of the two Eurasian Red worlds to “co-exist” with the non-Communist Western one, and the necessary part all three played in propping up one another and providing each in tum with excuses for their home populations when they adopted one program or another, despite occasionally sounding as though they were the most implacable of opponents. This is the core of Orwell’s famed novel Nineteen Eighty-four, originally titled Nineteen Forty-eight, and published in 1949. This book was not a futuristic science fiction tale ; in novelized form it described the real world of 1948, and everything in it was either in existence or well along the line of production. And his description of the beatings and coolings, the hostilities and the detentes, among the three-fold world masters, was anything but an imagination of things to come. As for the purely Soviet vs. "Western world" confrontation, with all its spy scares and provocative episodes, despite it all, they both managed, with great solemnity, to exchange the job every month of guarding seven German prisoners in the immense Spandau prison in Berlin, a ceremony of far more than passing interest and even greater significance in revealing who their common enemy really was. The Cold War neatly concealed their joint conduct of warfare on the Germans for years after the formal termination of the shooting in May, 1945.
[Getting along with Communism, Stalinist or Maoist, was something which hardly tasked their powers. The English writer George Orwell fully recognized the ability of the two Eurasian Red worlds to “co-exist” with the non-Communist Western one, and the necessary part all three played in propping up one another and providing each in tum with excuses for their home populations when they adopted one program or another, despite occasionally sounding as though they were the most implacable of opponents. This is the core of Orwell’s famed novel Nineteen Eighty-four, originally titled Nineteen Forty-eight, and published in 1949. This book was not a futuristic science fiction tale ; in novelized form it described the real world of 1948, and everything in it was either in existence or well along the line of production. And his description of the beatings and coolings, the hostilities and the detentes, among the three-fold world masters, was anything but an imagination of things to come. As for the purely Soviet vs. "Western world" confrontation, with all its spy scares and provocative episodes, despite it all, they both managed, with great solemnity, to exchange the job every month of guarding seven German prisoners in the immense Spandau prison in Berlin, a ceremony of far more than passing interest and even greater significance in revealing who their common enemy really was. The Cold War neatly concealed their joint conduct of warfare on the Germans for years after the formal termination of the shooting in May, 1945.In the USA, the dominant forces of finance, industry, commerce and agriculture must have gone to considerable effort to suppress a continuous guffaw while trembling in public about the “menace of Communism”, and pursuing minor functionaries (but never anyone of substantial prominence) for allegedly advancing the interests of the other via some espionage caper. Though reenacted in many ways, as Orwell correctly recognized, this was essentially a deception, and intended to make easier the advancement of domestic policy, though his effort to alert the English-speaking world about the nature of this basically dishonest “cold war”, via the devices of fiction, was shortcircuited. The clever conversion of his commentary in novel form on the world of 1948 into a tale supposedly of things in the world to come, some 35 years away, was a publisher’s smart sales ploy as well as a fundamental diversion of its readers from its real message. Had The Balance Sheet of Ratification 195 Orwell lived, it would have been interesting to see if he would have commented on the basic alteration achieved in distorting his principal thesis.
The “West” faced about as much of a threat to their economic power from Communism as the world of the Industrial Revolution even in its early decades faced from a system no further along than stone hatchets. They had put down the real threats to their power in destroying the Halo-German-Japanese revolutionary upstarts, whose incredible energy and organizing genius, even considering their considerable handicaps, must have thrown a serious fright into many of their antagonists in the struggle of 1939-1945, especially when they thought about the future. The new world now in the hands of the “victors” had to be structured so as to keep them down, not so much as to keep the Communists out, though it had to appear as though the latter were the sole motivation. The last thing the “free world” feared was the spasmodic and sickly productivity and the outrageously poor quality of the output of the Red world ; only the most desperately poor considered Communist products worth striving to possess, and 35 years after war’s end, it was still unordinary to see Communist artifacts in the “West”, with the exception of weapons. Only the gross distortions of central planning, which kept the Red civilian-consumption sector largely in the final quarter of the 19th century, made possible the lopsided allocation of resources resulting in good guns. There were few who feared a system which could not even feed itself, but its publicized ominousness, used as public policy made the civilian population of its apparent adversary also amenable to control which they otherwise might not have endured at all. Even in the Far East, a totally battered and flattened Japan, by comparison with the victorious Reds of China, still were to be calculated at an advantage best measured in terms of a century of more, perhaps two, in some opinions, over a regime which even after a generation was best known for ping pong. For the “liberators”, converting the vanquished into economically powerful political satellites was the main job lying ahead ; the “free world” had learned the hard way what Lawrence Dennis had meant when he spoke of “the bloody futility of frustrating the strong”.
In the meantime, however, the sham had to be carried on, since an enemy somewhere had become an operational necessity for the vIctonous regardless of location. Foreign policy was simply the major tool in controlling and directing domestic policy. In Orwell’s book it was frankly endorsed and employed as basic dynamics ; in the “real world” it was too, only that domestic manipulation via foreign policy simply had to be disguised and never admitted regardless of circumstances.
— James J. Martin, The Man who Invented “genocide” : The Public Career and Consequences of Raphael Lemkin, 1984]
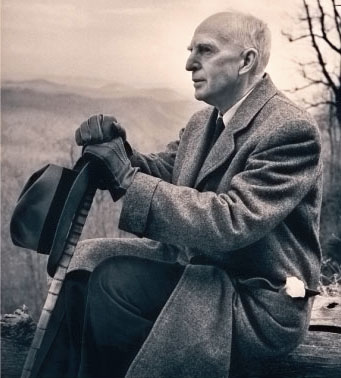 6. Les énoncés de principe de Beard sur ces points de vue sont apparus dans deux livres écrits en collaboration avec George HE Smith, The Idea of National Interest (1934) [consultable] [recension] [cf « The Idea of the National Interest », Henry W. Brands, Diplomatic History n°2/1999] et The Open Door at Home (1934). Ils ont refait surface avec vigueur dans ses Giddy Minds and Foreign Quarrels (1939) [extrait] et A Foreign Policy for America (1940). [Sur la conception de la politique étrangère chez Beard, lire le chapitre 4 qui lui est consacré dans From Vienna to Chicago and Back : Essays on Intellectual History and Political Thought in Europe and America, Gerald Stourzh, 2007]
6. Les énoncés de principe de Beard sur ces points de vue sont apparus dans deux livres écrits en collaboration avec George HE Smith, The Idea of National Interest (1934) [consultable] [recension] [cf « The Idea of the National Interest », Henry W. Brands, Diplomatic History n°2/1999] et The Open Door at Home (1934). Ils ont refait surface avec vigueur dans ses Giddy Minds and Foreign Quarrels (1939) [extrait] et A Foreign Policy for America (1940). [Sur la conception de la politique étrangère chez Beard, lire le chapitre 4 qui lui est consacré dans From Vienna to Chicago and Back : Essays on Intellectual History and Political Thought in Europe and America, Gerald Stourzh, 2007][Sur la notion d'intérêt général : « Contribution à l’analyse de l’idéologie de l’intérêt général », F. Rangeon & JF Vasseur & C. Legrand, « Intérêt général, décision, pouvoir », JL Laville, in : Discours et idéologie, PUF, 1980 ; ainsi que la contestation de cette notion par l'économiste anarcho-capitaliste Pierre Lemieux, « L’État idéal à la rescousse », 2013, « The Impossibility of Populism », 2021. — Pour nuancer chez Marx la dénonciation de l'idéologie de l'intérêt général comme idéologie de la classe dominante, lire : « Intérêt général, intérêt de classe, intérêt humain chez le jeune Marx » (S. Roza, 2017), « L’apport de Marx à la théorie de l'État » (H. Desbrousses, 2007). — Sur le rapport intérêt national / coopération transnationale : « International Ideals and the National Interest », Frederick L. Schuman, in : The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1952 ; « National interests and foreign policy », Donald Nuechterlein, in : British Journal of International Studies n°3/1976]
7. Le grand apport de Keynes est bien sûr sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), dans laquelle il expose de façon posée son cadre théorique de la production globale. Une version antérieure de sa critique de l’économie classique se trouve dans sa brochure The End of Laissez-Faire (1926). La littérature critique sur Keynes est vaste. De bons points de départ sont Robert Lekachman, The Age of Keynes (1966) [recension] et (dir.), Keynes' General Theory : Reports of Three Decades (1964). L’historien James J. Martin a fait remarquer qu’il suffirait simplement de consulter les numéros de la Harvard Business Review de la fin des années 1920 pour trouver des preuves de très nombreuses idées “keynésiennes” circulant dans les cercles intellectuels américains avant la parution de la Théorie générale. Les influences de Keynes et des “keynésiens” — quoique graduelles — sur la théorie et la politique dans les États libéraux-démocratiques ont toujours été reconnues ; beaucoup moins traitée a été la question de son influence sur les États fascistes, de même que la prise en compte et l’adoption par ces derniers de politiques présentant de fortes similitudes dans leur principe avec ce que nous appellerions le “keynésianisme”. On doit à James Martin d'avoir rappelé au public que Keynes écrivit une introduction spéciale à la traduction allemande de la Théorie générale publiée en 1936 dans un pays sous régime national-socialiste ; voir « JM Keynes's Famous [sic : c'est la redécouverte de Martin] Foreword to the 1936 German Edition of the “General Theory” », pp. 197-205 dans J. Martin, Revisionist Viewpoints : Essays in a Dissident Historical Tradition (1971).
 8. Norman Thomas, recensant Is Capitalism Doomed ? dans World Tomorrow, XV (juin 1932), écrit : “Nulle part je n’ai vu une plus virulente attaque contre la notion de finance internationale des banquiers. D’un point de vue socialiste, M. Dennis néglige ou semble négliger les facteurs de grande importance, mais les facteurs qu’il examine, il les traite de la manière la plus incisive. (…) Malgré cette critique, je tiens à recommander chaleureusement le livre de M. Dennis. Le socialiste convaincu y trouvera plus de munitions que dans la plupart des livres radicaux”. [Rappelons qu’au début des années 30, les articles de L. Dennis sur la finance dans l’hebdomadaire The Nation côtoyaient souvent ceux aussi incisifs de N. Thomas, par ex. « A Socialist Program for Banking », Nation n°3533, 1933]
8. Norman Thomas, recensant Is Capitalism Doomed ? dans World Tomorrow, XV (juin 1932), écrit : “Nulle part je n’ai vu une plus virulente attaque contre la notion de finance internationale des banquiers. D’un point de vue socialiste, M. Dennis néglige ou semble négliger les facteurs de grande importance, mais les facteurs qu’il examine, il les traite de la manière la plus incisive. (…) Malgré cette critique, je tiens à recommander chaleureusement le livre de M. Dennis. Le socialiste convaincu y trouvera plus de munitions que dans la plupart des livres radicaux”. [Rappelons qu’au début des années 30, les articles de L. Dennis sur la finance dans l’hebdomadaire The Nation côtoyaient souvent ceux aussi incisifs de N. Thomas, par ex. « A Socialist Program for Banking », Nation n°3533, 1933] Le marxiste britannique John Strachey, traitant du même titre dans son livre The Coming Struggle for Power (1932) qualifie Dennis comme “admirablement réaliste quand il montre les contradictions fatales inhérentes au capitalisme à grande échelle. (…) Il a écrit une analyse de la crise [du capitalisme] de loin plus pénétrante que celle rédigée par n’importe quel économiste capitaliste professionnel” (p. 149-150). Dennis avait écrit une critique largement favorable du livre de Strachey lors de sa première parution : « A Communistic Strachey », Nation, 8 mars 1933, pp. 264-65. [Sur les rapports Dennis-Strachey, cf Horne p. 47 : “Matthew Josephson knew that this former State Department official had been ‘friendly’ with the British progressive, John Strachey, and ‘afterward he had explored with him the merits of communism, Dennis had concluded that communism would take too long to gain acceptance in America’ but still being ever more critical of the status quo and desirous of far-reaching change that would shake the foundations of the nation, became attracted to fascism which — at least in its early stages—was not as controversial as V. I. Lenin’s creation in Eurasia”]
 [Ci-contre Strachey en 1945. D’abord, infatigable propagandiste d’un marxisme apocalyptique, et proche compagnon de route du parti communiste britannique des années 1930, il rompt avec celui-ci en 1940, s’éloigne du marxisme et devient député travailliste (1945-1963). En 1945, il entre au gouvernement comme ministre du Ravitaillement (1945-1950). Selon Strachey, l’évolution de la pensée économique de Keynes au début des années 1930 cachait son incapacité à comprendre que le capitalisme ne pouvait pas être réformé (cf The Nature of Capitalist Crisis, 1935). Strachey changera progressivement d’avis, grâce notamment à l’influence intellectuelle de Keynes et à l’évolution de ses solutions réformistes. Cf John Strachey : An intellectual biography, Noel W. Thompson, 1993. Pour resituer son affinité avec Dennis en 1932, ce passage de Lewis S. Feuer (in : Ideology and the Ideologists, 2010) nous éclairera sur l’aura du théoricien :
[Ci-contre Strachey en 1945. D’abord, infatigable propagandiste d’un marxisme apocalyptique, et proche compagnon de route du parti communiste britannique des années 1930, il rompt avec celui-ci en 1940, s’éloigne du marxisme et devient député travailliste (1945-1963). En 1945, il entre au gouvernement comme ministre du Ravitaillement (1945-1950). Selon Strachey, l’évolution de la pensée économique de Keynes au début des années 1930 cachait son incapacité à comprendre que le capitalisme ne pouvait pas être réformé (cf The Nature of Capitalist Crisis, 1935). Strachey changera progressivement d’avis, grâce notamment à l’influence intellectuelle de Keynes et à l’évolution de ses solutions réformistes. Cf John Strachey : An intellectual biography, Noel W. Thompson, 1993. Pour resituer son affinité avec Dennis en 1932, ce passage de Lewis S. Feuer (in : Ideology and the Ideologists, 2010) nous éclairera sur l’aura du théoricien :Dès les années 1930, John Strachey avait totalement rejoint l'idéologie communiste marxiste. Il fut pendant plusieurs années le “maître à penser” de la gauche en Amérique, ouvrant la voie à une renouveau de l'idéologie marxiste, en laquelle l'ère stalinienne au début des années trente donnait expression. Son livre, The Coming Struggle for Power, fut le livre idéologique le plus influent parmi les jeunes intellectuels américains à cette époque. Au début des années 30, une division inter-générationnelle apparut dans les rangs des rédacteurs et écrivains de The New Republic, principal organe des intellectuels américains. Les plus jeunes étaient attirés par l'idéologie ; les anciens étaient désidéologisés. “Les jeunes hommes du cercle de The New Republic, contrairement aux plus âgés et impassibles, étaient impatients de l'avènement de la Révolution ; ils en parlaient, en rêvaient”. Il y avait un contraste en 1931 et 1932 entre des hommes tels que Felix Frankfurter, plus tard juge à la Cour suprême des États-Unis, et les “jeunes littéraires sauvages” de ce cercle, écrivait Matthew Josephson, qui en faisait partie. Les anciens prévoyaient de voter pour le désigné candidat démocrate à la présidence, tandis que les jeunes idéologues soutenaient le candidat communiste. Ce qui était primordial, écrivait Josephson en juillet 1932, était “de prendre parti pour les extrémistes, les militants de toutes sortes, qui peuvent secouer notre société inerte jusqu'au réveil”. Au milieu de 1935, le mot “révolution” était devenu un symbole majeur de la nouvelle génération idéologique. Pour être écouté sur n'importe quel sujet, que ce soit en politique, en morale, en art ou en science, il fallait arguer une position de “révolution”. (…) La “Révolution” entra dans une phase déclinante après la Seconde Guerre mondiale. En 1960, sa valeur sur le marché des idées recommença à atteindre des niveaux sans précédent]
9. Le président Roosevelt, dans son discours sur l’état de l’Union du 6 janvier 1941 au Congrès, a tenu à mentionner ceux qui, non seulement “avec des cuivres résonnants”, mais aussi avec “un tintement de cymbales”, ont prêché “le -isme du pacifisme”. Le mois précédent, il avait diligenté le secrétaire à l’Intérieur Harold L. Ickes pour dénoncer nommément ceux qui constituaient le “groupe des pacifistes à l’œuvre”. Ickes proclama dans son discours à l’Université de Columbia le 17 décembre 1940 que Lawrence Dennis était “la tête pensante du fascisme américain”. Cela suscita une réplique publique acerbe de la part de Dennis : “La réalité en Amérique qui se rapproche le plus du fascisme est M. Ickes et la réalité qui vient ensuite est le troisième mandat de M. Roosevelt. J'ai écrit un livre sur The Coming American Fascism et prédit qu’il passerait par une guerre contre le fascisme. Depuis, j'ai dit à plusieurs reprises que M. Roosevelt et son New Deal étaient les seules tendances fascistes importantes en Amérique. Je n’ai jamais appartenu ni été lié à aucun mouvement ou organisation à caractère politique de toute ma vie”. Voir « ”The Ism of Apaisement” : Roosevelt Brands Foes of His Foreign Policy », Life, 20 janv. 1941, pp. 26-27, et “MK Hart exige qu’Ickes se rétracte ; L. Dennis conteste le droit d’attaquer le caractère et les motivations des conciliateurs”, New York Times, 19 déc. 1940, p. 22.
 10. Dennis et l’avocat Maximilian St. George se sont prononcés sur le procès dans A Trial on Trial : The Great Sedition Trial of 1944 (National Civil Rights Committee, Chicago, 1946), une autopsie de 503 pages de l’un des cas de poursuites fédérales les plus étranges cas dans l’histoire de ce pays. Des excuses tardives pour le procès et la dernière tentative de condamnation des accusés, cette fois devant le tribunal de l’opinion publique moins exigeant en matière de preuve, ont été présentées par le procureur en chef O. John Rogge dans The Official German Report (Thomas Yoseloff, NY, 1961), un titre des plus intriguant pour un livre qui n’était ni “officiel”, ni “allemand”, ni un “rapport” [il s'agit d’une diatribe rédigée en 1944]. Entre-temps, cinq ans à peine après son “extravaganza” sur la “sédition de masse”, Rogge exprima dans Our Vanishing Civil Liberties [Nos libertés civiles en voie de disparation] (Gaer Books, NY, 1949) son inquiétude la plus vive et la plus outrée au sujet de quelque chose comme la diffamation gouvernementale des dissidents et les procès-spectacles politiques pour eux ; à l’époque, il agissait en tant qu’avocat de la défense de membres du Parti communiste américain jugés pour des violations de la loi Smith. Ceux qui ne seraient pas surpris par le manque de cohérence de Rogge en tant que défenseur des libertés civiles et de la liberté d’expression pourraient l’identifier comme le spécimen d’une nouvelle espèce dans la vie intellectuelle américaine : le “libéral totalitaire”, parfaitement capable par rapport à ses principes de faire un virage à 180 degrés sans le moindre scrupule ou cas de conscience. [Dans le Journal of Historical Review vol. 06, 1985, on pourra consulter une recension de A Trial on Trial pour sa réédition ainsi qu’un article de David Baxter sur le procès]
10. Dennis et l’avocat Maximilian St. George se sont prononcés sur le procès dans A Trial on Trial : The Great Sedition Trial of 1944 (National Civil Rights Committee, Chicago, 1946), une autopsie de 503 pages de l’un des cas de poursuites fédérales les plus étranges cas dans l’histoire de ce pays. Des excuses tardives pour le procès et la dernière tentative de condamnation des accusés, cette fois devant le tribunal de l’opinion publique moins exigeant en matière de preuve, ont été présentées par le procureur en chef O. John Rogge dans The Official German Report (Thomas Yoseloff, NY, 1961), un titre des plus intriguant pour un livre qui n’était ni “officiel”, ni “allemand”, ni un “rapport” [il s'agit d’une diatribe rédigée en 1944]. Entre-temps, cinq ans à peine après son “extravaganza” sur la “sédition de masse”, Rogge exprima dans Our Vanishing Civil Liberties [Nos libertés civiles en voie de disparation] (Gaer Books, NY, 1949) son inquiétude la plus vive et la plus outrée au sujet de quelque chose comme la diffamation gouvernementale des dissidents et les procès-spectacles politiques pour eux ; à l’époque, il agissait en tant qu’avocat de la défense de membres du Parti communiste américain jugés pour des violations de la loi Smith. Ceux qui ne seraient pas surpris par le manque de cohérence de Rogge en tant que défenseur des libertés civiles et de la liberté d’expression pourraient l’identifier comme le spécimen d’une nouvelle espèce dans la vie intellectuelle américaine : le “libéral totalitaire”, parfaitement capable par rapport à ses principes de faire un virage à 180 degrés sans le moindre scrupule ou cas de conscience. [Dans le Journal of Historical Review vol. 06, 1985, on pourra consulter une recension de A Trial on Trial pour sa réédition ainsi qu’un article de David Baxter sur le procès]Une volte-face particulièrement frappante des “libéraux totalitaires” fut le soutien indéfectible (ou l’acquiescement) aux efforts pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire taire, enfermer, ou mettre sur liste noire les non-interventionnistes pour lesquels les qualificatifs de “séditionniste” ou “conciliateur” servaient de bien pratiques moyens de dénigrement, tout comme pendant la guerre froide pour faire taire, enfermer ou mettre sur liste noire ceux opposés aux efforts de guerre on les accusait de communisme [et de pactiser avec l'ennemi] — se rendant ainsi, ironie de l’histoire, susceptibles de subir le même réquisitoire maccarthyste de “trahison” et de “complicité avec un État jugé violent”. Une description haute en couleur, bien que peu réjouissante, de ce phénomène a été donnée par l’historien Harry Elmer Barnes dans son pamphlet The Chickens of the interventionist Liberals have come home to roost : The bitter fruits of globaloney (tirage confidentiel, 1954). Plus récemment, l’historien Leo Ribuffo a avancé le terme “Brown Scare” [peur des bruns] pour suggérer que la route vers la “Red Scare” de la fin des années 1940 et du début des années 1950 a été pavée en partie par les libéraux eux-mêmes en raison de leur comportement d’avant-guerre et durant la guerre. Voir ses « Fascists, Nazis, and American Minds : Perceptions and Preconceptions » (America Quarterly n°4/1974) et The Old Christian Right : The Protestant Far Right from the Great Depression to the-Cold Guerre (1983) [recension].
[On pourra rapprocher cette critique politique avec celle sociologique des “effets pervers” chez R. Boudon, à savoir l'écart entre intention et résultat. Un exemple récent, grâce aux révélations de Snowden sur la NSA en 2013, serait le passage de la surveillance de masse à la paranoïa généralisée par l’administration américaine]
 11. Pour constater la stigmatisation de Dennis après guerre à travers la mise à l’écart des médias officiels, il est possible de comparer la liste avant-guerre des recensions de ses livres avec celle après-guerre, au moyen de la bibliographie qui figure à la fin de cette étude. Le Book Review Index, le Combined Retrospective Index to Book Reviews in Scholarly Journals 1886-1974 et le Combined Retrospective Index to Book Reviews in Humanities Journals 1802-1974 énumèrent un grand total de zéro critique de A Trial on Trial et une critique du dernier livre de Dennis, Operational Thinking for Survival (1969). James J. Martin, le directeur de Ralph Myles Publisher, nous a confirmé que, malgré l’envoi d’une centaine d’exemplaires en service presse d’Operational Thinking lors de sa publication, une seule recension fut publiée — par le vieil ami de Dennis et adversaire politique, Frederick L. Schuman [ci-contre] : « Reflections of a Pragmatist », Nation, 8 déc. 1969, 641-642.
11. Pour constater la stigmatisation de Dennis après guerre à travers la mise à l’écart des médias officiels, il est possible de comparer la liste avant-guerre des recensions de ses livres avec celle après-guerre, au moyen de la bibliographie qui figure à la fin de cette étude. Le Book Review Index, le Combined Retrospective Index to Book Reviews in Scholarly Journals 1886-1974 et le Combined Retrospective Index to Book Reviews in Humanities Journals 1802-1974 énumèrent un grand total de zéro critique de A Trial on Trial et une critique du dernier livre de Dennis, Operational Thinking for Survival (1969). James J. Martin, le directeur de Ralph Myles Publisher, nous a confirmé que, malgré l’envoi d’une centaine d’exemplaires en service presse d’Operational Thinking lors de sa publication, une seule recension fut publiée — par le vieil ami de Dennis et adversaire politique, Frederick L. Schuman [ci-contre] : « Reflections of a Pragmatist », Nation, 8 déc. 1969, 641-642.12. “America’s n°1 intellectual fascist” et “Brain-truster for the forces of appeasement” : Life, 20 janvier 1941, 26-27. “Le leader intellectuel…” : Arthur S. Link et William B. Catton, American Epoch : A History of the United States, vol. II : 1921-1945, 1955, 18.
[Pour citer d'autres exemples, confondant critique du libéralisme et anti-patriotisme (Un-American), cf bulletin Propaganda Analysis n°1-IV, 1940 : “At present, in the opinion of one observer, Lawrence Dennis, author of The Dynamics of War and Revolution, often regarded as America's chief theorist of National Socialism, the world is galloping into collectivism, war or no war, but with war hastening the process. He sees Stalin as reaping most of the benefits, while imperialist nations are destroying one another. Collectivism will come to all nations anyway, says Dennis, and the deeper they get into the war the quicker it will come. If the United States wants to keep what it has of free enterprise it will stay out of the struggle ; but in any event it should remember that this collectivism is coming and everywhere will eventually be led by the elite”.
Ou encore Joseph Roucek, Twentieth Century Political Thought, 1946 : “Of quite different character, a better fascist and one much more dangerous to American democracy was Lawrence Dennis, eminently intellectual product of Harvard University with practical experience in the Department of State and Wall Street. Dennis's specialty was softening the people for a ‘palace revolution’ which he pretended not to advocate but to anticipate. Two of his books, The Coming American Fascism and The Dynamics of War and Revolution present a brilliant and plausible exposition of ‘government by the elite’”.
Notons que si “Dennis avait beau penser que c’est la force qui mène le monde et qu’il est nécessaire pour les élites d’asseoir leur pouvoir sur l’État, il n’a jamais cautionné les méthodes brutales des fascistes européens et n’a jamais fait montre du moindre antisémitisme”, Justin Raimondo, « The subversion of Lawrence Dennis », Taki's Magazine, 2007. Voir aussi la réponse de Dennis au magazine juif américain Emanu-El - Jewish Journal en date du 26 oct. 1934, « Political Anti-Semitism in a Fascist America is Unthinkable, Says Advocate of Strong Ruler » : “Je ne vois pas comment un mouvement antisémite pourrait réussir dans ce pays. […] Le racisme ne pourra jamais servir de socle à un programme politique gagnant. […] Hitler déclare que le Juif ne peut être citoyen de l’Allemagne, et je trouve que cette position reflète un nationalisme malsain. […] Quant à une persécution ou une violence organisée visant les Juifs de notre pays, je la tiens pour inconcevable” (cité par Horne, 64-65). Dans une lettre à Charles Parsons du 10 déc. 1949, déplorant la campagne médiatique contre les inculpés du procès de 1944, il reproche même à l’Anti-Defamation League, fondée par l'organisation B'nai B'rith, de l’avoir impliqué dans le procès : “Je m'efforce toujours de préciser que je n’ai rien contre les Juifs et que je ne critique que certains actes de certains Juifs comme les sionistes en Palestine, l’Anti-Defamation League” (cité par Horne, 146). Sur la question des juifs américains au sein du gouvernement Roosevelt, cf « Jews and the New Deal », Leonard Dinnerstein, American Jewish History n°4/1983. De nos jours, comme l’observe Serge Halimi dans un article du Monde Diplomatique d'août 1989 : “les juifs américains n’approuvent pas tous l’inconditionnalité pro-israélienne de l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) ou sa tendance à soutenir les thèses du Likoud sur chacun des sujets qui suscite un débat en Israël. Mais le fait demeure : l’AIPAC est perçu comme le porte-parole des juifs américains au Congrès parce qu’il est infiniment mieux organisé que n’importe quelle autre organisation de leur communauté. Et, dans la mesure même où ce qu’il est maintenant convenu d’appeler ‘le lobby’ tout court est efficace, les positions des responsables israéliens les plus intransigeants reçoivent un écho apprécié dans l’une des capitales mondiales dont les vues comptent”. Pour rappel, le lobbying a longtemps été une réalité seulement américaine touchant divers domaines (pharmacie, tabac, armement, etc), aujourd’hui il s’est banalisé au sein du Parlement européen, même si en France le modèle républicain revendiquait se distancier de toute ingérence : le dernier épisode fut la colère de Mitterrand en 1995 contre les pressions des associations mémorielles. Les stratégies d’influence des lobbys ne sont pas le ressort caché de la politique gouvernementale, chacun des deux domaines obéit à sa propre logique d’intérêt, mais n’en reste pas moins problématique la question de l’intérêt général]
13. Les détails biographiques sont tirés du portrait de Dennis dans Maxine Block, éd., Current Biography 1941 (1941), p. 218-20, ainsi que des souvenirs de deux amis de longue date de Dennis, H. Keith Thompson [cf aussi son entretien sur Francis Parker Yockey, 1986] et James J. Martin, provenant de conversations avec cet auteur.
14. Pour les premières appréciations de Dennis sur le New Deal comme fondamentalement sans direction, voir « The Planless Roosevelt Revolution », American Mercury n°125, mai 1934. [L’article sans concession décoche en conclusion cette flèche du Parthe : “So far, Mr. Roosevelt has shown himself to be a master showman but not a master builder. To build, you need a plan”]
15. Lawrence Dennis, The Dynamics of War and Revolution (Weekly Foreign Letter, NY, 1940) [recension], ci-après cité comme Dennis, Dynamics. Ce livre devait être publié par les éditeurs réguliers de Dennis, Harper & Brothers, qui l’avaient déjà imprimé et commencé à relier lorsque, avec les répercussions intellectuelles nationales de la chute de la France en juin 1940, la maison a eu froid aux yeux et a reculé. Dennis a ensuite acheté le stock et a publié le livre sous l’empreinte de son bulletin. Cet auteur a vu, avec l’aimable autorisation de James J. Martin, l’un des exemplaires extrêmement rares du livre portant l’empreinte originale de Harper & Brothers sur la reliure et la jaquette.
16. Justus D. Doenecke, « Lawrence Dennis : Revisionist of the Cold War », in : Wisconsin Magazine of History n°4/1972, p. 277, note 11, citant une réponse de Dennis à Doenecke, le 27 janvier 1971, au sujet du nom de ces abonnés.
17. L’auteur a examiné, avec l’aimable autorisation de James J. Martin, le dossier de correspondance entre Dennis et Ralph Myles Publishers, d’où proviennent ces informations.
18. Dynamics, p. 71, faisant référence à “The Significance of the Frontier in American History” par Frederick Jackson Turner, conférence prononcée lors de la réunion annuelle de l’American Historical Association à Chicago en 1893.
[Sur la constitution du territoire américain, cf aussi « Le destin californien des États-Unis », R. Steuckers, 1985. Rappelons aussi la conviction des États-Unis en leur “destinée manifeste” pour justifier l’expansion du pays. Pour interroger les racines de l’idéologie de la “destinée manifeste”, qui rend rend également compte des grands traits de l'identité américaine (individualisme, dynamisme, idéalisme) et acquiert de ce fait la valeur d'un mythe explicatif, se reporter à : « Origines et formes diverses du “destin manifeste” dans les Amériques », Louis-Georges Harvey & Yvan Lamonde, Les Cahiers des dix n°67, 2013. En plus de permettre la construction de son territoire national, l’idée de “destinée manifeste” a permis aux États-Unis de fixer leur politique étrangère, et ce à plusieurs reprises. Il est possible de citer les exemples suivants : 1) Théodore Roosevelt, dans son discours prononcé au Congrès le 6 décembre 1904 baptisé le “corollaire de la doctrine Monroe” a déclaré que les États-Unis se devaient d’exercer un “pouvoir de police international”, il y a bien ici une idée de devoir, de mission ; 2) La doctrine Truman énoncée en 1947 par le Président Harry Truman s’inspire de l’idée de destinée manifeste en mettant en avant un devoir de protection des peuples européens. Généralement, le mythe de “destinée manifeste” a constitué la base des arguments en faveur d’un exceptionnalisme américain, mis en avant par plusieurs administrations successives (Clinton, Bush père, Bush fils…). En somme, l’idéologie de destinée manifeste a appuyé les ambitions impérialistes de la politique étrangère américaine]
19. Dynamics, p. 61. Dennis était à son meilleur ironique en décrivant l’essence de cette hypocrisie : “Maintenant, s’il y a bien quelque chose qu’un économiste orthodoxe abhorre, c’est le monopole. Les économistes passent la plupart de leur temps à essayer de prouver que le monopole est mauvais car les entreprises et les hommes d’affaires passent la plupart de leur temps à essayer d’obtenir le monopole ou à échouer dans les affaires parce qu’ils n’y parviennent pas”.
20. Confronté au boom démographique de l’après-Seconde Guerre mondiale en Amérique et dans le monde, Dennis modifiera sa tonalité sinon sa thèse ; cf. Dennis, Dynamics, ch. 6, not. pp. 88-101, avec Operational Thinking for Survival, ch. 7, not. p. 47-58. Dans le premier ouvrage, il n’avait pas vraiment pris en compte les tendances démographiques du “tiers-monde” ; dans le dernier, il le fait et considère cette partie du monde comme porteuse d’un dynamisme puissant en raison de ses tendances natalistes — tandis que, par rapport à elle et relativement à ce sujet, Amérique et Occident continuent de décliner.
 21. Dennis livra un exposé court et percutant de son point de vue sur les qualités “dynamiques” et “révolutionnaires” de l’axe “socialiste” germano-italien-russe dans sa contribution “The Party-State and the Elite” à une sorte de symposium “Who Owns the Future ?” (À qui appartient l’avenir ?) organisé par l’hebdomadaire classsé à gauche et progressiste The Nation (11 janv. 1941, p. 36-44) ; les autres contributeurs étaient Frederick L. Schuman et Max Lerner [ci-contre en 1949]. Ce trialogue remarquable, qui conserve son intérêt et sa pertinence restant d’actualité pour la discussion des principes des relations internationales, représentait la dernière fois qu’une opinion dissidente “fasciste” telle que celle de Dennis obtiendrait une large audience dans une importante revue intellectuelle américaine.
21. Dennis livra un exposé court et percutant de son point de vue sur les qualités “dynamiques” et “révolutionnaires” de l’axe “socialiste” germano-italien-russe dans sa contribution “The Party-State and the Elite” à une sorte de symposium “Who Owns the Future ?” (À qui appartient l’avenir ?) organisé par l’hebdomadaire classsé à gauche et progressiste The Nation (11 janv. 1941, p. 36-44) ; les autres contributeurs étaient Frederick L. Schuman et Max Lerner [ci-contre en 1949]. Ce trialogue remarquable, qui conserve son intérêt et sa pertinence restant d’actualité pour la discussion des principes des relations internationales, représentait la dernière fois qu’une opinion dissidente “fasciste” telle que celle de Dennis obtiendrait une large audience dans une importante revue intellectuelle américaine. [Pour une évocation substantielle de ce débat : William L. O’Neill, A Better World : Stalinism and the American Intellectuals, 1982, p. 28-29. Dans un recueil combinant réalisme machiavélien et humanisme radical attaché au régime démocratique, Max Lerner reprend son texte en l'introduisant ainsi : “Quelques mots d'explication seront nécessaires pour éclaircir le contexte de cette lettre. Frederick L. Schuman écrivit une lettre à Lawrence Dennis au sujet de son dernier livre, The Dynamics of War and Revolution, et Dennis lui adressa une lettre en retour. À la lecture de ces deux lettres, j’ai demandé aux auteurs la permission d’écrire une réponse à toutes les deux, et, avec leur consentement, j’ai arrangé la publication de l'ensemble dans The Nation, où il parut sous le titre “À qui appartient l'avenir ?” Pour les besoins de ce livre, il était impossible de réimprimer les autres lettres, mais leur teneur et leur argumentation sont implicites dans ma réponse. La thèse de Dennis était la suivante : le capitalisme a perdu la dynamique interne qui lui donnait autrefois sa force, et avec elle sa possibilité de survie ; le succès historique d'un socialisme organisé sous l’État à parti unique s’avère inévitable ; les efforts actuels de la part de l'Amérique pour résister à l'expansion militaire nazie sont en fin de compte voués à l'échec car une réaction d’après-guerre apportera le triomphe (nullement indésirable selon lui) des forces fascistes en Amérique. Schuman pense qu'une certaine forme de césarisme est inévitable et que ce dernier peut aussi bien être américain que tout autre. Il appelle à une action engagée américaine pour combattre le nazisme et établir les conditions d'un empire mondial américain, mais il reste sceptique quant à notre capacité à organiser efficacement la résistance en raison d'une paralysie de la volonté qu'il considère comme caractéristique de la démocratie capitaliste occidentale dans sa phase actuelle” (Ideas for the Ice Age : Studies in a revolutionary era, 1941, recension). De cet auteur, surtout connu outre-atlantique pour sa défense de l’éducation aux valeurs comme garante d’une liberté politique (cf Max Lerner : Pilgrim in the Promised Land, Sanford Lakoff, 1998, recension), recommandons : Magisterial Imagination : Six Masters of the Human Science, Routledge, 1994, où sont abordés Aristote, Machiavel, Tocqueville, John Stuart Mill, Thorstein Veblen et Oliver Wendell Holmes Jr. ; ainsi que America as a civilization, 1957, entretien radiophonique, trad. fr. : La civilisation américaine, Seuil, 1961, recension]
 22. [note en sus] On ne peut ignorer la transmission des crises financières à l’économie réelle. Irving Fisher est le premier à concevoir que la déflation (baisse du niveau général des prix) puisse en retour être exacerbée par l’instabilité financière. Dès 1933 il décrit le mécanisme de la déflation par la dette (debt-deflation) dans un article : « La théorie des grandes dépressions par la dette et la déflation ». La baisse des prix accroît le poids des dettes et réciproquement : à partir de l'analyse de ce cercle vicieux, Fisher entendait fournir une explication à toutes les dépressions, à commencer par celle des années 1930. Une analyse qui reste d'une brûlante actualité et qui ne peut être séparée de la politique monétaire.
22. [note en sus] On ne peut ignorer la transmission des crises financières à l’économie réelle. Irving Fisher est le premier à concevoir que la déflation (baisse du niveau général des prix) puisse en retour être exacerbée par l’instabilité financière. Dès 1933 il décrit le mécanisme de la déflation par la dette (debt-deflation) dans un article : « La théorie des grandes dépressions par la dette et la déflation ». La baisse des prix accroît le poids des dettes et réciproquement : à partir de l'analyse de ce cercle vicieux, Fisher entendait fournir une explication à toutes les dépressions, à commencer par celle des années 1930. Une analyse qui reste d'une brûlante actualité et qui ne peut être séparée de la politique monétaire. Pour approfondir : « Endettement, déflation et crises financières » (M. Anota, 2013), « Fisher et la déflation par la dette », R. Gomez Betancourt & A. Vila (L‘Économie politique n°66, 2015), « Du dollar-compensé au 100% Monnaie : La réponse d'Irving Fisher à la crise de 1929 », A. Vila (Revue d'histoire de la pensée économique n°8, 2019), « La déflation par la dette : une approche “(pré)-systémique” des crises » (H. Cova, 2022). On rapprochera ce mécanisme du “paradoxe de la tranquillité” de Hyman Minsky (1986), mécanisme économique reposant sur le caractère endogène des crises (notamment des crises financières) et l’endettement. La crise est le fruit du fonctionnement même du système financier : plus les investisseurs sont confiants, plus ils vont adopter un comportement de financement risqué.
23. Beard employa ces mots lors de sa dernière conversation avec son collègue révisionniste Harry Elmer Barnes. Voir Barnes (dir.), Perpetual War for Perpetual Peace : A Critical Examination of the Foreign Policy of Franklin D. Roosevelt and its Aftermath (1953), p. viii.
24. [note en sus] Sur le capitalisme sauvage (1860-1900) et les “barons voleurs”, lire le chap. XI de : Une histoire populaire des États-Unis (Agone, 2003, recension, extrait) par Howard Zinn. Voir aussi cette vidéo illustrative.
 25. [note en sus] « Le seigneur féodal du fief était tout autant propriétaire que le millionnaire sous le capitalisme moderne. Il avait des droits de propriété sur les outils de production et dirigeait souvent les processus de production. Mais à la différence de l’homme de propriété sous le capitalisme moderne, il ne pouvait jamais prendre une décision concernant ses droits de propriété, dont l’un des résultats aurait conduit à un chômage généralisé et à une misère, car, en pratique, il ne pouvait pas expulser le serf de la terre ou lui refuser l’usage de la terre et d’un capital élémentaire pour la production de nourriture, de logement et de vêtements. Le capitalisme moderne est le premier système important de droits de propriété permettant aux propriétaires de prendre des décisions qui entraînent un chômage à grande échelle. La liberté tant vantée du capitalisme moderne est en grande partie une question de liberté des propriétaires vis-à-vis de la responsabilité sociale des conséquences de leurs choix économiques. Il s’agit de la liberté des propriétaires de ne pas investir leurs gains si l’incitation au profit n’est pas jugée suffisante. Dire qu’il s’agit aussi de la liberté du travailleur de s’abstenir de travailler, c’est se moquer éperdument des nécessités humaines. L’homme riche est, dans un sens pratique, libre de retenir son pécule de l’investissement. Le pauvre n’est jamais libre qu’au sens légal, confinant à l’absurde, de refuser son travail au plus offrant, aussi bas que soit l’offre, si, comme l’exigent les principes du capitalisme sain, refuser son travail revient à mourir de faim. À l’heure actuelle, l’une des règles fondamentales du capitalisme sain est violée par le paiement de l’allocation-chomâge, qui empêche un homme de mourir de faim et lui permet ainsi de retenir son travail au plus offrant si l’offre n’est pas matériellement supérieure au montant pouvant être obtenu à partir de l’allocation ». (L. Dennis, The Coming American Fascism : The Crisis of Capitalism, Harper & Brothers, 1936, p. 22-23)
25. [note en sus] « Le seigneur féodal du fief était tout autant propriétaire que le millionnaire sous le capitalisme moderne. Il avait des droits de propriété sur les outils de production et dirigeait souvent les processus de production. Mais à la différence de l’homme de propriété sous le capitalisme moderne, il ne pouvait jamais prendre une décision concernant ses droits de propriété, dont l’un des résultats aurait conduit à un chômage généralisé et à une misère, car, en pratique, il ne pouvait pas expulser le serf de la terre ou lui refuser l’usage de la terre et d’un capital élémentaire pour la production de nourriture, de logement et de vêtements. Le capitalisme moderne est le premier système important de droits de propriété permettant aux propriétaires de prendre des décisions qui entraînent un chômage à grande échelle. La liberté tant vantée du capitalisme moderne est en grande partie une question de liberté des propriétaires vis-à-vis de la responsabilité sociale des conséquences de leurs choix économiques. Il s’agit de la liberté des propriétaires de ne pas investir leurs gains si l’incitation au profit n’est pas jugée suffisante. Dire qu’il s’agit aussi de la liberté du travailleur de s’abstenir de travailler, c’est se moquer éperdument des nécessités humaines. L’homme riche est, dans un sens pratique, libre de retenir son pécule de l’investissement. Le pauvre n’est jamais libre qu’au sens légal, confinant à l’absurde, de refuser son travail au plus offrant, aussi bas que soit l’offre, si, comme l’exigent les principes du capitalisme sain, refuser son travail revient à mourir de faim. À l’heure actuelle, l’une des règles fondamentales du capitalisme sain est violée par le paiement de l’allocation-chomâge, qui empêche un homme de mourir de faim et lui permet ainsi de retenir son travail au plus offrant si l’offre n’est pas matériellement supérieure au montant pouvant être obtenu à partir de l’allocation ». (L. Dennis, The Coming American Fascism : The Crisis of Capitalism, Harper & Brothers, 1936, p. 22-23) [illustration ci-haut : affiche du film Bound for glory / En route pour la gloire, 1976. Portrait mâtiné de road movie de Woody Guthrie, compositeur folk américain des plus prolifiques, le film retrace, dans le contexte des années 1930, son parcours de “hobo”, voyageur clandestin vagabondant de train en train, jusqu'à sa carrière naissante de chanteur populaire et contestataire. Hal Ashby filme l'exode massif des paysans du Texas et de l’Oklahoma vers les vergers de la Californie à la prospérité trompeuse et réalise une fresque sociale dans le décor des Raisins de la colère. Alors que la Grande Dépression pousse des milliers d'Américains à quitter leur foyer et prendre la route en quête d'une vie meilleure, fuyant la faim et les récoltes anéanties par les tempêtes de poussière, c'est la brutalité des employeurs qui les attend au bout de leur exode périlleux]
 26. Arthur M. Schlesinger, The Age of Roosevelt, Vol. III : The Politics of Upheaval (1960), p. 74. L’auteur note à raison un certain élément “romantique” dans la pensée et l’expression de Dennis. Cela ne peut cependant pas masquer la complexion générale de Dennis en tant qu’analyste qui n’a de cesse de souligner et d’affirmer le caractère rationnel, détaché, réaliste et empirique dans la manière d’aborder les problèmes à l’étude. Il a peut-être “succombé” à des envolées romantiques à l’occasion, en outre sa stylistique n’a jamais été monotone, mais compte tenu de l’ensemble de son œuvre, il serait vain de contester l’appellation que lui a donnée l’éditeur bostonien Porter Sargent : “ce réaliste incorruptible”. En revanche, l’autre figure principale du fascisme intellectuel américain, Francis Parker Yockey (1917-1960), auteur de Imperium : The Philosophy of History and Politics (1948 en 2 vol.), était un mystique des plus romantique qui avait tendance à ne pas argumenter un cas, comme le faisait Dennis, mais à l’énoncer et à se passer de justification. Les deux hommes — ils ne se sont apparemment jamais rencontrés — étaient très intelligents et instruits, ont écrit des œuvres d’une érudition indéniablement vaste et ont été grandement influencés par Spengler. Mais leurs approches des mêmes problèmes d’histoire et de société étaient nettement différentes à bien des égards. Yockey était certainement le plus “typiquement fasciste”. Une analyse comparative de leurs approches constituerait une fructueuse étude.
26. Arthur M. Schlesinger, The Age of Roosevelt, Vol. III : The Politics of Upheaval (1960), p. 74. L’auteur note à raison un certain élément “romantique” dans la pensée et l’expression de Dennis. Cela ne peut cependant pas masquer la complexion générale de Dennis en tant qu’analyste qui n’a de cesse de souligner et d’affirmer le caractère rationnel, détaché, réaliste et empirique dans la manière d’aborder les problèmes à l’étude. Il a peut-être “succombé” à des envolées romantiques à l’occasion, en outre sa stylistique n’a jamais été monotone, mais compte tenu de l’ensemble de son œuvre, il serait vain de contester l’appellation que lui a donnée l’éditeur bostonien Porter Sargent : “ce réaliste incorruptible”. En revanche, l’autre figure principale du fascisme intellectuel américain, Francis Parker Yockey (1917-1960), auteur de Imperium : The Philosophy of History and Politics (1948 en 2 vol.), était un mystique des plus romantique qui avait tendance à ne pas argumenter un cas, comme le faisait Dennis, mais à l’énoncer et à se passer de justification. Les deux hommes — ils ne se sont apparemment jamais rencontrés — étaient très intelligents et instruits, ont écrit des œuvres d’une érudition indéniablement vaste et ont été grandement influencés par Spengler. Mais leurs approches des mêmes problèmes d’histoire et de société étaient nettement différentes à bien des égards. Yockey était certainement le plus “typiquement fasciste”. Une analyse comparative de leurs approches constituerait une fructueuse étude. [L’influence de Spengler ne va pas sans interroger celle de l’historien anglais Arnold Toynbee sur Dennis, celui dont l’œuvre “a contribué à la formation de la conscience que la civilisation occidentale a prise d’elle-même” (Aron), même si les deux historiens, réunis par une même préoccupation pour le destin des civilisations, diffèrent par leur méthodologie et analyse. Sur les rapports entre Spengler et Toynbee, cf. « De Spengler à Toynbee : Deux philosophies opportunistes de l'histoire », Lucien Febvre, RMM n°4/1936 ; « Herr Spengler and Mr. Toynbee », Humfrey Michell, in : Toynbee And History : Critical Eassays And Reviews, 1956 ; « Two Prophets of the Twentieth Century : Spengler and Toynbee », James Joll, Review of International Studies n°2/1985. Rappelons que pour Toynbee, les dérives de la démocratie (instabilité, efficacité limitée, etc) entraînent, pour la société industrielle, la limitation de son pouvoir d’auto-détermination. Cette limitation implique un arrêt de l’élan vital. Cette perte d’harmonie, conséquence de la démocratie est, pour Toynbee, la cause fondamentale du déclin d’une civilisation. À terme, sans lien avec la société, l’individu au sein d’une société démocratique ne sera plus capable de décider et d’agir : “La perte de la décision personnelle est le critère ultime de l’effondrement”. Ce qui explique cette assertion dans l'introduction de Dynamics… : “Modern industrialism and democracy have developed conditions which only new forms of social organization can correct. To contradict successfully the foregoing statement it is necessary to show either that unemployment is a tolerable condition or that democracy can correct it. My critics are reminded that the burden of such proof lies on them and not on the challenger of democracy and capitalism”]
27. [note en sus] La lettre est datée de mai 1933 dans The Official German Report (p. 175) et du 15 avril 1933 par Robert Nedelkoff dans son article. Elle est adressée à Mildred Blackman, une femme éprise de mondanités dont Dennis s’était entiché au point de vouloir se fiancer avec elle, malgré le fait que sa condition financière fût alors au plus bas de toute son existence. Elle le rejeta d’ailleurs vite pour cette raison. Elle fut interrogée au printemps 1943 par les agents du FBI pour alimenter éventuellement l’instruction judiciaire. Horne nous en brosse un rapide portrait (p. 60-61). Pour elle, l’irritation de Dennis contre le New Deal était dû à une attente frustrée d’un poste de cabinet dans la première administration Roosevelt débutant en mars 1933. La lettre traduit surtout son état d'esprit du moment, elle commence d'ailleurs ainsi : “It was good to get your sweet letter of Tuesday. I am depressed to find you are also depressed. But I fully understand”. Mais indirectement cet épisode anecdotique témoigne d’une phase de transition chez Dennis, déchiré entre une carrière honorifique et une vie monacale de refus. Son attachement pour une femme sans doute très belle mais de nature vénale et ambivalente, pour qui la noblesse de cœur ne peut être qu’excuse à la pauvreté, renvoie à la propre ambivalence de Dennis à ce moment-là. Il conclut ainsi sa lettre : “I am too intelligent or intellectual to believe that it is anyone's fault. This mechanistic philosophy saves me from a sense of inferiority, guilt, or personal failure. I realize there are techniques for different types of contests and that I am not a master of the techniques needed for successful trading. I do not feel inferior or defeated because of this defect. The only consolation and perhaps my deepest worry is that I can love and that I have you to love. How cruel it is to suffer unfulfilled love”. L’égarement passionnel renvoie à un égarement plus large, autant existentiel que professionnel. Comme le rappelle James Hillman à propos des amours impossibles comme inhérentes à la condition humaine : “Nous sommes trahis au cœur même de la relation intime qui rend la confiance originelle possible. Nous ne pouvons être trahis que là où nous plaçons notre plus haute confiance. (…) La trahison de soi par soi est peut-être ce qui nous cause le plus de soucis. Elle est souvent la conséquence de la trahison par l'autre. (…) Nous avions dévoilé le pacte qui nous lie à notre nature profonde. C'est précisément dans cet acte que nous avons été trahis. C'est pourquoi nous refusons d'être ce que nous sommes, nous commençons à nous abuser nous-mêmes au moyen d'excuses et d'échappatoires et l’auto-trahison finit par correspondre à la définition jungienne de la névrose : igentlich leiden, une souffrance inauthentique. On ne vit plus sa propre forme de souffrance, mais par mauvaise foi et manque de courage, on se ment à soi-même, on se trahit soi-même”. En 1933 il épouse finalement la danseuse de ballet Eleanor Simson (1909-1984), avec qui il aura trois enfants : un garçon mort en bas âge (1935-1935) et deux filles, Emily (1934) et Laura (1936-2015).
28. Voir Doenecke, « Lawrence Dennis : Revisionist of the Cold War », Wisconsin Magazine of History n°4/1972, ainsi que deux autres articles du même auteur : « Lawrence Dennis : The Continuity of Isolationism », Libertarian Analysis, I, 1, 1970, p. 38-65, et « The Isolationist as Collectivist : Lawrence Dennis and the Coming of World War II », Journal of Libertarian Studies n°3/1979. Mentionnons aussi une réflexion critique sur Dennis dans son étude Not to the Swift : The Old Isolationists in the Cold War Era (1979) [recension] [Doenecke a aussi rédigé l’entrée Dennis dans World Fascism : A Historical Encyclopedia, 2006]. Que Dennis ait été une figure d’intérêt dans les cercles intellectuels libertaires est notable, étant donné qu’il n’était pas pour le moins libertaire. Un tel intérêt semble découler principalement de l’ampleur de son anti-interventionnisme en matière d’affaires étrangères ; entre aussi en jeu probablement quelque affinité avec son iconoclasme fondamental.
[Pour un traitement isolationniste libertaire plus récent de Dennis, voir J. Raimondo, « Tale of a “Seditionist” : The Story of Lawrence Dennis », Chronicles, XXIV, 2000, p. 19-22]
[Ajoutons aussi, plus proche du national-anarchisme : « Philosophical Anarchism and the Death of Empire », Keith Preston, 2003, trad. partielle]
29. Ibid., p. 283. Le livre de Radosh apporte une contribution décisive à l’explication et à la compréhension des premiers points de vue anti-“consensus” de la guerre froide et mérite amplement son statut de petit classique. Mais il y prédomine sourdement un leitmotiv “cinq personnages en quête d’une thèse” — immédiatement perceptible dans le titre et le sous-titre eux-mêmes : les prophètes étaient de “droite” et étaient des critiques “conservateurs”. Ces désignations pourraient s’appliquer sans aucun doute à Robert A. Taft et John T. Flynn — mais à Charles A. Beard, Oswald Garrison Villard et Lawrence Dennis ? Les trois derniers auraient probablement un petit rire à ce sujet, et le dernier aurait pu en plus menacer de porter plainte pour diffamation.
30. Voir William Appleman Williams, « The Frontier Thesis and American Foreign Policy », dans History as a Way of Learning (New Viewpoints, 1974), pp. 137-57.
31. Justus D. Doenecke, The Literature of Isolationism : A Guide to Non-Interventionist Scholarship, 1930-1972 (Ralph Myles, Colorado Springs, 1972), p. 40. [L'auteur a complété cette monographie par un article, « The Literature of Isolationism, 1972-1983 : A Bibliographical Guide », Journal of Libertarian Studies n°1/1983] [Cf aussi « American Anti-Interventionist Tradition : A Bibliographical Essay », in : Literature of Liberty n°2/1981 : “Corporatist elitist Lawrence Dennis continues to facinate students, though here again we need a full biography”]
32. [note en sus] Parmi les approches critiques possibles de l'économie politique chez Dennis, s’avère nécessaire la prise en compte de la dimension historique du capitalisme. Pour une première approche (par ordre de difficulté) : Histoire du capitalisme : 1500-2010, Michel Beaud, 2010 ; Histoire du capitalisme, Jürgen Kocka, 2017 [recension 1 / recensio 2] ; La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre temps, Karl Polanyi, 1944 (présentation / résumé). Toutefois la difficulté consiste à penser conjointement système économique, système politique, système monétaire. Se pose toujours par ex. la question politique de la régulation financière ou encore celle de l'idéologie dominante néo-libérale comme processeur de la mutation du capitalisme. Trois auteurs pourront présenter utilité si l’on privilégie une approche comparatiste : Pollock, Schumpeter et Wallerstein.
1) Friedrich Pollock élabore dans les années 30 la notion de capitalisme d’État : le capitalisme de l’entre-deux-guerres se caractérise comme une nouvelle forme sociale complètement administrée et unidimensionnelle. Au sein de celle-ci, la prise en charge de l’économie par l’État vient neutraliser la contradiction structurelle intrinsèque au capitalisme. Cf son article « State Capitalism : Its Possibilities and Limitations » (1941). Par-delà son influence sur l’École de Francfort, Pollock reste encore pertinent pour aborder les mutations du capitalisme postlibéral avec la financiarisation de l’économie et le téléguidage des États, cf compte-rendu par Clément Homs. Voir aussi « Capitalisme d’État et dialectique de la raison », Manfred Gangl, 2017.
2) Joseph Schumpeter, en regard de son approche originale, est souvent qualifié d'économiste “hétérodoxe”. Il partage avec Fernand Braudel, nonobstant leur différence d'approche, l'idée d'une importance de la “longue période” dans l’étude du capitalisme (cf « Braudel, Schumpeter et l'histoire du capitalisme », F. Dannequin, 2006). Dans son livre Capitalisme, Socialisme et Démocratie (1942) [traduction partielle], il défend l’idée que le capitalisme est soumis à un processus d’évolution innervé par l’innovation. La “destruction créatrice” est au cœur de la dynamique du capitalisme. Ce processus de mouvement permanent de destructions et de créations d’activité se déploie à long terme et transforme de l’intérieur la structure économique. Ce n’est pas la destruction qui porte la création, mais l’innovation qui engendre les deux, dans la dynamique globale du capitalisme. Celle-ci se matérialise sous forme de cycles. Toutefois il juge inéluctable la décomposition du système capitaliste et, inversement, considère l'émergence du socialisme comme inévitable : le gigantisme industriel engendre la bureaucratisation des tâches de direction, exproprie la bourgeoisie en vidant de sa substance la notion de propriété (“le progrès économique tend à se dépersonnaliser et à s’automatiser. Le travail des bureaux et des commissions tend à se substituer à l’action individuelle”).
Dans une lettre du 30 août 1944, le philosophe John Dewey avait déjà fait ce rapprochement : “My son sent me a copy of a small pamphlet on Is Capitalism Doomed ? Even more extraordinary than the affirmative answer, stated in a less doctrinaire and more intelligent way than usual statements to that effect, is the fact that it is written by the research man [Lawrence Dennis] of an industrial organization. And although it purports not to represent the views of the writer but to summarize an amalgam of Hansen and Schumpeter, it is even more astonishing to me that the comments forming the second part of the pamphlet and written by business men are comparatively mild and admit practically that the future of capitalism is tied to great modifications of the ‘private enterprise’ system” (cité par C. de Souza, thèse, 2018).
3) Immanuel Wallerstein, ce sociologue de l'économie consacre son œuvre à l’étude du capitalisme comme entité globale et historique, constituant le système-monde moderne. En retraçant les étapes du capitalisme au cours des cinq derniers siècles, il met en évidence ses composantes qui ont constamment évolué comme celles qui sont restées invariantes. Et en mettant l’accent sur l’émergence et le développement d’un marché mondial unifié, avec la division internationale du travail qui l’a accompagné, il montre comment le capitalisme a provoqué l’appauvrissement des pays du tiers monde. Et pourquoi les problèmes économiques et sociaux de ces pays perdureront tant qu’ils resteront intégrés au capitalisme mondial. De lui : The World System : Five Hundred Years or Five Thousand ?, 1993 et en français : Le capitalisme historique (1983), Une nouvelle phase du capitalisme ?, Syllepse, 2001.
On prendra aussi acte de la sociologie économique de Thorstein Veblen dont l'influence reste cruciale (on se reportera à la biographie de Joseph Dorfman qui reste la meilleure introduction : Thorstein Veblen and his America, 1934 [consultable] [recension]). Cf aussi « Thorstein Veblen's Views on American “Exceptionalism” : An Interpretation », Rick Tilman, Journal of Economic Issues n°1/2005 ; « Veblen’s Institutionalist Elaboration of Rent Theory », Michael Hudson, 2012 [traduction].
Pour contextualiser le capitalisme américain, de J. Dorfman : The Economic Mind in American Civilization [L'esprit économique de la civilisation américaine] (1946-59, not. vol. 3 à vol. 5), et du marxien Lewis Corey : The Decline of American Capitalism (1934) and The Crisis of the Middle Class (1935). Enfin, pour soumettre à examen la “thèse de la frontière” (frontière au sens américain d’aire maximale de prospérité), on se reportera à : Géographie et capital : vers un matérialisme historico-géographique, David Harvey, Syllepse, 2010.

◊ Suppléments documentaires :
• Articles de L. Dennis (par ordre chronologique)
« Revolution, Recognition and Intervention » (Foreign Affairs n°2/1931)
« Nicaragua : In Again, out Again » (Foreign Affairs n°3/1931)
« Usury and the Canonists » (Economic Journal n°166, 1932)
« Work or Profits ? » (New Republic n°945, 1933) [recension]
« A Communistic Strachey » (Nation n°3531, 1933) [recension]
« Can the Banks be made safe ? » (Nation n°3532, 1933)
« Money : Master or Means ? » (Nation n°3533, 1933)
« Is Capitalism doomed ? » (Saturday Review n°45-IX, 1933) [recension]
« Unscrambling a Receivership » (New Republic n°968, 1933) [recension]
« The Squirrel Cage of Debt » (Saturday Review n°49-IX, 1933) [recension] [version html]
« A Dated Liberal » (The Nation n°3557, 1933) [recension]
« HG Wells’s Internationalism » (Saturday Review n°8-X/1933) [recension]
« Beverley Nichols's Pacific Manifesto » (Saturday Review n°11-X, 1933) [recension]
« The Planless Roosevelt Revolution » (American Mercury n°125, 1934)
« The Case Against Liberalism » (Commonweal n°49-IX, 1934) [recension]
« Money » (Commonweal n°5-XXI, 1934) [recension]
« Fascism for America » (Annals of the American Academy of Political & Social Science, 1935)
« Portrait of American Fascism » (American Mercury n°144, 1935) [version html]
« What is Mussolini ? » (American Mercury n°147, 1936) [recension]
« The highly moral causes of war » (American Mercury n°151, 1936)
« Making the world safe for Communism » (American Mercury n°153, 1936) [recension]
« Soviet Russia goes on sale » (American Mercury n°156, 1936)
« Russia's private war in Spain » (American Mercury n°158, 1937)
« Liberalism commits suicide » (American Mercury n°166, 1937)
« England liquidates Liberalism » (American Mercury n°172, 1938)
« Propaganda for war : Model 1938 » (American Mercury n°173, 1938)
« The real communist menace » (American Mercury n°174, 1938)
« How to rig a bull market » (American Mercury n°177, 1938)
« What price good neighbor ? » (American Mercury n°178, 1938)
« The class war comes to America » (American Mercury n°180, 1938)
« After the peace of Munich » (American Mercury n°181, 1939)
« Our Nation of wishful thinkers » (American Mercury n°182, 1939)
« The Party-State and the Elite » (Nation n°2/1941)
« Reply » (droit de réponse à Paul Mattick) (Living Marxism n°3/1941)
• Autres
« A shamefaced apologist for fascism » (J. Hansen, Fourth International n°10/1943)
« Populist Influences on American Fascism » (V. Ferkiss, The Western Political Quarterly n°2/1957)
« The Frontier Thesis and the Great Depression » (S. Kesselman, Journal of the History of Ideas n°2/ 1968)
« Some reflections on the Coming of an American Fascism » (C. J. Karier, in : Educational Theory n°3/1987)
« The Strange Career of Lawrence Dennis : Race and Far-Right Politics in the Great Depression » (S. Leikin, 1995)
« Lawrence Dennis : The Populist Intellectual » (C. Willis, Populism versus Plutocracy : The Universal Struggle, 1996)
« American Culture in the 1930s » (David Eldridge, Edinburgh Univ. Press, 2008)
« The Enigma of American Fascism in the 1930s » (Michael Kleen, AltRight, 2011)
« Lawrence Dennis and James Burnham » (Panther Red, 2017)
*
◊ Émissions radio NBC America's Town Meeting of the Air :
12 déc. 1935 : Personal Liberty & The Modern State avec Howard Lee McBain, Lena Madison Phillips, Roger Baldwin, Henry Pratt Fairchild, Lawrence Dennis [lien mp3]
11 nov. 1936 : Opinion & The Town Meeting Idea avec Dorothy Thompson, Lawrence Dennis, Scott Nearing [lien mp3]
*
 [Ci-contre : En 1932 parait chez Knopf aux USA The Twelfth Hour of Capitalism (La Douzième Heure du Capitalisme) de l’économiste Kuno Renatus, traduit par Ernest W. Dickes (Die Zwölfte Stunde der Weltwirtschaft, Beck, 1931). Son constat alarmiste est contemporain du livre de Dennis sur la fin du capitalisme : « Si jeune que soit encore le capitalisme, il a déjà complètement oublié le caractère conditionnel de la loi de la productivité sur laquelle repose tout son système : “Tu ne contracteras des dettes qu’à des fins productives” ».
[Ci-contre : En 1932 parait chez Knopf aux USA The Twelfth Hour of Capitalism (La Douzième Heure du Capitalisme) de l’économiste Kuno Renatus, traduit par Ernest W. Dickes (Die Zwölfte Stunde der Weltwirtschaft, Beck, 1931). Son constat alarmiste est contemporain du livre de Dennis sur la fin du capitalisme : « Si jeune que soit encore le capitalisme, il a déjà complètement oublié le caractère conditionnel de la loi de la productivité sur laquelle repose tout son système : “Tu ne contracteras des dettes qu’à des fins productives” ». Malgré sa critique économique gardant encore pertinence, il demeure tout comme le livre de Dennis complètement oublié. Et pourtant l’instrumentalisation des dettes publiques et privées continue à faire levier pour s’approprier la souveraineté des pays. Elle permet d’imposer des politiques néolibérales d’austérité, de baisses salariales, de concurrence internationale et de contrôle social. Bien des pays sont contraints de suivre ce qui est préconisé par les institutions économiques mondiales (FMI, Banque mondiale), notamment les programmes d’ajustement structurel qui visent à privatiser et à déréglementer le plus possible et qui mènent à une forme de recolonisation. Le comble de l’ironie pour l’Europe est atteint en 2010 avec l’affaire Goldman Sachs, banque la plus puissante du monde, qui a spéculé sur le dos de la Grèce tout en se faisant rémunérer par Athènes pour l’aider à gérer la crise]
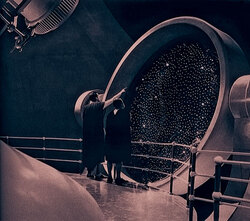 [Ci-contre : scène du film d’anticipation Things to Come (Les Mondes futurs ou La Vie future, Menzies, 1936). Lorsque Herbert Georges Wells écrit son roman The Shape of Things to Come en 1933, il ressent avec une justesse quasi prémonitoire que le monde va de nouveau basculer dans un conflit mondial. Dennis, dans une recension, fustige toutefois l’écrivain, compagnon de route des socialistes anglais, pour son apologie d’un “État-Monde” (ou démocratie parlementaire universelle). Produit par la London Films d’Alexander Korda, offrant, outre costumes et effets spéciaux, des décors inspirant gigantisme et puissance, il s’agit du film de science-fiction le plus cher et le plus ambitieux des années 30, l’un des tous premiers grands films de ce genre avec Metropolis (que Wells détestait). Le film se déroule sur trois grandes périodes, anticipant ainsi les cent années à venir : 1940 avec le début d’une guerre qui durera 25 ans, 1972 où le monde exsangue est revenu à une civilisation de type féodal et enfin 2036 où règne le culte du progrès sous un régime de technocrates bienveillants. — Que retenir du genre anticipatif ? Crise économique et mondialisation qui accélèrent la déprogrammation néo-libérale de l’État-providence, métastases terroristes, conflit militaire de grande envergure, déplacements nord/sud de populations, politiques sécuritaires de surveillance généralisée, dérèglement climatique, massacre environnemental : face à de tels maux, notre désarroi collectif n’a rien à envier à l’imaginaire dystopique]
[Ci-contre : scène du film d’anticipation Things to Come (Les Mondes futurs ou La Vie future, Menzies, 1936). Lorsque Herbert Georges Wells écrit son roman The Shape of Things to Come en 1933, il ressent avec une justesse quasi prémonitoire que le monde va de nouveau basculer dans un conflit mondial. Dennis, dans une recension, fustige toutefois l’écrivain, compagnon de route des socialistes anglais, pour son apologie d’un “État-Monde” (ou démocratie parlementaire universelle). Produit par la London Films d’Alexander Korda, offrant, outre costumes et effets spéciaux, des décors inspirant gigantisme et puissance, il s’agit du film de science-fiction le plus cher et le plus ambitieux des années 30, l’un des tous premiers grands films de ce genre avec Metropolis (que Wells détestait). Le film se déroule sur trois grandes périodes, anticipant ainsi les cent années à venir : 1940 avec le début d’une guerre qui durera 25 ans, 1972 où le monde exsangue est revenu à une civilisation de type féodal et enfin 2036 où règne le culte du progrès sous un régime de technocrates bienveillants. — Que retenir du genre anticipatif ? Crise économique et mondialisation qui accélèrent la déprogrammation néo-libérale de l’État-providence, métastases terroristes, conflit militaire de grande envergure, déplacements nord/sud de populations, politiques sécuritaires de surveillance généralisée, dérèglement climatique, massacre environnemental : face à de tels maux, notre désarroi collectif n’a rien à envier à l’imaginaire dystopique]
 Lawrence Dennis,
Lawrence Dennis,
Black voice in the right wing wilderness• Recensions :
⬨ Lawrence Dennis :
• The Coming American Fascism, 1936. Intro. WA Carto, Noontide Press, Newport Beach, 1993
• The Dynamics of War and Revolution, 1940. lntrod. James J. Martin, Noontide Press, Newport Beach, 1980
• A Trial on Trial : The Great Sedition Trial of 1944, av. Maximilian St. George, National Civil Rights Committee, 1946
• Operational Thinking for Survival, Ralph Myles, Colorado Springs, 1969.⬨ Gerald Horne :
• The Color of Fascism : Lawrence Dennis, Racial Passing, and the Rise of Right Wing Extremism in the United States, New York UP, 2006.
[Ci-contre : couverture du livre de Gerald Horne]
***
Lawrence Dennis (1893-1977) is a forgotten figure in American intellectual history. He was an articulate isolationist, an independent political and economic commentator, an advisor to Col. Lindbergh and the America First Committee, which hoped to keep the US out of a world war. This work made him an enemy of Franklin Delano Roosevelt, who put Dennis on trial with two dozen other right-wing opponents to his policies, in “The Great Sedition Trial” of 1944. Although the trial was inconclusive and stopped with the death of the judge, Dennis has been forever after tainted as a “fascist”. Perhaps he was.
In his 1936 book, The Coming American Fascism, he prophesied fascism in some form was the future of the United States. Dennis believed that the Depression proved that economic liberalism was dead and managed economies inevitable. He called for nationalization of banks, monopolies and schools, and generally, for a country administered by an “elite” imbued with ideals of national service rather then the dreams of private profit at public expense. But The Coming American Fascism is not a hate book. Dennis was not a racist and he was no extremist either ; the mark of right-wing extremism is conspiracy theory, which Dennis rejected. Dennis was too savvy for that ; for him, politics was a power struggle between elites, not the unfolding of a secret plan. The world could not be dominated by a single group with a comprehensive program, so there are no scapegoats (if Dennis takes shots at any special group it is lawyers), nor does the book make a fetish of military virtue. Dennis was no Nazi ; The Coming American Fascism is not Mein Kampf for Americans [0]. He argued for an American fascism that was “scientific and pragmatic”, flexible and open to an elite of talent. He does argue for a single party state and for “the logic and inevitability of a disciplined party organization for effective and responsible action” (CAF 298-9). All in all, he has as much in common with Alexander Hamilton as with Mussolini, and except for his Hobbesian emphasis on the ruthless struggle for national survival, little in common with Adolf Hitler.
In short, Dennis is that rare animal, a right-wing intellectual. Now, thanks to Professor Horne, we learn that Lawrence Dennis was black and only passing as white-something once known but forgotten. Born in Atlanta, he began life as Lonnie Dennis, and gained fleeting fame as a child evangelist, touring the US and Europe with his visibly black mother. It is probably symptomatic of my racial and political naivete that I was stunned that “the brains of American fascism”, as Harold Ickes called him, was black. Besides, the picture of Dennis on the cover and frontispiece of Gerald Horne's study shows a manifestly white man with a craggy face and rock-like chin who looks like he could have been the model for New Hampshire's late lamented state symbol, “The Old Man of the Mountain”. Reading Dennis as black changes utterly the meaning of his anti-liberal, openly elitist message.
Graduated from Exeter and Harvard, Dennis distinguished himself as an army officer in World War I. After the war he served the State Department in Romania, Haiti, Honduras, and Nicaragua, so he saw American imperialism first hand and was not impressed. By his own account, he was “the principle American chargé d’affaires in Nicaragua in August 1926, who, at the request of the State Department, sent the telegram asking the Marines to come back to 'protect American life and property”' (DWR 108) and so crush Nicaraguan hopes of political independence. In 1927 Dennis left government service after complaining about US policy in Latin America and went to work for Wall Street as an agent for the Seligman bank. Assigned to Peru, he saw enough to convince him that a market crash was immanent. Specifically, Peru was flooded with loans that could never hope to be repaid. When Dennis made his views known in print, Seligman chose not to believe him, but when the crash came and Dennis was vindicated, he was able to parlay his apparent prophecy into a life as a public intellectual, writing for The New Republic and other magazines, and testifying before Congressional Committees on economic matters. He was especially proud of two articles on the banking crisis in The Nation, written in 1933, that showed the correct way out of the slump via government spending. Dennis made then the still heretical proposal that if the government could command spending for war, it could just as easily command it for welfare programs-clearly he was not your garden variety rightist (see OTFS 189-198). Indeed, Horne believes that Dennis hoped to become one of Roosevelt's Brain Trusters. When this failed to materialize, Dennis found himself, to use his own preferred terms, as one of the “out” elite, as opposed to one of the “ins”.
If Dennis looks like what Gerald Horne calls a “melanin deficient” person, he shows in this first biographical study of Dennis that this multilingual Harvard graduate, US Army officer, diplomat and Wall St. insider, was indeed “black” by the perverse legal codes of the United States, which means that he should be considered one of the important black public intellectuals of the twentieth century. Labeled a fascist, which Horne’s unfortunate title only reinforces, Dennis has been consigned to the brimming right-wing “crackpot” bin of American history. He deserves much better. He deserves to be read. The Color of Fascism was so interesting — and so frustratingly short on critical detail — that I found Dennis’s 1940 book The Dynamics of War and Revolution (the only one of Dennis's books in my college library) and read it. That book shows that Lawrence Dennis was a brilliant public intellectual.
His book is more lively and better written than Walter Lippman’s The Good Society (1937) to which it probably responds, or Thurman Arnold’s wry study of liberal ideology, The Folklore of Capitalism (1937) to which it nods. His first book, Is Capitalism Doomed ? (1932) seems truly out of print ; but his other books, including the one that made him notorious, The Coming American Fascism (1936), are still available. As I found on reading it, “fascism” in that book does not mean Hitler or Mussolini, but any “strong authoritarian executive state” (102) willing the national good through central economic planning. In fact, in Dennis’s account, all managed economies, from Italy to the USSR, including the US under the New Deal, were socialist. Finally, the late Operational Thinking for Survival (1969) is a pragmatic “guide to useful thinking about the near future” in the space age, “the age of permanent war crisis”. This book is little known-even less than the privately printed Trial on Trial of 1946. It is so obscure that Horne himself seems unaware of its existence, though an article by Keith Stimely available on the web marks it as an important late work, and stresses “operational thinking” as a crucial key-term for Dennis [1].
That the late Stimely was interested in Dennis should have clued me in. When the most recent reprints of Dennis arrived, I saw that they were undertaken by Willis Carto’s Noontide Press, which means that Dennis has become canonical on the extreme right. Given his idiosyncratic views (not fervently anti-communist, disillusioned with Christianity, pro Third World) this is surprising to me. But, the “Lawrence Dennis Institute”, which bills Dennis and its ideology as populist-progressive, seems to be the heir to the now defunct Liberty Lobby. Dennis deserves a better fate. Perhaps now that his racial filiations are known, rather than a “right wing extremist” as Horne still wants him to be, Dennis will find his place in the disenchanted anti-liberal black company of Thomas Sowell, Clarence Thomas, and George Schuyler.
Given Horne’s own left politics, it is not surprising that he is not much interested in Dennis’s political rehabilitation or in him as a public intellectual. Horne, a prolific writer who has already contributed a left interpretation of the Civil Rights movement in his biography of Ben Davis [2], still feels the need to reassure his audience that he himself “is a dark-skinned person with Socialist views”. He is frankly dismayed by Dennis’s political ideas. Instead, he wants “to try to shed light on how Jim Crow, an ideology that was a close cousin of fascism, may have driven Dennis to political extremities and infected his thinking” (x-xi). To Horne, Dennis is merely an eccentric and racially damaged African-American thinker whose unique subject-position gave him dark insights into the so-called “good society” of the high priests of liberalism like Lippman. Yet, Horne presents no evidence that Dennis is in any sense an “extremist”. In his own mind, he was a dissident “theorist”, not an ideologue. His books bear him out.
Theorist or not, once the US entered World War II, efforts were made to determine if Dennis was a traitor because of his extensive German contacts. He was put under FBI surveillance and in 1942 his papers were seized. Despite this hostile scrutiny, the worst that can be said of Dennis is that in the Thirties he admired Hitler as a dynamic leader and saw in fascism an answer to the bankrupt “liberal consensus” that underwrote capitalism in the 19th century. As a free-floating intellectual with patrician tastes, he was often short of cash, so his Weekly Foreign Letter, which tried to reach “elite” subscribers with Dennis's isolationist message, apparently “did receive some contributions from the German Embassy” (xi). Unfortunately, Horne leaves it unclear if these subsidies continued after Germany declared war on the US, Dec 10, 1941. Also, Dennis was “a frequent visitor” to the German Embassy in the Thirties and was invited to the Nuremberg party rally of 1936. He met Hitler and Mussolini, and, according to Horne, had a high opinion of Hitler’s inner-circle : Goering, Goebbels, and even Rosenberg (seemingly because the arch-ideologue Rosenberg was a “theorist” like himself).
Finally, FBI files studied by Horne reveal that, during 1938-1940, Dennis had frequent meetings with Dr. Friedrich Auhagen, a one-time Columbia Professor of German who was a Nazi agent, but Horne says nothing about any meetings after the US entered the war. Presumably there were none. Since Dennis was an articulate spokesman for isolationism, Auhagen would have been interested in encouraging Dennis ; he even hired him to speak at his “American Fellowship Forum”, but that was in April 1939, months before open hostilities in Europe. Dennis also wrote for The Reader’s Digest when it was soft on fascism, but as he was never charged with treason, it is likely there was no evidence of any. Altogether, these disturbing contacts with Germany cloud Dennis’s legacy. As Horne writes, “Dennis, of course, sought to deny what seemed obvious to many others — that he was at the center of a vast right-wing conspiracy” CAF 69). But Horne fails to clearly outline any such conspiracy. Whatever the case was, Dennis's “fascism” is sophisticated and buttressed by extensive economic, not racial arguments. Given his covert racial situation, Dennis could not have been a simple black nationalist, (like several black “fuehrers” active in Harlem at the time). His post-war writing, with his frequent and ironic use of Lothrop Stoddard’s “rising tide of color” shows a keen interest in the third world and an anti-imperialism consistent with his isolationism of the late 1930s. Dennis was attracted to celebrities, so it's easy to see why he cottoned to the impressionable Lindbergh, who was transported by Nazi spectacle. Yet, despite some affinities with America's Aryan wunderkind, for whom he wrote some speeches, Dennis seems to have been skeptical, even contemptuous of Bund-style marching societies and mass politics.
Although visible on stage at America First rallies, Dennis preferred to work behind the scenes. He was good friends with Col. Truman Smith, Lindbergh's political advisor and arch-isolationist, and Lindbergh advisor Congressman George Tinkham subscribed to his publications. Unlike Lindbergh, Dennis never expressed anti-Semitism in his writings that I have seen. He denies anti-Semitism in his searching polemical analysis of his own trial : The Trial on Trial : The Great Sedition Trial of 1944. There is no trace of it in The Dynamics of War and Revolution, the one book by Dennis introduced in the trial. (Curiously, according to Dennis, The Coming American Fascism, which is a pro-fascist book, was not.) The government witness against him also conceded that Dynamics “is certainly not a Nazi book” ; instead, he compared it with Spengler’s The Decline of the West (TT 138). Though flattering, the comparison is apt only in that the books are both deeply pessimistic and conservative. Spengler believed in “Prussianism”, not Nazism ; in Bismark, not Hitler. Dennis’s writing has none of Spengler’s Wagnerian power-chords and stifling Romanticism. Dennis's is a classic and cynical style, almost “French”, with a turn towards epigram : “Bismark once said that politics is the science of the possible. Ethics is clearly the science of the desirable, which literally, can mean anything possible or impossible” (DWR 25).
It’s important to see that Dennis endorses “a desirable fascism” because he feels we must come to terms with reality, not be blinded by the ethical idealism of so-called democracy. He believes that might is right and always has been. “Democracy”, he writes, “is valid only in so far as it postulates and expresses in effective action the might of the people” (my emphasis CAF 143). Since it does not, in fact, do this, we need to move on. He holds no brief for any single leader, but he is for the rule of dynamic elites “willing the national good” as Ezra Pound would say. And he sees that in reality, elites do rule, though increasingly and therefore hypocritically, in the name of “the people”. History is enacted by conflicts between “in” elites and the “outs” trying to get back in. Beneath this political turbulence the common people are fed whatever it is expedient for them to know.
Horne believes that Dennis took this dim view of democracy because of Jim Crow. He recognized the pliability of the people, their susceptibility to sentiment and difficulty in distinguishing the common good from “minority interests”. As he wrote about the Depression in the 1930s, “The role of education in our present crisis is to make the masses susceptible as they never were before to propaganda and demagogic manipulation. The greater the number of people who can vote and read, the greater the irrationality, the greater the conflict of minority interests and the greater the anarchy in the political and economic processes under a system of parliamentary democracy. The people can rule with rationality and success only through a single leader, party and governing agency” (DWR 125). Just to be clear, these minority interests as one can see in reading The Coming American Fascism, are simply “interest groups” and their powerful lobbies ; is it not a code word for Jews (CAF 97-99).
Dennis's cynicism about how public power serves private interests is why he’s worth reading today. He notes “once good advertising technique becomes good political technique a country is ready for a Dr. Goebbels” (CAF130) — or a Karl Rove. His unsparing critique of liberalism is obviously informed by the history of slavery. He scorns the “immunity liberalism gives to property but not to human life”. Liberalism also “means that long wars result in the greater concentration of wealth, as a result of war financing by borrowing from the rich, whereas” in the past under monarchies and in future under fascism, “long wars would result in a drastic equalization of wealth if the funds needed were taken by levy” from the rich, or rich corporations (CAF 135). Dennis’s insight helps explain why no windfall profit taxes have been levied (or even considered) against big oil and the private military industry in our long war in Iraq from which they have profited so outrageously.
Dennis looks to Germany, Italy, the USSR, and his own United States to see where demagogic rule via “good advertising technique” is in fact happening. FDR’s rush to world war, despite fervent election year promises to the contrary in 1940, was driven by the reality that capitalism has failed, and that only war could save liberalism as well as the British Empire. This crusade would, in Dennis’s view, only hasten the onset of some kind of national socialism — that is, managed economies by nationalist elites. He thought that the continuation of liberalism under war conditions could only result in sham elections and, as his own experience would bear out, show trials. It took on characteristics of our war-time ally the USSR, rather than Hitler's Germany.
In the event, Dennis proved prophetic. The half of Europe that was not swallowed by the Soviets after the war went forward under more or less social-national economies, with nationalized railroads, health care, and major industries, although the German banking system under the Bundesbank (modeled on the Federal Reserve Bank of the United States) maintained a liberal fa;:ade. Keynesian economics saved capitalism as the Cold War militarized the economy and society. In the words of economist Meghnad Desai, the post-war period was “the golden age of national capitalism” [3]. It was Dennis’s curious subject position as a passer, Horne argues, that taught him to be a cynic, a realist and a pessimist. For Dennis, history was force, liberal ideology its velvet glove. Having experienced the US as a black southerner, Dennis saw “democracy” as the cover story of imperialism, with the south as a classic economic colony, in some ways more socially and racially backward even than Haiti, Honduras, and Nicaragua.
No wonder Dennis was unimpressed with liberalism. His State Department service in the Caribbean and Latin America in the 1920’s gave him an inside look at American imperialism at its most flagrant and most racist. Thus, he saw American “interventionism” for what it was-coercive aggression to protect private investments abroad paid for by American taxpayers. Liberalism, for Dennis, is nothing more than the ideology of the British Empire, eagerly embraced by the United States, which depended on “free-markets” and the gold standard to extract profit from its possessions. Freedom, in liberal terms, is nothing more than the free-play of capital-exactly what “spreading freedom” means to the Bush regime. “Liberal economics is essentially a system of propaganda” (CAF 35) he wrote, dependant on uniquely 191h century conditions, free land, cheap labor and superior military technology. It could not survive long in the 20th century.
Dennis admired Frederick Turner and realized that the “closing of the frontier”, the relative success of the labor movement, and the erosion of European technological superiority meant the end of capitalism as a dynamic system. In the 20th century it would need to be “rationalized” and managed by a pragmatic and strong-willed elite. In the 1930s, Dennis saw that this was already happening in the fascist countries and in the USSR. Meanwhile, even Britain had ditched the cant of ’free-markets’ and opted for tariff protection, thereby “admitting defeat in foreign trade… and spelling the doom of a liberal British imperialism” (CAF 45). There was only one term for any non-communist alternative to liberalism in the polarized, politicized l930's-fascism. Dennis was attracted to economic self-sufficiency (autarky) and he thought that “men were better off in the army than in the bread-line” (CAF 281) but as an anti-imperialist, he thought armies were for defense, not aggression.
Besides in the twentieth century there were no more “easy wars of conquest”. Instead of foreign wars Dennis proposed “pyramid building” — that is, public works projects”, capital investments by the state that would never be created by private capital or enterprise for a profit or for interest”. In economic terms these “non-productive” public investments nonetheless could have real social value. These could be public monuments, or workers’ housing (DWR 220-235). Dennis hoped that such investments would be made to benefit the public ; in any event, we got the space-race, the invasion of the moon, and the Cold War. These are 20th century analogues to the pyramids : perfectly useless, perfectly spellbinding, conjuring both the dynamism and discipline Dennis had in mind back in 1940 but without the social benefits.
Horne’s focus on Dennis's constant reminders of the anomalous plight of “the Negro” in these supposedly free states shows unequivocally that Dennis was preoccupied with his racial secret. He passed successfully his whole life ; although some guessed at his race, he never admitted it, not even to his family. Horne’s reading of The Dynamics of War and Revolution stresses Dennis's recurrent references to America’s racial hypocrisy ; “In this book he poured out like molten lava the pent-up frustrations of a man who was furious with society that had compelled him to make his family disappear in order to advance”… Dennis did not hesitate to point out that… the United States was a limited herrenvolk democracy” (Horne 90). Hiding his racial secret, Dennis's sense of intellectual superiority must have been flattered by the blindness of others around him ; but his obsessive need to name-drop says a lot about his social insecurity. Certainly, his position colored his sharp, almost Voltairean irony. In The Trial on Trial, Dennis goes out of his way to mock the government's inept and quasi-scientific method of deciding what Nazi propaganda was by listing its characteristics : “ … one does not need fourteen characteristics any more than one needs fourteen characteristics to differentiate whites from Negroes. Three characteristics will suffice in the case of Negroes : color of skin, texture of hair and thickness of lips” (T on T 359). Reading this assuming that Dennis was a white fascist, we cringe ; reading him as a black writer we can be amused by this covert act of resistance and how Dennis must have cackled inwardly writing it.
Despite claims to discuss “racial passing” Horne has nothing very deep to say about it, nothing like the searching New Yorker essay by Henry Louis Gates on Anatole Broyard’s double life of a decade ago [4]. Horne's introduction gives us a brief standard history of racial passing in the United States and makes the case that those who pass may well become conservatives as a defensive screen against inquiries about ancestry. Passing, for Horne, simply means the opportunistic abandonment of one's family and the requisite loneliness (Horne 25) ; it is more sentimental loss than political statement. A rambling writer at best, Horne insists on dwelling on the sorrows of Dennis's supposed alienation from his mother in paragraph after paragraph. But what Dennis's feelings were, or even if his mother was alive, are pure speculation. Since he never discussed it, nothing is known of how Dennis made his decision to pass, what agonies it might have cost him, or even how, at age twenty, he inserted himself into Philips Exeter Academy, presumably posing as a much younger person, as well as a white. For Dennis's early life, Horne is forced to rely on FBI files-hardly an archive likely to be full of insight into the motivations of a nominally “black” person making the huge existential leap from one “race” to another.
However, he does point out that Dennis's “isolationism” was not only a political position, but “also, points ironically to his social position”. Yet, however distanced from his black roots, Dennis seems anything but socially isolated ; he seems to have been accepted fully as a member of the “elite”, with prominent, moneyed friends, including Philip Johnson the architect, Sterling Morton the salt magnate, the Lindberghs and many others on his mailing list for The Weekly Foreign Letter (1938-1942) and later, The Appeal to Reason, which he started in 1946 and which ran, apparently, into the 1950s. I have to say “apparently” above, because Horne’s limited interest in Dennis's ideas, except as they conform to his own beliefs and his one-sided, though valuable, presentation of Dennis as a black thinker, means that his account of the evolution of Dennis’s thought is scattered across his text. One symptom is a lack of a bibliography ; he gives us no dates, no history of Dennis's publications. And, as mentioned, he seems quite unaware of Dennis's late book, Operational Thinking for Survival.
A public intellectual is a philosopher of the present, so Dennis’s thought evolved in response to public events, even as his assumptions remained little changed : the dynamic period of capitalism ended with the foreclosure of frontier conditions, liberalism is purely ideological, fascism of one kind or another inevitable. The Dynamics of War and Revolution is a substantial work of revisionist history and was so taken by contemporaries as Horne shows by quoting reviews. But Horne does not stress, as Stimely does, respectful contemporary treatments of Dennis in the work of such intellectuals as Alan Pendleton Grimes, David Spitz, and Arthur Schlesinger, Jr. I would add that the Marxist historian Lewis Corey quotes Dennis’s early work approvingly in The Decline of American Capitalism (1934). Horne does point us to comments by Ezra Pound on Dennis. On reading articles by him in The Examiner (March 1939), “the poet laureate of fascism” (Horne xv) was inspired to produce a laudatory if rather incoherent radio speech, urging Americans to “read him”, but is clear that, isolated in Rapallo, the poet’s acquaintance with Dennis's work was very limited. Still, Horne uses Pound’s equivocal endorsement to underline Horne's right-wing filiations with his “erstwhile comrade” and to insinuate that even though “some of [Dennis’s] ideas did not seem to dovetail with those on the ultraright” like Pound, and even though he constantly asserted that he was not a fascist, Dennis, in Horne's reading, “was ’passing’ or seeking to position himself advantageously” for the inevitable fascist regime to come (Horne xvi). In short, he argues that Dennis was a cynical opportunist. This is just one of many moments when the reader feels Horne's deep disapproval of Dennis as a passer ; he sees Dennis as a kind of opportunistic race traitor ; it can’t be admitted that for the “melanin deficient” but legally “black” person, race need not be a law of nature, but as Gates points out about Broyard, “an elective affinity”.
Horne’s political — and dare I say racial ? — discomfort with Dennis may explain why he doesn’t analyze Dennis’s work in its own terms. When Horne approves of an idea he often suggests that it was “borrowed from the Black Left”. Since, as Ralph Ellison has taught so well, the Black Left was far from independent at the time Dennis was writing-it was more or less an agency of the Comintern-one wonders just what Horne means. Altogether, Dennis’s work is a serious vision of a new kind of America ; it asks to be read thoughtfully.
To repeat, this is not a vision of hate, or of reaction, as the term “fascism” suggests, but a prophetic vision of a possible future, which materialized, instead, as the fascistic National Security State. The whole of Dennis’s work deserve to be read and studied by those interested in American intellectual history and, as Horne shows, by those interested in African-American history as well. Perhaps Horne’s pioneering book will serve to recall this forgotten black outsider back from the kitchen to sit with his peers at the dining room table of American intellectual history. It is far more useful to put Dennis in conversation with W.E.B. DuBois and Amiri Baraka than with Mussolini and Hitler.
► Alec Marsh, Callaloo n°4, 2008.
• Notes :
[note en sus] 0. Allusion à l’affirmation ubuesque du journaliste George Seldes : “The Mercury also announced that Dennis was the author of The Coming American Fascism, which was about to be printed and which was recognized as a Mein Kampf for America” (Facts and fascism, 1943, p. 164).
1. All Dennis's books, except ls Capitalism Doomed ? can be bought online. For an account of Stimely, see Kevin Coogan, Dreamer of the Day : Francis Parker Yockey and the Postwar Fascist International, Automedia, 1999, p. 525-6 [recension]. Stimely's impressive essay is called “Lawrence Dennis and the Frontier Thesis for American Capitalism” (1986), published 2001.
2. Black Liberation / Red Scare : Ben Davis and the Communist Party, Newark, U. of Delaware, 1994.
3. See Marx's Revenge : The Resurgence of Capitalism and the Death of Statist Socialism, Verso, London. 2002, pp. 216-234.
4. Now collected in : Henry Louis Gates Jr., “The Passing of Anatole Broyard”, in : Thirteen Ways of Looking at a Black Man, New York, Random House, 1997, pp. 180-214.*
• nota bene : Dans une lettre à Justus Doenecke, datée du 30 mars 1970, Dennis revient sur le court épisode du Comité America First (il dura un an) : “The anti-intervention or then so-called isolation cause was basically anti–New Deal. It was against America getting into the war only because the New Dealers seemed to be using American intervention in the war as essentially a New Deal strategy. The America Firsters or antiwar factors were not really pacifist or antiwar. They were anti–New Deal and that made them antiwar in that period and situation” (folder 22, box 3, Lawrence Dennis Papers, Hoover Institution, Stanford University). Cité par Bradley Hart (in : Hitler's American Friends, 2018, recension), qui recycle hélas subrepticement le fantasme de la “cinquième colonne” et vante Edgar Hoover pour son action, citation reprise hors contexte dans un article de Mark Dunbar daté de 2019 pour faire un parallèle entre années 30 et Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, et sous-entendant un opportunisme de Dennis. Dans un article récent, Nelson Lichtenstein revient à propos, au sujet des podcats de Rachel Maddow traitant de la période, sur ce type de lecture tendancieuse de l’histoire qui sert de justification a posteriori de convictions et n'apporte rien au débat public :
“Indeed, despite all the America First bluster, bipartisan interventionism, not fascism, soon dominated American politics. After June 1940, when France fell to the Nazis, the United States rapidly became what Roosevelt called an “arsenal of democracy” whose enormous resources shifted the tide of battle. A newly empowered labor movement was increasingly anti-fascist, and American liberals were growing far more interventionist. When we consider that Congress passed Lend-Lease, a peacetime draft, and a gigantic increase in the war budget — all before Pearl Harbor — the various machinations of Viereck and his collaborators come to seem petty indeed. In describing those hostile to American intervention in the war, Maddow and her podcast collaborators like to tell stories of corruption and misadventure. But the Bund failed to mobilize more than a sliver of support among German Americans, one reason the Nazi regime repudiated the organization in the late 1930s. And Father Coughlin’s heavily Irish audience was far more anti-British than pro-German. (…) The problem is that MSNBC’s obsession with Trump and his most prominent right-wing supporters has created a dichotomy between political “extremism” on the one hand and “normal” politics on the other. But there is no such thing as normality when it comes to political culture or discourse, in the 1940s or today, and it is fruitless to think that defeating the Trumpists is going to return us to some kind of equilibrium that rescues us from corruption, subversion, inequality, and racism. Only the most robust sort of democratic movement, one that directly mobilizes heretofore marginalized elements of the body politic, has the capacity to defeat reaction and inaugurate a new set of battles for a new society”.

[Ci-contre : What show have you got, little man ? (Que trames-tu, petit bonhomme ?), caricature sur Wall Street par Udo Keppler illustrant la couverture de l’hebdomadaire satirique Puck du 8 avril 1908. Dans son pamphlet de 1932, Dennis est partisan de nationaliser les banques, de confier à l’État le monopole du crédit et de liquider Wall Street. Convaincu que le capitalisme individuel est appelé à imploser, il préconise une réformme profonde qui s'apparente beaucoup au capitalisme d'État, à la technocratie, au planisme et au corporatisme fasciste]
A scenario for the establishment of fascism in America was provided by economist Lawrence Dennis, the self-styled “intellectual leader of American fascism”, in The Coming American Fascism (1936). The liberal state had failed, according to Dennis, because “the masses have not the intelligence or the humanity, nor the [upper classes] the magnanimity, which liberal assumptions have postulated”. With the collapse of socially irresponsible capitalism and the demonstrated incapacity of democratic government to deal with the crisis, he argued, fascism would prove the necessary and rational alternative to social disintegration and chaos.
Fascism, according to Dennis, would be instituted by a disaffected elite organized behind a “great leader”. Free of racial, religious, or ethnic bigotry, American fascism would be the fulfillment of “inevitable and irresistible” social changes long under way in the United States — centralization and rationalization. Fascism would dictate extreme governmental centralization — the abolition of the federal system, states’ rights, and the separation of powers among the legislative, executive, and judicial branches of government. The government would consist of a council of managers and engineers who would administer a “national plan”, a program of social rationalization that would bring the nation’s “social machinery up to date”. It would nationalize monopolies and large corporations but otherwise retain economic freedom.
“Fascism — wrote Dennis — regards private property rights, private initiative, and the free market, subject to a proper regime of public interest, as useful institutions — useful means to public ends. The difference between fascism and liberalism, in this respect, is that fascism considers these institutions as means to national ends, whereas liberalism makes the nation and national government a means to the ends of private property and the free market”.
The increasing power of the federal government, business consolidation, and the standardization of American life, Dennis argued, presaged the arrival of fascism. “Big business has been making fascism inevitable ; it has been efficiently preparing the people with suitable behavior patterns and developing appropriate mechanisms of centralized national control to hand over to a triumphant fascism. We have perfected techniques in propaganda and press and radio control which should make the United States the easiest country in the world to indoctrinate with any set of ideas, and to control for any physically possible ends”.
Ironically, Dennis’s fascist America closely resembled the socialist America desired by many on the left. Both rejected individualism and competition and celebrated cooperation and community. Both relied on national planning by committees of experts. But whereas the socialists based their hopes on an unlikely transformation of human nature, Dennis recognized that all utopias rest ultimately on coercion.
► Robert Rosenbaum, Waking to Danger, 2010.

 ◊ Pour compléter le portrait de Dennis, des extraits choisis d'un entretien privé en 1967 enregistré par un universitaire (pratique de recherche alors répandue comme montré au début du film Little Big Man, 1970) :
◊ Pour compléter le portrait de Dennis, des extraits choisis d'un entretien privé en 1967 enregistré par un universitaire (pratique de recherche alors répandue comme montré au début du film Little Big Man, 1970) :• Mr. Dennis, could you tell us what your view was of the developments in Europe after 1933 ?
Dennis : I took what was then considered a pro-Fascist view. I said that Hitler and Mussolini were rising to meet the economic crisis and that we would have to do much the same thing. I did not in any way identify myself with those movements, but I defended them and tried to explain them ; and that got me under considerable criticism and attack as being a Fascist. I said, “The United States will have to go Fascist in the same way that Germany and Italy have gone. They have to meet the Depression. The government has to meet the depression”. (…) I went over to England and spent some weeks there, as I did on the continent. I was following the rise of these new movements like Fascism and Nazism. My thesis was that we would have to follow along much the same lines here, and that got me branded as a Fascist, which I wasn’t. I was merely taking an objective view, and I was taking a prophetic view. President Roosevelt when he came in thought that all he needed to do was balance the budget, cut down spending and everything would be all right, But of course that was just the thing that was all wrong. He couldn’t cope with the situation by cutting down spending and balancing the budget. It didn’t allow of that. The conservatives were very much against him, but the liberals began to go more and more interventionist. Of course Roosevelt would never have allowed anyone to call him a “Fascist”. No one in his party would have called themselves “Fascists”, but they were following very much the same lines that Hitler and Mussolini were following in dealing with a similar situation.
• You have been quoted as saying that “Ihe New Deal is fast going Fascist”. What did you mean by that statement ?
Dennis : Well, I meant that the New Deal was becoming government interventionist, taking over the economy, spending money, controlling money. I didn’t mean that the New Deal was coming to use the word “Fascist”. One of the things I combatted, and it cost me a great deal, was the popular idea that Fascism was something very evil which we had to avoid and fight. Communism had a special quality of being directed from Moscow, but Communism and Fascism and Socialism had a great deal in common. I saw that the New Deal was going Socialist or Fascist. I was not as careiul as I should have been at the time in using those words. I was not afraid of being called a Fascist because I was not a Fascist. There was no Fascist party or movement, no party or movement that called itself Fascist; but the term was just loosely applied.
• In your book, The coming American fascism, one of the questions that you discuss at great length is the question of elite. Now, I’d like to ask you : Did you gain your concern for elite in America from reading any particular works ? For instance had you read Plato or Robert McKells ?
Dennis : I read those books, yes. I don’t know where I got the word from. The word was coming into use. I got the idea of the elite and that they had an important role to play.
• Could you tell me if you ever had any association with Fritz Kuhn of the German American Bund, and, if so, what association ?
Dennis : No, I never had any association with Fritz Kuhn. I can't say right now whether I ever met him or not. I may have met him, I went to so many parties and dinners and meeting but I never had any association with him, and I never approved of his adopting the German slogans and Germanizing his organization and group. I never approved of that at all. The men that I approved of were men like Norman Thomas and Lindbergh.
• Could you tell me briefly how it is that you could have approved of Norman Thomas, since he was a socialist and you were identified with people who were opposed to Socialism ?
Dennis : Well, I wasn’t identified with anybody really. These people who were called Fascists were Socialists. Fascism is just another word for a special kind of socialism. Norman Thomas always kept his socialism very pure and very detached from movements like fascism or Nazism. All those movements were socialistic.
• Could you describe to me, Mr. Dennis, your attitude during World War II ?
Dennis : Well, my attitude was one of always being willing to support the government. As a matter of fact, I applied for a
commission and was going to get a commission and the publishers of P-M and a good many of the liberal papers got wind of it and they attacked the government for giving me a commission, so I didn’t get the commission. I always took the position “my country right or wrong”. I was always for my country. I didn’t approve of its policies, but I was willing to support it and fight for it. I tried to get a commission in World war II.• One of the elements of National Socialism in Germany but which was not an element of Italian Fascism particularly was anti-Semitism. what was your view towards this phenomenon ?
Dennis : I was always against anti-Semitism. That was one of the reasons I never would in any way identify myself with or let myself be identified with the German Nazis. I was always against anti-Semitism. Many of my best friends and close associates during all those years were Jews. I never could see anti-Semitism.
• Could you tell me what your views toward Communism were after World War II ? Do you consider yourself a fervent anti-communist ?
Dennis : Well, yes. I don’t favor… I’m not an anti-Communist in the sense that most anti-Communists would call themselves anti-Communists. I don’t favor war against Communism. I think Communism is something we should co-exist with. I’m against religious war, and fighting Communism as such is a religious war. I think President Johnson leans that way now. They’re not anti-Communist in the sense that they’re not disposed to carry on or wage a war against Communism. They want to co-exist.
• Could you describe for me in more detail your particular relationship with Joseph Kennedy ? How well did you know him ? What common views did you share, particularly about the question of America’s entry into world war II ?
Dennis : Well, I was I think first introduced to Joe Kennedy by my friend and classmate who was on Reader’s Digest, namely, Paul Palmer. Palmer knew that Kennedy was very much of an anti-war man, and I met him on that. I went to call on him several times in his Massachusetts house there at the Cape, and I called on him once or twice down in Florida. He had a very high regard, I think, for me. He spoke well of me. We never had any association, but we had a very keen friendship, and our views coincided very much because Kennedy was very much what was called an isolationist. He was against our getting into war.
• Can you tell me if you ever considered going into politics yourself ?
Dennis : No, I never did. If I had, I would have behaved quite differently. I could have had a very successful career in politics, but I’ve always been a maverick [non-conformiste]. I had my own political opinions. I wasn’t combative, but I formed different views. I think my childhood had something to do with it. My mother never had any influence over me, but she took me around in Europe and I got to meet people, the best people. I listened and I picked up a lot. I cherished economics. If I had been practical and wanted to go into politics, I could have gone far. I was quite popular and a good mixer, but I always killed myself by my radical views. I was a dissenter [dissident]. It didn’t bother me any that I was a dissenter. If I hadn’t been a dissenter, I could have gone along with the liberals or conservatives. I could have gone along with the New Dealers. I could have gone right to the top. But I never considered doing it. I had my opinions and my views. I was just a dissenter.
► The reminiscences of Lawrence Dennis, entretien avec W. Keylor, Université de Columbia, 1967.

 ◊ Disons-le tout net, la littérature secondaire sur L. Dennis est inexistante en français, non tant par l’absence de traduction que par méconnaissance ou ignorance de la civilisation américaine (1). Nous livrons toutefois trois extraits en français de texte d’intérêt variable sur Dennis, par ailleurs non exempts de partis-pris idéologiques. Le premier voit en Dennis une résistance à la globalisation que Roosevelt initie. Le deuxième présente une contextualisation sociale de la crise mais désappointe dans sa conclusion par le raccourci caricatural assimilant Dennis à une logique de groupuscule marginal (2). Le troisième enfin nous offre un résumé concis s’insérant dans un “rapide panorama” des fascismes américains de cette période (3). C'est pourquoi, pour conclure cette entrée, nous ajouterons un court texte de Dennis sur la “pensée opérative” pour inspirer une approche réaliste, que ce soit sur l’économie de guerre (4) ou bien concernant le destin européen (5).
◊ Disons-le tout net, la littérature secondaire sur L. Dennis est inexistante en français, non tant par l’absence de traduction que par méconnaissance ou ignorance de la civilisation américaine (1). Nous livrons toutefois trois extraits en français de texte d’intérêt variable sur Dennis, par ailleurs non exempts de partis-pris idéologiques. Le premier voit en Dennis une résistance à la globalisation que Roosevelt initie. Le deuxième présente une contextualisation sociale de la crise mais désappointe dans sa conclusion par le raccourci caricatural assimilant Dennis à une logique de groupuscule marginal (2). Le troisième enfin nous offre un résumé concis s’insérant dans un “rapide panorama” des fascismes américains de cette période (3). C'est pourquoi, pour conclure cette entrée, nous ajouterons un court texte de Dennis sur la “pensée opérative” pour inspirer une approche réaliste, que ce soit sur l’économie de guerre (4) ou bien concernant le destin européen (5).*
 1. Pour donner un exemple récent, le populisme américain est propice à divagations. Il se distingue de son emploi médiatique que Serge Halimi, dans un article en 1998, déplorait déjà : “C’est ainsi que, tel un virus, l’adjectif populiste contamine le journalisme et l’analyse sociale”. Remontant à la fin du XIXe siècle et se caractérisant par une méfiance envers les élites, il transcende les appartenances de droite comme de gauche et interroge la question du peuple (cf « Donner du pouvoir au peuple, pas aux élites », Saul Alinsky, 1972 ; What Is Populism ?, pamphlet de Larry Gambone, 1996, repris en article pour The Idyllic, 2004). Il ne peut donc être confondu avec la stigmatisation de l’électorat pauvre et rural de Trump. Cette disqualification à partir d’un point de vue dominant, dont la condescendance frise le misérabilisme, feint d’ignorer dans le même temps, sous prétexte de sociologie électorale, le programme économique de Trump qui, entre autres choses, a consisté en la réduction des taux d’imposition pour les ultra-riches comme lui (cf « Ur-Fascism and Neo-Fascism », Andrew Johnson, The Journal of International Relations, Peace Studies, and Development n°1/2019 ; « National-néolibéralisme : De quoi le “populisme” est le nom », Pierre Sauvêtre, Sens public, 2020). Pour rappel, le Center for Responsive Politics, association enquêtant sur l'argent en politique, établit dans une étude en 2012 que la moitié des élus au Congrès étaient millionaires.
1. Pour donner un exemple récent, le populisme américain est propice à divagations. Il se distingue de son emploi médiatique que Serge Halimi, dans un article en 1998, déplorait déjà : “C’est ainsi que, tel un virus, l’adjectif populiste contamine le journalisme et l’analyse sociale”. Remontant à la fin du XIXe siècle et se caractérisant par une méfiance envers les élites, il transcende les appartenances de droite comme de gauche et interroge la question du peuple (cf « Donner du pouvoir au peuple, pas aux élites », Saul Alinsky, 1972 ; What Is Populism ?, pamphlet de Larry Gambone, 1996, repris en article pour The Idyllic, 2004). Il ne peut donc être confondu avec la stigmatisation de l’électorat pauvre et rural de Trump. Cette disqualification à partir d’un point de vue dominant, dont la condescendance frise le misérabilisme, feint d’ignorer dans le même temps, sous prétexte de sociologie électorale, le programme économique de Trump qui, entre autres choses, a consisté en la réduction des taux d’imposition pour les ultra-riches comme lui (cf « Ur-Fascism and Neo-Fascism », Andrew Johnson, The Journal of International Relations, Peace Studies, and Development n°1/2019 ; « National-néolibéralisme : De quoi le “populisme” est le nom », Pierre Sauvêtre, Sens public, 2020). Pour rappel, le Center for Responsive Politics, association enquêtant sur l'argent en politique, établit dans une étude en 2012 que la moitié des élus au Congrès étaient millionaires. 2. Dennis n’a jamais tenté de créer un parti fasciste américain ni n’en aurait rejoint un si cela avait possible dans le système électoral américain qui assoit le bipartisme. Pour une approche historique plus nuancée de ce phénomène : « Les fascismes américains des années trente : aperçus et réflexions » (Peter H. Amann, Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits contemporains n°126, 1982). En parallèle il serait utile d'interroger l’implantation limitée du communisme aux USA dans les années 20 et 30, qui ne touche pas que l'intelligentsia mais se greffe aussi sur l’histoire du syndicalisme. Pour une introduction à l’histoire du mouvement ouvrier : A History of American Labor, Joseph G. Rayback. 1959. Pour une interrogation sociologique, recommandons un des tenants de l'École du Wisconsin : Theories of the Labor Movement, Selig Perlman, 1928. Par ailleurs, plus anecdotique mais non moins négligeable, un historique de l'expérince auto-gestionnaire aux USA sera consultable dans le volume 2 de : Autogestion, l'encyclopédie internationale (Syllepses, 2018).
3. “L’étude de l’extrême-droite américaine s’inscrit dans ces travaux. Elle tend à montrer qu’il convient d’opérer une distinction fondamentale entre le peuple américain et l’action du gouvernement des États-Unis, ce dernier n’étant pas l’expression du peuple, mais le principal bras armé des lobbies dans leur action de domination mondiale. Le prétendu ‘impérialisme américain’ n’est en réalité que l’expression d’un impérialisme plus général, les États-Unis étant colonisés de l’intérieur par ces lobbies contre lesquels, et comme ailleurs, des groupes ont tenté, et tentent toujours, de mener la lutte de libération” (p. 12).
4. Cf « Guerres, transformation du capitalisme et croissance économique », É. Bosserelle (L’Homme & la Société n°4/2008).
5. « L’Europe face à la puissance », entretien avec Hans Kribbe (Le Grand Continent, 2021)
• nota bene : par souci bibliographique, indiquons un portrait ciselé de Dennis dans le recueil Des Gentlemen à part : Portraits de quelques mal-pensants du monde anglo-saxon, Christophe Dolbeau, Akribeia, 2018 [recension], p. 69 à 88, ainsi qu'une captation idéologique de Dennis dans Le complexe de Caïphe (Michael Collins Piper, 2012).
***
 L’ère Roosevelt, prélude à la globalisation
L’ère Roosevelt, prélude à la globalisationDurant la IIe Guerre mondiale, quelques Européens clairvoyants ont dénoncé la “gouvernance mondiale” en tant qu’objectif ultime de FDR. Ils ne faisaient que développer des idées bien connues aux USA, chez ceux que l’on appelait déjà des “révisionnistes”. En 1934, Gérald Nye avait rendu publiques les conclusions de la commission sénatoriale qu’il présidait, concernant les modalités d’entrée en Guerre des USA, l’année 1917. Elles confirmaient ce que les Républicains claironnaient depuis le début des années 1920 (singulièrement l’historien Harry Elmer Barnes), à savoir que les USA n’étaient nullement intervenus dans la Grande Guerre par l’effet d’un quelconque idéalisme ou d’une indignité particulière des gouvernants et des habitants des Empires Centraux, mais pour voler au secours des fonds US massivement investis chez les Alliés, en très mauvaise posture au début de 1917. La commission sénatoriale accusait nominativement le Président Thomas Woodrow Wilson et son conseiller intime Edward House (l’un des créateurs de la Federal Reserve), le secrétaire d’État Robert Lansing et le secrétaire au Trésor Gibbs Mac Adoo, lui-même très sensible aux intérêts du trust Morgan et gendre du Président Wilson. Depuis la fin des années 1920, le sénateur Robert La Follette, indéniablement progressiste au plan social, réclamait le vote d’un nouvel amendement à la Constitution, instaurant un referendum avant toute entrée en guerre (Radosh, 1975). Pour les pacifistes, il était évident que la victoire des Alliés et de leurs Associés (dont faisaient partie les USA) n’avait fait que renforcer les haines en Europe et l’on citait davantage, à l’époque, le chauvinisme des Polonais, des Roumains, des Tchèques et des Yougoslaves que l’esprit revanchard des Allemands.
Dès la fin des années 30, quelques hommes politiques des USA, ennemis d’une certaine finance orientée vers la spéculation, avaient dénoncé les risques potentiels de l’impérialisme économique US, singulièrement la restriction des libertés individuelles et le bourrage de crânes de la propagande rooseveltienne. Pacifistes et isolationnistes, mais loin d’être tous des “fascistes” cachés ou avoués, ils étaient avant tout des hommes opposés à l’impérialisme politique, économique et militaire des USA. Ils combattaient ce qu’ils appelaient la “globalisation” de la politique US, c’est-à-dire son intervention dans les affaires intérieures des autres continents (Radosh, 1975). L’expression a-t-elle beaucoup changé de sens ? C’est affaire d’opinion.
L’historien Charles Beard, le sénateur Robert Taft et quelques autres, tel l’ambassadeur à Londres Joseph Kennedy, refusaient toute nouvelle intervention militaire US en cas de conflits extra-américains. Ils s’opposaient aux prêts US en direction des autres continents et proposaient d’améliorer la vie économique de tous les États des Trois Amériques, pour révolutionner les conditions de vie de leurs habitants les plus pauvres. Il leur apparaissait qu’il y avait trop de malheureux et d’analphabètes sur l’énorme continent américain pour gaspiller ailleurs les capitaux US. Ils étaient partisans de “l’autarcie financière à l’échelle du continent américain” (Radosh, 1975). On ne pouvait être plus opposé aux thèses des financiers cosmopolites et des hommes du Big Business qui conseillaient FDR. Après 1945, Taft continuera la lutte contre ceux qui faisaient des forces armées des USA les humbles servantes des financiers, des négociants et des entrepreneurs US. Le problème du sous-développement de l’Amérique latine demeure entier de nos jours.
L’ex-diplomate Lawrence Dennis (un “quart de nègre”, selon la terminologie raciste de l’époque), proche des idées nationales-socialistes et invité au Congrès du NSDAP de 1936 (ceux qui s’en indignent ignorent généralement que ce congrès fut consacré aux arts et à la culture, raison pour laquelle beaucoup d’artistes et de littérateurs étrangers y furent invités), conspuait, en 1932, le capitalisme spéculatif et l’extension démesurée des crédits bancaires, qui étaient à ses yeux les deux causes essentielles de la Grande Dépression (la crise économique débutée en 1929)… alors que la plupart de ses contemporains ne l’envisageaient encore que comme une crise de surproduction, analogue à celle de 1920-1923 (c’était notamment le cas de François Simiand, en cette même année 1932, qui n’avait rien compris à son mécanisme, y voyant une “rançon de la modernité”, soit un chômage lié à l’augmentation des rendements et au machinisme). Dans son livre de 1932, Is capitalism doomed ?, Dennis plaidait lui aussi en faveur de la mise en valeur de l’Amérique latine par les capitaux US.
Dans son œuvre de 1940, The dynamics of war and revolution, il dénonçait le nouveau cercle vicieux, celui où les destructions guerrières mènent aux reconstructions, si profitables au Big Business : l’expansionnisme capitaliste génère des guerres répétées et se nourrit d’elles. Ce “fasciste” décrivait de façon prémonitoire le phénomène qui paraîtra merveilleux aux universitaires et aux financiers des années 60 (cf. Anonyme, 1968, dans un médiocre travail de potaches cyniques, bien inférieur au livre de Dennis, réédité en 1975). Dans sa dernière œuvre, Operational thinking for survival, parue en 1969, Dennis critiquait le consumérisme effréné, ce qui est plus que jamais d’actualité. À tous ces hommes, opposés à la nouvelle orientation politique de FDR née en 1937, il paraissait évident que la globalisation de la politique US (les politiques étrangère et militaire des USA mises au service de l’impérialisme économique) ne pouvait que restreindre les libertés individuelles, casser les traditions nationales et, par la propagande naïve qu’elle impliquait, amoindrir le libre-arbitre des citoyens. Assurément, c’étaient de “vils fascistes” !
► Bernard Plouvier, Le devoir d’insurrection ou la réponse géopolitique à la tentation cosmopolite, Æncre, 2013.

La crise aurait pu avoir le même effet qu’elle eut en Europe, mais il n’en fut rien. Les Américains gardèrent une attitude franchement défiante face aux discours fascistes proférés par de nombreux orateurs et agitateurs publics. Malgré les campagnes actives de mouvements proto-fascistes, fascisants, profascistes ou authentiquement fascistes qui se développèrent aux États-Unis au cours des années trente, l’Amérique ne fut pas le laboratoire escompté de la synthèse fasciste. Une étude poussée et méticuleuse des mouvements fascistes montrerait qu’aucun d’entre eux ne réussit à fédérer une large part de la population américaine, ni à constituer un parti crédible, susceptible de gagner des élections nationales. Parce qu’ils furent tous, ou presque, des objets de pure imitation, les partis fascistes conservèrent un discours brutal et extrémiste, celui des premières heures du fascisme européen que ce dernier avait abandonné depuis de longues années afin de prendre le pouvoir par la voie légale. Ainsi, plutôt que de rassembler et de séduire, les mouvements — ou, devrait-on dire, les groupuscules — fascistes américains renvoyaient l’image de groupes de gesticulateurs vulgaires et brutaux ; de surcroît, ils effrayaient une population qui rejetait en bloc l’idée de voir un jour un parti tout-puissant prendre la place d’un État fédéral à l’égard duquel, au reste, les Américains conservaient un sentiment de défiance. Ce ne fut qu’avec la crise et la situation de désarroi sans précédent que connaissait le peuple américain qu’il avait consenti à faire confiance à l’État fédéral. Pourtant, pendant près de cinq ans, la solution fasciste était apparue à certains comme l’une des voies possibles à la résolution de la Grande Dépression.
Malgré une attirance certaine pour les discours proférés par Hitler, Ford, parce qu’il était trop profondément imprégné de la tradition politique libérale américaine, ne fut jamais l’homme capable de réaliser la synthèse fasciste “à l’américaine”, c’est-à-dire sur des bases idéologiques américaines. Il avait également perdu une grande partie de son aura et de son potentiel à rassurer la nation, et ce ne fut pas vers lui que cette dernière se tourna pour trouver la solution qui pourrait remettre l’Amérique sur la voie de la réussite, la sortir de sa déréliction, faire renaître l’espoir et sauver sa démocratie. Alors qu’il fut longtemps glorifié comme un homme tourné vers l’avenir, un visionnaire, une icône nationale, le symbole triomphant du rêve américain, Henry Ford était désormais considéré comme un homme du passé et ne pouvait plus faire figure de sauveur.
La remise en cause de la démocratie
Les “prophètes des ténèbres”, selon l’expression de Stuart Knee, désignèrent la démocratie libérale américaine comme responsable de la crise qui frappait le pays. Dès les premières années de la Grande Dépression, les librairies se remplirent d’essais et de profession de foi de penseurs qui se faisaient les avocats d’une idéologie de rupture avec la démocratie libérale qui, selon eux, avait plongé le pays dans la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait. Leur but était essentiellement de démontrer que le gouvernement était corrompu et incapable, que les capitalistes et les banquiers de Wall Street faisaient la loi. Parmi les groupes extrémistes qui condamnaient le système américain, une extrême droite proto-fasciste proposait de substituer à la démocratie la dictature de l’élite. Le théoricien et représentant de ce “fascisme américain” était Lawrence Dennis (1).
Diplômé d’Harvard, diplomate pendant sept ans, et économiste à Wall Street, il fut au début des années 30 éditeur de The Weekly Foreign Letter. Il publia trois ouvrages principaux dans lesquels il exposait la nature et les traits du “fascisme américain”. L’ouvrage le plus significatif par son contenu est très certainement le deuxième de sa trilogie : The Coming American Fascism. Écrit en 1936 sur le ton d’un essai prophétique ce livre, se nourrissant du contexte de la dépression, prédit l’effondrement du communisme et par suite du capitalisme. La grande crise 1929 serait, selon lui, un signe du début de la chute du capitalisme qui avait été décrite dans le premier ouvrage Is Capitalism Doomed ? à la lecture duquel on apprend que les bureaucrates d’un gouvernement dictatorial et le monde des affaires exploiteront les classes moyennes laborieuses, de plus en plus appauvries, et que ces dernières se tourneront finalement vers le fascisme. Dennis décrivait le mécanisme de la Grande Dépression et comment, à son maximum, on assisterait à l’asphyxie de la libre entreprise par le capitalisme. Il émettait des avertissements sur le danger encouru par l’agriculture américaine et la menace constituée par le corporatisme agricole. La thèse essentielle de ce livre est la suivante : « le capitalisme s'est effondré à défaut de conquêtes de nouveaux mondes ». Il décrit brillamment l’économie de dette émergeant dans les années 30 : « Emprunter pour financer la production, mais qu’est-ce que cela a apporté à la consommation et à l’emploi ? […] Emprunter crée une division du revenu national ce qui est défavorable au maintien d’un marché satisfaisant ».
Toutes ces idées, développées, furent reprises dans The Coming American Fascism. On y trouve une violente attaque du système libéral américain, à savoir du laisser-faire capitaliste et de la démocratie. Cette dernière serait nuisible, car elle cautionnerait et favoriserait les erreurs des dirigeants du monde des affaires. La société devait, selon Dennis, avoir d’autres objectifs que la vile et simple recherche des profits. Il comparait la démocratie capitaliste libérale à l’état de nature de Hobbes : des affrontements entre individus pour le gain du profit ainsi que la défection de l’intérêt national seraient inévitables dans la démocratie et la société serait mise à mal par une telle lutte pour la prospérité financière. La démocratie libérale, faite par et pour les capitalistes, serait antinationale et antisociale. Pour ce théoricien fasciste, la liberté ne saurait être obtenue par l’absence de contraintes gouvernementales, car même en démocratie des contraintes — économiques — persistent. Il reviendrait donc à “l’élite” d’exercer le pouvoir. Les membres de la société constituant l’élite seraient choisis parmi ceux ayant les plus hauts revenus. Pour définir le type de gouvernement le plus souhaitable, Dennis estimait que le pragmatisme devait venir en aide à ces élites.
Pour ces fascistes élitistes, aucune valeur ne peut s'imposer a priori et être aveuglément appliquée à la façon du dogmatisme socialiste. L’État et ses élites entraînant la société vers son propre accomplissement, le gouvernement serait infaillible et ne tolèrerait aucune contestation, en particulier de la part d’individus ou de groupes dé fendant des intérêts particuliers. Seul un autocrate libéré des nombreux carcans institutionnels serait à même de mener la nation à son accomplissement. L’État devrait contrôler et chapeauter l’économie et ses organes vitaux même si la propriété privée doit être absolument préservée.Un parti unique assurerait la représentation du peuple auprès du gouvernement. La représentation est définie ainsi : « procédé par le quel le gouvernement est saisi de la volonté populaire, par lequel il fait comprendre cette volonté populaire et fournit les moyens et les buts de l’administration publique ». L’élite fasciste détiendrait une responsabilité étrangère aux dirigeants libéraux. Cette responsabilité en revanche ne s'exercerait que devant l’élite elle-même, à savoir par rapport à un idéal qu’elle aurait elle-même défini. Sa responsabilité ne s'exercerait pas devant le peuple qui est incompétent. Le troisième ouvrage de Dennis, The Dynamics of War and Revolution, se conclut ainsi : « On entendra un peu moins parler des droits de l’homme et un peu plus des devoirs ainsi que des droits du peuple américain ».
Avant la Seconde Guerre mondiale, il fonda un mouvement prônant une rhétorique raciste, ultra-nationaliste et isolationniste. Au reste, entre 1933 et 1940, on recensa l’émergence de 121 groupes prêchant une idéologie fasciste, pronazie, antisémite. Les Américains, sévèrement touchés par la dépression, se tournèrent vers ces groupes qui désignaient un bouc émissaire responsable de tous leurs maux.
► Damien Amblard, Le “fascisme” américain et le fordisme, Berg, 2007.
1. Nous devons la majeure partie de cette analyse des écrits de Lawrence Dennis à Yves-Henri Nouailhat.

Le cas de Lawrence Dennis (1893-1977) est très disputé. Les agissements de “Carlson” en ont fait un fasciste invétéré. La brochures des Friends of Democraty attaquant le Colonel Lindbergh cherchait à mettre en parallèle ses propos avec ceux d’Adolf Hitler ou de Lawrence Dennis qui se trouvait ainsi placé sur le même plan que le Chancelier du Reich… Sa présence en 1944 parmi les inculpés du Procès pour sédition, où le Procureur le qualifie d’“Alfred Rosenberg” des fascistes américains, a renforcé cette approche. Elle reste celle d’un ouvrage qui lui a été entièrement consacré (1).
Certains prétendent le laver du péché de fascisme d’autant que son anti-bellicisme systématique l’a conduit, après guerre, à condamner l’intervention en Corée qui pour lui — et il avait raison — préludait à un engagement au Vietnam qu’il a également condamné. Il s’est donc retrouvé alors, avec le bulletin Appeal to Reason qu’il a publié à partir de 1945, comme inspirateur d’un courant fort éloigné de la majorité de l’extrême-droite américaine, courant qui n’entend pas être confondu avec un quelconque “fascisme”. Ces défenseurs considèrent que Lawrence Dennis a été mal compris ou que sa pensée a été déformée à des fins de propagande. Ils soutiennent qu’on a feint de prendre pour préconisation ce qui n’était que prédiction et pour approbation ce qui n’était qu’analyse. D’autres, sans reprendre les accusations les plus outrancières, ne le considèrent pas moins comme le théoricien d’un “fascisme américain” (2). Au demeurant ces discussions n’ont pas un intérêt fondamental. Des théories peuvent être “fascistes” sans exiger que leurs auteurs soient eux-mêmes fascistes. Si, pour Lawrence Dennis, “le fascisme est une vision du monde qui peut être imposée par un Mouvement n’ayant pas nécessairement besoin de comprendre l’idée fasciste”, on peut, avec le même esprit de boutade, estimer qu’on peut imposer la vision de Lawrence Dennis sans pour nécessairement comprendre l’idée profonde de Lawrence Dennis…
La femme du colonel Lindbergh trouvait Dennis “bien bronzé” (3). En effet, il était né à Atlanta d’un juriste blanc et de sa maîtresse mulâtre. Orphelin de père à huit ans, il voyage alors avec sa mère adoptive en Europe où il apprend le français et l’allemand. De retour aux États-Unis à treize ans, il intègre le prestigieux collège d’Exeter, malgré (ou grâce à) son absence d’instruction classique, puis admis en 1915 à Harvard où — après une interruption due à la guerre de 1917-1918 à laquelle il participe — il obtient ses diplômes en 1920. Il exerce alors comme diplomate pendant sept ans avant d’abandonner sa carrière par hostilité à l’expédition américaine au Nicaragua. Il devient alors économiste à Wall Street. Outre son propre périodique Weekly Foreign Letter, il publie trois ouvrages : Is capitalism doomed ? (1932), The coming american Fascism (1936) — qui a fait le plus pour sa sulfureuse réputation — et The Dynamic of War and Revolution (1940).
Ayant annoncé l’éclatement de la bulle financière il se livre à une violente critique d’un capitalisme qui a substitué la spéculation à l’investissement, ce qui génère le chômage. Il est hostile à la “stratégie de la dette” et à l’extension infini du crédit. Il se prononce pour le “planisme” (4), la lutte contre l’exportation de capitaux, le protectionnisme, la nationalisation des banques et des trusts, une production tournée vers la satisfaction du marché intérieur avec recherche d’autarcie. Faute de conquête de nouveaux mondes ou de nouveaux marchés, le capitalisme est condamné à périr. Les “demi-mesures” du New Deal — qu’il dénonce dès 1934 dans The Awakener — n’apportent rien et il prédit que Roosevelt choisira la solution de la guerre (5). Il note ironiquement que ce choix impliquera une “fascisation” du pouvoir pour contraindre la société à lutter contre le fascisme…
Refusant le choix entre le Charybde du chaos économique et le Scylla du communisme (considéré comme le règne de bourgeois médiocres et inefficaces), il ne voit, comme seule alternative à la guerre, qu’un renouveau politique et spirituel par une élite conduisant un État centralisé dans le seul intérêt national. Il préconise (ou analyse comme solution) un régime dictatorial, indépendant des intérêts particuliers et libéré des carcans institutionnels (6), corporatiste, où la fonction de l’État consiste à imposer des directives efficaces sans supprimer l’initiative privée et le droit de propriété.
Son point de vue n’est pas strictement économique puisqu’il considère que la société devrait avoir d’autres objectifs que la vile et simple recherche des profits. La démocratie libérale est anti-nationale et anti-sociale puisque, faite par et pour les capitalistes, elle provoque des luttes pour le gain des profits mettant à mal l’harmonie de la société. Loin des utopies, il se prononce pour le plus grand pragmatisme, “le Fascisme n’ayant pas la conviction naïve de détenir le modèle idéal pour tous les temps”.
L’ouvrage de Gerald Horne The color of fascism prétend — comme le montre la colossale finesse de son titre — expliquer tout Dennis par son origine ethnique et sa volonté de passer pour blanc alors qu’il aurait été noir (7). On peut toujours douter des thèses à base psychanalytique (8). En tout état de cause les ouvrages de Dennis ne portent pas trace de racisme ou d’antisémitisme. La seule référence sur les juifs est le conseil qu’il aurait donné aux Allemands, lors de sa tournée européenne de 1936 : “Pourquoi ne traitez-vous pas, ni plus ni moins, les juifs comme nous traitons les noirs aux États-Unis ? Vous pourrez pratiquer discrimination et autre mais avec une dose d’hypocrisie et de modération qui évitera de choquer l’opinion américaine”.
► François Duprat & Alain Renault, Les fascismes américains (1920-1944), Déterna, 2009.
Notes
1. The color of fascism : Lawrence Dennis, racial passing and the rise of right-wing extremism in the United States, Gerald Horne, NY University Press, 2006. Sa source principale n’est autre qu’Under Cover (du journaliste Arthur Derounian sous le nom de plume de John Roy Carlson, Dutton, NY, 1943) [brûlot commandité par Friends of democracy, prétendant être une enquête d’infiltration au sein de groupes subversifs pour justifier la diffamation — Dennis y étant qualifié de “champion du national-socialisme”].
[Cette affirmation sur la “source principale” de la biographie peut surprendre, elle est en effet gratuite et polémique avec Horne, qui évoque d’ailleurs ce livre page 115. Horne peut tout à fait être débattu, sa bibliographie prolifique a principalement traité des luttes communistes contre l'impérialisme en la rabattant sur la “question raciale” aux USA, mais au moins assume-t-il être historien et activiste, ménageant ainsi une distance critique pour son lectorat. Ses derniers livres continuent à revendiquer ce parti-pris polémique qui ne peut être ni confondu ni confondant avec la très médiatisée vogue “woke” instrumentalisée par les Démocrates dans la bataille électorale contre le Républicain Trump : White Supremacy Confronted : US Imperialism and Anti-Communism versus the Liberation of Southern Africa, from Rhodes to Mandela (2019), The Counter-Revolution of 1836 : Texas Slavery & Jim Crow and the Roots of US Fascism (2022), Revolting Capital : Racism and Radicalism in Washington DC, 1900-2000 (2023). Son combat intellectuel, superposant sciemment division économique et division communautaire au lieu de questionner leur interaction dans le système américain, reste fidèle à une certaine radicalité, en témoigne sa conférence “Les Pères fondateurs des États Unis n’étaient pas des libérateurs” en 2020. Son intransigeance n’est pas sans rappeler celle de l'écrivain noir américain James Baldwin]
2. Histoire des doctrines politiques aux États-Unis, Yves-Henri Nouailhat, PUF / Que sais-je ?, 1969.
3. Même réflexion de Berlusconi concernant Obama… mais Dennis était moins bronzé et plus diplômé.
4. Le planisme n’est pas propre au “fascisme”, mais il constitue un de ses composantes. Pour une application pratique : Une expérience d’économie dirigée : l’Allemagne Nationale-Socialiste, René Dubail, 1962.
[Rappelons que réduire l’économie planifiée au collectivisme ou au dirigisme serait expéditif, en témoignerait le commissariat général au Plan, créé par de Gaulle début 1946 (on pourra aussi se reporter à l'entrée “Participation”). Dans une recension sur La route de la servitude, André Reix nous met en garde sur ce point tel qu’abordé par Friedrich Hayek : “l’auteur ne fait œuvre de savant, mais, au contraire de ce qu’il veut prouver, il soutient un idéal de vie qu’il ne démontre pas. Il prouve par l’absurde que le socialisme égale le totalitarisme, ce qui pour lui équivaut à prouver le bienfait du libéralisme. Il retombe en fait toujours dans l’économisme qui fait de l’homme un homo œconomicus, au mieux. (…) Il part en guerre contre le totalitarisme, à juste titre, mais c’est pour le remplacer par l’idéal britannique, dont on ne voit nullement qu’il soit supérieur. (…) Aussi bien, précise l’auteur, le but de mon livre n’est pas de donner le programme complet et détaillé de l’ordre social futur que nous désirons’. Son principe est celui-ci : la politique de liberté individuelle, seule politique vraiment progressive, reste aussi valable aujourd'hui qu’au XIXe siècle. Il prône donc d'abord le libéralisme comme dogme universel, puis il analyse le socialisme qui est la grande utopie. À partir de ce double axiome sans fondement, Hayek construit son édifice économique par voies d'opposition : individualisme et collectivisme, planisme et démocratie, contrôle économique et totalitarisme, sécurité et liberté, la fin de la vérité, conditions matérielles et fins idéales. Les chapitres les plus curieux sont les chapitres 12 et 13 intitulés ‘Les racines socialistes du nazisme’ et ‘Les totalitaires parmi nous’, où l’auteur nous enseigne que les socialistes sont les promoteurs du nazisme et que le socialisme est une arme contre l’Occident libéral. Certes, nous n’en doutons pas. Jamais l’auteur ne s’avise de constater que le libéralisme est le père réel du socialisme et que l’un et l’autre sont les deux faces, l’une en plein, l’autre en creux, du même visage. Et que l’économie en fin de compte est liée à la volonté de l’homme, ou plutôt des hommes vivant en société. Là en réalité est le fondement du problème, et Aristote l’a bien vu quand il appelle l’homme un animal social. Ce qu’oublient tous les économistes contemporains, de même que beaucoup d’hommes politiques. Sans ce fondement humain, l’économie et la politique ne sont que des vases vides, des illusions qui, à l’usage, deviennent des instruments meurtriers”, Rev. Ph. n°1/1987]
5. Au cours de débats lors de la crise de 2007, plusieurs économistes ont relevé, le plus souvent sous forme de boutade compte-tenu de la référence, que la relance dite keynesienne n’avait fonctionné que dans l’Allemagne d’Hitler. Il est généralement admis que les États-Unis ne sont sortis de la crise entamée en 1929 que par la guerre. Le cycle “destruction-reconstruction” permet en effet de relancer pour un temps la machine… On peut imaginer que face aux nouvelles crises le capitalisme invente une nouvelle forme de guerre permettant à la fois d’éviter des pertes humaines, auxquelles les pays occidentaux sont de plus en plus rétifs, et de mobiliser dans le même camp tous les pays du Monde : la “guerre au réchauffement climatique” grandement génératrice de “destruction-reconstruction”… On trouvera les même ingrédients : anti-bellicistes voués aux gémonies comme “traîtres au genre humain”, idiots utiles, idiots tout court, propagandistes, profiteurs, atteintes aux libertés les plus dérisoires — comme le choix de ses ampoules — sous prétexte de mobilisation…
[Sur ce “New Deal vert”, cf « Comment le néolibéralisme a transformé le capitalisme », P. Dockès & PY Hénin, 2022. Mentionnons du premier, pour un public averti, le monumental : Le Capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective, 2 volumes, Garnier, 2014 & 2019, recension t. 2]
6. Il est bien évident que les problèmes ne peuvent être résolus par ceux qui en vivent, ni que des solutions puissent être trouvées par des règles… limitées par de prétendus principes fondamentaux interdisant les régles efficaces.
7. Sans doute en vertu de la règle : “Aux États-Unis une goutte sang noir vous fait nègre, au Brésil une goutte de sang blanc vous rend blanc”.
8. Ainsi du temps où nazisme et homosexualité avaient mauvaise réputation, le même genre d’analystes ne manquait pas d’exposer que le premier était une expression politique du second… Depuis, la réputation du nazisme s’étant encore dégradée, mais l’homosexualité ayant été hissée au rang de valeur, l’explication est inverse et s’accompagne de l’émergence de l’héroïque épopée des triangles roses…
• nota bene : On pourra retrouver le chapitre « Henry Ford et l'antisémitisme américain » dans un tiré à part. Par ailleurs l’ouvrage consacre son dernier chapitre au procès politique de 1944. La diversité des profils met à mal la thèse d’intelligence avec l'ennemi : George Sylvester Viereck, Elizabeth Dilling, William Dudley Pelley, Joe McWilliams, Robert Edward Edmondson, James True, Gerald Winrod, William Griffin, Prescott Freese Dennett, Ulrich Fleischhauer, etc. Dennis relèvera : “un des faits significatifs du procès était l’absolue insignifiance des accusés par rapport à la grande importance que le gouvernement voulait lui donner par toutes sortes de publicité”. Notons avec amusement que dans sa thèse sur le conspirationnisme aux USA (2014), Julien Giry cite l’ouvrage au sujet du procès, au point de répéter sans discernement dans son corps de texte la formule stylistique (non-juridique) “le procès fut frappé de collapsus”.
*
Extrait de la page 16 du magazine Life (équivalent de Paris-Match créé en 1949 sur son modèle) du 17 janvier 1944. Durant l'été 1936, Dennis se rend en Europe. Il rencontre entre autres Keynes, Churchill, Pierre Laval. Profitant de son séjour, il visite Rome et Berlin. “Présent au dîner annuel du Harvard Club de Berlin, il assiste ensuite, début septemble, au quatrième congrès de Nuremberg. À cette occasion, on le photographie en compagnie d’un jeune hitlérien en grand uniforme et avec swastika : publié dans Life, ce cliché achèvera de faire de lui la grande icône du fascisme américain” (C. Dolbeau) Comme le remarque John V. Denson : “After Pearl Harbor, the federal government was even less concerned with legal niceties. A sedition trial was launched, in the waning days of the war : the America First Committee was named, along with most of the other anti-interventionist groups, in the first two indictments. Also named was Lawrence Dennis, author of The Dynamics of War and Revolution, Is Capitalism Doomed ?, and The Coming American Fascism, whose great crime was to write books similar in theme (and style) to James Burnham's The Managerial Revolution, which was just then receiving much acclaim in leftwing intellectual circles. A vicious propaganda campaign was conducted in the press, smearing isolationists as Nazi agents and focusing on members of Congress who had done their best to keep us out of the slaughter” (John V. Denson, The Costs of War : America's Pyrrhic Victories, 1997).

 Pensée opérationnelle et stratégie de survie
Pensée opérationnelle et stratégie de survieAnticiper les défis des âges futurs — une période de crises et de conflits permanents — c'est apprendre comment penser et non quoi penser. Et c'est probablement le plus grand écueil auquel sont confrontés l’humanité et ses dirigeants en plein milieu du siècle. Telle est en tous cas la problématique que cet ouvrage entend poser et principalement traiter. Il ne propose rien d'autre, en guise de résolution des problèmes aussi bien mondiaux que concernant le peuple américain et ses leaders de cette période, que la pensée opérationnnelle. Cette dernière consiste en une manière ou un moyen d'élaborer toutes sortes de solutions pour résoudre toutes sortes de problèmes plutôt que de s'accrocher à une solution en soi. L'ambition de ce livre est est d'exposer, d'expliquer, et discuter de ce qui est nommé approche opérationnelle des problèmes et défis d'un contexte politique, social, économique ainsi que de la nature des conflits. La spécificité de cette approche peut être qualifiée d'opérationnelle.
[traduction en cours]
► Lawrence Dennis, extrait de : Operational Thinking for Survival, 1969.







