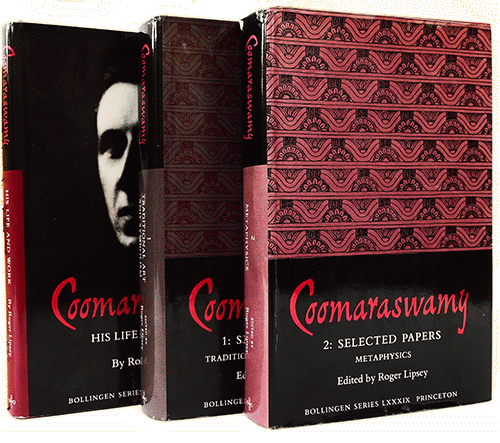-
Par EROE le 30 Juillet 2020 à 07:00
 • Présentation : L’œuvre de Guénon dans la revivification du point de vue traditionnel trouva un complément dans celle d’un autre métaphysicien d’une pénétration et d’une envergure remarquables, Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), fils d’un Cingalais et d’une Anglaise. Comme Guénon, Coomaraswamy fit ses débuts dans le domaine scientifique, mais tandis que le tour d’esprit “abstrait” de Guénon l’avait conduit vers les mathématiques, Coomaraswamy, qui fut toujours sensible à la signification des formes, se tourna vers la géologie, science descriptive dans laquelle il devint une autorité. Son tempérament était complémentaire de celui de Guénon de bien des manières. Alors que Guénon fut un métaphysicien peu enclin à s’intéresser aux formes artistiques, Coomaraswamy était profondément réceptif aux formes esthétiques et connut en fait l’appel de la tradition alors qu’il travaillait comme géologue dans les collines et montagnes de Ceylan (Sri Lanka) et de l’Inde où il fut le témoin de la rapide destruction de la civilisation et de l’art traditionnels de sa patrie. Coomaraswamy fut aussi un érudit méticuleux et soucieux des détails alors que Guénon fut essentiellement un métaphysicien et un mathématicien soucieux des principes. Les deux hommes étaient complémentaires jusque dans leurs traits personnels et dans leurs styles littéraires, et pourtant en parfait accord quant à la validité de la perspective traditionnelle et des principes métaphysiques qui sont au cœur de tous les enseignements traditionnels.
• Présentation : L’œuvre de Guénon dans la revivification du point de vue traditionnel trouva un complément dans celle d’un autre métaphysicien d’une pénétration et d’une envergure remarquables, Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), fils d’un Cingalais et d’une Anglaise. Comme Guénon, Coomaraswamy fit ses débuts dans le domaine scientifique, mais tandis que le tour d’esprit “abstrait” de Guénon l’avait conduit vers les mathématiques, Coomaraswamy, qui fut toujours sensible à la signification des formes, se tourna vers la géologie, science descriptive dans laquelle il devint une autorité. Son tempérament était complémentaire de celui de Guénon de bien des manières. Alors que Guénon fut un métaphysicien peu enclin à s’intéresser aux formes artistiques, Coomaraswamy était profondément réceptif aux formes esthétiques et connut en fait l’appel de la tradition alors qu’il travaillait comme géologue dans les collines et montagnes de Ceylan (Sri Lanka) et de l’Inde où il fut le témoin de la rapide destruction de la civilisation et de l’art traditionnels de sa patrie. Coomaraswamy fut aussi un érudit méticuleux et soucieux des détails alors que Guénon fut essentiellement un métaphysicien et un mathématicien soucieux des principes. Les deux hommes étaient complémentaires jusque dans leurs traits personnels et dans leurs styles littéraires, et pourtant en parfait accord quant à la validité de la perspective traditionnelle et des principes métaphysiques qui sont au cœur de tous les enseignements traditionnels.Coomaraswamy fut un homme d’une immense énergie qui laissa derrière lui un vaste corpus littéraire. Nous ne nous intéresserons pas ici aux nombreux ouvrages qu’il consacra à l’art oriental, particulièrement à celui de l’Inde, de Sri Lanka et de l’Indonésie. Qu’il suffise de dire que les années de sa maturité passées en Angleterre et plus encore les dernières trente années de sa vie en Amérique — où il fut conservateur de la collection d’art oriental du Musée des Beaux-Arts de Boston — furent des périodes majeures du point de vue de son effort pour porter à l’attention du public occidental un des aspects vitaux des civilisations orientales, leur art. Coomaraswamy n’était pourtant pas un historien de l’art ; l’intérêt qu’il porta à l’étude de l’art traditionnel se rapportait en fait à la vérité véhiculée par celui-ci (1). Ses études se situent sur le plan intellectuel, et il expose dans des œuvres telles que La Transformation de la nature en art et La Philosophie chrétienne et orientale de l’art une métaphysique de l’art qui présente l’art traditionnel comme support de la connaissance sacrée.
Comme Guénon, Coomaraswamy s’attaqua lui aussi sans relâche au modernisme, soulignant davantage que Guénon les dévastations provoquées par l’industrialisme dans le domaine des artisanats et des modes de vie traditionnels en Occident comme en Orient. Mais il se pencha également sur les questions intellectuelles impliquées dans cette crise ; il entreprit en fait à la fin de sa vie une série d’ouvrages intitulée “la série des épouvantails” (Bugbear Series), dont seul l’ouvrage The Bugbear of Literacy fut publié de son vivant, et qui vise à détruire les diverses idoles du modernisme par le recours à des principes intellectuels.
Pour ce qui est de la métaphysique et de la cosmologie, Coomaraswamy écrivit aussi nombre d’articles et de livres largement nourris d’apports hindous, bouddhistes et islamiques, mais aussi de références à Platon, Plotin, Denys, Dante, Érigène, Eckhart, Boehme, Blake et d’autres représentants de la tradition sapientielle. Comme Guénon (2), il mit l’accent sur l’unité de la vérité qui est au cœur de toutes les traditions, unité à laquelle il devait consacrer sa célèbre étude “Paths That Lead to the Same Summit” (Sentiers menant au même sommet).
Outre plusieurs ouvrages sur les traditions hindoue et bouddhiste dont Hindouisme et Bouddhisme constitue la synthèse intellectuelle, Coomaraswamy donna également des études purement métaphysiques telles que Recollection, lndian and Platonic, On the One and Only Transmigrant, et Time and Eternity (3).
Coomaraswamy était profondément intéressé par le mythe et le symbole, par la mentalité soi-disant primitive et l’anthropologie traditionnelle. Ses études sur le symbolisme religieux et sur la signification traditionnelle du mythe ont joué un rôle central dans le regain d’intérêt à leur égard qui se fit jour parmi les spécialistes de l’étude comparée des religions, et ce en dépit de la tendance dite “démythologisante” si évidente dans certaines écoles de théologie protestante et même catholique. Coomaraswamy consacra également de nombreuses études aux sciences traditionnelles, de son essai sur le symbolisme de zéro en mathématiques indiennes à son traité sur la distinction entre la doctrine traditionnelle des degrés de réalité et l’évolutionnisme moderne. Au total, son œuvre fournit une présentation des enseignements traditionnels dans la langue universitaire contemporaine, et elle le fait avec un tel degré d’érudition et de clarté d’expression qu’en dépit de l’opposition presque unanime des milieux modernes à ses idées qui marqua ses débuts, il en vint à exercer une vaste influence, de nos jours encore sensible, sur un large éventail d’universitaires et de penseurs qui compte aussi bien des historiens de l’art que des physiciens. Au cœur de ce remarquable édifice intellectuel résident les concepts de connaissance du sacré et de connaissance sacrée ; ses œuvres, comme celles de Guénon, furent en fait le produit d’un intellect dont la “respiration” et l’activité se situaient dans un monde de caractère numineux, un monde reflétant la substance même de l’intelligence.
► Seyyed Hossein Nasr, La Connaissance et le sacré, L'Âge d'Homme, 1999. [recension]
1. Lire la contribution « From Art to Spirituality » de Jacques de Marquette au recueil-hommage Art & Thought, 1947.
2. « Si Guénon veut que l’Occident se mette à l’étude de la métaphysique orientale, ce n’est pas parce qu’elle est orientale, mais parce que c’est la métaphysique. Si la métaphysique “orientale” différait de la métaphysique “occidentale” — comme la vraie philosophie diffère de ce qui est souvent appelé ainsi dans nos modernes universités —, l’une ou l’autre ne serait pas la métaphysique. C’est la métaphysique dont l’Occident s’est détournée dans sa tentative désespérée de vivre de pain seulement, une entreprise dont les fruits de mer Morte sont devant nos yeux. C’est seulement parce que cette métaphysique subsiste encore comme une puissance de vie dans les sociétés orientales — dans la mesure où celles-ci n’ont pas été corrompues par le contact desséchant de la civilisation occidentale ou plutôt de la civilisation moderne (car l’opposition n’est pas entre Orient et Occident comme tels, mais entre “ces voies que le reste de l’humanité suit tout naturellement” et ces chemins d’après la Renaissance qui nous ont conduits à la présente impasse) — et non pour orientaliser l’Occident, mais pour le ramener à la conscience des racines de sa propre vie et des principes qui ont subi une “transvaluation” dans le sens le plus sinistre, que Guénon nous demande de nous tourner vers l’Orient », (« Eastern Wisdom and Western Knowledge » [Sagesse orientale et savoir occidental], Isis n°4, 1943).
3. Recension : L’auteur, orientaliste, est passé de travaux sur l’art à des recherches sur la symbolique et la métaphysique. Ce livre, le dernier de son auteur (1947), confronte les doctrines du temps et de l’éternité dans les différentes traditions. Ainsi on trouvera successivement étudiés l’hindouisme, le bouddhisme, la Grèce, l’Islam et le christianisme. Le nombre et la précision des citations et références, les correspondances établies d’un mode de pensée à l’autre font de ce livre un instrument de travail utile. On a ajouté à ces études sur le temps un article sur « Kha et autres mots signifiant “zéro” dans leurs rapports avec la métaphysique de l’espace ». Une étude serrée de textes empruntés au Rig-Véda montre la conjonction du vide et du plein, la correspondance du point axial et du noyau engendrant l’espace principiel. L’espace est à l’origine un point, comme il y a en chacun un espace principiel, foyer de l’énergie spirituelle. (Michel Adam, Rev. Phi. n°4/1977)
*
• nota bene : cf aussi notice biographique de P. Baillet in Politica Hermetica n°1, 1987. Ainsi que cette présentation par P. Ringgenberg (réf. infra).
• Voir aussi bibliographie commentée. Se reporter en bas de page pour une bibliographie détaillée.

 ♦ Présentation du dossier documentaire. Il comprend 11 textes ♦
♦ Présentation du dossier documentaire. Il comprend 11 textes ♦• 4 études : AKC : de l’idéalisme à la tradition / AKC et la “philosophia perennis” / La saveur de l’infini / Ajouts
• 7 par AKC : Le fondement religieux des formes de la société indienne / “Paternité spirituelle” et “puppet complex” / L’art asiatique / La beauté est un état de l'âme / Le Védānta et la tradition occidentale / Le “Monothéisme” védique / La mise au monde de l’Esprit

 Ananda K. Coomaraswamy : de l’idéalisme à la tradition
Ananda K. Coomaraswamy : de l’idéalisme à la tradition[Ci-contre : timbre indien de 1977 commémorant le centenaire de la naissance d'Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947). À droite, le dieu Shiva-Nataraja lors de sa danse cosmique]
Parmi les représentants de ce qu’il est convenu d’appeler la “pensée traditionnelle”, Ananda K. Coomaraswamy représente une figure de proue, peut-être la plus intéressante. Il parvint mieux que tout autre à utiliser tous les moyens que lui offrait son époque pour véhiculer un message culturel opposé aux valeurs dominantes de la modernité. Sa vie comme son œuvre, souvent moins connues que celles des autres représentants du courant traditionaliste (Guénon, Evola, Schuon), montrent combien une pensée métaphysique peut s’exprimer par le biais de la culture académique occidentale sans pour autant se banaliser, c’est-à-dire sans que les valeurs sapientielles qu’elle véhicule ne perdent leur potentialités “révolutionnaires”.
Un étudiant brillant
Coomaraswamy naquit à Colombo, sur l’île de Ceylan, le 22 août 1877. Son père, Sir Mutu Coomaraswamy, notable local, appartenait à l’ethnie tamoule et sa mère, Elizabeth Clay Beeby, était une Anglaise originaire du Kent. Son nom de famille dérive d’une divinité hindoue, Skauda Kumara, à laquelle est dédiée un temple sur l’île de Katargama. Le suffixe swamy signifie “maître”, “seigneur” ou “propriétaire”. Il fut rajouté dans un second temps au nom de famille — accolement caractéristique de la classe moyenne cultivée, qui formait à Ceylan la bureaucratie de haut rang. Sir Mutu Coomaraswamy, s’il était très lié aux traditions de son pays, savait aussi frayer avec les colons. Il se rendit d’ailleurs à plusieurs reprises en Grande-Bretagne, où il put fréquenter les cercles les plus fermés de la haute société, et ainsi celle qui devint sa femme.
Homme d’une grande culture philosophique, religieuse et littéraire, il se révéla également un combattant politique. Ses sévères critiques de l’utilisation des taxes payées par les autochtones pour financer sur l’île même l’Église d’Angleterre, s’inscrivent dans la lutte qu’il mena toute sa vie durant contre l’occidentalisation de la culture locale — lutte dont la traduction de textes bouddhistes et d’un drame tamoul fut la manifestation positive. Sur de nombreux points, le fils suivra les traces du père. Même s’il ne le connut qu’à peine — Sir Mutu mourut lorsqu’Ananda n’avait pas encore deux ans —, l’influence psychologique et spirituelle fut énorme. Après la mort de son mari, Elizabeth Beeby s’établit en Grande-Bretagne, où elle éleva son fils.
Le jeune Coomaraswamy fut ainsi influencé par les idées de William Morris (1834-1896), singulier animateur d’un mouvement d’opinion d’inspiration socialiste utopique, pour lequel il éprouva toujours une vive affection, même dans la dernière période de sa vie. À l’Université, Coomaraswamy choisit une voie scientifique, présentant avec succès, en 1906, une thèse de doctorat en géologie et botanique — il était alors le premier Ceylanais à obtenir ce diplôme. Roger Lipsey, son biographe américain, a très justement noté combien cette formation rigoureuse lui permit d’acquérir un esprit méthodique et d’aborder avec un angle de vue original les études de métaphysique [1]. Revenu à Ceylan, Coomaraswamy commença des recherches géologiques de terrain, rapportant ses observations dans des revues spécialisées. Les résultats de ses travaux furent alors jugés très satisfaisants : publication de cartes géologiques, découverte de gisements de mica et de graphite, identification en 1904 d’un nouveau minéral, la thorianite… Le jeune homme excellait, s’attirait l’estime de ses confrères et semblait se destiner à une carrière paisible et honorable.
 [Ci-contre ; Gravure sur bois de CR Ashbee servant de colophon à L’Art médiéval cingalais en 1908 imprimé artisanalement par la maison d'édition Essex House Press (héritière de la Kelmscott Press de William Morris) dans la chapelle normande de Broad Campden, unissant ainsi arts du livre et ouvrage de défense des arts. Première œuvre magistrale d'AKC aidé par son épouse, son sérieux encyclopédique avait nécessité un travail quasi éthnographique de mars 1903 jusqu'en décembre 1906]
[Ci-contre ; Gravure sur bois de CR Ashbee servant de colophon à L’Art médiéval cingalais en 1908 imprimé artisanalement par la maison d'édition Essex House Press (héritière de la Kelmscott Press de William Morris) dans la chapelle normande de Broad Campden, unissant ainsi arts du livre et ouvrage de défense des arts. Première œuvre magistrale d'AKC aidé par son épouse, son sérieux encyclopédique avait nécessité un travail quasi éthnographique de mars 1903 jusqu'en décembre 1906]Sa valeur scientifique étant désormais reconnue, Coomaraswamy fut nommé responsable des recherches minéralogiques à Ceylan. Mais il se désintéressa peu à peu de sa vocation première. Durant ses années de voyage à travers Ceylan, Coomaraswamy, accompagné de sa première épouse, Ethel Mary Partridge, excellente photographe, découvrit l’art traditionnel de l’île. Les époux commencèrent alors à recueillir une vaste documentation ethnographique : annotations, souvenirs, objets, photographies d’artisans travaillant dans les régions les plus reculées et épargnées par l’industrialisation. Pendant quelques années, le géologue et l’ethnologue cohabitèrent. Certains livres, comme le remarquable Mediaeval Singhalese Art (1908, 2e éd. 1956), rapportent les fruits de ce travail pionnier.
Lors de ces périples, un fait symbolique marqua le jeune chercheur anglo-indien, ainsi qu’il l’explique lui-même dans un essai en partie autobiographique, Borrowed Plumes (1905) : ce fut la rencontre, à la campagne, d’une femme cingalaise et de son fils, tous deux vêtus à l’européenne, contrastant ainsi singulièrement avec leur entourage traditionnel. Ceux-ci appartenaient à une classe aisée et semblaient respectés. “Ils étaient pourtant, écrit l’auteur, adeptes d’une religion et de coutumes étrangères. Cela me parut un symbole de tout ce que j’avais constaté, durant les deux dernières années, au sujet de la disparition progressive des coutumes locales au bénéfice des civilisations avancées. Et je m’aperçus que cet écroulement n’était que l’épiphénomène d’un mouvement mondial, marqué par la destruction continuelle du caractère national, de l’individualité et de l’art. (…) Notre civilisation orientale existe depuis deux mille ans : son âme sera-t-elle totalement anéantie par l’impact du mercantilisme occidental ? Je me prends parfois à rêver que l’esprit oriental n’est pas mort, qu’il sommeille seulement, et qu’il s’apprête à jouer un grand rôle dans la vie spirituelle de l’humanité” [2]. Ce fut pour Coomaraswamy une vision révélatrice de la plus profonde réalité, semblable à l’expérience du jeune prince Siddharta, lorsque celui-ci, sortant du palais paternel, vit un vieillard, un malade, un cadavre et un moine mendiant — quatre personnages symbolisant à la fois les maux et les disgrâces du monde et la voie de celui qui a abandonné les passions et les liens de l’existence.
Au cours de ses enquêtes ethnologiques, Coomaraswamy s’était forgé une conviction : l’art est indissociable du peuple qui le produit. En le détruisant au nom des impératifs du progrès technologique, on nie en même temps les caractères et la physionomie d’une communauté. Comme Lipsey a pu justement l’observer, Coomaraswamy assuma fort bien le fait d’être partagé entre deux cultures, l’anglaise et la ceylanaise, cette tension lui évitant de cultiver, à l’instar des colons ou des autochtones, des sentiments déplacés de supériorité ou d’infériorité. Par cette égale distance vis à vis de ses origines et de son éducation, il devenait le témoin lucide des grandes transformations marquant déjà l’Orient. Le jeune directeur des recherches minéralogiques s’était transformé en spécialiste des arts ceylanais, et le spécialiste allait bientôt céder la place au penseur incarné, participant directement à la vie de cette nation paternelle dont il pressentait bien que la défense était devenue un devoir.
L’aventure de la “Société pour la réforme sociale de Ceylan”
Ce fut le premier changement radical de son existence. Coomaraswamy éprouva la nécessité de s’engager publiquement afin de réveiller la conscience autochtone. Il fut aidé dans cette entreprise par quelques résidents européens, également préoccupés de la renaissance des études bouddhistes, et fonda avec eux la Société pour la réforme sociale de Ceylan, dont il devint président. Dans le manifeste publié par le journal de la Société s’affirment des objectifs de préservation des spécificités locales, aussi bien dans le domaine matériel que spirituel, et de renaissance du sentiment d’appartenance. S’il s’agit de décourager l’avènement systématique des us et coutumes étrangères, les signataires affirment également la nécessité de mieux connaître la civilisation occidentale pour se montrer capable d’en discerner les aspects éventuellement bénéfiques. Le ton du manifeste, écrit en anglais, n’était pas à proprement parler “anti-occidental” ou “anti-colonial”. Nous le qualifierions plus volontiers de “réformiste” — il défendait un changement graduel, non violent, de la société, fondé sur une éthique de la conviction et du dialogue —, même si certaines options “radicales” (une mutation nécessaire des fondements mêmes de l’être collectif) pointaient déjà. Coomaraswamy critiquait volontiers un certain anti-colonialisme (comme celui du mouvement indien Swadeshi) qui, empruntant les voies de la revendication occidentale, finissait par se placer sur le même plan “qualitatif” que son adversaire. Il jugeait ainsi l’indépendance politique nécessaire, mais non suffisante, car amputée d’un fondement culturel spécifique qui la légitime. Le combat le plus urgent visait à ressourcer l’âme du peuple colonisé. Ce désir de “changer la société”, d’en transformer d’abord la mentalité pour agir ensuite sur ses structures, caractérise d’ailleurs les engagements contractés par Coomaraswamy tout au long de son existence, même lors de son séjour aux États-Unis.
Certes, les ombres ne manquaient pas. En novembre 1907, par ex., la Société pour la réforme sociale invita une oratrice ambiguë en la personne d’Annie Besant, récemment élue présidente de la Société internationale de théosophie. Or cette organisation fut responsable d’une mystification systématique à l’égard de la tradition hindoue, œuvrant en sous-main pour l’intérêt du pouvoir colonial anglais qui alimentait avantageusement, à travers la diffusion d’idées pseudo-religieuses contaminées par de nombreux préjugés occidentaux, les sources de division parmi les Indiens. Bien plus tard, Coomaraswamy devait reconnaître que “la théosophie est en grande partie une philosophia perennis déformée” [SL 39].
Dans les premières années de ce siècle, Coomaraswamy se situait ainsi à la confluence d’idées parfois contradictoires : en lui cohabitaient un vitalisme nietzschéen, un goût suranné pour le romantisme victorien (idéalisation du passé), l’influence encore sensible de William Morris, un intérêt marqué pour la théosophie et une adhésion sereine à l’hindouisme orthodoxe — l’éducation chrétienne qu’il avait reçue de mauvais gré en Angleterre semblant constituer le réactif de ces intuitions encore tumultueuses [3]. L’action réformatrice engagée à Ceylan, bien qu’ayant connu un certain retentissement, ne recueillit pas les fruits attendus, à tel point que Coomaraswamy ne dissimula pas sa franche déception devant l’indifférence d’une large partie de la population. Son départ pour l’Angleterre — qui ne l’empêcha pas de participer encore à la vie intellectuelle de sa patrie ceylanaise — coïncide avec l’ouverture de nouveaux horizons philosophiques.
L’influence des idées de William Morris devint alors de plus en plus prégnante. Comme nous l’avons signalé, Morris était un socialiste utopiste et humanitaire, héritier du courant romantique, violemment hostile au mythe du progrès. L’admiration que Coomaraswamy vouait alors aux civilisations pré-modernes trouvait en lui un éveilleur irremplaçable. Morris avait traduit des textes de littérature nordique traditionnelle, et Coomaraswamy, suivant son exemple, traduisit en 1905 la Völuspa. Cette admiration se concrétisa également par un engagement dans le Mouvement des Arts et Métiers (Arts & Crafts) que dirigeaient Morris, John Ruskin et C. R. Ashbee, et qui visait à défendre les dernières survivances organiques de la vie communautaire par opposition à la laideur et à l’anomie des sociétés industrielles.
Si la volonté du jeune Ananda de réformer la société dans le sens d’une plus grande justice doit beaucoup à Morris, il convient aussi de rappeler combien cette vocation était, dès l’origine, étrangère aux velléités égalitaristes et matérialistes d’un certain socialisme. Même s’il s’exprimait alors en termes parfois confus (et trouvait encore quelques vertus à la modernité, notamment… au cosmopolitisme), Coomaraswamy ne dissociait pas la recherche de la meilleure justice et la défense des identités individuelles et collectives : qu’à chacun revienne ce qui lui est dû, et, pour cela, que chacun soit selon son être propre. D’autre part, l’anthropocentrisme de Morris — “ne traitant ni de métaphysique ni de religion”, selon ses propres termes — n’eut aucun prise durable sur celui qui allait, quelques années plus tard, entreprendre une vaste relecture des doctrines sapientielles.
À cette époque, la curiosité intellectuelle de Coomaraswamy se développait tous azimuts. Il mit en place les grandes lignes de son système philosophique — “l’individualisme idéaliste” — où se trouvaient réunis William Blake et William Morris, Friedrich Nietzsche et les transcendantalistes américains. Simultanément, l’intérêt plus “politique” qu’il portait à Ceylan se déplaça vers l’Inde, nation en lutte pour son indépendance. Ce changement de perspectives s’explique doublement. Le jeune philosophe souffrait encore de la déception consécutive à l’échec de son engagement ceylanais et souhaitait, en s’engageant sur la question indienne, élargir son champ de vision. L’appartenance de son père à l’ethnie tamoule — originaire de l’Inde et tardivement implantée à Ceylan — trouva aussi dans cette aventure une signification nouvelle. En recherchant ses propres racines, Coomaraswamy s’était également armé d’une profonde conviction : l’Occident en crise aura besoin de l’Orient pour régénérer ses forces créatrices. Si le premier procure une jouissance matérielle jusqu’alors inconnue, le second apporte une sagesse indispensable à la sérénité.
 ”Aucune collaboration avec les Anglais…”
”Aucune collaboration avec les Anglais…”[Ci-contre : le libre-penseur Tagore & AKC aux USA en 1931]
En 1909, Coomaraswamy fut en contact avec les milieux nationalistes et anticolonialistes du Bengale, qui étaient divisés sur le problème de la stratégie à suivre — non-violence ou terrorisme —, mais unis par la devise commune à tout le mouvement Swadeshi (”Propre nation”) : “Aucune collaboration avec les Anglais, dans quelque secteur que ce soit”. Des figures de proue, souvent culturellement éloignées, s’imposaient peu à peu à la direction des indépendantistes. Certaines avaient été durement éprouvées par de longues années de détention, comme le leader traditionaliste Tilak, qui mourut dans une prison birmane en 1920, et toutes — Aurobindo, Gandhi, Tagore — étaient à quelque degré persécutées. C’est dans cette période troublée que Coomaraswamy connut Tagore à Calcutta. La rencontre se révéla importante pour sa maturation intellectuelle (Tagore, alors âgé de quarante ans, était de huit ans son aîné), et si les positions des deux hommes devaient plus tard se différencier radicalement, leur amitié ne fléchit jamais. Tagore (1861-1941) fut un personnage étonnant. Poète, Nobel de littérature en 1913, philosophe, auteur de chansons, il se fit le promoteur des activités culturelles les plus diverses, parmi lesquelles il faut rappeler la fondation de l’université Vihsva Bahrati, ainsi que de la revue du même nom, diffusée très largement à travers le monde et où furent notamment publiés des essais de René Guénon, Ezra Pound, Alain Daniélou, Julius Evola [4] et, naturellement, Coomaraswamy. Tagore n’était pas un hindou traditionaliste. Sa pensée pourrait plutôt se définir comme un agrégat hétérogène d’idées orientales et occidentales, déclinées d’une manière tout à fait personnelle et souvent discutable du point de vue de la cohérence interne — une sorte de “religion de l’homme” sensualiste, à la fois anti-métaphysique et anti-progressiste.
Coomaraswamy, alors âgé de trente-deux ans, décida d’étudier plus avant la question religieuse. La fréquentation de Sir John Woodroffe, juge anglais à la Haute Cour de Calcutta, reconnu, sous le pseudonyme d’Arthur Avalon, comme un excellent spécialiste du tantrisme, le soutint dans cette tâche. En 1913 et 1916 parurent ses premiers livres exclusivement consacrés à la religion et à la métaphysique : Myths of the Hindus and Buddhists et Buddha and The Gospel of Buddhism [5].
Si la documentation réunie dans ces essais impressionne par sa densité et sa précision, certaines interprétations sont toutefois hasardeuses et certaines intuitions erronées. Par ailleurs, l’approfondissement religieux est encore rapporté pour une large part aux questions politiques. En intervenant dans le débat sur l’avenir de l’Inde, Coomaraswamy affirma à plusieurs reprises que la réalisation de l’indépendance resterait caduque tant qu’elle ne s’accompagnerait pas d’une redécouverte et d’un renforcement du véritable esprit indien. “L’Inde, politiquement et économiquement libre, mais assujettie à l’Europe au plus profond de son âme, ne saurait être un idéal digne de foi, pour lequel nous devrions vivre ou mourir. (…) La faiblesse de notre mouvement national vient de ce que nous n’aimons pas l’Inde : nous aimons une banlieue anglaise, nous aimons la confortable prospérité bourgeoise” [6]. Ce rappel appuyé du passé de l’Inde lui valut une réputation définitive de “réactionnaire” auprès des représentants progressistes du mouvement anticolonial. Au point qu’une de ses contributions pour un livre consacré à Gandhi, rédigée bien des années plus tard, fut refusée pour son orientation trop antimoderne [SL 348-351].
Malgré les tumultes de sa vie privée — divorcé de sa première femme, il épousa en deuxièmes noces une musicienne anglaise qui lui donna deux fils, mais ce second mariage se solda bientôt par un échec —, Coomaraswamy poursuivait de front son approfondissement philosophico-religieux et ses activités de critique d’art. La grande découverte de la peinture de Rejput, dont il mit en relief la valeur symbolique et sacrale, confirma sa notoriété. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Coomaraswamy se déclara objecteur de conscience, refusant de s’engager dans un conflit étranger aux intérêts du peuple indien. Ce comportement lui valut des rétorsions économiques de la part des autorités et, à partir de 1917, il ne retourna plus en Angleterre. Par chance, durant cette période difficile, le musée de Boston lui fit une offre inattendue : devenir directeur de sa section d’art indien, récemment créée. Paradoxalement, comme le remarque non sans malice Lipsey, Coomaraswamy dut s’établir dans le pays le plus progressiste du monde !
Les dix premières années passées aux États-Unis furent fécondes. Coomaraswamy acquit une érudition proprement encyclopédique, et ses travaux sur l’art indien devinrent des références à l’autorité mondialement reconnue. Le domaine de ses connaissances “intérieures” s’approfondit également. Son intérêt déjà ancien pour les transcendantalistes américains — Ralph W. Emerson (1803-1882), Henry D. Thoreau (1817-1862), Walt Whitman (1819-1892) [7] — se précisa. Il ressentait chez eux une tension spirituelle similaire à la sienne et ne fut guère étonné de découvrir, parmi leurs principales sources d’inspiration, la pensée orientale (hindouisme, soufisme, taoïsme et confucianisme). C’est sur cette base doctrinale d’ordre sapientiel que les transcendantalistes avaient engagé la polémique contre le rationalisme et le sensualisme de la philosophie anglo-saxonne (Locke et Hume), très prisés à l’époque.
Coomaraswamy fut également fasciné par les Indiens d’Amérique du Nord, dont il étudiera plus tard, avec une grande rigueur, la mythologie. Il s’intéressa au mouvement des Shakers, communautés chrétiennes quasi monastiques, alors sur le point de disparaître. Leur production artisanale était, aux yeux de Coomaraswamy, représentative d’un haut niveau de spiritualité : sévère, impersonnelle, caractérisée par une relation harmonieuse des parties et une unité formelle parfaite. Il y vit un des rares exemples modernes d’un style artistique traditionnel débarrassé de tout archaïsme, ne reproduisant pas les formes “extérieures” [GB 201], mais incarnant les mouvements intérieurs de l’âme.
L’ultime métamorphose
La maturité intellectuelle de Coomaraswamy correspondit à une période de nouveau troublée de sa vie privée : un troisième mariage, avec une femme très jeune — indéniable anticonformisme dans une Amérique puritaine —, sombra plus rapidement encore que les deux précédents. La sérénité ne vint en ce domaine qu’avec sa quatrième et dernière femme, Luisa Runstein, Argentine d’origine juive, qui devait mettre au monde son fils Rama.
Dans les années trente, au seuil de la vieillesse, Coomaraswamy connut la plus évidente métamorphose de son existence, accomplissant ce qu’il semblait tenir depuis longtemps en germe. Sa plume se fit moins imaginative et plus ascétique. S’il dédiait aux universitaires ses études spécialisées, l’érudit ne négligeait pas pour autant le grand public, auquel s’adressaient ses textes les plus fascinants, comme La Danse de Çiva (livre que l’on peut déjà qualifier de “sapientiel”, même si les influences vitalistes et irrationalistes n’y sont pas encore éteintes). Sa pensée devint alors d’une cohérence et d’une pureté peu communes, et Lipsey parle à juste titre d’ “une transition du premier état au second”, marquée par l’apparition de nouveaux centres d’intérêt et par un véritable “changement qualitatif de l’esprit” [8].
En 1932 était paru son premier essai s’inscrivant ouvertement dans la perspective traditionaliste (Maha-Pralaya et le jugement final). À partir de 1933, ses obligations vis-à-vis du musée de Boston se faisant moins pressantes, Coomaraswamy put se consacrer pleinement aux recherches métaphysiques. Son style devint encore plus impersonnel, et la documentation sur les textes sacrés toujours plus érudite. Les notes de ses essais s’allongèrent au point de devenir des chapitres à part entière. Coomaraswamy fournit, dans une lettre adressée à l’historien d’art allemand Herman Goetz, l’explication de cette ultime métamorphose : “Ce fut un changement naturel et nécessaire qui trouva son origine dans mon travail précédent, où prévalait l’intérêt iconographique. Je n’étais plus satisfait par la simple description et je devais être capable d’expliquer le pourquoi des formes. Pour cela, il me fut nécessaire de parcourir les Veda, et la métaphysique en général, d’où émergent les raisons séminales du développement symboliques. Naturellement, il m’était impossible de me satisfaire de simples explications sociologiques, puisque les formes des sociétés traditionnelles elles-mêmes ne peuvent être expliquées que d’un point de vue spirituel” [SL 27].
La pensée de René Guénon, auquel Coomaraswamy consacra un essai en 1935 [SO 78], joua à cette époque un rôle fondamental. La découverte des travaux du penseur français — grâce à Marco Pallis [9] et à RA Nicholson, traducteur de Rumi — agit comme une “mise en ordre” des réflexions auxquelles Coomaraswamy était parvenu par sa voie propre. Il trouva sa véritable fonction, qui se différenciait de celle de Guénon, cependant engagé comme lui dans une oeuvre de témoignage de la Tradition et de résistance au monde moderne. Ainsi écrit-il à Marco Pallis : “Ma fonction première n’est pas d’écrire des livres ou des articles abordables : ceci est justement le point qui différencie mon rôle de celui de Guénon. Toute ma volonté d’écrire est adressée aux doyens et aux spécialistes, à ceux qui, ces derniers temps, ont affaibli notre sens des valeurs et dont l’érudition tellement vantée se révèle en dernier ressort très superficielle. Je pense que la rectification doit survenir au niveau de ce qui est considéré comme étant le ‘sommet’ — et alors seulement cette rectification trouvera sa place dans les écoles, dans les livres et dans les encyclopédies” [10].
Entre 1935 et 1947, le penseur anglo-indien écrivit ses meilleurs textes (not. Hindouisme et bouddhisme, Le temps et l’éternité, Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne de gouvernement). Ses connaissances déjà prodigieuses s’enrichirent encore de contacts fructueux, personnels ou épistolaires : M. Pallis, cité précédemment, Mircea Eliade, JE Brown, Aldous Huxley, Gershom Scholem, Frithjof Schuon et bien d’autres. Même s’ils ne se rencontrèrent jamais, il eut avec Guénon une relation soutenue et féconde (en 1947, son fils Rama se rendit en Égypte pour rencontrer le penseur français) [11]. Le nom de Coomaraswamy commence également à cette époque à apparaître dans des publications traditionalistes (Études traditionnelles, Isis).
Dans les dernières années de son existence, le désir de réaliser intérieurement ses connaissances théoriques se fit toujours plus pressant. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le retour de Coomaraswamy en Inde — alors devenue indépendante : il se comportait ainsi comme un Hindou traditionnel qui, après avoir accompli ses devoirs dans le monde, se retire durant sa vieillesse. Dans le discours prononcé à l’occasion de la célébration de son soixante-dixième anniversaire, Coomaraswamy avait officiellement déclaré vouloir “rentrer à la maison” avec sa femme : “Nous avons l’intention de rester en Inde, à présent une nation libre, pour le restant de nos jours (…) Pour moi, le moment est venu de passer d’un mode de vie actif à un autre plus contemplatif, dans lequel j’aimerais expérimenter d’une façon plus immédiate, plus complète, une partie au moins de la Vérité dont ma compréhension, pour l’instant, n’a été que de l’ordre de la logique” [M 434-435]. Mais le destin en avait décidé autrement : un infarctus l’emporta dans la matinée du 7 septembre 1947. Après des oraisons funèbres gréco-orthodoxe et hindouiste, son corps fut incinéré et ses cendres furent pour une moitié “restituées” au Gange et pour l’autre confiées à sa famille ceylanaise.
Les contradictions des années de jeunesse
Pour analyser avec plus de précision la pensée “essentielle” de Coomaraswamy, celle des quinze dernières années de son existence, il faut revenir à sa production intellectuelle des décennies précédentes, afin de mettre en évidence les continuités et les ruptures. Comme nous l’avons signalé, Coomaraswamy fut longtemps influencé par la philosophie moderne “profane”, dans ses variantes humaniste, sentimentaliste ou historiciste. Dans de nombreux écrits des années dix et vingt de ce siècle, nous trouvons chez lui certains thèmes qui seront par la suite abandonnés ou “retournés”, l’auteur s’étant entre-temps placé à un niveau d’analyse qualitativement différent.
Un exemple de ce parcours intellectuel ascendant nous est fourni par son approche du rapport Asie-Occident, auquel est lié le concept de “sagesse orientale” (et plus particulièrement “indienne”), visant “le bien-être humain” [DS 1] — cette finalité ne devant évidemment pas être interprétée dans un sens hédoniste. “À l’avenir, écrit Coomaraswamy, la civilisation devra être humaine, et non plus locale ou nationale. (…) Le peuple élu de l’avenir ne saurait être une nation ou une race, mais une aristocratie de la Terre qui unisse la virilité de la jeunesse européenne à la sérénité de la vieillesse asiatique” [DS 112 et 135]. Ou bien encore : “En ce moment, tandis que le monde occidental réalise qu’il a échoué dans la tâche de recueillir les fruits de la vie au sein d’une société fondée sur la compétition et l’auto-affirmation, la découverte de la pensée asiatique offre un sens nouveau et profond à l’existence, mettant en avant les concepts d’ordre moral et de responsabilité mutuelle (…) L’hindouisme (…) se positionne contre le monde du laisser-faire, demandant à ses disciples d’abandonner tous leurs ressentiments et leurs convoitises (…) offrant en échange le bonheur et la paix, au-delà de notre seule appréhension rationnelle du monde” [12].
Le cadre de cette rencontre Orient-Occident était alors aussi nettement laïc que philosophique : “l’esprit” était entendu dans son acception moderne, sans épaisseur ni transcendance. La connaissance restait un fait humain — portée certes à un très haut niveau —, tandis que la morale devenait une valeur suprême (là encore, à un degré d’exigence fort éloigné du moralisme vulgaire). Durant cette période, Coomaraswamy, qui refusait déjà la dénaturation des identités collectives, combattait pour une philosophie syncrétique et élitiste à nuances cosmopolites, fondée sur la convergence des vérités orientales et des théories philosophiques occidentales, même modernes. Ainsi s’explique, par ex., l’équivalence alors posée entre l’Éveillé du bouddhisme et le Surhomme de Nietzsche [13]. L’individualisme idéaliste de Coomaraswamy — “religion de l’Europe moderne” — s’alimentait de telles analogies. Sa philosophie pouvait réunir un mystique comme William Blake, un transcendantaliste comme Walt Whitman et un vitaliste comme Friedrich Nietzsche sans y voir la moindre contradiction interne [DS 115 sq].
L’introduction de La Danse de Çiva, rédigée par Romain Rolland, est encore révélatrice de cette “œcuménisme profane” où Coomaraswamy se joignait volontiers aux critiques partielles de tel ou tel aspect de la civilisation occidentale. Un certain exotisme et d’ingénues visions idylliques — bien loin de la sévérité orientale —, caractérisent cette période. Pour autant, il ne faut pas négliger la qualité de ses livres : le physicien et philosophe Fritjof Capra [14], par ex., s’est dit fort influencé par La Danse de Çiva, où un rapprochement, audacieux pour l’époque, entre physique moderne et métaphysique hindoue était déjà énoncé. Et sous de nombreux aspects, les critiques actuelles de la modernité, relevant d’une gauche post-marxiste, ne sont pas sans évoquer l’anti-modernité “profane” du jeune Coomaraswamy. Outre ces hésitations philosophiques, les premiers livres révèlent enfin une maîtrise imparfaite du langage — conséquence d’une purification incomplète de sa pensée. Ainsi, le terme “esthétique”, dont il refusa par la suite le sens positif communément employé aujourd’hui, se retrouve souvent dans ses textes sur l’art [DS 30].
Ces réserves faites, il convient de souligner que les orientations du premier Coomaraswamy n’étaient pas sans analogies intuitives avec celles de la Tradition. En témoigne, par ex., ce qu’il écrivit à propos des sociétés archaïques, définies comme “unanimes” (c’est-à-dire cohérentes intérieurement), ou bien au sujet du féminisme et du nationalisme, considérés comme des phénomènes négatifs inscrits dans la logique du déracinement : “La soi-disant féministe est réduite en esclavage par les idéaux masculins, de la même manière que le soi-disant nationaliste vis-à-vis des idéaux européens” [DS 98-99]. Ses critiques de la mentalité “victorienne” de Gandhi vont dans le même sens [SL 352], à une époque où sa sympathie pour le mouvement de libération hindou ne l’empêchait nullement de porter un jugement positif sur le système des castes (qu’il idéalisa même quelque peu dans ses années de jeunesse, en le décrivant comme un auto-gouvernement participatif) [DS 125]. Ses observations sur l’importance de la “vocation” dans le rôle que chacun doit jouer au sein de l’ordre social [DS 125 et 138] et sa critique aristocratique du “principe de majorité”, assimilé à une “tyrannie” [DS 137], restent également éclairantes, comme l’est, sur un autre plan, sa défense d’institutions traditionnelles telles que le mariage hindou et le satî, tous deux menacées par les progressistes [DS 82 sq].
[Ci-contre : dessin de David Levine paru dans The New York Review of Books du 22 fév. 1979]
La pensée de Coomaraswamy, parvenue à maturité, se caractérise par la primauté de la métaphysique : c’est désormais à partir de principes spirituels qu’il continue d’écrire sur l’art, la politique ou l’histoire. Que désignait cette métaphysique, ou philosophia perennis, pour celui qui se définissait dès lors comme “penseur traditionaliste” [CI 151] ? C’est une doctrine d’ordre supérieur, identifiée à “la Réalité non mesurable” [M 164] d’origine transcendante. Elle introduit l’individu à la découverte du “Soi suprême”, c’est-à-dire du “vrai Principe” dont la quête est la finalité de chaque existence [M 372 sq]. À partir de ce renouvellement intérieur d’ordre ontologique, situé au-delà des valeurs, le “Connais-toi toi même” de l’oracle de Delphes prend sens et fait destin. Aux pragmatiques, qui aiment à envisager les possibilités concrètes ouvertes par telle ou telle doctrine, Coomaraswamy explique les conséquences “sociologiques” de ses présupposés métaphysiques : chaque homme doit s’élever, selon ses capacités, au-delà de lui-même, et non au-dessus des autres [CI 144]. La concurrence de tous contre tous, qui caractérise une ère moderne ayant sacrifié la verticalité du rapport à Dieu à l’horizontalité des seuls rapports sociaux, ne peut que s’opposer à l’épanouissement des êtres.
”La philosophie métaphysique, écrit Coomaraswamy, est jugée “pérenne” à cause de son éternité, de son universalité et de son immutabilité. (…) Ce qui a été révélé aux origines détient implicitement l’entière vérité. (…) La doctrine n’a pas d’histoire” [M 7]. C’est dans cette tradition primordiale indifférente aux lois de l’évolution que prennent racine le christianisme, l’islam, le védisme, le taoïsme et toutes les traditions particulières dont le caractère sacré est apparu aux hommes à différents moments de leur histoire [M 37]. Les analogies de ces grandes religions démontrent, selon Coomaraswamy, “la cohérence de la tradition métaphysique à travers l’espace et le temps” [TN 107]. C’est sans doute dans ce domaine de l’analyse comparée que réside l’une des principales contributions du penseur anglo-indien à la compréhension correcte de “l’unité transcendantale des religions” : par l’étendue de ses références, la finesse de ses observations et le soin apporté aux détails et aux sources — toujours traitées “scientifiquement” —, par l’interprétation originale de la polysémie des symboles, son œuvre dépasse peut-être en profondeur celles de Guénon ou de Schuon.
La conscience de l’Unité, dépassant les manifestations historiques particulières qui conjuguent l’Éternité avec le devenir, c’est-à-dire le contingent, suppose que l’observateur ne cherche pas à comprendre son “propre” Dieu (ni celui des autres), mais Dieu en soi [15]. “Nombreux sont les chemins qui mènent au faîte de la même et unique montagne ; les différences entre ces chemins sont d’autant plus visibles que l’on se trouve plus bas, mais elles disparaissent en atteignant le sommet” [SO 74]. Coomaraswamy affirmait également : “Pour moi, le héros solaire — le Soleil divin — est toujours la même Personne, qu’elle s’appelle Agni, Bouddha, Jésus, Jason, Sigurd, Hercules, Horus, etc.” [SL 81]. Mais il précisait : “Tandis qu’il ne peut y avoir qu’une seule métaphysique, il ne doit pas exister une seule religion, mais une hiérarchie de religions, dans lesquelles la vérité est plus ou moins convenablement exprimée” [M 38]. Parmi les formes les plus pures de l’expérience religieuse, il plaçait en premier lieu l’hindouisme, auquel il avait adhéré de façon rigoureuse, non seulement du fait de l’influence paternelle (son père, rappelons-le, était un hindou orthodoxe fort cultivé), mais aussi pour les qualités intrinsèques de cette Voie, jugée plus conforme à son approche du sacré entendu dans sa globalité, c’est-à-dire intégrant des aspects déconcertants, terrifiants et sombres souvent négligés (voire rejetés) par d’autres religions. L’hindouisme présente de fait l’alliance assez rare d’une doctrine métaphysique normative exigeante associée à une symbolique extraordinairement riche et diversifiée, qui intervient pour mettre en évidence la dimension “essentiale” (numen) du monde.
Pour éviter les malentendus, il convient de rappeler que Coomaraswamy, se référant à la pureté métaphysique de l’Inde (et de l’Orient en général), n’entendait pas proposer à l’Occident une quelconque “conversion” à des croyances “exotiques”. Sa conception universelle et unitaire du “centre” ou du “sommet” reconnaissait la nécessaire polymorphie de ses manifestations singulières. En examinant “l’unité de la Parole transcendante”, il voulait solliciter et éveiller des sensibilités spirituelles anesthésiées, le rappel des vérités éternelles ramenant chacune d’elles à ses propres racines, à sa source originelle. “Pour vous, la valeur de la tradition orientale ne se trouve pas dans les différences, mais dans ce qui peut vous rappeler ce que vous avez oublié”, écrivait-il au professeur FSC Northrop [SL 180]. Et il ne manquait jamais une occasion de souligner, dans ses remarquables études sur la genèse de la métaphysique occidentale [16], les étonnantes analogies entre le Védanta et le platonisme ou la philosophie chrétienne médiévale. L’attitude de Coomaraswamy exclut toute velléité de syncrétisme — il en fit au contraire le reproche à Aldous Huxley [SL 193] : l’unité ne se réalise pas de l’extérieur, en sélectionnant arbitrairement ce qui “plaît”, mais de l’intérieur, en partant du cœur de la Tradition, au travers d’une “intuition non spatiale et non temporelle” [17], ”l’intuition intellectuelle” guénonienne, qui permet la compréhension simultanée d’une multitude de phénomènes apparemment disjoints. “Pour n’importe quel traditionaliste, la Vérité suprême ne reste pas à découvrir, mais à comprendre” [M 22].
Cette démarche ne vise pas à déprécier le monde et son devenir en se réfugiant dans les abstractions théoriques, mais plutôt à l’enrichir en montrant la transparence de la réalité métaphysique dans ses aspects symboliques : la différence entre sacré et profane ne nous est pas donnée par les objets, mais par la façon dont ceux-ci sont “vus” et “vécus”, c’est-à-dire dans la luminosité ou l’opacité du rapport que nous entretenons avec eux. En effet, “le devenir n’est pas contradiction de l’Être, mais plutôt épiphanie de l’Être” [M 336], une “théophanie” [GB 166]. Devenir et Être “ne sont pas alternatifs, mais corrélatifs (…) L’unité du monde intelligible se montre compatible, sous tous ses aspects, avec la multiformité de ses manifestations” [18]. Par conséquent, ce qui survient possède toujours un “sens” que l’on ne saisit correctement qu’en dépassant la présomptueuse logique du “réalisme” — cette attention portée au superficiel, qui n’est qu’appauvrissement du monde. Rien n’est laissé au hasard, affirme Coomaraswamy en se référant aux textes traditionnels [M 345].
L’âge obscur dans lequel nous vivons, le Kali Yuga des Hindous, l’âge de fer de l’antiquité classique ou l’âge du “bison qui se tient sur une seule patte” des Indiens d’Amérique, se présente lui-même comme une nécessité. Il constitue “une phase nécessaire du cycle dans son ensemble” [SL 32], durant laquelle, malgré la décadence des civilisations et la crise collective des valeurs, les individus peuvent encore chercher la libération — comme ils peuvent rester prisonniers dans l’ignorance de l’existence “samsarique”. Si Coomaraswamy estimait que nous étions à la fin du cycle — “c’est la fin du Kali Yuga, et chaque mort doit être suivie par une résurrection” [SL 431] —, il n’en continuait pas moins de s’engager sur le plan sociopolitique, refusant d’accepter le statu quo du temps présent par désintéressement du monde profane. Ainsi, qualifiant sans ménagement les États-Unis de “barbarie organisée” [SL 32], il ne craignit point de s’attirer les foudres progressistes et égalitaristes en déclarant : “Je voudrais voir le système des castes s’intensifier, surtout en ce qui concerne les brahmanes, qui devraient être rétrogradés s’ils ne sont pas à la hauteur des tâches spirituelles ; ils devraient devenir vaishya s’ils pensent à s’enrichir et shudras lorsqu’ils deviennent des techniciens” [SL 32].
À mesure que progressait sa réflexion, Coomaraswamy fut amené à souligner les pièges (dans lesquels lui-même était tombé) d’une approche purement profane de la transcendance. Une telle démarche, accomplie sans préparation préalable, foncièrement individualiste, ne peut accoucher que d’une “religion naturelle” teintée d’exotisme, irriguée de “concepts essentiellement profanes” [19]. Cette voie ne fournit ni points d’attache ni valeurs opposables au “monde moderne”, qui se trouve “dans un état de chaos” caractérisé “par le désordre, l’incertitude, le sentimentalisme et le désespoir” [GB 267]. Pour ré-apprendre à connaître la vérité, il faut d’abord rétablir le juste véhicule : l’appréhension symbolique (”iconique”) du réel plutôt que le raisonnement logico-discursif et analytique.
Pensant résumer sur ce point la pensée de Coomaraswamy, Arturo Schwarz a conclu que “les enseignements ésotériques ont leur racine dans l’inconscient collectif de l’homme” [20]. Or, rien n’est plus erroné que ce propos imprudent, fruit d’une lecture approximative. Coomaraswamy, au contraire, avait expressément précisé que la “sur-conscience” à laquelle est liée la connaissance ésotérique “ne peut en aucune manière être assimilée au subconscient de la psychologie moderne” [IB 135], dont il postulait, comme Guénon, la nature “infernale”. Il critiqua ainsi le “réductionnisme psychologique” de Carl Gustav Jung. Oublier l’art de penser avec des images signifie perdre le langage même de la métaphysique et se rabaisser à la logique rationaliste de la philosophie profane. Cette incompréhension du symbolisme a touché également les milieux les plus intransigeants du christianisme, les groupes fondamentalistes et intégristes aveuglés par leur pauvre littéralité (travers typiquement “moderne”) : “La vérité est que le contenu d’une forme abstraite, ou plutôt essentielle, comme celle de la roue solaire néolithique (dans laquelle nous ne reconnaissons qu’une preuve de l’adoration des forces de la nature ou, au mieux, une personnification de ces forces) (…) est tellement riche que son exposition complète nécessiterait plusieurs volumes” [GB 246].
Selon Coomaraswamy, l’homme des temps archaïques vivait dans un monde pénétré de symboles. “L’un des traits les plus caractéristiques de la mentalité primitive est que les objets, les êtres, les phénomènes en général, peuvent être à la fois ce qu’ils sont et quelque chose d’autre qu’eux-mêmes” [GB 160]. Dans le monde traditionnel s’établissent pareillement des correspondances “horizontales” et “verticales” : “Ce qui se trouve en haut, se trouve ici-bas”, récite l’Aitareya Brahmana (VII, 2). Cette attitude révèle une perception holiste de la réalité, que Coomaraswamy décèle dans tous les “modes de pensée pratiques, politiques, moraux et religieux qui (contrairement aux nôtres) ne sont pas indépendants, mais s’incluent dans un Tout présent en chacune de ses parties” [GB 259]. Au vu de ces prémisses, on comprend mieux pourquoi Coomaraswamy considérait que le spécialiste du folklore devait être, non seulement un psychologue, mais aussi un théologien et un métaphysicien [SO 107 sq].
Cette attention à la pensée symbolique, dans laquelle Coomaraswamy voyait le cœur de la recherche métaphysique, l’éloigna des missionnaires chrétiens, responsables à ses yeux de véritables “génocides spirituels” accélérant “la sécularisation et la destruction des cultures existantes et le déracinement des individus” [SO 63] (plus en avant dans le texte, Coomaraswamy parle expressément de ”l’histoire sanglante du christianisme”, SO 68-69). Coomaraswamy respectait les éléments traditionnels du christianisme, mais il en critiquait fermement le prosélytisme, l’intolérance et la partialité, liés selon lui à l’hypertrophie des éléments “sentimentaux”. Sa visée universelle l’éloignait à ce point de tout particularisme qu’il affirmait plaisamment : “Je suis trop catholique pour être catholique” [SL XXV].
Plus intéressante encore est son étude des relations entre Hindouisme et bouddhisme [IB] (ouvrage que certains spécialistes considèrent comme son “testament spirituel”), où il est démontré que le bouddhisme n’est pas l’hérésie “moderne” que beaucoup dénonçaient alors (y compris Guénon, jusqu’aux années trente). La différence qui sépare brahmanisme et bouddhisme se place essentiellement sur le plan “technique” : le premier définit ce que nous sommes, le second ce que nous ne sommes pas [IB 139]. Si les approches divergent, la finalité reste la même : la libération de l’ignorance et des illusions provoquées par une identification absolue de l’homme au devenir, qui le rend esclave et non maître de lui-même. Voilà pourquoi le monde des phénomènes se révèle, “selon notre degré de maturité” [IB 14], source d’éveil ou d’erreur : “L’illusion n’émane pas de l’objet, mais naît chez celui qui le perçoit” [21].
Quelles furent les conceptions artistiques du chercheur anglo-indien, si importantes dans la genèse de sa pensée ? Selon l’excellente définition de Grazia Marchianò, Coomaraswamy “a indiqué (…) une manière religieuse de pénétrer le mystère de la Forme, un yoga de la connaissance dans lequel le connaissant et le connu s’unissent dans une interrogation créatrice unique du mystère de l’Être” [22]. Selon Coomaraswamy, le domaine artistique est aujourd’hui grevé d’un exhibitionnisme narcissique et d’un esthétisme frénétique qui ne sont pas sans évoquer le comportement de la pie voleuse, soucieuse de collectionner indistinctement tous les objets qui brillent. “Tandis que presque tous les autres peuples ont appelé rhétorique leur théorie sur l’art ou sur l’expression, et ont considéré l’art comme une forme de connaissance, nous avons inventé une “esthétique” (…) Le mot grec d’où dérive ce terme signifie “perception à travers les sens”, en particulier à travers les sensations tactiles. L’expérience esthétique est donc une faculté que nous avons en commun avec les animaux et les végétaux, sans aucune référence aux dimensions contemplative et active de l’Être” |GB 13]. Une telle déviation rend l’art moderne littéralement insignifiant aux yeux de Coomaraswamy (à de rares exceptions près, comme la production des Shakers ou celle de William Morris, par ex.). Réduit à l’expression paroxystique du moi de l’artiste dans sa dimension purement profane (quand elle n’est pas résolument… commerciale !), l’art n’exprime plus la présence de cette réalité supérieure, non humaine, qui jaillissait autrefois dans l’œuvre.
Si Coomaraswamy oppose l’esthétique à la rhétorique, cette dernière doit être entendue dans un sens très particulier. Elle désigne ici une théorie de l’art “en tant qu’expression efficace de thèses”. Depuis Platon et Aristote, la rhétorique se veut un moyen de rendre la vérité “efficace”. Par la connaissance de cette vérité, le Soi spirituel se met en harmonie avec le monde : il se nourrit de l’ordre des choses et non de leur “affabilité”, auquel est sensible, au contraire, le Soi sentimental de l’âme végétative. Aujourd’hui, l’art occidental ne s’adresse qu’à cette sphère sensible de l’homme et demeure muet au regard de l’Être. L’éphémère et le profane du sensualisme ont pris le pas sur la “forme intelligible”, qui constitue l’essence de toute réalité éternelle. L’émotion incontrôlée, si caractéristique de l’homme dénué de centre, se libère sans retenue, jetant le masque de la cérébralité. Sur de nombreux points, de profondes analogies peuvent être relevées entre ce discours et celui d’un autre grand historien de l’art, Hans Sedlmayr [23] — même si l’on ne relève aucune influence réciproque entre les deux hommes.
L’art traditionnel est cathartique, “anagogique” (Dante), répète souvent Coomaraswamy. “Le lecteur ou le spectateur de l’imitation d’un mythe doit être enlevé, arraché à sa personnalité habituelle, et doit, comme pour chaque rite sacrificiel, devenir un dieu le temps du rite, et revenir à soi seulement lorsque le rite est achevé, lorsque l’épiphanie tend à sa fin et que le rideau se baisse. Nous devons rappeler qu’à l’origine de toutes les manifestations artistiques étaient des rites, et que le but du rite (…) est de sacrifier l’homme déclinant pour en faire renaître un autre, plus parfait” [GB 20-21]. Saint Thomas considérait que “l’art est l’imitation de la nature dans sa façon d’opérer”. Mais pour trouver la nature, “il faut briser toutes les formes de celle-ci”, comme l’énonçait Maître Eckhart. L’œuvre d’art peut alors se définir comme “l’équilibre polaire entre le physique et le métaphysique” (W. Andrae) [GB 194]. Selon Coomaraswamy, “un art naturaliste purement visuel (c’est-à-dire provoquant des sensations identiques à celles produites par son modèle visible), uniquement destiné à l’expérience des sens, est non seulement irréligieux et idolâtre (l’idolâtrie désignant l’amour des créatures en elles-mêmes), mais aussi irrationnel et vague” [TN 95]. L’art, toujours impersonnel, doit représenter des archétypes. La copie d’un objet est copie d’une copie, c’est-à-dire l’opposé de la création artistique véritable, qui est expression d’une Idée (au sens platonicien du terme) et non idéalisation d’un fait. La beauté entendue comme essentialité, harmonie, équilibre, unité formelle, a déserté notre univers de décorations “autothétiques”, replié sur lui-même. Cet art subjectif est le miroir où se reflète une conception individualiste et mécaniciste du monde. La valeur de l’art véritable réside dans le symbole, et sa force dans l’union intime de la signification et de l’utilité. “Les œuvres d’art sont des moyens créés par l’artiste pour répondre aux besoins du commun, consommateur ou spectateur. La production des œuvres d’art n’est jamais une fin en soi” [GB 75]. Ce but transcende la simple expressivité. L’originalité et la créativité ne se justifient pas sur un plan purement esthétique (”l’art pour l’art”), mais se jugent par l’utilisation qui en est faite, c’est-à-dire qu’elles deviennent légitimes lorsque des exigences nouvelles surgissent de leur contemplation.
Dans les civilisations traditionnelles — hindoue, chinoise, paléo-grecque, chrétienne médiévale, égyptienne, maori, amérindienne, pour reprendre les exemples étudiés par Coomaraswamy —, il existait une “maîtrise” de soi-même qui n’était pas une censure intériorisée, mais dérivait de l’intime adhésion de l’artiste à une conception sacrée du monde, pour laquelle la fidélité à certains canons était “normale”, spontanée [CI 93]. La scission entre “signification” et “utilité” a accouché de l’art moderne “excentrique”, réduit à une signification autoréférentielle devenue indicible aux hommes alors que l’utilité est désormais confiée à la brutale fonctionnalité de la technique. “Notre civilisation contemporaine peut légitimement être qualifiée d’inhumaine et ne peut qu’être dépréciée si on la compare aux cultures primitives dans lesquelles, comme les anthropologues nous l’assurent, les exigences du corps et de l’âme sont satisfaites en même temps. La production vouée à la seule satisfaction des besoins corporels est la malédiction de la civilisation moderne” [GB 29]. Spiritualité et matérialité ne doivent pas être scindés, et Coomaraswamy condamne sans appel les enseignements prodigués “dans les sections des beaux-arts de nos universités” — qu’il qualifie de “palabres” [GB 43]. Un jugement tranché qui l’isola de nombreux milieux académiques. Mais pouvait-il en être autrement pour cet admirateur de l’art paléolithique et “des dessins exécutés avec du sable par les Indiens d’Amérique, qui sont, du point de vue intellectuel, de qualité supérieure à n’importe quelle peinture produite en Occident durant les deux derniers siècles” [24] ?
Le sacrement de l’autorité
Il est enfin une facette moins connue de la personnalité de Coomaraswamy : sa réflexion “politique”, principalement exposée dans un ouvrage au titre guénonien, Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne de gouvernement [AS]. Cet essai propose une exégèse attentive de l’approche hindoue de “l’autorité légitime”. Dans Hindouisme et bouddhisme, Coomaraswamy soulignait déjà : “La politique des communautés céleste, sociale et individuelle, est gouvernée par la même et unique loi” [IB 78]. En effet, selon la conception traditionnelle de l’ordre, il n’existe pas de scission ni d’opposition entre ce qui est intérieur (l’ordre spirituel présent en chaque homme) et ce qui est extérieur (la sphère politique), ces deux domaines s’influençant réciproquement au sein d’une même “loi sapientielle”. Coomaraswamy souligne en contrepoint la congruence de l’individualisme (”négation de tous principes supérieurs à l’individualité”) et de l’anthropocentrisme (”réduction de la civilisation, dans tous les domaines, aux seuls éléments purement humains”, selon la définition de Guénon). Ce double mouvement a entraîné la désacralisation de la société et du politique. “Le mirage de la liberté individuelle est l’antithèse parfaite du summum bonum, ce bien souverain qui représente la véritable liberté, une libération de soi et non une liberté pour soi” [AS 115]. Selon la perspective cyclique, cette décadence se rattache au développement d’une conception “prométhéenne” de la liberté. Cette dernière se confond avec l’affirmation hypertrophiée du moi, indifférente à toute valeur supérieure. Aucune politique ne peut sérieusement prétendre contrecarrer ce mouvement si elle n’impose l’ordre extérieur de sa propre réalité intérieure : prédominance de “l’intuition intellectuelle” (supra-individuelle) sur la sphère psycho-émotionnelle, et de cette dernière sur la dimension organique et physique. Telle est la base de l’autorité légitime. Selon Coomaraswamy (et Guénon, les deux penseurs s’opposant sur ce point à Julius Evola), la caste sacerdotale doit se situer au sommet de la pyramide sociale. Son rôle “pontifical” suppose une connaissance effective de type sapientiel, ésotérique — aux antipodes, évidemment, de la caricature de sacerdoce qu’incarne un clergé catholique rabaissé au rang d’administrateur d’un moralisme paroissial.
Coomaraswamy, se fondant sur la lecture des textes hindous (notamment les Upanishads) mais également bouddhistes (l’Anguttara Nikaya), renverse par ailleurs l’idée préconçue selon laquelle le guerrier incarne, dans les sociétés traditionnelles, le principe de virilité. Il soutient au contraire que la fonction sacerdotale, contemplative, autocentrée, appartient au type masculin, tandis que l’ordre militaire, actif, hétérocentré (car soumis au sacerdoce), est de type féminin. Le schéma triparti, mis en lumière depuis par les études de Georges Dumézil ou de Jean Haudry, renfermait probablement une signification androgynique : son caractère totalisant réunissait dans un même corps les principes masculin (première fonction) et féminin (deuxième et troisième fonctions).
L’ordre traditionnel est évidemment fort éloigné des monarchies constitutionnelles de notre temps. Selon Coomaraswamy, “le discrédit dont souffre la monarchie, mais aussi le pouvoir spirituel, est la conséquence d’une évolution moderne, essentiellement prolétarienne et matérialiste” [AS 89]. Il refusait ainsi l’assimilation si fréquente de la royauté de droit divin et de la tyrannie : “Si le monarque oriental et traditionnel n’est pas un roi constitutionnel (…) ni un roi qui tient son pouvoir d’un quelconque contrat social, mais un souverain de droit divin, cela n’implique nullement qu’il ait un pouvoir absolu ; au contraire, il est sujet d’un autre roi (…) la Loi (…) principe même de la royauté” [AS 31]. Cette Loi, ce sont les normes qui président à l’exercice de tout pouvoir temporel et qui sont dictées par la caste sacerdotale.
La qualité exceptionnelle des travaux de Coomaraswamy faisait dire à Seyyed Hossein Nasr qu’”il exerça une influence considérable sur un grand nombre de chercheurs et de penseurs — qu’ils soient historiens d’art ou scientifiques —, influence qui perdure aujourd’hui” [25]. Une pensée aussi complexe mériterait bien sûr un commentaire plus précis que cette brève présentation. Nous la conclurons en rendant un ultime hommage à la logique transparente et à la cohérence rigoureuse des travaux de Coomaraswamy, chez qui le refus des compromis ne se traduisait pas par l’intolérance et le sectarisme, mais par une exigence supérieure de l’esprit. Une bouffée d’air pur, en notre époque trouble de totalitarisme “doux”.
► Giovanni Monastra, Nouvelle École n°47, 1995. [version PDF]
[traduit de l’italien par Stefano Castelli, texte tiré de Futuro Presente n°3, 1993]
• Abréviations :
AS : Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne de gouvernement, Arché, 1985. [Au sujet de ce texte, nous signalons une excellente étude de Philippe Baillet, I fondamenti della politica tradizionale, éd. di Ar, 1987]
CI : Come interpretare un’opera d’arte, Rusconi, 1977.
DS : The Dance of Siva, Dover Publications, New York 1985.
GB : Il Grande Brivido : Saggi di simbolica e arte, AKC, Adelphi, 1987. [édition italienne du recueil Selected Papers I : Traditional Art and Symbolism, 1978. En 2017 est paru le second volume : La tenebra divina : Saggi di metafisica]
IB : Induismo e Buddismo, AKC, Rusconi, 1973. [Hinduism and Buddhism]
M : Selected Papers II : Metaphysics, Princeton Univ. Press, 1978.
SL : Selected Letters of AK Coomaraswamy, A. Moore (ed.), Oxford Univ. Press, 1988.
SO : Sapienza orientale e cultura occidentale, AKC, Rusconi, 1975. [édition italienne de Suis-je le gardien de mon frère]
TN : La trasfigurazione della natura nell’arte, Rusconi, 1976. [The Transformation of Nature in Art, 1934]
⬨ Giovanni Monastra est né en 1952. Docteur en biologie, il a soutenu une thèse d’Anthropologie physique à l’université de Padoue en 1981. Depuis 1983, il travaille pour une firme pharmaceutique de la Vénétie. Il a effectué plusieurs recherches sur la biochimie des neurotransmetteurs, avant de passer une année (1990) à la Yeshiva University (New York) en qualité de Visiting Assistant Professor. Il a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues italiennes et étrangères. Auteur d’une longue préface au livre du paléontologue Roberto Fondi, La Révolution organiciste : Entretien sur les nouveaux courants scientifiques (Labyrinthe, 1986), il collabore à plusieurs revues culturelles italiennes, dont notamment Diorama letterario, Trasgressioni et Futuro Presente, ainsi qu’à la revue américaine Sophia : A Journal of Traditional Studies, dirigée par le professeur Seyyed Hossein Nasr. Giovanni Monastra poursuit actuellement des recherches en immuno-pharmacologie et prépare un livre sur la vie et l’œuvre du penseur traditionaliste anglo-indien Ananda Kentish Coomaraswamy. Des articles de lui, traduits en français, ont paru dans les revues Politica Hermetica, Krisis et Nouvelle École. Il a aussi collaboré au récent “Dossier H” consacré à Julius Evola (L’Âge d’Homme, 1997).
• Notes
01. Roger Lipsey, Coomaraswamy : his Life and Work, Bollingen Series LXXXIX, Princeton Univ. Press, 1977, pp. 11-13. Pour les informations biographiques, cf. également l’excellent ouvrage du Dr Rama Coomaraswamy, Ananda K. Coomaraswamy, Bibliography/Index, Prologos Books, 1988.
 02. AK Coomaraswamy, Borrowed Plumes, publié en cent exemplaires par l’Industrial School de Kandy (Ceylan), 1905, pp. 6-7 (copie gracieusement mise à notre disposition par le Dr Rama Coomaraswamy). [À titre anecdotique, cette scène servit d’ouverture à un court brûlot : Do Clothes Make the Person ? (2004), tiré du chapitre 7 de The Way and the Mountain (M. Pallis, 1960) et repris dans les recueils pérennialistes Every branch in me (2002) et The Underlying Religion, 2007. L’auteur y décrit le rôle important de l’habillement traditionnel, qui implique une “participation symbolique” à une tradition religieuse. Il illustre les effets psychologiques négatifs qui ont été utilisés historiquement et politiquement par le biais de manœuvres politiques stratégiques (par ex. en Russie et en Chine) et la manière dont la modernité “progressiste” a catalysé une division symbolique de l’Absolu. De nos jours, nous pouvons réfléchir à l’impact du passage de l’habillement traditionnel à l’habillement occidental moderne, par ex. dans les habitudes des nonnes et des moines contemporains dans leur participation au monde séculier]
02. AK Coomaraswamy, Borrowed Plumes, publié en cent exemplaires par l’Industrial School de Kandy (Ceylan), 1905, pp. 6-7 (copie gracieusement mise à notre disposition par le Dr Rama Coomaraswamy). [À titre anecdotique, cette scène servit d’ouverture à un court brûlot : Do Clothes Make the Person ? (2004), tiré du chapitre 7 de The Way and the Mountain (M. Pallis, 1960) et repris dans les recueils pérennialistes Every branch in me (2002) et The Underlying Religion, 2007. L’auteur y décrit le rôle important de l’habillement traditionnel, qui implique une “participation symbolique” à une tradition religieuse. Il illustre les effets psychologiques négatifs qui ont été utilisés historiquement et politiquement par le biais de manœuvres politiques stratégiques (par ex. en Russie et en Chine) et la manière dont la modernité “progressiste” a catalysé une division symbolique de l’Absolu. De nos jours, nous pouvons réfléchir à l’impact du passage de l’habillement traditionnel à l’habillement occidental moderne, par ex. dans les habitudes des nonnes et des moines contemporains dans leur participation au monde séculier] 03. “La religion en Orient — écrit-il en 1908 dans The Ceylon National Review — n’est pas, comme en Occident, une formule ou une doctrine, mais une manière de regarder le monde et celle-ci inclut toute la vie, de sorte qu’il n’y a pas de division entre le sacré et le profane”.
04. Rappelons que Coomaraswamy introduisit les idées d’Evola dans le monde anglo-saxon. Récemment le Dr Rama Coomaraswamy nous a informé qu’il existait une correspondance entre son père et Evola, à l’époque où ce dernier lui fit parvenir Révolte contre le monde moderne, mais également La tradition hermétique et Le mystère du Graal.
 05. Myths of the Hindus and Buddhists. L’œuvre, commencée par Sœur Nivédita disciple de Svami Vivekananda [1863-1902, réformateur de l’hindouisme dans la modernité indienne], morte prématurément en 1911, fut achevée par Coomaraswamy.
05. Myths of the Hindus and Buddhists. L’œuvre, commencée par Sœur Nivédita disciple de Svami Vivekananda [1863-1902, réformateur de l’hindouisme dans la modernité indienne], morte prématurément en 1911, fut achevée par Coomaraswamy. [Elizabeth Noble (1867-1911) : Née dans une famille irlandaise, elle adopte la vocation d’enseignante, adhérant aux idées du New Education Movement qui balaie alors l’Europe. La rencontre de Vivekananda à Londres en 1895 bouleverse sa vie. Trois ans plus tard, elle part s’installer définitivement en Inde. Swami Vivekananda lui donne le nom de Nivedita (qui signifie "Dédiée à Dieu") lorsqu'il l'initia au vœu de Brahmacharya le 25 Mars 1898. Elle s’y occupe de l’éducation des filles et des femmes, ouvrant pour elles une petite école à Calcutta, et participe aux secours humanitaires pendant les épidémies et les famines. Elle se joint aussi au mouvement nationaliste indien en s’opposant à la partition du Bengale (1905) et en soutenant, par ses écrits et conférences, le mouvement Swadeshi qui appelle au boycott des produits britanniques importés au profit de produits artisanaux fabriqués dans le pays. Nivedita publie nombre d’ouvrages sur l’histoire indienne, la condition des femmes, l’éducation, l’art et la mythologie et aussi des articles dans les presses indienne et britannique.
On lira avec profit « Indian art » (in : Œuvres Complètes, vol. 3). Elle rencontra en 1902 Aurobindo, considéré par elle comme le “Mazzini du Bengale” (cf. Sister Nivedita & Sri Aurobindo, P. Nandakumar, 2017). Il reviendra ultérieurement sur sa démarche compréhensive de la dimension civilisationnelle : « Une culture ou une civilisation étrangères peuvent être considérées de diverses manières : nous pouvons jeter sur elles un regard intuitif et plein de sympathie, et, étroitement identifiés à elles, apprécier leurs qualités ; c’est l’approche qu’a choisie Sister Nivédita dans son Web of Indian Life [1904, présentation], ou M. Fielding dans son ouvrage sur la Birmanie, ou encore sir John Woodroffe dans ses études sur le Tantra. Essayant d’écarter tous les voiles afin que l’âme d’un peuple se révèle à nos yeux, ces observateurs ne nous communiquent peut-être pas tous les faits extérieurs et tangibles ; par contre, ils nous enseignent quelque chose de plus profond, de plus réel ; non point la chose en elle-même, saisie dans l’imperfection de la vie, mais sa signification idéale. L’âme, l’esprit essentiel est une chose, les formes qu’il assume dans l’âpre réalité humaine en sont une autre, souvent imparfaite et pervertie » (Les Fondements de la culture indienne, 1923).
Pour approfondir : « L’école du Bengale : échanges idéologiques et artistiques dans le Bengale du début du XXe s. », Marie Planchot, 2021 (version html). On notera aussi, dans ce contexte, l'influence d’Okakura Kakuzō (à l'initiative du mouvement nihonga). Comme le note Inaga Shigemi : « le premier livre d’Okakura publié en anglais, The Ideals of the East (1905) fut préfacé par “Sœur Nivédita de la Mission Ramakrishna”. La vision d’Okakura devait servir à Nivedita d’assise idéologique et de force motrice dans la construction d’une identité nationale en Inde moderne. C’est dans le concept d’unité organique (one-ness) que Nivedita trouva ce qu'elle appela une “force syncrétique toute-puissante” (all-pervasive syncretic force) permettant de réaliser la “synthèse indienne” sous l’égide de l’hindouisme modernisé. La déclaration célèbre d’Okakura à l’ouverture de cet ouvrage : “L’Asie est une” (Asia is one), a servi de slogan politique qu’il s’agissait de réaliser dans une Inde divisée par le règne colonial de l’Empire britannique » (in : Approches critiques de la pensée japonaise du XX e siècle, 2018 ; cf. aussi « Sister Nivedita and Art Criticism », Japan Review n°16, 2004 et « “That Great Ocean of Idealism” : Calcutta, the Tagore Circle, and the Idea of Asia, 1900–1920 », Mark Ravinder Frost, in : Indian Ocean Studies, Routledge, 2010]
06. Art and Swadeshi, Madras 1911, pp. 3-4, cité in : Coomaraswamy : his Life and his Work, op. cit., p. 89.
07. Pour mieux connaître le mouvement transcendantaliste américain, on consultera Ralph W. Emerson, Il trascendentalista, Mondadori, 1989 ; Henry D. Thoreau, La désobéissance civile, Climats, 1992 ; Marcher, Terradou, 1991 ; Walden ou la vie dans les bois, L’Âge d’Homme, 1990 ; Walt Whitman, Feuilles d’arbre, 2 vol., Grasset, 1994 ; Comme des baies de genévrier : feuilles de carnet, Mercure de France, 1993. Pour un aperçu critique : Stanley Carrell, Statuts d’Emerson : Constitution, philosophie, politique, Éclat, 1992.
08. Coomaraswamy : his Life and his Work, op. cit., p. 161.
 09. Marco Pallis (1895-1989) est un représentant important du courant de pensée “traditionnel” : musicien et compositeur, alpiniste, traducteur, métaphysicien, il adhéra au bouddhisme, dont il connut personnellement de nombreux représentants vivants dans les pays himalayens. Il a laissé des textes comme Il loto e la croce, Borla, Torino, 1969 ; The Way and the Mountain, 1960 [trad. fr. : La Voie et la Montagne : Quête spirituelle et bouddhisme tibétain, Harmattan, 2010] ; Peaks and Lamas, 1939. Ce dernier essai fut très apprécié par Coomaraswamy et Guénon. Signalons également un article fort instructif, “A fateful meeting of minds : AK Coomaraswamy and R. Guénon”, in : Studies in Comparative Religion, I, 1978, pp. 176-188, consacré à l’étude des convergences et des divergences entre les deux spécialistes de la Tradition.
09. Marco Pallis (1895-1989) est un représentant important du courant de pensée “traditionnel” : musicien et compositeur, alpiniste, traducteur, métaphysicien, il adhéra au bouddhisme, dont il connut personnellement de nombreux représentants vivants dans les pays himalayens. Il a laissé des textes comme Il loto e la croce, Borla, Torino, 1969 ; The Way and the Mountain, 1960 [trad. fr. : La Voie et la Montagne : Quête spirituelle et bouddhisme tibétain, Harmattan, 2010] ; Peaks and Lamas, 1939. Ce dernier essai fut très apprécié par Coomaraswamy et Guénon. Signalons également un article fort instructif, “A fateful meeting of minds : AK Coomaraswamy and R. Guénon”, in : Studies in Comparative Religion, I, 1978, pp. 176-188, consacré à l’étude des convergences et des divergences entre les deux spécialistes de la Tradition. Si anattā (non-moi) s’est trouvé en opposition avec quelque autre conception qui lui barrait la route, celle-ci doit sûrement être cherchée dans ce que la tradition hindoue a de meilleur du point de vue intellectuel, c’est-à-dire dans le monde des Upanishads où cette idée d’un soi transcendant, que le Vedanta shankarien allait plus tard systématiser, est déjà énoncée dans tous ses éléments essentiels. Parmi les auteurs les plus importants qui ont traité ce sujet en notre siècle, on peut en citer deux qui représentent des positions différentes : René Guénon et Ananda K. Coomaraswamy. Le premier s’était signalé dans les années 20 par deux livres remarquables sur l’Hindouisme dont l’intention était d’aider l’Occident à retrouver une dimension de connaissance dont la théologie chrétienne avait perdu l’accès depuis des siècles. Le nouvel enthousiasme du jeune Guénon pour la sagesse védantine telle que le grand Shankaracharya l’a exposée le conduisit à rejeter anattā et avec celui-ci le Bouddhisme tout entier considéré comme rien de plus qu’une ride d’hérésie sur l’océan de l’intellectualité hindoue ; le fait de ne pas avoir consulté de textes bouddhistes parallèles fut responsable de la conclusion hâtive à laquelle il tint obstinément pendant un temps. Plus tard, cependant, avec l’appui de AK Coomaraswamy dont il admirait l’érudition lucide doublée d’un respect scrupuleux pour l’autorité de la tradition, j’approchai Guénon, et le résultat fut qu’il accepta d’éliminer de ses ouvrages publiés les passages antibouddhistes contestables, décision dont on ne cessera jamais de lui être reconnaissant. C’est un épisode de mes jeunes années auquel je pense avec une gratitude particulière ; sans cette expérience, je ne sais pas si je me serais risqué à traiter d'une question aussi délicate que celle d’anattā dans ses relations avec l’Hindouisme et, de façon générale, avec les religions théistes.
Pour ce qui est de Coomaraswamy, ses conclusions se situaient exactement à l’opposé de celles de Guénon, vu qu’à l’époque de sa plus grande maturité ses commentaires avaient été fort influencés par la volonté de démontrer la thèse selon laquelle les enseignements du Bouddha sur la connaissance de soi se rapprochaient pour l’essentiel de celles du Brahmanisme, malgré certaines différences d’expression. Les idées de Coomaraswamy sur ce sujet se développèrent jusqu’à minimiser l’originalité intrinsèque du dharma du Bouddha dans l’intérêt d’un universalisme hindou quelque peu artificiel. À l’appui de cette thèse, il faisait pencher les plateaux de la balance dans le sens d’une pétition de principe en recourant à un expédient visuel que seules les langues européennes modernes ont rendu possible mais que celles de l’Orient excluent entièrement, c’est-à-dire en utilisant les deux formes “soi” et “Soi”, de manière à établir une distinction automatique entre le soi empirique, ou ego, siège de la pensée illusoire, et le véritable principe transcendant d’ipséité vers lequel tend toute expérience contemplative. Un tel procédé peut à la rigueur se justifier lorsque l’on traite isolément du Vedanta ou d’un autre thème semblable ; mais l’introduire dans un contexte bouddhique est à la fois impropre techniquement et fallacieux à long terme. Outre l’objection linguistique que l’on vient de formuler, cet artifice de transcription présente le sérieux inconvénient d’éliminer l’ambiguïté s’attachant aux divers moyens d’utiliser le mot “soi”, ambiguïté qui, en fait, est essentielle pour toute discussion de cette quesion, ne serait-ce que parce qu’elle correspond étroitement à notre expérience humaine. Qui est le véritable soi ? Seul le contexte est capable de montrer de quel soi il s’agit dans un cas donné ; c’est aussi vrai des formulations écrites que de la vie. Anticiper arbitrairement sur la conclusion en dérobant au mot clé son caractère incertain ne revient qu’à embrouiller la question encore davantage. A. Coomaraswamy et R. Guénon furent tous deux de grands hommes à qui notre génération doit beaucoup ; si je les ai quelque peu critiqués dans la circonstance présente, c’est parce que cela m’a donné la possibilité de faire ressortir qu'une certaine indéfinité s’attache au mot “soi” dans son usage courant, fait qui, envisagé avec attention à chaque occasion qui se présente, deviendra lui-même un facteur d’illumination et non le contraire.
► Marco Pallis, Lumières bouddhiques, Fayard, 1983]
10. SL, p. 26. Pour sa part, Marco Pallis voyait en Guénon et Coomaraswamy deux “pôles opposés”, aboutissant à des conclusions similaires par des raisonnements fort différents (”A Fateful Meeting…”, art. cit., pp. 178-179). Un autre spécialiste des doctrines sapientielles, Martin Lings, a insisté sur la complémentarité des deux personnages : “Si nous voulons résumer le sens de l’œuvre de Coomaraswamy par le terme vérité, celle de Guénon pourrait être illustrée par le mot orthodoxie. En lisant Guénon, nous ne perdons presque jamais la sensation de force entraînante qui se dégage de sa plume (…) l’intention ou l’espoir de (…) pousser une minorité qualifiée à entreprendre une action effective dans le domaine du transcendant. Ce propos fut sans doute également présent chez Coomaraswamy, mais le lecteur en est moins conscient. La première impression est celle d’un vaste enchevêtrement de vérités métaphysiques et cosmologiques, qui poussent l’intelligence dans ses dernières limites, l’élargissant, l’illuminant et la préparant à l’action spirituelle qui constitue le complément de la doctrine ; ce complément a tendance à être implicite chez Coomaraswamy, tandis qu’il est manifeste chez Guénon” (The Eleventh Hour, Quinta Essentia, Cambridge, 1987, pp. 88-89) [trad. : La Onzième Heure, 2001 ; du même auteur : Croyances anciennes et superstitions modernes, 1987].
11. Paul Chacornac, La vie simple de René Guénon, éd. Traditionnelles, 1978, p. 112.
12. AK Coomaraswamy, Buddha and The Gospel of Buddhism, Citadel Press, Secausus 1988, pp. 2-3 (éd. fr. : La pensée de Gotama, le Bouddha, Pardès, 1993)
13. Ibid., par ex. p. 179.
14. Cf. Fritjof Capra, Il tao della fisica, Adelphi, 1982 (éd. fr. Le Tao de la physique, Sand, 1989).
15. A Lecture on Comparative Religion, 1944 (inédit), cité in : Coomaraswamy…, op. cit., p. 276.
16. Cf. par ex. Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Adelphi, 1986.
17. AK Coomaraswamy, Time and Eternity, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1988, p. 139 (éd. fr. : Le Temps et l’Éternité, Dervy, 1976)
18. AK Coomaraswamy, What is Civilization ?, Lindisfarne Press, 1989, p. 72.
19. What is Civilization ?, op. cit., pp. 15-16.
20. AK Coomaraswamy, préface à l’Introduzione all’arte ed alla mitologia dell’India, Salamandra, 1984, p. 13.
21. Time and Eternity, op. cit., p. 7.
22. G. Marchianò, L’Armonia estetica, Dedalo, Bari 1974, p. 57. [Cf. sa préface à Tempo ed eternità, 1996, recension]
23. Hans Sedlmayr, La morte della luce, Rusconi, 1970 ; La perdita del centro, Rusconi, 1974.
24. Sir Gawain e il Cavaliere Verde, op. cit., p. 162.
25. Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred, State University of New York Press, 1989, p. 106 [trad. La Connaissance et le sacré, L'Âge d'Homme, 1999]. Mircea Eliade a écrit : “Il ne fait aucun doute qu’Ananda Coomaraswamy a été l’un des spécialistes les plus érudits et les plus créatifs du siècle” (Spezzare il tetto della casa, Jaca Books, 1988, p. 209 [Briser le toit de la maison la créativité et ses symboles, 1986]), tandis qu’un rédacteur anonyme (Guénon ?) de la revue Études traditionnelles (n°265, 1948), qui commémorait sa disparition, le définissait comme “l’un de ses collaborateurs les plus valables” et “un excellent serviteur de la Vérité”.
***
 • nota bene : Outre l'encadré de Monastra (cf pdf article), on pourra se reporter à Coomaraswamy on Evola’s Revolt (Gornahoor, 2012) ainsi qu’à l’introduction d’AKC au chapitre “Man and Woman”, in : The Visva-Bharati Quarterly vol. V, 1940, p. 305 sq.. Dans un écrit ultérieur (Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne du gouvernement, 1942), AKC renouvelle son désaccord sur la thèse de la royauté comme primant sur le sacerdoce :
• nota bene : Outre l'encadré de Monastra (cf pdf article), on pourra se reporter à Coomaraswamy on Evola’s Revolt (Gornahoor, 2012) ainsi qu’à l’introduction d’AKC au chapitre “Man and Woman”, in : The Visva-Bharati Quarterly vol. V, 1940, p. 305 sq.. Dans un écrit ultérieur (Autorité spirituelle et pouvoir temporel dans la perspective indienne du gouvernement, 1942), AKC renouvelle son désaccord sur la thèse de la royauté comme primant sur le sacerdoce :« La thèse que développe Evola dans l’étude sur la Royauté le conduit à donner une mauvaise interprétation de l’Aitareya brahmana VIII, 27. S’il n’en avait pas été ainsi, son admirable chapitre “Homme et femme” qui traite de la vraie relation entre le Sacerdoce et la Royauté — soit à peu près entre l’Église et l’État — aurait eu une portée bien plus grande. Telle qu’elle se présente, l’argumentation d’Evola, en faveur de la supériorité de la Royauté, principe actif, sur le Sacerdoce, principe contemplatif, est une concession au “monde moderne” contre lequel s’élève sa polémique.
Son argumentation est une perversion de la doctrine grecque comme de la doctrine indienne. Dans la tradition grecque, l’espèce héroïque — ou caste, Ghenos-jati — dans l’âme comme dans la Communauté — “cette partie de notre âme qui est douée de force virile (andreia – skt. virya) et de courage (thymos, skt dhu) et qui désire la victoire (philonikeia - skt. jisnu)” (Platon, Timée 70a) — est la meilleure part de l’âme mortelle ou animale, supérieure à l’autre part qui est l’appétit et inférieure à la partie spirituelle et immortelle qui se trouve dans la loi. Son siège est dans le cœur, entre les intestins et la tête ; celle-ci est le défenseur de la communauté entière ; sa fonction est d’écouter la Voix (Logos) de l’Acropole, de servir (yperétein) et de coopérer dans la guerre (synmakhi einai) avec le principe sacré, contre la meute des appétits qui sont en nous ou des incitations (vulgaires) de la cité.
Les trois parties de l’âme — ou du corps politique — correspondant de manière évidente, hiérarchiquement, à brahma, kshatra et vis, respectivement le Sacerdoce, la Royauté et le Peuple dans la tradition védique — dans laquelle le çudra est représenté par les Asuras) ; et il n’est pas permis de douter de la supériorité du caractère sacré sur le caractère royal. Que l’autorité spirituelle, le hieron de Platon soit aussi le dominant, l’arkhon, de la même manière que le brahma “est en même temps brahma et kshatra” signifie en réalité que le Pouvoir Suprême est un pouvoir, tout ensemble, royal et sacerdotal, mais ceci ne veut certainement pas dire que le kshatra, pris isolément du brahma, soit en soi l’autorité suprême ou autre chose que son agent et serviteur. Dans son livre Les castes (1938, p. 65), A. M. Hocart renouvelle l’erreur d’Evola quand il affirme “l’homme et son épouse sont le ciel et la terre, de la même manière que le roi l’est du prêtre” alors qu’il aurait dû écrire : “de la même manière que le prêtre l’est du roi” ».
Lire aussi un autre extrait de ce texte. Commentaires : « Le problème du pouvoir suprême », T. Jolif, in : Evola envers et contre tous, Avatar, 2010 ; les dernières pages du texte polémique de Jean-Louis Gabin « René Guénon contre “l’extrême droite” et les idéologies modernes », 2010. Pour une approche critique : « Pouvoir et autorité », Jean Moncelon.
***
⬨ Pour prolonger :
• « Perennial values against modern decadence », Brian Keeble, Studies in Comparative Religion n°1 & 2, 1979
• La globalisation du “traditionalisme” (M. Toti, 2007)
 • De la Philosophia perennis au pérennialisme américain (Setareh Houman, Archè, 2010). Traduction anglo-américaine : From the Philosophia Perennis to American Perennialism, 2014. Après un rappel historique des racines du pérennialisme nord-américain, depuis la Renaissance, les quêtes romantiques et transcendantalistes jusqu'au théosophisme moderne, S. Houman retrace l'histoire de ce courant aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle aux années 2000. Elle en décrit les manifestations, fait état des débats qu'il suscite et soulève des interrogations. — Présentation éditeur :
• De la Philosophia perennis au pérennialisme américain (Setareh Houman, Archè, 2010). Traduction anglo-américaine : From the Philosophia Perennis to American Perennialism, 2014. Après un rappel historique des racines du pérennialisme nord-américain, depuis la Renaissance, les quêtes romantiques et transcendantalistes jusqu'au théosophisme moderne, S. Houman retrace l'histoire de ce courant aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle aux années 2000. Elle en décrit les manifestations, fait état des débats qu'il suscite et soulève des interrogations. — Présentation éditeur :La quête d’une sagesse d'origine non humaine, immuable dans son essence, transmise depuis l'aube de l'humanité mais morcelée et perdue en partie, est un thème récurrent dans l'histoire de l'ésotérisme occidental. Il s'est exprimé, notamment, au début du XXe siècle dans une forme de pensée appelée “traditionalisme” (“l’École Traditionnelle”), surtout à partir du moment où le Français René Guénon s'en fit le porte-parole avec ses écrits anti-modernistes. Le terme “pérennialisme” (perennialism) est synonyme, mais on l'emploie plus spécifiquement à propos de la forme prise aux États-Unis par cette pensée, dont Coomaraswamy, Frithjof Schuon, Seyyed Hossein Nasr, Huston Smith, et une seconde génération d'auteurs, comme James Cutsinger, figurent parmi les principaux représentants. Après un développement introductif consacré aux racines du pérennialisme nord-américain — depuis la Renaissance jusqu'au théosophisme moderne et l'œuvre d'un Ananda K. Coomaraswamy, en passant par les quêtes romantiques et transcendantalistes d'une lumière venue d'Orient —, l’auteur présente l'histoire de ce courant proprement dit aux États-Unis depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Elle en décrit les diverses manifestations, notamment au sein de milieux tant académiques qu'artistiques, et fait état des débats qu'il a suscités et continue à susciter. Enfin, elle en souligne certains aspects problématiques, en les soumettant à une interrogation de type historico-critique.
Son ouvrage constitue un apport richement documenté, qualitativement stimulant, aux études et réflexions portant non seulement sur la culture et civilisation nord-américaines en particulier, mais aussi sur un aspect non négligeable du paysage philosophique contemporain en général. Aussi ne saurait-il manquer de retenir l'attention de nombreux lecteurs, d'autant que la précision dans l'articulation du discours se trouve rehaussée par une langue claire et élégante de bout en bout. La monographie de Setareh Houman consacrée au pérennialisme est une lecture indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à l'étude de ce sujet dans une perspective critique et historique. Bien organisée, reposant sur une recherche solide des sources documentaires y relatives, et d'une écriture aisée, cette étude est la première à ne pas seulement situer le mouvement pérennialiste américain dans le contexte historique qui lui est propre, mais aussi à en analyser, dans le détail, la vision du monde. Alors que la littérature consacrée au pérennialisme tend, la plupart du temps, à être marquée par un esprit partisan et des programmes de type apologétique, le Dr. Houman aborde son objet dans un esprit qui allie la générosité et le respect à la rigueur et à la précision académiques. Je recommande chaleureusement cet ouvrage à quiconque désire comprendre.

 Ananda K. Coomaraswamy et la “philosophia perennis”
Ananda K. Coomaraswamy et la “philosophia perennis”[Ci-contre : buste en bronze d’AKC par par Arnold H. Ronnebeck, 1929]
On doit féliciter Roger Lipsey pour sa summa en trois volumes, somptueusement éditée par la Princeton University Press (1). Ananda K. Coomaraswamy était un écrivain prolifique et, dans les quinze dernières années de sa vie, plutôt difficile. Il aimait contribuer à des périodiques obscurs en Inde, au Portugal, en France, en Roumanie et en Tchécoslovaquie. De plus, quoique bien connu comme historien de l’art indien et orientaliste, il distribuait ses innombrables articles dans des revues consacrées aux études médiévales (Speculum), à l’histoire de la science (Isis), aux langues modernes (Papers of Modern Languages Association), à la critique littéraire (Criterium), à l’histoire des religions (Review of Religion ; Zalmoxis ; Revue des études religieuses), à l’hermétisme (Études traditionnelles) ou à la psychologie pathologique (Psychiatry). On est tenté de penser que Coomaraswamy multipliait à dessein les obstacles sur le chemin de ses lecteurs les plus fidèles. Finalement, il décida de réunir ses articles, mais il ne publia qu’un seul volume (Figures of Speech or Figures of Thought) et assez tardivement — en 1946, un an avant sa mort. La plupart de ses essais les plus tardifs et les plus significatifs étaient presque impossibles à consulter hors des bibliothèques des grandes universités américaines ; certains d’entre eux étaient littéralement inaccessibles. En conséquence, pendant plus d’un quart de siècle Coomaraswamy fut absent de la confrontation et des débats de la “culture vivante”.
Quoiqu’il ait bâti sa réputation sur ses premiers livres — Mediaeval Sinhalese Art (1908), Arts and Crafts of India and Ceylon (1913) et plus spécialement Rajput Painting (1916) — et soit devenu de plus en plus connu et respecté parmi les orientalistes et les historiens de la culture après 1917 (quand il fut nommé Conservateur du Département d’art indien au Musée des Beaux-Arts de Boston), il ne goûta qu’une seule fois au plaisir d’être un “auteur à succès”, et ce fut pour une mauvaise raison. En 1922, Madeleine Rolland traduisit en français la Danse de Shiva, qui parut avec une longue préface enthousiaste de Romain Rolland (3). Le grand prestige de l’auteur de Jean-Christophe fit de ce choix d’essais un best-seller et la Danse de Shiva fut chaudement discutée dans tous les hebdomadaires littéraires européens, de Lisbonne et de Rome jusqu’à Athènes, Bucarest et Varsovie. À cette époque toutefois (1922-1925), la plupart de ces essais ne représentaient plus guère les nouvelles idées et les nouveaux intérêts de Coomaraswamy.
Sa première biographie, bien documentée et brillamment écrite par Lipsey, présente en détail les différents milieux sociaux et culturels où il évolua, depuis son premier poste officiel comme géologue à Ceylan (1902-1905) jusqu’à son installation à Newton, près de Boston (1932-1947). C’est une histoire fascinante, qui aide à comprendre le développement et les traits caractéristiques de l’œuvre de Coomaraswamy. Pour notre propos, il suffit de dire qu’on peut distinguer trois phases importantes dans sa biographie intellectuelle. La première est marquée par ses études sur l’histoire de l’art et de l’artisanat indiens et son interprétation de leurs fonctions et de leurs significations. Naturellement, l’intérêt de Coomaraswamy pour l’art indien dura jusqu’à la fin de sa vie, mais sa méthode herméneutique fut progressivement approfondie. Dans ce que nous pouvons appeler le deuxième stade, on note une familiarité croissante avec quelques problèmes de l’histoire des religions, en particulier le symbolisme de la fertilité chthonienne représentée par la Magna Mater, et les cosmogonies, rituels et mythologies aquatiques (6). Finalement, vers 1932, commença la troisième période et la plus créative, où il se consacra exclusivement à l’illustration des différentes expressions de la philosophia perennis, la tradition primordiale et universelle présente dans toute civilisation authentique non acculturée (7).
Or, on n’ignore pas que la longue et importante tradition de la philosophia perennis a joui d’un certain prestige, surtout de la Renaissance italienne à Leibniz (8). Par ailleurs, René Guénon, à commencer par son Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues (1921), écrivit tous ses livres dans la perspective de cette tradition, et devint en 1932 le directeur des Études traditionnelles, auxquelles Coomaraswamy donna plusieurs articles. Nous n’examinerons pas ici la philosophia perennis, non plus que le problème de la tradition. Toutefois, contrairement à René Guénon ou à d’autres “ésotéristes” contemporains, Coomaraswamy développa son exégèse sans abandonner les outils et les méthodes de la philologie, de l’archéologie, de l’histoire de l’art, de l’ethnologie, du folklore et de l’histoire des religions. Comme Henry Corbin, il abordait les documents spirituels mythes, symboles, figures divines, rituels et systèmes théologiques à la fois en savant et en philosophe. On peut être d’accord ou non avec ses présuppositions méthodologiques et son herméneutique, comme on peut être d’accord ou non avec d’autres orientations contemporaines : sociologiques, psychologiques, phénoménologiques, structuralistes ou historicistes. Mais, en dernière analyse, Coomaraswamy aussi bien que Henry Corbin et que d’autres auteurs (par ex. Gilbert Durand, S.H. Nasr, Jean Servier, Elémire Zolla, Antoine Faivre, etc.) appartiennent à la même communauté internationale de savants qui se sont consacrés à l’étude et à l’interprétation de tous les aspects des réalités religieuses.
Les quelque mille pages des deux premiers volumes de ce travail (Selected Papers, 1 & 2) illustrent les intentions de Coomaraswamy et sa méthode (9). Lipsey remarque qu’il « n’a pas consacré un seul article à l’idée de Tradition » (3 : 273). Toutefois, dans le dernier chapitre du volume 3 (Tradition : An Introduction to the Later Writings), Lipsey réunit un certain nombre de citations de différents essais et résume ce que Coomaraswamy entendait par “tradition”. Il faut revenir à ce chapitre après avoir lu quelques-uns des exposés énumérés dans la note 9. Il convient de souligner que Coomaraswamy « n’a jamais rien fabriqué qui ressemble à un résumé de toutes les expressions traditionnelles d’une certaine idée, car il pensait que cela ne pouvait conduire qu’à “une monstruosité mécanique et sans vie, une sorte d’espéranto religieux”. Il procéda plutôt par une méthode comparative, confrontant les formules d’une tradition avec celles d’une autre, gardant à l’esprit la probabilité que toutes les religions aient une source commune » (3 : 277). Coomaraswamy ne se soucia jamais de « prouver dialectiquement la justesse d’aucune doctrine, quelle qu’elle fût, mais seulement d’en démontrer la cohérence et, par là, l’intelligibilité. La cohérence de la philosophia perennis est en fait un bon terrain pour la "foi" (c’est-à-dire la confiance, en tant que distincte de la simple croyance) ; mais, comme cette philosophia n’est ni un “système” ni une “philosophie”, on ne peut raisonner pour ou contre » (2 : 90 n.).
On peut aisément multiplier de telles citations, illustrant l’importance décisive des “premiers principes” dans la compréhension et l’interprétation des réalités religieuses. « Il y a une science de la théologie dont les théologies juive, chrétienne, indienne et musulmane sont seulement des applications spéciales. C’est exactement comme si nous devions discuter mathématiques avec un savant oriental; il ne faudrait pas avoir à l’esprit les mathématiques de l’homme blanc ou de l’homme de couleur en tant que tel, mais seulement les mathématiques en soi. De la même façon, ce n’est pas de votre dieu ou de son dieu que vous devez apprendre à parler avec le théologien oriental, mais de Dieu lui-même » (10). On peut déchiffrer dans de telles formulations l’influence croissante du rationalisme rigide de Guénon. La comparaison des constructions théologiques avec la pensée mathématique est plutôt simpliste. L’historien des religions est, au contraire, fasciné par la multiplicité et la variété des idées sur le mode d’être unique de Dieu, élaboré au cours des millénaires, car chaque structure théologique représente une nouvelle création spirituelle, un aperçu récent et une meilleure approche de la réalité ultime.
N’examinant pas les interprétations modernes de la tradition, nous n’insisterons pas sur l’ambivalence de ce terme. On sait que la tradition a été, incorrectement, identifiée à des idéologies politiques réactionnaires, à l’antimodernisme, à la dépréciation de “l’histoire”, à l’exaltation du passé, au pessimisme, etc. On peut reconnaître certains de ces traits dans la vie et les écrits de Coomaraswamy. Toutefois, on hésite à voir en lui un “pessimiste”. En tout cas, le pessimisme ne caractérise plus seulement les adeptes de la tradition. Les dernières décennies ont été marquées par un pessimisme et un nihilisme rapidement croissants. On pourrait presque dire qu’à l’exception du marxisme et de la théologie de Teilhard de Chardin, “l’ère posthistorique” se développe sous le signe du pessimisme.
Nombre d’obstacles entravent la compréhension et l’assimilation des écrits de Coomaraswamy. Si l’on peut accepter son accumulation excessive de citations et de références textuelles et bibliographiques, on est quelque peu déconcerté par la place qu’elles prennent. Qu’on se rappelle seulement les notes 22, 24 et 41 — respectivement de six, cinq et huit pages dans Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government de 1942. Les quinze pages de son article Svayamatṛnna sont suivies de trente-six pages de notes. Il faut espérer qu’un jour quelqu’un préparera une édition “didactique”, au moins de ses articles les plus importants. Et aussi qu’une édition de ses œuvres complètes paraîtra dans un proche avenir.
Il ne fait nul doute qu’Ananda Coomaraswamy fut l’un des savants les plus érudits et créateurs du siècle. Point n’est besoin de rappeler son rôle décisif dans la compréhension et la valorisation de l’art indien. Il fut, de plus, le premier à fournir des preuves à l’appui de la continuité entre l’Inde préaryenne, le védisme, le brahmanisme et le bouddhisme. Les nombreux et excellents parallèles extra-indiens qu’il examine dans ses exégèses sont toujours enrichissants et éclairants. Pour l’historien des religions aussi bien que pour l’orientaliste et l’historien de l’art, son analyse herméneutique d’images traditionnelles, de symboles et de mythes est peut-être encore plus stimulante que sa reformulation implicite ou explicite de la philosophia perennis. Une lecture attentive de l’un quelconque de ses articles importants est toujours enrichissante : sous une masse de citations et de références textuelles, on trouve bon nombre d’interprétations profondes, subtiles et instructives. Si elles avaient été découvertes et assimilées à l’époque de leur publication, quelques-uns des vieux malentendus irritants qui hantent périodiquement certains historiens des religions auraient été dissipés comme il convient.
► Mircea Eliade, Briser le toit de la maison, 1986. [version anglaise]
• nota bene : voir aussi l'article suivant du recueil : « La souveraineté chez les Indo-Européens ».
1. Coomaraswamy (Ananda K.). Vol. 1 : Selected Papers : Traditional Art and Symbolism. Vol. 2 : Selected Papers : Metaphysics. Vol. 3 : His Life and Work. Ed. Roger Lipsey, Bollingen Series nº 89, Princeton University Press, 1977. Pp. xxxviii + 544 ; xxvi + 435 ; xvi + 304.
2. Pour citer un seul exemple : son originale et très érudite monographie « Svayamātrinnā : Janua Coeli » (Zalmoxis n°2, 1939, en fait 1940 : 3-51), imprimée à Bucarest en mon absence et défigurée par un grand nombre de fautes d’impression, fut disponible en seulement quinze tirés à part que j’envoyai de Paris en 1945. Toute l’édition de Zalmoxis, vol. 2, fut brûlée à Bucarest. Le texte original, correct, de Svayamātrinnā parut pour la première fois dans Coomaraswamy, 2, 465-520 (sauf indication contraire, les références sont faites à cet ouvrage).
3. Voir mon article « A. Coomaraswamy », Revista Fundațiilor regale n°4, 1937 : 183-189, repris dans Insula lui Euthanasius,1943, pp. 265-275.
4. Voir aussi l’important compte-rendu d’un de ses disciples : Schuyler Camman, « Remembering Again », Parabola 3 n°2, 1978 : 84-91.
5. Il faut garder à l’esprit les rapports de Coomaraswamy avec les mouvements nationalistes indiens et les influences de William Morris et du Cercle Tagore à Calcutta (voir Life and work, chapitres 5, 7, 9, 17).
6. Voir ses Yaksas, 2 vol. (1928, 1931) ; « Archaic Indian Terracottas », Jahrbuch fur prahistorische und ethnographische Kunst (1928), pp. 64-76 [repris dans : From River Banks and Sacred Places : Ancient Indian Terracottas, J. Paulson, 1977] ; « The Tree of Jesse and indian parallels or sources », Art Bulletin, vol. 11, 1929, etc.
7. La plupart des écrits réunis dans les deux volumes des Selected Papers appartiennent à cette période.
8. Voir entre autres Charles B. Schmitt, « Perennial Philosophy : From Agostino Steuco to Leibniz », Journal of the History of Ideas n°27, 1966 : 505-532, surtout 507-511 (Marsile Ficin), et 511-513 (Pic de La Mirandole). « Le programme de Nicolas de Cuse, Ficin et Pic, avec ses racines dans Plutarque, le néo-platonisme, les Pères et d’autres anciens auteurs ayant traité de la religion, arrive à sa pleine réalisation avec Steuco (ibid., p. 515). Agostino Steuco publia sa De perenni philosophia en 1540 (voir aussi D.P. Walker, « Orpheus the Theologian », dans The Ancient Theology, 1972, pp. 22-41).
9. Certains essais sont extrêmement importants. Pour n’en citer que quelques-uns : A Figure of Speech or a Figure of Thought ? (1: 13-42) ; The Philosophy of Mediaeval and Oriental Art (1: 43-70) ; The Symbolism of the Dome (1: 415-464) ; Symplegades (1: 521-544) ; Recollection, Indian and Platonic (2: 49-65) ; Akimcañña : Self-Naughting (2: 88-106) ; Vedic Exemplarism (2: 177-197).
10. Selected Papers, 2: 276.

 • Présentation du texte : Au début des années 1940, un nouveau lieu de spiritualité littéraire et orientaliste s’est constitué, mais à Marseille, autour de la revue également proche des surréalistes, Les Cahiers du Sud, dirigée par Jean Ballard. Les poètes et les écrivains qui ont fui la Belgique et la France en guerre s’y croisent : Simone Weil, en instance de départ pour Londres, s’initie au sanscrit auprès de Daumal, Lanza del Vasto de retour d’Inde rédige Le pèlerinage aux sources, publié en 1943, tandis que Jacques Masui prépare un numéro de la revue sur l’Inde. Ce dernier présente René Daumal à Jean Herbert qui le charge de corriger des traductions de l’anglais, notamment L’Enseignement de Râmakrishna, paru en 1942, et l’Essai sur le bouddhisme zen de Daisetz Teitaro Suzuki, publié l’année suivante. Dans les années 1940, deux ouvrages édités par Jean Ballard témoignent des rencontres qui se sont opérées entre ces hommes de lettres et certains savants autour d’un même objet d’étude, la culture religieuse et philosophique de l’Inde dont il s’agit à chaque fois de dégager « l’actualité présente », prolongeant ainsi l’entreprise engagée avec Hermès. Un numéro spécial de la revue intitulé Message actuel de l’Inde, paru en 1941 sous le double patronage de Jean Ballard et de Jacques Masui, traduit l’existence du pôle littéraire des producteurs de discours sur l’Inde ; les éditeurs se sont en effet attachés les collaborations notamment de Jean Herbert, de René Daumal, de Lanza del Vasto, de Jean Grenier, d’Émile Dermenghem et de Benjamin Fondane dont les essais cohabitent avec des textes de Gandhi, de Rabindranath Tagore, d’Aurobindo, de Râmakrishna, de Vivekananda ou du disciple de ce dernier, Siddheswarananda, arrivé en mission en France.
• Présentation du texte : Au début des années 1940, un nouveau lieu de spiritualité littéraire et orientaliste s’est constitué, mais à Marseille, autour de la revue également proche des surréalistes, Les Cahiers du Sud, dirigée par Jean Ballard. Les poètes et les écrivains qui ont fui la Belgique et la France en guerre s’y croisent : Simone Weil, en instance de départ pour Londres, s’initie au sanscrit auprès de Daumal, Lanza del Vasto de retour d’Inde rédige Le pèlerinage aux sources, publié en 1943, tandis que Jacques Masui prépare un numéro de la revue sur l’Inde. Ce dernier présente René Daumal à Jean Herbert qui le charge de corriger des traductions de l’anglais, notamment L’Enseignement de Râmakrishna, paru en 1942, et l’Essai sur le bouddhisme zen de Daisetz Teitaro Suzuki, publié l’année suivante. Dans les années 1940, deux ouvrages édités par Jean Ballard témoignent des rencontres qui se sont opérées entre ces hommes de lettres et certains savants autour d’un même objet d’étude, la culture religieuse et philosophique de l’Inde dont il s’agit à chaque fois de dégager « l’actualité présente », prolongeant ainsi l’entreprise engagée avec Hermès. Un numéro spécial de la revue intitulé Message actuel de l’Inde, paru en 1941 sous le double patronage de Jean Ballard et de Jacques Masui, traduit l’existence du pôle littéraire des producteurs de discours sur l’Inde ; les éditeurs se sont en effet attachés les collaborations notamment de Jean Herbert, de René Daumal, de Lanza del Vasto, de Jean Grenier, d’Émile Dermenghem et de Benjamin Fondane dont les essais cohabitent avec des textes de Gandhi, de Rabindranath Tagore, d’Aurobindo, de Râmakrishna, de Vivekananda ou du disciple de ce dernier, Siddheswarananda, arrivé en mission en France.Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un second volume, Approches de l’Inde : Tradition et incidences, publié en 1949 aux éditions Cahiers du Sud, atteste de la coexistence d’agents issus des pôles opposés du champ dont l’alliance paraissait sinon improbable du moins impossible dix ans auparavant. Conçue de nouveau par Jacques Masui et placée sous l’autorité intellectuelle de René Guénon dont un essai ouvre le volume, cette entreprise éditoriale se caractérise par la participation des indianistes universitaires les plus proches des fractions littéraires et catholiques du pôle mondain. Ainsi sont réunis, notamment, Jean Filliozat, Olivier Lacombe et Paul Masson-Oursel (directeurs d’études à l’EPHE 5e section), Anne-Marie Esnoul (alors bibliothécaire de l’Institut de civilisation indienne), le docteur Thérèse Brosse, consultante auprès de l’UNESCO, mais aussi membre de la Société théosophique, qui mène depuis le milieu des années 1930 des recherches sur la physiologie du yoga qu’elle poursuit à l’Institut français de Pondichéry, dans les années 1950 ; l’abbé Jules Monchanin et le père Émile Gathier (auteur de La pensée hindoue en 1958), tous deux missionnaires en Inde du Sud ; Alain Daniélou, Mircea Eliade et Ananda K. Coomaraswamy, que rapprochent des trajectoires déviantes homologues autant que leurs défenses des théories savantes indigènes. Parmi les collaborateurs étrangers, les maîtres spirituels hindous, très présents dans le numéro publié en 1941, sont cette fois quasiment ignorés, à l’exception d’Aurobindo, au profit des universitaires et des hommes de science, comme : Mahendranath Sircar (professeur de philosophie à l’université de Calcutta), Radhakumud Mookerji (professeur de sociologie à l’université de Lucknow), Henrich Zimmer (indianiste, anciennement professeur à l’université d’Heidelberg, avant d’émigrer aux Etats-Unis en 1938), auteur d’études sur la mythologie et le symbolisme dans la culture hindoue et, enfin, Carl G. Jung dont les visées théoriques et thérapeutiques empruntent au fonds des doctrines indiennes.
Si tous les auteurs réunis dans ce volume ne peuvent être considérés, au même titre, comme des tenants de la pensée traditionnelle exposée dans nombre d’articles, les universitaires français accréditent néanmoins de leurs savoirs cette vision spiritualiste de l’Inde exprimée par Jacques Masui qui en appelle, sur un ton prophétique, « aux sources vivantes de l’être » afin de « desserrer l’étreinte de la catastrophe qui s’approche rapidement ». Et si Ananda K. Coomaraswamy, dans le seul article traitant du système social indien, ne peut en considérer que le fondement religieux qui en légitime le principe hiérarchique, comme le fait René Guénon, c’est aussi parce que tous les auteurs réunis dans ce volume semblent s’accorder au moins tacitement pour reconnaître que « le génie de l’Inde (…) c’est son adoration de l’unité et son indifférence à l’homme », comme le dit par ailleurs Jean Grenier. [R. Lardinois, L’invention de l’Inde, 2007]
*
• Présentation : — M. Coomaraswamy a réuni dans cette brochure trois études distinctes, dans la première desquelles il s’est proposé de montrer, par l’exemple de l’Inde, comment, « dans un ordre social traditionnel, les institutions représentent une application des doctrines métaphysiques à des circonstances contingentes », de telle sorte que tout y a une raison d’être, non pas simplement biologique ou psychologique, mais véritablement métaphysique. Il examine successivement à ce point de vue le quadruple but de la vie humaine (purushârtha), l’institution des quatre âshramas, la notion de dharma avec tout ce qu’elle implique, et enfin, en connexion avec le swadharma, l’institution des castes, avec le caractère de “vocation” qu’y revêt essentiellement l’exercice de toute profession quelle qu’elle soit, ainsi que le caractère sacré et rituel qu’a nécessairement toute activité là où les castes elles-mêmes sont considérées comme “nées du Sacrifice”, si bien que le point de vue profane ne s’y rencontre nulle part, et que la vie tout entière y apparaît comme l’accomplissement d’un rituel dans lequel il n’est rien qui soit dépourvu de signification. (R. Guénon, 1946).
***
 Le fondement religieux des formes de la société indienne
Le fondement religieux des formes de la société indienne[Ci-contre : Situé à Delhi, la capitale indienne, le temple Akshardham est très récent puisque sa construction s’est achevée en 2005. Fait de grès rose et de marbre blanc, il est entouré de jolis jardins et fontaines. Il a été construit en hommage du fondateur du courant hindou moderne, Swaminarayan. Son architecture mélange Inde traditionnelle et moderne]
Un ordre social ayant, comme celui de l’Inde, un caractère traditionnel ne se développe pas au hasard, mais se conforme à une théorie, à un ensemble de principes ou de valeurs qui sont censées avoir été révélées et dont la vérité n’est pas mise en doute. Les institutions sont une application des doctrines métaphysiques aux circonstances contingentes et prennent par conséquent une couleur locale, changeant selon les époques tout en maintenant continûment un haut degré de stabilité comparable à celui d’un organisme vivant dans lequel, par le processus répété de la mort et de la renaissance que nous appelons “devenir” ou “vie”, un ordre existant préserve une identité discernable et engendre ,un ordre futur. Dans une société traditionnelle, on respecte les institutions établies, et si un mal vient à se produire, on ne s’imagine pas qu’il peut être corrigé par une révolution des institutions, mais seulement pair un changement de l’esprit (metanoia : repentir) laissant l’ordre lui-même inchangé. La “réforme” comme le mot l’indique n’implique pas autre chose qu’un retour à la forme qui a donné lieu à une déviation. Le monarchiste, par exemple, ne pense pas que la substitution de la démocratie à la monarchie puisse accroître le bien-être du peuple ; il soutient que cette amélioration ne peut être obtenue que lorsque le roi, devenu un tyran qui “gouverne dans son propre intérêt”, se souvient qu’il ne détient jamais qu’une vice-royauté, que sa fonction consiste uniquement à faire exécuter ce que conseille l’Autorité spirituelle, et que, conformément à ce qu’énonce le Livre de la Science du Gouvernement : « l’essentiel de cette science dépend de l’empire que le chef a sur lui-même » (Kautilya, Arthashâstra, I, 6).
Toute coutume établie a une raison d’être métaphysique plutôt que biologique ou psychologique. Ainsi, le prototype de tout mariage est fondé sur les relations naturelles du soleil avec le ciel, ou du ciel avec la terre, et auxquelles correspondent également les relations de l’Autorité Spirituelle avec le Pouvoir Temporel. La moralité est affaire de conduite correcte ou habile, et, comme pour l’art, c’est une question de savoir-faire, de connaître ce qui doit être fait, plutôt que de sentiment. Et, lorsqu’un modèle universel de “conformité” est accepté à l’unanimité, l’opinion publique suffit pour contrôler l’ensemble de la situation. Personne ne peut être convaincu de l’irrationnalité d’une coutume à moins qu’on ne lui démontre qu’elle n’a aucune base métaphysique. Par exemple, ce n’est pas assez de détester la guerre, et d’éviter d’y penser, car, si l’on s’en tient à cela, lorsque la crise éclate, on s’expose à se laisser convaincre par d’autres arguments plausibles. Nous devons nous demander si oui ou non l’idée d’une nature humaine déterminée par des facteurs économiques plutôt que spirituels avec, pour conséquence, un genre de vie assujetti au monde des affaires, n’a pas rendu les guerres totales inévitables ; si nous ne nous sommes pas bornés « à désirer la paix mais pas les choses qui la favorisent » [1]. Beaucoup trop souvent, les hommes de bonne volonté sont enclins à attaquer une institution qui ne leur est pas familière comme le système des castes de l’Inde ou d’ailleurs, sans se demander d’abord quels en sont les buts, ou si ces buts qui sont les valeurs vitales de la société donnée et qui constituent l’essence de sa morale, peuvent être également atteints par les institutions nouvelles que l’on se propose d’introduire de l’extérieur. Dans des cas de ce genre, on perd de vue que les formes d’une société traditionnelle composent une texture très serrée qui peut se défaire ou s’embrouiller si l’on enlève un de ses fils. On néglige lé fait qu’on ne peut changer les styles de la musique sans affecter tout l’organisme. C’est une illusion de penser qu’on peut réaliser un “monde meilleur” en combinant le “meilleur” d’une culture avec celui d’une autre. En tant que moyens ces meilleurs sont généralement incompatibles et l’effet réel d’une pareille tentative est presque toujours la combinaison de ce qu’elles ont de pire. Nous ne pouvons que nous aider mutuellement à mieux faire ce que chacun a déjà essayé de faire ; exiger d’autrui de se modifier pour devenir ce que nous sommes, c’est le détruire moralement. Dans cet exposé, je n’ai pas l’intention de justifier le système social indien, mais seulement de l’expliquer.
Les institutions peuvent être définies comme les moyens pour le perfectionnement de l’individu. On doit les juger en fonction des fins immédiates et des fins dernières de la vie ; elles seront considérées comme bonnes si elles conduisent à la réalisation de ces fins, comme mauvaises dans le cas contraire. Pour les Hindous, le but de la vie, la “fin de l’homme” (purushârthà) ou sa raison d’être, est défini de quatre manières différentes et par rapport à la vie active et à la vie contemplative. D’une part, les buts de la vie sont : la satisfaction des désirs (kâmà), la recherche des valeurs (artha) et l’accomplissement de la fonction (dharma, au sens de devoir) ; d’autre part, le but suprême et total de la vie est d’atteindre à la libération (moksha) à l’égard de tout désir, de toute valeur, de toute responsabilité.
Ces fins, immédiates et dernières, sont énoncées dans l’ordre de leur hiérarchie mais ne doivent pas être considérées comme indépendantes ou comme essentiellement différentes les unes des autres. Le but ultime, la libération, contraste néanmoins d’une certaine manière avec les trois buts propres à la vie active, et ce contraste apparaît dans le fait qu’on admet très bien qu’un homme a des responsabilités sociales impérieuses (considérées souvent comme une dette due à ses ancêtres) et qu’il peut s’en défaire en une fois, et pour toujours. Des dispositions sont prises, par conséquent, à la fois pour la vie du chef de famille qui exerce une profession (qu’elle soit sacerdotale, royale, pastorale, ou artisanale) et pour la vie de pauvreté du mendiant Sannyâsî qui renonce d’un seul coup à tous les rites,et à tous les devoirs sociaux, et qui ne possédant plus rien, vit de “charité”, au plus pur sens du mot, de la charité inspirée par l’amour de ses semblables qui considèrent comme un privilège de le nourrir.
Ces deux modes de vie, dans le monde et hors du monde, ont été nommés à juste titre les normes “ordinaires” et “extraordinaires” d’une civilisation [2]. Et c’est en vue de leur accomplissement que s’est développée l’institution des “quatre âshramas”. Je dis “développée” car une formule catégorique ne peut être établie comme telle à l’origine, mais il faut comprendre que, comme toute formule, elle n’est qu’une définition des vies de l’étudiant, du chef de famille, de l’ermite et du religieux, telles qu’elles sont reconnaissables dès l’abord. Dans toutes les civilisations, on les retrouve. Par exemple, dans les dernières années que Platon consacre à la contemplation permanente de toutes choses quand l’âme atteint à la maturité, « si les hommes désirent couronner la vie qu’ils ont menée ici-bas par un destin qui lui correspond dans l’autre monde » (Platon, République, 498 c-d) ; dans l’Europe chrétienne où la vocation suprême du contemplatif, justifiée par l’exemple de Marie (qui a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas enlevée), représente la norme “extraordinaire” est mise en contraste avec la norme “ordinaire” de ceux qui, comme Marthe, sont “actifs” (surchargés de travaux et troublés par des choses différentes de la “seule chose qui compte”). C’est presque exclusivement du point de vue moderne “philistin”, séculier et moraliste, que la norme extraordinaire a fini par être considérée en Occident comme une évasion des responsabilités sociales. On pourrait fort bien répliquer que sans l’exemple de ceux qui ont renoncé à toutes les valeurs pour choisir la Valeur Suprême (qui n’est pas une valeur parmi les autres), celles dont dépend l’ordre de la vie active seraient réduites à de simples préférences et considérées en même temps comme absolues.
Étudier les Écritures saintes et exercer sa fonction (swadkarma) dans celui des âshramas où l’on vit momentanément est le remède qui nous est prescrit contre la passivité, l’angoisse, l’amnésie. Certes, il faut être aussi un fervent ou un incandescent (tapasvi) si l’on veut connaître Dieu ou même accomplir des œuvres avec succès, mais on ne peut se dispenser des devoirs de sa “station” sous prétexte qu’on est un tel “fervent” (Maitri-Upanishad IV, 3). La racine du mot âshrama est shram : se donner de la peine ; d’où aussi shramana, moine ou religieux. Ce sont les équivalents sémantiques exacts de askeo et asketes “ascète”. Il est tout aussi intéressant de constater dans le même ordre d’idée que le sanskrit kushalatâ, le grec sophia et l’hébreu hochmâ, ont pris le sens de sagesse ou de prudence en ce qui concerne l’action en général, alors qu’ils désignaient à l’origine l’habileté dans l’exercice d’un métier. Un âshrama est donc un stade de la vie qui doit être considéré comme un atelier ou comme une étape d’un voyage ininterrompu et toujours ardu. Les âshramas sont autant de séjours non au sens de lieux de repos mais de lieux d’activité. Le refrain d’une ancienne chanson de pèlerin est : “continue à marcher” (charaiva-charaiva). Le mot âshrama a aussi le sens plus spécial de lieu de retraite : ermitage solitaire ou communautaire.
En dehors de ce sens particulier les Quatre âshramas désignent successivement la vie de l’étudiant (brahmachârî, “celui qui marche avec Dieu”, expression qui a un sens plus général), la vie du chef de famille (grihastha, l’homme marié qui occupe un emploi), celle de l’anachorète (vanaprastha), et enfin, la vie de celui qui renonce à tout (sannyâsî) ou “l’homme véritablement pauvre” qui ne possède plus rien, ne pratique aucun rite, n’a plus de toit, et en l’honneur de qui l’on a déjà accompli les rites funéraires. Dans des circonstances normales, ces quatre modes de vie doivent être adoptés successivement, et, en tout cas, une “retraite prématurée” est regardée comme tout à fait , indésirable. On admet cependant que lorsque la vocation est irrésistible, le passage de la vie sous le toit familial à la vie sans toit de l’Errant (parivrâjaka : pèlerin) qui “n’a plus rien pour poser sa tête”, peut se faire à n’importe quel âge, de même que le Christ disait à un jeune homme : “Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi”. On ne saurait exagérer l’honneur et le respect qui sont accordés par les laïques aux religieux, hindous ou bouddhistes. Toute femme qui attend un enfant fait le vœu de porter un fils qui sera religieux. Tout Hindou, tout Bouddhiste souscrirait à ces paroles du Maître Eckhart sur les vagabonds sans toit (sâdhu) : « Béni est le royaume où réside l’un d’entre eux ; en un instant, ils font plus de bien et un bien plus durable que n’en ont fait toutes les actions qui ont jamais été accomplies dans le monde », et à celles de Platon disant que les hommes jugés par le monde comme des “inutiles” sont les “vrais pilotes”.
Le terme hindou et bouddhiste le plus général pour désigner la “religion” dans le sens de Vérité Suprême, et aussi, par conséquent de vraie doctrine, est Dharma. Ce mot que l’on retrouve dans Dhruva, l’Étoile Polaire, symbole de la constance, dont la racine est dhri, soutenir, a la même origine que le grec thronos trône, en latin, firmus, et peut-être aussi forma. On peut le traduire littéralement par “fermeté”, l’opposé de l’état de déséquilibre et de désordre impliqué dans “infirmité”. On peut aussi le traduire plus librement par des mots comme “norme”, “constante”, “ordre”, “loi” ou “justice”. Ce concept a une valeur particulière pour nous en ce qui concerne l’explication des institutions car, nous allons le voir, sa signification essentielle est celle du grec dikaiosyne “justice”, qui dans le Nouveau Testament est rendu généralement par “droiture”, et du latin lex, comme dans Lex AEterna. Afin de fixer le sens du mot, il sera nécessaire de citer ses emplois dans quelques textes significatifs. La divinité est le “support” (dhâtri) de tout sacrifice (Rig-vêda, I, II, 14). Les dieux et les hommes en ont fait leur “support” (dharma) (Rig-vêda, X, 92-2) ; et au pluriel, les dharmâni sont les Lois inviolables dont il est le Surveillant (dharmânâm adhyaksha) (Rig-vêda, VIII, 43-44).
Dans la plus ancienne Upanishad, qui décrit la procession divine, la divinité qui est unique in principio, qui est aussi le Sacerdoce (Brahma), engendre les trois autres espèces ou castes de divinités, la hiérarchie angélique des Kshatriyas, des Vaishyas et des Shûdras, c’est-à-dire les Princes, les Hôtes et leur Sustenteur commun. Mais elle ne s’est pas encore développée tout entière, elle n’est pas sortie, elle n’est pas encore existante (na vyabhavat), ce qui veut dire qu’elle n’est pas encore en acte dans l’exercice de son autorité (vibhûti : exousia). C’est pourquoi elle engendre “la plus splendide forme du Dharma” : la Justice ou la Loi, ce par quoi un Seigneur est vénérable, de sorte qu’il n’y a rien au-dessus de la Loi ; et par elle un homme faible peut faire entendre raison à plus fort que lui, comme s’il en appelait à César ; et certes cette Justice est identique à la Vérité (satyam) (Brihadâranyaka Upanishad I, 4-11-14).
La portée morale de cette équation de la justice avec la vérité apparaîtra immédiatement si nous nous rappelons que les plus anciennes Écritures parlent déjà des Rois qui « agissent conformément à la Vérité » (satyam grihnânâh krinvânâh, RV X., 109, 6) ou qui s’appuiant sur la vérité (satyam grihnânâh, A. V. V., 17, 10), si nous considérons que c’est précisément en s’appuyant sur la vérité (satya-graha), l’aletheias ephapsis de Platon (Timée, 90 c) ou, en d’autres termes, en faisant appel à César, la justice qui régente le monde, que Gandhi, notre politicien le plus écouté, à qui nous avons donné le nom de “Magnanime” (Mahatma), a cherché à libérer l’Inde de l’esclavage et de l’exploitation. Qu’il ait pu compter avec tant de confiance sur ses disciples pour le suivre dans cette voie, qui exige la discipline la plus rigoureuse, montre que dans l’Inde on a cru et on croit vraiment que “la Vérité vous rendra libre”. On n’a jamais mis en doute que c’est par des “Actes de Vérité” que quelqu’un est, en fait, libéré de toute position fâcheuse où il puisse se trouver ; et que finalement, c’est par un dernier et suprême “Acte de Vérité” que l’on “s’évade totalement” et que l’on est admis à la porte du Soleil. Car le Soleil lui-même (non pas le disque « que tous les hommes voient mais celui que quelques-uns connaissent par l’esprit », comme le dit un texte hindou) est la Vérité et ne peut refuser l’entrée à quiconque frappe à sa porte en invoquant son nom. Lui, l’Esprit immanent (prâna), les Puissances « en firent leur Loi », et « Lui seul est, maintenant et demain » [3]. De plus, « cette Justice est l’élixir de tous les êtres et ils sont son élixir ; cet Homme immortel, brillant comme la flamme — Brahma, le Sacerdoce — réside dans cette Loi, cet Homme Immortel, brillant comme la flamme — Brahma, le Sacerdoce — né de cette Loi (dharma) est en vous (adhyâtman). Il est votre propre Soi, l’Immortel, il est ce Sacerdoce, (il est) tout ceci » (Brihadâranyaka Upanishad II, 5-11). Il est “votre propre Soi”, car en vérité, “tu es Cela” plutôt que ce que tu nommes “je” ou “toi-même”, “cela”, c’est-à-dire votre Soi spirituel distinct de l’individu passager, psycho-biologique, non pas tel homme mais le Soi de tous les êtres, le Soi Immortel et Maître du soi (individuel), arche psyches athanaos psyche psyches, is qui intus est, “non pas moi, mais le Christ en moi”, c’est l’Homme commun ou la Raison commune, “l’inwyt” (esprit intérieur), la conscience, la “syneidesis” (conscience intime), la “synteresis”, le “Daimon” de Socrate, pour qui la Vérité seule compte et qu’on ne peut contredire.
Ces deux “soi” seront en guerre l’un contre l’autre [4] jusqu’à ce que nous nous soyons mis en paix avec nous-mêmes, jusqu’à ce qu’on ait décidé qui dirigera, “le meilleur ou le pire” ; alors seulement, quand “nous” sommes soumis, « ce soi (individuel) mène à ce Soi (universel) et ce Soi (universel) à ce soi (individuel) » ; ils s’unissent et sous cette forme il s’unit avec l’autre monde, et sous cette forme il s’unit avec notre monde (Aitarêya Aranyaka, II, 3-7). Quand il est victorieux, alors seulement nous pouvons le considérer comme notre ami, alors seulement nous sommes libérés de la Loi, par notre identification avec elle, nantis d’ « une couronne et d’une mitre qui nous dépassent » et devenus « une loi vis-à-vis de nous-mêmes », au sens où nous disons que « le Christ était toute vertu, parce qu’il agissait par inspiration et non d’après des règles ». Mais ceux qui sont encore “soumis à la loi”, qui ne sont pas encore émancipés, quand ils s’interrogent sur les actes rituels (karma) ou sur la conduite (vritta), doivent agir comme le feraient les Brahmanes qui sont les sagaces “amants de la justice” (dharma-kâmâh) (Taittirîya Upanishad III, 2). L’organisation politique se définit par l’association de l’Autorité Spirituelle et du Pouvoir Temporel qui coopèrent comme en un mariage. C’est, en vérité, une des fonctions essentielles du Grand-Prêtre que d’être « l’œil qui veille sur le monde pour voir si le Roi ne fait pas de mal » (Jaiminîya Brâhmana, III, 94). Et ainsi, comme en Chine, ou comme chez Platon (qui pense qu’on doit retrouver les mêmes castes — genos : jâti — dans la cité et dans l’âme de chacun de nous) (Platon, République, 551 c), cette doctrine s’applique à notre organisation politique “individuelle” qui comprend un Prêtre pour la Vie Intérieure, un Roi pour les affaires extérieures, des facultés sensibles, des organes physiques de perception. « Ce monde saint que je voudrais bien connaître où le Sacerdoce et la Royauté se meuvent en plein accord » [5]. En d’autres termes : « Ton Royaume viendra ».
On retrouve les mêmes notions dans le Bouddhisme. Comme le Christ, le Bouddha (l’Éveillé) n’a pas essayé de changer la structure de la société. Il vivait dans un royaume qui n’était pas de ce monde et dans lequel il n’était rien, selon ses propres paroles. Sa position à l’égard du système des castes, n’était pas “égalitaire” au sens moderne du mot, mais il affirmait simplement que tous les hommes (et toutes les femmes) ont des capacités spirituelles égales, et il distinguait avec soin le Brahmane de naissance de celui qui mérite ce titre par sa conduite et son savoir. Il n’y avait certainement rien de nouveau dans ces propositions, bien qu’il fût nécessaire de les réaffirmer. Dans l’Hindouisme, en fait, comme le souligne le professeur Edgerton, « un membre de n’importe quelle caste, même un sans-caste peut devenir un Mendiant qui recherche la Vérité ». Nul en vérité n’a le droit de demander à un Hindou Sannyâsî ce qu’il était dans le monde, car il a cessé d’être quelqu’un, comme l’Esprit de Dieu qui « ne vient pas d’un lieu déterminé et ne se confond avec personne » (Katha Upanishad II, 18). Le Bouddha lui-même suivait une ancienne Voie, bien antérieure à l’époque où il est censé, peut-être à tort, avoir vécu. Il niait avoir inventé sa doctrine qui était, disait-il, composée de vérités qu’il avait expérimentées et vérifiées. En vérité, comme le dit Philon, « les paroles d’un prophète ne lui sont jamais tout à fait personnelles » (Spec., IV, 49).
Le fait que la Loi de la vie soit à la fois hors du temps et dans le temps correspond à la distinction entre le Dharma absolu qui est le pouvoir de Dieu lui-même et la loi immanente qui est en nous, notre modèle de vérité et de conduite. Et la distinction entre Dharma et Swa-Dharma correspond aussi à celle entre le Grand-Opérateur (Vishwakarma) par qui toutes choses sont faites et l’artisan individuel (swa-karmakrit) qui s’occupe de ses tâches particulières. Dans la Bhagavad-Gîtâ, où cette doctrine est le mieux et le plus complètement développée, il est dit que la division en castes est établie par Dieu et selon la diversité naturelle des qualités humaines (swabhâvaja) et leurs fonctions correspondantes. « L’homme atteint à la perfection ou à la réussite grâce à un amour fervent de son propre travail (swakarma) ». Dans ce cas, naturellement, atteindre à la perfection ne signifie pas faire fortune. Nous avons déjà signalé qu’un homme mûr ne se préoccupe nullement de quelque indépendance économique mais bien d’un état qui est au delà des considérations économiques. Le succès, c’est l’intégration et la réalisation de soi de l’Homme Émérite, celui qui a accompli ce qu’il avait à accomplir (kritakrityah) et qui a pu ainsi s’unir à Brahma (Brahma-bhûta) [6]. Il faut noter, en outre, que le sens de dévotion à sa propre tâche est aussi celui de “diligence”, donc l’opposé de “négligence”. La “diligence” qui implique qu’on aime sa tâche, que l’on y consacre tous ses soins [7], ne signifie pas simplement qu’on est laborieux, ni que l’on se donne du mal, mais que l’on travaille aisément, naturellement (sahajam) ou, au sens platonicien (et à l’opposé de l’idéal des “périodes de congé” et des “semaines de quarante heures”), que l’on travaille à loisir.
Ces idées sont l’essence même de l’axiologie indienne. Nous les retrouvons dans un livre aussi profane que le Livre de la Science de Hawking, où il est dit : « La voie qui mène au ciel est aisément parcourue lorsqu’on fait ce qui est prescrit par la naissance ou la caste » (Syainika Skâstra I, 25), swajâty-uktâbhicharanât. L’idée que l’on doit accomplir son devoir dans la voie où il a plu à Dieu de nous appeler, l’idée de vocation, si elle n’est pas “moderne”, n’est pas non plus spécifiquement indienne. Platon a défini la justice (dikaiosyne), c’est-à-dire le dharma, comme “le fait d’accomplir sa tâche selon la Nature” (to eauton prattein, kata physin) et il dit que, dans ces conditions, on fera plus de choses et on les fera mieux et plus facilement que de toute autre manière [8].
Le mot caste n’est nullement le synonyme de classe, ni le produit de préjugés de race qui sont caractéristiques des peuples occidentaux et démocratiques ! Il est très intéressant de constater que dans l’Inde moderne, où les puissances dirigeantes furent très loin d’être exemptes du préjugé de races, mais s’efforcèrent, par contre, d’ignorer le système des castes, des distinctions de classe étaient faites dans les services administratifs et déterminées par les différences de salaires ; l’exclusivisme social s’est fortement développé comme c’est le cas quand des hommes sont capables de faire le même genre de travail, mais gagnent des salaires différents selon leur “grade”. Il est non moins intéressant de constater que, dans ces mêmes services, existe une discrimination par quota contre les Brahmanes, de crainte qu’ils n’“usurpent” grâce à leurs hautes capacités intellectuelles les postes les plus brigués, attitude comparable à celles des Américains qui fixent des quota contre les Juifs et font naître ainsi un sentiment de classes rivales dans un pays où il n’y en avait jamais eu auparavant.
Peut-être demanderez-vous : « Comment peut-on appeler travail choisi un travail qui est imposé ? » Et tout d’abord, comment est-il imposé ? Nous ne devons pas négliger la conception traditionnelle selon laquelle le père, en ce qui concerne sa personnalité empirique ou “caractère”, revit dans son fils, lequel s’identifie à lui sous tous les rapports et prend sa place dans la communauté lorsqu’il s’en retire ou après sa mort, et cette transmission naturelle est confirmée par les rites formels de la transmission. La fonction héréditaire est une forme du service divin et le métier (c’est-à-dire le ministère), un travail qui en même temps honore Dieu et satisfait les besoins actuels de l’homme. C’est ainsi que dans l’Inde, comme chez Platon, la première raison pour laquelle on “doit” procréer est qu’il faut transmettre de génération en génération le “bon travail” [9] afin que, comme le dit le Livre de la Sagesse, nos descendants puissent « maintenir le système du monde » (Écclésiaste, xxxviii, 34), « notre ordre social ». En second lieu, c’est un fait, l’Hindou qui n’est pas corrompu par l’idée d’“ascension” sociale n’est jamais honteux de sa profession ; il en est fier, au contraire. C’est en s’inspirant de ce point de vue que Hocart pouvait dire que dans l’Inde « chaque occupation est un sacerdoce » (A. M. Hocart, Les Castes, p. 27).
Dans la Gîtâ, vous avez peut-être remarqué ce passage : « C’est autant par son travail que par ses prières qu’il chante Ses louanges ». Ainsi le travail est une sorte de liturgie et Laborare est orare, ou, comme dit le Livre de la Sagesse : « Leur prière se confond avec le travail de leurs mains » [10]. Tous les peuples dont le travail n’a pas été organisé en vue d’un profit ont toujours chanté en accomplissant leur tâche et, bien souvent, le contenu de ces chansons est religieux ou métaphysique : mais dans les sociétés “civilisées”, c’est-à-dire mécanisées, ces chansons ne subsistent que sous la forme de divertissements de salon avec accompagnement de piano. Le mal que l’urbanisme a fait aux cultures traditionnelles et à leurs manufacturiers (au sens littéral et propre du mot), il l’a fait en premier lieu aux travailleurs : « Nous leur avons enlevé la possibilité de réaliser des chefs-d’œuvre. Nous avons effacé dans leurs âmes le besoin de la qualité pour ne leur laisser désirer que la quantité et la vitesse » [11]. Pouvez-vous imaginer des ouvriers d’usine se mettant en grève pour avoir le droit de prendre en considération la “bonté” du travail à effectuer et non pour avoir de plus gros salaires et une plus grande part des bénéfices patronaux ? Selon la doctrine chrétienne, le travailleur est « naturellement enclin par la justice » à prendre cette “bonté” en considération (Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologica, II, II, 57, 3 ad 2). Si cela n’est pas, c’est parce que l’homme mécanisé, déterminé par les facteurs économiques et par conséquent irresponsable, a été dénaturé. Comme le dit le comte de Portsmouth : « C’est la richesse et le génie de notre peuple dans la variété, le caractère et l’habileté, que nous devons sauver maintenant » (Alternative to Death, 1944, p. 30). Tout cela est, en partie, le prix qui doit être payé pour la poursuite sans fin d’ « un niveau de vie plus élevé », prix que tout “cobaye”, doit payer pour l’insatiable avidité qu’entretient avec tant de succès le commerce moderne. Si la pauvreté consiste à n’avoir jamais assez, le monde industriel sera toujours dans le besoin.
La “sanctification du travail” a été désignée comme “l’apport le plus important du moyen âge au monde”. Il aurait mieux valu dire que c’est l’héritage d’un passé immense qui a été vendu pour une bouchée de pain et qui n’a plus aucune signification dans notre monde de “réalité appauvrie”. Du point de vue hindou, les castes sont, à la lettre, « nées du sacrifice », c’est-à-dire de la “Rupture du pain”, sacrifice primordial de l’Un, que hommes et dieux ont rendu multiple et par conséquent aussi, du rituel qui reproduit le sacrifice originel et qui correspond à la Messe chrétienne. La Divinité qui est et qui accomplit le premier sacrifice, “qui se divise pour remplir le monde” par son omniprésence totale, s’appelle, en tant que Démiurge par qui toutes les choses sont faites : “Celui qui fait tout” Vishwakarma, et, en vérité, elle accomplit les actes divers, vishiva karmâni, qui sont nécessaires pour célébrer le sacrifice de la Messe d’une façon parfaite. Mais l’individu, lui, n’est pas de même l’Homme de tous les métiers. « J’ai manifesté les quatre castes, dit Shrî Krishna, j’ai réparti les qualités et les tâches » (Bhagavad Gîtâ IV, 13). « Il existe donc une diversité de fonctions bien qu’il n’y ait qu’un Dieu qui accomplit tout dans tous les êtres » (I Cor., 12, 6).
Nous avons vu que de nombreux textes indiens et chrétiens parlent de la “Nature” comme du fondement de tout bon comportement ; mais avant de passe à une conclusion, il faut comprendre clairement que cette Nature n’est pas le milieu dans lequel nous nous trouvons, dont nous faisons partie ; ce n’est pas la Nature que scrute la science moderne, mais la Mère Nature par qui toutes choses sont “naturées”, qui fait que les hommes sont “humains” et les chevaux “chevalins”, il s’agit de la distinction, qui ne nous est plus familière, entré la Natura naturans, Creatrix Universalis, Deus, et la Natura naturata. La Nature, dont nous avons dit qu’elle est le modèle de toute action, c’est la “Nature toujours productrice” de Platon, le Virâj indien, le Sein de Brahma d’où toutes choses prennent le “lait” de leurs qualités spécifiques. C’est la Nature que tous les philosophes grecs, depuis les physiciens ioniens jusqu’à Philon, ont cherché à connaître, celle qui est impliquée dans la définition chrétienne du péché (moral, artistique ou spirituel) considéré comme l’abandon de tout ordre vers une fin, du bien propre à chacun selon sa propre nature ou son inclination naturelle, comme « tout ce qui est opposé à la Règle de la Nature, de la Raison ou de la Loi éternelle » (Summa Théologica I, 63, 15 I-II, 109, 2 ; II, II, 133, I, etc.). C’est la Nature dans ce sens-là qui doit être envisagée et non le monde qui nous entoure lorsque nous parlons de “vérité conforme à la Nature” en art, ou d’un “retour à la Nature” dans notre mode de vie, ou d’une Loi naturelle comme norme des lois faites par les hommes (Summa Theologica, I, 11, 93, 3).
Il faut ajouter à ceci quelques mots sur les notions d’“égalité” et de “liberté”. Il est bon de se rappeler que notre égalitarisme moderne, l’idéalisation de la plèbe et de la loi du nombre, diffère grandement de la notion classique et traditionnelle d’égalité et de justice qui existe dans une société qui forme un tout à la façon d’un organisme, de cette sorte d’égalité dont pouvait encore se réclamer Olivier Goldsmith en disant : « Je suis partisan de la monarchie, par amour de l’égalité ». Notre conception moderne de l’égalité est arithmétique, l’autre est “proportionnée” ou “analogique”. Ainsi, dans un État juste, « les fonctions et les honneurs administratifs doivent être distribués aussi également que possible selon une symétrie inégale » et non, comme l’a souvent dit Platon, en s’emparant habilement des votes ou en les achetant. La meilleure justice est celle qui donne à chacun selon sa propre nature, et c’est cette sorte d’égalité naturelle ou de justice politique que l’État exige si l’on veut éviter les conflits de classes [12]. Par ailleurs, une égalité arithmétique n’est équitable qu’à l’intérieur d’un groupe de pairs et l’on trouve précisément cette égalité dans les guildes artisanales et commerciales de l’Inde, lesquelles correspondent plus ou moins aux castes et aux « trade-unions » modernes, avec la réserve que les pouvoirs et les fonctions de ces dernières sont beaucoup plus limités ? De ce point de vue, et de celui des “conseils de village” on peut dire qu’aucun pays n’a su mieux que l’Inde procéder d’une façon démocratique.
Dans une hiérarchie basée sur la vocation, il n’est jamais question de “faire ce qu’on aime”, mais d’aimer ce qu’on fait, « en tout on doit tenir compte du plaisir qu’un homme éprouve lorsqu’il peut œuvrer selon sa propre nature » (Marc-Aurèle, X, 33).
Permettez-moi de vous donner maintenant quelques exemples d’“égalité proportionnée” dans une société qui est complète parce que fondée sur la vocation. Dans une telle société, naturellement, la liberté de choix est de plus en plus limitée à mesure qu’on s’élève dans la hiérarchie : “noblesse oblige”. Considérez la liberté de parole qui est accordée à la presse vénale, aux agitateurs de Hyde Park, aux politiciens malhonnêtes, aux habitués des antichambres parlementaires, et aux propagandistes. Un Roi ne jouit pas d’une aussi grande liberté. Dans le système des castes, « le Roi n’a pas le droit de dire tout ce qu’il veut mais seulement ce qui est correct » (sâdhu) (Shatapatha Brâhmana V, 4, 5). Bien des choses sont permises à un Shûdra qui ne le sont pas à un Brahmane, ou à la femme d’un Brahmane. La veuve d’un Shûdra peut se remarier, celle d’un Brahmane ne le peut pas — et de plus, selon la loi hindoue, la sanction qui frappe un Brahmane est beaucoup plus sévère que celle qui atteint un Shûdra pour la même faute. C’est une situation analogue à celle d’une famille. Comme le dit Aristote : « Tout est ordonné en vue d’une fin. Mais comme dans une maison, les hommes libres ont moins que les autres la faculté d’agir au hasard, tous leurs actes ou presque tous sont réglés d’avance alors que les serviteurs et les animaux ont une responsabilité réduite et agissent le plus souvent au hasard » (Aristote, Métaphysique, XII, 10, 3). On doit donc distinguer la liberté de choix qui est celle des hommes libres, de la liberté de spontanéité qui n’est que soumission à nos passions dominantes, ou le fait d’être gouverné par la “faim et la soif”. Qu’est-ce, après tout, que le libre arbitre sinon l’obéissance aux décrets de notre conscience en tant que médiatrice de la Loi éternelle ? Socrate n’était-il pas libre, bien que condamné à mort, puisqu’il se refusait à désobéir à son Daimon ?
Je parlerai brièvement des sans-caste appelés aussi Intouchables, et j’en parlerai parce que ceux-ci sont vraisemblablement pour vous un sujet d’étonnement. Tout d’abord, le problème ne se pose que du point de vue de la norme “ordinaire” : « Les hommes pourvus d’un savoir authentique ne font pas de différence entre les Brahmanes d’un savoir et d’un comportement parfaits et les bœufs, les éléphants, les chiens et les éleveurs de volailles… Celui qui Me voit partout et voit toutes choses en Moi, je ne le perdrai jamais et jamais il ne me perdra » (Bhagavad Gîtâ V, 18). En second lieu, le problème ne peut être compris que situé dans son contexte historique : à travers les siècles, des aborigènes ont été gagnés par l’exemple à la culture brahmanique et absorbés graduellement dans la hiérarchie sociale. C’est le choc soudain des conditions modernes et le développement des conflits politiques et des luttes de classes (souvent délibérément exploitées sinon provoquées par ceux dont le principe de gouvernement est Divide et impera) qui ont aggravé la situation. Le problème vous paraîtra peut-être plus clair si je vous signale que vous et moi, nous sommes, du point de vue orthodoxe, des “intouchables”. Le sentiment de contamination rituelle ressenti par ceux dont la vie est disciplinée et contrôlée lorsqu’ils se trouvent en contact avec ceux dont le mode de vie et de nourriture est beaucoup moins strict, est parfaitement naturel. Ce n’est pas, comme le préjugé de couleur, un déni d’humanité. Il serait aussi déraisonnable de s’attendre à ce que les Hindous orthodoxes admettent n’importe qui dans leurs enceintes sacrées que d’imaginer qu’ils pourraient vous y admettre, vous. Il vous est loisible d’employer un cuisinier brahmane ; mais cela ne vous autorisera pas à épouser sa fille, ni même à entrer dans votre propre cuisine sans retirer vos chaussures, et c’est ce qui doit être. C’est le Swâmî Vivêkânanda qui a donné la meilleure réponse à ce problème. Si les sans-caste ou hors-caste désirent améliorer leur condition, « qu’ils apprennent le sanskrit » ; autrement dit, qu’ils adoptent les modes de pensée et de vie plus élevés et plus purs qui n’ont pu être préservés pendant des milliers d’années que parce que ceux qui les mettaient en pratique ne se sont pas mêlés aux autres.
Je crois que nous sommes enfin parvenus à établir une définition qui n’est pas trop inexacte des concepts de Dharma et de Swadharma qui sont à la base des formes de la société indienne. Le premier est le modèle universel, la loi qui règle toutes choses sous le soleil, l’autre est une participation à cette Loi, devant laquelle tout homme est responsable, par sa constitution physique et mentale. Cette définition illustrera “l’accord global” de la tradition commune, qui est l’héritage de tous les hommes, car c’est de la même façon que la Philosophie Scolastique distingue la Loi éternelle de la Loi naturelle.
Ainsi que le dit saint Thomas d’Aquin : « Toutes choses dans l’Univers protégé par la Providence sont réglées par la Loi éternelle, mais l’individu qui participe aussi à cette loi est soumis à la Loi naturelle. Ce ne sont pas deux Lois différentes mais l’aspect universel et l’aspect particulier d’une seule et même Loi ». Qu’il s’agisse d’un sens ou de l’autre, la participation détermine le rôle que la créature “doit” jouer dans le monde. Omnia participant aliqualiter legem ceternam, scilicet ex impressione ejus habent incli-nationis in proprios actus et fines, et le fait que l’artisan est « naturellement enclin par la justice à accomplir fidèlement sa tâche » n’est qu’un exemple parmi bien d’autres de cette doctrine [13].
Il nous reste à esquisser en guise de conclusion une synthèse finale qui est explicite dans les textes de la doctrine hindoue et qui nous permettra de concilier quelques-unes des positions contradictoires qui ont été signalées. Vous avez pu remarquer la corrélation des termes karma et swa-karma employés ci-dessus avec ceux de dharma et swa-dharma. Là signification littérale du mot karma est “action”, “travail” ou “fabrication”. Or, de même qu’en latin facere et operare se réfèrent primitivement à un acte rituel, à “l’accomplissement d’actes sacrés” ou “saints” (sacra facere, “sacrifice”) le sens primitif de karma (qui n’est jamais entièrement perdu de vue) se réfère à l’accomplissement des rites sacrificiels qui sont les modèles de tout ce qui peut être fait. C’est un point de vue dont l’importance ne saurait être dépassée ; il implique de la part de celui qui le comprend une réduction complète de la distinction entre le sacré et le profane et de l’opposition de l’esprit et de la matière, une perception de toutes choses à la fois dans leur signification temporelle et dans leur signification éternelle. Il permet de satisfaire en même temps les besoins du corps et ceux de l’âme, comme dans les sociétés primitives et comme le demandait Platon, afin de constituer la République idéale. L’indistinction des activités et des fonctions sacrées et profanes caractérise toutes les cultures traditionnelles, même primitives, certains ordres monastiques et certains groupements comme celui des “Shakers” (trembleurs), et elle est souvent réalisée aussi par des mystiques isolés qui, comme les “Anges”, sont capables de mener une vie très active et très pratique, sans interrompre pour cela leur contemplation.
D’autre part, là où tout travail est déterminé par le système économique et les loisirs consacrés à la poursuite fiévreuse d’un plaisir que l’on n’a pu trouver dans le travail, les actes habituels de la vie, le fonctionnement de la pensée sont profanés, et seules certaines choses et certains moments, bien rares, sont considérés comme sacrés. Cette vie double ou plutôt cette moitié de vie est le symptôme visible de la schizophrénie et de l’amnésie modernes. Jam scio morbi tut maximan causant ; quid ipse sis, nosse desisti (Boèce, Consolation de la Philosophie).
Dans la vie plus unifiée des Indiens, le sens de l’existence ne s’est pas centré uniquement autour des rites particuliers. La vie elle-même a été traitée comme un rite significatif, et de ce fait, sanctifiée. C’est en citant l’exposé qu’en fait Ghora Angirasa à Krishna, fils de Dêvakî, que nous pourrons peut-être le mieux expliquer cette doctrine de la vie envisagée tout entière comme un sacrifice :
« Quand un homme a faim et soif et n’éprouve pas de plaisir, il fait son initiation. Quand un homme mange, boit et prend du plaisir, il participe aux sacrifices. Quand un homme rit, festoie, a des rapports avec une femme, il participe ainsi à la liturgie. Lorsqu’un homme est fervent, généreux, qu’il agit bien, ou ne fait pas de mal, ou dit la vérité, il donne ainsi son tribut aux prêtres. Aussi dit-on : Il engendrera, il a engendré. Et c’est ainsi qu’il renaît. La Mort est l’ablution finale [14], unum ex vitae officiis, mori (Sénèque, Ep. 77, jusqu’à la fin). Ta vision retourne au Soleil, ton mental dans le Vent. Adieu ».
Telle est la philosophie du travail enseignée par Krishna, fils de Dêvakî, dans la Bhagavad Gîtâ. Krishna lui-même, qui n’a rien à gagner par son travail, “travaille sans cesse” afin de maintenir l’existence du monde et de tous ses enfants « qui périraient si tous les hommes suivaient Ma voie ». Ainsi tous les hommes doivent travailler afin de sauvegarder leur existence et celle de la société. Quiconque agit, produit des résultats ou fruits qui peuvent être bons ou mauvais, et auxquels lui et les autres doivent goûter ; telle est la causalité engendrée par le karma. Mais on ne peut y échapper par l’inaction qui, de toute façon, est impossible. Le monde est enchaîné par tout ce qui est fait, sauf lorsqu’il s’agit d’un sacrifice offert dans le feu allumé par la connaissance, sacrifice meilleur que celui d’objets concrets. Ainsi donc, nous devons faire tout ce que la Nature nous demande d’accomplir, tout ce qui doit être accompli, mais sans nous inquiéter des conséquences sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir. Nous devons renoncer en sa faveur à toutes nos activités afin qu’elles soient siennes et non nôtres. Elles ne la toucheront pas plus qu’une goutte d’eau n’adhère à une feuille de lotus vernissée. On ne se libère pas par le mérite mais uniquement en travaillant, sans penser que le “je”, ce que j’appelle “moi-même”, est l’acteur. “L’inaction” ne consiste pas à ne rien faire, mais bien dans l’activité sans action. Quiconque pense ainsi est un homme “bridé”, un Yogî, même s’il fait tout. Le Roi Janaka atteignit à la perfection tout en menant une vie active. Donc, combattez, agissez. « Le Yoga est l’habileté dans les actes » [15].
C’est sur cette métaphysique de l’action que repose tout le système des castes de l’Inde. Mais, oublions pour un temps que les modes de vie occidentaux sont, superficiellement, si différents des nôtres. Y a-t-il dans les intentions de ces vies, dans les concepts de justice, de dignité et de bonheur quelque chose qui diffère tellement ? Y a-t-il dans cette philosophie du travail une chose qu’un individu quelconque peut ne pas admettre ? Il est vrai que dans un système de production industrielle organisé en vue du profit, dans lequel règne la “loi de la jungle”, l’envie et les luttes de classes sont peut-être inévitables. Mais c’est maintenant un système en voie de disparition, aussi catastrophiques que puissent en être les dernières convulsions. Il ne durera que tant que vous croirez encore en lui ; et je pense que votre foi dans un progrès automatique n’est plus tout à fait ce qu’elle était il y a cinquante ou même vingt ans. La période qui suivra dépend de ce que vous en attendez. La vie est une matière qu’il vous appartient de façonner, mais la forme que vous lui imposerez préexiste dans votre âme et c’est cette forme qui prévaudra. Aussi est-ce votre façon de penser actuelle, votre visée avant le saut qui importe. Au milieu du chaos vous êtes du moins libres de concevoir, comme nous l’avons fait, une société d’hommes qui gagnent tous leur vie en faisant ce qu’ils aiment le mieux au monde et vous penserez ainsi comme nous. Et n’est-il pas évident qu’il faut s’accorder sur la fin, si l’on veut obtenir une coopération efficace dans le choix et l’utilisation des moyens ? Il s’agit d’une « Alternative devant la Mort ». Je citerai cet extrait de la fin du livre du comte de Portsmouth qui porte ce titre :
« Nous avons beaucoup à apprendre de l’Orient depuis la grande exploitation agricole jusqu’à la haute philosophie. Nous avons commis un crime contre les pays orientaux en leur imposant avec arrogance des techniques et des idéologies étrangères d’une efficacité douteuse. Tôt ou tard, cet état de choses peut faire éclater la guerre la plus horrible de toute l’histoire… Peut-être parviendrons-nous encore maintenant à l’éviter en faisant preuve de générosité et de sagesse, en reconnaissant nos fautes… Nous ne pouvons le faire en manifestant seulement notre supériorité matérielle et technique, sans foi, sans montrer l’exemple… à l’Orient ; le choc de notre monde sur le monde oriental a engendré l’usure mécanique et inhumaine, la misère, l’industrie lourde. Du point de vue spirituel, nous avons été des iconoclastes… et, pour cela, bien plus que pour avoir été des conquérants, nous ne serons pas aisément pardonnés. Nous avons forgé les instruments de la vengeance… Si nous désirons éviter une grande guerre raciale… nous devons… mettre fin aux luttes fratricides des peuples européens en recouvrant la santé physique et spirituelle. Quels que soient les Dieux que nous adorons, la restauration de la Chrétienté n’est pas une tâche vile » (Alternative to Death, 1944, p. 179).
On a dit, non sans vérité, qu’à l’heure actuelle, tous les peuples orientaux redoutaient ou haïssaient l’homme blanc ; très certainement, ils n’ont et ne peuvent avoir confiance dans ses intentions ni dans ses promesses. Si nous avons si peur de la Chrétienté, c’est parce que votre civilisation chrétienne n’a du Royaume de Dieu que le nom. Réfrénez votre zèle de missionnaires ! Nous ne voulons pas vous imposer nos propres institutions. Notre rôle consiste seulement à vous rappeler l’existence de l’Homme oublié, de l’Homme commun dont vous invoquez le nom en vain lorsque vous venez à nous, la Bible dans une main et la doctrine du “laissez-faire” dans l’autre :
« Nous pensons qu’il est très beau de vouloir rendre tout le monde heureux. Mais il n’est pas pire égoïste que l’homme qui désire faire par la force le bonheur des autres. Il paraît se sacrifier aux autres, mais, en réalité, il sacrifie les autres à ses propres besoins, sans aucune pitié » [16].
Je vous dis donc : Comprenons-nous les uns les autres avant d’essayer de nous rendre mutuellement justice.
► Ananda K. Coomaraswamy, in : Approches de l’Inde : Tradition et incidences, 1949.
[trad. F. Berys & R. Allar de « The Religious Basis of the Forms of Indian Society », 1946 (version html) repris dans East and West and other essays, Ola books, 1947]
1. « Celui qui recherche la paix et le calme n’a rien à faire avec le commerce international » (G. H. Gratton et G. R. Leighton « The Future of Foreign Trade », Harpers Magazine, 1944). « Le système de libre entreprise et l’économie capitaliste mènent à la guerre » (Harold Laski, The Nation, 15 décembre 1945).
2. Franklin Edgerton, « Dominant Ideas in the Formation of Indian culture », Jaos, 62, 1942, p. 151-156.
3. Brihadâranyaka Upanishad I, 5-23 ; Katha Upanishad IV, 13. Les “Puissances” et “Divinités” auxquelles il est fait allusion sont les “formes aériennes” ou “facultés de l’âme” dont les noms se réfèrent à Ses actes plutôt qu’aux nôtres.
4. Bhagavad Gîtâ VI, 5-6 ; Dkammapada, 66 ; Ep. ad Romanos VII, 22, 23.
5. Vajasanéyi Samhitâ XX, 5 ; cf. Platon, République, 473 d ; cf. aussi mon « Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government », American Oriental Séries n°22, New Haven, 1942.
6. Bhagavad-Gîtâ XVIII, 49-54 ; dans les textes bouddhistes : brahma-bhûto = buddho.
7. À propos de cette sollicitude et de ces soins, cf. Hermès Trismégiste que je cite dans mon livre : Why Exhibit Works of Art ?, p. 53, n. 9 [recueil repris sous le titre Christian and Oriental philosophy of art, 1956].
8. Platon, République, 433 a-d ; cf. Charmide, 161 b ; République, 370 c, 441 d ; Protagoras, 322-323 et Lois, 689 c-d.
9. Voir références dans mon Hinduism and Buddhism, p. 41, n. 146, à Shatapatha Brâhmana, 1, 8, 1, 30, 31 ; Philon, Conf., 94 ; Dec., 119, etc.
10. Écclésiaste XXXVIII, 34 ; Saint Thomas d’Aquin, Summa contra Gentiles III, 135 : « Homo autem ex spirituali natura conditus est. Necessarium est igitur secundum dividam ordinationem, ut et corporales actiones exerceat et spiritualibus intendat : et tanto perfectior est quanto spiritualibus intendit » (Deux natures, l’une spirituelle et l’autre corporelle, constituent l’homme. Il est donc nécessaire, d’après le plan divin, qu’il fasse des actions corporelles, et qu’il s'applique aux choses spirituelles ; et il sera d’autant plus parfait que son application aux choses spirituelles sera plus soutenue).
11. Jean Giono, Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, 1938. « Quand les nations vieillissent, les arts se flétrissent et le commerce s’installe à chaque coin de rue » (William Blake). « Aujourd’hui la machine est devenue une chose terrifiante. On la voit partout j dans les champs, dans les fermes, dans les bureaux, dans les magasins, dans les usines. Et partout où elle se trouve, l’humanité est plongée dans les ténèbres du chômage et de la sous-consommation » (R. D. Knowles, Britain’s Problem, 1941). « Le travail de l’homme, aussi, a cessé de lui apporter un soutien spirituel, il n’est jamais seul en présence de tâches rendues plus chères par un travail lent et pénible, qui dure parfois des années ou même toute une vie… Ainsi le contact personnel, qui fait naître une intimité presque religieuse entre le travailleur et son travail, a été presque détruit, car la “chaîne mobile” ne permet qu’un contact impersonnel avec des milliers de pièces séparées d’un tout ; et le goût de l’artisan pour la qualité a été remplacé par celui de la quantité » (Betty Heimann, Indian and Western Philosophy, 1937, p. 134).
12. Sur “l’égalité proportionnée”, cf. Platon, Lois, 744 c, 757 c : Philon, Spec., IV, 165, 166, 231 et passim.
13. Summa Theologica II, I, 91, 2, etc. Notez surtout que la Loi Naturelle est la partie de la Loi Éternelle qui dirige chaque créature vers les activités et les buts qui lui conviennent.
14. Chhândogya Upanishad III, 17,1-5. En ce qui concerne l’interprétation sacrificatoire de l’acte des hommes bons, cf. Brihadâranyaka Upanishad, VI, 2, 13 ; VI, 4, I, 28, Chhândogya Upanishad, v, 8, Jaiminîya Brahmana, 1, 17, etc. La renaissance du sacrificateur est ou bien physique à partir de l’autel domestique ou spirituelle à partir de l’autel du sacrifice. Telle est la signification suprême de la distinction entre celui qui est né une fois et celui qui est né deux fois. Cf. Jean, III, 3-8.
15. Ce paragraphe est un résumé des chapitres IV et V de la Bhagavad Gîtâ. Cf. Saint Thomas d’Aquin, Summa contra Gentiles 111-135. « Praecipit ergo Dominus nos non debere esse sollicitos de eo quod ad Deum pertinet, scilicet de eventibus nostrarum actionum : non autem prohibuit nos esse sollicitos de eo quod ad nos pertinet, scillicet de nostro opere », paroles que nous retrouvons presque textuellement dans la Bhagavad Gîtâ II-47, IV, 20 ; VI, 7, etc.
16. Jean Giono, Lettre aux Paysans…, 1938, p. 67. Cf. W. Blake, The Spirit of Love : « Vous n’êtes au pouvoir d’aucun autre ennemi, vous n’êtes emprisonné par personne d’autre que par votre moi terrestre et n’avez besoin d’être délivré que de lui. Il est le seul meurtrier de la vie divine que vous portez en vous. C’est votre propre Caïn qui tue votre propre Abel. Tout ce que vous commande votre nature terrestre s’accomplit sous l’influence de votre obstination, de votre amour-propre et de votre égoïsme, que cela vous conduise à des actes louables ou blâmables ; tout cela se fait sous le signe de Caïn et vous donne la même bonté que celle de Caïn à l’égard de son frère ».

• “Paternité spirituelle” et “puppet complex” (1945)

• Présentation du texte : — Dans cette brochure, dont le but est d’indiquer dans quel esprit doit être abordée l’étude de l’art asiatique si on veut le comprendre réellement, l’auteur insiste de nouveau sur la notion de l’art traditionnel et normal, et sur ce qui le distingue des cas anormaux comme celui de la décadence “classique” et celui de l’art européen depuis la Renaissance. D’autre part, une étude soi-disant “objective”, c’est-à-dire en somme une observation purement extérieure, ne peut mener à rien en réalité, car il n’y a aucune véritable connaissance là où il n’y a aucune conformité entre le connaissant et le connu. Dans le cas d’une œuvre d’art, il faut donc savoir avant tout à quel usage elle était destinée, et aussi quelle signification elle devait communiquer à l’intelligence de ceux qui la regardaient. À cet égard, il est essentiel de se rendre compte que les apparences présentées par un art traditionnel ne sont pas le simple rappel de perceptions visuelles, mais l’expression ou la réalisation sensible d’une “contemplation” (dhyâna), qui est ce par quoi l’artiste travaille, et ce sans quoi le produit de son travail ne sera pas vraiment une œuvre d’art. Enfin, c’est une erreur de penser, comme le font généralement les modernes, que la répétition des formules transmises entrave les facultés propres de l’artiste, car celui-ci doit avoir réellement fait ces formules siennes par sa compréhension, ce qui est d’ailleurs le seul sens où l’on puisse parler de “propriété” quand il s’agit d’idées, et il les “recrée” en quelque sorte quand après se les être assimilées, il les rend conformément à sa propre nature. (R. Guénon, 1938).
***
[Ci-contre : Analogies entre les centres sacrés du corps humain et l'architecture védique ou Vastu Shastra : Le Cœur du Temple est ton propre Cœur]
Pour apprécier l’art de l’Asie dans son ensemble on doit avant tout comprendre qu’il ne représente pas seulement une autre section de l’art, mais aussi un art spécifiquement différent de ce que nous avons fini par entendre avec ce mot dans les temps modernes. Nous sommes tous par trop enclins à commettre l’erreur de regarder un exemple de l’art asiatique comme nous le faisons avec l’œuvre personnelle exhibée dans une exposition, oubliant que l’œuvre asiatique, détachée sur le moment de son environnement, fut toujours exécutée pour sa seule utilité et nullement pour figurer en un endroit autre que celui auquel elle était destinée. Il existe, en fait, comme on l’a assez souvent signalé, deux genres d’art très différents, l’un étant constant et normal et l’autre changeant et individualiste. Les arts traditionnels et normaux sont, grosso modo, ceux de l’Asie en général, ceux de l’Égypte, ceux de la Grèce jusqu’à la fin de la période archaïque, ceux de l’Europe médiévale et ceux du monde entier mentionnés collectivement comme arts des primitifs et comme art folklorique. Les arts anormaux sont ceux de la décadence classique et de l’Europe après la Renaissance.
L’œuvre asiatique a toujours vu le jour selon les circonstances, c’est-à-dire pour répondre à un besoin humain spécifique. On ne peut y établir une distinction tranchée entre un art raffiné et inutile et un art appliqué et utile comme on n’y trouve pas non plus quelque chose qui serait un art purement décoratif dans le sens d’une simple garniture dépourvue de toute signification. Tout ce que nous pouvons dire est que dans certaines œuvres prédominent les valeurs matérielles et dans d’autres les valeurs spirituelles, mais ces valeurs ne sont jamais exclusives les unes des autres. On ne peut non plus tracer une distinction logique entre les arts culturels et les arts folkloriques : la différence est une question de facture, et parfois de raffinement plutôt que de complication ou de contenu. En d’autres termes, bien qu’on puisse rencontrer des lois somptuaires, correspondant à une hiérarchie fonctionnelle, les nécessités fondamentales de la vie, physique et spirituelle, sont les mêmes pour toutes les classes. C’est pourquoi l’usage et la signification des œuvres d’art n’ont jamais besoin d’explication, l’artiste se distinguant de l’homme uniquement par la possession d’une connaissance et d’une habileté spécifiques.
Dans une mesure limitée, la pratique des divers arts est accessible à chacun ; par exemple, dans l’Inde médiévale, un ensemble de “soixante-quatre arts” était considéré comme essentiel pour l’éducation, et la peinture séculière en particulier était pour l’homme et la femme un art d’agrément aristocratique. De même, la peinture “lettrée” des sages taoïstes bien souvent pratiquée par plusieurs membres ou générations d’une même famille, n’était pas à proprement parler une activité professionnelle, étant choisie pour elle-même. Toutefois, la société asiatique est en général solidement fondée sur la vocation et n’est compréhensible que sur cette base : la pratique et les traditions des divers arts descendant en succession pédagogique de génération en génération, le père initiant le fils dans les mystères du métier. Ce dernier terme, comme dans l’Europe médiévale, impliquait beaucoup plus qu’une instruction purement technique, car la pratique de tout art traditionnellement transmis est essentiellement un rite. Pas seulement un gagne-pain mais une manifestation ordonnée des facultés spirituelles intérieures de l’individu concerné, dont la liberté — “la justice due à chaque homme tel qu’il est en lui-même” de Platon — réside dans le fait que c’est sa nature propre, dont dépend sa naissance dans une condition donnée, qui détermine et trouve son expression dans ses activités fonctionnelles. Sa vocation est alors le privilège particulier et le droit de chaque travailleur, pour qui seule est légitime la fonction donnée. C’est ainsi, par exemple, que fonder une cite sans être membre de la guilde héréditaire des architectes était considéré en Inde comme quelque chose de comparable à un meurtre, et si nous mettons dans la balance la nature de la construction moderne par des entrepreneurs visant le profit et non le “travail bien fait”, même à nous il semblera raisonnable de regarder le travail d’architectes irréguliers comme aussi dangereux que celui de médecins inexpérimentés. Or, en Asie ces principes demeurent valables pour la peinture ou la musique comme pour tout autre art “pratique” : c’est uniquement dans l’Occident moderne que les besoins de l’âme et de l’intellect sont abandonnés “sans dommage” au bon vouloir de l’amateur.
L’art de l’Asie présente des différences et liaisons stylistiques et des influences européennes l’ont plus d’une fois marqué. Un changement stylistique correspond en premier lieu à une caractéristique ethnique et en second lieu à la caractéristique des peuples concernés, toujours (historiquement parlant) en mutation. Nous disons des peuples plutôt que des individus parce que, dans le genre d’art que nous avons en vue, l’artiste n’exploite jamais sciemment sa personnalité, mais laisse seulement dans son œuvre la trace de son caractère, de la même façon qu’une idiosyncrasie se révèle dans l’écriture. La comparaison est appropriée, car en Extrême-Orient et en Perse l’art d’écrire, la calligraphie, a été haussé à un rang au moins aussi haut que celui de la peinture, et très au-dessus de la sculpture. Ce qu’il est loisible d’appeler le “style” demeure inchangé durant de longues périodes, et la plus grande expérience est requise pour distinguer le travail d’un scribe d’avec celui d’un contemporain. Les différences décelables ne tiennent pas à un goût personnel, mais représentent des degrés d’approximation par rapport au modèle ou canon qui est le même pour tous. Ainsi en va-t-il pour d’autres arts, comme par ex. celui de la danse, où la distinction entre exécutants supérieurs et inférieurs correspond à des degrés de virtuosité et non à des différences de thème et de manière. Le style est alors toujours l’accident et non la forme de l’art : les problèmes de style sont des questions dont l’importance est d’ordre psychologique et historique plutôt qu’artistique. Les préférences stylistiques sont une question de goût et ne sont pas à prendre comme base d’appréciation. La statuette est l’image de celui qu’elle représente et non celle de qui l’a exécutée.
Le problème des influences est quelque peu plus compliqué. Pour autant que des “influences” sont décelables dans une œuvre, il est évident que l’on a affaire à ce qui n’est pas réellement unifié ni correctement exprimé mais à un travail composite, hybride, qu’il est impossible de prendre en considération du point de vue de l’une ou l’autre source impliquée, de même qu’on ne peut sans inconséquence extraire d’une tradition artistique ou religieuse des formules qu’on introduira dans une autre. L’uniformité (consistency) symbolique est une condition primordiale de l’intégrité. C’est surtout vrai avec un mélange d’éléments tirés non seulement de styles ethniquement distincts, mais de deux genres d’art totalement différents et à des stades de développement tout aussi différents, ce qui précisément est arrivé dans les deux périodes, hellénistique et moderne, quand l’art asiatique a subi des influences occidentales avec des résultats comparables en insignifiance aux produits de l’européenne chinoiserie et des modernes archaïsmes ou primitivismes.
Il faut donc admettre comme présupposé qu’une œuvre asiatique trahissant une patente ressemblance avec quelque chose d’européen sera la dernière source où puiser une compréhension des véritables préoccupations de l’art. C’est, au contraire, là où l’art asiatique est le plus semblable au même genre d’art européen, le plus semblable à celui de la Grèce archaïque, de Byzance et de Rome, que des ressemblances superficielles sont le moins décelables. On est ici confronté à deux styles d’art nécessairement différents, parce que si nous pouvons agiter les mêmes pensées, nous ne pourrons les exprimer que selon la façon qui nous est propre, différents par le style mais par essence les mêmes, parce qu’ayant en vue les mêmes fins, et passant de la même façon des causes formelles à l’information de la matière. Dans l’art asiatique comme dans l’art médiéval, c’est le fond ultime (gravitas, artha) de l’œuvre qui est sa raison d’être et est à saisir si nous voulons comprendre, pas seulement aimer ou ne pas aimer. Un divorce de la beauté d’avec la vérité est inconcevable : beauty has to do with cognition ; la beauté de l’ouvrage, privilège inhérent à toute chose faite juste et bien, procure une légitime délectation, mais n’est jamais la fin poursuivie par l’artiste, dont l’immanquable souci fut d’exprimer son sujet non pas joliment mais adéquatement. Tout art significatif est significatif “de” quelque chose (significatif sans “de” n’a pas de sens) ; regarder des surfaces esthétiques comme fins en elles-mêmes est tout bonnement une forme de fétichisme, et c’est en pensant à cela que Platon demande si pertinemment : “À propos de quoi le sophiste est-il si éloquent ?” C’est précisément nos préoccupations idolâtres des surfaces esthétiques d’œuvres d’art, avec leur “histoire”, et notre indifférence pour leur contenu qui plus que tout entravent notre compréhension des arts normaux du monde. Notre fétichisme est si naïf, si profondément ancré en nous, que nous n’hésitons pas à affirmer que tous les autres peuples adoraient comme nous des objets inanimés, des coloriages et assemblages, comme dit Platon : “de belles couleurs et de beaux sons”. Nous qui sommes des “amants de l’art” oublions qu’adorer une peinture est une chose et que voir le “tableau qui n’est pas dans les couleurs” en est une autre, et c’est pour celle-ci qu’existe le travail matériel. Collectionner pour les seules valeurs esthétiques est mal user ou mésuser ; une pie en fait autant. L’art est linguistique et communicatif ; il est destiné à “informer” le spectateur, qui toutefois ne recevra la forme qui existait d’abord dans l’artiste que par un acte intellectuellement contemplatif analogue à celui grâce auquel la forme a été originellement conçue. Si vraiment, parmi ceux qui se veulent étudiants de l’art asiatique, ou de l’art “primitif”, quelqu’un pouvait acquérir une connaissance a priori de l’esthétique scolastique et la conviction que l’art est ni plus ni moins “la façon correcte de faire les choses”, on pourrait dire que pour comprendre l’art asiatique aucune préparation supplémentaire ne s’imposerait à lui. Malheureusement les arts de l’Europe chrétienne et médiévale sont, pour notre mentalité et sous tous les rapports, leur histoire exceptée, manifestement aussi arbitraires et mystérieux que ceux de l’Asie : les approches contemporaines de l’art médiéval ou asiatique sont les unes autant que les autres sentimentales.
Ce ne sera donc qu’avec une prise en considération des intentions de l’art asiatique et de la manière avec laquelle l’artiste aborde le problème formel présenté par les exigences des choses à exécuter en conformité des exigences spécifiques et spirituelles que nous pouvons espérer atteindre quelque réelle compréhension. En effet, à moins de savoir à quoi servait un objet et ce qu’il était censé devoir communiquer, nous manquons de base pour un jugement artistique. Celui-ci revient à savoir dans quelle mesure l’objet considéré a été bien et justement fait, et ce n’est certainement pas une question de goût à moins que notre goût n’ait été formé dans le domaine inhabituel au point que nous ayons appris à aimer ce que nous connaissons de préférence à connaître ce que nous aimons. Toute étude “objective” qui n’engage à rien, que ce soit celle de l’art ou de la nature, commence et finit dans l’ignorance (1) ; seule la connaissance comble l’observation quand il y a conformité du connaisseur et du connu, sans distinction, dans un acte unique d’existence. Tout comme il est exigé d’un artiste d’être d’abord ce qu’il veut représenter (et Dante est ici en termes exprès d’accord avec les prescriptions hindoues et chinoises), le spectateur à son tour connaîtra ce qui est représenté seulement quand il deviendra le thème de l’œuvre et verra qu’elle l’exprime lui-même.
Le problème de notre instruction en l’art asiatique passe ainsi du champ immédiat de l’art à celui de la culture générale qui trouve son expression dans tous les arts et dans l’organisation sociale. Du côté matériel, nous devons comprendre la manière de vivre de ceux pour qui les œuvres furent produites ; du côté spirituel, quelle signification et quels buts étaient tenus pour admis. Nous devons participer à l’expérience asiatique, nous doter pour le moment d’une complexion asiatique et regarder l’univers avec des yeux asiatiques. Si difficile que cela puisse paraître, ce n’est pas impossible ; et c’est certainement ainsi, et non dans la découverte de nouvelles sensations visuelles, si raffinées soient-elles, ni dans la satisfaction de visées décoratives jusqu’ici insoupçonnées, ni dans l’acquisition à n’importe quel prix de nouveaux modèles stylistiques à imiter, que résident pour nous les valeurs fondamentales de l’art asiatique.
Il va de soi que les exemples choisis de l’art asiatique sont techniquement admirables, et que beaucoup seront jugés beaux dès l’abord et de notre point de vue partial (tout point de vue local et datable, d’où l’on envisage les choses en fonction du passé et du futur ou du proche et du lointain, est forcément partial). Il est toutefois difficile de penser que cela seul justifie toutes les dépenses de temps et d’argent qu’implique la présence de telles œuvres d’art en Amérique. Au contraire, une collection d’œuvres d’art asiatique met directement en question notre trop facile supposition que l’art est un simple spectacle et dans un certain sens un moyen de fuir les tracas de l’existence. Chacune de ces œuvres est porteuse d’une signification et nous avertit sans ménagement que quelque chose ici n’est pas à voir, mais à connaître, et que nous pourrons très bien ne pas avoir vu si ce qu’elle affirme nous laisse insensible, sans changement. Chacune de ces œuvres nous gratifie d’un défi à l’égal de celui de Dante nous assurant que la Divina Commedia fut écrite en vue d’une fin strictement pratique, à l’égal de cet instinct profond qui nous fait préférer que les Écritures ne soient pas lues et la Messe non célébrée plutôt que lues pour leur seule valeur littéraire et entendue sans “recueillement”. Parce que ce ne sont pas des arts sentimentaux comme les nôtres ; ni humanistes ni naturalistes, ils ne sont pas non plus des illustrations de la littérature, ils sont intelligibles et expressifs par leur première intention. Leur vérité est une question de ressemblance non avec les formes visibles de la nature regardées comme des phénomènes sans rapport les uns avec les autres, mais avec les idées et significations qu’expriment ces mêmes formes naturelles. Du point de vue chinois la première fonction de l’art est de révéler l’intervention de l’Esprit (ch’i) dans les formes de la vie ; on a dit en Inde que tous les chants, sacrés ou profanes, réfèrent à Dieu, et que le véritable maître est celui qui révèle la présence de l’Esprit suprême (paramâtman) partout où s’attache le mental ; en Islam c’est la musique des sphères qui fait écho à la voix humaine et au luth, et toute forme séduisante de la nature ou de l’art tire sa beauté d’une source supra-mondaine. Inutile d’ajouter que ces conceptions du monde comme théophanie ne diffèrent en rien des traditions platonicienne et scolastique. En d’autres termes, la beauté des surfaces esthétiques, ou celles des formes naturelles qu’elles peuvent ou ne peuvent pas nous rappeler, est toujours un bien mais non pas un bien ultime ; les œuvres d’art sont comparables à des noix, et il faut les débarrasser de leur aimable écosse matérielle si l’on veut voir le tableau qui n’est pas dans les couleurs, de même que pour découvrir la nature telle qu’elle est en elle-même (cette nature dont l’art imite la façon d’opérer) “toutes ses formes doivent voler en éclat”. Les véritables intentions de l’art sont en fin de compte iconoclastes ; et c’est précisément dans ce sens que les formes anthropomorphes et naturalistes de l’art sont tout ce qu’il y a de moins artistiques. Ce n’est pas le rôle de la nature d’imiter ses propres effets, et l’artiste est comparable à l’Architecte divin précisément sous ce rapport, en œuvrant non pas au moyen d’idées qui lui sont extérieures, mais “grâce à un monde (2) conçu dans son intellect”. Il juge de ce que les choses doivent être, non par l’observation, mais “par leurs idées”, qu’il lui faudra d’abord concevoir en des formes imitables. La perfection de l’art est vraiment atteinte quand l’opération intellectuelle, l’art dans l’artiste, ce avec quoi il œuvre, devient elle-même toute la forme de l’œuvre à exécuter, qui alors émane de l’artiste sans calcul. On a ainsi la signification du chinois “vol du dragon” et l’effacement de l’artiste lui-même. Car s’il y a une suprême perfection vers laquelle tendent toutes les choses, celle de l’Un dont les formes de l’intellect sont déjà des vies, bien que n’étant pas faites avec les mains ni suivant un modèle extérieur — alors parler d’un “art créatif” humain signifie que la liberté et la spontanéité relatives de qui est en pleine possession de son art (c’est-à-dire en qui la forme de la chose à exécuter existe dans tous ses détails) et la “vie” de l’œuvre même (qui est pareille à la vitalité de son auteur), sont vraiment des imitations de cette nature dans sa façon d’opérer et dans ses effets.
Il est alors de première importance, afin d’éviter le risque d’un complet malentendu, de comprendre que les manifestations de cet art ne sont pas, ou le sont seulement par accident et incidemment, une réminiscence de perceptions visuelles. Il n’y a là aucune étude d’un modèle qui pose ni un quelconque enregistrement de fugaces effets de lumière. Tous les thèmes qui appartiennent à un “genre” sont étrangers à cet art ; le nu, par ex., n’est jamais représenté pour lui-même mais uniquement quand le thème l’exige, et on ne peut non plus expliquer ce fait avec des considérations d’ordre moral alors que le symbolisme sexuel est assez librement utilisé à des fins doctrinales. Même un paysage (landscape) n’est pas une “échappée” (scape) comme nous l’entendons, mais plutôt comme un entretien allusif (et pas seulement pour nous élusif) sur les principes conjoints de l’existence. Quand nous parlons d’une “évolution” ou d’un “progrès” artistique, gardons-nous de tomber dans l’erreur courante qui consiste à regarder l’art des Anciens et des Asiatiques comme une tentative défectueuse (inadequate) dans l’espèce de travail descriptif que nous présumons tacitement avoir toujours été le but de tout art. Nous n’avons pas à nous flatter en disant que “ce fut avant qu’ils ne connaissent un brin d’anatomie”, ou à déplorer que les règles de la perspective étaient ignorées, oubliant que nos préoccupations médicales ou topographiques pouvaient ne pas intéresser celle que nous jugeons. Abstenons-nous de supposer que la composition a été fixée uniquement dans une recherche d’agrément (comfort) comme chez nous, et comprenons que dans un art significatif la composition est une question de relations logiques entre les parties et que, si le résultat et plaisant, c’est peut-être non pas parce que le plaisant a été recherché, mais parce qu’il y a des principes d’ordre communs à la pensée et à la vision, ou, en d’autres termes, parce que la vérité, qu’elle soit mathématique ou métaphysique, ne se laisse exprimer qu’admirablement. Ce n’est point à dire que les arts — même les plus abstrus — ne soient pas à proprement parler “imitatifs”, mais dans l’art, en tant que distinct d’une figuration descriptive et scientifique, la “ressemblance” se rapporte à la “forme” (3), et le mimétisme présuppose ainsi l’existence de symbolismes naturellement appropriés (adequate), visuel ou auditif, géométrique ou naturel, dès lors que dans cette conception de la vie des analogies sont attribuées à tous les niveaux de référence. C’est en vérité pourquoi les formes manifestement naturalistes, celles notamment des montagnes, des nuages ou des animaux et pareillement toutes les relations humaines quelles qu’elles soient, sont à l’égal des formes géométriques, utilisables dans la communication de significations autres que celles qui sont strictement physiques.
En considérant une œuvre d’art inaccoutumée, nous devons présumer qu’elle avait nécessairement un but puisque le parti inverse reviendrait à penser que le besoin de son existence faisait défaut. Pour comprendre sa forme véritable d’un point de vue spécifiquement technique (artefactual) nous avons à considérer d’abord la forme de l’œuvre telle qu’elle préexiste dans la conscience de l’artiste. Cette raison d’être ou idée de la chose reste dans l’artiste quel que soit le sort de l’objet (même s’il ne l’exécute jamais), et en puissance dans la nature humaine jusqu’à la fin des temps. S’il en était autrement nous devrions convenir que seul l’artiste et nul autre est censé comprendre le travail de ses mains. La manière avec laquelle cette forme imitable du sujet est conçue sera bien entendu modifiée selon la nature du matériau utilisé, un homme par exemple sera figuré en couleur autrement que dans la pierre, et une suite d’événements en paroles autrement qu’avec des gestes. La représentation (image) de la chose à exécuter sera aussi, comme nous avons vu, influencée par la nature de l’homme qui l’exécute et concevra forcément son idée à sa façon. Pour finir, la configuration (shape) de l’œuvre achevée sera en partie marquée par la dextérité plus ou moins grande de l’artiste, laquelle est sa cause aussi bien efficiente que formelle, mais cela aussi, la dextérité étant admise et, en général, tout homme est adroit de ses mains, est un facteur d’importance secondaire. En résumé, l’essentiel pour juger de l’art est une connaissance de la forme d’après laquelle on a œuvré.
Le désir du mécène ayant été agréé (une question facile dans les sociétés unanimes, où la seule distinction entre mécène et artiste tient au fait que l’un sait ce qui est à exécuter et l’autre comment l’exécuter), l’opération de l’artiste sera double, consistant d’abord en une activité intellectuelle par laquelle la forme appropriée est conçue, et ensuite en une imitation de cette forme dans le matériau choisi. Comment la forme et le modèle de l’œuvre à exécuter ont-ils été choisis ? L’on peut dire qu’ici plus qu’ailleurs réside le “secret” de l’art. L’opération intellectuelle est principalement une activité, et non une question de passive “inspiration” ou de “tempérament” ; l’acte imaginatif est en effet un acte rituel, dont le succès dépend d’une exécution méticuleuse. Jusqu’à un certain point, en effet, le rite est identique à tous égards à celui de la “subtile adoration” dans laquelle l’objet de dévotion (qui dans le cas de l’artiste sera le principe du thème ou travail à exécuter) est visualisé en fonction d’une incantation appropriée (ou, du point de vue de l’artiste, d’une “prescription” appropriée). En d’autres mots, l’artiste conçoit l’idée de l’objet sur lequel se porte sa volonté sous une forme imitable ; si, par exemple, il pense “eau” ou “possibilité”, il voit une spirale, et s’il pense à la terre il voit un lotus, s’il pense “lumière” il voit de l’or, s’il pense au “Monde” il voit une roue, s’il pense au Soleil il voit un aigle ou un cheval, s’il pense à l’aurore, il voit une fiancée, s’il pense au Père il voit un Dragon. Avant même que l’arbre soit abattu, il a de la statue terminée une image mentale claire et précise. Pour que cela soit possible, il importe qu’il ne soit pas distrait par des désirs ou idées égotiques et c’est ce que signifie : “peindre sans vanité dans le cœur”. Il doit être transféré dans ce qu’il imagine, restant lui-même seulement en puissance. Comme disent les livres hindous, il lui faut être habile en dhyana-yoga. Inutile sera “l’observation”, car dans l’univers aucune chose n’est à proprement parler imitable ; on ne peut reproduire un arbre en y pensant, et les idées n’étant pas localisables, peuvent seulement être nourries» (entertained).
Le terme dhyâna, en chinois tch’an, en japonais zen et contemplatio dans le yoga chrétien a pour synonyme “art dans l’artiste”, ou simplement “art” avec le sens de ce par quoi l’artiste travaille et ce qui est fait est un travail de l’art. Le monde lui-même est une création contemplative : “Il pensa les choses et, voyez, elles sont” ; connaître le vrai “nom” d’une chose, c’est l’évoquer. Quand les constructeurs de l’autel du feu, lequel est une imitation du cosmos et une synthèse de tous les arts de la même façon qu’une cathédrale, sont dans l’embarras à l’une ou l’autre phase, les dieux les exhortent à “réfléchir”. Comme Tchouang Tzû le déclare aussi, “Voir d’abord mentalement et ensuite avancer”, d’accord avec l’aphorisme hindouiste ultérieur : “D’abord la vision et ensuite la tâche” (dhyâtvâ kuryât) ; et ces conceptions de ce que l’on appelle en esthétique scolastique les “premières et secondes” ou “libres et serviles” opérations artistiques se retrouvent d’un bout à l’autre de la littérature asiatique sur l’art. Kouo Hsi, notamment, note que le peintre “se confondant avec les montagnes et les rivières saisit leur idée (i) et ainsi voit mentalement l’idée du paysage” ; il dit aussi que “saisir l’idée est difficile”, ce qui nous rappelle un passage du Genji Monogatari où le héros remarque qu’il ne lui a pas été facile de représenter “l’idée” ou “intention” (en japonais kokoro, en chinois i) des scènes qu’il s’est efforcé de dépeindre. On peut résumer toute la situation avec ces mots d’Eckhart : “Pour qu’elle soit exprimée correctement, une chose doit venir de l’intérieur, mue par sa forme” (latin forma = grec eidos), ou de saint Augustin : “C’est par leurs idées que nous jugeons ce à quoi les choses doivent ressembler”. C’est pleinement dans ce sens, et non dans celui communément reçu de “remédier aux imperfections de la nature”, que l’art traditionnel est un “idéal”.
Il est d’une grande importance de mettre en évidence l’accord de ces conceptions avec une autre particularité des arts traditionnels de l’Asie et d’ailleurs, une particularité que le dernier des canons de Hsieh Ho définit commodément : “Renouvelle des formes transmises”. Il n’est pas du tout rare que l’observateur moderne pense que ces arts, dans lesquels les mêmes motifs sont exprimés et les mêmes symboles utilisés pendant des millénaires, sont monotones, de même qu’il pense à une civilisation stable comme étant inerte, voire à la connaissance comme étant inférieure à la recherche. Sous ce rapport, l’observateur moderne, accoutumé à l’idée de propriété artistique, fasciné et troublé par le prestige du génie, et en dépit du robotisme de son entourage, parle de clichés et de modèles “stéréotypés”. Il voit dans la soumission de l’artiste une sorte d’asservissement, étant incapable de concevoir ce que signifie “peindre sans vanité dans son cœur” (Kouo Hsi), et toute idée “d’autorité” est ainsi prise en mauvaise part. À ces affirmations une admire réponse est donnée en ces termes par Keyserling : “L’immense majorité des Orientaux a recours à des citations quand ils désirent exprimer une expérience directe, ce qui ne dénote pas chez eux comme chez nous de l’impuissance ou un manque de goût ; ce trait signifie que l’âme se reconnaît maintes et maintes fois dans certaines manifestations éternelles comme la Nature se renouvelle continûment, avec une constante originalité”. De nouveau, nous comprenons combien il est vrai que l’art est une imitation de la nature dans sa manière d’opérer. Comme le printemps succède au printemps sans monotonie, le peuple à qui des modèles “identiques” ont été transmis de génération en génération pendant des millénaires reproduit des choses du même genre sans être jamais pareilles.
L’artiste traditionnel n’est pas un archaïsant, étant parfaitement fondé à penser que les formes qu’il utilise sont les siennes parce qu’il les a faites siennes, et on ne peut concevoir un autre génie de propriété dans le domaine des idées. La preuve de la liberté artistique réside dans le fait que jusque dans les arts les plus conservateurs on reconnaît toujours et sans peine des styles locaux et des enchaînements stylistiques ; c’est dans l’art académique et non dans les arts traditionnels que l’artiste est asservi. Choisir des sujets n’est pas le privilège de l’artiste comme tel ; c’est la liberté du mécène, et ce serait pur sentimentalisme que de définir la relation normale de l’artiste avec l’homme (exprimée par la maxime d’Aristote : “la fin générale de tout art est le bien de l’homme”) comme une privation d’indépendance. C’est celui qui prend un style comme norme qui est un copiste et non celui qui poursuit des fins permanentes (fixed). Lorsque la signification logique des formules qui ne sont en aucun sens les “nôtres” est oubliée, le symbole devenant alors une simple “forme d’art” ou “ordre” cf. les effets désastreux que la danse “orientale” et la sculpture “africaine” ont eus sur nous c’est alors qu’on est en droit de parler pertinemment d’imitation dans un sens péjoratif. Des exemples d’une telle activité comparable à celle d’un perroquet abondent parmi nous. Il suffira de mentionner la construction de palais gouvernementaux, de musées, de bureaux de poste, à l’imitation de temples grecs, ou la reproduction de “meubles de style”, avec quoi il est confessé sans ambages que nous n’avons pas d’idées qui sont “nôtres”. Il n’en va pas autrement quand intervient une expression individuelle de soi ou une originalité calculée, car plus la nature d’un homme est réduite et identifiée à la diversité et plus nous nous acheminons vers une mentalité de troupeau, vers le commun dénominateur le plus bas. On est en droit d’affirmer que, si dans les sociétés unanimes il y a diversité dans la ressemblance, dans les sociétés individualistes il y a uniformité dans toute variété. Ce qui dans les arts traditionnels nous semble une question de mémoire et une fastidieuse répétition est en réalité une re-création dans le double sens du terme (4). Si nous ne pouvons supporter d’entendre sans lassitude la même histoire racontée plus d’une fois, c’est l’indice de l’ennui d’hommes d’affaires fatigués.
Ce que nous avons dit ci-dessus sur l’acte imaginatif est décrit traditionnellement comme étant une dérivation de toutes les formes d’art à partir de niveaux de référence supramondains. L’assertion hindouiste que “tout travail d’art, par exemple un vêtement ou un char, est exécuté ici-bas en imitation des œuvres d’art angéliques”, s’accorde presque mot pour mot avec celle de Plotin disant que “toute musique est une représentation terrestre de la musique contenue dans le rythme du Royaume idéal” et que “des métiers tels que la construction et la charpenterie... puisent leurs principes dans ce royaume et ce qui s’y conçoit”. De même, le commandement de l’Exode, XXX-40 : “Exécute toutes choses d’après le modèle qui t’a été donné sur la montagne” fournit à Tertullien l’occasion de remarquer que le Chérubin et le Séraphin “ne furent par aperçus sous la forme qui provoqua l’interdiction (de l’idolâtrie)”. Les textes hindouistes vont jusqu’à parler des prototypes intellectuels ou angéliques comme étant une “conformation spirituelle”, jusqu’à dire qu’au moyen de constructions humaines correspondantes se réalise une analogue auto-intégration “métrique”, “humaine” et “bienheureuse” (chandomaya). Il est de fait que c’est précisément par son caractère “rythmique” que quiconque participe à un rite (qui est toujours une œuvre d’art) est élevé au-dessus de lui-même à de plus hauts niveaux de l’existence — extensions du mode humain s’il est simplement “présent”, mais même aux niveaux d’une lumière suprahumaine s’il “comprend”, c’est-à-dire si sa conscience se conforme réellement et activement à la teneur finale de l’opération qu’implique le travail du rituel et de l’art. Chaque travail d’art est sous cet angle à l’état potentiel un “support de contemplation”, la beauté formelle de l’œuvre conviant le spectateur à l’accomplissement d’un acte spirituel qui lui est propre, dont l’œuvre d’art fut seulement le point de départ. En général, nous commettons l’erreur d’attendre de l’œuvre d’art qu’elle fasse quelque chose à nous et pour nous, au lieu de repérer en elle un simple poteau indicateur sur une route que chacun ne pourra suivre que pour lui-même.
En résumé, il ne pouvait s’agir d’esquisser ici quelque chose comme un compte rendu descriptif ou historique de l’art de la moitié de l’humanité et durant au moins six millénaires. Tout ce que nous avons essayé fut de dégager la signification centrale de l’idée de l’art régnant dans ce milieu. Les arts asiatiques diffèrent non pas de ceux que nous voyons ailleurs mais de ce avec quoi nous sommes familiarisés ; ce n’est pas seulement une question de différence ethnique et stylistique, mais Weltanschauung (5) tout à fait différente de la nôtre. La signification et la valeur possible de ces arts pour nous ne résident pas réellement dans ce qu’ils sont, nous laissant libres de les aimer ou pas, mais dans ce pour quoi ils existent, ce que nous pouvons ignorer mais à notre détriment. Tels qu’ils existent ce ne sont que des fragments extraits d’un contexte splendide, compréhensibles seulement dans la mesure où nous sommes capables de reconstituer ce contexte, d’y prendre part et d’arriver à saisir la nécessité de toutes ces corrélatives manifestations. Le résultat final de l’art asiatique est une organisation de la vie à l’image d’un canon éternel. Tout le dispositif de cette vie, dont si peu est vu dans les livres ou musées, et même par le voyageur, a été conditionné et déterminé d’un point de vue d’où l’on peut référer à leurs raisons transcendantes les plus humbles nécessités de l’existence. Nous ne voulons pas dire qu’il y a quelque chose d’illégitime et de méprisable dans la jouissance de ces œuvres d’art pour ce qu’elles sont, s’ils flattent notre goût ou excitent notre curiosité; nous sommes parfaitement libres de les considérer comme du bric-à-brac ou comme des sources d’information historique ; l’approche archéologique est certes de toute apparence plus saine que celle de notre esthétisme psycho-analytique. Il est sans doute vrai que nous ne savons plus faire usage de ces fragments épars d’une vie ordonnée de la façon avec laquelle ils étaient à utiliser. Néanmoins, il peut être bon de comprendre que dans les arts asiatiques et leurs pareils il y a plus que ce qu’y rencontrent les yeux et qu’il y a peut-être rien moins qu’une nourriture humaine suffisante dans les autres arts qu’on est en droit de regarder comme de simples formes d’amusement, si raffinées soient-elles, et dont toute la signification se limite à vrai dire à celle de leurs surfaces esthétiques.
► Ananda Coomaraswamy, Asiatic art, brochure publiée par The New Orient Society of America, 1938.
[traduit de l’anglais et annoté par René Allar, publié dans Être n°2/1982. Texte repris avec « Athena & Hephaistos » dans le fascicule Traditional Doctrine of Art, Golgonooza Press, Ipswich, 1977]
Notes
1. D’une fin spirituelle.
2. Un monde (world) et non pas un mot (word), évidente faute d’impression dans l’édition que nous utilisons.
3. Il n’est peut-être pas superflu de souligner que l’auteur emploie le mot “forme” au sens scolastique par opposition ou corrélation au mot “matière”. C’est ce par quoi les choses sont déterminées à une certaine manière d’être. On distingue sous ce rapport la forme extrinsèque, celle par laquelle une chose est déterminée de l’extérieur comme dans le cas d’une statue, et la forme intrinsèque, qui détermine l’être de l’intérieur comme l’âme raisonnable est la forme de l’être humain. Dans l’expression sanscrite nâma-rûpa, nom et forme qui désigne l’union des deux éléments constitutifs de l’individualité, le premier terme correspond au latin forma tandis que le second qui signifie “forme” est l’équivalent du latin materia.
4. L’anglais recreation signifie re-création et récréation.
5. En allemand : conception du monde.

 La beauté est un état de l'âme
La beauté est un état de l'âmeOn estime habituellement que les objets naturels, hommes, animaux, paysages, et les objets artificiels, usines, tissus, œuvres faites dans une intention d’art, peuvent être classés en deux catégories : ils sont beaux ou laids. Et pourtant, nul principe général de classification n’a jamais été découvert, et ce qui semble beau à l’un est jugé laid par un autre. Comme le dit Platon, « chacun choisit ce qu’il aime parmi les objets de beauté, selon son goût propre ».
Prenons, par exemple, le type humain : chaque race et, jusqu’à un certain point, chaque individu a son idéal unique. Et nous ne pouvons jamais espérer être d’accord : nous n’allons pas attendre de l’Européen qu’il préfère les traits mongols, ni du Mongol qu’il préfère les traits européens. Sans doute, il est aisé à chacun d’affirmer la valeur absolue de son goût et de mépriser les autres types ; comme le héros de la chevalerie, soutenant par la force des armes que la beauté de la dame de ses pensées surpassait toutes les autres. Les différentes sectes défendent également la valeur absolue de leur éthique propre. Mais il est clair que ces prétentions ne sont que des préventions : comment décider quel idéal racial ou moral “vaut le mieux” ? Il serait trop facile d’affirmer que le nôtre est le meilleur ; tout au plus, avons-nous le droit de croire qu’il est le meilleur pour nous. Cette relativité n’est nulle part mieux exprimée que dans la réponse classique attribuée à Majnoun quand on lui disait que sa Lailâ n’était rien moins que belle aux yeux du monde : « Pour voir la beauté de Lailâ, il est nécessaire d’avoir les yeux de Majnûn ».
Il en est de même pour les œuvres d’art. Des artistes différents sont inspirés par des objets différents ; ce qui attire ou stimule l’un, déprime ou repousse l’autre, et le choix varie de racé à race et d’époque à époque. De même aussi pour l’appréciation, caries hommes n’admirent généralement que les œuvres auxquelles ils ont été prédisposés par leur éducation ou leur tempérament. Entrer dans l’esprit d’un art qui ne vous est pas familier exige un effort que, pour la plupart, nous ne sommes pas disposés à faire ; l’humaniste commence ses études, convaincu que l’art de la Grèce n’a jamais été surpassé ni égalé et qu’il ne le sera jamais ; beaucoup pensent, comme Michel-Ange, parce que la peinture italienne est bonne, que toute bonne peinture est italienne. Beaucoup n’ont jamais senti la beauté de la sculpture égyptienne, de la peinture et de la musique indienne ou chinoise : mais qu’ils aient aussi la hardiesse de nier cette beauté, cela ne prouve rien.
Il est possible aussi d’oublier que certaines œuvres sont belles, ce qui arriva au XVe siècle pour la sculpture gothique et la peinture des Primitifs italiens : le souvenir de leur beauté n’a été retrouvé que par un grand effort dans le courant du XIXe siècle. Il peut se faire encore que, pour maints objets naturels et pour maintes œuvres d’art, l’humanité apprenne très lentement à leur découvrir de la beauté ; l’Occident n’a pas su apprécier esthétiquement le désert et la montagne avant le XIXe siècle, et les plus grands artistes ne sont compris souvent que longtemps après leur mort. Ainsi, plus nous considérons la variété du choix humain, plus nous sommes forcés d’admettre la relativité du goût.
Pourtant, il reste des philosophes fermement convaincus de l’existence d’une Beauté (rasa) absolue, comme d’autres soutiennent la conception d’une Vérité et d’un Bien absolus. Ceux qui aiment Dieu, identifient ces Absolus avec Lui, et affirment qu’il ne peut être connu que comme Beauté, Vérité et Amour parfaits. En général on estime également que le vrai critique (rasika) est capable de décider quelles œuvres d’art sont belles (rasavant) ou non, ou plus simplement de distinguer les œuvres de génie de celles qui n’ont pas droit à ce titre. Et cependant, nous sommes obligés de reconnaître la relativité du goût et le fait que tous les dieux (devas et Içvaras) sont modelés à la ressemblance de l’homme.
Il nous faut donc résoudre cette contradiction apparente. Nous n’y parviendrons qu’en employant une terminologie plus exacte. Jusqu’ici j’ai parlé de “beauté” sans définir ce que j’entendais par là et me suis servi d’un seul mot pour exprimer des idées multiples. Nous ne voulons pas dire la même chose quand nous parlons d’une belle femme et d’un beau poème ; et la différence de sens est encore plus évidente si nous parlons de beau temps et de beau tableau. En réalité, la conception de la beauté et l’adjectif “beau” appartiennent exclusivement à l’esthétique et ne devraient être employés que quand il s’agit de jugement esthétique. Nous faisons rarement un jugement pareil quand nous disons des objets naturels qu’ils sont beaux ; généralement, nous entendons par là que ces objets nous plaisent, pratiquement ou éthiquement. Trop souvent, nous préférons juger une œuvre d’art de la même façon : la trouvant belle, si elle représente un objet ou une forme d’activité qui excite vraiment notre sympathie, ou si elle nous séduit par la délicatesse ou l’éclat du coloris, la suavité des sons, ou le charme des mouvements. Mais quand nous énonçons ainsi un jugement sur la danse d’après notre penchant pour le charme ou l’adresse du danseur, ou le sens de la danse, nous n’avons pas le droit de nous servir du langage de l’esthétique dans une œuvre d’art les éléments utiles, stimulants et moraux. N’oublions pas que l’acteur qui joue le traître dans la pièce est peut-être un plus grand artiste que celui qui joue le héros. Car la beauté, selon le mot profond de Millet, ne naît pas du sujet de l’œuvre d’art, mais de la nécessité qu’a éprouvée l’artiste de représenter ce sujet.
Une œuvre d’art ne devrait être traitée de bonne ou de mauvaise que par rapport à sa qualité esthétique ; le sujet et les matériaux seuls sont pris dans les mailles de la relativité. En d’autres termes, dire qu’une œuvre est plus ou moins belle ou rasavant, c’est définir jusqu’à quel point elle est œuvre d’art et non simple illustration. Quelle que soit l’importance en elle de l’élément séduction ou de ses applications pratiques, en cela ne consiste point sa beauté. Qu’est-ce donc que la Beauté, qu’est-ce que le rasa, et qu’est-ce qui nous donne le droit de dire d’œuvres diverses qu’elles sont belles ou rasavant ? Quelle est la seule et unique qualité que les œuvres d’art les plus dissemblables possèdent en commun ?
Rappelons l’historique d’une œuvre d’art. Il faut d’abord : 1) une intuition esthétique de la part de l’artiste original : poète ou créateur ; puis, 2) l’expression intérieure de cette intuition, — la vraie création ou vision de la beauté ; 3) l’indication de cette beauté par des signes extérieurs (langage), avec l’intention de la communiquer, — c’est l’activité technique pure. C’est seulement en jugeant esthétiquement l’œuvre d’art que nous pouvons parler de la présence ou de l’absence de beauté dans cette œuvre, que nous pouvons l’appeler ou non rasavant ; quand nous la jugeons du point de vue de son action pratique ou éthique, nous devrions faire usage de la terminologie correspondante et dire, du tableau, du chant, ou de l’acteur, qu’ils sont ou non séduisants, de l’action qu’elle a de la noblesse, la couleur de l’éclat, le geste de la grâce, et ainsi de suite ; on verrait ainsi que nous ne parlons point de l’œuvre d’art, mais que nous jugeons seulement les parties séparées, les matériaux qui la composent, les formes d’activité qu’ils représentent ou les sentiments qu’ils expriment.
Il va de soi que rien ne nous empêche de nous laisser influencer par des considérations d’éthique ou de sympathie, quand nous choisissons des œuvres d’art pour notre agrément particulier. Pourquoi l’ascète s’exposerait-il au tourment en suspendant dans sa cellule une figure nue, pourquoi le général ferait-il exécuter une berceuse la veille d’une bataille ? Quand tous les ascètes et tous les généraux seront devenus artistes, nous n’aurons plus besoin d’œuvres d’art ; en attendant, une sélection éthique quelconque est permise et nécessaire. Mais en opérant cette sélection, nous devons savoir exactement ce que nous faisons, si nous voulons éviter une infinité d’erreurs dont la plus néfaste est cette forme de la sentimentalité qui trouve essentiels enfin, 4) le stimulant qui en résulte pour le rasika ou critique, et le pousse à reproduire l’intuition originale ou ce qui en approche.
La source de l’intuition originale peut, nous l’avons vu, se trouver dans n’importe quel aspect de la vie. Ainsi, à l’un des créateurs, les écailles d’un poisson suggéreront un dessin rythmique ; un autre est ému par certains paysages ; un troisième choisit comme sujet de misérables masures ; un quatrième chantera des palais ; un cinquième exprimera l’idée que toutes choses s’enchaînent, s’enlacent, énamourées, sous forme de Danse Universelle, ou bien il rendra cette même idée, avec une égale intensité, en disant qu’ « un seul passereau ne tombe point sur le sol sans que notre Père le sache ». Chaque artiste découvre la beauté et chaque critique la retrouve quand il goûte la même révélation par l’intermédiaire des signes extérieurs. Mais où est cette beauté ? Nous l’avons vu, on ne peut prétendre qu’elle existe dans certaines choses à l’exclusion d’autres ; il est donc permis d’affirmer que la beauté est partout ; et je ne le nie point, mais il me paraît préférable et plus clair de dire qu’il est possible de la découvrir partout. Si on pouvait déclarer qu’elle existe partout dans un sens matériel et intrinsèque, nous n’aurions qu’à la poursuivre avec des appareils photographiques et des balances, comme on fait en psychologie expérimentale. Mais alors, nous n’acquérerions qu’une certaine connaissance du goût moyen : nous ne découvririons pas la façon de distinguer les belles formes de celles qui ne le sont point. La Beauté ne se peut ainsi mesurer, car elle n’existe pas hors de l’artiste lui-même et du rasika qui parvient à la même révélation (1).
Toute architecture est ce que vous y faites quand vous la regardez,
(Pensiez-vous qu’elle était dans la pierre blanche ou
grise ? Ou les lignes des arceaux et corniches ?)
Toute musique est ce qui s’éveille en vous quand les instruments vous remémorent,
Ce ne sont pas les violons ni les cornets… ni la partie du baryton…
C’est plus proche et plus loin que cela.Walt Whitman, Un Chant pour les Emplois (in : Feuilles d'herbe, 1855)
Une fois les considérations de sympathie mises de côté, il reste encore une valeur pragmatique à la classification des œuvres d’art en belles ou laides. Mais que voulons-nous dire exactement par ces termes appliqués à des objets ? Dans les œuvres d’art que nous appelons belles, nous reconnaissons une correspondance entre le thème et l’expression, entre le fond et la forme ; tandis que dans celles que nous traitons de laides, nous trouvons que le fond et la forme sont en désaccord. Cependant, cette correspondance ne va jamais, dans le temps et dans l’espace, jusqu’à l’identité : c’est notre propre activité qui, en présence d’une œuvre d’art, complète la relation idéale et en ce sens, la beauté d’une œuvre est “ce que nous y faisons”, plutôt qu’une qualité qui y serait présente. Par rapport à cet objet, “plus” ou “moins” beau sont des mots impliquant une correspondance plus ou moins grande entre le fond et la forme : et c’est tout ce que nous pouvons dire de l’objet comme tel : en d’autres termes, cet art est bon, qui est bon dans son genre. Dans le sens le plus strict d’activité esthétique intérieure et achevée, la beauté cependant est absolue et ne peut avoir de degrés.
La vision de la beauté est spontanée, comme la lumière intime de l’amant (bhākta). C’est un état de grâce qui ne peut être atteint par un effort conscient ; mais il est peut-être possible d’écarter les obstacles qui s’opposent à sa manifestation, et maints témoignages prouvent que le secret de tout art se trouve dans l’oubli du moi (2). Nous savons que l’on ne parvient pas à cet état de grâce par la poursuite du plaisir ; les hédonistes ont leur récompense, mais ils restent esclaves de la forme séduisante ; tandis que l’artiste est libre, dans la beauté.
Remarquons en outre que, quand nous parlons sérieusement de la beauté d’une œuvre d’art, la considérant en vérité comme telle, en dehors de toute association, du sujet, ou du charme technique, nous employons encore une formule elliptique. Nous entendons par là que les signes extérieurs : poèmes, peintures, danses, etc., nous aident d’une façon effective à nous “remémorer”. Nous pouvons dire que leur forme est significative. Mais c’est indiquer simplement qu’ils possèdent cette sorte de forme qui nous remémore la beauté, éveille en nous l’émotion esthétique, celle qui expose les relations intimes des choses, et d’après Hsieh Ho, « qui révèle le rythme de l’esprit dans les gestes des choses vivantes ». Toutes les œuvres qui la possèdent sont linguistiques ; rappelons-nous le, et nous ne tomberons pas dans l’erreur de ceux qui veulent employer le langage pour le langage, et nous ne confondrons pas ces formes significatives, ou leur sens logique, ou leur valeur morale, avec la beauté quelles nous remémorent.
Insistons cependant sur ce fait, que le concept de beauté a pris naissance chez le philosophe, non chez l’artiste : lui s’est toujours occupé de dire clairement ce qu’il avait à dire. À toutes les époques de création l’artiste a été amoureux du sujet qu’il a choisi (sinon, son œuvre n’est pas “sentie”) ; il n’a jamais entrepris d’atteindre au Beau dans le sens strictement esthétique, car viser à ce but, c’est aller au-devant d’un échec, c’est vouloir voler sans ailes. À l’artiste il ne faut point dire que le sujet ne compte pas : mais le philosophe le doit dire au philistin, a qui déplaît une œuvre d’art pour la seule raison qu’elle lui déplaît.
Le vrai critique (rasika) perçoit la beauté dont l’artiste a montré les signes. Il n’est pas nécessaire que le critique apprécie tout ce qu’a voulu dire l’artiste (une œuvre d’art est kâma-dhenu, elle offre plusieurs sens), car il sait, sans raisonnement, si l’œuvre est belle ou non, avant même que l’esprit se soit demandé “ce qu’elle représente”. Les écrivains hindous prétendent que la capacité de sentir la beauté (de goûter le rasa) ne peut s’acquérir par l’étude, mais qu’elle est la récompense du mérite acquis dans une vie antérieure ; car beaucoup de braves gens et de ceux qui croient faire de l’histoire de l’art ne l’ont jamais perçue. On naît poète, on ne le devient pas ; il en est de même du rasika, dont le génie diffère, en degré seulement, de celui de l’artiste original. Disons, pour nous exprimer à l’occidentale, que l’expérience s’achète par l’expérience et que les opinions ne doivent pas s’accepter toutes faites. Nous ne gagnons rien, nous ne sentons rien, si nous croyons sur parole que des œuvres sont belles. Plutôt mille fois être franc, avouer que nous ne pouvons peut-être en voir la beauté. Un jour viendra, qui sait, où nous serons mieux préparés à la comprendre.
Le critique, dès qu’il veut expliquer la beauté, doit prouver ce qu’il avance, et il ne peut le faire par aucune argumentation, mais seulement en créant une nouvelle œuvre d’art, sa critique. Le public, saisissant la lueur réfléchie, mais toujours la même lueur, car il n’y en a qu’une, aura ainsi une chance, la seconde fois, d’approcher de l’œuvre avec plus de respect. Quand je dis que les œuvres d’art nous aident à nous remémorer et que l’activité du critique consiste à reproduire, je veux faire entendre que la vision de l’artiste original peut, elle-même, être une découverte plutôt qu’une création. Si la beauté attend partout que nous la découvrions, cela revient à dire qu’elle est aux ordres de notre souvenir (dans le sens soûfi et celui de Wordsworth) : dans la contemplation esthétique comme dans l’amour et dans la connaissance, nous recouvrons momentanément l’unité de notre être, affranchi de l’individualité.
Il n’y a pas différents degrés de beauté ; l’expression la plus simple, comme la plus complexe, nous remémore un seul et même état. La sonate n’est pas supérieure en beauté à la courte pièce lyrique, ni le tableau au dessin, seulement parce que sonate et tableau demandent une exécution plus compliquée. La beauté de l’art civilisé n’est pas supérieure à celle de l’art du sauvage, uniquement parce que son ethos peut être plus sympathique. Supposons des cercles, grands et petits ; ils diffèrent de contenance, mais ce sont tous des cercles. De même, il ne peut y avoir de progrès continu en art. Dès qu’une intuition donnée a atteint son expression parfaitement claire, il ne reste plus qu’à multiplier et répéter cette expression. La répétition peut être souhaitable pour plusieurs raisons, mais elle entraîne presque invariablement une décadence graduelle, car nous finissons bientôt par ne plus prêter attention à la révélation. La vitalité d’une tradition ne persiste qu’autant qu’elle est alimentée par l’intensité de l’imagination. Ce que nous entendons par art créateur n’a cependant pas de rapport nécessaire avec la nouveauté du sujet, bien que celle-ci ne soit pas exclue. L’art créateur est l’art qui nous révèle la beauté là où, sans cela, elle nous aurait échappé, ou qui nous en donne une révélation plus claire. La beauté nous échappe parce que certaines expressions deviennent, comme on dit, “rebattues” ; alors, l’artiste créateur, traitant le même sujet, réveille notre mémoire. La mission de l’artiste est de montrer la beauté de toutes expériences, les nouvelles comme les anciennes.
Beaucoup ont avec raison insisté particulièrement sur ce que la beauté d’une œuvre d’art est indépendante du sujet, et il est vrai que l’humilité de l’Art, trouvant son inspiration partout, est identique à l’humilité de l’Amour, qui ne distingue pas entre un chien et un Brahmane, et à celle de la Science, pour qui la forme la plus vile est aussi chargée de sens que la plus noble. Et cela est possible parce que, partout et toujours, est le même Tout indivisé.
Si nous contemplons une forme de beauté,
C’est Son reflet qui luit au travers.On comprend maintenant dans quel sens nous avons le droit de parler de Beauté Absolue et d’identifier cette beauté avec Dieu. Nous n’impliquons point par là que Dieu (qui n’a point de parties) ait une forme gracieuse qui puisse devenir un objet de connaissance ; mais en tant que nous voyons et sentons la beauté, nous Le voyons, Lui, et ne faisons qu’un avec Lui. Que Dieu soit le premier artiste ne veut pas dire qu’il a créé des formes dont le charme aurait été moindre si la main du potier avait fait un faux mouvement ; mais tout objet naturel est une réalisation immédiate de Son être. Cette activité créatrice est comparable à l’expression esthétique dans son caractère involontaire : nul élément de choix n’entre en ce monde d’imagination et d’éternité, mais il existe toujours une parfaite identité d’expression-intuition, d’âme et de corps. L’artiste humain qui découvre la beauté ici ou là, est le guru idéal de Kabîr « qui révèle l’Âme Suprême partout où s’attache l’esprit ».
► Ananda Coomaraswamy, La Danse de Çiva : Quatorze essais sur l'Inde, 1922.
[trad. Madeleine Rolland de « That Beauty is a state », The Burlington Magazine for Connoisseurs n°145, 1915. Autre version pdf]
1. « En écoutant, vous ne pouvez en entendre le son ; et en contemplant, vous ne pouvez en voir la forme » (Tchouang-Tseu. Cf. « Le secret de l’art repose en l’artiste lui-même », Kouo Jo Hsû (XIIe siècle), cité dans The Kokka n° 244.
2. Riciotto Canudo : « Il est certain que le secret de tout art est dans la faculté de s’oublier soi-même », La Musique comme religion de l’Avenir [in : La Renaissance contemporaine n°24, 1911].
***
 A. K. Coomaraswamy et la naissance d’un symbole hindou universel
A. K. Coomaraswamy et la naissance d’un symbole hindou universelC’est lors de la glorification néo-romantique de l’Orient par l’Occident au début du XXe siècle, que le Shiva dansant éveilla l’intérêt de l’Occident. Philosophes, artistes, conservateurs de musée, collectionneurs et écrivains étaient emplis d’un enthousiasme pour l’Inde et ses dieux qui leur semblaient si mystérieux et exotiques. Le fameux historien de l’art Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947) a été très influencé par cet enthousiasme et y a beaucoup contribué. Premier conservateur de l’art indien au Museum of Fine Art à Boston, et auteur largement lu, il eut une influence considérable sur des générations d’universitaires et de passionnés d’art. Son article majeur, « La danse de Shiva », a d’abord été publié en 1918 dans un recueil d’articles du même nom. Aux yeux de Coomaraswamy, le Shiva dansant est la plus expressive des œuvres d’art indiennes. Sa portée va au-delà du symbolisme hindou ; il est l’image idéale de toute action divine : « Tout grand thème dans la religion ou dans l’art, tout grand symbole, devient un tout pour l’humanité. Siècle après siècle, il confère aux hommes des trésors tels qu’ils en possèdent dans leur cœur. Quelles que soient les origines de la danse de Shiva, elle devint avec le temps l’image la plus évidente de l’activité de Dieu, sans rivale parmi les autres arts et religions. » (Coomaraswamy, 1952, p. 84, emphase dans l’original).
Selon Coomaraswamy, il n’existe pas d’artiste aujourd’hui — aussi grand soit-il — qui pourrait créer une représentation plus exacte de cette énergie. La Nature est immobile et ne peut danser tant que Shiva ne le désire pas. Par sa danse, il la maintient, et poursuivant sa danse, il détruit toutes formes et tous noms par le feu, mettant à nouveau le monde au repos. C’est de la poésie, mais — dit Coomaraswamy — il y a néanmoins de la science dans l’image de cette manifestation de l’énergie rythmique primale (Coomaraswamy, 1952, p. 83). Toujours selon Coomaraswamy, la figure de culte, les processions, la danse et la musique qui l’accompagnent, sont des symboles universellement compréhensibles. Le contexte rituel est cependant relégué ici à l’arrière-plan de l’analyse afin d’établir la danse de Shiva comme parfait exemple de la synthèse de la science, de la religion et de l’art (Kaimal, 1999, p. 391). Les idées de Coomaraswamy ont convaincu un vaste public et furent largement diffusées. En particulier, la notion de la danse de Shiva comme symbole suprême de l’activité divine a semblé donner une réponse claire, simple et fascinante à des questions complexes. Elle comblait un besoin de spiritualité qui était, de par l’esprit du temps, empreint d’une profonde admiration pour le mysticisme oriental. [source]
***
 • Au reproche courant d'esthétisme (par ex. « Art as an escape from secularity », Klas Grinell, 2017 : « Par chance pour les traditionalistes, la vérité traditionnelle n’est pas complètement perdue. Grâce à l'art sacré il leur est possible de se reconnecter aux idées platoniciennes ou aux noms divins, échappant ainsi à la société déchue qui les environne. C’est pourquoi je qualifie leur vision de l’art d’évasion de la sécularité. Leur art sacré est une demeure solitaire où les connaisseurs aristocratiques peuvent se retirer du monde qui les porte et contempler une sagesse éternelle. Ils n’ont pas besoin de changer le monde. Et pourquoi le devraient-ils, étant donné qu’ils ont tendance à jouir de ses privilèges matériels tout en étant profondément consternés par la vulgarité de la modernité séculière ainsi que par son manque de respect pour les hiérarchies et les normes naturelles ») ou encore de passéisme, on objectera l'avis plus nuancé de Roger Lipsey (dans son introduction, p. XXXV, du tome I des Selected Papers, cité par Jacques Thomas, introduction à La théorie médiévale de la Beauté, 1997) :
• Au reproche courant d'esthétisme (par ex. « Art as an escape from secularity », Klas Grinell, 2017 : « Par chance pour les traditionalistes, la vérité traditionnelle n’est pas complètement perdue. Grâce à l'art sacré il leur est possible de se reconnecter aux idées platoniciennes ou aux noms divins, échappant ainsi à la société déchue qui les environne. C’est pourquoi je qualifie leur vision de l’art d’évasion de la sécularité. Leur art sacré est une demeure solitaire où les connaisseurs aristocratiques peuvent se retirer du monde qui les porte et contempler une sagesse éternelle. Ils n’ont pas besoin de changer le monde. Et pourquoi le devraient-ils, étant donné qu’ils ont tendance à jouir de ses privilèges matériels tout en étant profondément consternés par la vulgarité de la modernité séculière ainsi que par son manque de respect pour les hiérarchies et les normes naturelles ») ou encore de passéisme, on objectera l'avis plus nuancé de Roger Lipsey (dans son introduction, p. XXXV, du tome I des Selected Papers, cité par Jacques Thomas, introduction à La théorie médiévale de la Beauté, 1997) :« Il serait utile d’examiner si Coomaraswamy fut un conservateur, et, si oui, si son conservatisme peut faire obstacle à nos efforts contemporains. Certes, son intérêt exclusif pour l’art religieux traditionnel et la psychologie des artistes et mécènes qui en eurent besoin, était conservateur et tourné vers le passé. Il considérait le monde moderne comme un cul-de-sac. Cependant, il souhaitait vivement une brillante continuation à la culture. Ce fut cela qui lui donna tant d’énergie pour étudier les principes et les formes artistiques du temps précédant l’époque moderne. Il n’avait, je crois, que très peu d’espoir en ce qui concerne le monde moderne, et, cependant, il se comporta comme s’il lui était possible de contribuer à un nouvel et splendide avenir. En ce paradoxe se trouve l’homme : son esprit lui disait que la vérité des rishis védiques, la psychologie austère et l’enseignement plein de compassion du Bouddha, la claire lumière de Platon, la splendeur visionnaire de Plotin, les aperçus chrétiens concernant l’intimité de Dieu avec l’homme — que tout cela, ainsi que les arts qui les exprimaient, sont lettres mortes dans le monde moderne. Mais ses écrits trahissent l’espoir que ces choses peuvent être assimilées. En son voeu que nous “revenions d’une manière ou d’une autre aux principes premiers” — en particulier dans la désarmante simplicité de cette phrase qu’il utilisait quelquefois — on peut admettre qu’il ne savait pas comment le monde moderne pouvait effectuer ce changement, mais qu’il a su de quelle sorte de changement il s’agissait ».
[Ci-dessus : Girl with Deer, Eric Gill, 1920, Art Institute of Chicago ou V & A. Cet artiste avait aussi illustré le livret Three Poems par AKC, imprimé en 1920 par le St. Dominic’s Press et à tirage confidentiel]
***
⬨ Pour prolonger :
• « L’appréciation des arts non familiers » (AKC, 1936)
• « A brief introduction to the “Traditional Doctrine of Art” » (T. Scott, 2007)
• « Religion and the performing arts : a critique of AKC » (V. Subramaniam, 1998)
• The Traditional Theory of Literature, Ray Livingston, Minnesota Univ. Press, 1962
• « Aesthetic Theories of A. Coomaraswamy » (R. Rapael, Indian Literature n°6, 1977)
• « The Art Criticism of Sri Aurobindo and Ananda Coomaraswamy » (S. Mohanty, 2013)
• « The sacred and the profane aspects in the Traditional Art » (A. Gonzalo Alemán, 2020)
• Sir John Woodroffe, Tantra and Bengal, K. Taylor, 2001, ch. IV : Romantic orientalists [recension]
• Quest for Coomaraswamy : A life in the arts, Pratapaditya Pal, Bayeux Arts, 2020 [recension 1 / rec. 2]
• The Wisdom of Ananda Coomaraswamy : Reflections on Indian Art, Life, and Religion, World Wisdom, 2011
• « AK Coomaraswamy : Scholar of the Spirit », Brian Keeble, in : The Essential Sophia, World Wisdom, 2006
• « AK Coomaraswamy and the true art of living », B. Keeble, in : God and Work : Aspects of Art and Tradition, 2009
• The True Scholar : Passages from AK Coomaraswamy on Art and Scholarship, choix de textes par Roger Lipsey, 2013
• Pour la doctrine traditionnelle de l'art qui associe éthique et esthétique : Principes et méthodes de l'art sacré (Titus Burckhardt, 1958 ; cf aussi L'Achimie : sa signification et son image du monde, 1979 et Science moderne et sagesse traditionnelle, 1986), L'ésotérisme comme principe et comme voie (F. Schuon, Dervy, 2012 ; cf. aussi De l'Unité transcendante des religions, lire chap. IV, 1948) et La connaissance et le sacré, ch. 8 (Nasr, 1999)
 • Les théories de l'art dans la pensée traditionnelle : Guénon, Coomaraswamy, Schuon, Burckhardt, Patrick Ringgenberg, Harmattan, 2011, 832 p., 54 €. [Recension] Retrace le déploiement d'une vision métaphysique et contemplative des arts chez quatre auteurs : la naissance d'une conception traditionnelle des civilisations chez Guénon, son exemplification et son développement chez Coomaraswamy, le renouvellement de la problématique de l'art chez Schuon et les développements et la synthèse effectués par Burckhardt. — Présentation éditeur :
• Les théories de l'art dans la pensée traditionnelle : Guénon, Coomaraswamy, Schuon, Burckhardt, Patrick Ringgenberg, Harmattan, 2011, 832 p., 54 €. [Recension] Retrace le déploiement d'une vision métaphysique et contemplative des arts chez quatre auteurs : la naissance d'une conception traditionnelle des civilisations chez Guénon, son exemplification et son développement chez Coomaraswamy, le renouvellement de la problématique de l'art chez Schuon et les développements et la synthèse effectués par Burckhardt. — Présentation éditeur :Le courant de pensée métaphysique et universaliste initié par René Guénon a influencé, jusqu'à nos jours, plusieurs penseurs, qui ont postulé l'idée d'un art traditionnel, fondé sur une tradition symbolique, une esthétique canonique et une créativité ritualisée et initiatique. Le Français Luc Benoist, ancien conservateur du musée des Beaux-Arts de Nantes, synthétisa une vision guénonienne de l'art dans les années 1930, et le Cinghalais Ananda K. Coomaraswamy, conservateur dans les années 1930-1940 au musée des Beaux-Arts de Boston, associa étroitement, dans une perspective philosophique, l'art, le symbolisme et la métaphysique. À leur suite, deux auteurs majeurs ont poursuivi, étendu ou refondé une “pensée traditionnelle” sur l'art. Fondateur et maître d'une confrérie soufie en Europe, Frithjof Schuon a publié une oeuvre importante de spiritualité et de métaphysique, et s'est consacré également à la poésie et à la peinture, dans laquelle il a surtout illustré des thèmes relatifs aux Indiens d'Amérique du Nord et à l'idée d'une féminité céleste et universelle. Initié au soufisme et grand connaisseur du Maroc, Titus Burckhardt a écrit sur les “principes et méthodes de l'art sacré” et sur l'art islamique, inspirant dans les années 1970 plusieurs travaux qui présentent une interprétation soufie et philosophique de l'architecture, de la calligraphie et des décors islamiques.
Situés dans la postérité du romantisme et du postimpressionnisme, ainsi que de l'orientalisme et des courants ésotériques du XIXe et du début du XXe siècle, ces auteurs sont plus ou moins isolés dans le panorama contemporain des idées, bien qu'ils aient eu une influence souterraine considérable sur nombre d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes, de René Daumal à Raymond Queneau, d'André Breton à John Tavener, d'Albert Gleizes à Maurice Béjart. Plusieurs de leurs thèses — sur le symbolisme des arts prémodernes, l'interprétation soufie des arts islamiques ou la critique spirituelle de l'art post-médiéval — se trouvent également au coeur des débats contemporains sur le dialogue / conflit des civilisations, l'herméneutique des arts, la fonction de l'esthétique, le contenu du symbole, le regard sur l'Autre. Jusqu'à présent, les théories traditionalistes de l'art n'avaient fait l'objet que d'études fragmentaires et dispersées : le présent ouvrage comble une lacune, en offrant un panorama critique complet des théories traditionnelles de l'art, des thèses de René Guénon aux métaphysiciens de l'art islamique, d'Ananda K. Coomaraswamy, pionnier reconnu des études indiennes, aux peintures et poèmes de Frithjof Schuon.
• nota bene : Du même auteur, Diversité et unité des religions chez René Guénon et Frithjof Schuon (Harmattan, 2010). On lira avec distance critique la longue recension polémique parue dans les CU n°1, 2016.
• « Stella Kramrisch and A. Coomaraswamy », Pratapaditya Pal, 2023. À l’instar de Ernest Binfield Havell, pionnier de l’histoire de l’art indien, les approches de ces deux figures se démarquent de tout cadre européo-centré afin de mieux comprendre l'intention artistique derrière les œuvres. Kramrisch accepte l’idée de Coomaraswamy selon laquelle l’art indien est “symbolique” et reflète la perception de l’esprit plutôt que celle de la rétine, ce qui distingue les objectifs de l’art indien de ceux de l’art occidental. Si on devine aisément chez elle l'influence de Wilhelm Worringer pour qui toute volonté créatrice se donne pour but l'expression adéquate de sa position à l'égard du milieu (la psychologie des styles est regardée comme l'expression de types spécifiques de mentalités), il reste pourtant difficile de cerner sa spécifité, que ce soit dans son active implication dans les débats de l’époque sur l’écriture de l’histoire de l’art ou encore dans la dimension politique de ses travaux et de ses activités en tant qu’historienne de l’art européenne traitant un objet de recherche extra-occidental. C'est pourquoi consulter le dossier exceptionnel que lui consacre la revue franco-allemande Regards croisés n°11, 2021, se révèlera précieux pour différencier les démarches
Tissage traditionnel d'un sari sur un métier à bras dans un atelier de Varanasi (Bénarès) (photo : Money Sharma, 2021). — « “Tradition ne veut pas dire simplement fixation stylistique et ne dépend pas seulement d’un consensus général”, écrivait Ananda Coomaraswamy dans un article sur la nature de l’art traditionnel, qu’il opposait en tant que tel à l’art “académique” ou à celui “qui est à la mode”. “L’art traditionnel est ordonné à une fin particulière et emploie des moyens déterminés pour parvenir à sa fin ; il est transmis de maître à élève depuis un passé immémorial”. Selon cet auteur, un art traditionnel comporte donc un style propre, caractérisé par une série de critères relatifs à son esthétique ; il fait l’objet d’un consensus partagé par la société ou le groupe au sein duquel il se manifeste ; il a une fin, une raison d’être dans ce cadre, et il y est considéré comme efficace, c’est-à-dire doté non seulement d’une fonction, mais de pouvoirs, à un niveau ou un autre ; cette efficacité se manifeste, y compris sur les plans psychologique et symbolique, par l’application d’une série de moyens, de règles et de techniques spécifiques ; la conservation de l’ensemble de ces données est garantie notamment par des modes de transmission adéquats ; les arts traditionnels sont enfin caractérisés par l’ancienneté des principes qu’ils mettent en œuvre, sinon nécessairement de toutes les modalités de leurs expressions » (Laurent Aubert, Cahiers d’ethnomusicologie n°9, 1996)

[Ci-contre : fresque des grottes d'Ajanta : “L'Inde a coutume de suggérer les infinis éternels et indicibles en termes de beauté sensuelle. L'amour de l'homme pour la femme ou pour la nature ne fait qu'un avec son amour pour Dieu. Rien n'est commun ou impur. Toute vie est sacrement, aucune partie de celle-ci ne vaut plus qu'une autre, et il n'y en a aucune qui ne symbolise les choses éternelles et infinies. L'Inde ne fait aucune distinction entre amour sacré et amour profane. Tout amour est un mystère divin ; c'est la reconnaissance de l'Unité. En effet, toute la distinction entre sacré et profane n'a pas de sens pour l'Inde, et c'est ainsi que la relation de l'âme à Dieu peut être conçue en termes d'adoration passionnée de la femme pour son amant”]
L’art indien traditionnel est profondément religieux : chaque aspect de la vie y acquiert une signification sacrée. Êtres humains, arbres, fleurs, oiseaux, toutes les formes de la matière sont présentes dans la peinture et la sculpture de l’Inde, mais aucune n’est belle en soi : toutes tirent leur beauté de la part divine qu’elles recèlent et que seuls perçoivent ceux qui ont su créer en eux l’espace favorable à cet accueil.
Le Natyasastra, écrit vers le VIe siècle avant JC, est le plus ancien traité indien où il soit question du beau. Le sage Bharata y pose, comme principe premier, le rasa ou “saveur”, qu’il définit comme une émotion profonde et durable. Correspondant à autant d’effets de l’art, il distingue différents rasas : l’érotique, le comique, le pathétique, le furieux, l’héroïque, le terrible, l’odieux et le merveilleux.
Pour ressentir le rasa, le spectateur doit connaître une disponibilité intérieure que seul procure le détachement de soi même. État de pureté et d’équilibre où l’on a su renoncer au désir égoïste pour atteindre au ravissement de la contemplation. Entrevoir le divin, c’est libérer l’âme dans sa vérité. On ne saurait ramener le rasa, comme la catharsis des anciens Grecs, à une purification, à une purge des émotions : le spectateur ne s’arrête pas à la réaction, plaisante ou désagréable, que lui inspire ce qu’il contemple, il la dépasse dans la sérénité.
Si cette étape ultime est contemplation pure, la démarche qui y conduit exige un grand dépouillement et une intense concentration mentale. L’activité esthétique, tout comme le yoga, est une ascèse spirituelle qui repose sur la pratique du détachement. Les émotions que suscite l’œuvre d’art n’appartiennent ni à l’artiste, ni à l’interprète ni au spectateur, mais à quiconque a su transcender ses passions pour atteindre à l’absolu. Ainsi que l’a dit Ananda Coomaraswamy, “toute connaissance, toute vérité est absolue et infinie : elle n’est pas à créer, mais à découvrir”.
Quand il veut dépeindre les dieux, l’artiste indien se situe aux antipodes de l’anthropomorphisme de l’art hellénique. Il ne part pas de l’observation et de l’analyse des traits physiques, il fait appel à la méditation et à l’intuition. Chaque divinité du panthéon hindou symbolise un ensemble cohérent de conceptions religieuses : l’apparence physique qu’on lui prête n’en est qu’une expression tangible. L’aspect matériel que prend le dieu n’est que le véhicule de sa signification spirituelle. Si on a représenté les dieux et déesses de l’Inde avec plusieurs têtes et de multiples bras, c’est qu’ils incarnent des idées abstraites et éternelles, qui n’ont pas d’équivalences dans la nature.
L’un des idéaux indiens de la forme divine correspond à la notion traditionnelle du héros ou du surhomme. Il prend, dans le Mahabharata, la forme idéalisée du guerrier qui est devenu invincible après avoir vaincu à plusieurs reprises le roi des animaux. Il finit même par acquérir certains des caractères physiques de son adversaire : large poitrine, épaules puissantes, bras longs et musclés, taille mince contrastant avec l’épaisseur du cou. Cet aspect léonin est devenu, dans l’art indien, le symbole de la force physique. Quant à la rapidité, autre qualité indispensable du chasseur, elle est symbolisée par des jambes de cerf ou de gazelle, si souvent représentées dans l’art bouddhique, des fresques d’Ajanta aux sculptures d’Amaravati.
L’art indien, qu’il soit hindou ou bouddhiste, ne représente jamais les dieux qui ont conquis la sagesse par l’ascèse comme des saints au corps émacié par les privations, au visage exsangue, mais comme des figures harmonieuses : la peau est lisse, le corps rond et puissant. Alors que les divinités de l’Extrême-Orient ont le plus souvent pour séjour un jardin paisible au sol parsemé de pétales printaniers, l’idéal de la beauté indien se situe dans les solitudes célestes de l’Himalaya, image même de l’infini.
La conception indienne du beau repose sur la distinction essentielle entre le plaisir et la félicité (ananda) dont la Bhagavad Gita nous dit qu’elle est l’essence même de la beauté. Le plaisir est individuel et égoïste, accidentel et relatif, tandis que la félicité ouvre les portes de l’absolu et de l’infini. Et si le plaisir est fugitif, la félicité est plénitude, équilibre et paix. Ni le Ramayana ni le Mahabharata ne s’achèvent par la victoire du bien sur le mal, des bons sur les méchants. Pourquoi ? Il ne s’agit pas, pour les héros, de conquérir les trônes de ce monde, mais d’atteindre à l’état de perfection, seule voie d’accès à une possible vie future.
C’est ce que reflètent les sublimes visages des fresques d’Ajanta : une civilisation où le conflit entre l’esprit et la matière se dénoue dans la beauté.
► Romain Maitra, Le Courrier de l’Unesco n°12/1990.
• nota bene : Ce court article, destiné à un large public, emprunte son inspiration à AKC : “L'art indien est essentiellement religieux. Le dessein manifeste de l’art indien est la représentation de la Divinité. Mais l'infini et l'inconditionné ne peuvent être exprimés en termes finis ; et l'art, incapable de représenter la Divinité inconditionnée et ne voulant pas être restreint par les limites de la condition humaine, est en Inde dédié à la représentation des dieux, qui, pour l'homme fini, représentent des aspects compréhensibles d'un tout infini” (« The Aims of Indian Art », 1908, brochure intégrée ensuite au recueil Essays in National Idealism, 1909, trad. fr. in : L’art hindou, 2024).
***
 Dans un des essais, l’éminent Ananda Coomaraswamy remarque que “dans la consécration de l'humanité, il n'y a pas de place pour la distinction — toujours étrangère à la pensée indienne — du sacré et du profane. Mais lorsque, dans l'amour, le fini est mis en présence de l'infini, lorsque la conscience de l'intérieur et de l'extérieur est dissoute dans l'extase de l'union avec l'être aimé, le moment de la réalisation est exprimé, dans la poésie indienne, sous la forme symbolique du discours de Rādhā, la chef des bergères (gopis), adressé à Krishna, le Vacher Divin” (1). Ce moment d'extase est ainsi restitué par les lignes suivantes du poème Kishna de Sri Aurobindo :
Dans un des essais, l’éminent Ananda Coomaraswamy remarque que “dans la consécration de l'humanité, il n'y a pas de place pour la distinction — toujours étrangère à la pensée indienne — du sacré et du profane. Mais lorsque, dans l'amour, le fini est mis en présence de l'infini, lorsque la conscience de l'intérieur et de l'extérieur est dissoute dans l'extase de l'union avec l'être aimé, le moment de la réalisation est exprimé, dans la poésie indienne, sous la forme symbolique du discours de Rādhā, la chef des bergères (gopis), adressé à Krishna, le Vacher Divin” (1). Ce moment d'extase est ainsi restitué par les lignes suivantes du poème Kishna de Sri Aurobindo :Pour ce seul instant, les âges passés ont été vécus ;
Le monde vibre alors enfin en moi.For this one moment lived the ages past ;
The world now throbs fulfilled in me at last.(A. Ranganathan, « Sri Aurobindo as an art critic », in : Indian Literature n°2, 1972)
1. « Indian music », in : Essays in national idealism, 1909. Il existe un autre article de 1917 avec ce titre. Tous deux sont repris dans le recueil Essays on Music, Prem Lata Sharma (éd.), IGNCA, 2010.
***
[illustration : La représentation du dieu Krishna en flûtiste (bansuri) apparaît dès le VIe siècle dans l’Inde méridionale et traduit une relation particulière entre dieu et dévot. Cf. Sur le chemin de Krsna : la flûte et ses voies, Charlotte Schmid, EFEO, 2014. Dans la préface à sa traduction des Chants d'amour de Rādhā & Krishna par le poète médiéval Vidyāpati, AKC remarque : « Porté par l’extase, l’homme se trouve en dehors de lui-même. Que cette évasion momentanée de “lui-même” constitue le plus somptueux cadeau que la vie puisse offrir, qu'elle délivre une promesse, pour ainsi dire un avant-goût, de Libération, il n’en faut pas moins pour nous garantir que le Nirvana est autre chose que l’anéantissement. Dans le même temps, il importe de garder à l’esprit que de telles extases ne sont pas plus accordées aux adeptes du plaisir qu’à ceux qui s’obstinent dans leur orgueil intellectuel. Dans la littérature dévotionnelle Vaishnava (vishnouiste), ce point ne cesse d’être rappelé. Ce n'est que lorsque l'oreille cesse d'entendre le monde extérieur, qu’elle s’ouvre à la musique du cœur, celle que délivre la flûte de Krishna », in : Vidyapati Bangiya Padabali : Songs of the love of Radha and Krishna, 1915]
Je ne trouve aucune “douceur sucrée” en Ramakrishna ! Bhakti dans la Bhagavad Gita signifie “service” (dans le sens de donner à quelqu'un ce qui lui est dû, service en tant que serviteur) ou “assiduité” plutôt que littéralement “adoration”. “L'amour platonicien” n'est pas l'amour des autres “pour eux-mêmes”, mais de ce qui est divin en eux, et comme cela est identique à ce qui est divin en nous, c'est tout autant amour de soi (et par là amour du Soi) qu'amour des autres ; la notion de “Je” et celle des “autres” est (comme dans le bouddhisme) également illusoire, et ce dont nous avons le plus besoin n'est pas tant “l'altruisme” que l'amour de soi au sens aristotélicien et scolastique.
(Lettre d'AKC à Helen Chapin, 22 déc. 1945)

[Ci-contre : Sadashiva (Shiva l'indestructible), VIe s., Prince of Wales Museum, Bombay. Statue provenant des grottes d'Éléphanta sur l'île d'Éléphanta, au large de Bombay]
⬨ Extraits de Ananda K. Coomaraswamy,
Source : Introduction to Indian Art (1923) (1)
Tout l’art indien a été produit par des artisans de métier selon des traditions transmises en succession générationnelle. L'originalité et la nouveauté ne sont jamais intentionnelles. (…) Ce qui est nouveau surgit constamment dans la tradition indienne sans but ni calcul de la part de l’artisan, simplement parce que la vie est restée pendant de longues périodes une expérience immédiate. (…) Il n'est pas important que nous ne connaissions pas les noms des peintres : toute l’Inde était richement peinte à cette époque [de la période Gupta], et l'art est l’art d'une race, et non d'un individu.
En Inde, où personne ne discuterait d’art (il n'y a pas d'équivalent sanskrit au concept moderne d’art), où nul autre que des philosophes n’aborderait la théorie de la beauté, et où les sculptures et les peintures étaient considérées non comme des “œuvres d'art” mais comme des moyens de répondre à des fins convenues, l’art était une qualité inhérente à toutes les activités, présente pour tous dans l’environnement quotidien et produite par tous proportionnellement à la vitalité (et non à la nature) de leur activité.
• Note :
1. Il n’y a qu’une apparence de contradiction entre cette affirmation et le fait que dans un livre postérieur AK Coomaraswamy a consacré un chapitre à « La théorie de l’art en Asie » — précisément parce que la notion asiatique de l’art n’est pas équivalente au “moderne concept d’art”. Le mot vakya, employé dans la définition de l’art que présente le texte suivant (n°2), se rapporte originellement à ce qui est produit par les énergies de l’esprit dans un sens très général (il signifie pour Shankara le produit de la synthèse notionnelle exprimée dans un jugement). Et sous cet aspect la distinction entre l’art et la nature a été beaucoup moins marquée dans l’Inde qu’en Grèce (voir texte n°5).
D’autre part, en ce qui regarde la beauté dont la notion n’a été discutée par « personne en dehors des philosophes », et qui est, comme le dit Olivier Lacombe (texte n°6), « impliquée plutôt qu’exprimée par la pratique et la théorie de l’art indien », remarquons que l’expression de “saveur spirituelle” rendrait certainement le mot rasa de plus près que l’expression “beauté idéale” employée par AKC (dans les textes n°2 et n°3).
[note par Jacques Maritain, in : L'intuition créatrice dans l'art et dans la poésie [recension], DDB, 1966 (traduction de : Creative intuition in art and poetry, 1953). Appendice chapitre I]
Sur le rasa : Le Rasa : Essai sur l'esthétique indienne, Subodh Chandra Mukerjee, 1926 ; « The Rasa Theory : Theology or Aesthetics ? », VK Chari, in : The Sacred and the Secular in India's performing arts, 1980 ; « La délectation du rasa : La tradition esthétique de l’Inde », P. Bruguière, Cahiers d'ethnomusicologie n°7, 1994 ; « AKC’s Aesthetics : the rasa theory and the Hindu religious tradition in art », T. Wignesan, Journal of The Institute of Asian Studies n°1/1996, Chennai (version html).
***
Source : The Theory of Art in Asia, 1934
• Texte 1
Considérons maintenant ce qu’est l’art et quelles sont les valeurs de l’art d’un point de vue asiatique, c’est-à‐dire principalement indien et extrême-oriental. (…) En premier lieu donc, nous constatons que l’élément formel dans l’art est reconnu représenter, de façon évidente, une activité purement mentale. (…) Celui qui peint une icône, ayant par différents moyens propres à la pratique du yoga, éliminé les influences distrayantes des émotions fugitives et des images des créatures, par sa propre volonté et sa propre pensée, procède alors à la visualisation de la forme du devatā, ange ou aspect de Dieu, décrite dans une prescription canonique donnée. (…) Le mental “produit” ou “tire” cette forme à lui, comme à travers une grande distance. (…) La forme ainsi connue dans un acte de non-différenciation, étant maintenue en vue aussi longtemps que nécessaire, est le modèle dont procédera l’exécution dans la pierre, le pigment ou un autre matériau. Tout le processus, jusqu’au moment de la fabrication, appartient à l’ordre de la dévotion personnelle, dans lequel on contemple une image conçue mentalement ; dans tous les cas, le principe invoqué est que la véritable connaissance d’un objet n’est pas obtenue par une simple observation empirique ou un enregistrement réflexe, mais seulement quand ce qui connaît et ce qui est connu, ce qui voit et ce qui est vu, se réunissent dans un acte qui transcende la distinction. (…)
La Beauté est invisible et indivisible (2), elle ne peut-être connue que comme la Divinité est connue, dans le cœur. L’art est une expression de la Beauté, la science une expression de la Vérité, l’éthique une expression de la Perfection, en terme de lumière et d’ombre, de thèse et d’antithèse, de bien et de mal. L’erreur consiste principalement à attacher une valeur absolue à l’un ou l’autre de ces facteurs relatifs, qui ne sont que des moyens d’appréhension, et non des fins en soi.
• Texte 2
L’art est alors défini comme suit : vākya rasâtmakam kāvyam, c’est-à-dire « l’art est l’expression in-formée par la Beauté idéale ». (…) Dans cette théorie de l’art, le terme le plus important est rasa rendu ci-dessus par “Beauté idéale”, mais signifiant littéralement “teinture”, ou essence, et généralement traduit dans le présent contexte par “goût”.
• Texte 3
La définition de l’expérience esthétique (rasâsvādana) donnée dans le Sāhitya Darpana, III, 2-3, est d’une autorité et d’une valeur telle qu’elle demande une traduction in extenso. Nous en donnerons d’abord une version très littérale avec un bref commentaire, puis une expression plus fluide évitant les interruptions.
1) « Le goût (rasah) est goûté par des hommes ayant une connaissance innée des valeurs absolues, en exaltation de la pure conscience, comme lumineux par lui-même, à la fois dans le mode de l’extase et de l’intellect, libéré du contact des choses connaissables, frère jumeau du Goût de Brahma, dont le souffle de vie illumine en un éclair au-delà du monde, comme aspect intrinsèque, dans l’indivisibilité ».
2) « L’expérience esthétique pure appartient à ceux dont la connaissance de la beauté idéale est innée. Elle est connue intuitivement, dans une extase intellectuelle non accompagnée d’idéation, au plus haut niveau de conscience de l’être. Né de la même mère que la vision de Dieu, sa vie est comme un éclair de lumière aveuglante d’origine transcendante, impossible à analyser, et pourtant inscrite au plus profond de notre être ». (…)
L’expérience esthétique est une métamorphose, pas seulement de l’impression (que suggère le mot aesthesis en lui-même), mais également de la compréhension. (…) Ainsi, l’expérience esthétique, la reproduction, naît de l’identification du spectateur avec le sujet présenté, de la même façon que l’intuition originale naît de l’identification de l’artiste avec le thème concerné. La critique répète le processus de la création.
• Texte 4
L’icône indienne ou extrême-orientale, sculptée ou peinte, n’est pas plus une image de mémoire qu’une idéalisation, mais un symbolisme visuel, idéal au sens mathématique. L’icône “anthropomorphique” est du même genre qu’un yantra, c’est-à-dire une représentation géométrique d’une divinité, ou un mantra, c’est-à-dire une représentation auditive de celle-ci. La particularité de l’icône dépend immédiatement de ces conditions et ne peut pas être expliquée autrement, même si dans la pratique courante, nous ne sommes pas conscients que c’est le yantra et non la faculté intrinsèque de l’œil qui crée l’image. En conséquence, l’icône indienne remplit tout le champ de la vision d’un seul coup, tout étant également clair et essentiel : l’œil n’est pas conduit à aller d’un point à un autre, comme dans la vision empirique, pas plus qu’à chercher une concentration de signification dans une partie plutôt que dans une autre, comme dans un art plus “théâtral”. Il n’y a aucune sensation de texture ou de chair, mais seulement de pierre, de métal, ou de pigment, l’objet étant une image faite dans l’un ou l’autre de ces matériaux, et non une décevante réplique (savarna) d’une quelconque cause objective de sensation. Les parties de l’icône ne sont pas reliées organiquement, parce que rien n’oblige à ce qu’elles fonctionnent d’une manière biologique, mais idéalement, comme les composantes nécessaires d’un type donné d’activité, exprimées en termes de médium visible et tangible. Cela ne signifie pas que les différentes parties ne sont pas reliées, ou que le tout n’est pas une unité, mais que la relation est mentale plutôt que fonctionnelle (3). Ces principes s’appliquent aussi bien aux paysages qu’à l’iconographie.
Dans l’art occidental, on conçoit généralement l’image comme vue dans un cadre ou par une fenêtre, et donc amenée vers le spectateur ; l’image orientale, en revanche, n’existe réellement que dans notre propre mental et notre propre cœur. Elle est dès lors projetée ou reflétée dans l’espace. La représentation occidentale est construite comme si on la voyait d’un point de vue fixe, elle doit donc être plausible suivant les règles de l’optique. Le paysage chinois, au contraire, est typiquement représenté comme vu de plus d’un point de vue, ou en tout cas d’un point de vue conventionnel et non “réel” ; l’essentiel ici n'est pas la vraisemblance, mais l’intelligibilité. (4)
⬨ Extraits de : Olivier Lacombe
Source : L’Absolu selon le Védânta, 1937
Pour l’Indien, la forme prise en soi n’est rien qu’une limite instable tracée dans la pure dispersion du non-être et du devenir. Et la plasticité de la matière sous la main de l’artiste et de l’artisan est révélatrice non pas d’une indétermination négative ; d’une potentialité ad omnia parata par privation et capable d’être actuée par des formes qui lui sont “imposées” mais d’une indétermination positive et de plénitude capable de se manifester par un certain nombre de formes en harmonie avec ses virtualités. Et l’image du travail d’art ne hante pas un Çankara — bien qu’il en use et précisément comme en Occident, pour aider à la démonstration d’une Intelligence ordonnatrice de l’Univers — elle n’a pas pour lui de valeur privilégiée parce qu’il pense que si l’artiste peut grace à son intelligence et à ses idées modeler la matière, c’est que celle-ci est en son fond ultime non pas seulement prête pour l’œuvre d’une intelligence, mais intelligence elle-même.
• Texte 6
Si nous nous reportons maintenant aux données communes de l’esthétique indienne, nous pourrons en résumer comme suit les enseignements. L’art ne représente pas la nature, qu’on entende la chose à la manière du réalisme naturaliste ou de l’idéalisme dit classique, mais continue ou reprend le mouvement créateur immanent a la nature ; sa fin est de suggérer à l’âme du spectateur et de l’auditeur, par un système de “signes inducteurs” des états et des tendances psychiques prégnants d’émotion esthétique (rasa). Et la question est si peu de leur conformité avec les sentiments naturels entendue comme adéquation de la copie à son modèle, qu’on oppose volontiers la qualité supérieure de leur artificialité (samskrtatva) à la grossièreté de l’émotion naturelle (prākrtatva), un peu comme on oppose le surnaturel à la nature et le sacré au profane. Il faut d’ailleurs noter que les arts de l’Inde sont dans une très large mesure des arts sacrés parce qu’ils sont au service de la religion : les traités assignent communément à la peinture, à la sculpture, à l’architecture la fonction de servir le culte et la méditation ; ils enjoignent aux imagiers de construire de telle sorte leurs images qu’elles induisent au cœur du fidèle les dispositions nécessaires a l’oraison par l’expression de cette sorte de beauté propre au divin qui consiste en bienveillance, calme et charme (śiva, śānta, sundara). Et tout en leur fournissant les règles canoniques capables de leur faire atteindre ce but, ils leurs rappellent d’avoir à pratiquer d’abord eux-mêmes les méthodes de recueillement du yoga, faute de quoi, l’esprit n’étant pas purifié et rectifié, l’intuition génératrice ne pourrait se produire et l’habileté technique resterait impuissante.
C’est en effet le second enseignement des esthéticiens indiens que l’œuvre d’art est le fruit de surabondance d’une intuition créatrice analogue à l’intuition suprasensible du mystique. Analogue seulement et non pas identique, car si l‘art humain peut être ordonné à des fins sacrées, il n’appartient pas de droit à leur domain et se place aussi bien en marge des valeurs religieuses que des valeurs naturelles, à ne considérer que sa nature propre. En troisième lieu quand it s’agit de l’art humain, dépendant et débile, l’accent tombe plutôt sur la nécessité a priori de sa règle que sur la liberté de son jeu ; mais ce dernier aspect n’est jamais tout à fait aboli et nous le verrons passer en pleine lumière des que nous considérerons l’art divin. Enfin la conception de la beauté impliquée plutôt qu’exprimée par la pratique et la théorie de l’art indien semble se mouvoir entre deux plans, de même que la doctrine shankarienne de l’être et de la causalité : au plan inférieur du panthéisme et du parināmavāda correspondrait l’esthétique de l’ornementation où “souvent richesse passe pour beauté” ; l’infini paraît alors jeter sa plénitude dans une prodigalité de “formes” intensément affirmées par l’excès de réalité qui se presse en leurs limites. Au plan supérieur du non-dualisme et du vivartavāda correspondrait l’esthétique du calme et du renoncement. Les deux tendances se marient dans le grand art de l’Inde et contribuent à lui dormer son équilibre et son harmonie.
***
Notes
2. « From Coomaraswamy, I learned that, despite the term visual art, all art represents invisible things. I thought about that for a long time. It didn’t make sense at first, but I have come to see that it is true, and not just for art objects » (Bill Viola, Presence and Absence : Vision and the Invisible in the Media Age, 2007).
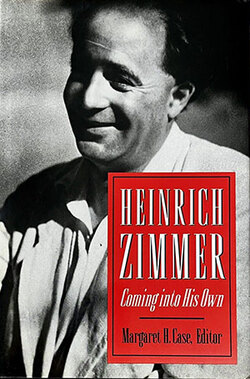 3. Mary F. Linda, en montrant en quoi AKC intègre les apports de l'indianiste Heinrich Zimmer dans l'approche des mantras et yantras, illustre l'entrée de celui-ci dans une maturité métaphysique soucieuce d'ordonnancement psycho-physique pour favoriser une voie d'accomplissement :
3. Mary F. Linda, en montrant en quoi AKC intègre les apports de l'indianiste Heinrich Zimmer dans l'approche des mantras et yantras, illustre l'entrée de celui-ci dans une maturité métaphysique soucieuce d'ordonnancement psycho-physique pour favoriser une voie d'accomplissement : « Dans Kunstform und Yoga [1926, trad. : Artistic form and yoga in the sacred images of India, 1984], Zimmer décrit, comme personne ne l'avait fait auparavant, la vision du monde métaphysique indienne ou le cadre conceptuel dans lequel les images hindoues et bouddhistes étaient produites et l'instrumentalité de ces images pour la méditation. D'autres contributions originales sont ses explications du processus de déploiement et d'enroulement par lequel le dévot fait l'expérience du divin en lui-même et résout ainsi la dualité du Moi et du Non-Moi, l'équivalence et la hiérarchie des types de yantras, et l'homologie des mandalas et de l'architecture tridimensionnelle. Comme Coomaraswamy, Zimmer a reconnu que l'art et la religion étaient indissociables — en effet, l'art représente le divin par le biais de l'iconographie —, que les images sont des visualisations de l'adorateur et que l'iconographie et les proportions des images sont déterminées par la tradition. Coomaraswamy, qui a poursuivi les thèmes présentés par Havell sur l'idéalisme de l'art indien et la nécessité de comprendre l'intention de l'artiste, a reconnu la profondeur du travail de Zimmer. Comprendre l'art indien comme le faisaient le créateur et l'utilisateur était au cœur de son commentaire à l'intention de son public occidental. Selon Coomaraswamy, compte tenu de l'exposé de Zimmer sur l'instrumentalité de l'imagerie hindoue, l'étude de la nature ne pouvait plus servir de base à l'interprétation des séquences stylistiques, et maintenant que le “pourquoi c'est ce que c'est” était compris et accepté, il était possible de retracer les séquences stylistiques dans le temps et l'espace en tant qu'enregistrements du mouvement culturel et spirituel. Coomaraswamy semble impliquer que le travail de Zimmer est la déclaration finale sur la métaphysique et l'esthétique de l'art indien et qu'il a établi le “mouvement spirituel” comme base du style » (« Zimmer and Coomaraswamy : Visions and Visualizations », in : Heinrich Zimmer : Coming into His Own, 1994).
 4. « De ce bref tour d’horizon nous pouvons déjà établir que l’art du paysage s’est développé essentiellement dans deux aires culturelles : l’Extrême-Orient et l’Europe tardive (celle du Nord principalement, comme nous allons le voir). Les autres grandes cultures étant restées, à notre connaissance, non paysagères. Pourquoi ? Avant de répondre, nous voudrions d’abord examiner en quoi la notion du paysage extrême-oriental se distingue de celle de l’Occident. En chinois le paysage est désigné par le terme shan-shui, soit “la montagne et l’eau”. Ce sont les deux pôles fondamentaux de son art. Cette expression, on peut le dire d’emblée, est à l’opposé du concept occidental. (…) La notion de paysage n’y dépend donc pas, comme en Occident, de la situation d’un observateur dans un espace réel ; observateur déjà en somme détaché de son espace ambiant, individualisé si l’on peut dire, puisqu’il voit le paysage en face de lui, “contre” lui. Le fait que le peintre — ou le spectateur — puissent voir au contraire un paysage de différents points de vue, voire d’endroits imaginaires, et qu’il verront alors toujours les mêmes choses, montre que, si leurs formes concrètes varient, ces mêmes choses ne seront cependant plus définies ou caractérisées par leurs formes apparentes, mais qu’elles seront des archétypes, des essences dont ces formes seront seulement des symboles. On aura ainsi passé du plan des choses sensibles ou plan corporel au plan subtil ou intermédiaire. C’est en ce sens que l’on comprendra ce que nous disions plus haut, soit que le terme de shan-shui donne en fait une définition “objective” de ce qu’est le paysage. Car son existence ne dépendra plus alors de la présence d’un individu qui l’observe, comme en Occident, mais qu’il sera saisi dans son essence métaphysique ou principielle, indépendante de toute présence ou existence humaines » (François-Edouard Denys (La voie du paysage : réflexions métaphysiques, 2000).
4. « De ce bref tour d’horizon nous pouvons déjà établir que l’art du paysage s’est développé essentiellement dans deux aires culturelles : l’Extrême-Orient et l’Europe tardive (celle du Nord principalement, comme nous allons le voir). Les autres grandes cultures étant restées, à notre connaissance, non paysagères. Pourquoi ? Avant de répondre, nous voudrions d’abord examiner en quoi la notion du paysage extrême-oriental se distingue de celle de l’Occident. En chinois le paysage est désigné par le terme shan-shui, soit “la montagne et l’eau”. Ce sont les deux pôles fondamentaux de son art. Cette expression, on peut le dire d’emblée, est à l’opposé du concept occidental. (…) La notion de paysage n’y dépend donc pas, comme en Occident, de la situation d’un observateur dans un espace réel ; observateur déjà en somme détaché de son espace ambiant, individualisé si l’on peut dire, puisqu’il voit le paysage en face de lui, “contre” lui. Le fait que le peintre — ou le spectateur — puissent voir au contraire un paysage de différents points de vue, voire d’endroits imaginaires, et qu’il verront alors toujours les mêmes choses, montre que, si leurs formes concrètes varient, ces mêmes choses ne seront cependant plus définies ou caractérisées par leurs formes apparentes, mais qu’elles seront des archétypes, des essences dont ces formes seront seulement des symboles. On aura ainsi passé du plan des choses sensibles ou plan corporel au plan subtil ou intermédiaire. C’est en ce sens que l’on comprendra ce que nous disions plus haut, soit que le terme de shan-shui donne en fait une définition “objective” de ce qu’est le paysage. Car son existence ne dépendra plus alors de la présence d’un individu qui l’observe, comme en Occident, mais qu’il sera saisi dans son essence métaphysique ou principielle, indépendante de toute présence ou existence humaines » (François-Edouard Denys (La voie du paysage : réflexions métaphysiques, 2000).
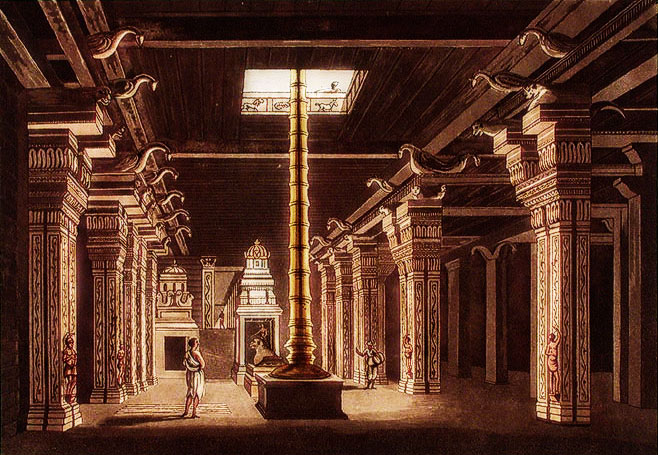 • Présentation du texte : — The American Scholar (n° de printemps 1939) publie une conférence de M. Ananda K. Coomaraswamy intitulée The Vedanta and Western Tradition ; cette conférence fut faite devant un auditoire d’étudiants américains, n’ayant naturellement aucune connaissance des doctrines orientales ; c’est dire que la tâche n’était certes pas exempte de difficultés. L’auteur expose tout d’abord avec une remarquable clarté les caractères essentiels de la métaphysique traditionnelle, ce qu’elle est et aussi ce qu’elle n’est pas, insistant particulièrement sur les différences capitales qui la séparent de tout ce qui porte habituellement le nom de “philosophie”. Il prend ensuite les principaux points de la doctrine du Vêdânta, les éclairant par des parallèles avec d’autres études traditionnelles, surtout avec celles des Grecs et du Christianisme, dont le langage doit être normalement plus familier à des Occidentaux, et montrant en même temps par là l’universalité de la tradition. Nous signalerons notamment les parties de l’exposé concernant Âtmâ et ses rapports avec le monde manifesté, la “transmigration” distinguée de la “métempsychose” et l’impossibilité de la “réincarnation”, le processus de la réalisation spirituelle ; dans cette dernière, nous retrouvons l’explication de quelques-uns des symboles dont nous avons eu l’occasion de parler récemment, comme ceux du “rayon solaire”, du “sommet de l’arbre” et de la “porte étroite”, avec la distinction des états “élyséen” et “empyréen” et le passage de l’un à l’autre “à travers le Soleil”. En terminant, l’auteur a soin de préciser que, dans toute doctrine traditionnelle, il ne s’agit jamais d’une “recherche”, mais seulement d’une “explicitation”, et que “la Vérité ultime n’est pas quelque chose qui reste à découvrir, mais quelque chose qui reste à être compris par chacun, et chacun doit faire le travail pour lui-même”. (René Guénon, 1939)
• Présentation du texte : — The American Scholar (n° de printemps 1939) publie une conférence de M. Ananda K. Coomaraswamy intitulée The Vedanta and Western Tradition ; cette conférence fut faite devant un auditoire d’étudiants américains, n’ayant naturellement aucune connaissance des doctrines orientales ; c’est dire que la tâche n’était certes pas exempte de difficultés. L’auteur expose tout d’abord avec une remarquable clarté les caractères essentiels de la métaphysique traditionnelle, ce qu’elle est et aussi ce qu’elle n’est pas, insistant particulièrement sur les différences capitales qui la séparent de tout ce qui porte habituellement le nom de “philosophie”. Il prend ensuite les principaux points de la doctrine du Vêdânta, les éclairant par des parallèles avec d’autres études traditionnelles, surtout avec celles des Grecs et du Christianisme, dont le langage doit être normalement plus familier à des Occidentaux, et montrant en même temps par là l’universalité de la tradition. Nous signalerons notamment les parties de l’exposé concernant Âtmâ et ses rapports avec le monde manifesté, la “transmigration” distinguée de la “métempsychose” et l’impossibilité de la “réincarnation”, le processus de la réalisation spirituelle ; dans cette dernière, nous retrouvons l’explication de quelques-uns des symboles dont nous avons eu l’occasion de parler récemment, comme ceux du “rayon solaire”, du “sommet de l’arbre” et de la “porte étroite”, avec la distinction des états “élyséen” et “empyréen” et le passage de l’un à l’autre “à travers le Soleil”. En terminant, l’auteur a soin de préciser que, dans toute doctrine traditionnelle, il ne s’agit jamais d’une “recherche”, mais seulement d’une “explicitation”, et que “la Vérité ultime n’est pas quelque chose qui reste à découvrir, mais quelque chose qui reste à être compris par chacun, et chacun doit faire le travail pour lui-même”. (René Guénon, 1939)***
Le Védānta et la tradition occidentale
Ce sont là réellement les pensées de tous les hommes en tous temps et en tous lieux ; elles ne sont pas nées avec moi. Walt Whitman
Il y a eu des maîtres tels qu’Orphée, Hermès, le Bouddha, Lao-Tseu et le Christ dont l’humaine existence en tant que fait historique peut être mise en doute et auxquels on accordera alors la dignité supérieure d’une réalité mythique. Shankara, comme Plotin, saint Augustin ou Eckhart, fut certainement un homme parmi les hommes bien que l’on sache relativement peu de choses sur sa vie. Il naquit dans une famille brahmane de l’Inde méridionale (1), vécut avec éclat dans la première moitié du IXe siècle après JC et fonda un ordre monastique qui subsiste encore de nos jours. Il devint sannyâsin, “homme véritablement pauvre”, à l’âge de huit ans, disciple d’un certain Govinda dont le maître avait été Gaudapâda, auteur d’un traité dans lequel il met en évidence la “non-dualité” de l’Être divin comme doctrine essentielle des Upanishads (2). Shankara se rendit à Bénarès où il écrivit à l’âge de douze ans son fameux commentaire des Brahma-Sūtras ; les commentaires des Upanishads et de la Bhagavad-Gītā furent écrits plus tard. Ce grand sage consacra la majeure partie de son temps à parcourir l’Inde entière, enseignant et prenant part à des controverses. On s’accorde pour fixer sa mort entre 30 et 40 ans. Les pérégrinations et discussions qui furent son lot ont toujours compté parmi les institutions caractéristiques de l’Inde ; à l’époque de Shankara comme maintenant le sanskrit était la langue commune des lettrés exactement comme le fut le latin pendant des siècles dans les pays occidentaux ; un libre débat public suscitait généralement tant d’intérêt que dans presque toutes les demeures princières de grandes salles étaient aménagées pour accueillir instructeurs et controversistes itinérants.
La métaphysique traditionnelle à laquelle se rattache le nom de Shankara est connue comme étant le Védānta, terme qu’on trouve dans les Upanishads et qui signifie la “fin des Védas”, avec le double sens de dernière section et d’importance ultime, ou comme étant l’ātma-vidyā, la doctrine de la connaissance du véritable “soi” ou “essence spirituelle”, ou encore comme étant l’advaita, la “non-dualité”. Ce dernier terme, tout en niant la dualité, n’avance aucune affirmation sur la nature de l’unité et ne doit pas être interprété comme impliquant quelque chose de semblable à nos monismes ou panthéismes. C’est une gnose (jñāna) qu’enseigne cette métaphysique.
Shankara ne fut en aucune façon le fondateur, l’inventeur ou propagateur d’une nouvelle religion ou philosophie ; sa tâche en tant qu’interprète de la doctrine védique consista à démontrer l’unité et la cohérence de celle-ci et à élucider ses apparentes contradictions par une mise en corrélation des formulations divergentes avec leurs points de vue respectifs. En particulier, comme dans la scolastique européenne, il distinguait deux approches complémentaires de Dieu, celle de la théologie affirmative et celle de la théologie négative. Dans la démarche de l’affirmation ou connaissance relative, les qualités sont par excellence des attributs de l’Identité suprême tandis que dans la démarche de la négation elles sont éliminées (3). Le fameux “non, non” des Upanishads base de la méthode suivie par Shankara comme dans celle du Bouddha, correspond à la vérité — énoncée entre autres par Dante — qu’il y a des choses inaccessibles à la pensée discursive et qu’on ne peut rendre intelligibles qu’en niant en elles tout ce qui est positif.
La manière de Shankara est aussi originale que puissante et non moins grande est sa finesse. De son commentaire de la Bhagavad-Gītā, je citerai un passage qui présente l’avantage supplémentaire de nous mettre tout de suite devant le problème central du Védānta : la discrimination de ce qui est réellement et non pas conformément à notre façon de penser “moi-même”. “D’où vient — demande Shankara — qu’il y a des maîtres qui, comme le commun des mortels, déclarent ‘je suis ainsi et ainsi’ et ‘cela est à moi’ ? Voici pourquoi. C’est parce que leur prétendu savoir revient à penser à leur corps comme étant leur soi”. Dans son commentaire des Brahma-Sūtras il énonce avec quatre mots sanskrits ce qui, du commencement à la fin, est demeuré dans la métaphysique hindoue la doctrine cohérente de l’Esprit immanent en chacun de nous, l’unique connaisseur agent et transmigrant (4).
La littérature métaphysique sur laquelle s’appuient les exposés de Shankara est constituée essentiellement par les quatre Védas avec leurs Brāhmanas et Upanishads complémentaires, tous textes considérés comme révélés et éternels, dont seule la recension est datable, antérieure de toute façon à 500 ans av. JC, auxquels il faut joindre la Bhagavad-Gītā et les Brahma-Sūtras (antérieurs au début de l’ère chrétienne). Dans cet ensemble de textes, les Védas sont liturgiques, les Brāhmanas sont une explication du rituel et les Upanishads sont consacrées à la doctrine de Brahma, à la Theologia Mystica, que présupposent la liturgie et le rituel (5). Les Brahma-Sūtras forment un abrégé extrêmement concis de la doctrine et la Bhagavad-Gītā est un exposé adapté à la compréhension de ceux dont la fonction native ressortit plus à la vie active qu’à la vie contemplative.
Pour plusieurs raisons que j’essaierai d’expliquer, exposer le Védānta s’avère plus difficile que ce ne serait le cas avec les vues personnelles d’un “penseur” moderne ou même d’un penseur tel que Platon ou Aristote. L’anglais en usage de nos jours, pas plus que le jargon des philosophes et psychologues contemporains, ne nous fournit un vocabulaire approprié et l’éducation actuelle ne comporte pas non plus un arrière-plan idéologique qui faciliterait la communication. Aussi je devrai user d’un langage purement symbolique, abstrait et technique, comme si je vous entretenais des mathématiques supérieures ; rappelez-vous qu’Émile Mâle parle du symbolisme chrétien comme étant une sorte de “calcul infinitésimal”. Il y a toutefois l’avantage suivant : ce qui est communiqué et les symboles employés pour le transmettre ne sont pas plus spécifiquement indiens qu’ils ne sont grecs ou islamiques, égyptiens ou chrétiens.
La métaphysique a recours le plus souvent à des symboles visuels (par ex. la croix et le cercle) et surtout au symbolisme du soleil et de la lumière parce que comme dit Dante “aucun autre objet des sens dans tout l’univers est plus digne d’être choisi pour représenter Dieu”. Mais je devrai aussi utiliser des termes techniques comme essence et substance, potentialité et acte, aspir et expir, exemplarité, éviternité (6), forme et accident. La métempsychose doit être distinguée de la transmigration et l’une comme l’autre de la “réincarnation”. Nous aurons aussi à faire le départ entre l’âme et l’esprit. Pour savoir quand et comment rendre un terme sanskrit par notre mot “âme” (anima, psyché), on doit apprendre les divers sens que ce mot a reçus dans la tradition européenne ; quelle sorte d’âme peut être “sauvée” ; quelle sorte d’âme le Christ nous demande de “haïr” si nous voulons devenir ses disciples ; à quelle sorte d’âme fait allusion Eckhart quand il dit que “l’âme doit se mettre à mort” ; et on doit se demander comment il est possible de penser aux animaux comme étant “sans âme” alors que le mot animal signifie littéralement “animé”. Nous devrons distinguer l’essence de l’existence et j’aurai peut-être à forger un mot comme “maintenant-toujours” (nowever) pour dégager la teneur complète et originale de mots tels que “soudainement”, “immédiatement” et “tout de suite”.
Pour la plupart d’entre nous la littérature sacrée de l’Inde n’est accessible que dans des traductions dues à des érudits plus rompus à la linguistique qu’à la métaphysique ; et elle a été exposée et expliquée — je devrais plutôt dire liquidée (explained away) — principalement par des savants imbus des suppositions propres au naturaliste ou à l’anthropologue, savants dont les capacités intellectuelles ont été tellement inhibées par leurs pouvoirs d’observation qu’ils ne savent plus distinguer la réalité de l’apparence, le Soleil surnaturel de la métaphysique d’avec le soleil physique de leur expérience individuelle. Ces derniers mis à part, la littérature hindoue a été étudiée et expliquée par des propagandistes chrétiens préoccupés avant tout de démontrer la fausseté et l’absurdité des doctrines concernées ; ou par des théosophistes qui ont caricaturé ces doctrines avec les meilleures intentions et des résultats peut-être encore pires.
L’homme instruit d’aujourd’hui a également perdu tout contact avec les modes de penser européens et les aspects intellectuels de la doctrine chrétienne qui approchent le plus de ceux des traditions védiques. Une connaissance du christianisme moderne sera peu utile car la sentimentalité foncière de notre époque a réduit ce qui autrefois était une doctrine intellectuelle à une simple morale qui se distingue à peine d’un humanitarisme pragmatique. On ne peut dire d’un Européen qu’il est suffisamment préparé pour l’étude du Védānta à moins qu’il ait acquis une certaine connaissance et compréhension d’auteurs tels que Platon, Philon le Juif, Hermès, Plotin, des Évangiles (surtout celui de saint Jean), de Denys l’Aréopagite et, pour finir, d’Eckhart qui, avec peut-être l’exception de Dante, doit être regardé, du point de vue hindouiste, comme étant le plus grand de tous les Européens.
Le Védānta n’est pas une “philosophie” dans le sens courant du mot mais uniquement avec celui qu’il a dans l’expression philosophia perennis, et uniquement si nous avons dans l’idée la “philosophie hermétique” ou la “sagesse” qui consolait Boèce (7). Les philosophies modernes sont des systèmes clos, utilisant les procédés de la dialectique et tenant pour établi que les oppositions s’excluent réciproquement. Dans la philosophie moderne les choses sont ainsi et pas autrement ; dans une philosophie éternelle cela dépend du point de vue qui est le nôtre. La métaphysique n’est pas un système mais une doctrine conséquente ; elle ne s’occupe pas simplement d’une expérience conditionnée et quantitative mais de la possibilité universelle. C’est pourquoi elle envisage des possibilités qui peuvent ne pas être des possibilités de manifestation, formelles d’une façon ou d’une autre, ainsi que des ensembles de possibilités pouvant se réaliser dans un monde donné. L’ultime réalité métaphysique est une Identité suprême dans laquelle l’opposition de tous les contraires, y compris celle de l’être et du non-être, se trouve résolue ; ses “mondes” et ses “dieux” sont des niveaux de référence, des entités symboliques qui ne sont ni des lieux ni des individualités mais des états d’existence réalisables en vous.
Les philosophes ont des théories personnelles sur la nature du monde ; notre “discipline philosophique” est avant tout une étude de l’histoire de ces opinions et de leur connexion historique. Misant sur leur chance d’apporter quelque perfectionnement aux théories de ses devanciers nous encourageons tout philosophe en herbe à avoir ses propres opinions. Nous n’envisageons pas, à l’instar de la philosophia perennis, la possibilité de connaître la vérité une fois pour toutes ; et nous nous proposons encore moins comme but de devenir cette vérité.
La “philosophie” métaphysique est appelée “pérenne” en raison de son éternité, universalité et immutabilité. C’est la “sagesse incréée” de saint Augustin, “la même maintenant telle qu’elle a été et telle qu’elle sera toujours” ; la religion qui, dit-il encore, a été dénommée chrétienne “seulement après la venue du Christ”. Ce qui fut révélé au commencement contient implicitement la vérité totale ; et aussi longtemps que la tradition est transmise sans déviation, autrement dit, aussi longtemps que la chaîne des maîtres et disciples n’est pas rompue, aucune contradiction ou erreur ne sont possibles. D’autre part, la compréhension de la doctrine doit être constamment renouvelée ; et ce n’est pas une question de vocabulaire. Que la doctrine en elle-même est absolument sans histoire n’exclut pas la possibilité, voire la nécessité, d’une incessante explicitation de ses formules ; une adaptation des rites pratiqués à l’origine et une application de ses principes aux arts et aux sciences. Plus l’humanité dévie de son auto-suffisance (self-sufficiency) primitive et plus s’impose une semblable application. De ces explicitations et adaptations une histoire est possible. C’est ainsi qu’intervient une distinction entre ce qui a été “entendu” au début et ce qui par la suite a été “remémoré”.
Une déviation ou hérésie n’est possible que lorsque l’essentiel de l’enseignement a été sous quelque rapport mal compris ou altéré. Dire par exemple que “je suis panthéiste” équivaut à avouer que je ne suis pas “métaphysicien” comme déclarer que “deux et deux font cinq” reviendrait à convenir que je ne suis pas “mathématicien”. Dans l’économie de la tradition ne peut subsister une contradiction quelconque, des théories ou dogmes exclusifs l’un de l’autre. Par exemple, ce qu’on appelle les “six systèmes de la philosophie hindoue” (une locution où seuls les mots six et hindoue sont justifiés) ne sont aucunement des théories qui s’excluent ou se contredisent. Ces prétendus systèmes sont ni plus ni moins orthodoxes que ne le sont les mathématiques, la chimie et la botanique, lesquelles, bien qu’étant des disciplines séparées et plus ou moins scientifiques en elles-mêmes, ne sont pas autre chose que des branches d’une “science” unique. L’Inde, en fait, utilise le terme de “branches” pour désigner ce que les indianistes prennent à tort pour des “sectes”. C’est précisément parce qu’il n’y a pas de “sectes” au sein de l’orthodoxie brahmanique que l’intolérance au sens européen est effectivement inconnue dans l’histoire indienne et pour la même raison il est tout aussi facile pour moi de penser dans les termes de la philosophie hermétique. Il y a forcément des “branches” puisque rien ne peut être connu si ce n’est selon la modalité du connaisseur ; aussi clairement que nous puissions saisir que tous les chemins mènent à un seul et même soleil, il est tout autant évident que chacun doit choisir le parcours qui part du point où il se trouve au moment de se mettre en route. Pour des raisons identiques, l’hindouisme n’a jamais été une foi missionnaire. Il se peut que la tradition métaphysique ait été préservée en Inde davantage et mieux qu’en Europe. S’il en est bien ainsi, cela signifie tout simplement que le chrétien apprendra du Védānta à mieux comprendre sa propre “voie”.
Le philosophe espère prouver ses vues. Pour le métaphysicien il suffit de montrer qu’une doctrine censément fausse est en contradictions avec les principes premiers. Par exemple un philosophe qui argumente en faveur de l’immortalité de l’âme s’efforcera de découvrir les preuves d’une survivance de la personnalité ; le métaphysicien se bornera à rappeler que “le premier commencement est forcément identique à la fin dernière”, d’où il suit que l’âme, pour autant qu’elle a été créée dans le temps, aura nécessairement une fin dans le temps. Le métaphysicien ne se laissera pas convaincre avec quelque prétendue “preuve de la survivance de la personnalité” pas plus qu’un physicien avec l’une ou l’autre prétendue preuve du mouvement perpétuel. Les questions dont s’occupe en ordre principal la métaphysique ne peuvent être prouvées ouvertement et on peut tout au plus les illustrer, c’est-à-dire les rendre intelligibles par analogie car, même vérifiées par une expérience personnelle, on ne peut les formuler qu’avec un langage symbolique et mythique. En même temps, la foi est dans une certaine mesure facilitée par la logique infaillible des textes et leur force attractive. Rappelons-nous la définition chrétienne de la foi : “adhésion à une proposition crédible”. Il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire. Toutefois, ce sont là des actes de la pensée non pas successifs mais simultanés. Autrement dit il ne saurait y avoir la connaissance de quelque chose à quoi la volonté refuserait son consentement ou l’amour de quelque chose que l’on ne connaît pas.
La métaphysique diffère encore davantage de la philosophie par le fait d’avoir une fin tout ce qu’il y a de plus pratique. Elle n’est pas plus une recherche de la vérité par amour de la vérité que les arts qui s’y rapportent sont une recherche de l’art pour l’art ou que la conduite qu’elle dicte est une observance morale par amour de la morale. Il y a évidemment une queste, mais le chercheur sait d’avance, dans la mesure où la chose est exprimable avec des mots, ce qu’il est en train de chercher ; et la queste ne prendra fin que lorsqu’il sera devenu l’objet même de sa recherche. Une connaissance qui n’est que verbale, un assentiment de pure forme ou un comportement impeccable ont tout au plus la valeur d’une indispensable prédisposition, celle des moyens au regard de la fin.
Pris dans leur matérialité, comme “littérature”, textes et symboles se dérobent inévitablement à la compréhension de ceux qui ne sont pas eux-mêmes à la recherche. Vocables et symboles métaphysiques sont sans exceptions les éléments techniques de cette queste. Ce ne sont jamais des parures littéraires et, comme Malinovsky l’a si bien dit en une autre occasion, “le langage technique, quand il s’agit d’une recherche pratique, n’acquiert sa signification que par une participation personnelle à ce genre de recherche”. C’est pourquoi les hindous ont le sentiment que les textes védiques, traduits littéralement et grammaticalement, n’ont jamais été compris par les érudits européens, dont les méthodes de travail sont de leur propre aveu objectives, sans engagement. Le Védānta ne peut être connu que dans l’exacte mesure où il est vécu. Conséquemment, un hindou ne peut accorder sa confiance à un instructeur dont la doctrine ne se reflète pas directement dans sa façon d’être et d’agir. C’est là quelque chose qui est aussi éloigné que possible de la moderne conception de l’érudition.
À l’intention de ceux qui entretiennent des idées romantiques sur “l’Orient mystérieux” nous devons ajouter que le Védānta n’a rien à voir avec la magie ou avec l’exercice de pouvoirs occultes. Il est exact qu’en Inde on admet l’efficacité des procédés magiques et la réalité des pouvoirs occultes. Mais la magie y est tenue pour une science appliquée de la plus basse catégorie et si des pouvoirs occultes tels qu’une action à distance sont obtenus accidentellement au cours d’une pratique contemplative, on considère leur usage, sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles, comme une dangereuse déviation de la voie.
Le Védānta n’est pas non plus une sorte de psychologie pas plus que le Yoga n’est une sorte de thérapeutique si ce n’est tout à fait incidemment. La santé physique et mentale est une condition préalable de toute entreprise spirituelle. On procède à une analyse psychologique pour démolir notre chère et naïve croyance en l’unité et immatérialité de “l’âme”, pour distinguer l’esprit de ce qui n’est pas l’esprit mais uniquement la manifestation psycho-physique d’une de ses modalités les plus limitées. Celui qui, comme Jung, s’obstine à résoudre en psychologie les données essentielles de la métaphysique hindoue ou chinoise ne peut que dénaturer le sens des textes. D’un point de vue hindouiste, la psychologie n’a guère plus de valeur que le spiritisme, la magie et autres “superstitions”. Pour finir, je dois souligner que la métaphysique, autrement dit le Védānta, n’est pas non plus une forme de mysticisme si ce n’est dans le sens avec lequel nous pouvons parler comme Denys l’Aréopagite d’une Theologia Mystica. Ce qu’on entend d’habitude par mysticisme implique une réceptivité passive — “nous devons nous rendre capables de laisser les choses arriver dans la psyché” comme dit Jung (qui ce disant se proclame “mystique”). En fait, la métaphysique répudie la psyché tout entière. Les paroles du Christ : “Nul ne peut devenir mon disciple s’il ne hait sa propre âme” ont été maintes et maintes fois prononcées par les gurus hindous ; loin d’impliquer de la passivité une pratique contemplative exige une activité que l’on compare souvent au flamboiement d’un feu tellement ardent qu’il ne laisse voir ni fumée ni vacillement. Le pèlerin de la voie est appelé un “homme à la tache” (toiler) et le refrain qui caractérise son chant est “Va de l’avant, va de l’avant !”. La “Voie” est par dessus tout activité.
Le Védānta considère comme admise une omniscience indépendante de toute source extérieure de connaissance et une béatitude indépendante de toute source extérieure de plaisir. En disant “Cela tu es” le Védānta affirme que l’homme possède, est lui-même “ce qui étant connu tout est connu” et “ce pour le seul amour de quoi toutes les choses sont chères”. Il affirme que l’homme méconnaît ce trésor qui est caché en lui parce qu’il a hérité de l’ignorance propre à la nature du véhicule psycho-somatique avec lequel il s’identifie par erreur. Le but de tout l’enseignement est l’élimination de cette ignorance ; quand l’obscurité a été percée il ne reste plus que la Gnose de la Lumière. C’est pourquoi la technique de cet enseignement quant à sa forme est toujours destructrice et iconoclaste ; ce n’est pas la communication d’une information mais l’instruction en une connaissance latente.
La “grande parole” des Upanishads est “Cela tu es”. Naturellement, “Cela” est ici l’Atman ou l’Esprit, le Sanctus Spiritus, le grec pneuma, l’arabe ruh, l’égyptien Amon, le chinois tch’i ; l’Atman est l’essence spirituelle, indivise, qu’elle soit transcendante ou immanente ; et aussi nombreuses et variées que soient les directions dans lesquelles il peut s’étendre ou d’où il peut se replier, il est le moteur immobile dans le double sens transitif et intransitif. Il se prête à toutes les modalités de l’être mais ne devient jamais lui-même quelqu’un ou quelque chose. Cela, au regard de quoi tout le reste est un tourment — Cela tu es. En d’autres termes, “Cela” est le Brahman, ou Dieu dans le sens général de Logos ou l’Être considéré comme source universelle de toute existence — déployant, manifestant et produisant, la fontaine de toutes choses, lesquelles sont toutes “en” lui comme le fini est dans l’infini sans en être toutefois une “partie” puisque l’infini est sans parties.
Dans ce qui suit, j’utiliserai le plus souvent le mot Atman. L’Atman en tant qu’il est ce qui souffle (8) et illumine, est premièrement “Esprit” (et parce que ce divin Éros [9] est l’essence incitatrice de toutes choses et ainsi leur être réel) mais le mot Atman est également employé comme pronom réfléchi pour signifier “soi” — comme soi-même, en un sens quelconque même grossier, ou par référence au soi spirituel, à la personne (comme unique sujet connaissant, l’essence de toutes choses, qu’il faut distinguer du “moi” sensible et contingent, celui-ci étant composé du corps et de tout ce que nous entendons par “âme” quand nous parlons de “psychologie”). Deux “sois” très différents sont donc ainsi impliqués et il en est résulté que les traducteurs ont pris l’habitude de rendre Atman par “soi” écrit avec une minuscule ou une majuscule selon le contexte. La même distinction est tracée, par exemple, par saint Bernard entre ce qui est ma “propriété” (proprium) et ce qui est mon être véritable (esse).
Une formule disjonctive hindouiste distingue le “connaisseur du champ” — l’Esprit en tant qu’unique sujet connaissant en toutes choses et le même en tout — d’avec le “champ”, le composé corps et âme tel qu’on vient de le définir (comprenant les pâtures des sens et embrassant par conséquent tout ce qui peut être envisagé objectivement). L’Atman ou Brahman n’est pas susceptible d’être envisagé de cette façon car “Comment pourrais-tu connaître le connaisseur de la connaissance ?” — en d’autres termes : comment la cause première de toutes les choses pourrait-elle être l’une d’elles ?
L’Atman est sans division mais il est divisé en apparence et identifié avec le divers par les différentes formes de ses véhicules : souris ou homme, de même que l’espace déterminé et différent dans une jarre est manifestement séparé et distinguable d’avec l’espace qui l’entoure. Dans ce sens on peut dire : “Il est unique en lui-même mais plusieurs tel qu’il est dans ses enfants” et “se partageant il remplit ces mondes”. Mais il en est ainsi seulement dans le sens où la lumière remplit l’espace tandis qu’elle demeure elle-même sans solution de continuité, ce qui distingue les choses les unes des autres dépendant non de différences dans la lumière mais uniquement de leur pouvoir réfléchissant. Quand la jarre est mise en pièces, quand le vase de la vie est détruit, nous comprenons que ce qui était limité en apparence était sans bornes et que la “vie” a un sens qu’il ne faut pas confondre avec “vivant”. Dire que l’Atman est ainsi à la fois participé et indivisible, “non divisé parmi les choses divisées”, sans position locale et en même temps partout, est une autre façon de désigner ce avec quoi nous sommes davantage familiers : la doctrine de la Présence totale.
En même temps, chacune de ces apparentes délimitations de l’Esprit correspond à l’actuation dans la durée d’une de ses possibilités indéfiniment nombreuses de manifestation formelle. L’existence de l’apparition commence avec la naissance et finit avec la mort ; elle n’est pas renouvelable. Rien de “Shankara” ne survit si ce n’est un legs charitable. Pour cette raison, bien que nous puissions parler de lui comme étant encore une force vivante dans le monde, l’homme n’est plus qu’un simple souvenir. D’autre part, à l’Esprit gnostique, au Connaisseur du champ, de toutes les naissances, ne peut jamais faire défaut une connaissance directe de chacune de ses modalités, un savoir sans avant et sans après (relatif à l’apparition et à la disparition de Shankara dans le champ de notre expérience). Il s’ensuit que là où connaissance et être, nature et essence sont un et le même, l’être de Shankara est sans commencement et ne saurait avoir de fin. Autrement dit, dans un certain sens nous pouvons parler convenablement de “mon esprit” et de “ma personne” comme de “l’Esprit” et de “la Personne”, bien que l’Esprit et la Personne soient une substance parfaitement simple, sans composition. Je reviendrai plus loin sur la signification de “l’immortalité”, mais pour le moment je désire m’appuyer sur ce que je viens de formuler pour expliquer ce qu’il faut entendre par une distinction de points de vue exempte de tout sectarisme. Alors que l’étudiant occidental en “philosophie” pense que le Sāmkhya et le Védānta sont deux “systèmes” inconciliables parce que le premier envisage la libération d’une pluralité de Personnes et le second la libération d’une personne indénombrable, pareille antinomie n’existe pas pour un hindou. On peut déjà l’expliquer avec la remarque que dans les textes chrétiens : “Vous êtes tous un en Jésus-Christ” et “Quiconque est uni au Père est un en esprit” les pluriels “vous” et “quiconque” représentent le “point de vue” du Sāmkhya et le singulier “un” celui du Védānta.
La validité de notre conscience d’être, mis à part toute question d’être Un-tel, avec un nom et des traits enregistrables, est donc reconnue comme fondée. Il importe de ne pas confondre ceci avec l’argument : Cogito ergo sum. Que “je” sens ou que “je” pense ne prouve pas que “je” suis, car on peut dire avec le védantiste ou le bouddhiste que c’est là une simple question d’opinion, que “les sentiments sont éprouvés” et que “les pensées sont pensées”, que tout cela fait partie du “champ” dont l’esprit est le surveillant (surveyor), de même que nous regardons un tableau qui, en un certain sens, est une partie de nous-même bien que nous ne soyons en aucun sens une de ses parties. Conséquemment se pose la question : “Qui es-tu ?” “Qu’est ce soi auquel nous devons recourir ?” Nous admettons tous que le mot “soi” peut avoir plus d’une signification quand nous parlons d’un “conflit intérieur” ; quand nous disons que “l’esprit est prompt et la chair faible” ; ou quand nous disons avec la Bhagavad-Gītā que “l’Esprit est en guerre avec tout ce qui n’est pas l’Esprit”.
Suis “je” l’esprit ou la chair ? (Nous devons toujours nous souvenir qu’en métaphysique la “chair” comprend les facultés cognitives et esthétiques [10] de l’âme). Nous pouvons être convié à considérer notre reflet dans un miroir et pouvons comprendre que nous nous voyons là “nous-même” ; si nous sommes un peu moins naïf nous pouvons être convié à considérer l’image de la psyché telle qu’elle se reflète dans le miroir de la pensée et pouvons comprendre que nous ne sommes aucune de ces choses qu’elles existent parce que nous sommes plutôt que nous existons parce qu’elles sont. Le Védānta affirme que dans mon “essence” je suis aussi peu, ou seulement autant, impressionné par toutes ces choses qu’un auteur dramatique est impressionné par la vue de la douleur ou de la joie éprouvée par ceux qui évoluent sur la scène la scène, dans ce cas, de la “vie” (en d’autres termes, le “champ” ou “pâturage” distingué d’avec son surveillant aquilien, l’Homme Universel). Tout le problème de la fin dernière de l’homme, de sa libération, béatitude ou déification, revient donc à se trouver “soi-même” non plus dans “cet homme” mais dans l’Homme Universel (11), la forma humanitatis, qui est indépendante de tous les ordres du temps et n’a ni commencement ni fin.
Concevez que le “champ” est le cercle ou cirque du monde, que le trône du Spectateur, de l’Homme Universel, est au centre et surélevé, que son regard d’aigle embrasse en tous temps la totalité du champ (aussi bien avant qu’après le déroulement de chaque événement particulier) de sorte que de son point de vue tous les événements poursuivent incessamment leur cours). Nous allons transférer notre conscience d’être, de notre position dans le champ, où les jeux continuent, au pavillon dans lequel se tient au repos le Spectateur dont dépend l’entier accomplissement.
Concevez que les lignes droites de la vision par lesquelles le Spectateur est relié à chaque exécutant séparé et le long desquelles chacun pourrait regarder en haut (intérieurement) vers le Spectateur si ses capacités de vision étaient suffisantes, sont les lignes de force ou fils par lesquels le maître des marionnettes meut celles-ci pour lui-même (étant toute l’assistance). Chacune des marionnettes en action est convaincue de sa propre existence indépendante, comme une marionnette parmi les autres qu’elle aperçoit dans l’environnement immédiat qui lui est propre et qu’elle distingue par leurs nom, apparence et comportement. Le Spectateur ne voit pas et ne peut voir les marionnettes ou exécutants comme eux se voient, imparfaitement, mais il connaît l’être de chacun d’eux tel qu’il est réellement — c’est-à-dire pas seulement efficient dans une position locale donnée, mais simultanément en chaque point le long de la ligne de force visuelle par laquelle la marionnette est en liaison avec lui, et essentiellement en ce point vers lequel convergent toutes les lignes de force et où l’être de toutes choses coïncide avec l’être en soi. En ce point l’être de la marionnette subsiste comme une raison éternelle dans l’intellect éternel appelé encore le Soleil céleste (supernal), la Lumière des lumières, l’Esprit, la Vérité.
Supposons maintenant que le Spectateur s’endorme quand il ferme les yeux l’univers disparaît, pour ne réapparaître que lorsqu’il les ouvre de nouveau. L’ouverture des yeux (”Que la lumière soit”) est appelée en religion l’acte de création mais en métaphysique elle s’appelle manifestation, émission ou souffle (briller, émettre et respirer étant une seule et même chose in divinis) ; la fermeture des yeux est appelée en religion la “fin du monde” mais en métaphysique elle s’appelle retrait, silence, rétention du souffle. Pour nous il y a ainsi alternance ou évolution et involution. Mais pour le Spectateur central il n’y a aucune succession d’événements. Il est toujours éveillé et toujours endormi. Différent du marin qui tantôt se repose et pense et tantôt ne pense pas, notre Spectateur se repose et pense, et ne pense pas, maintenant-toujours (nowever).
Je viens de dresser un tableau du cosmos et de “l’Œil” qui le surveille. J’ai toutefois omis de dire que le champ est divisé par des clôtures concentriques que l’on peut, par commodité, mais ce n’est pas nécessaire, fixer au nombre de vingt et une (12). Le Spectateur est ainsi à la vingt-et-unième portion de l’espace à partir de la barrière la plus extérieure avec laquelle est délimité l’environnement envisagé. Chaque exploit d’un acteur ou occupant du parterre est confiné dans les possibilités que représente l’espace entre deux barrières. C’est là qu’il est né et c’est là qu’il meurt. Considérons cet être venu au monde, le dénommé Un-tel, comme il est en lui-même et comme il s’imagine — “un animal raisonnable et mortel, que je connais et reconnais comme étant ce que je suis”, comme dit Boèce. Un-tel ne conçoit pas qu’il peut aller et venir à son gré dans le temps mais sait qu’il vieillit chaque jour, que la chose lui plaise ou non. En revanche, il conçoit que sous d’autres rapports il peut faire ce qu’il lui plaît, dans la mesure où ne s’y oppose pas son environnement — par exemple, un mur de briques, l’agent de police ou les mœurs de l’époque. Il ne comprend pas que cet environnement dont il fait partie et auquel il ne peut se soustraire est un environnement déterminé par les lois de la causalité ; que celle-ci fait ce qu’elle fait en raison de ce qui a été fait. Il ne comprend pas qu’il est ce qu’il est et fait ce qu’il fait parce que d’autres avant lui ont été ce qu’ils furent et ont fait ce qu’ils firent, et tout cela sans le moindre commencement concevable. Un-tel est au sens propre du mot une créature des circonstances, un automate, dont le comportement aurait pu être prévu et expliqué avec une entière connaissance des causes passées, représentées à présent par la nature des choses y compris sa propre nature. C’est la doctrine du karma, doctrine de la fatalité innée, que la Bhagavad-Gītā énonce ainsi : “Lié par l’action (karma) d’une nature qui est née en toi et qui t’appartient en propre, ce que tu désires ne pas faire tu le fais bon gré mal gré” (XXI-20). Un-tel n’est que le maillon d’une chaîne causale dont nous ne pouvons imaginer un commencement ou une fin. Il n’y a ici rien sur quoi le déterministe le plus endurci ne puisse être d’accord. Le métaphysicien — qui, lui, n’est pas comme le déterministe, un nāstika, un “rien-de-plus” (13) — se contente en ce point de signaler que c’est seulement ainsi que le travail de la vie, son mode de perpétuation, est explicable causativement, que l’existence d’une chaîne de causes présuppose la possibilité logiquement antérieure de cette existence — en d’autres mots, présuppose une cause première dont on ne peut penser qu’elle est une cause médiate parmi d’autres dans l’espace ou dans le temps.
Pour revenir à notre automate, considérons ce qu’il arrive à sa mort. L’être composite est défait dans le cosmos ; il n’y a plus rien qui puisse survivre comme conscience d’être Un-tel. Les éléments de l’entité psycho-physique sont dispersés et transmis à d’autres comme un don charitable. C’est là en réalité un processus qui s’est continué durant toute la vie de notre Un-tel et dont on peut facilement suivre le déroulement, maintes fois décrit dans la tradition hindoue comme “renaissance du père dans et comme fils”. Un-tel vit dans ses descendants directs et indirects. C’est la prétendue doctrine hindoue de la “réincarnation” ; elle correspond à la doctrine grecque de la mésentomatose ou métempsychose ; c’est aussi la doctrine chrétienne de notre préexistence en Adam “selon la substance corporelle et la vertu séminale” ; et c’est également la moderne doctrine de la “récurrence des caractères ancestraux”. Seul le fait d’une telle transmission des caractères psycho-physiques peut rendre intelligible ce que la religion appelle notre héritage du péché originel, en métaphysique notre héritage de l’ignorance, et le philosophe notre prédisposition à connaître en termes de sujet et d’objet. Ce n’est que lorsque nous sommes convaincus que rien ne peut arriver par hasard que l’idée de Providence devient intelligible.
Dois-je dire qu’il ne s’agit pas d’une doctrine de la réincarnation ? Dois-je dire qu’aucune doctrine de la réincarnation selon laquelle l’être véritable, la personne (14) d’un homme ayant vécu autrefois sur terre et à présent décédé, renaîtra d’une autre mère terrestre n’a jamais été enseignée en Inde, pas même dans le bouddhisme — ni sur ce point dans le néoplatonisme ou dans quelque autre tradition orthodoxe ? Dans les Brāhmanas il est dit aussi nettement que dans l’Ancien Testament que ceux qui, dans le passé, ont quitté ce monde sont partis pour toujours et ne renaîtront plus parmi les vivants. Du point de vue hindouiste comme du point de vue platonicien tout changement est une mort. Nous mourons et renaissons chaque jour et à toute heure, et la mort “quand le moment arrive” n’est qu’un cas spécial. Je ne dis pas qu’une croyance en la réincarnation n’a jamais été professée en Inde. Je dis qu’une telle croyance n’a pu provenir que d’une mésinterprétation populaire des textes, que la croyance des érudits modernes et des théosophistes résulte d’une interprétation aussi naïve que mal informée de ces textes. Si vous demandez comment une telle croyance a pu prendre corps, je vous demanderai de considérer les énoncés suivants de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin : nous étions en Adam “selon la substance corporelle et la vertu séminale” ; “le corps humain préexistait dans les œuvres antérieures dans leurs vertus causales” ; “Dieu ne gouverne pas le monde directement mais aussi au moyen des causes médiates, et s’il n’en avait pas été ainsi, le monde eût été privé de la perfection de la causalité”, “comme une mère est grosse de sa progéniture à naître, ainsi le monde même est fécond avec les causes des choses non nées” ; “la Fatalité réside dans les causes créées mêmes”. Si ces textes avaient été extraits des Upanishads, n’y auriez-vous pas vu, non pas uniquement ce qui s’y trouve réellement, la doctrine du karma, mais aussi une doctrine de la “réincarnation” (15) ?
Par réincarnation nous entendons une re-naissance ici-bas de l’être véritable, de la personne (16) du défunt. Nous affirmons que c’est là une impossibilité pour de bonnes et suffisantes raisons métaphysiques. La considération principale est la suivante : étant donné que le cosmos embrasse une série indéfinie de possibilités dont toutes se réaliseront dans une durée également indéfinie, le présent univers aura terminé sa course quand toutes ses possibilités se seront traduites en acte — de même que chaque vie humaine termine sa carrière quand toutes ses possibilités sont épuisées. La fin d’une éviternité (17) sera atteinte sans qu’il y ait place pour l’une ou l’autre répétition d’événements ou récurrence de conditions révolues. La succession temporelle implique une succession de choses différentes. L’histoire se répète en des types mais ne peut se répéter avec l’un ou l’autre détail particulier. Nous pouvons parler d’une “migration de gènes” et appeler ce fait une renaissance de types mais cette réincarnation du caractère d’Un tel n’est pas à confondre avec la transmigration de sa véritable personne.
Ainsi sont la vie et la mort de l’animal raisonnable et mortel. Mais quand Boèce confesse qu’il n’est que cet animal, la Sagesse réplique que cet homme Un tel oublie ce qu’il est. C’est en ce point que nous nous séparons du “rien de plus” (nothing-morist), du “matérialiste” et du “sentimentaliste” (Je mets ces deux mots entre guillemets parce que la matière est ce qui est “senti”). Souvenez-vous de la définition de l’homme comme “corps, âme, et esprit” (18). Le Védānta soutient que seul l’être véritable est spirituel et que cet être qui lui est propre n’est pas “dans” Un tel ou dans une de ses “parties” (19) mais est uniquement réfléchi en lui. En d’autres termes, il soutient que cet être n’est pas au niveau du champ d’Un tel ou limité de quelque façon par ce champ, mais s’étend de ce champ jusqu’au centre sans s’arrêter aux barrières qu’il pénètre. Ce qui, dès lors, arrive au moment de la mort, par delà la décomposition d’Un tel, est le retrait de l’esprit hors du véhicule phénoménique dont il a été la “vie”. Par conséquent, nous parlons de la mort avec la précision la plus rigoureuse en disant “rendre l’âme” ou Un tel “expire”. Il me faut, j’en suis certain, vous rappeler seulement par parenthèse que cette “âme” (ghost) n’est pas un esprit dans le sens spirite, ce n’est pas un “personnage” qui survit, mais un principe purement intellectuel comme celui dont sont faites nos idées : l’âme (ghost) est un esprit dans le sens où, en anglais, Holy Ghost est le Sanctus Spiritus. Ainsi, à la mort, la poussière retourne à la poussière et l’esprit à l’esprit.
Il s’ensuit que la mort d’Un tel comporte deux possibilités qui, approximativement, sont celles qu’impliquent les expressions familières “sauvé” et “perdu”. Ou bien la conscience d’Un tel a été centrée sur lui-même et doit périr avec lui, ou bien elle a été centrée sur l’esprit et s’en va avec celui-ci. C’est, comme l’énoncent les textes védantiques, l’esprit qui demeure par delà quand le corps et l’âme sont défaits. Nous commençons maintenant à voir ce que signifie le grand commandement “Connais-toi toi-même”. Dans l’hypothèse que notre conscience d’être a été centrée sur l’esprit nous pouvons dire que plus complètement nous serons devenus “ce que nous sommes”, “éveillés”, avant la dissolution du corps, et plus près du centre du champ sera notre nouvelle apparition ou “renaissance”. Notre conscience d’être ne va nulle part ailleurs que là où elle est déjà.
Nous envisagerons plus loin le cas de celui dont la conscience d’être s’est éveillée par delà la dernière des vingt et une barrières ou vingt et un niveaux de référence et pour qui il ne reste plus qu’un vingt et unième passage. Considérons pour le moment le premier pas. Si nous avons fait ce premier pas avant de mourir — si nous avons vécu “en esprit” jusqu’à un certain degré et non tout bonnement en animaux raisonnables — nous aurons, le corps et l’âme étant défaits dans le cosmos, franchi la première des barrières ou circonférences établies entre nous et le Spectateur central de toutes choses, le Soleil éternel, l’Esprit et la Vérité. Nous serons venu à l’existence dans un nouvel environnement où, par exemple, il y aura peut-être encore une durée mais pas dans le sens que nous avons maintenant de l’écoulement du temps. Nous n’aurons pas emporté avec nous l’un ou l’autre des mécanismes psycho-physiques dans lesquels une mémoire sensorielle pourrait subsister. Seules les “vertus intellectuelles” survivent. Il ne s’agit pas de la survivance d’un “personnage” (lequel était une propriété que nous avons léguée en partant) ; c’est l’existence continuée de la véritable personne d’Un tel, désormais débarrassée des délimitations antérieures les plus grossières d’Un tel. Nous serons passé au-delà sans une interruption de la conscience d’être.
Dans cette voie, par une succession de morts et de renaissances, toutes les barrières peuvent être franchies. Le chemin que nous suivons sera celui du rayon spirituel ou rayon du cercle qui nous rattache au Soleil central. C’est le pont unique qui enjambe la rivière de la vie séparant le bord d’ici du bord le plus éloigné. Le mot “pont” est employé à dessein, car c’est la “digue plus étroite que le tranchant d’un rasoir”, le pont Cinvat de l’Avesta, le “pont d’épouvante” familier au folkloriste, que seul un héros solaire est capable de traverser, c’est un vaste pont de lumière, consubstantiel avec sa source que le Véda proclame “le pont même” — expression qui correspond au “Je suis la voie” des chrétiens. Vous avez déjà deviné que la traversée de ce pont, par des gradins qui délimitent ses points d’intersection avec nos vingt-deux circonférences, constitue ce qui est une transmigration ou régénération progressive proprement dite. Chaque pas dans cette voie a été marqué par une mort à un “moi” antérieur et par une renaissance consécutive et immédiate comme “autre homme”. Je dois intercaler ici la réserve que ce qui précède simplifie par trop mon exposé. En effet, ayant distingué deux directions de mouvement, l’une circonférentielle et déterminée, l’autre centripète et libre, je n’ai pas mis en évidence que leur résultante ne se laisse indiquer convenablement que par une spirale.
Mais il est temps de démonter le matérialisme spatio-temporel de notre image du cosmos et du pèlerinage de l’homme depuis sa circonférence jusqu’au centre ou cœur. Tous les états d’être, tous ceux d’Un tel que nous avons conçu comme venant à l’existence à des niveaux superposés, sont en vous, attendant leur reconnaissance ; toutes les morts et renaissances impliquées sont préternaturelles — c’est-à-dire ne sont pas “contre la nature” — mais extrinsèques aux possibilités particulières de l’état donné d’existence à partir duquel la transmigration est envisagée comme ayant lieu. Et ne s’y trouve pas non plus impliqué un facteur temps. Plutôt, puisque les vicissitudes temporelles ne jouent aucun rôle dans la vie de l’esprit, il est possible que le voyage s’accomplisse partiellement ou entièrement soit avant la venue de la mort naturelle soit à l’article de la mort ou après. Le pavillon du Spectateur est le Royaume des Cieux qui est en vous, c’est-à-dire dans le cœur (le cœur dans toutes les traditions orientales et anciennes est non seulement le siège de la volonté mais aussi de l’intellect pur, le lieu où se consomme le mariage du Ciel et de la Terre) ; c’est là seulement que le Spectateur peut être vu par le contemplatif dont le regard est inversé et remonte ainsi le chemin du Rayon qui rattache l’œil extérieur à l’Œil intérieur, le souffle de la vie au Vent de l’Esprit.
À présent nous pouvons peut-être mieux comprendre tout ce que signifient les mots poignants du Requiem védique : “le Soleil reçoit ton œil, le Vent ton esprit” et pouvons reconnaître leur équivalent dans ces paroles d’Eckhart : “l’œil avec lequel je vois Dieu et l’œil de Dieu sont un seul œil, une seule vision, un seul acte de connaissance, un seul amour”, ou de saint Paul : “vous serez un seul esprit”. Les textes traditionnels sont énergiques. Par exemple, on trouve dans les Upanishads l’assertion que quiconque adore en pensant que la divinité est autre que lui-même ne vaut guère plus qu’un animal.
Cette attitude transparaît dans l’aphorisme passé en proverbe et disant que “pour adorer Dieu vous devez devenir Dieu” — ce qui est également le sens des mots “adorer en esprit et en vérité”. Nous sommes ainsi ramenés à la grande parole : “Cela tu es” et avons maintenant une meilleure idée mais encore éloignée d’une compréhension parfaite (parce que le dernier pas reste à franchir) de ce que “Cela” peut être. Nous pouvons à présent voir comment les doctrines traditionnelles (distinguant l’extérieur et l’intérieur, l’homme de ce monde-ci et l’homme de l’autre monde, l’automate et l’esprit immortel), tout en déclarant et en insistant sur la chose qu’Un tel n’est qu’un maillon dans une chaîne causale sans fin, affirment néanmoins que les chaînes peuvent être brisées et la mort vaincue sans acceptation de temps ; que par conséquent cela peut arriver aussi bien ici et maintenant qu’au moment de la mort ou après.
Toutefois, nous ne sommes pas encore arrivés à ce qui est défini du point de vue métaphysique comme étant la fin suprême et ultime de l’homme. En parlant d’une fin de parcours nous avons jusqu’ici pensé uniquement à une traversée de toutes les vingt et une barrières et à une vision du Soleil suprême, de la Vérité même, à l’accession au pavillon du Spectateur, à l’existence dans le Ciel face à face avec l’Œil manifesté. C’est là, en fait, la conception de la fin dernière de l’homme telle qu’elle est envisagée par la religion. Il s’agit d’une béatitude éviternelle atteinte à la “Cime de l’Arbre”, au “Sommet de l’existence contingente” ; c’est un salut hors de toutes les vicissitudes temporelles du champ que nous avons laissé derrière nous. Mais c’est un paradis dans lequel chacun est un sauvé parmi ses pareils et autre que le Soleil des hommes ou Lumière des lumières, expressions aussi bien védiques que chrétiennes ; c’est un paradis qui, comme l’Élysée grec, est en dehors du temps mais non sans durée ; un lieu de repos et non une demeure définitive (dès lors que ce n’était pas notre ultime source, laquelle était dans le Non-Être de la Déité). Il nous reste à traverser le Soleil afin de parvenir au “domaine” (home) empyréal du Père. “Nul ne parvient au Père si ce n’est par moi”. Nous sommes passés par les portails de l’initiation et de la contemplation ; nous avons, grâce à un processus d’auto-négation, passé de la zone la plus extérieure à la zone la plus intime de notre être et n’entrevoyons plus aucune voie permettant d’aller plus loin — tout en sachant que derrière cette image de la Vérité, par laquelle nous avons été illuminés, il y a quelque chose en dehors de toute comparaison et tout en sachant que derrière cette face de Dieu qui brille sur le monde il y a un autre et terrifiant côté qui n’est pas tourné vers l’homme mais entièrement replié sur lui-même un aspect qui ne connaît ni n’aime quoi que ce soit d’extérieur à lui-même. C’est notre propre conception de la Vérité et de la Bonté qui nous empêche de voir Celui qui n’est ni bon ni vrai dans un sens qui est nôtre. L’unique voie d’approche passe directement à travers tout ce qui nous avait fait penser que nous commencions à comprendre ; si notre voie d’accès est à trouver, l’image de “nous-mêmes” que nous chérissons encore — si élevée qu’en soit la manière — et celle de la vérité et de la bonté que nous avons imaginées per excellentiam doivent d’un seul et même coup voler en éclats. “Plus nécessaire à l’âme qu’elle perde Dieu plutôt que les créatures (…) l’âme honore Dieu davantage en étant libérée de Dieu (…) mourir à toute activité désignée par la nature divine si elle doit entrer dans la divine nature où Dieu est entièrement désœuvré (…) elle perd son propre soi, et allant son propre chemin, ne s’enquiert plus de Dieu” (Eckhart). En d’autres termes, nous devons être un avec le Spectateur quand ses yeux sont ouverts et quand ils sont fermés. Sinon, que deviendrons-nous quand il dort ? Tout ce que nous a appris la théologie positive doit être complété et achevé avec une Inconnaissance, la Docta Ignorantia des théologiens chrétiens, l’A-gnôsia d’Eckhart. C’est pour cette raison que des hommes comme Shankara et Denys l’Aréopagite ont si fortement insisté sur la via remotionis (20), et non parce qu’un concept positif de la Vérité ou Bonté leur était si peu que ce soit moins cher qu’à nous. Il est rapporté en effet que la pratique personnelle de Shankara fut dévotionnelle — même quand il implorait le pardon pour avoir adoré avec un nom le Dieu qui n’a pas de nom. Pour de tels hommes il n’y avait littéralement rien qu’ils ne fussent prêts à abandonner.
Énonçons d’abord la doctrine chrétienne afin de mieux comprendre l’hindoue. Les paroles du Christ sont les suivantes : “Je suis la porte ; par moi si un homme entre il sera sauvé ; et il sera libre d’entrer et de sortir”. Ce n’est pas assez d’avoir atteint la porte ; nous devons être admis. Et il faut payer le prix de cette admission ; “que celui qui veut sauver son âme la perde”. Des deux sois propres à l’homme, les deux ātmans des textes hindouistes, le soi connu avec un nom, comme étant Un tel, doit être mis à mort pour que l’autre soi, délivré de toutes les entraves, soit “libre comme la Déité dans sa non-existence”.
Dans les textes védantiques c’est également le Soleil des hommes ou Lumière des lumières qui est appelé le portail des mondes et le gardien du seuil. Quiconque est arrivé jusque là est mis à l’épreuve. En premier lieu on lui déclare qu’il entrera conformément au solde créditeur du bien et du mal dont il est redevable. S’il comprend il répondra : “Tu ne peux me demander cela ; tu n’ignores pas que ce que ‘moi’ j’ai pu accomplir n’était pas ‘mon’ fait mais le ‘tien’”. C’est là la Vérité ; et il n’est pas dans le pouvoir du Gardien du Seuil, lequel est la Vérité elle-même, de se désavouer. On pourra aussi lui poser la question : “Qui es-tu ?” S’il répond en donnant ses nom et prénom il est littéralement emporté par les facteurs du temps ; mais s’il répond : “Je suis la Lumière, toi-même, et comme tel viens à toi”, le Gardien répondra avec les mots de bienvenue : “Quoi que tu sois je le suis et ce que je suis tu l’es ; entre”. Il devrait être tout à fait clair qu’il ne peut y avoir de retour à Dieu pour celui qui est encore quelqu’un car, ainsi que l’énoncent nos textes : “Il n’est venu d’aucun endroit ni devenu quelqu’un”.
De la même façon, appuyant son dire sur le logos — “Si un homme ne hait ses père et mère (…) oui et même aussi son âme, il ne peut être mon disciple” —, Eckhart déclare “aussi longtemps que tu sais qui étaient ton père et ta mère dans le siècle, tu n’es pas mort de la mort véritable” ; et de la même façon Rûmî, l’égal d’Eckhart en Islam, attribue au Gardien du Seuil ces mots : “Quiconque entre en disant je suis Un tel, je le frappe en plein visage”. En fait, on ne peut offrir une meilleure définition des Écritures védiques que celle de saint Paul disant : “la Parole de Dieu est rapide et puissante, plus acérée qu’une épée à double tranchant, s’étendant même jusqu’à la séparation de l’âme d’avec l’esprit” : Quid est ergo, quod debet homo inquirere in hac vita ? Hoc est ut sciat ipsum. Si ignoras te, egredere (21).
Le dernier et plus difficile problème surgit quand nous demandons quel est l’état de l’être ainsi délivré de lui-même et retourné à sa source ? Il est on ne peut plus évident qu’une explication psychologique est ici hors de propos. De fait, c’est précisément en ce point que l’on peut le mieux reconnaître que “celui qui est le plus certain de comprendre très certainement ne comprend pas”. Du Brahman, ce que l’on peut dire — Il est et c’est seulement ainsi qu’il se laisse appréhender — peut tout aussi bien se dire de celui qui est devenu le Brahman. Il est impossible de dire ce qu’il est parce qu’il n’est aucun ceci. Un être “délivré dans cette vie” (l’homme mort qui marche de Rumi) est “dans le monde mais pas du monde”.
Nous pouvons néanmoins approcher le problème en considérant en quels termes il est parlé des Réalisés (Perfected). Ils sont appelés Rayons de Soleil, Vents de l’Esprit ou Se-mouvant-à-leur-gré. On dit aussi qu’ils sont aptes à s’incorporer dans les mondes manifestés, c’est-à-dire aptes à participer à la Vie de l’Esprit, qu’ils se meuvent ou restent au repos. C’est un Esprit qui souffle où il veut. Toutes ces expressions correspondent à la parole du Christ : “Il entrera et trouvera des pâtures”. On peut également le comparer au pion dans un jeu d’échecs. Quand il a traversé l’échiquier du côté le plus rapproché au côté le plus éloigné, le pion est transformé. Il devient intendant et est appelé familièrement “celui qui se meut à sa guise”. Mort à son ci-devant soi, il n’est plus confiné dans des directions ou positions particulières, mais peut aller et venir à son gré, à partir de l’emplacement où ses transformations se sont réalisées. Et cette liberté de se mouvoir à volonté est un autre aspect de l’état des Parfaits, mais elle dépasse la conception de ceux qui sont encore de simples pions. On peut aussi remarquer que le pion d’antan, même sous la menace d’une mort imminente, dans son voyage à travers la table de jeu, demeure libre après sa transformation, soit de se sacrifier soit d’échapper au danger. En termes strictement hindouistes, son mouvement antécédent était une traversée, son mouvement régénéré est une descente.
La question de l’anéantissement que les érudits occidentaux n’ont cessé de débattre avec tant de sérieux ne se pose pas. Le mot n’a pas de sens en métaphysique, où il est traité uniquement de la non-dualité, du permutable et de l’identique, de la multiplicité et de l’unité. Tout ce qui a été une raison éternelle ou idée d’une manifestation individuelle ne peut cesser d’être tel ; la teneur de l’éternité ne peut être changée. C’est pourquoi, comme le déclare la Bhagavad-Gītā, “Il n’est pas d’autrefois où je ne fus pas et il n’est pas d’autrefois où tu ne fus pas”.
La relation d’identité du “Cela” et du “tu” dans le logos “Cela tu es” est énoncée par le Védānta avec des désignations telles que “Rayon du Soleil” (impliquant une filiation) ou avec la formule bhédābhéda (dont le sens littéral est “distinction sans différence”). Cette relation est encore exprimée par la comparaison des amants si étroitement enlacés qu’il n’y a plus de conscience “d’un dedans ou d’un dehors” et par l’équation vishnouite correspondante : “Chacun est les deux”. On la repère également dans la conception propre à Platon de l’unification de l’homme intérieur et de l’homme extérieur ; dans la doctrine chrétienne sur la qualité de membre du Corps mystique du Christ ; dans saint Paul disant “Quiconque est uni au Seigneur est un seul esprit” ; et dans l’admirable formule d’Eckhart “fondus sans être confondus”.
Je me suis efforcé de rendre clair que la prétendue “philosophie” de Shankara n’est pas une “recherche” mais une “explicitation” ; que la Vérité ultime n’est pas pour le védantiste, et pour le traditionaliste, quelque chose qui reste à découvrir mais qui doit être compris par tout un chacun, lequel fera le travail pour lui-même. Dans cette vue j’ai essayé d’expliquer tout juste ce que Shankara comprenait exactement dans des textes tels que l’Atharva Véda (X-844) disant : “Sans désir, recueilli, immortel, existant par soi-même, satisfait avec la pure essence, ne manquant de rien, celui qui connaît cet Esprit stable, sans âge et toujours jeune, à coup sûr se connaît soi-même et ne redoute pas la mort”.
► Ananda Coomaraswamy, 1933.
[traduit et annoté par René Allar, publié dans Être n°1 à 4/1976. « The Vedanta and Western Tradition », conférence faite en 1933 au Radcliffe College de Cambridge (Massachusetts) et édité dans The American Scholar n°2/1939. Résumé. Texte repris dans le recueil The Perception of Vedas, 2000]
Notes
1. À Kaladi, petite localité du Kerala, sur la rivière Churna, à une dizaine de kilomètres de la ville d’Alwaye.
2. Il s’agit du célèbre traité versifié connu sous le nom de Māndūkya-Kārikā car il se présente comme une glose (très libre) de la Māndūkya-Upanishad. C’est un des sommets sinon le sommet de la littérature advaïtique.
3. Comme autant de limitations de la réalité absolue.
4. Il s’agit de la formule shankarienne dont l’auteur parlera plus loin dans sa conférence : “C’est le Seigneur seul qui transmigre” (et non l’âme individuelle comme le veut l’interprétation réincarnationiste).
5. L’auteur passe sous silence les Aranyakas parce que ces textes qui devaient être médités ou avaient été élaborés dans la forêt (aranya) sont une portion détachée des Brāhmanas comme c’est également le cas de plusieurs Upanishads qui en sont la conclusion, notamment la Brihad Āranyaka Upanishad et la Taittirīya Upanishad.
6. Terme appartenant au lexique scolastique et désignant une durée indéfinie, du latin aevum.
7. Condamné à mort par Théodoric dont il était l’ami et le ministre, Boèce (480-524) écrivit dans sa prison, avant de périr dans les tortures, la Consolation de la Philosophie qui fut un des livres essentiels de l’enseignement scolastique.
8. Allusion à la racine an, respirer, à laquelle certains grammairiens rattachent ātman ou ātmā (la première forme est le thème de la déclinaison et la seconde le nominatif). Le Nirukta, le plus ancien traité sanscrit de sémantique, fait dériver ātman de la racine at qui a le double sens d’aller sans cesse et d’obtenir : “ātmā vient de ar, parce que tout est parcouru et obtenu par l’ātmā en raison de son omniprésence, sarva-gatatvāt, litt. par le fait d’aller partout”
9. On sait que pour les Orphiques comme pour Hésiode (la Théogonie) Érōs était le dieu créateur.
10. Au sens donné par Kant à ce terme d’après le grec aísthèsis, sensation.
11. Expression empruntée à l’ésotérisme islamique pour désigner un soufi qui a réalisé la totalisation de l’être. Cf. R. Guénon, Le Symbolisme de la Croix, chap. 2.
12. Ce nombre de 21 est une allusion à la cosmogonie védique qui, avec les mondes “au-delà du Soleil”, envisage au total 33 sections de l’univers manifesté et non-manifesté. Dans la Chāndogya Upanishad le Soleil est appelé le Vingt-et-unième. Pour plus de détails, cf. A. Daniélou, Le Polythéisme hindou, pp. 112-113.
13. En anglais nothingmorist pour rendre le sanskrit nāstika qui désigne tout négateur d’un au-delà : na asti, “il n’y a pas” (un autre monde).
14. Au sens scolastique de persona : nous sommes un individu en raison de notre corps et une personne en raison de notre esprit “qui nous rend semblables à Dieu”.
15. En raison de leurs allusions à la transmigration les Écritures brahmaniques se prêtent plus facilement que les textes chrétiens à une interprétation réincarnationniste. On lit par ex. dans la Prashna Upanishad que “celui qui a suivi la voie rituélique des pères, après un séjour dans le monde de la Lune, revient (āvartaté) dans le monde humain (mānavaloka)”. On doit également reconnaître que les commentateurs traditionnels ne précisent jamais qu’on a affaire à un langage symbolique pas plus qu’ils n’écartent en termes explicites l’interprétation littérale, c’est-à-dire réincarnationniste. Ils semblent ménager une donnée volontairement ambiguë que son aspect concret rend plus efficace comme fondement de l’éthique et plus facile à comprendre par le commun des mortels en présence d’un mystère qui, comme le dit la Katha Upanishad, est un objet de controverse même entre les dieux, un problème supra-rationnel dont seul un guru compétent est capable de transmettre la solution “inaccessible à la seule logique” (1-2-9).
16. Pour les philosophes modernes la personne est caractérisée essentiellement par la conscience ; c’est un être “qui sait qu’il sait”, définition qui rétrécit celle qu’ont formulée les docteurs scolastiques en explicitant les notions de subsistance et de plénitude. Selon saint Thomas d’Aquin “la personne est un tout existant séparément ; c’est ce qui existe et agit tandis que la nature est ce par quoi quelque chose est ainsi et ainsi, l’intelligence ce par quoi ce tout comprend (intelligit) et l’existence ce par quoi ce tout subsiste”. Pour rendre cette définition adéquate au regard du Soi non duel, il faut retrancher toute distinction réelle entre l’existence ou être (sat) et l’intelligence ou conscience (chit). Quant à la notion de plénitude elle correspond à celle de la félicité (ānanda) et transparaît dans l’étymologie de Purusha et c’est donc à bon escient que, dans ses traductions, A.K. Coomaraswamy rend ce terme par “Personne”.
17. Dans son Traité de Dieu (10, 5 & 6), saint Thomas affirme que l’éviternité, en latin aevum, ne se laisse confondre ni avec le temps ni avec l’éternité : l’aevum en diffère comme étant quelque chose d’intermédiaire entre les deux. Le temps a essentiellement l’avant et l’après, l’éternité ne peut les avoir tandis que l’aevum, durée propre aux anges et aux (principes représentés par les) corps célestes, n’a pas “en soi” l’avant et l’après, mais ceux-ci peuvent s’adjoindre à lui. En d’autres termes, l’aevum suppose l’immutabilité mais reste compatible avec des changements, avec une succession “accidentelle” d’avant et après. Le Docteur angélique revient longuement sur cette question dans son Traité des Anges. Rappelons à ce propos que René Guénon déclare que tout ce qui est dit en théologie sur la nature angélique correspond métaphysiquement aux “états supérieurs de l’être”, autrement dit aux dévas de l’hindouisme, terme que Coomaraswamy précisément traduit par “the angels”.
18. Il n’est peut-être pas inopportun de souligner que cette triple distinction s’autorise de la Bible. On lit en effet dans le Livre de Daniel : “Bénissez le Seigneur, esprits et âmes des justes” (III-82), dans les Épîtres de saint Paul : “. que tout votre esprit, votre âme et votre corps se conservent sans reproche” (I, Thess. V-23) et “Le premier homme Adam a été fait âme vivante et le dernier Adam esprit vivifiant” (I, Cor. XV, 45).
19. Il y a peut-être ici un jeu de mots avec part qui signifie en anglais partie et rôle d’acteur.
20. La voie du rejet (remotio) des attributs positifs de Dieu, équivalent du néti néti, “pas ainsi, pas ainsi”, védantique.
21. “Qu’est-ce donc que l’homme doit chercher à savoir en cette vie ? Qu’il se connaisse lui-même”. “Si tu ignores qui tu es, sors d’ici”.
***
⬨ Pour prolonger :
« The Problem of defining Vedanta » (C. Bebenek, 2019)
« Note sur Plotin et la pensée indienne », O. Lacombe, in : Indianité, Belles-Lettres, 1979
« Le rêve indien de Plotin et Porphyre », J. Lacrosse, Revue de philosophie ancienne n°1/2001
« A comparative study of Plotinus & Advaita Philosophy », B. Mehta, in : Int. Journ. of the Platonic Tradition, 2017
« De la commensurabilité des discours mystiques en Orient et en Occident : une comparaison entre Plotin et Çankara », J. Lacrosse, in : Mystique : la passion de l'Un, de l'Antiquité à nos jours, Univ. de Bruxelles, 2005
Advaita and Neoplatonism : A critical study in comparative philosophy, Johan F. Staal, Univ. of Madras, 1961 [pdf]

• Présentation du texte : — « Dans le D. S. Krishnaswami Aiyangar Commemoration Volume (Madras, 1936), M. Ananda Coomaraswamy a donné une étude intitulée Vedic Monotheism, dans laquelle il montre que, dès l’origine, et non pas plus ou moins tardivement comme le prétendent d’ordinaire les modernes, les multiples noms divins n’ont jamais désigné réellement autre chose que des aspects ou des attributs divers du Principe premier et unique. C’est d’ailleurs pourquoi il a pu être dit justement que les Dêvas sont “participants” (bhakta) de l’essence divine ; et que le sens originel du mot bhakti est effectivement celui de “participation”, quels que soient les autres sens plus ou moins dérivés qu’il ait pu prendre par la suite » (R. Guénon, 1936).
***
Un seul Feu est allumé sous de multiples formes,
un seul Soleil est présent pour tous sans exception,
une seule Aube illumine tout cela :
ce qui est seulement Un devient tout cela.Rig Véda VIII, 58, 2
Habituellement, l’érudition universitaire n’admet dans la métaphysique indienne que le développement graduel de la notion d’un principe unique, dont les dieux multiples (devāh, vishve devāh, etc) sont en quelque sorte les pouvoirs, les aspects opératifs, ou les attributs personnifiés. Mais comme le dit Yāska :
« C’est à cause de Sa grande divisibilité (mahā-bhāgyāt) qu’ils Lui appliquent de nombreux noms, l’un après l’autre. (…) Les autres dieux (devāh) apparaissent (bhavanti) comme subordonnés (pratyangāni) à l’Esprit unique (ekasyātmanah) (…) leur devenir est une naissance l’un de l’autre, ils sont d’une seule et même nature ; ils trouvent leur origine dans la fonction (karma) (1) ; l’Esprit est leur source. (…) L’Esprit (ātman) est la totalité de ce qu’est un dieu » (Nirukta VII, 4).
De la même façon, BD I, 70-74 :
« À cause de l’immensité de l’Esprit (mahātmyāt), on donne une diversité de noms (vidhiyate) (2) (…) selon la distribution de leurs sphères (sthânavibhagéna). C’est dans la mesure où ils sont des “différentiations”, des “présences” (vibhutih) (3) que les noms sont innombrables. Mais les poètes (kavayah), dans leurs incantations (mantrêshu), disent que les divinités (dêvatás) ont une source commune ; elles sont appelées de différents noms selon les sphères dans lesquelles elles sont établies (4). Certains disent qu’elles y participent (tad bhaktah), et que telle est leur dérivation ; mais en ce qui concerne la dite Trinité de ceux qui dirigent le monde, il est bien entendu que la totalité de leur participation (bhaktih) est dans l’Esprit (ātman) (5) ».
Les passages précédents illustrent la méthode théologique normale employée dans toute discussion de divinis nominibus [concernant les noms divins], quand la reconnaissance des opérations diverses d’un seul principe donne lieu à l’apparence superficielle d’un polythéisme. Dans le christianisme, par exemple, « nous ne disons pas le Dieu unique, car la déité est commune à plusieurs » (ST I, 31, 2c) ; et encore, « Créer appartient à Dieu selon Son être propre, c’est-à-dire Son essence, qui est commune aux trois Personnes. Par conséquent, créer n’est pas propre à l’une des Personnes, mais commun à toute la Trinité » (ST I, 45, 6c) ; et il est bien entendu que « bien que les noms attribués à Dieu signifient une seule réalité, parce qu’ils la signifient sous de multiples et différents aspects, ces noms ne sont pas synonymes. (…) Les multiples aspects de ces noms ne sont ni vides ni vains, car une réalité une et simple, qu’ils représentent d’une manière imparfaite et diverse, leur correspond à tous » (ST I, 13a ad 2) (6). Cf. Sāyana sur SB, 16, 1, 20 : Prajapati n’est pas explicite parce qu’Il est essentiellement tous les dieux et que donc on ne peut dire de Lui qu’« il est ceci ou cela » (ayam asaviti) mais seulement qu’“Il est”. Et aussi Hermès Trismégiste :
« Dirons-nous qu’il est juste que le nom de “Dieu” (cós, devā) doive Lui être attribué, ou celui de Producteur (nomis, kavya), ou celui de Père (natip, pitri, Prajapati) ? Non, ces trois noms sont tous les siens ; Il est justement nommé “Dieu” en raison de Son pouvoir, “Producteur” en raison du travail qu’Il accomplit, et “Père” en raison de Sa bonté » Lib., XIV, 4.
Dans le même sens, Plotin :
« Cette vie des étoiles animées est une seule chose identique, puisqu’elles sont une dans l’Âme universelle, de sorte que leur mouvement spatial lui-même repose sur l’identité et se résout dans un mouvement qui n’est pas spatial mais vital » (Ennéades IV, 4, 8).
Il est bien connu que ces conceptions de l’identité du Premier Principe avec toutes ses puissances sont courantes dans les Brahmanas et dans l’Atharva Véda. On peut citer par ex. SB, X, 5, 2, 16 : « Comme ils disent à ce sujet : “la Mort est-elle une ou multiple ?”, on pourrait répondre : “une et multiple”. Car, dans la mesure où Il est Cela (la Personne dans le Soleil). Il est unique ; et dans la mesure où Il est distribué de façon multiple (bahudha vyāvishtih) dans Ses enfants, Il est multiple », à lire conjointement avec le verset 20 : « Tel Il est approché, tel Il devient » (yathopásate tad eva bhavati) (7) ; et AV, VIII, 9, 26 : « Un Taureau, un Prophète, une Maison, une seule Ordonnance, un simple Yaksha * dans Son domaine, une Saison qui n’est jamais vidée » ; et AV I, 12, 1, où Agni est décrit comme « Une énergie dont la procession est triple » (ekam ojas tredhâ vicakrame).
* : [yaksha : ensemble de divinités d’origine non-aryenne, assimilées dans le brahmanisme aux génies ou esprits subtils, participant de la nature des dieux (deva), mais aussi associées aux démons (rākshasa)… voir AKC, Yakshas, Delhi, 1980]
On oublie le plus souvent que le même point de vue est affirmé si explicitement et de façon répétée dans le Rig Véda qu’il ne laisse place à aucun malentendu. Une discussion complète de la formulation védique du problème de l’un et du multiple demanderait une étude étendue de l’exemplarisme védique [cf. « Vedic Exemplarism », 1936], mais nous pouvons attirer l’attention sur l’expression vishvam êkam (multiplicité intégrale) dans RV III, 54, 8 [l’édition anglaise porte ici : integral multiplicity (multiplicité intégrale) pour vishvam ēkam. Plus loin (infra), vishve, appliqué aux Dieux, est également rendu par several (plusieurs)]. Tout ce que nous proposons maintenant est de rassembler quelques-uns des plus remarquables textes védiques dans lesquels l’identité de l’un et du multiple est catégoriquement affirmée ; en ajoutant que, même si aucune de ces formulations explicites n’avait été disponible, la loi qu’elles expriment aurait pu, indépendamment, être déduite d’une analyse des fonctions attribuées aux divers pouvoirs, car bien que ces fonctions soient caractéristiques de divinités particulières, elles ne sont jamais entièrement spécifiques à l’une d’entre elles (8).
Des passages familiers, souvent rejetés comme “tardifs”, comprennent RV I, 164, 46 : « Les prêtres se réfèrent de bien des façons différentes (bahudha vadanti) à Cela qui est seulement un, ils L’appellent Agni, Yama. Matarishván : ils L’appellent Indra, Mitra, Varuna, Agni, qui est l’aigle céleste (suparna) Garutmân » ; RV X, 114, 5 : « Les Poètes extatiques (vipráh kavayah) Le conçoivent de multiples façons (bahidhá kalpayanti), l’aigle qui est un » ; et X, 90, 11, où, après que les premiers sacrificiants aient divisé (vyadadhuh) la Personne, la question est posée sur le mode brahmodaya [transmission de la doctrine ; enseignement du Veda] : « En combien de parties le conçoivent-ils ? » (katidha vyakalpayan). C’est précisément cette finalité (artham) d’être fait pour habiter dans de multiples endroits (bahudha nivishta) que redoute Agni, alors qu’Il s’attarde dans l’obscurité (tamasi ksheshi, X, 51, 4-5), bien qu’en fait, même quand il avance, Il reste encore dedans (anu agram carati ksheti budhnah, III, 55, 7 = krishne budhne, IV, 17, 14 = vrishabhasya nile, IV, 1, 12, etc). Comme le dit Eckhart : « le Fils reste à l’intérieur en tant qu’essence et s’avance en tant que personne … la nature divine intervient dans la relation d’altérité, autre mais pas un autre, car cette distinction est rationnelle, pas réelle ». « Aux Poètes Il se manifeste en tant que le Soleil des hommes (avir … abhavat sûryo nrin) » (RV I, 146, 4) 10. Cf. Plotin, V, 8, 9 : « Lui qui est l’unique Dieu … comment nommer un lieu qu’Il n’atteint pas ? ».
Tout aussi explicites, cependant, sont les énoncés dispersés dans les autres livres. En particulier, on dit souvent de Lui qu’ll a deux formes différentes, selon que Son être est dans le Jour ou la Nuit, et cela « comme Il veut » (yatha vasham) (RV III, 48, 4 ; VII, 101, 3 ; cf. X, 168, 4 et AV, VI 72, 1). Quand l’énoncé suivant est employé : « Maintenant Il devient stérile (starir u tvad bhavati), maintenant il engendre (sûte u) » VII, 101, 3, cette dernière expression, comme Sa désignation en tant que súh dans I 146, 5, revient à dire savita bhavati : « Il devient Savitri ». Cf. III, 55, 19 et X, 10, 5, où Tvashtri et Savitri sont identifiés par apposition. Dans RV III, 20, 3 et VIII, 93, 17, Agni et Indra sont appelés “polynominaux” (bhúrini-nama, puru-náma) [litt. : qui a de nombreux noms] et dans II, 1, Agni est appelé par les noms de presque tous les pouvoirs, et il y a d’innombrables passages dans lesquels Indra est une désignation du Soleil. Dans VIII, 11, 8, Agni est « visible dans de nombreux endroits différents, ou aspects » (cf. I, 79, 5 et VI, 10, 2, Agni purvanîkah). Bien que son apparence soit la même dans de multiples lieux (purutra hi sadrinn asi, VIII, 11, 8 ; I 94, 7), Son devenir est divers (purutra … abhavat, I, 146, 5), et Il reçoit de nombreux noms, car « Tel Il se manifeste, tel il est appelé » (yâdrig éva dadrishé tâdrig ucyate) (V, 44, 6) 11, dont SB X, 5, 2, 20, cité plus haut, est à peine plus qu’une paraphrase. RV I, 146, 5, cité aussi plus haut, est fondé sur d’innombrables textes dispersés dans le Rig Véda, par ex., III, 5, 4 et 9, où Agni est identifié à Mitra, Varuna et Mâtarishvân ; dans IV, 42, 3, Varuna s’identifie Lui-même à Indra et Tvashtri ; pareillement dans V, 3, 1-2, Agni est identifié à Mitra, Varuna et Indra. Et il ne s’agit pas ici de simple suggestion ; les points de vue particuliers selon lesquels les différents noms sont appropriés sont soigneusement établis.
(De la même façon, si Agni en tant que Soleil est le “visage” ou le “point” (aniká) des dieux (RV I, 115, 1 ; VII, 88, 2, etc), et en même temps logiquement « pourvu de multiples visages (púrvanîkah) », « cela ne pose rien de réel dans le Dieu éternel, mais seulement quelque chose selon notre façon de penser » (ST III, 35, 5c), car « Les hommes, dans leur culte sacrificiel, ont posé sur Toi, Agni, les nombreux visages (bhürini hi tve dadhire anikågne devasya yajnavo jandsah) » (RV III, 19, 4). Les “visages” ou “points” de l’Agni solaire sont en fait ses “rayons”, ceux-là même par lesquels le Soleil spirituel soutient l’être de toutes choses, mais qui cachent la Porte solaire (JUB 13, 6), celui qui voudrait y entrer, priant, par conséquent, que les rayons puissent être dispersés (Isha Up. 15, etc). Autrement dit, Agni est l’Arbre de Vie (vanaspati, passim), « les "autres Feux" sont tes branches » (RV 1 59, 1) : « tous les autres Agni dérivent de toi. Ô Agni » ; « toutes ces déités sont des formes d’Agni » (AB III 4) 12.}
Dans de nombreux cas le verbe bhū (devenir), tel qu’on le rencontre dans les textes du brāhmana et du Nirukta déjà cités, est employé dans le Rig Véda pour indiquer dans le même sens le passage d’un nom, et de la fonction associée, à un autre. Par exemple, RV III, 5, 4 : « Agni devient (bhavati) Mitra quand il est enflammé, Mitra le prêtre ; et Varuna devient Jātavédas » ; cf. IV, 42, 3 : « Moi, Varuna, je suis Indra », et V, 3, 1-2 : « Toi, Agni, tu es Varuna à la naissance (bhuvo varuno yad ritāya veshi) (X, 8, 5), tu es devenu (bhavasi) Mitra en étant enflammé. En toi, Ô fils de la Force, demeurent les Dieux Universels ; tu es Indra pour l’adorateur mortel. Par rapport aux vierges tu deviens Aryaman, et en tant que Svadhavan tu portes un nom secret » (nāma … guhyam), probablement comme Trita de I, 163, 3 : « Trita tu es par l’opération intérieure (asi … tritoguhyena vratêna) ». Et encore RV III, 29, 11 : « Comme Germe de Titan il est Tanûnapāt l’élevé (13), quand il est né au loin il est Narasānsa, quand il est formé dans la Mère il devient Mātarishvān, le vent de l’Esprit dans sa course (tānunapāt ucyate garbha āsuro narasānso bhavati yad viyāyate matarishvā yad amimita mātari vātasya sargo [garbha] abhavat sarimani) » (cf. III, 5, 9). Cet esprit est en fait la propre Essence de Varuna (ātma te vāta, VII, 87, 2), et le souffle de Vâc (X, 125, 8), un vent dont la forme n’est jamais vue, mais qui est l’Essence (ātmā) de tous les dieux, se mouvant tandis qu’on l’écoute (X, 168, 4).
Aux précédents passages, où on a considéré les effets diversifiés de ce qui est en réalité une unique opération, on peut ajouter RV VI 47, 18 : « Il est la contrepartie de chaque forme, c’est cette forme qu’Il prend que nous devons considérer ; Indra, en vertu de Ses pouvoirs magiques agit sous de multiples formes (rupam rupam pratirupam babhuva tad asya rupam cakshanaya indro mâyâbhih pururupa Iyate) », un passage correspondant de près à la « forme unique qui est celle de nombreuses choses différentes » d’Eckhart qui résume la doctrine scolastique de l’exemplarisme. Et alors que dans X, 5, 1, Agni seul est ritupati, en RV VI, 9, 5 : « Les différents dieux pourvus d’un esprit et d’une volonté commune montent infaillibles dans l’unique saison » (ekam ritum, cf. êka ritu dans AV, VIII 9, 26, cité plus haut), correspondant de près à ST III 32, 1 ad 3, où ce qui est fait par l’une des Personnes de la Trinité est dit être fait par toutes, « parce qu’il y a une seule nature et une seule volonté ».
SB VIII, 7, 3, 10 : « Ce Soleil là-bas assemble ces mondes sur Son esprit comme sur un fil », BG VII, 7 : « Tout ceci est enfilé sur moi » et X, 20 : « Je suis l’Esprit qui se tient dans le cœur de tous les êtres », reprennent simplement la pensée de RV I, 115, 1 : « Le Soleil est l’Esprit (ātman) de tout ce qui se meut ou reste au repos ». En X, 121, 2, Hiranyagarbha (Agni, Prajapati) est appelé le « donneur d’Esprit » (ātmada), et c’est dans ce sens qu’Agni, en I, 149, 3, est « d’une centuple essence » (shatātmā) (cf. bhuri nāma vandamāno dadhāti, V, 3, 10). En X, 51, 7 Agni est invoqué pour donner aux dieux leur “part” (bhagam) ; c’est sa fonction particulière en tant que prêtre.
Il est ainsi suffisamment clair que le Nirukta et le Brihah Dévatá sont pleinement justifiés à dire que les dieux participent (bhakta) de l’essence ou inspir divins ; même la phraséologie des mantras védiques est conservée par les auteurs. La référence à la “participation” nous conduit à l’examen du Bhaga védique, ultérieurement [appelé] Bhagavan. Bhaga n’est pas un nom personnel, mais plutôt une désignation générale du pouvoir actif dans l’un de ses aspects, en tant que “Donneur généreux” ou “Répartiteur”, qui fait participer ses bhaktas à ses richesses. Ces richesses ne peuvent être que les aspects de son Essence, puisque assuré. ment nous ne pouvons penser que la déité puisse posséder quelque chose de plus que ce qu’Elle est elle-même ; « Se répartissant lui-même. Il remplit entièrement ces mondes (armanam vibhajya purayati imán lokán) » Cette dernière citation est tirée des Upanishad (MU VI 26) mais le concept est védique. En fait, on se réfère à Bhaga par apposition comme le “Distributeur” (vibhaktri, RV, V 46, 6) ; et bhaga est “partage” ou “distribution”, comme dans II 17, 7, adressé à Indra : « Je te prie, Bhaga (…) distribue, apporte, donne-moi cette part (bhagam) par laquelle le corps est doué de pouvoir (mámah) », où bhagam = amritasya bhagam, dans I, 164, 21 ; voir aussi VIII, 99, 3 : « Dépendant de lui, comme du Soleil, les Multiples [dieux] (vishve, sc. devah) ont participé à ce qui appartient à Indra » ; I, 68, 2, où dans une louange adressée à Agni, les Multiples [dieux] (vishve, sc. devah) sont dits « participer à ta déité (bhajanta dêvatvam) » ; VII 81, 2 comprend la prière à l’aube : « puissions-nous être associés par participation » (sam bhaktêna gamemahi). D’après ces passages, il est suffisamment clair que bhaga et vibhaktri sont le distributeur ou donneur, qui fait don de lui-même ou de sa substance ; samb haja, le participant qui prend part au don ; bhaga, bhaksha, et bhakta la part qui est donnée ou reçue. Tandis que ce sont là des expressions védiques, bhakti, l’acte de distribution, ou le fait de prendre ce qui est donné, et bhakta en tant que synonyme de vibhaktri, le donneur, interviennent seulement plus tard.
Le délicat problème de “l’origine du mouvement bhakti” n’aurait peut-être, jamais eu besoin d’être posé si des interprétations telles que celles-ci avaient été retenues dans la traduction de textes postérieurs, spécialement celui de la Bhagavad Gîtâ. Bhakta dans le Rig Veda peut être soit la part de “trésor” obtenue par le sacrificiant de la part de la déité (IV 1, 10, ratnam devabhaktam, etc), soit, inversement, celle qui est donnée ou fixée aux déités par le sacrificiant (1 91, 1, pitaro... dêveshu ratnam abhajanta dhirah), {et typiquement par Agni en tant que prêtre sacrificiel (hotri) : « Transmets gracieusement aux dieux leur part (bhagam) de l’oblation » (X 51, 7) : Ite missa est !}. Dans ce dernier cas le sacrificiant ou le prêtre sacrificiel est le vibhaktri, et la substitution de bhakta au vibhaktri védique n’introduit aucune conception nouvelle.
Bhakti implique la dévotion, parce que tout don présuppose l’amour : il ne s’ensuit pas que bhakti doive être traduit par “amour”. Il est vrai que le bhakti-marga est aussi le prêma-marga, la passive “Voie de l’Amour”, en tant qu’elle se distingue du jnâna-marga, l’active “Voie de la Connaissance” ; mais que les expressions bhakti-mârga et préma-mârga se réfèrent à la même chose ne les rend pas pour autant synonymes (des expressions sont “synonymes” seulement quand elles renvoient à la même chose sous le même rapport). On peut difficilement nier que les pitarah [ancêtres paternels] qui sont, en RV I, 91, 1, abhijanta [de noble naissance], étaient bhaktas dans le sens ultérieur, ou que leur voie fut un bhakti-mârga. Nous devrions rendre bhakti-marga par “Voie de Dédicace” ou “Voie de Dévotion” plutôt que par “Voie d’Amour”. Il est vrai que, dans le même sens, “participation” implique “amour”, et vice versa, puisqu’un amour qui ne participe pas de l’aimé n’est aucunement “amour”, mais plutôt “désir”. Amour et participation relèvent néanmoins de conceptions logiquement différenciées, chacune jouant son propre rôle dans la définition de l’acte dévotionnel ; et quand les deux expressions sont confondues dans une traduction équivoque, non seulement ces nuances de sens sont perdues, mais en même temps l’évidence de la continuité de la pensée védique et de ses formes ultérieures est occultée, et un faux problème est soulevé.
Ainsi nous tenons à exprimer notre complet accord avec les vues de Franklin Edgerton, qui conclut que « tout ce qui est contenu au moins dans les plus anciennes Upanishad, sans presque aucune exception, n’est pas une nouveauté propre à ces Upanishad, mais peut être trouvé exposé, ou du moins très clairement esquissé, dans les plus anciens textes védiques » (14), et celles de Maurice Bloomfield, qui soutient « que mantra et brâhmana sont pour une moindre part des distinctions chronologiques ; qu’ils représentent deux modes d’activité littéraire, et deux modes d’expression littéraire, qui sont largement contemporains... Les deux formes existaient ensemble, pour autant que nous sachions, depuis les époques les plus anciennes ; seule la rédaction des recueils de mantra paraît, dans l’ensemble, avoir précédé celle des brâhmanas. (…) Les hymnes du Rig Véda, comme ceux des trois autres Védas, furent liturgiques dès le commencement. Ce qui signifie qu’ils forment seulement un fragment (…) les textes tardifs et les commentaires peuvent contenir l’explication correcte » (15) : Bloomfield, également, en se référant aux plus anciennes parties du Rig Véda, les appellent « le dernier précipité, avec derrière lui un long passé enchevêtré d’activité littéraire d’une étendue immense et indéfinie » (16).
Nous sommes d’accord :
• avec Alfred Jeremias quand il dit dans l’avant-propos de son Altorientalische Geisteskultur (1929) : « Die Menschenheitsbildung ist ein einheitliches Ganzes, und in den verschiedenen Kulturen findet man die Dialekte der einen Geistessprache » [La formation de l’humanité est un tout unitaire et dans les différentes civilisations on retrouve les dialectes d’une seule langue de l’esprit],
• avec Carl Anders Scharbau (Die Idee der Schöpfung in der vedischen Literatur, 1932) : « Die Tiefe und Grösse der theologischen Erkenntnis des Rigvedas keineswegs hinter der des Vedanta zurücksteht » [La profondeur et la grandeur de la connaissance théologique du Veda ne sont nullement inférieures à celles du Vedanta] (17) ;
• et finalement avec Sâyana, qu’aucune des références védiques n’est historique.
C’est précisément parce que les incantations védiques sont liturgiques qu’il est déraisonnable d’attendre d’elles l’exposé systématique d’une philosophie qu’elles tiendraient pour acquise ; si nous considérions les mantras en eux-mêmes, cela reviendrait à déduire la philosophie scolastique du livret de la Messe. Non que cela soit impossible, mais nous pourrions être accusés de lire dans la Messe des significations qui n’auraient pu être présentes à la mentalité prévalant dans les “Âges Sombres”, et de faire preuve de complaisance, comme le dit le professeur Keith (qui ne peut lui-même être accusé d’une telle faiblesse), envers « notre désir naturel de trouver une raison prévalant dans un âge barbare ». En fait, cependant, les mantras et les hymnes latins sont de la même façon si finement ouvrés, leur symbolisme est employé avec une telle exactitude mathématique (Émile Mâle parle du symbolisme chrétien comme d’un “calcul”), que nous ne pouvons supposer que leurs auteurs ne comprenaient pas leurs propres mots ; c’est nous qui ne comprenons pas, si nous persistons à lire l’algèbre comme si c’était de l’arithmétique. Tout ce que nous pouvons apprendre de l’histoire littéraire est que les doctrines qui sont tenues pour acquises dans les mantras ne furent, peut-être, publiées qu’après l’intervention d’un changement linguistique relativement important ; nous pouvons trouver quelques mots nouveaux, mais nous ne rencontrons pas de nouvelles idées. C’est notre propre faute si nous ne pouvons pas voir que Mitrāvarunau [duel sanskrit de mitrāvaruna = mitra + varuna], dont le second est « le frère immortel du mortel » qui est le premier, ne sont rien d’autre que l’apara et le para Brahman auxquels les Upanishads se réfèrent comme respectivement mortel et immortel.
Exactement comme il a dû exister, en rapport avec les liturgies babyloniennes, une « littérature de sagesse (…) non écrite et destinée à être récitée dans les temples » (18), et qu’on doit supposer qu’il exista là le concept d’un « Dieu unique (…) [dont] les aspects divers n’étaient pas encore considérés comme des divinités séparées dans le panthéon suméro-accadien » (19), il en est de même dans le cas des liturgies védiques, où l’occurrence des concepts d’un « Unique, qui est également inspiré, expiré » (ānít avātam) (X 129, 2), et d’Agni en tant qu’« être et non-être en un » (sadasat) (X 5, 7), n’a rien d’étonnant. Nous ne voyons alors dans les Brahmanas, les Upanishads, la Bhagavad Gitā, et même dans le Bouddhisme, rien d’autre qu’une recension et une publication ultimes de ce qui a toujours été enseigné, que ce soit à des initiés ou dans ces cercles dont l’existence est suggérée par la forme brahmôdaya de nombreux hymnes, et par des Brahmanes tels que celui auquel se réfère RV X, 71, 11 comme expliquant la tradition de l’origine (vadati jāta-vidyām), et dont nous pouvons supposer avoir été, comme Agni lui-même « celui qui comprend la génération de toutes choses » (vishvā veda janimā) (VI, 15, 13 ; cf. IV, 27, 1).
► AK Coomaraswamy, « Vedic “Monotheism” », 1936.
[Traduction : Dominique Tournepiche, in : Vers la Tradition n°117, 2009. On lui doit aussi deux traductions : celle du maître soufi Ahmad al-Alawi (La voie du taçawwuf, 2006) et de l'érudit soufi Abdul Baqi Miftah (Les clés ontologiques et coraniques du livre des Fuçûç al-hikam d'Ibn Arabi, 2011)]
[Cette étude fut initialement publiée dans le Dr.s. Krishnaswami Aiyangar Commemoration Volume (Madras, 1936), et revue et corrigée pour le Journal of Indian History, XV (1936). La seconde édition, comprenant les addenda et les notes supplémentaires de l’auteur est celle publiée à partir de l’édition des Selected papers, vol. 2, 1977].
Abréviations des textes cités :
AB : Aitareya Brahmana / AV : Atharva Veda
BD : Brihad Devatá de Shaunaka / BG : Bhagavad Gità / BU : Brhadaranyaka Upanishad 3 : Jataka (Histoires des anciennes naissances du Bouddha)
JAOS : Journal of the American Oriental Society / JUB : Jaiminiya Upanishad Brahmana
MU : Mairi Upanishad / Mund. Up : Mundaka Upanishad
PB : Pancavimsha Brahmana
RV : Rig Veda
SB : Shatapatha Brahmana / ST : Summa Theologica[Les annotations entre crochets sont du traducteur].
Notes
1. C’est, en fait, Vishvakarma, Celui qui fait Toutes Choses, qui donne leurs “noms”. c’est-à-dire leur être personnel, aux dieux, et qui est par conséquent appelé devanām namadhah, X, 82, 3. (Les fonctions sont « simplement les noms des actes de Brahma », BU I, 4, 7 ; c’est de l’Esprit que proviennent toutes les activités », ibid. I, 6, 3 ; « toute action découle de Brahma » BG III, 5 ; cf. Meister Eckhart, vol. II, Evans ed., 175).
2. Presque littéralement identique à Jan van Ruysbroeck :
« À cause de sa noblesse et de sa sublimité incompréhensibles, que nous ne pouvons correctement nommer ni exprimer complètement, nous Lui donnons tous ces noms », Adornment of the Spiritual Marriage, XXV.
« Car je considère impossible que Celui qui fait cet univers dans toute sa grandeur, le Père ou le Maître de toutes choses, puisse être appelé d’un seul nom ; je tiens qu’Il est sans nom, ou plutôt, que tous les noms sont Ses noms. Car Il est dans son unité toutes les choses ; de sorte qu’il faut que nous appelions toutes les choses par son nom, ou que nous l’appelions par le nom de toutes les choses », Hermès, Asclepius III, 20a.
« Lui seul possède l’esprit du Christ, celui qui a changé ses noms et ses formes depuis le commencement du monde et est réapparu ainsi encore et encore dans le monde » (Clément, Clementine Homilies III, 20, cf. BG IV, 8, sambhavami yuge yuge [Je me manifeste d’âge en âge]).
« Chaque prince angélique est une propriété de la voix de Dieu porte le grand nom de "Dieu" » (Jacob Boehme, Signatura rerum, XVI 5). Cf. JUB III 1, où le Vent de l’Esprit (vāyu) est appelé « l’unique et entière divinité (eka … krisni devata) », le reste constitue des “demi-divinités”.
3. « Le Vent est omniprésent (vayur ákásham anuvibhavati) » JUB IV 12, 10 ; et ainsi, comme le dit Krishna, « Il n’y a pas de fin à mes présences divines (nánto ’sti mama div nám vibhutinám) » BG X 40, C’est à ces “présences” ou “pouvoirs” que les noms multiples sont donnés}.
4. Cf. PB XX 15, 2-2 où les sphères d’action d’Agni, Vayu et Aditya s sont appelées leurs “lots” ou “parts” (bhaktih).
5. Une ontologie de ce genre ne doit pas être proprement appelée panthéiste ou moniste. Ce serait légitime seulement si, quand l’essence a été analysée sous ses multiples aspects, il ne restait rien ; au contraire, tous les textes sacrés indiens, en commençant par le Rig Veda, affirment invariablement que ce qui reste dépasse la totalité de ce qui suffit à remplir ces mondes, et que la source reste inaffectée par ce qui est produit à partir d’elle ou y retourne au début ou à la fin d’un éon. L’idée que tout ceci est une théophanie ne signifie pas que l’on voit tout de Lui ; au contraire, « un quartier seulement », pour ainsi dire, de son abondance (RV X, 90, 3 ; cf. MU VI, 35, BG X, 42) suffit à remplir les mondes de temps et d’espace, quelle que soit l’étendue qu’ils puissent atteindre ou la durée qu’ils puissent supporter.
Cf. Whitby dans la préface à la version anglaise de L’Homme et son devenir selon le Vêdânta de R. Guénon (1925) : « Il faut espérer que ce livre donnera le coup de grâce [en français dans le texte] au préjudice absurde et presque inexplicable qui déprécie constamment la doctrine védique à cause de son prétendu “panthéisme”. Ce lieu commun… » ; et Lacombe, dans sa préface à l’ouvrage de René Grousset, Les philosophies indiennes (1931) : « Il ne faut pas conclure, à notre avis, que le Vedanta soit pantheiste, ou même moniste, surtout au sens que ces mots ont chez nous. Il se nomme lui-même advaita, non-dualiste. Sa préoccupation d’assurer la transcendance de Brahman non moins que son immanence, de maintenir l’intériorité de sa Gloire, est manifeste. Position irréductible… » ; et Coomaraswamy, A New Approach to the Vedas, 1933, p. 42 [Une nouvelle approche des Védas, 1994, p. 99-100].
On peut ajouter qu’une objection similaire peut être faite au mot “monothéisme” dans le titre de la présente étude. Tad ekam dans RV X, 129, 2 est bien plutôt “Identité Suprême” que “Dieu unique”. C’est en tant que “Dieu unique”, comprenant des aspects aussi nombreux que les points de vue desquels Il est considéré, que “Cet Un” devient intelligible ; mais ce que Cet Un peut être en lui-même ne peut être exprimé qu’en termes de négation, par exemple, “sans dualité”. Voir Erwin Goodenough, An Introduction to Philo Judaeus (1940), p. 105.
6. En « se divisant Lui-même (atmânam vibhajya) pour remplir ces mondes » (MU, VI, 2, etc), Il reste « indivisé dans ces divisions » (avibhakta vibhakteshu) (BG, XVIII, 20, cf. XIII, 16), « non-mesuré, c’est-à-dire immatériel, parmi le mesuré (vimite mita) » (AV, X, 7, 39 ; amátra, BU III, 8, 8, etc) ; les dieux immanents, les Expirs (pránáh), sont les « mesures du Feu » (tejo-mátráh) (BU IV, 4, 1), c’est-à-dire « le Feu éternel, s’allumant avec mesure s’éteignant avec mesure » (Héraclite, fr. 30). « En d’autres termes, il n’y a pas en Lui de multiples existences, mais seulement une existence unique, et ses divers noms et attributs sont simplement ses modes et ses aspects » (Jami, Lawa’ih, XV).
7. Par ex., AB III, 4 : « Qu’on ait recours à (upasate) Lui pour s’en faire un ami (mitra-krityaiva), sa forme est alors celle de l’Ami (mitra) ». Dans le Kailayamalai, on s’adresse à Shiva comme « Toi qui prends la forme imaginée par tes dévots », voir Ceylon National Review, janv. 1907, p. 285.
8. Max Müller a inventé le terme “hénothéisme” pour décrire cette méthode, qu’il a apparemment imaginée être particulière aux Vedas. Le christianisme, en fait, est “hénothéiste” pour autant qu’il affirme que ce qui est fait par l’une des personnes l’est par toutes, et vice versa. Un “hénothéisme” pleinement développé est même davantage caractéristique du stoicisme et de Philon, cf. Émile Bréhier, Les idées philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie, 1908, pp. 112-113 : « La conception de dieux myrionymes [qui a dix mille noms, qui a de nombreux noms], d’un dieu unique auquel sous ses différentes formes s’adressent les prières des initiés était familière au stoicisme (…) de même que dans les hymnes orphiques, la toute puissance de chaque Dieu n’empêche pas leur hiérarchie, de même ici (c’est-à-dire, selon Philon] les êtres sont classés bien souvent hiérarchiquement comme s’il s’agissait d’étres distincts », [Voir aussi Plotin V 8, 9 : « Lui et tous ont une seule existence, alors que chacun est encore distinct. C’est une distinction selon l’état, sans qu’il y ait d’intervalle : il n’y a pas de forme extérieure que l’on puisse placer, l’une ici et l’autre là, et empécher, quelle qu’elle soit, d’être une pleine identité : cependant, il n’y a aucun échange de parts de l’un à l’autre. Chacune de ces totalités divines n’est pas non plus un pouvoir fragmenté (…) le divin est un seul pouvoir total ». Le second passage aurait pu être écrit au sujet de la trinité chrétienne]. Donc, ici aussi, nous rencontrons cette apparence superficielle de polythéisme qui trompe commodément l’apologiste de quelque autre religion que celle en discussion ici, le musulman par exemple, quand il appelle “polytheiste” la doctrine chrétienne de la trinité.
9. Vác, la Grande Mére, est pareillement “divisée” par les dieux, et faite pour occuper de multiples stations (má devá vyadadhuh purutra bharisthatram bhurya-veshavantim, RV X, 125, 3). Il est partout clairement établi que l’unité divine est essentielle et la multiplicité conceptuelle.
10. Jean 1, 4 : « et vita erat lux hominum ». [Le Soleil spirituel (de RV, I, 115, 1, etc) est la “Lumière des lumières” (jyotishām jyotis, RV, I, 113, 1 ; BU IV, 4, 16, etc) : « L’étincelante Lumière des lumières est ce que connaissent les connaisseurs de l’Esprit » (átma-vidah), Mund. Up. II, 2, 10 ; le « Père des lumières » (Jacques, I, 17)]
11. Comme dans ST I, 13, 1 ad 3 : « Pronomina vero demonstrativa dicuntur de Deo, secundum quod faciunt demonstrationem ad id quod intelligitur, non ad id quod sentitur Secundum enim quod a nobis intelligitur, secundum hoc sub demonstrationem cadit » [Les pronoms démonstratifs se disent en vérité de Dieu, selon qu’ils font la démonstration de ce qui est intelligible, non de ce qui est sensible. En effet, ce qui nous est intelligible est soumis à la démonstration].
12. Par ex. AV XIII, 3, 13 : « Cet Agni devient Varuna le soir : le matin il devient Mitra », etc ; JUB III 21, 1-2, où le Vent (vāyu) souffle depuis les cinq quartiers — est, sud, ouest, nord et en-haut — respectivement en tant qu’Indra, Ishâna, Varuna, Soma et Prajapati ; JUB IV, 5, 1, où Agni, « le messager de Varuna », devient Savitri à l’aube, Indra Vaikuntha à midi, Yama la nuit ; J IV, 137 : « Sujampati proclamé dans le ciel, est nommé sur terre en tant que Maghavā ».
13. Le nom Tanūnapāt : « Petit-fils de Lui-même » formule la doctrine bien connue selon laquelle « Agni est allumé par Agni » (RV I, 12, 6 ; VIII, 43, 14), et d’après quoi, dans le rituel, le nouveau Garhapatya [feu domestique dans le rituel védique] doit être allumé avec l’ancien. Cf. ST III, 32a ad 1 : « la prise de soi (c’est-à-dire, l’assomption de la nature humaine quand elle prend naissance) est attribuée au Fils », à savoir que c’est l’acte propre du Fils (gr. autogenês, auto-engendré) aussi bien que celui des autres Personnes.
14. « Sources of the Filosofy of the Upaniṣads », in : JAOS, XXXVI (1916), 197.
15. « Contributions to the Interpretation of the Veda », in : JAOS, XV (1893), 144.
16. « On Certain Work in Continuance of the Vedic Concordance », in : JAOS, XXIX (1908), 288.
17. p. 168, n. 166.
18. Stephen Herbert Langdon, Tammuz and Ishtar, 1914, p. 11.
19. Henri Frankfort, Iraq Excavations of the Oriental Institute, 1932/33, 1934, 147.
[Addendum : Meister Eckhart vol. II, Evans ed., 153 : « Même s’il y avait une centaine de personnes dans la Déité, l’homme qui voit des distinctions en dehors du temps et du nombre n’en saisirait qu’une »]

“Vous ne pouvez vous baigner deux fois les pieds dans la même eau, parce que l’eau qui coule est toujours nouvelle” Héraclite *
Cet article réunit une partie des matériaux rassemblés pendant les dernières années en vue d’une analyse critique des doctrines indiennes, et incidemment néo-platoniciennes, ou d’autres encore, concernant la “réincarnation”, la régénération, et la transmigration, selon les définitions que je précise ci-dessous (1) pour ces termes. Ces doctrines, souvent considérées comme superposables, semblent avoir été plus gravement incomprises, si possible, que tout autre aspect de la métaphysique indienne. Les thèses que l’on va proposer ici affirment que la doctrine indienne de la palingénèse se trouve correctement exprimée par la position bouddhiste. Celle-ci pose que dans la “réincarnation” rien (2) ne demeure d’une incorporation à l’autre, la continuité étant seulement celle que l’on peut voir lorsque l’on éclaire une lampe à partir d’une autre, que les termes employés pour “renaissance” (par ex. : punar jamma, punar bhava, punar āpadana [prati januma, nava jamna]) sont utilisés dans au moins trois sens facilement distinguables :
1) eu égard à la transmission de père en fils des caractéristiques physiques ou psychiques, c’est-à-dire de ce qui touche à la palingénèse dans son sens biologique, défini par Webster comme “la reproduction sans changement des caractères ancestraux” (3)
2) eu égard à une transition d’un plan de conscience à un autre opérée chez un même individu et généralement au cours d’une même vie, à savoir cette sorte de renaissance qui se trouve impliquée lorsque l’expression : “excepté si vous renaissez”, et dont le terme ultime est la déification (4)
3) eu égard au mouvement ou à la pérégrination de l’Esprit d’un corps-et-âme à un autre, dont le mouvement (5) prend place nécessairement quelque soit le véhicule composé qui meurt ou celui qui est généré, exactement comme on peut verser de l’eau d’un récipient dans la mer, et en repuiser dans un autre. Il s’agit toujours “d’eau”, mais jamais vraiment d’une certaine eau, sauf si l’on considère que le récipient paraît imposer une identité temporaire et une forme à son contenu ; et troisièmement, il n’y a pas de doctrine de la renaissance enseignée dans les Upanishads ou la Bhagavad Gītā qui ne soit déjà explicite et implicite dans le Rig-Véda.
Nous avons utilisé le mot “Esprit” dans la présente introduction pour renvoyer indifféremment à ātman, brahman, mrityu, purusha, etc., mais dans le corps de l’article ce terme ne rend compte que de l’ātman, assumant comme usuelle sa dérivation d’une racine an ou vā, signifiant respirer ou souffler. Mais parce que l’Esprit est réellement la totalité de l’Être dans tous les êtres, qui n’ont pas d’essence particulière mais seulement un devenir, ātman peut être aussi utilisé de manière réflexive pour signifier l’homme lui-même tel qu’il se conçoit “lui-même” (soit comme corps, ou corps-et-âme, ou corps-âme-et-esprit, ou enfin et réellement comme Esprit seulement) (6) et dans ces contextes, nous rendons ātman par “soi”, ou quelquefois “soi, ou esprit”. Nous utilisons les capitales chaque fois qu’il y a une possibilité de confondre l’Homme véritable ou le Dieu immanent avec l’homme “lui-même” ; mais il faut toujours se souvenir que la distinction entre esprit et Esprit, et personne et Personne est “seulement logique et non réelle”, en d’autres termes, une distinction sans différence (bhedābheda). On peut former une sorte d’image de ce qui est peut-être impliqué par une telle distinction (qui est analogue à celle des Personnes envisagées dans la Trinité chrétienne) en se rappelant que l’on parle des Êtres Accomplis comme de “rayons” de Soleil Divin, rayons qui sont manifestement distincts si l’on considère leur extension, mais non moins évidemment indistincts si on les considère dans leur développement, c’est-à-dire à leur source.
Les Upanishads et la BG sont d’abord concernées par le souci d’opérer dans le disciple un déplacement de son auto-référent — le sentiment que “Je suis” — de soi-même à l’Esprit en nous : ceci a un but exclusivement pratique (7) d’indiquer une Voie (mārga, magga bouddhiste) (8) que l’on peut suivre de l’obscurité à la lumière, du péché à la souffrance, et de la mort à un état de béatitude hors de la mort et hors du temps (que l’on peut atteindre même ici et maintenant). Dans les Upanishads et le bouddhisme primitif, il est clair que ce qui a été un enseignement initiatique transmis à travers une succession de maître à disciple était maintenant ouvertement publié et dans une certaine mesure adapté à la compréhension des types de mentalité “royale” et non seulement “sacerdotale”, par ex. dans la BG [le savoir est traditionnellement accordé aux brahmanes, la caste des prêtres, or la BG. est l’enseignement du Dieu Krishna à Arjuna, un kshatriya, archétype royal, NDT]. D’autre part, il est également clair qu’il existait des fautes de compréhension populaires largement répandues, fondées soit sur une ignorance des doctrines traditionnelles, soit provenant d’une interprétation trop littérale de ce qu’ils avaient entendu (9). L’évidence interne de ces textes eux-mêmes avec leurs questions et leurs réponses, leurs définitions et leurs réfutations, est amplement suffisante pour le montrer. De là, alors, la nécessité de ces innombrables dialogues dans lesquels, de la même manière dans les Upanishads, la BG et le bouddhisme, ce qui en “nous” est, et ce qui n’est pas l’Esprit se trouve nettement distingué et contrasté ; l’Esprit étant ce qui “reste” (10) lorsque tous les autres facteurs de la personnalité composite “identité-et-apparence”, ou “âme-et-corps” ont été éliminés. Et de plus parce que “l’Un qui respire cependant ne respire pas” (RV X, 129.2) n’est pas quelque chose que l’on pourrait opposer à quelque autre chose, Cela ou Celui-ci se trouve décrit simultanément au moyen d’affirmations et de dénégations, per modum excellentiae et remotionis [par mode d’excellence et de négation] (11). L’analyse suivante de l’identité suprême (tad ekam) réduite aux mots dérivés de an (respirer) ou vâ (souffler) peut aider à une meilleure compréhension des textes :
Dieu sans qualification
avātam, nirātmā, anātmya, nirvāna [inconditionné], en pali nibbana. Des définitions négatives sont seules possibles.
L’Esprit, Dieu, le Soleil, “le Connaisseur du Champ” : le Roi
[Le Champ est le corps quintuple (physique, vital, mental, idéel et divin) aussi bien individuel que cosmique. Le Connaisseur du Champ est le sage, c’est-à-dire l’homme qui a conscience du Brahman en lui, NDT]
ātman, en pali attā. En mouvement, vāyu, vāta, “Flux de l’Esprit” ; et prāna, la “Respiration”, le “Souffle de Vie”, en tant qu’il nous est imparti, il ne s’agit pas du souffle entendu empiriquement, mais du “fantôme” qui se trouve produit lorsque les créatures vivantes meurent (12). Étant “Un et plusieurs”, transcendant et immanent, bien que sans interstice ou discontinuité, l’Esprit, soit comme ātman soit comme prāna, peut être considéré comme pluriel (ātmanah, prānah), bien que seulement “comme si” [la chose, sa connaissance et son nom sont un. Voir aussi note 24, NDT]. La Forme, distinguée de la substance : l’Intellect.
Ce-qui-n’est-pas-l’Esprit, la Lune ; le Champ, le Monde, la Terre : le domaine du Roi
anātman, en pali anattā, le véhicule hylomorphique, physique et psychique ou mental inférieur, de l’Esprit, apparemment différencié de ses enveloppes. La substance mortelle en tant qu’elle est distinguée de ses Formes informantes.
À notre avis, ces concepts ne sont pas des catégories “philosophiques”, mais des catégories de l’expérience, sub rationem dicendi sive intelligendi (selon les raisons enseignées et comprises), plutôt que secundum rem (selon la chose elle-même).
Nous ne pouvons certainement pas discuter ici en détail ce que l’on entend réellement par la palingénèse, la métempsychose, ou la métasomatose dans la tradition néo-platonicienne (13). Nous ferons seulement observer que dans des textes comme les Ennéades de Plotin, III, 4, 2 (version de Mackenna), où il est dit : “Ceux (c’est-à-dire d’entre “nous”) qui ont conservé le niveau humain sont des hommes encore une fois. Ceux qui ont vécu seulement pour les sens deviennent des animaux (…) l’esprit de la vie précédente paye la rançon” (14), on doit prendre conscience que c’est une métempsychose et une métasomatose (et non une transmigration de la personne réelle) qui est en cause ; en d’autres termes, c’est une affaire d’héritage direct ou indirect des caractéristiques psycho-physiques du défunt, qu’il n’emporte pas avec lui à la mort, et qui n’ont pas part à sa véritable essence, mais seulement à son véhicule temporel et le plus extérieur. C’est seulement parce que nous “nous” identifions à tort avec ces vêtements accidentels de la personnalité transcendante, les propriétés pures et simples de l’expérience humaine terrestre, que l’on peut dire que “nous” sommes réincorporés en hommes ou en animaux : ce que n’est pas “l’esprit” qui paie la rançon, mais l’âme animale ou sensitive avec laquelle l’esprit désincarné n’a plus de rapport (15). La doctrine rend compte simplement de la ré-apparition des caractéristiques psycho-physiques dans la sphère mortelle de la succession temporelle. La finalité de l’enseignement est toujours qu’un homme devrait s’être reconnu “lui-même” en l’esprit, et non dans l’âme sensitive, avant sa mort, faute de quoi on peut seulement penser qu’“il” est à quelque degré “perdu”, ou de toute manière désintégré. Lorsque d’autre part, on dit que l’Âme est “auto-distribuée” (cf. ātmānam vibhajya, MU VI, 26) et que c’est “toujours la même chose qui est entièrement présente” (ibid. III, 4.6), et que cette “Âme traverse les cieux dans leur entier sous des formes variant selon la variété des lieux” — “la forme sensitive, la forme raisonnante, même la forme végétative” (16) — il est évident que c’est seulement ainsi qu’il est question de “plusieurs Âmes”, et que ce qui est décrit n’est pas la translation d’une personnalité privée d’un corps à l’autre, mais bien plutôt la pérégrination de l’Esprit (ātman) décrite de façon répétée dans les Upanishads comme omnimodale et omniprésente, et occupant par là ou plutôt animant corps après corps, ou plutôt corps et âmes sensitives, qui se suivent l’une l’autre, selon des séries déterminées de façon causale (17).
Tout cela est certainement aussi ce qu’Eckhart (en lequel se continue la tradition néo-platonicienne) doit entendre lorsqu’il dit : “Cela est dépendant de l’essence divine, son développement (c’est-à-dire son véhicule) est la matière, en laquelle l’âme revêt des formes nouvelles et rejette les anciennes, (…) celle à laquelle elle renonce, elle meurt à elle, et celle qu’elle revêt, elle vit en elle” (E, 379) presque identique à la BG II, 22 : “Lorsqu’un homme rejetant des vêtements usés, en prend d’autres, de même, l’habitant du Corps (dehin = sharira ātman), se dépouillant des corps usés, prend de nouveaux corps”, cf. BU IV, 44 : “Ainsi cet Esprit, terrassant le corps et quittant sa nescience (18), se fabrique à lui-même une forme nouvelle et plus juste”.
Les trois sections des Upanishads traduites ci-dessous commencent par la question : “Qu’est principalement l’Esprit ?”, c’est-à-dire “qu’est-ce “Soi”, qui n’est pas ‘moi-même’ ? Qu’est cet ‘Esprit’ en ‘moi’, qui n’est pas ‘mon’ esprit ?” C’est la différence que Philon établit dans les Quaestiones ad Genesis II, 59 et De Cherubim, 113 sqq. (que cite Goodenough, By Light, Light : The Mystic Gospel of Hellenistic Judaism, pp. 374-375) lorsqu’il distingue “nous” de ce qui en nous existait avant “notre” naissance et existera encore quand “nous, qui dans notre réunion avec nos corps (19), sommes des mélanges (sunkritoi) et avons des qualités, n’existerons pas, mais serons portés à renaître, et nous reliant aux choses immatérielles, deviendront des non-mêlés (asunkritoi) et sans qualités”. La “renaissance” (palingenesia) n’est assurément pas ici une “agrégation” ou une palingénèse au sens biologique, mais une “régénération” (palingénèse puisqu’un être naît de nouveau de l’Esprit de Lumière et comme tel), cf. Goodenough, p. 376, note 35.
“Qu’est-ce principalement le Soi (ou) principalement l’Esprit ?” Comme l’a dit feu Clarence E. Rolt dans un contexte différent : “Pascal a donné une réponse décisive : Il n’y a que l’Être universel qui soit tel. (…) Le bien universel est en nous, est nous-mêmes et n’est pas nous. Voici exactement la doctrine dionysienne. Chacun doit entrer en lui-même et y trouver Quelque Chose qui est son vrai Soi et cependant n’est pas son soi particulier. Quelque chose d’autre que son individualité, laquelle chose est en son âme et cependant hors d’elle” (Dionysius the Aeropagite on the Divine Names and mystical theology, 1920, p. 35).
“Si un homme vient vers moi (…) et ne haït pas son âme (heautou psuchèn ; Vulgate : animam suam) il ne peut être mon disciple” (Luc, XIV, 26). Les versions anglaises reculent devant une telle traduction, et écrivent “ne haït pas sa propre vie”. Il est évident cependant que ce n’est pas seulement “vie” qui est entendu ici. En effet il est demandé à ces hommes en même temps de “haïr” leurs proches. Si, au contraire, ils les aiment, ils peuvent être volontaires pour sacrifier jusqu’à leur vie pour eux ; ce qui est évidemment entendu est l’âme inférieure, que l’on distingue en général dans la tradition néo-platonicienne du pouvoir supérieur de l’âme qui est celui de l’Esprit et non réellement une propriété de l’âme, mais son hôte royal (20). De nouveau c’est précisément selon ce point de vue que Saint Paul dit avec une voix de tonnerre : “Car la parole de Dieu est prompte et puissante, et plus aiguë qu’une épée à deux tranchants, capable même de pénétrer et de séparer l’âme de l’esprit” (Hébr. IV, 12) (21), et on peut ajouter de manière cohérente que “Tout ce qui est lié en Dieu est Un même Esprit” (I Cor., VI, 17 cf. xii ; 4-13).
On peut comparer cela, d’un côté avec la BG VI, 6 : “L’Esprit est vraiment l’ennemi de ce-qui-n’est-pas-l’Esprit, et en guerre avec cela” (anātmanas tu shatrutve vartetātmaiva shatru-vat) où anātman = bouddhiste anattā [non-soi] (22), tout ce qui, corps-et-âme, dont on dit na me so attā (ceci n’est pas mon esprit), et de l’autre, avec la phrase d’Eckhart : “Cependant l’âme doit renoncer à son existence” (E, 274) (23) et, dans l’anonyme Cloud of Unknowing (Le Nuage d’Inconnaissance), ch. XLIV : “Tous les hommes ont des sujets d’affliction : mais plus que tous en particulier éprouve du chagrin celui qui éprouve et sait qui il est”, et avec le jugement de William Blake : “Je descendrai vers l’Annihilation et la Mort Éternelle, de crainte que le Jugement Dernier arrive et me trouve non-annihilé, et que je sois saisi et livré aux mains de ma propre Ipséité”. Toute Écriture, et même toute sagesse, en effet “proclame qu’il faut se libérer du soi”.
Mais si “celui-ci éprouve du chagrin d’éprouver et de savoir qui il est”, celui qui n’est plus quelqu’un, et voit, non lui-même, mais comme nos textes l’expriment, seulement l’Esprit, un et semblable en immanence et en transcendance, étant ce qu’il voit, devenu ce qu’il est (geworden was es ist), il ne ressent pas de chagrin, il est béatifié — “Un guide, Esprit contenu dans tous les êtres, qui rend manifeste une forme unique ! Les hommes contemplatifs voient Celui qui se tient en eux-mêmes, et voient avec Lui — le bonheur éternel leur échoit, et non aux autres” (KU V, 12) (24).
Il n’est pas aisé d’avoir une “expérience actuelle de la Non-Connaissance, et du Chemin Négatif qui y conduit” (Rolt, ibid.) sinon pour ceux qui sont pleinement mûrs, comme des fruits à maturité prêts à tomber de leur branche. Il est des hommes encore “vivants”, du moins en Inde, pour qui les rituels funéraires ont été accomplis, comme pour les sceller “morts et enterrés dans le Divin”. “Il est difficile pour nous d’abandonner les choses familières autour de nous et de rebrousser chemin vers l’ancienne demeure d’où nous venons” (Hermès, Lib. IV, 9). Cependant l’on peut dire, même de celui qui est encore conscient d’un soi, ou ne peut pas supporter une nourriture très solide, qu’il éprouve de la joie de manière spéciale, même si celle-ci n’est pas encore très spéciale, celui dont la volonté a déjà entièrement acquiescé, bien qu’il ne l’ait pas encore réalisé totalement, à l’annihilation de toute idée d’une propriété privée quelconque dans l’être, et a ainsi, pour ainsi dire, prévu et pré-goûté une ultime renonciation de toutes ses possessions importantes, aussi bien physiques que psychiques. Mors janua vitae [la mort est la passerelle de la vie (éternelle), expression médiévale chrétienne souvent utilisée en épitaphe].
► Ananda K. Coomaraswamy, « The coming to birth of the Spirit », in : D. R. Bhandarkar Volume, 1940.
[Traduction (légèrement modifiée) : Élisabeth Andrès, Connaissance des Religions n°3/4, 1989]
• nota bene : une autre traduction, « La naissance de l’Esprit », se trouve dans les Essais métaphysiques (2022).
*
Liste des abréviations :
BG : Bhagavad Gita / BU : Brihadaranyaka Upanishad
CU : Chandogya Upanishad
KA : Kausitaki Upanishad / KU : Katha Upanishad
MU : Maitri Upanishad
RV : Rig veda SamhitāE : Meister Eckhart, vol. I, trad. Clare de Brereton Evans, 1924
ST : Somme théologiqueNotes
*. You cannot dip your feet twice into the same waters, because fresh waters are ever flowing in upon you : Reconstitution par AKC du fragment 12 selon la classification Diels-Kranz d’après des variantes. La formulation première est celle-ci : As they step into the same rivers, different and still different waters flow upon them ; À ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d’autres et d’autres eaux (trad. Paul Tannery, 1887). On la retrouve chez Eusèbe (Préparation évangélique, XV, 20) qui cite Arius Didyme (fin du Ier siècle de notre ère) qui lui-même se prononçait sur la doctrine de Zénon d'après ce qu'en avait exposé Cléanthe (JF Pradeau indique fort à propos “le contexte de cet exposé sur l'âme, dont on voit bien qu'il relève de l’appropriation stoïcienne d'Héraclite : en l'occurrence, les stoïciens veulent voir en Héraclite un précurseur de leur définition de l'âme comme un souffle de même nature que le principe actif et hégémonique qui informe la totalité du monde”). AKC la rapproche d’autres citateurs. Platon : “On ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve” (Cratyle, 402 a, cf. aussi 401 d et 440 c-e) ; “toutes choses sont en mouvement comme des flots” (Théétète, 160 d) . Aristote : “Il n'est pas possible d'entrer deux fois dans le même fleuve” (Mét., Gamma, 5, 1010 a). Plutarque : “Car on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve, selon Héraclite, et l’on ne peut pas non plus saisir deux fois dans le même état une réalité mortelle” (Sur l’E de Delphes, 18, 392 a-c). Diogène Laërce : “L'univers entier s'écoule à la façon d'un fleuve” (Vies et Doctrines des philosophes illustres, IX, 1). Simplicius : “C’est là la thèse d'Héraclite, qui dit que tout s’écoule et ne reste jamais pareil” (Commentaire de la Physique). AKC renvoie dans une note complémentaire (reproduite dans The Essential Ananda K. Coomaraswamy, 2004) aux autres fragments 30, 31a, 31b, 91a et b, 48a, 50 et 10 et conclut : “L’accent est mis ici sur l’unité du Flux universel dont nous faisons partie, à un moment donné une chose puis une autre au suivant”.
1. Voir aussi mon « Vedic exemplarism », in : Harvard Journal of Asiatic Studies, I, 1936 et « Rebirth and omniscience in Pali Buddhism », in : Indian Culture, III, 1937, p. 19 sq. et p. 760 ; et René Guénon, L’Erreur spirite, 1930, ch. VI.
2. Milinda Panha, 72 : na kochi satto (aucun être). Noter que cette expression n’est en aucune façon nécessairement exclusive de l’Ātman, tel qu’il est défini par la négative dans les Upanishads. du ouk ón theos [Dieu vidé de substance] de Basilide*, du Dieu d’Érigène “qui n’est pas quelque cela”, du Divin “non-existant” d’Eckhart, du Dieu de Behmen [Jakob Böhme] qui n’est “aucune chose”.
[* : “Le “dieu non étant”, dont on ne peut rien affirmer, même l'existence, parce qu'il est au-dessus de tout prédicat, est trait pour trait le Brahman du Vedânta, qui est au-dessus de l'être et du non-être et dont le seul nom possible est une négation”, BEFEO t. II, 1902]
3. Dans un certain nombre de textes importants, on définit renaissance explicitement et catégoriquement en termes d’hérédité, et c’est là sans doute le seul sens qui laisse entendre que l’individu retourne sur le plan de l’être qu’il a quitté à sa mort. On dit expressément que le défunt n’est plus vu de nouveau ici (Shatapatha brāhmana XIII, 8.4.12, etaj jivā’s cha pitarash cha na samdricyante, et ibid., et passim, sakrid parānchah pitarah).
Nous avons aussi le RV VI, 70.3 : “Il est mis au monde dans sa progéniture selon la loi” (pra prajābhir jāyate dharmanas pari) ; Aitareya Brahmana VII, 13 : “Le père pénètre sa femme, la mère, devenant un embryon, et venant à l’être de nouveau, est remis au monde par elle” (jāyām pravicati, garbho bhūtvā, sa mātaram, tasyām punar navo bhūtvā jāyate, cf. Atharva-Véda XI, 4.20) ; Aitareya Aranyaka II, 5 : “En cela il produit le fils à venir à la fois avant et après sa naissance” (kumara janmano agre adhibhāvayati), c’est lui-même en tant que fils qu’il fait advenir (sa ya kum ram... adhibhavayaty atmānam eva) ; CU III, 17.5 : “Ce qu’il a procréé, c’est sa renaissance” (ashoshtheti punar-utpādanam) ; BU III, 9.28 : “Lui (le défunt) a réellement été mis au monde, mais il n’est pas né de nouveau, car (étant défunt) qui est là pour mettre au monde de nouveau ?” (jāta eva na jāyate, ko nu evam janayet punah). Nous avons aussi BU II, 2.8, où la filiation est la renaissance “dans une similitude” (pratirūpah). Il serait impossible d’avoir une définition plus claire du sens ordinaire de “réincarnation”. Cette réincarnation filiale est en outre précisément l’antapokatastasis ou le “renouveau des choses par substitution” d’Hermès, comme l’explique Scott (Hermetica, 322) : “Le père vit à nouveau dans son fils ; et bien que les individus meurent et ne reviennent plus, la race se renouvelle perpétuellement”.
Il faudrait ajouter qu’en-dehors du fait de nature de la réincarnation progénitive, il existe aussi une communication et une délégation formelles de la nature et du statut de père dans le monde, qui s’accomplit lorsque le père est sur le point de mourir. Ainsi dans BU I, 5, 17-20, lorsque ce “legs total” (sampratti) a été fait, “Le fils qui a été ainsi mis au monde (anusishthah) est appelé le représentant-mondain (lokyah) et ainsi à travers le fils, le père est encore-présent-dans (prati-tishthati) le monde” ; et de même, en KA II, 15 (10), où le legs total du père au fils (pitāputriyam sampradānam) est décrit en grands détails, et après ce legs, si par hasard le père guérit, il doit soit vivre sous la tutelle du fils, soit devenir religieux errant (parivāvrajet, c’est-à-dire devenir un parivrājaka, mort au monde dans sa forme extérieure).
4. cf. mon « Indian doctrine of man’s Last End », in : Asia n°5/1937. [Texte repris dans la revue Sophia n°1/1988]
5. Le “Mouvement”, non un mouvement local, mais une omniprésence, et lorsque nous parlons même métaphoriquement, d’une “procession” in divinis. Il ne s’agit pas d’un mouvement local, mais de celui d’un Moteur Immobile. “L’Un sans Mouvement, plus rapide que la pensée elle-même, (…) qui dépasse les autres bien qu’ils courent” (Isha Up., 4). “Assis, Il voyage loin ; penché, Il va partout” (KU II, 21), étant “sans fin dans toutes les directions” (MU VI, 17) et bien qu’“Il ne soit venu de nulle part” (KU II, 18), cependant “perpétuellement différencié et allant partout” (Mundhaka Up., I, 2.6) et “prenant des naissances d’une grande variété” (bahudhā jāyamānah) (ibid., II, 2.6).
6. Lorsque nous disons “Ne me fais pas de mal”, faisant référence au corps, ou “Je sais” ou “mon âme”, un professeur très scrupuleux dirait “Ne fais pas de mal à ce corps”, “cette pensée connaît” et “l’Esprit en ‘moi’” ou “habitant-du-Corps”.
7. cf. Franklin Edgerton, « The Upanishads : what do they seek and why ? », in : Journal of the American Oriental Society n°2/1929 [« Les Upanishads cherchent à connaître la vérité réelle sur l'univers, non pour elle-même, non pas pour la pure joie de connaître, non pas à titre de spéculation abstraite, mais simplement parce qu'ils considèrent une telle connaissance comme un raccourci pour acquérir la maîtrise de la toute puissance cosmique. Le possesseur d'une telle connaissance sera en mesure de satisfaire n'importe lequel de ses désirs. Il sera exempt de la vieillesse et de la mort, du danger et de la douleur, de tous les maux dont la chair a le partage. Par la connaissance de l'Un qui est Tout, et par l'identification mystique de son propre soi-même avec cet Un qui est Tout, il a, comme cet Un, le Tout sous son contrôle », citation traduite in : « L’absolu brahmanique », M. Ledrus, Gregorianum n°2, 1932]. Dante, Épître à Cangrande, §§ 15-16. La tradition védique n’est ni philosophique, ni mystique, ni religieuse au sens moderne courant de ces mots. La tradition est métaphysique. mystique n’a sens que pour ce qui expose un mystère et dans le sens de Denys, Theologia Mystica. La position indienne a été admirablement définie par Satkari Mookerjee : “Évidemment la question de la libération est un problème de la plus extrême importance et constitue la justification et l’ultime raison d’être de la recherche philosophique. La philosophie en Inde n’a jamais eu un intérêt seulement spéculatif sans préoccupation de son application à la vie. (…) Le but se dessine, visible, à l’horizon philosophique, mais on a reconnu qu’il n’existait pas de raccourci ou de voie facile pour y parvenir. Il faut payer le prix fort sous forme d’une réalisation philosophique sans atermoiement des mystères ultimes de l’existence, que l’on peut accomplir grâce à une discipline morale rigoureuse ; et la satisfaction banalement académique et intellectuelle résultant des études philosophiques était considérée comme valable seulement dans la mesure où elle était conduite pour en mener à bonne fin l’heureux achèvement” (in : The Cultural Heritage of India, vol. III, pp. 409-410, 1937, les italiques sont de mon fait).
8. Pour le sens de ce mot, voir ma « Nature of ‘Folklore’ and ‘popular art’ », in : Quarterly Journal Mythic Society, 1936. [Texte repris dans le recueil La Philosophie chrétienne et orientale de l’art]
9. Nous ne disons pas qu’une théorie de la réincarnation (ré-incorporation de l’homme véritable et de la vraie personnalité du défunt) n’a pas été objet de croyance en Inde ou ailleurs, mais nous sommes d’accord avec M. Guénon pour dire qu’elle “n’a jamais été enseignée dans l’Inde, même par les bouddhistes”, et il s’agit essentiellement d’une notion occidentale moderne, de même que “nulle doctrine traditionnelle authentique n’a jamais parlé de la réincarnation” (L’Erreur spirite, 1923).
Les savants modernes ont été d’accord en général pour dire que la réincarnation n’est pas une doctrine védique, mais est d’origine populaire ou inconnue, adoptée et considérée comme admise déjà dans les Upanishads et le bouddhisme. Laissant de côté le bouddhisme pour le moment, on peut faire remarquer que lorsque l’on a affaire à cette thèse fondamentale et révolutionnaire, et non à la simple expansion de doctrines enseignées préalablement, il serait inconcevable du point de vue d’un hindou orthodoxe et traditionnel de penser que ce qui n’est pas enseigné dans une partie de la shruti [révélation, littéralement “audition”. Ensemble des textes védiques, seule source authentique de connaissance, NDT] puisse l’avoir été dans une autre ; sur un tel sujet, on ne peut pas imaginer un hindou orthodoxe “choisissant entre” le RV et les Upanishads, comme si l’une pouvait avoir raison et l’autre tort. Cette difficulté disparaît si nous découvrons que la théorie de la réincarnation (distinguée des doctrines de la métempsychose et de la transmigration) n’est pas vraiment enseignée dans les Upanishads : sur ce point nous attirons particulièrement l’attention sur la proposition de la BU IV, 337 où il est expliqué que lorsqu’une nouvelle entité vient à l’être, on dit des éléments factoriels du nouveau composé, non “Voici venir un tel” (préalablement défunt) mais “VOICI VENIR LE BRAHMAN” [le Brahman est ici le terme neutre désignant l’Absolu, et non le mot masculin à une caste de la société traditionnelle hindoue, NDT] : Ceci est totalement en accord avec le Milinda Panha bouddhiste, 72, où il est dit catégoriquement qu’aucune entité d’aucune sorte ne va d’un corps à l’autre, mais qu’il s’agit simplement d’allumer une nouvelle flamme.
En établissant une différence entre la réincarnation telle que nous l’avons définie ci-dessus, et la métempsychose et la transmigration, on peut ajouter que ce que l’on entend par métempsychose est l’aspect psychique de la palingénèse, ou en d’autres termes, l’hérédité psychique, et que ce que l’on entend par transmigration est un changement d’état ou de niveau de référence excluant par définition l’idée d’un retour à un état ou un niveau qui a déjà été traversé. On peut seulement distinguer la transmigration de l’ātman (esprit) “individuel” comme un cas particulier de la transmigration du paramātman (Esprit, Brahman). Dans ce cas cependant, on peut prouver qu'il est souhaitable d'utiliser un terme tel que “pérégrination” : la pérégrination remplace la transmigration lorsque l’on a atteint l’état de kāmācharin (Celui-qui-se-meut-à-volonté).
Sans doute il est beaucoup de passages dans les Upanishads etc., qui, enlevés de leur contexte général, semblent parler de réincarnation personnelle et ont été ainsi l’objet d'une interprétation erronée, en Inde, comme en Europe, cf. W. Scott, Hermetica, II, pp. 193-194, note 6 (“Il”, dans la première phrase citée, est le fils de Valérius, et pour notre affaire “un tel” ou Tout homme ; les italiques sont mon fait) : “Pendant sa vie sur terre, il était une partie distincte de pneuma, distingué et divisé du reste des hommes ; maintenant cette partie du pneuma qui le constituait, est mêlée à la masse globale du pneuma dans laquelle réside la vie de l’univers. C’est certainement ce qu’entendait l’écrivain (Apollonius), s’il adhérait à la doctrine exposée dans la partie précédente de la lettre. Mais à partir de ce point, sa parole est ambiguë, et il utilise des phrases qui, pour un lecteur qui n’a pas totalement saisi le sens de sa doctrine, peut sembler impliquer une survivance de l’homme comme personne distincte et individuelle.
La pensée moderne, qui est attachée à “l’individualité” et aux “preuves de la survivance de la personnalité” est prédisposée à interpréter à tort les textes traditionnels. Nous ne devrions pas lire dans ces textes ce que nous aimerions ou espérerions “naturellement” y trouver, mais y lire ce qu’ils veulent : cependant “il nous est difficile d’abandonner les choses familières autour de nous, et de retourner au vieux logis dont nous sommes venus” (Hermès, Lib. IV, 9).
Même si nous pouvons chérir les chaînes de l’individualité, elle n’est qu’une modalité partiale et nettement délimitée de l’être : “Je” se trouve défini par ce qui est “non-je”, et ainsi emprisonné. C’est en pensant à se libérer de cette prison et de cette partialité que nos textes démontrent constamment que notre individualité prétentieuse n’est ni uniforme ni constante, mais composite et variable, faisant remarquer que le plus sage est celui qui peut dire le plus “Je ne suis pas maintenant l’homme que j’étais”. Ceci est vrai dans une certaine mesure de toutes les choses en train de devenir (werdende) ; mais la “fin de la route” (adhvanah pāram) se trouve au-delà de “l’humanité”. C’est seulement pour ce qui n’est pas individuel, mais universel (cosmique) que l’on peut utiliser le prédicat perdurer, et que l’on peut utiliser celui d’éternité, sans avant et sans après, seulement pour ce qui n’est ni individuel ni universel.
10. KU V, 4 : kim-atra parisishyate (Que reste-t-il [quant l’ātman associé à un corps s’en va] ?) ; CU VIII, 1.4 : kiṃ tato'tishishyata iti (Qu’en reste-il alors ?) [cf. traduction de ce passage dans Le Temps et l’Éternité, 107-108]. À noter que tad shishyate = sesha [Celui qui demeure (shishyate) après la dissolution, dans la cosmologie hindoue] = Ananta [sans limite] = Brahman = Ātman.
11. Nous avons débattu brièvement de la doctrine indienne de divinis nominibus in : « Vedic Monotheism », JIH, XV, 1936, et nous ferons simplement remarquer ici que RV V, 44.6 : yātrig eva dadrice tādrig uchyate (Tel il est conçu, tel on le nomme) répond à St. Thomas, ST I, q. 13, art. 1, resp. [Resituons le passage. Pourquoi devrions-nous supposer que nos paroles sur Dieu ne peuvent être adéquates ? Il y a plusieurs raisons philosophiques. La première est celle-ci : nos mots ne se réfèrent aux choses qu’à travers les pensées que nous en avons. Du fait que, dans cette vie, nous ne comprenons pas l’essence de Dieu, il suit que les mots que nous appliquons à Dieu ne sont pas adéquats] : “Selon le Philosophe, les mots sont des signes des pensées et les pensées sont des similitudes des choses [De l'interprétation, trad. Tricot : Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l’âme, et les mots écrits les symboles des mots émis par la voix]. Cela montre que les mots se réfèrent aux choses à signifier par l’intermédiaire de ce que l’esprit conçoit. Et il s’ensuit que nous pouvons nommer un être dans la mesure où notre intellect peut le connaître” (secundum philosophum, voces sunt signa intellectuum, et intellectus sunt rerum similitudines. Et sic patet quod voces referuntur ad res significandas, mediante conceptione intellectus. Secundum igitur quod aliquid a nobis intellectu cognosci potest, sic a nobis potest nominari). Et, plus loin, objection 3 : “Quant aux pronoms démonstratifs, ils se rapportent à Dieu comme connu par l’intellect, non comme perçu par les sens” (pronomina vero demonstrativa dicuntur de Deo, secundum quod faciunt demonstrationem ad id quod intelligitur, non ad id quod sentitur). Ainsi que art. 5 : “Il faut donc dire que les noms en question sont attribués à Dieu et aux créatures selon l’analogie, c’est-à-dire selon une certaine proportion” (dicendum est igitur quod huiusmodi nomina dicuntur de Deo et creaturis secundum analogiam, idest proportionem).
12. Prāna, comme le grec pneuma, a la double valeur de Spiritus et spiraculum vitae, selon le contexte. “C’est comme Souffle-de-vie (prāna) que l’Esprit Prévoyant (prajnātman) saisit et dresse le vivant” (KA III, 3), cf. St. Thomas, ST III, 32.1 : “Le pouvoir de l’âme qui est dans la semence façonne le corps à travers l’Esprit qui y est enclos” et Schiller, Wallenstein, III, 13 : “C’est l’Esprit qui s’enfouit dans le corps” (Es ist der Geist der sich den Körper schart) ; et Jaiminiya Upanishad Brahmana III, 32.2 : “Tandis que l’on dit que les prānāh divisés se meuvent à l’intérieur des vecteurs des canaux (nadhi, hita) du cœur” (voir refs. Robert Ernest Hume, The Thirteen Principal Upanishads, 1921), in : Hermès Lib. X, 13 et 17, “l’esprit vital (pneuma) traverse les veines et les artères avec le sang, mais non sous forme du sang, (et ainsi) meut le corps, et le porte comme une charge (…) (et) contrôle le corps”.
Le Prāna est identifié au Prajnātman : en tant que Prāna (vie), en tant que Prajnātman (immortalité) ; la longueur des jours en ce monde et l’immortalité en l’autre sont complémentaires. Distingué du Prāna, les prānāh divisés sont des courants de perception obtenus au moyen des organes de sens et qui leur sont préalables. De là, comme il est dit dans la KU IV, 1 : “Le Soi Suprême né par lui-même transperce les ouvertures sensorielles attirées vers le dehors. C’est pourquoi elles sont tournées vers l’extérieur, non vers le Soi intérieur. Mais seul l’homme sage, désireux d’immortalité, le regard tourné vers l’intérieur, voit le Soi en lui” (se reporter à la discussion de ce passage dans : « A Study of the Katha-Upanisad (IV. I) », Indian History Quarterly n°3/ 1936 ). [Cf. aussi : “c’est parce qu’il regarde à l’extérieur à partir de notre intérieur que nous ne le voyons pas ; pour voir celui qui est le seul qui voit, étant lui-même non vu, notre œil doit être re-tourné. En d’autres termes, ce n'est pas avec l’œil du sens de la vue, mais avec celui du cœur ou de l’intellect, que l’on doit chercher à le voir”, « Sur la psychologie, ou plutôt la pneumatologie dans l'Inde et dans la Tradition », note 68, in : La Signification de la Mort, pp. 42-43]
13. Pour maintes références, voir Walter Scott, Hermetica, II, 265 sqq.
14. À savoir la rançon d’une “transmigration honteuse dans des corps d’une autre sorte”, Hermès Trismégiste, Asclépius I, 12 a, cf. BU VI, 2.16, CU V, 10, 7-8, KA I, 2. Nous comprenons que le résultat d’une bestialité en “nous” vient de ce que ces types bestiaux sont transmis : c’est la réincarnation du caractère dans le sens 1), et c’est ainsi que les enfants sont punis pour les péchés de pères. “Bêtes” de plus, est un symbole, de même que nous disons’ Ne fais pas la bête ou d’un homme qu’il est un vers ou d’une femme qu’elle est un chat. La tradition indienne emploie couramment un tel langage. Aitareya Aranyaka II, 3-8 (un locus classicus, cf. La définition de la personne par Boèce, Contra Evtychen, II) par ex., définissant l’homme spirituel comme celui qui connaît ce qui est et ce qui n’est pas mondain etc., comme une personne (purusha), et définissant les autres — dont la connaissance est seulement une affection — comme du bétail (pashu).
À l’adresse de ceux convaincus par l’origine populaire de la notion de réincarnation (entendue comme une renaissance dans la chair de la personne récemment décédée), on peut remarquer que les Bataks de Sumatra dévoraient “les captifs de guerre pour assimiler leur valeur et celle de leurs grands-mères ou grands-pères comme forme de captation pieuse. Cette dernière était souvent, sinon toujours, à la demande de la victime, dans la conviction qu'elle assurerait une existence continue sous la forme d'une nouvelle âme” (G.H. Seybold dans : Asia n°9/1937, p. 641, c'est moi qui souligne). Cette croyance cannibale est une croyance en la métempsycose, et non une croyance en la “réincarnation”.
15. Il faut toujours avoir à l’esprit dans tous ces débats que “l’âme” (psuchè, anima, sans équivalent exact en sanskrit autre que nāma, le nom ou forme d’une chose par laquelle s’établit son identité) est une valeur double : les plus hauts pouvoirs de l’âme coïncident avec l’Esprit (pneuma) et/ou l’Intellect (noûs hégemôn, ou noûs), les plus bas avec la sensation (aesthesis) et l’opinion (doxa). De la la hiérarchie gnostique de l’homme animal, psychique et spirituel, le premier devant être perdu, l’intermédiaire étant capable de libération, et le dernier étant virtuellement libre, et assuré de libération à la mort (Codex Bruce [manuscrit copte gnostique], etc.). Lorsque nous disons “perdu”, il faut entendre “détruit dans le cosmos” (Hermès, Lib. IX, 6) et par “libéré” tout à fait séparé de l’âme animale et ainsi devenu ce que les pouvoirs plus élevés sont déjà, à savoir divins. Il faut rendre ātman par âme. Il convient d’observer que animal vient de anima = psuchè, animalia = empsucha ; de là W. Scott (Hermetica, I, 297) rend Solum enim animal homo par “L’homme et l’homme seul de tous les êtres à avoir une âme” ; c’est par le noûs et non par la psuchè que l’homme se distingue de l’animal (Hermès, Lib. VIII, 5). On peut noter que la doctrine d’Averroès concernant l’unité de l’Intellect (pour laquelle monopsychisme semble un terme inapproprié) répugnait aux auteurs scolastiques chrétiens d’une période assez ancienne, précisément à cause de son incompatibilité avec la croyance en l’immortalité personnelle (cf. De Wulf, Histoire de la Philosophie médiévale, II, 1936, 361) ; d’autre part, l’imagination (phantasmata) et la mémoire survivent à la mort du corps non en temps qu’elles se trouvent dans l’intellect passif (hermétique : noêsis, scr, ashuddha manas), mais seulement en tant qu’elles se trouvent dans l’intellect possible (hermétique noûs, scr. shuddha manas) qui est en action quand il s’identifie à chaque chose en tant qu’il la connaît (St. Thomas, ST I, 2.67.2 c). En outre, St. Thomas indique que : “dire que l’âme appartient à la Substance Divine conduit à une improbabilité manifeste” (I, 90, 1) et Eckhart parle constamment des morts et de la dernière mort de l’âme. Il est clair au moins qu’il est hors de question de penser à une immortalité de “l’âme” sensitive et raisonnante, et que l’âme que l’on peut dire en quelque sens “immortelle” ne peut l’être qu’en rapport au “pouvoir intellectuel de l’âme” plutôt que par rapport à l’âme elle-même. Pour Hermès (Lib. XI, 24 a), “l’âme qui est liée au corps” ne peut pas être conçue comme un principe immortel, même si l’on suppose une cohérence temporaire post-mortem de certains éléments psycho-physiques du bhūtātman ; on ne peut pas non plus se représenter “l’âme” que le Christ nous demande de “haïr” comme l’équivalent de l’âme immortelle de l’homme. La quête de “l’homme moderne à la recherche d’une âme” est bien différente de celle qu’implique Philon par “l’âme de l’âme” ; on peut dire que la psychologie et l’esthétique modernes envisagent seulement l’âme inférieure et animale en l’homme, et seulement le subconscient. Philon dit (Quis rerum divinarum Heres, 48, version de Goodenough, p. 378) que “le mot âme est utilisé en deux sens, en référence soit à l’âme comme un tout, soit à sa partie dominante (hègemonikon, scr. anatarvāmin), qui enfin à proprement parler est l’âme de l’âme” (psuchè psuchès, cf. in MU, III, 2 : bhūtātman […] amrito syātma, le moi élémental […] son Soi qui ne peut mourir). La valeur du concept européen “âme” est demeurée ambiguë depuis lors. Par suite, dans l’analyse des doctrines néo-platoniciennes de la renaissance, et aussi à travers la tradition chrétienne, depuis les hymnes jusqu’à Eckhart et aux mystiques flamands, il est indispensable de savoir exactement de quelle “sorte d’âme” on parle dans un contexte donné et lorsque l’on traduit du sanskrit, il est extrêmement dangereux, si cela n’induit pas invariablement en erreur, de traduire ātman par âme.
16. “L'âme parcourt le ciel tout entier, ici sous une forme, là sous une autre”, Platon, Phèdre 246 b-c. Socrate poursuit ainsi son exposé sur la nature de l'âme : “quand elle est parfaite et ailée, elle chemine dans les hauteurs et administre le monde entier ; quand, en revanche, elle a perdu ses ailes, elle est entraînée jusqu'à ce qu'elle se soit agrippée à quelque chose de solide ; là, elle établit sa demeure, elle prend un corps de terre qui semble se mouvoir de sa propre initiative grâce à la puissance qui appartient à l'âme. Ce qu'on appelle vivant, c'est cet ensemble, une âme et un corps fixé à elle, ensemble qui a reçu le nom de mortel”. Cette citation est reprise par Plotin (Ennéades, III, 4, 2) qui rajoute : “soit sous la forme sensitive, soit sous la forme rationnelle, soit, précisément, sous la forme végétative”. Elle correspond exactement à ce qui est dit dans Nirukta, VII, 4 : “C'est à cause de la grande divisibilité du Divin (devatā) qu'ils Lui attribuent de nombreux noms. (…) Les autres Dieux (devāh) ou Anges constituent les membres de l’Esprit unique (eka ātmā). Ils trouvent leur origine dans leur fonction (karma) ; l’Esprit (ātman) est leur source. (…) L'Esprit est la totalité de ce qu'ils sont”, et BD I, 70-74 : “C’est à cause de sa vastitude que l’Esprit reçoit divers noms selon la distribution des sphères. C’est pour autant qu’ils sont des différenciations (vibhutih, cf. BG X, 40) que les noms sont innombrables (…) selon les sphères dans lesquelles ils sont établis”, cf. MU VI, 26 : “Se distribuant lui-même, Il remplit ces mondes”. Pour d’autres références, voir mon « Vedic Monotheism » in : JIH, XV, 1936. “Or, il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Et il y a des différences de ministères, mais le même seigneur. Et il y a diversité d’activités, mais c’est le même Dieu qui agit dans toutes. (…) Les membres de ce corps, étant multiples, sont cependant un même corps” (I Cor. 12:4-6 et 12).
17. Pour karma (= adrishtha) dans la doctrine chrétienne, cf. Augustin, Gen. ad Lit. VII, 24 (cité par St. Thomas, ST I, 91.2) : “Le Corps humain pré-existe dans les travaux précédents dans leurs vertus causales”, et De Trin. III, 9 : “Une mère est enceinte de l’embryon à naître, ainsi le monde lui-même est lourd des causes des choses non encore produites” (cf. ST I, 115.2 et 4) et : “Si Dieu gouvernait seul (et non en même temps au moyen de causes médiates), les choses seraient privées de la perfection de la causalité” (ST I, 103.7 ad 2).
18. Hermès Trismégiste, Lib. X, 8b, kakia de psuchès agnosia. (…) Tounantion de aretè psuchès gnosis. Ho gar gnous kaï agathos kaï eusébês kaï êde theios [le vice de l’âme, c'est l’ignorance. (…) Au contraire, la vertu de l’âme est la connaissance : car celui qui connaît est bon et pieux, et déjà divin] et XI, ii, 21a : “Mais si vous enfermez votre âme dans votre corps, et vous avilissez, et dites ‘Je ne sais rien’ (Ouden nôo), (…) alors qu’avec vous à faire avec Dieu ?”. Comme le dit Ulrich en commentant le traité des Noms divins de Denys : Ignorantia divisiva est errantium (l’ignorance entraîne la division des choses qui errent) [Ignorantia = scr. Avidya, errantium d’Ulrich = scr. samsārasya ; Cf. BU IV, 4, 19 : “Seulement par l’Intellect (manasā) peut-il être vu qu’il n’y a pas de pluralité en Lui” ; et KU IV, 14 : “Tout comme l’eau tombée en pluie sur un sommet élevé court ici et là parmi les collines, ainsi celui qui voit les principes dans la multiplicité court après eux”]. “Agnostique” signifie Ignoramus, ou même quis ignorare vult sive ignorantium diligit. Au contraire, “Pensez que pour vous aussi rien n’est impossible” (Hermès, Lib. XI, ii, 20b), cf. CU VIII, 1, cf. “si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, (…) rien ne vous serait impossible” (Mat. XVII, 20). “Tant qu’elle ne sait pas ce qui est savoir, l’âme se détournera du bien qu’elle ne sait pas reconnaître” (Eckhart, E, 385). “Pas d’abandon de qualités sans omniscience” (Saddharma-pundarika ou Sūtra du Lotus V, 74-75) [sarvajñatvamrte nāsti nirvānam = Il n’est point de véritable nirvana sans omniscience].
19. BG XIII, 26 : “Tout ce qui a été produit, tout être (kimchit sattvam, cf. Mil 72 kochi satto, cité ci-dessus) mobile ou immobile, sache qu’il naît de l’union (samyogāt) du Champ et du Connaisseur du Champ”. Le “Champ” a été défini plus haut en XIII, 5-6 : il comprend la totalité de ce que l’on devrait appeler “âme et corps” et tout ce qui est éprouvé ou perçu par eux.
20. cf. Plutarque, Sur la disparition des oracles, 436 f, où l’âme de l’être est assignée à Prophétie (é mantikè, ici = pronoïa. La Providence est ainsi distinguée des “causes imposées et naturelles”) comme à son support matériel (ulen men auté tèn psuchèn toù anthropou... apodidontes) ; et la BG VI, 6 où l’esprit est nommé l’ennemi de ce qui n’est pas l’esprit (anātmanas tu shatrutve vartetātmaiva shatru-vat). “Vouloir perdre [haïr] notre psyché doit signifier nous oublier nous-même entièrement” (William Inge, Personal Idealism and Mysticism, 1907, p. 102), “ne plus vivre ma propre vie, mais laisser ma conscience possédée et baignée par la vie Infinie et Éternelle de l’esprit (W. James, Varieties of religious experience, 1902, p. 451).
21. merismou psuchès kaï pneumatos [divisant âme et esprit] (Hébr. IV, 12), cf. Hermès, Lib. X, 16 : ho noûs tès psuchès (chorixetai) [l’intellect (se sépare) de l’âme].
22. Anātman, de même qui “n’est pas habité d’esprit” (non sans qualificatif dans CB II, 2.2.8, où dieux et titans sont de même originellement “non habités d’esprit” et “mortels” et “n’être pas habité d’esprit est la même chose qu’être mortel” (anātmā hi martyah) : Agni seul est “immortel” (amartyah).
23. Comparer les expressions utilisées par St. Bernard : déficere a se tota et a semetipsa liquescere in : De diliogendo Deo ; et comme le fait remarquer Étienne Gilson : “Quelle différence y-a-t-il donc, à la limite, entre aimer Dieu et s’aimer soi-même ?” (La théologie mystique de saint Bernard [recension], 1934, p. 156)
24. Eko vashi sarva-bhūtāntarātmā ekam rūpam bahudhā yah karoti : Tam ātmastham ye’nupashyanti dhirāh teshām sukham shāshvatam nêtareshām (KU V, 12) [Unique régisseur, le Soi intérieur à tout être, qui rend multiple sa forme unique, les sages qui Le discernent se tenant en eux-mêmes, le bonheur éternel leur échoit, et à nul autre]. Nous ne pouvons restituer la force évocatrice de la racine anu dans l’expression anupashyanti qu’en répétant “voyant… et voyant avec”. À noter que ekam rūpam bahudhā yah karoti (bien qu’unique apparaît multiforme) correspond à Samyutta Nikaya, II, 212 : eko’pi hutvā bahudhāhomi (étant Un, je deviens multiple) ; et “tout le reste est infortune” correspond à l’expression bouddhique aniccā, anattā, dukkha [impermanence, insatisfaction, non-moi].
“Les Âmes descendantes se lamentent : Nos yeux auront peu de place pour y saisir les choses (…) et quand nous voyons le Ciel, nos ancêtres, réduits à petite échelle, nous ne cesserons de nous plaindre. Et même si nous voyons, nous ne verrons guère complètement” (Hermès, cité par Jean Stobée, Exc. XXIII, 36). “Car maintenant nous voyons à travers un filtre, obscurément, mais ensuite nous verrons face à face : maintenant je connais en partie, mais plus tard, je connaîtrai aussi bien que je suis connu” (I, Cor. XIII, 12). Une vision-de est perfectionnée en vision-comme, de même la connaissance-de [connaissance objective, empirique, relative] en connaissance-comme (adaequatio rei et intellectus : voir le Ciel complètement exige un œil de la largeur du Ciel). Dhirāh (contemplatifs), ceux qui voient au-dedans, non avec les yeux de la chair (māmsa chakshus), qui voient l’Esprit “sur tout ce qu’il faut voir” (abhidhyāyeyam, MU I, 1). “L’Esprit qui est nôtre et en toutes choses, par rapport auquel tout le reste est infortune” (BU III, 4.2).
***
 « La doctrine métaphysique oppose simplement le temps comme continuité à l’éternité hors du temps, laquelle ainsi, ne doit pas être confondue avec la perpétuité : elle coïncide avec le présent réel, ou l’instant, dont on ne peut avoir l’expérience dans le temps. Ici, la confusion n’apparaît que pour une conscience réfléchissant en fonction du temps et de l’espace ; pour elle, un instant succède à un “instant” sans interruption, et il lui semble qu’il y ait une série indéfinie d’instants, collectivement totalisés dans le “temps”. Cette confusion peut être dissipée si nous nous apercevons qu’aucun de ces instants n’a de durée ; quant à la mesure, ils sont tous des zéros dont la “somme” est impensable. C’est une question de relativité ; c’est “nous” qui sommes en mouvement, tandis que l’instant est immuable et parait seulement se déplacer — de même que le soleil semble se lever et se coucher parce que la terre “tourne” ».
« La doctrine métaphysique oppose simplement le temps comme continuité à l’éternité hors du temps, laquelle ainsi, ne doit pas être confondue avec la perpétuité : elle coïncide avec le présent réel, ou l’instant, dont on ne peut avoir l’expérience dans le temps. Ici, la confusion n’apparaît que pour une conscience réfléchissant en fonction du temps et de l’espace ; pour elle, un instant succède à un “instant” sans interruption, et il lui semble qu’il y ait une série indéfinie d’instants, collectivement totalisés dans le “temps”. Cette confusion peut être dissipée si nous nous apercevons qu’aucun de ces instants n’a de durée ; quant à la mesure, ils sont tous des zéros dont la “somme” est impensable. C’est une question de relativité ; c’est “nous” qui sommes en mouvement, tandis que l’instant est immuable et parait seulement se déplacer — de même que le soleil semble se lever et se coucher parce que la terre “tourne” ».
« La doctrine du Vêdânta selon laquelle le monde est de la nature de l’art n’est pas une doctrine de l’illusion. Elle distingue simplement la réalité relative de l’œuvre de la réalité plus grande, celle de l’Artisan dans laquelle subsiste le paradigme. Le monde est une épiphanie ; et ce n’est pas sa faute mais la nôtre, si nous prenons par erreur, les choses qui furent faites pour la Réalité d’après laquelle elles furent faites, le phénomène lui-même pour son modèle. Qui plus est, l’illusion ne peut être proprement attribuée à un objet, elle ne peut provenir que de celui qui le perçoit ; l’ombre est une ombre, quoi que nous en fassions ».
Le Temps et l’Éternité
♦ BIBLIOGRAPHIE ♦
⬨ Ouvrages en français :
• L’Art de l’ornementation (2019) (1)
• L’Art hindou (2024) (2)
• L’Arbre inversé (1984)
• Les arts et métiers de l’Inde et de Ceylan (1924)
• Aspects de l’hindouisme (1988) (3)
• Autorité spirituelle et Pouvoir temporel dans la perspective indienne (1985)
• La Danse de Çiva (1922) (4)
• Deux études sur la Katha Upanisad (2014)
• La Doctrine du sacrifice (1978) (5)
• Essais métaphysiques (2022) (6)
• Hindouisme et Bouddhisme (1949) [recension]
• Une Nouvelle Approche des Vedas (1994) (7)
• Peindre ce qui n’est pas dans les couleurs (2019)
• La Pensée de Gotama, le Bouddha (1949) (8)
• La Philosophie chrétienne et orientale de l’art (1990) (9)
• La Porte du ciel (2008) (10)
• Pour comprendre l’art Hindou (1926) [recension]
• La Sculpture bouddhiste (2021) (11)
• La Sculpture de Bharhut (1956)
• La Sculpture de Bodhgaya (1936)
• La Signification de la Mort (2001) (12)
• Suis-je le gardien de mon frère ? (2003) (13)
• Les Symboles fondamentaux de l’art bouddhiste (2005) [présentation]
• Le Temps et l’Éternité (1976) (14)
• Technique et théorie de la peinture indienne (2015)
• La Théorie médiévale de la Beauté (1997) (15)
• La Transformation de la Nature en art (1994) (16)1. Présentation. Préface. Contient : Ornement / La Concaténation de Leonardo… / Mobilier Shaker / Samvega : le choc esthétique / « Une façon de parler ou une façon de penser ? » / Intention / Imitation, expression et participation / Le symbolisme littéraire.
2. Présentation. Contient : Les buts de l’art indien / Art et Yoga en Inde / L’art indien / L’influence grecque sur l’art indien / Un coffret en ivoire du sud de l’Inde.
3. Contient : Châyâ / L’exemplarisme védique / Nirukta = Hermeneia / Shri Ramakrishna et la tolérance religieuse / La Doctrine Tantrique de la “Bi-Unité” divine / Lîlâ.
4. Contient : L’apport de l’Inde au bonheur de l’humanité / Conception Hindoue de l’Art : Histoire de l’esthétique / Conception hindoue de l’Art : Théorie de la beauté / La beauté est un état de l’âme / Les primitifs bouddhiques / La danse de Çiva / Images indiennes à plusieurs bras / La musique indienne / Position de la femme aux Indes / Sahaja / Fraternité intellectuelle / Nietzsche d’un point de vue cosmopolite / La jeune Inde / Individualité, autonomie et fonction.
5. Recension. Contient : Anges et Titans / La face obscure de l'aurore / Sire Gauvain et le Chevalier vert / L'épouse hideuse / Les magiciens sans tête / Le rapt de la Nâgi / Sarpabandha / Ātmayajña : le sacrifice de soi.
6. Présentation. Préface. Contient : Sur la pertinence de la philosophie / La voie du pèlerin / La doctrine védique du silence / Le Vedānta et la tradition occidentale / Manas / Akimcanna : la négation de soi / Les mesures de feu / Être sain d’esprit / Ars sine scientia nihil / Réminiscence, indienne et platonicienne / Le seul et unique Transmigrant / Les fenêtres de l’âme / Qu’est-ce que la civilisation ? / La naissance de l’Esprit / L’interprétation des symboles.
7. Contient : Brihadaranyaka Upanishad, I, 2 / Fragments de la Maitri Upanishad / Trois hymnes védiques / Appendice : Le mouvement apparent du Soleil.
8. Traduction de : The Living Thoughts of Gotama the Buddha (Cassell, 1948).
9. Contient : Pourquoi exposer des œuvres d’art ? / La philosophie chrétienne et orientale, ou la vraie philosophie de l’art / L’art est-il superstition ou mode de vie ? / En fait, à quoi sert l’art ? / Beauté et vérité / La nature de l’art médiéval / La conception traditionnelle du portrait / La nature du “folklore” et de “l’art populaire” / La beauté des mathématiques.
10. Contient : Introduction : Un temple hindou : le Kandarya Mahadeo. I — La Porte du Soleil : Le symbolisme du Dôme / Svayamātrinnā : Janua Coeli / Ushnishâ et Chatra / Eckstein / “E” à Delphes / Notes sur l'iconographie du coq sur la colonne. II — Symboles de passage : Le Pont périlleux du Bonheur / Symplegades. Appendices : Le Pâli Kannikâ / Le Temple Hindou : un Diagramme du Monde / Sharkara / La construction de l'Autel de Feu.
11. Présentation. Contient : La nature de l’art bouddhiste / La Sculpture de Bharhut / Deux bas-reliefs de Bharhut / À propos de l’image de Bouddha.
12. Contient : Sur la psychologie, ou plutôt la pneumatologie dans l’Inde et dans la Tradition / Qui est “Satan” et où est “l’Enfer” ? / La signification de la mort / “Socrate est vieux” implique-t-il “Socrate est” ? / Mahâ Pûrusha : “Suprême Identité” / Les aspects bhakta de la doctrine de l’Âtman / Le Déluge dans la Tradition hindoue.
13. Recension. Contient : Suis-je le gardien de mon frère ? / L’illusion de l’instruction / Des chemins qui conduisent au même sommet / Sagesse orientale et savoir occidental / Orient et Occident / Paternité spirituelle et “puppet complex” / Gradation, évolution et réincarnation / L’illusion de la démocratie, de la liberté et de l’égalité.
14. Traduction de « Time and Eternity », in : Artibus Asiae, Supplementum, vol. 8, 1947.
15. Contient : Denys l’Aréopagite / Ulrich Engelbert de Pulchro / Saint Thomas d’Aquin « Du divin Beau et comment il est attribué à Dieu » / Commentaire de Coomaraswamy sur le tria requiruntur.
16. Contient : La théorie de l’art en Asie / La vision de l’art chez Maître Eckhart / Les réactions à l’art en Inde / L’esthétique du Šukranītisāra / Paroksha / Abhasa / Origine et utilisation des images en Inde.
***
• nota bene : Les éditions i annonçaient la sortie des Gardiens de la Porte du Soleil (d'après l’édition anglaise de Robert A. Strom, 2004). Mais le triste décès du traducteur Max Dardevet a retardé ce projet. Il est probable que Jean Annestay le reprenne ultérieurement. Sont accessibles les ébauches des chapitres suivants : 1. L’iconographie primitive du Sagittaire - 2. Les gardiens de la Porte du Soleil et le type du Sagittaire - 3. Concernant les Sphinx - 6. Le Sphinx Grec - 7. L’âme immortelle comme psychopompe. Signalons aussi chez cet éditeur la parution récente de : Architecture hindoue et bouddhiste : temps et éternité, Adrian Snodgrass, 2023, complétant Architecture, temps et éternité (2020). L’auteur, préfacier de la Porte du Ciel, prolonge magistralement AKC sur l’art architectural indien (cf. « Indian Architectural Terms », in : JAOS, 1928 et Essays in early indian architecture, 1992).
***
⬨ Articles parus dans Études Traditionnelles :
« Beauté, Lumière et Son » (206, 1937)
« Châyâ » (450, 1975)
« De la mentalité primitive » (236, 1939)
« Du prétendu panthéisme dans l’Inde et dans le Néo-Platonisme » (226, 1938)
« Eckstein » (441, 1974)
« Gradation, évolution, réincarnation » (263, 1947)
« Khwajâ Khadir et la Fontaine de Vie » (224, 1938)
« L’exemplarisme védique » (452-453, 1976)
« L’idée de création éternelle dans le Rig Vêda » (193, 1936)
« L’ordination bouddhique est-elle une initiation » (235, 1939)
« La Doctrine Tantrique de la “Bi-Unité” divine » (212, 1931)
« La nature du Folklore et de l’Art populaire » (210, 1937)
« La Vierge allaitant Saint Bernard » (216, 1937)
« La Voie lactée » (221, 1938)
« Le Baiser du Soleil » (253 & 254, 1946) [partie 1 / partie 2]
« Le Bouddhisme originel » (233, 1939)
« Le mythe du Bouddha » (259, 1947)
« Le symbolisme de l’épée » (217, 1938)
« Le symbolisme du tir à l’arc » (247 & 248, 1945)
« Lîlâ » (447, 1975)
« “Mahâtmâ” » (231, 1939)
« Nirukta = Hermeneia » (203, 1936 & 206, 1937)
« Nirvâna, Nibbâna » (244, 1940)
« “Paternité spirituelle” et “Puppet complex” » (443-444, 1974)
« Pourquoi exposer des œuvres d’art » (296, 1951)
« Sagesse orientale et savoir occidental » (293-295, 1951)
« Shri Ramakrishna et la tolérance religieuse » (199, 1936)
« Un temple indien : le Kandarya Mahadeo » (518, 1992)
« Une étude sur la Katha Upanishad » (456-457, 1977)***
⬨ Articles parus dans Être, approches de la non-dualité :
« Le Védanta et la tradition occidentale » (1 à 4/1976)
« L’art asiatique » (2/1982)• nota bene : articles insérés à notre dossier.
***
⬨ Articles parus dans La Règle d’Abraham :
« Khwaja Khadir et la fontaine de vie dans la tradition des arts persan et mongol » (03, 1997)
« Ornement » (07, 1999) (1)
« L’iconographie des nœuds de Dürer et de la "concaténation" de Léonardo » (10, 2000)
« La doctrine védique du Silence » (12, 2001)
« Sur le seul et unique transmigrant » (19, 2005)1. — Dans The Art Bulletin (1939), M. AKC a fait paraître un article intitulé Ornament, dans lequel il montre que « la préoccupation moderne des aspects “décoratif” et “esthétique” représente une aberration qui n’a rien de commun avec les buts originels de l’art ». Si l’on considère l’histoire des différents mots qui ont été employés pour exprimer l’idée d’une ornementation ou d’une décoration, on trouve que la plupart d’entre eux ont désigné tout d’abord, non pas quelque chose de surajouté ou de superflu, mais l’achèvement même de l’objet en vue de son usage propre ; tel est le cas des termes sanscrits alamkâra, bhûshana et âbharana, des termes grecs dérivés de kosmos, et aussi des termes latins decor et ornamentum, qui gardaient encore leur sens premier au moyen âge. Aucun art traditionnel ne peut être compris sans une connaissance de sa véritable signification, et en réalité, qu’il s’agisse de l’ensemble ou des détails, rien n’y est dépourvu de signification ; vouloir en faire l’objet d’une simple appréciation esthétique, c’est se condamner à ignorer complètement ce qui fait toute sa raison d’être (R. Guénon, 1945-1946).
***
⬨ Articles parus dans Vers la Tradition :
« Jeu et sérieux » (82, 2000) (1)
« La mer » (85, 2001) (2)
« Symptôme, diagnostic et remède » (113, 2008) (3)
« “Monothéisme” védique » (117, 2009) (4)
« Notes sur la Katha Upanishad (132, 2013)
« Une étude sur la Katha Upanishad (IV,1) » (133, 2013)
« Les origines de l’iconographie du Sagittaire » (143 & 145, 2016)
« Le concept d’Éther chez Philon d’Alexandrie » (152, 2018)
« Les Chérubins selon Philon d’Alexandrie » (159, 2020)
« Le Sphinx grec » (163, 2021)
« Deux hymnes védantiques extraits de la Siddhantamuktavali » (167, 2022) (5)
« Le chemin du pèlerin » (170, 2022)1. Trad. de « Play and Seriousness », in : The Journal of Philosophy n°20, 1942.
2. Trad. de « The Sea », in : India Antiqua : Essays in honor of JP Vogel, Brill, 1947.
3. Trad. de « Symptom, Diagnosis, and Regimen », College Art Journal n°4/1943. — Dans le College Art Journal (n° de mai 1943), un article du même auteur, intitulé : Symptom Diagnosis, and Regimen précise le caractère anormal de la conception moderne de l’art : on en est arrivé à penser que l’art, au lieu d’« imiter la nature dans ses opérations », doit simplement imiter ou copier les choses sensibles qui nous entourent, et aussi notre propre individualité ; d’autre part, on a séparé entièrement la question de l’usage d’une œuvre d’art, de celle de sa signification. Le seul remède à cette situation serait un changement radical dans les méthodes d’interprétation de l’art employées par les critiques et les historiens : il faudrait renoncer au point de vue “esthétique”, qui, comme le mot lui-même l’indique, ne relève que de la sensibilité, et aussi à l’analyse psychologique qui ne cherche dans une œuvre que l’expression de l’individualité de l’artiste, ce qui est sans aucun intérêt pour sa véritable compréhension (R. Guénon, 1945-1946).
4. Article inséré dans notre dossier.
5. Trad. de : « Two Vedântic Hymns from the Siddhântamuktâvali », Bulletin of the School of Oriental Studies n°1/1935. Le traducteur P. Griffiths a ajouté un appareil critique. Autre traduction dans : Technique et théorie de la peinture indienne, 2015.• nota bene : Vers la Tradition est une revue associative dévolue aux études traditionnelles, diffusée uniquement par abonnement. Pour apprécier la diversité intellectuelle des sujets, on pourra consulter et télécharger quelques anciens numéros sur archive.org.
***
⬨ Articles parus dans les Cahiers de l’Unité :
« L’Unique et Seul Transmigrant » (18, 2020) (1)
« Réminiscence, indienne et platonicienne » (19, 2020)
« L’interprétation des symboles » (20, 2020) (2)
« Ars sine scientia nihil » (21, 2021)
« Manas » (22, 2021) (3)
« Remarques sur l’Hymne à l’Homme Universel (1) » (23, 2021)
« Remarques sur l’Hymne à l’Homme Universel (2) » (24, 2021)
« Le Ṛgveda comme Land-Náma-Bók (1) » (25, 2022)
« Le Ṛgveda comme Land-Náma-Bók (2) » (26, 2022) (4)
« Le culte de la Vie : Que sont les Eaux ? » (27, 2022) (5)
« Une note sur l’Aśvamedha » (28, 2022)1. Pour AKC, c’est le Soi transpersonnel et lui seul qui transmigre. Voir éditorial et le commentaire « L'erreur réincarnationniste » (M. Dardevet) et Lettre du 21 mai 1942 : « S’il existe en Inde une doctrine de la transmigration (dans le sens du passage des états d’être à d’autres états d’être), la réincarnation (au sens du retour des individus à une incarnation sur terre) n’est pas une doctrine hindoue. La doctrine hindoue est, selon les mots de Shankaracharya, que : “Il n’y a pas d’autre transmigrant (samsarin) que le Seigneur”. Que ceci soit l’enseignement des Upanishads et des textes plus anciens pourrait être amplement soutenu par de nombreuses citations, et découle directement de la position que nos puissances ne sont “que les noms illusoires de Ses actes”, qui est “le seul voyant, auditeur, penseur, etc., en nous”, et du point de vue commun à l’Hindouisme et au Bouddhisme que c’est la plus grande de toutes les illusions de considérer “je suis celui qui agit”. Dans les naissances et les morts successives, c’est Brahma, et non le “moi” qui va et vient ». Sur ce sujet : R. Deliège, « Les hindous croient-ils en la réincarnation ? », L'Année sociologique n°1/2000 (présentation). Et aussi : « Renaître dans les autres mondes », R. Fabbri, Connaissance des religions n°71-72, 2004 ; B.A.-B.A de la réincarnation, Gérard Chauvin, Pardès, 1999.
2. Extrait : Symboles.
3. Voir présentation.
4. Recension.
5. Voir présentation.***
⬨ Articles d’AKC sur l’art :
« The Love of Art », in : Parnassus n°4/1936
« The normal view of Art », conférence, 1936 (1)
« An Approach to Indian Art », in : Parnassus n°7/1935
« Understanding the Art of India », in : Parnassus n°4/1934
« Hindu Theatre », in : The Indian Historical Quaterly vol. 9, 1933
« What is the Use of Art anyway ? », in : The American Review n°3/1937 (2)
« Is Art a superstition or a way of life ? », in : The American Review n°4/1937 (3)
« Notes sur la sculpture bouddhique », in : Revue des arts asiatiques n°4, 1928
« Samvega : “Aesthetic Shock” », in : Harvard Journal of Asiatic Studies n°3/1943 (4)
« The Influence of Greek on Indian Art », in : Studies in Comparative Religion n°1/1974 (5)
« The Intellectual Operation in Indian Art », in : Journal of the Indian Society of Oriental Art n°1/1935 (6) 1. Parue dans le fascicule Patron and Artist, Pre-Renaissance and Modern (AKC & G. Carey, Wheaton College Press, Norton [Massachusetts], 1936). Recension : — Ce livre est la réunion de deux conférences, dans la première desquelles M. AKC expose The normal view of Art, c’est-à-dire la conception traditionnelle, telle qu’elle exista jusqu’à la Renaissance, en tant qu’elle s’oppose à la conception anormale des modernes. Suivant la vue traditionnelle, l’art implique essentiellement une connaissance, loin d’être simplement affaire de sentiment l’œuvre d’art ne peut être vraiment “belle” que si elle est adaptée à l’usage auquel elle est destinée, et, quelle qu’elle soit d’ailleurs, c’est seulement à cette condition qu’elle peut atteindre la perfection dans son ordre ; et l’artiste ne doit point chercher à être “original”, mais à être “vrai”. Nous citerons, comme tout spécialement intéressant à notre point de vue, ce passage concernant les initiations de métier : « L’objet de toutes les initiations est, par la transmission d’une impulsion spirituelle, de stimuler dans l’individu le développement de ses propres possibilités latentes. L’enseignement initiatique rattache l’activité caractéristique de l’individu, manifestée extérieurement dans sa vocation, à un ordre universel, intérieurement intelligible ; l’artisan initié travaille, non plus simplement à la surface des choses, mais en accord conscient avec un modèle cosmique qu’il s’attache à réaliser. Un tel enseignement s’appuie sur la vocation et en même temps réagit sur elle, lui donnant une signification plus profonde que celle qui peut s’attacher au simple talent ; la vocation devient le type d’une activité ayant des prolongements et des correspondances dans tous les domaines, non seulement matériels, mais aussi intellectuels, et même en Dieu, qui, en tant que Son acte est conçu comme une création per artem, est l’exemplaire de tout ouvrier humain. De cette façon, la tradition affirme que les œuvres d’art sont des imitations, non pas d’autres choses, mais de formes conçues dans l’esprit de l’artiste et qui, à leur tour, doivent être, dans la mesure où ses pouvoirs le permettent, à la ressemblance des raisons éternelles ». — Le sujet de la conférence de M. Graham Carey est Liberty and Discipline in the four artistic essentials ; ces quatre choses essentielles sont le but que se propose l’activité artistique, la matière sur laquelle elle s’exerce, les outils ou instruments qu’elle emploie, et enfin l’idée ou l’image à laquelle elle se conforme (on peut remarquer que ceci correspond aux quatre “causes” d’Aristote), La thèse de l’auteur est que, suivant la conception traditionnelle, l’artiste était soumis à des règles strictes quant aux trois premiers points, mais libre à l’égard du quatrième, tandis que, en ce qui concerne l’art moderne, la situation a été exactement renversée. Il examine en détail quelques tentatives qui lui paraissent susceptibles de favoriser un retour à l’ordre normal ; et, en terminant, il insiste sur le fait que l’intention artistique, procédant du désir de donner, est à l’opposé de l’intention commerciale, qui procède du désir d’acquérir, si bien que toute “commercialisation” est contraire à l’esprit même de l’art. (RG, 1936).
1. Parue dans le fascicule Patron and Artist, Pre-Renaissance and Modern (AKC & G. Carey, Wheaton College Press, Norton [Massachusetts], 1936). Recension : — Ce livre est la réunion de deux conférences, dans la première desquelles M. AKC expose The normal view of Art, c’est-à-dire la conception traditionnelle, telle qu’elle exista jusqu’à la Renaissance, en tant qu’elle s’oppose à la conception anormale des modernes. Suivant la vue traditionnelle, l’art implique essentiellement une connaissance, loin d’être simplement affaire de sentiment l’œuvre d’art ne peut être vraiment “belle” que si elle est adaptée à l’usage auquel elle est destinée, et, quelle qu’elle soit d’ailleurs, c’est seulement à cette condition qu’elle peut atteindre la perfection dans son ordre ; et l’artiste ne doit point chercher à être “original”, mais à être “vrai”. Nous citerons, comme tout spécialement intéressant à notre point de vue, ce passage concernant les initiations de métier : « L’objet de toutes les initiations est, par la transmission d’une impulsion spirituelle, de stimuler dans l’individu le développement de ses propres possibilités latentes. L’enseignement initiatique rattache l’activité caractéristique de l’individu, manifestée extérieurement dans sa vocation, à un ordre universel, intérieurement intelligible ; l’artisan initié travaille, non plus simplement à la surface des choses, mais en accord conscient avec un modèle cosmique qu’il s’attache à réaliser. Un tel enseignement s’appuie sur la vocation et en même temps réagit sur elle, lui donnant une signification plus profonde que celle qui peut s’attacher au simple talent ; la vocation devient le type d’une activité ayant des prolongements et des correspondances dans tous les domaines, non seulement matériels, mais aussi intellectuels, et même en Dieu, qui, en tant que Son acte est conçu comme une création per artem, est l’exemplaire de tout ouvrier humain. De cette façon, la tradition affirme que les œuvres d’art sont des imitations, non pas d’autres choses, mais de formes conçues dans l’esprit de l’artiste et qui, à leur tour, doivent être, dans la mesure où ses pouvoirs le permettent, à la ressemblance des raisons éternelles ». — Le sujet de la conférence de M. Graham Carey est Liberty and Discipline in the four artistic essentials ; ces quatre choses essentielles sont le but que se propose l’activité artistique, la matière sur laquelle elle s’exerce, les outils ou instruments qu’elle emploie, et enfin l’idée ou l’image à laquelle elle se conforme (on peut remarquer que ceci correspond aux quatre “causes” d’Aristote), La thèse de l’auteur est que, suivant la conception traditionnelle, l’artiste était soumis à des règles strictes quant aux trois premiers points, mais libre à l’égard du quatrième, tandis que, en ce qui concerne l’art moderne, la situation a été exactement renversée. Il examine en détail quelques tentatives qui lui paraissent susceptibles de favoriser un retour à l’ordre normal ; et, en terminant, il insiste sur le fait que l’intention artistique, procédant du désir de donner, est à l’opposé de l’intention commerciale, qui procède du désir d’acquérir, si bien que toute “commercialisation” est contraire à l’esprit même de l’art. (RG, 1936). Lire aussi les autres recensions consacrées à G. Carey dont certains travaux ont été réunis dans le recueil Real Beauty and Right Making : catholic essays on sacred art, 2017. Le préfacier, John Carey, souligne les liens étroits entre GC, AKC & Eric Gill, ces deux derniers étant fortement influencés par Art et scolastique [recension] du néo-thomiste Jacques Maritain (1920, que Gill traduira en 1923). Tout comme Ruskin ou Morris, tous trois ne séparaient pas considérations esthétiques et préoccupations sociales, portant attention à la recherche d'un mode de vie apportant véritablement sens et satisfaction à l’existence terrestre. La dévastation causée par la Grande Dépression incita Carey à se rapprocher du mouvement ouvrier catholique et à fonder en 1942 avec sa ferme dans le Vermont la base d'une communauté auto-suffisante d’artisans (qui n’aura pas l’ampleur espérée). Dans les années 50, il bâtit à Benson l'église Christ Sun of Justice selon ses conceptions du symbolisme architectural. Il y est enterré non loin, avec comme épitaphe ce vers virgilien : Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
2. Traduction : « En fait, à quoi sert l'art ? » [extrait], in : La Philosophie…, 1990. Recension : — Dans l’American Review, M. AKC publie un article sur The Use of Art, dans lequel il s’élève contre les théories “esthétiques” modernes, et spécialement contre la conception de “l’art pour l’art” ; il y oppose la vue normale suivant laquelle l’art est “la façon juste de faire les choses”, quelles qu’elles soient, de telle sorte qu’elles soient adaptées aussi parfaitement que possible à l’usage auquel elles sont destinées. La distinction toute moderne entre “l’artiste” et “l’artisan” n’a, selon cette vue normale, aucune raison d’être ; et l’industrie séparée de l’art, comme elle l’est de nos jours, apparaît comme une activité illégitime et ne méritant même pas d’être considérée comme véritablement “humaine”. (RG, 1937)
3. Traduction : « L’art est-il superstition ou mode de vie ? », in : La Philosophie…, 1990. Recension : — L’American Review publie un important article de M. AKC, intitulé Is Art a superstition or a way of life ? L’auteur s’élève contre la conception “esthétique” propre aux modernes, d’après laquelle une œuvre d’art doit être seulement “sentie” (c’est ce qu’indique le sens même du mot “esthétique”) et non pas “comprise”, et n’a d’autre but que de procurer un certain plaisir spécial, ce qui en fait un simple objet de luxe, sans signification réelle et sans utilité vitale. De là résulte l’existence d’une industrie entièrement séparée de l’art, réduite à une activité purement mécanique, et dans les produits de laquelle la qualité est sacrifié à la quantité ; de là aussi, d’autre part, l’idée erronée que les choses ont toujours été ainsi, que les artistes ont toujours formé une catégorie spéciale d’hommes, dont le travail n’avait rien à voir avec la fabrication des choses nécessaires à l’existence, alors que la vérité est, au contraire, que la distinction entre “artiste” et “artisan” est toute récente et opposée à la vue “normale” et traditionnelle selon laquelle l’art est inséparable du métier, quel que soit d’ailleurs celui-ci. Là où cette vue “normale” existe et où chacun suit sa “vocation” propre, c’est-à-dire exerce le genre d’activité qui correspond le mieux à ses aptitudes naturelles, « il n’y a aucune nécessité d’expliquer la nature de l’art en général, mais seulement de communiquer une connaissance, des arts particuliers à ceux qui doivent les pratiquer, connaissance qui est régulièrement transmise de maître à apprenti, sans que le besoin “d’écoles d’art” se fasse aucunement sentir ». En outre, dans une société traditionnelle, il n’y a rien qui puisse être proprement appelé “profane” ; aussi tout ce qui n’est considéré aujourd’hui que comme “ornementation” ou “décoration” a-t-il toujours une signification précise ; l’opération de l’artiste n’en est pas moins libre, non pas certes en tant qu’il invente les idées à exprimer, mais en tant que, les ayant faites siennes par assimilation, il les traduit d’une façon conforme à sa propre nature. L’art traditionnel est essentiellement symbolique, et c’est de là qu’il tire sa valeur spirituelle ; les symboles ne sont point affaire de convention, mais constituent un langage aussi précis que celui des mathématiques, et, « lorsqu’ils sont correctement employés, ils transmettent de génération en génération une connaissance des analogies cosmiques » ; c’est pourquoi « les arts ont été universellement rapportés à une source divine, la pratique d’un art était au moins autant un rite qu’une occupation commerciale, l’artisan devait toujours être initié aux “petits mystères” de son métier, et son œuvre avait toujours une double valeur, celle d’un outil d’une part et celle d’un symbole de l’autre ». Dans les conditions actuelles où il ne subsiste plus rien de tout cela, l’art, ayant perdu sa raison d’être tant au point de vue de l’utilité pratique qu’à celui de la connaissance et de la spiritualité, et ne servant donc plus réellement ni à la vie active ni à la vie contemplative, n’est proprement qu’une “superstition” au sens étymologique de ce mot. (RG, 1937)
4. Texte repris dans The Essential AK Coomaraswamy, 2004. Trad. fr. in : L'art de l'ornementation, 2019.
 5. Traduction : « L’influence de l’art grec sur l’art indien », in : L’art hindou, 2024. Le texte fit polémique car relativisant cette influence. Michael Falser dans un article de 2015 résume : « En conclusion, Coomaraswamy a tenté de provincialiser le style gréco-bouddhique du Gandhara, tenu pour une école régionale mineure et a défendu, sur un mode tout aussi essentialiste (on serait tenté de considérer là un '“orientalisme à l'envers”), l'existence d'une identité culturelle spécifiquement “indienne”, enracinée dans une civilisation séculaire et continue. Dans son court article intitulé “The Influence of Greek on Indian Art” (1908), il affirmait déjà qu'il existait un certain préjugé [qui] a conduit les chercheurs européens à considérer la Grèce classique comme la source naturelle de tout art, tout au moins à supposer que l'influence de l'art classique fût aussi importante et permanente en Orient qu'en Occident. Il affirme au contraire que l'art “gréco-romain tardif”, dans sa phase décadente, n'a finalement été ni très profond ni très important. (…) La question de la valeur de l'art du Gandhara ne pouvait être résolu, selon Coomaraswamy, que par des considérations religieuses et philosophiques, et non par de simples découvertes archéologiques dans la pierre. Il oppose l'aspect olympien de la religion grecque, avec ses dieux [comme] des hommes grands et beaux, à l'art indien [comme] essentiellement transcendantal et non concerné par la représentation d'hommes parfaits, mais par la suggestion de la Divinité (…) au-delà de l'apparence. En conséquence, Coomaraswamy qualifie la première phase de l'art indien d’éphémère, voire de totalement aniconique, avec des images introuvables, disparues depuis longtemps, de divinités en bois, en brique et en argile ».
5. Traduction : « L’influence de l’art grec sur l’art indien », in : L’art hindou, 2024. Le texte fit polémique car relativisant cette influence. Michael Falser dans un article de 2015 résume : « En conclusion, Coomaraswamy a tenté de provincialiser le style gréco-bouddhique du Gandhara, tenu pour une école régionale mineure et a défendu, sur un mode tout aussi essentialiste (on serait tenté de considérer là un '“orientalisme à l'envers”), l'existence d'une identité culturelle spécifiquement “indienne”, enracinée dans une civilisation séculaire et continue. Dans son court article intitulé “The Influence of Greek on Indian Art” (1908), il affirmait déjà qu'il existait un certain préjugé [qui] a conduit les chercheurs européens à considérer la Grèce classique comme la source naturelle de tout art, tout au moins à supposer que l'influence de l'art classique fût aussi importante et permanente en Orient qu'en Occident. Il affirme au contraire que l'art “gréco-romain tardif”, dans sa phase décadente, n'a finalement été ni très profond ni très important. (…) La question de la valeur de l'art du Gandhara ne pouvait être résolu, selon Coomaraswamy, que par des considérations religieuses et philosophiques, et non par de simples découvertes archéologiques dans la pierre. Il oppose l'aspect olympien de la religion grecque, avec ses dieux [comme] des hommes grands et beaux, à l'art indien [comme] essentiellement transcendantal et non concerné par la représentation d'hommes parfaits, mais par la suggestion de la Divinité (…) au-delà de l'apparence. En conséquence, Coomaraswamy qualifie la première phase de l'art indien d’éphémère, voire de totalement aniconique, avec des images introuvables, disparues depuis longtemps, de divinités en bois, en brique et en argile ».6. Texte repris dans le recueil Fundamentals of Indian art, 1985.
***
⬨ Autres articles d’AKC :
« L’Agôn héraclitéen » (1941)
« The deeper meaning of the struggle » (1907)
« The Meeting of Eyes » The Art Quarterly n°4/1943 (1)
« Two Passages in Dante’s Paradiso », in : Speculum n°3/1936 (2)
« Le “chant d'abeille” de Sur Das », in : L'Inde et son âme, 1928
« The Tree of Jesse and indian parallels or sources », in : The Art Bulletin n°2/1929 (3)
« Athena and Hephaistos », in : Journal of the Indian Society of Oriental Art XV, 1947
« On Hares and Dreams », in : The Quarterly Journal of the Mythic Society, XXXVII, 1946
« Fate, Foresight, and Free-will », in : Studies in Comparative Religion n°3-4/1979 [commentaire]
1. Trad. : « La rencontre des yeux » (MD 2021)
2. Trad. : « Deux passages du Paradis de Dante » (MD 2021)
3. Traduction : « L’Arbre de Jessé et les parallèles ou sources Indiennes » (MD, 2018)⬨ Articles indianistes d’AKC :
« On Translation : Māyā, Deva, Tapas », in : Isis n°55, 1933 (1)
« The Vedic Doctrine of 'Silence' », in : Indian Culture n°4/1937 (2)
« Prana-citi », in : Journal of the Royal Asiatic Society n°1/1943
« The “Four Causes” in the Bhagavad Gita », in : JAOS n°4/1937
« The Origin of the Buddha Image », in : The Art Bulletin n°4/1927 (3)
« Unatiriktau and Atyaricyata », in : New Indian Antiquary n°3/1943 (4)
« Maha-Pralaya and Last Judgement », in : The Cultural World n°4/1932 (5)
« An Indian Temple : The Kandarya Mahadeo », in : Art in America n°4/1947 (6)
« The flood in Hindu tradition », in : Studies in Comparative Religion n°4/1973
« Renaissance of Indian Culture », in : Journal of the Indian Society of the Oriental Art, XV, 19471. Traduction.
2. Traduction.
3. Réédition : Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1972.
4. — Dans le New Indian Antiquary également (n° de juin 1943), le même auteur, dans un article sur Unâtiriktan and Atyarichyata, montre, par l’étude du sens de ces termes et de l’emploi qui en est fait dans les textes vêdiques, que Prajâpati, comme Producteur et Régent des êtres manifestés, doit être regardé comme « une syzygie de principes conjoints, masculin et féminin », qui sont représentés symboliquement comme un “plein” et un “vide”, et qui sont aussi mis en correspondance avec le Soleil et la Lune. Ceci est en rapport, notamment, avec le symbolisme du “vaisseau plein” ou du “vase d’abondance”, dont le Graal est une des formes, et dont le caractère “solaire” est plus particulièrement manifeste dans le rituel hindou. (RG)
5. Traduction. Paru aussi dans Indian Historical Quarterly IX, 1933 et dans Blackfriars n°159, 1933.
6. Traduction : « Image de l’homme et du monde », Aurores n°45, 1984. Et dans le recueil La porte du ciel, 2018.***
⬨ Ouvrages d’AKC sur l’Inde :
Vidyāpati (1915)
Viśvakarma (1914)
Art & Swadeshi (1910) (1)
The Indian craftsman (1909)
The mirror of gesture (1917) [recension] [étude]
Perception of the Vedas (2000)
Essays in National Idealism (1909)
A New Approach to the Vedas (1933)
The Rig-Veda as Land-Náma-Bók (1935)
Myths of the Hindus & Buddhists (1913)
Elements of Buddhist iconography (1935)
History of Indian and Indonesian art (1927)
Buddha and the gospel of Buddhism (1916)
The Arts & Crafts of India and Ceylon (1913)
The Buddha's cuda, hair, usnisa, and crown (1920)1. Dans une recension, Ezra Pound note : « Even without the chapters on poetry the book is so full of profound and natural sense on matters of art industry and education that anyone who reads it will be grateful for this suggestion » (Poetry n°6, 1913). Ce recueil (cf. compte-rendu dans Fifty key texts in art history, 2012) forme un pont entre la pensée sur l'identité nationale et la théorie esthétique en s'enquérant du caractère national de l'art indien. Coomaraswamy était une figure active du mouvement indépendantiste swadeshi. Le terme de swadeshi (en sanscrit, le préfixe “sva” signifie “propre” et “desh” signifiant “pays”) renvoie aux notions de compter sur ses propres ressources et de produire localement. Le concept de swadeshi (auto-suffisance) s’inscrivit dans le discours politique en 1905 (partition du Bengale) avec l’appel au boycott des produits étrangers. Dans cet essai, AKC déplore la perte de beauté de l'artisanat indien due au mercantilisme occidental. Il soutient que la perte de la compréhension artistique a ruiné les industries indiennes et empêché la possibilité de leur renouveau, et que les initiatives swadeshi doivent être un idéal religieux et artistique au lieu de quelque chose de plus qu'une arme politique.
[Pour une rapide présentation des thèmes de figures bengalies (Aurobindo, Tagore, etc) : Indian Philosophy in english : From Renaissance to Independence, Oxford Univ. Press, 2011. Lire aussi « The Doctrine of Swadeshi Art : Art & Nationalism in Bengal », Partha Mitter, in : Visva-Bharati Quarterly n°1-4/1983-1984 ; ainsi que « Nationalism and Painting in Colonial Bengal », Jasmin Cohen, 2012]
Par la suite, lors du combat pour l’indépendance, le mouvement swadeshi appela à l’émancipation économique vis-à-vis de la puissance coloniale. Après l'indépendance (1950), il traduisit l’expression d’un nationalisme économique pointilleux dont l’une des déclinaisons fut le “Be Indian, buy Indian”, ou encore le “India shall be built by Indians” du Bharatya Janata Party. À partir des années 90, en prenant ostensiblement le virage de la libéralisation économique, qui se traduisit par une plus grande ouverture au commerce international et aux mouvements de capitaux étrangers, l’Inde met à rude épreuve ce principe autarcique du développement intérieur, cf. De la mondialisation au développement local en Inde, CNRS, 2021, chap. 1.
Si des historiens d’art n’ont pas manqué de rapprocher mouvement swadeshi et celui Arts & Crafts (Arts et artisanats), lire à ce sujet « Postindustrialism and the Long Arts & Crafts Movement : between Britain, India, and the USA » (Sria Chatterjee, 2020), des théoriciens de l'art comme Peter Riley y trouvent une veine inspiratrice pour l’auto-gestion :
« Traditionalism certainly has links with some aspects of anarchism. Partly this was the result of personal journeys. For example, Alan Antliff in his fine study of anarchism and aesthetics devotes much space to the ‘arts and crafts’ anarchism of Ananda Coomaraswamy [in Anarchist Modernism : Art, Politics, and the First American Avant-Garde, 2001]. But, as the historian of Traditionalism, Mark Sedgwick, points out, by the 1920s he had moved to become a leading Traditionalist writer (*). Modern anarchism has also taken up Traditionalist discourses. Arthur Versluis and Mark Sedgwick have also commented on its influences on the work of Peter Lamborn Wilson (Hakim Bey), whilst the anarcho-primitivist Fredy Perlman pays direct tribute to one of the leading Traditionalist writers, Mircea Eliade. Certainly, Perlman’s book is a striking evocation of the idea of inversion » (Making another world possible : Anarchism, Anti-Capitalism and Ecology in late 19th and early 20th Century Britain, 2013).
Rappelons le projet non abouti de livre associant AKC et Arthur J. Penty : Essays in Post Industrialism : A Symposium of prophecy concerning the future of society (circa 1914), consultable dans les archives de l’université de Princeton. Il est évoqué dans : The Post-Modern and the Post-Industrial : A critical analysis, Margaret Rose, 1991 [recension].
* : Cf. Against the Modern World : Traditionalism and the secret intellectual history of the XXth century (2004) [recension]. On pourra aussi consulter sa courte notice biographique d’AKC dans le recueil Occult Roots of Religious Studies : On the influence of non-hegemonic currents on Academia around 1900, 2021, p. 243.
***
« In Memoriam : AKC », M. Fowler, Artibus Asiae n°3/1947
« AKC : A short critical survey », G. Marchiano [✞ 2024], in : JCLA n°1-2/1993
« The Philosophia Perennis », G. Heard, in : Vedanta for the Western World, 1948
« AKC : From geology to philosophia perennis », R. Sorkhabi, in : Current Science n°3/2008
« A man of our time : A. Coomaraswamy », P. Mitter, Asian Studies Association of Australia n°3/1984
« AKC : A Study of his life and works », O. Gangoly, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Inst. n°1-2/1947
« AKC : A Call for Metanoia », B. Pandey, in : SHSS n°2/2022 (et : Dialogue n°3/2016)
The Only Tradition, William Quinn, 1997
« AC, Scholar and Dharma-Warrior » [pdf / html], Harry Oldmeadow, in : Journeys East, 2004 [trad. fr. : Vers l’Orient, Hozhoni, 2018, recension]. Une version précédente se trouve au chapitre 3 de : Traditionalism : Religion in the light of the perennial philosophy, 2000.⬨ Bibliographies :
« A Working Bibliography » (Rama P. Coomaraswamy, 1975)
« The Writings of AK Coomaraswamy » (R. Ettinghausen, Ars Islamica vol. 9, 1942)⬨ Articles critiques :
« Coomaraswamy et la catastrophe occidentale » (N. Bonnal, 2020)
« The Traces of the Bhagavad Gita in the Perennial Philosophy » (M. Widigdo, 2020)
« La rectification métaphysique de l’identité selon Coomaraswamy » (P. Ducay, 2022)
« Polemics of Decolonisation : The Art Criticism of Sri Aurobindo & AC », (S. Mohanty, 2013)
« John Tavener, AKC, le musicien et le métaphysicien », T. Jolif, in : Contrelittérature n°9, 2002
« Le thème de la danse cosmique entre mysticisme physique, hindouisme, New Age et vitalisme nietzschéen » (R. Rousseleau, in : Mises en scène de l'humain, Beauchesne, 2014)⬨ Billets de Max Dardevet sur AKC :
« In illo tempore »
« Art sacré et Symboles »
« Les Gardiens de la Porte »
« Métaphysique du Silence »
« Il y a deux “soi” en nous » (1)
« “L’œil intérieur” de Morris Graves »
« Un métaphysicien pour notre époque »
« Éléments pour une métaphysique traditionnelle »
« Les pèlerins de la Providence »
1. Cf. « The Two Selves : AKC as man & metaphysician », R. Lipsey, 1972 et « Seeing with Two Eyes », P. Samsel, 2007.• nota bene : lire aussi « in memoriam Max Dardevet (1949-2022) » (Julien Arland [pseud. Cyrille Gayat], 2022)
⬨ Autres :
Recensions de René Guénon (1935-1950)
Correspondance AKC - Guénon (1935-1947)
Art and Thought (volume-hommage à AKC, 1947) [recension]
Supplément (au recueil A. Coomaraswamy, the bridge builder, S. Durai Raja Singam, 1977) [recension]⬨ Vidéos :
AKC : The Neglected Genius of the 20th Century (I. Moeinian, 2023)
Traditional psychology vs modern psychotherapy (I. Moeinian, 2023)***
 ⬨ Notes sur Essais métaphysiques
⬨ Notes sur Essais métaphysiquesRecensions de René Guénon pour la revue Études Traditionnelles.
• Ars sine scientia nihil
— Dans le Catholic Art Quarterly (1943), M. Coomaraswamy rapproche la maxime des constructeurs du moyen âge, Ars sine scientia nihil, de l’affirmation de Guy d’Arezzo, Non verum cantorem facit ars, sed documentum [ce n'est pas seulement l’art qui fait le vrai “chanteur” mais aussi le thème, in : Regulae Rythmicae], ainsi que de la façon dont Dante parle de la doctrine cachée dans ses vers ; et il rappelle à ce propos les conceptions de Platon et de saint Augustin sur le caractère essentiellement intellectuel de la véritable “inspiration” considérée comme nécessaire dans toute vue traditionnelle et normale de l’art.
• Réminiscence, indienne et platonicienne
Source : « Recollection, Indian and Platonic », in : Journal Of The American Oriental Society n°3/1944.
— Le Journal of the American Oriental Society (supplément au n° d’avril-juin 1944) a publié deux études de M. Coomaraswamy, dont la première est intitulée : Recollection, Indian and Platonic ; il s’agit de la “réminiscence” platonicienne et de son équivalent dans les traditions hindoue et bouddhique. Cette doctrine, suivant laquelle ce que nous appelons “apprendre” est en réalité “se souvenir”, implique que notre “connaissance” n’est que par participation à l’omniscience d’un principe spirituel immanent, de même que le beau est tel par participation à la Beauté, et que tout être est une participation à l’Être pur. Cette omniscience est corrélative de l’omniprésence intemporelle ; il ne saurait donc être question d’une “prescience” du futur comme tel, par laquelle notre destinée serait décrétée arbitrairement, et c’est de cette fausse conception que proviennent toutes les confusions à ce sujet. Il n’y a là pas plus de connaissance du futur que du passé, mais seulement celle d’un “maintenant” ; l’expérience de la durée est incompatible avec l’omniscience, et c’est pourquoi le “moi” empirique est incapable de celle-ci. D’autre part, dans la mesure où nous sommes capables de nous identifier avec le “Soi” omniscient, nous nous élevons au-dessus des enchaînements d’événements qui constituent la destinée ; ainsi cette même doctrine de la connaissance par participation est inséparablement liée à la possibilité de la libération des couples d’opposés, dont le passé et le futur, “l’ici” et le “là” ne sont que des cas particuliers. Comme l’a dit Nicolas de Cusa, « le mur du Paradis où Dieu réside est fait de ces contraires, entre lesquels passe la voie étroite qui en permet l’accès » ; en d’autres termes, notre voie passe à travers le “maintenant” et le “nulle part” dont aucune expérience empirique n’est possible, mais le fait de la “réminiscence” nous assure que la Voie est ouverte aux compréhenseurs de la Vérité.
• Le seul et unique Transmigrant
— La seconde étude, On the One and Only Transmigrant, est en quelque sorte une explication de la parole de Shankarâchârya suivant laquelle « il n’y a véritablement pas d’autre transmigrant (samsârî) qu’Ishwara ». Le processus de l’existence contingente ou du devenir, dans quelque monde que ce soit, est une “réitération de mort et de naissance” ; la Délivrance (Moksha) est proprement la libération de ce devenir. Dans la doctrine traditionnelle, il n’est aucunement question de “réincarnation”, à moins qu’on ne veuille entendre simplement par là la transmission des éléments du “moi” individuel et temporel du père à ses descendants. La transmigration est tout autre chose : quand un être meurt, le “Soi”, qui est d’ordre universel, transmigre (samsarati), c’est-à-dire qu’il continue à animer des existences contingentes, dont les formes sont prédéterminées par l’enchaînement des causes médiates. La Délivrance n’est pas pour notre “moi”, mais pour ce “Soi” qui ne devient jamais “quelqu’un”, c’est-à-dire qu’elle n’est pour nous que quand nous ne sommes plus nous-mêmes, en tant qu’individus, mais que nous avons réalisé l’identité exprimée par la formule upanishadique “tu es Cela” (Tat twam asi). Cette doctrine n’est d’ailleurs nullement particulière à l’Inde, comme le montrent de nombreux textes appartenant à d’autres formes traditionnelles ; ici comme dans le cas de la “réminiscence”, il s’agit d’une doctrine qui fait véritablement partie de la tradition universelle.
• Akimcanna : la négation de soi
source : « Akimchannâ : self-naughting », in : New Indian Antiquary n°3/1940
— Le New Indian Antiquary (n° d’avril 1940) a publié une importante étude de M. Coomaraswamy, intitulée Akimchannâ : selfnaughting, qui se rapporte encore à un sujet connexe de la question d’anattâ, et traité surtout ici au point de vue du parallélisme qui existe à cet égard entre les doctrines bouddhique et chrétienne. L’homme a deux âtmâs, au sens qui a été indiqué précédemment, l’un rationnel et mortel, l’autre spirituel et qui n’est en aucune façon conditionné par le temps ou l’espace ; c’est le premier qui doit être “anéanti”, ou dont l’homme doit parvenir à se libérer par la connaissance même de sa véritable nature. Notre être réel n’est aucunement engagé dans les opérations de la pensée discursive et de la connaissance empirique (par lesquelles la philosophie veut ordinairement prouver la validité de notre conscience d’être, ce qui est proprement anti-métaphysique) ; et c’est à cet “esprit” seul, distingué du corps et de l’âme, c’est-à-dire de tout ce qui est phénoménal et formel, que la tradition reconnaît une liberté absolue, qui, s’exerçant à l’égard du temps aussi bien que de l’espace, implique nécessairement l’immortalité. Nous ne pouvons résumer les nombreuses citations établissant aussi nettement que possible que cette doctrine est chrétienne aussi bien que bouddhique (on peut dire que, en fait, elle est universelle), ni les textes précisant plus spécialement la conception d’âkimchannâ sous sa forme bouddhique ; nous signalerons seulement que l’anonymat est envisagé comme un aspect essentiel d’âkimchannâ, ce qui est en rapport direct avec ce que nous avons nous-même exposé (Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, ch. IX, où nous avons d’ailleurs mentionné l’article dont il est question présentement) sur le sens supérieur de l’anonymat et sur son rôle dans les civilisations traditionnelles.
• Être sain d’esprit
source : « On being in one's right mind », in : Review of Religion VII, 1942
— Dans la même revue encore (n° de novembre 1942), On Being in One’s Right Mind, par M. Coomaraswamy également, est une explication du véritable sens du terme grec metanoia, qu’on rend communément et très insuffisamment par “repentir” et qui exprime en réalité, un changement de noûs, c’est-à-dire une métamorphose intellectuelle. C’est là aussi, au fond, le sens originel du mot “conversion”, qui implique une sorte de “retournement”, dont la portée dépasse de beaucoup le domaine simplement “moral”, où on en est venu à l’envisager presque exclusivement ; metanoia est une transformation de l’être tout entier, passant “de la pensée humaine à la compréhension divine”. Toutes les doctrines traditionnelles montrent que le “mental” dans l’homme est double, suivant qu’on le considère comme tourné vers les choses sensibles, ce qui est le mental pris dans son sens ordinaire et individuel, ou qu’on le transpose dans un sens supérieur, où il s’identifie à l’hêgemôn de Platon ou à l’antaryâmî de la tradition hindoue ; la metanoia est proprement le passage conscient de l’un à l’autre, d’où résulte en quelque sorte la naissance d’un “nouvel homme” ; et la notion et la nécessité de cette metanoia sont, avec des formulations diverses, mais équivalentes en réalité, unanimement affirmées par toutes les traditions.
• La doctrine védique du silence
— « Dans Indian Culture (vol. III, n°4), M. Ananda Coomaraswamy étudie La doctrine védique du silence, qu’il rattache à ce que nous avons exposé ici au sujet du “secret initiatique”, ainsi que des “mythes” et des “mystères” entendus dans leur sens originel. Il s’agit donc essentiellement de l’inexprimable, qui est le “suprême” (para), tandis que la “parole” exprimée se réfère nécessairement au “non-suprême” (apara), les deux aspects apparaissant d’ailleurs comme inséparablement associés dans de nombreux textes, ainsi que dans le rituel, pour constituer ensemble la conception totale du Principe » (R. Guénon, 1947, repris dans Études sur l’hindouisme, 1967). Lire aussi cette note : « “Le Brahman est silence” : Une parole traditionnelle citée par Shankara dans son commentaire du Brahma Sūtra III, 2-17. Cf. l’affirmation hermétique : “Alors seulement vous le verrez, quand vous ne pourrez plus parler de lui car sa connaissance est profond silence et suppression de tous les sens” (Hermès, Lib. X, 6). Tout comme pour les Upanishads, l’ultime Brahma est un principe “à propos duquel aucune question ultérieure ne peut être posée” (Brihadaranyaka Upanishad III, 6), de même le Bouddha refuse constamment de discuter de la quiddité du Nibbāna. Selon les paroles d’Origène : “Dieu ne sait pas ce qu’Il est Lui-même car Il n’est pas une chose déterminée” et Maïmonide : “en affirmant quoi que ce soit de Dieu, vous vous éloignez de Lui”. Les Upanishads et le Bouddhisme n’offrent pas d’exception à la loi universelle du voisinage côte à côte de la via affirmativa et de la via remotionis [voie affirmative et voie négative]. Il n’y a rien de spécifiquement hindou, et encore moins de spécifiquement bouddhiste, dans la perspective selon laquelle nous ne pouvons pas connaître ce que nous pourrons devenir, c’est-à-dire “ce que l’œil n’a vu ni l’oreille entendu” (Première Épître aux Corinthiens II, 29). Dans le même temps, la fonction de l’image corporelle, verbale ou plastique ou, de quelque autre façon, symbolique, est médiatrice » (AKC, note 18, in : La sculpture bouddhiste, p. 25, 2021)
• Le Vedānta et la tradition occidentale
source : « The Vedanta and Western Tradition », in : The American Scholar n°2/1939
Lire plus haut en préambule au texte traduit par René Allar (1902-1983). Cf. traduction par M. Dardevet sur son blog.
• Qu’est-ce que la civilisation ?
— Dans une étude intitulée What is Civilization ? Albert Schweitzer Festschrift, M. Coomaraswamy prend pour point de départ la signification étymologique des mots “civilisation” et “politique”, dérivés respectivement du latin civitas et du grec polis, qui l’un et l’autre signifient “cité”. Les cités humaines doivent, suivant toutes les conceptions traditionnelles, être constituées et régies selon le modèle de la “Cité divine”, qui est par conséquent aussi celui de toute vraie civilisation, et qui peut elle-même être envisagée au double point de vue macrocosmique et microcosmique. Ceci conduit naturellement à l’interprétation de Purusha comme le véritable “citoyen” (purushaya, équivalent de civis), résidant au centre de l’être considéré comme Brahmapura ; nous pensons d’ailleurs avoir l’occasion de revenir plus amplement sur cette question.
***
⬨ Notes sur La Doctrine du sacrifice
• Recension : Dans ce volume, Gérard Leconte a réuni huit articles portant sur le thème du sacrifice. Les appuis culturels de ces études sont le rituel hindou et le symbolisme universel. Mais les travaux antérieurs de l’auteur lui permettent d’utiliser abondamment l’art, l’iconographie et le folklore. D’autres livres consacrés à l’étude des symboles et la cosmologie hindoue, sans doute plus familiers aux lecteurs de langue anglaise, ont préparé les principes d’interprétations des thèmes religieux analysés ici. Le sacrifice est surtout présenté à partir de deux de ses modalités principales : la décapitation et la métamorphose. On retrouvera les thèmes de la création et de la réintégration dans les deux premières études, consacrées surtout aux principaux mythes védiques. La mythologie celtique et la littérature arthurienne sont les fils conducteurs des deux textes suivants. Un dernier article, « Atmayajna : le sacrifice de soi », analyse la présence d’un sens profond dans les rites sacrificiels. Ainsi, ce volume présente une somme importante de documents autour du thème du sacrifice tisse les liens subtils qui relient les différents courants religieux entre eux. Le mythe, le rite, le conte et la légendes ont successivement abordés et ordonnés pour faire vivre de l’intérieur la conduite sacrificielle. (Michel Adam, Rev. Phi. n°3/1979)
***
Le sacrfice (en sanskrit yajña) est au cœur de la spiritualité indienne. Il signifie un geste ou une action pour étendre celle-ci, l’amplifier de manière à atteindre quelque chose et donc d’offrir, mais pas nécessairement dans le sens de l’immolation d’une victime auquel on associe le mot “sacrifice”. C’est une offrande rituelle, c’est-à-dire une opération par laquelle on transfère au monde spirituel un élément du monde sensible. Agni, le Feu, qui transforme l’offrande matérielle en réalité spirituelle, est le médiateur d’une des premières formes védiques du sacrifice.
Dès les Brahmanas (littérature exégétique des Védas, brahman signifiant en ce contexte formule sacrée), le rite sacrificiel en lui-même devient plus important que les dieux auxquels il était offert, il cesse d'être un acte propitiatoire tiré du legs indo-iranien mais en vient à être considéré en tant qu’événement participant à l’ordre socio-cosmique. L’ouvrage pionnier en ce domaine est celui de l’éminent indologue Sylvain Lévi : La doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas, 1898), qui ne sera pas sans marquer de son empreinte la célèbre étude des sociologues Marcel Mauss & Henri Hubert, l’Essai sur le sacrifice (1899, recension) pour lesquels, se démarquant de l’anthropologie religieuse anglaise (Tylor, Frazer), le sacré apparaît comme “l’expression symbolique du social”. C’est la transcendance du groupe sur l’individu qui s'exprime dans la religion : le fait religieux est traité en hypostase de la cohésion sociale. Même si les théories du sacrifice se présentent comme un champ de bataille en anthropologie, l'hommage de René Girard à S. Lévi lors de 3 conférences en 2002 à la BNF est à saluer.
Ce caractère fondamental du sacrifice s’est pleinement affirmé sous le brahmanisme et gardera un rôle central par la suite. C’est pourquoi en tant que catégorie indianiste, elle reste soumise à de nombreux débats. En effet, si elle est emblématique de la lente maturation qui a conduit du védisme à l’hindouisme (« d'un type de religion extravertie, aimant la vie, [à] une forme introvertie et ésotérique de religion » comme le note RC Zaehner, L’hindouisme, 1974, recension), elle reste toujours l’une des grandes lignes de force de la pensée et de la sensibilité indiennes : « Le sacrifice est la loi du monde, et sans sacrifice rien ne peut se gagner, ni la maîtrise ici-bas, ni la possession des cieux au-delà, ni la suprême possession de tout ce qui est » (Aurobindo) ; « Tout ce qui arrive dans le monde est en essence une offrande et un sacrifice » (Mâ Ananda Moyî) ; « Le monde ne peut subsister un instant sans le sacrifice » (Gandhi).
« Le sacrifice (yajna) dont il s’agit est une répétition mimée et rituelle de ce que firent les Dieux au commencement ; il constitue à la fois un péché et une expiation. Nous ne comprendrons pas le Mythe tant que nous n’aurons pas accomplis le Sacrifice, ni le Sacrifice avant d’avoir compris le Mythe. Mais avant que vous puissions tenter de comprendre l’opération, il faut se demande Qui est Dieu et Qui nous sommes. Dieu est une essence sans dualité (adwaita), ou, comme certains le soutiennent, sans dualité mais non sans relations. Il ne peut être appréhendé qu’en tant qu’Essence, mais cette Essence subsiste dans une nature duelle, comme être et comme devenir. Ainsi ce que l’on appelle la Plénitude est à la fois explicite et non explicite, sonore et silencieux, caractérisé et non caractérisé, temporel et éternel, divisé et indivisé, dans une apparence et hors de toute apparence, manifesté et non manifesté, mortel et immortel et ainsi de suite. Quiconque le connaît sous son aspect prochain, immanent, le connaît aussi sous son aspect ultime, transcendant. Le Personnage qui se tient dans notre cœur, mangeant et buvant, est aussi le Personnage dans le Soleil. Ce soleil des hommes, cette Lumière des lumières, que "tous voient mais que peu connaissent en esprit" est le Soi Universel (âtman) de toutes les choses mobiles et immobiles. Il est à la fois dedans et dehors mais sans discontinuité ; il est donc une présence totale, indivise dans les choses divisées. Il ne vient de nulle part, il ne devient qui que ce soit, mais il se prête seulement à toutes les modalités possibles d’existence » (Hindouisme et Bouddhisme).
• Anges et Titans
Source : « Angel and Titan : An essay in vedic ontology », in : JAOS n°4/1935
— « Cette importante étude fait suite à The Darker Side of the Dawn, dont nous avons rendu compte précédemment ; l’idée principale que l’auteur y développe est que les Dêvas (ou Anges) et les Asuras (ou Titans), respectivement puissances de Lumière et puissances de Ténèbres dans le Rig-Vêda, bien qu’opposés dans leur action, n’en sont pas moins d’une même essence, leur distinction portant en réalité sur leur orientation ou leur état. L’Asura est un Dêva en puissance, le Dêva est encore un Asura par sa nature originelle ; et les deux désignations peuvent être appliquées à une seule et même entité suivant son mode d’opération, comme on le voit par ex. dans le cas de Varuna. D’autre part, tandis que les Dêvas sont représentés habituellement sous des formes d’hommes et d’oiseaux, les Asuras le sont sous celles d’animaux et particulièrement de serpents ; de là une série de considérations du plus grand intérêt sur les divers aspects du symbolisme du serpent, principalement au point de vue cosmogonique. Bien d’autres questions sont abordées au cours de ce travail, et nous ne pouvons les énumérer toutes en détail : citons seulement la nature d’Agni et ses rapports avec Indra, la signification du sacrifice, celle du Soma, le symbolisme du Soleil et de ses rayons, de l’araignée et de sa toile, etc. Le tout est envisagé dans un esprit nettement traditionnel, comme le montreront ces quelques phrases que nous extrayons de la conclusion : “Ce qui doit être regardé du dehors et logiquement comme une double opération de sommeil et d’éveil alternés, de potentialité et d’acte, est intérieurement et réellement la pure et simple nature de l’Identité Suprême… Ni l’ontologie védique ni les formules par lesquelles elle est exprimée ne sont d’ailleurs particulières au Rig-Vêda, mais elles peuvent tout aussi bien être reconnues dans toutes les formes extra-indiennes de la tradition universelle et unanime” » (RG, 1936).
• La face obscure de l’Aurore
Source : « The Darker Side of Dawn », in : Smithsonian Miscellaneous Collection n°1/1935
— « Cette brochure contient de fort intéressantes remarques sur les dualités cosmogoniques, principalement en tant qu’elles sont représentées par une opposition entre “lumière” et “ténèbres” et sur certaines questions connexes, entre autres le symbolisme du serpent. Notons aussi un rapprochement fort curieux entre le sujet du Mahâbhârata et le conflit védique des Dêvas et des Asuras, qui pourrait évoquer également des similitudes avec ce qui se rencontre dans d’autres formes traditionnelles, de même d’ailleurs que ce qui concerne la couleur noire comme symbole du non-manifesté. Il est seulement à regretter que l’auteur se soit borné à indiquer toutes ces considérations d’une façon un peu trop succincte, en une vingtaine de pages à peine, et nous ne pouvons que souhaiter qu’il ait l’occasion d’y revenir et de les développer davantage dans des travaux ultérieurs » (RG, 1935).
• Les magiciens sans tête et l’Acte de Vérité
source : « Headless Magicians ; And an Act of Truth », in : JAOS n°4/1944
Comme mentionné par G. Leconte dans sa préface, « Coomaraswamy explique tout d'abord le sens du rite reposant sur la puissance effective de la parole. Le contexte védique comprend un exemple de décapitation, rapportée ici au cas de ces êtres “qui font ce qu’ils veulent de leurs têtes”, c’est-à-dire qu’ils ont acquis la liberté de leurs actes. L’objet de cette étude était d’expliquer une particularité icinnographique d’une sépulture bouddhiste ». Ce rite, l’Acte de vérité (satyakriyā), resterait l’une des grandes lignes de force de la pensée et de la sensibilité indiennes. Pourtant le réputé manuel indianiste anglais, le Wiley Blackwell Companion to Hinduism, reste succinct à son égard. Si on retrouve cette pratique dans le courant theravāda du bouddhisme (désignée en pāli par sacca-kiriyā), il est difficile de la recouper avec les rituels de prière hindoue. S'agirait-il chez AKC de défendre un fonds commun d’aspirations générales entre hindouisme et bouddhisme sans marquer les différences spécifiques ?
Un archaïsme védique
L’Acte de Vérité renvoie originairement à une prière archaïque indo-européenne qui perdurera dans le védisme : « Du point de vue formel, l'origine du credo zoroastrien est claire. Il résulte de la combinaison de deux traits de la priére indo-iranienne : la pratique de la satyakriyà et l'utilisation littéraire systématique du cas de coincidence. Satyakriya ou “acte de vérité” est un terme technique de la liturgie indienne qui désigne un type de priére consistant à s'attirer la faveur d'une divinité en énonçant une vérité sur son compte, quelque chose comme le “souvenez-vous” catholique. Duchesne-Guillemin donne pour l'Avesta l'exemple du Yt 5,76, où le héros mythique Vistauru se propitie Anàhità par l'expression d'une vérité. On y observe une combinaison frappante entre l'énoncé de la vérité et celui de la requéte » (Jean Kellens, « La prière d’identification dans la tradition zoroastrienne », 1978).
Jean Haudry précise : « Tout cela est lié indissociablement sans qu’on puisse discerner ce qui est premier : la pratique de “l’énonciation de vérité”, assertion vraie qui assure la réalisation d’un souhait, est magique ; mais l’assertion vraie se rapporte le plus souvent à l’accomplissement d’un devoir de son état, par ex., pour un guerrier, à ses actes d’héroïsme : elle a donc une base dans la période commune, celle des quatre cercles de l’appartenance sociale et des trois fonctions » (article, in : Journal Asiatique n°2/2014).
Selon Marcelle Saindon : « Eugene Watson Burlingame [1876-1932], le premier à étudier l’Acte de Vérité, le définissait comme une “déclaration solennelle d'un fait, accompagnée d'une injonction, résolution ou prière devant permettre à l'agent d’atteindre le but qu'il vise” [JRAS, 1917]. (…) Pour William Norman Brown — qui a poursuivi le travail de Burlingame —, il s’agit d’une croyance de l’Inde ancienne selon laquelle “la Vérité possède une force qu'une personne pourvue des qualifications nécessaires peut invoquer pour accomplir des merveilles ou des miracles” » (article, 2002).
Un caractère polymorphe
Il serait tentant de lui donner l'équivalent latin sacramentum, promesse faite en prenant à témoin un dieu, un être ou un objet sacré. Mais, comme le souligne Lyne Bansat-Boudon, l’Acte de vérité peut revêtir différentes formes, « encore que, dans cette dénomination d’acte de vérité, se laisse lire la signification proprement performative, au sens de la linguistique moderne, de la pratique. De quoi s’agit-il ? Des pouvoirs intrinsèques à l’affirmation véridique, qui, selon la magistrale analyse de Dumézil, peut prendre les allures du serment (aussi vrai que…), de l’ordalie (s’il est vrai que…), de la preuve prélogique (puisqu’il est vrai que…), ou de l’action (puisque je possède telle vérité…). Ainsi que conclut Dumézil : “La Vérité est très tôt apparue aux hommes comme une des armes verbales les plus efficaces, un des germes de puissance les plus prolifiques, un des plus solides fondements pour leurs institutions”. Et, en effet, non seulement l’Inde fait de l’acte de vérité un ressort puissant de ses mythes et de sa littérature, mais elle lui reconnaît une valeur égale à celle des lois dharmiques qui organisent la société » (Figures du jeûne indien, 2023).
Pour approfondir
Par “déclaration solennelle d'un fait, accompagnée d'une injonction, résolution ou prière devant permettre à l'agent d’atteindre le but qu'il vise”, le fait évoqué par l'agent est généralement une qualité morale ou spirituelle possédé par cet agent. En contexte indien, la qualité ou l'attribut invoqué par une personne est étroitement lié à son rôle dharmique. Même les personnes qui mènent une vie ostensiblement immorale, comme les voleurs et les prostituées, peuvent encore exercer un “acte de vérité” en faisant appel au “fait” qu'elles sont restés fidèles à leur devoir dharmique. Lire à ce sujet : « Le devoir, force de Vérité dans l'Inde ancienne », N. Brown, Annales n°4/1973 [trad. de « Duty as Truth in Ancient India », in : PAPS n°3/1972] et « The metaphysics of the truth act », in : Mélanges d'indianisme à la mémoire de Louis Renou, Boccard, 1968. Brown n'a pas manqué de souligner que la devise nationale de l'Inde : satyam eva jayate (seule la vérité est victorieuse), est une survivance moderne de l'Acte de vérité. Dans un article ultérieur, AKC réaffirmera que, pour le Connaissant, Acte de vérité et Acte de foi se rejoignent : « On n’a jamais mis en doute que c’est par des “Actes de Vérité” que quelqu’un est, en fait, libéré de toute position fâcheuse où il puisse se trouver ; et que finalement, c’est par un dernier et suprême “Acte de Vérité” que l’on “s’évade totalement” et que l’on est admis à la porte du Soleil. Car le Soleil lui-même est la Vérité et ne peut refuser l’entrée à quiconque frappe à sa porte en invoquant son nom ».
Critique de la catégorie
Si l’Acte de vérité subsiste comme motif légendaire ou littéraire hindou, certains soulignent que l’attribution d’un caractère magique à certains aspects du monde naturel est peu acceptable pour la sagesse hindoue. Ainsi l’intellectuel bouddhiste Jayarava Attwood note lapidairement : « d'une part, les auteurs clés décrivent la saccakiriyā comme “hindoue” alors qu'ils utilisent principalement des sources bouddhistes ; et, d'autre part, ils s'efforcent de la relier aux attitudes védiques envers la vérité sans finalement reconnaître que la saccakiriyā est avant tout un phénomène bouddhiste qui n'a pas d'équivalent védique. (…) Son idée principale [à WN Brown] est que la saccakiriyā peut être comprise comme une extension de l'accent védique mis sur rita (ordre cosmique) et satya (vérité), qui sont parfois presque synonymes. Cet argument est entravé par son incapacité à trouver un seul exemple crédible d'une saccakiriyā de type bouddhiste dans le Rigveda. L'équivalent sanskrit du mot pāli saccakiriyā, c'est-à-dire satyakṛiyā, ne se trouve dans aucun texte sanskrit. Si l'idée est védique, alors, comme il le dit, elle doit être “bien cachée” » (The 'Act of Truth' in relation to the Heart Sutra, 2013).
Plus nuancé, Martin G. Wiltshire considère simplement que « cela souligne l’existence en Inde ancienne d’une croyance selon laquelle, par la vertu, un pouvoir peut être exercé sur le monde phénoménal. À cet égard, on peut remarquer une simitude fonctionnelle avec la conception du mérite comme vertu cardinale, à ceci près que cette dernière s’inscrit dans un cadre cultuel plus clairement défini dans lequel le concept d’une qualité efficace est assimilé à la notion d’un acte de vertu spécifique adressé à un autre être. Mais tant un “acte de vérité” qu’un “acte de mérite” produisent des transformations “radicales” chez l’agent, l’un (généralement) sans délai et l'autre avec. Parce qu'il n'y a pas de temps découlement dans le cas d’un “acte de vérité”, celui-ci semble opérer de manière magique. Nous avons également vu qu'un “acte de mérite” est semblable à un “acte de vérité” en ce sens qu'il est parfois accompagné d'une résolution verbale ou d'une déclaration » (Ascetic Figures before and in the early buddhism, 1990).
On se gardera toutefois de confondre parole invocatrice et parole mantrique, fût-ce dans les courants tantrisants de l’hindouisme. Comme le note L. Hourmant à propos de L'énergie de la parole par André Padoux : « Grâce au mantra, parole suprêmement efficace et germe du dieu qui permet en faire naître mentalement la forme, l’adepte tantrique incorpore les phonèmes jusqu’à remonter à l’origine du son, la Parole divine qui est silence pour les oreilles. S’interrogeant sur les conditions d’efficacité de la parole mantrique, l’auteur note que paradoxalement cette efficacité est censée se réaliser de manière plénière que pour l’adepte qui est lui-même déjà déifié (comme l’énonce une formule tantrique ; celui qui est pas devenu dieu ne doit pas adorer la divinité). Pour l’homme ordinaire, le mantra n’a plus que l’efficacité aléatoire d’un procédé théurgique voire d’une recette magique ».
Plus largement, l’antagonisme créatif entre Parole et Silence (pour renvoyer à l'exposé de J. Scheuer, 2022 [recension]) constitue un fil conducteur de l’hindouisme dans ses variantes commentatrices de la Révélation védique. Ainsi que le remarque Alex Wayman : « Cet acte rituel, surnommé “Acte de Vérité”, est suffisament décrit dans l’épopée hindoue Rāmāyana et dans les sources bouddhistes. Il présente la forme traditionnelle : l’interprète annonce, si telle ou telle chose est vraie, alors laissez ceci ou cela se produire. “Tel et tel” signifie, selon l’explication éclairante de WN Brown, la performance exceptionnelle du devoir de la personne (dharma), et “ceci ou cela” désigne ce que les dieux ont tranché quant à manifester ou non une intervention surnaturelle. Dans un article précédent, j’ai souligné qu’il ne suffisait pas que la personne ait été extraordinaire dans l’accomplissement de son devoir, mais il lui fallait aussi verbaliser ce fait ; et c’est donc cette vérité verbale qui se montre supérieure au silence. En résumé, il ne suffit pas qu’une personne mérite l’aide des dieux ; elle doit en outre invoquer leurs secours. Ce qui précède rend un problème très clair. La tradition de la “vérité” serait suivie par ceux qui seraient inspirés par la déité ou désireux de l’invoquer, en particulier la divinité solaire. La tradition du “silence”, quant à elle, serait suivie par ceux qui, puisant dans leurs propres ressources, tenteraient d’atteindre un statut au-delà de l’humanité ordinaire. Il est certain que ces voies sont distinctes et très contrastées, suscitant par là même des allégeances divergentes. Le Manusmriti [Lois de Manou] insiste définitivement sur le fait que les brahmanes qui font appel à la divinité solaire à l’aube sont supérieurs aux ascètes silencieux qui s’évertuent — à la manière de Bouddha — à être illuminé juste avant l’aube » (« Two Traditions of India : Truth and Silence », in : Philosophy East and West n°4/1974).
Une relecture métaphysique
Au terme de ce modeste questionnement se dégage avec acuité chez AKC sa stratégie d’écriture, disséminée dans ses articles savants. Les formes religieuses ou artistiques sont des efforts plus ou moins valides ou adroits pour atteindre une réalité transcendante à laquelle la métaphysique donne une superstructure éclairée. L’intelligence métaphysique n’est point entendue ici au sens actuel de spéculation abstraite mais renvoie, selon une acception médiévale, à une meilleure appréhension du monde, de notre destinée, du divin. « Pour Coomaraswamy — précise Max Dardevet —, la tradition hindoue est l’une des formes de la philosophia perennis, et elle représente ainsi les vérités universelles dont aucune tradition ne peut revendiquer une possession exclusive. (…) Il a tenté de démontrer que les axiomes d’une telle métaphysique peuvent être clarifiés par la mise en corrélation de textes parallèles de diverses traditions. Cette métaphysique est pérenne en raison de son éternité et de son immutabilité ». Cela explique son assomption d’une catégorie indianiste en exercice spirituel, étonnamment proche de l’exercice de vérité tel que pratiqué par Augustin, et qu’Alexandre Stylios nous décrit dans son étude de philosophie juridique sur l’aveu :
« La recherche de la vérité, pour Augustin, passe par la voie de l’interiorité qui implique de se débarrasser du superflu extérieur. Cêtre humain parvient par cet exercice à une vérité sur lui ou y trouve la Vérité de Dieu grâce à sa foi. Il est difficile de savoir si la démarche introspective proposée par Augustin a pour objectif de mieux se connaître ou si c’est le procédé par lequel Augustin renonce à sa vérité et abandonne son moi pour trouver la Vérité de Dieu. Les commentateurs ne sont pas unanimes sur cette question. Précisons qu’Augustin est très imprégné de la culture et des usages monastiques. Il fréquence assidûment un monastère à Hippone et l’ascèse monastique et la morale qu’elle véhicule pénètrent profondément sa pensée.
En dépit de cette incertitude, la méthode utilisée par Augustin pour énoncer son “moi” présente un intérêt pour notre analyse. Augustin propose une méthode dans laquelle l’exercice de mémoire est fondamental et l’usage de la parole l’est encore davantage. Augustin cherche la vérité à travers un dialogue, non pas avec un tiers, mais avec lui-même. Il recourt à ce type de dialogue avec lui-même dans son livre, les Confessions, mais il emploie surtout cette méthode dans ses Soliloques, un écrit dans lequel il rualogue avec la Raison, sa propre raison.
L’acte de vérité passe par la verbalisation, par le dialogue, mais par un dialogue intérieur. La parole intime n’est pas confrontée à la parole d’un interlocuteur mais constitue tout de même un exercice rigoureux de dire la vérité. Exercice difficile également, comme le mentionne Brian Srock, car ce dialogue est empreint de sacré, Augustin y ferait usage du Langage de Dieu. Elle se dintingue ainsi des paroles banales de rous les jours. Cette parole intérieure doit être empreinte de respect envers Dieu. Les mots sont lourdement pesés et cet exercice de rigueur constitue un gage de vérité en quelque sorte. On pourrait y voir une affirmation solennelle d’Augustin de dire la vérité.
De notre point de vue, la méthode d’introspection du “moi” d’Augustin constitue un exercice spirituel qui relève davantage de l’idéal moral à poursuivre que de l’aveu de fautes en vue de faire pénitence. Lexercice aboutit certes à une vérité intime sur Augustin, mais à une vérité à garder pour soi. Le contenu de vérité personnelle qui ressort de cette introspection a pour objectif de susciter une conversion intérieure et s’inscrit dans une démarche éthique de vérité afin d’atteindre la perfection dans sa vie. Ce dialogue intérieur n’aurait pas comme objectif spécifique et primordial de procéder à l’aveu de ses fautes. On peut tout de même y voir une analyse personnelle et privée de sa propre subjectivité par Augustin » (L’aveu dans les traditions pénales accusatoire et inquisitoire, PUL, 2021).
⬨ Pour prolonger : « Coomaraswamy, St Augustine, and the Perennial Philosophy », S. Cross, in : Crossing religious frontiers, 2010.
• Atmayajña : le sacrifice de soi
source : « Atmayajna : Self-sacrifice », Harvard Journal of Asiatic Studies n°3-4/1942
La dernière étude, portant sur le sens intérieur du Sacrifice, conclut magistralement le recueil. C’est dans cette étude que les exemples mythiques traités auparavant seront mis en relation avec une intériorisation de la lutte ou de l’offrande qui préside au sacrifice.
— Dans le Harvard Journal of Asiatic Studies (n° de février 1942), M. AKC a publié une importante étude, Atmayajna : Self-sacrifice, dont l’idée principale, justifiée par de multiples références aux textes traditionnels, est, comme on aura déjà pu le comprendre par les citations que nous en faisons par ailleurs, que tout sacrifice est en réalité un “sacrifice de soi-même”, par identification du sacrifiant à la victime ou à l’oblation. D’autre part, le sacrifice étant l’acte rituel par excellence, tous les autres participent de sa nature et s’y intègrent en quelque sorte, si bien que c’est lui qui détermine nécessairement tout l’ensemble de la structure d’une société traditionnelle, où tout peut être considéré par là même comme constituant un véritable sacrifice perpétuel. Dans cette interprétation sacrificielle de la vie, les actes, ayant un caractère essentiellement symbolique, doivent être traités comme des supports de contemplation (dhiyâlamba), ce qui suppose que toute pratique implique et inclut une théorie correspondante. Il est impossible de résumer tout ce qui est dit, à cette occasion, sur l’Agnihostra, sur le Soma, sur le “meurtre du Dragon” (symbolisant la domination du “moi“ par le “Soi”), sur la signification de certains termes techniques importants, sur la survivance “folklorique » des rites traditionnels, et sur bien d’autres questions encore. Nous nous contenterons de reproduire quelques passages se rapportant plus particulièrement à la conception traditionnelle de l’action : « Les actes de toutes sortes sont réduits à leurs paradigmes ou archétypes, et rapportés par là à Celui dont procède toute action ; quand la notion que « c’est moi qui suis l’agent » a été surmontée et que les actes ne sont plus “nôtres”, quand nous ne sommes plus “quelqu’un”, alors ce qui est fait ne peut pas plus affecter notre essence qu’il n’affecte l’essence de Celui dont nous sommes les organes ; c’est en ce sens seulement, et non en essayant vainement de ne rien faire, que la chaîne causale du destin peut être brisée… Si le sacrifice est en dernière analyse une opération intérieure, cela n’implique aucune dépréciation des actes physiques qui sont les supports de la contemplation. La priorité de la vie contemplative ne détruit pas la validité réelle de la vie active, de même que, dans l’art, la primauté de l’actus primus libre et imaginatif ne supprime pas l’utilité de l’actus secundus manuel… Il est vrai que, comme le maintient le Vêdânta, aucun moyen n’est capable de faire atteindre à l’homme sa fin ultime, mais il ne faut jamais oublier que les moyens sont préparatoires à cette fin ». (RG, 1942).
En même temps, « il est demandé plus que les actes purs et simples, si l’on veut réaliser le dessein ultime dont les actes ne sont que les symboles. Il est dit expressément que “ce n’est ni par l’action ni par les sacrifices que l’on peut L’attein dre”, Celui dont la connaissance est notre bien suprême. Il est en même temps affirmé sans cesse que le Sacrifice ne s’accomplit pas seulement en mode parlé et visible, mais aussi en mode “intellectuel”, silencieusement et invisiblement, à l’intérieur de nous. Autrement dit, la pratique n’est que le support extérieur et la démonstration de la théorie. La distinction s’impose donc entre le véritable sacrificateur de soi-même et celui qui se contente simplement d’être présent au sacrifice et d’attendre que la déité fasse tout le travail réel. Il est même dit bien souvent que “quiconque comprend ces choses et accomplit le bon travail, ou même s’il comprend simplement (sans accomplir effectivement le rite), restitue la déité démembrée dans sa totalité et son intégrité” ; c’est par la gnose, et non par les œuvres, que l’on peut atteindre cette réalité » (Hindousime et bouddhisme).
 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique