-
Debord
À propos de la réédition de “La Société du spectacle” de Guy Debord
« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. »
[ill. : Robin Guinin]
 ♦ Analyse : Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, édition de 1988, suivi de « Préface à la quatrième édition italienne de La Société du Spectacle », édition de 1979, Gallimard/Folio n°2905, 1996, 148 p.
♦ Analyse : Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, édition de 1988, suivi de « Préface à la quatrième édition italienne de La Société du Spectacle », édition de 1979, Gallimard/Folio n°2905, 1996, 148 p.Signes encourageants pour les ennemis du système : à côté du développement du communautarisme, les livres des auteurs non conformistes connaissent un succès indéniable ; il en est ainsi pour ceux qui ont formé ce qu’il est convenu d’appeler l’“Internationale situationniste”. Après la réédition de La Société du Spectacle [1967] (voir NdSE n°20) et la sortie de Nous qui désirons sans fin de Raoul Vaneigem, voici que Gallimard réédite aussi Commentaires sur la société du spectacle, un des derniers ouvrages de Guy Debord [1931-1994].
Cette actualisation de La Société du spectacle n’apporte au fond rien de bien nouveau, même si nous y trouvons quelques formules toujours bien senties comme dans ses développements sur les sociétés mafieuses, sujet d’actualité s’il en est.
Ainsi après avoir rappelé que celle ci s’est imposée pour la première fois aux États-Unis à l’époque de la prohibition, puis dans le sud de l’Italie avec l’appui du gouvernement américain afin de l’aider dans son débarquement en 1943, la mafia s’impose d’abord dans la protection des populations pauvres et « grandit avec les immenses progrès des ordinateurs et de l’alimentation industrielle, de la complète reconstruction urbaine et du bidonville, des services spéciaux et de l’analphabétisme ». Elle prend ensuite une importance considérable dans l’immobilier, les banques, la grande politique et les grandes affaires de l’État, puis les industries du spectacle : télévision, cinéma, édition. Inutile de préciser que maintenant tous les ingrédients se trouvent réunis pour que l’Europe occidentale devienne un terrain de prédilection à toutes ces dérives mafieuses et tout pouvoir devient donc “mafia”, d’où ce raccourci saisissant de vérité :
« On se trompe chaque fois que l’on veut expliquer quelque chose en opposant la mafia à l’État : ils ne sont jamais en rivalité. La théorie vérifie avec facilité ce que toutes les rumeurs de la vie pratique avaient trop facilement montré. La mafia n’est pas étrangère dans ce monde ; elle y est parfaitement chez elle. Au moment du spectaculaire intégré, elle règne en fait comme le modèle de toutes les entreprises commerciales avancées ». Il n’y a qu’à regarder autour de soi pour vérifier la pertinence de ces paroles.Mais Guy Debord, à la fin de sa vie, semblait véritablement croire à une implosion de ce système, ce qu’il nommait «la chute immanquable de cette cité d’illusions ». Selon lui : « Les jours de celle-ci sont comptés parce que ses raisons et ses mérites ont été pesés, et trouvés légers ; ses habitants se sont divisés en deux partis, dont l’un veut qu’elle disparaisse ». Nous, nous appartenons clairement à ce dernier camp. Quant à ce qu’il adviendra à la suite du grand chaos : « ce livre ne donne aucune sorte d’assurance sur la victoire de la révolution, ni sur la durée de ses opérations, ni sur les âpres voies qu’elle aura à parcourir, et moins encore sur sa capacité, parfois vantée à la légère, d’apporter à chacun le parfait bonheur… Comme toujours, Guy Debord est l’homme d’un solide bon sens dont on ne peut que louer la lucidité : à nous autres de savoir être des indicateurs de bons chemins, des guides spirituels et politiques en quelque sorte. En effet on peut même éprouver la légitime impression que c’est à nous qu’il s’adresse lorsqu’il affirme : « À vrai dire, je crois qu’il n’existe personne au monde qui soit capable de s’intéresser à mon livre, en dehors de ceux qui sont ennemis de l’ordre social existant, et qui agissent à partir de cette situation ». C’est effectivement ce que nous sommes et faisons… de plus en plus nombreux !
► Pascal Garnier, Nouvelles de Synergies Européennes n°28, 1997.

Guy Debord : vers une conception policière de l’histoire ?
• Recension : Guy Debord, Anselm Jappe, éditions Via Valeriano, Marseille, 1995, 252 p.
 En 1993 est paru en Italie un livre d’Anselm Jappe sur Guy Debord. Il vient d’être publié en français par les éditions Via Valeriano. Anselm Jappe écrit : « Quelqu’un comme Debord est sans doute plus singulier en France qu’il ne le serait ailleurs. Les intellectuels français, liés à l’État en qualité de fonctionnaires depuis l’époque de Richelieu, ont fait preuve, en particulier durant ces dernières décennies, d’une capacité infinie à changer d’opinion, à s’adapter aux modes du jour, à collaborer avec des personnes qu’ils détestaient encore la veille, et à pactiser avec l’État dès que celui-ci leur fait une offre avantageuse. La génération de 68 y a particulièrement excellé — il suffit de penser aux grotesques althussériens maoïstes devenus en quelques années les “nouveaux philosophes” ou les “post-modernes”. C’est dans un tel contexte qu’il faut prendre l’orgueilleuse solitude défendue par Debord dans ses derniers livres, et sa phrase : “J’ai vécu partout, sauf parmi les intellectuels de cette époque” ». Nous citerons aussi ce passage qui s’appuie sur les Commentaires sur la société du spectacle : « Debord souligne que, voir partout des conspirations, des machinations de la police et des activités des services secrets, c’est-à-dire la “conception policière de l’histoire” était effectivement une vision réductrice jusqu’à une date récente. Aujourd’hui au contraire, les services secrets sont devenus la “plaque tournante centrale” des sociétés spectaculaires : ce sont eux, et beaucoup d’autres formations travaillant dans le secret, qui diffusent continuellement, sur chaque aspect de la vie une avalanche d’informations contradictoires, interdisant de se faire une idée précise de quoi que ce soit. Ici la police se joint au “médiatique” : depuis que toutes les communautés se sont dissoutes, l’individu n’est en contact avec le monde qu’au travers des images choisies par d’autres, qui peuvent y mettre n’importe quel contenu. En luttant contre toute trace authentique du passé historique, le spectacle veut faire oublier qu’il est un “usurpateur” qui vient de s’installer, espérant ainsi, par l’absence de comparaison, se faire accepter comme la meilleure et l’unique possibilité ».
En 1993 est paru en Italie un livre d’Anselm Jappe sur Guy Debord. Il vient d’être publié en français par les éditions Via Valeriano. Anselm Jappe écrit : « Quelqu’un comme Debord est sans doute plus singulier en France qu’il ne le serait ailleurs. Les intellectuels français, liés à l’État en qualité de fonctionnaires depuis l’époque de Richelieu, ont fait preuve, en particulier durant ces dernières décennies, d’une capacité infinie à changer d’opinion, à s’adapter aux modes du jour, à collaborer avec des personnes qu’ils détestaient encore la veille, et à pactiser avec l’État dès que celui-ci leur fait une offre avantageuse. La génération de 68 y a particulièrement excellé — il suffit de penser aux grotesques althussériens maoïstes devenus en quelques années les “nouveaux philosophes” ou les “post-modernes”. C’est dans un tel contexte qu’il faut prendre l’orgueilleuse solitude défendue par Debord dans ses derniers livres, et sa phrase : “J’ai vécu partout, sauf parmi les intellectuels de cette époque” ». Nous citerons aussi ce passage qui s’appuie sur les Commentaires sur la société du spectacle : « Debord souligne que, voir partout des conspirations, des machinations de la police et des activités des services secrets, c’est-à-dire la “conception policière de l’histoire” était effectivement une vision réductrice jusqu’à une date récente. Aujourd’hui au contraire, les services secrets sont devenus la “plaque tournante centrale” des sociétés spectaculaires : ce sont eux, et beaucoup d’autres formations travaillant dans le secret, qui diffusent continuellement, sur chaque aspect de la vie une avalanche d’informations contradictoires, interdisant de se faire une idée précise de quoi que ce soit. Ici la police se joint au “médiatique” : depuis que toutes les communautés se sont dissoutes, l’individu n’est en contact avec le monde qu’au travers des images choisies par d’autres, qui peuvent y mettre n’importe quel contenu. En luttant contre toute trace authentique du passé historique, le spectacle veut faire oublier qu’il est un “usurpateur” qui vient de s’installer, espérant ainsi, par l’absence de comparaison, se faire accepter comme la meilleure et l’unique possibilité ». ► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°19, 1996.

 Hommage à Guy Debord : à propos d'une réédition
Hommage à Guy Debord : à propos d'une rééditionLe fondateur de l'Internationale Situationniste qui se donnait pour but rien de moins que de « renverser le monde » s'est donné la mort à l'automne dernier. Nous, qui partageons avec lui cette même haine du système, devons accorder notre attention à Guy Debord qui a su bâtir une œuvre délibérément en dehors des sentiers battus. Fait paradoxal, alors qu'il a passé son temps à dénoncer le système, on n'a jamais autant parlé de lui que maintenant : réédition de ses livres, articles de presse, émissions de télévision et de radio… Il n'aurait sans doute jamais imaginé un pareil posthume tapage médiatique autour de sa personne. Bref Guy Debord intrigue. Justement au moment même ou le système médiatique semble donner quelques signes d'essoufflement (baisse de l'audience de la télévision) et ou celui-ci semble s'entrouvrir bien malgré lui aux idées politiquement incorrectes (voir l'affaire Garaudy et ses rebondissements avec l'Abbé Pierre), les éditions Folio ont eu l'idée opportune de rééditer son œuvre la plus connue qui a précédé les évènements de mai 1968 : La société du spectacle. Ce livre d'une densité extrême a eu le mérite de faire figure d'anticipateur.
Dans un premier temps, il s'ouvre sur une critique du système médiatique dont, pour nous, il est primordial de dénoncer la perversité puisqu'il est : « la justification totale du système existant » que nous combattons, « devenu en soi conception du monde ». L'émergence de ce type de société a été permise par la première phase de l'économisme qui a favorisé la dégradation de l'être en avoir, la deuxième phase étant l'aboutissement de celle-ci par le glissement généralisé de l'avoir en paraître. Cet ordre s'est établi et perdure grâce à « une reconstruction matérielle de l'illusion religieuse » ou le peuple se complet dans un désir de dormir, « le spectacle étant le gardien de ce sommeil », « monologue élogieux de l'ordre présent », univers doux et aseptisé du grand hospice occidental où l'histoire se retire comme d'une marée dont on a peur. D'ailleurs, les développements sur les rapports entre religion et conception de l'histoire rejoignent les analyses d'un Cioran, celui d'Histoire et utopie, laissant entrevoir un capitalisme unifié mondialement, régulé par les média, le village global de Mac Luhan en quelque sorte.
Cette fin de l'histoire annoncé par Fukuyama permettrait à ces foules solitaires de se contenter de suivre éternellement sur leurs écrans : « les fausses luttes des formes spectaculaires du pouvoir », l'alternance programmée entre la gauche et la droite pour ne citer qu'un seul exemple ainsi que d'avoir « le faux choix de l'abondance par la juxtaposition de spectacles concurrentiels et solidaires » : Arthur, Dechavanne et Delarue pour aller au plus simple.
Les autres formes d'évolution sociales n'ont été selon Debord permises que par l'émergence de cette société du spectacle. Celles-ci encouragent au sein de nos sociétés la primauté de l'économique sur le politique, la supériorité du quantitatif sur le qualitatif, le fétichisme de la marchandise, l'atomisation de la société, notamment grâce à une technologie omniprésente isolant le sujet sur sa machine (thème repris par la suite par des gens comme Baudrillard ou Faye), l'existence, à côté d'un capitalisme sauvage, d'un socialisme bureaucratique et policier qui aboutit à une prolétarisation du monde. De la sorte, nous aboutissons à une nouvelle forme d'organisation sociale, la nôtre, individualiste et égalitariste, où le boom du tertiaire et de la communication mène à « la logique du travail en usine qui s'applique à une grande partie des services et des professions intellectuelles ». Cet univers concentrationnaire de la tertiarisation, version moderne de la mine (mais une mine propre) permet un renforcement de la société capitaliste. Et ceci en acceptant qu'une part croissante de la population soit sous-employée et en tolérant ce que Guy Debord nomme « une nouvelle forme de lutte spontanée : la criminalité ». Tous ces processus depuis 30 ans se sont largement amplifiés.
Aussi, cette critique de notre société qui se veut de gauche, par bien des aspects, fait penser aux conclusions d'un Guénon ou d'un Evola. Notons cependant parfois une phraséologie marxiste qui semble céder à la mode de son époque (nous sommes dans les années 60) et qui paraît désuète aujourd'hui. Sachons également qu'il existe dans ce texte un oubli de taille : la dénonciation de la destruction de l'environnement qui elle, interviendra un peu plus tard dans Commentaires de la société du spectacle. Insistons également sur un fait où l'auteur se trompe (et c'est sans doute ce qui rend un caractère si pessimiste à son œuvre), c'est sa vision fausse de la paysannerie, qui est pour lui « l'inébranlable base du despotisme oriental ». Ce n'est sans doute pas une quelconque révolution prolétarienne (à laquelle Debord ne croit d'ailleurs justement pas) mais au contraire un réenracinement dans les valeurs immémoriales et universelles du sang et du sol que les hommes trouveront leur salut et leur épanouissement. Sans doute le fils nanti d'industriels cannois n'a-t-il pas eu l'occasion de découvrir les milieux simples des gens enracinés. Nous comprenons son mépris pour son milieu d'origine et pour la vaste poubelle parisienne où il a passé le plus clair de son existence. Sa critique du système est très lucide mais nous, nous proposons une vraie alternative aux échappatoires alcooliques des bistrots parisiens où il s'est abîmé. C'est celle du réenracinement du Maître des abeilles de Henri Vincenot, de L’Éveil de la glèbe de Knut Hamsun ou du monde artisanal de La gerbe d'or d'Henri Béraud.
Mais cela n'enlève rien à la pertinence de Debord dans les 221 paragraphes biens distincts de son texte : dans sa préface, datant de juin 1992, il parle ainsi des déçus de mai 1968 : « Les pires dupes de cette époque ont pu apprendre depuis, par les déconvenues de toute leur existence ce que signifiait la “négation de la vie qui est devenue visible”, “la perte de la qualité” liée à la forme-marchandise et la “prolétarisation du monde” ». Sûr de lui jusqu'au bout, il écrit : « Une telle théorie n'a pas à être changée, aussi longtemps que n'auront pas été délimitées les conditions générales de la longue période de l'histoire que cette théorie a été la première à définir avec exactitude ». Il n'y a rien à ajouter.
► Pascal Garnier, Nouvelles de Synergies Européennes n°20, 1996.

Il n'est guère étonnant de voir un hebdomadaire comme L'événement du jeudi se montrer fielleux à la sortie de Panégyrique II en éructant contre un fait dont nous nous doutions depuis quelque temps : les situationnistes connaissent une vogue dans le monde de l'édition qu'ils n'avaient jamais connu auparavant y compris dans le milieu journalistique le plus conformiste. En dépit du caractère ultra-contestataire de leur travaux qui, normalement, aurait dû titiller ces journalistes prêts à bouleverser, en paroles du moins, tous les tabous…
Mais au-delà du nihilisme imputé à cette pensée, ce qui inquiète justement les idéologues apologistes de notre beau monde, c'est que le vide sidéral qu'ils laissent derrière eux pourraient cette fois-ci ouvrir un boulevard à ce que dans leur jargon convenu on appelle “le fascisme”.
Ses adversaires ont aussi souvent reproché à Guy Debord, les côtés froids et sec de son œuvre. Mais ne lui reproche-t-on pas au fond de ne s' être jamais renié et d'être resté d'une extraordinaire cohérence par rapport à ses idées. Pourquoi ne pas le reconnaître ? Guy Debord avec sa critique centrale du système gênait : hérétique parmi les hérétiques, il a toujours rejeté cette “société du spectacle” dont il s'est fait le contempteur numéro un. Elle aurait bien aimé pourtant le présenter dans la fosse au lion mass-médiatique comme un phénomène spectaculaire et démontrer ainsi qu'elle pratiquait la démocratie jusqu' au bout, en lui laissant la portion congrue tout en présentant cet adversaire irréductible comme un vrai méchant comme savent si bien diaboliser tous ceux qui battent l'estrade de la scène. Guy Debord n'a jamais succombé à l'appel de ces sirènes perverses. Il n'est pas mort malheureux : c'est ce que laissent penser ses derniers écrits ou l'on sent bien la délectation qu'il éprouve en constatant la chute lente mais inéluctable de cette cité d'illusion qui sombre dans la décadence, la confusion et le chaos : « Toute ma vie je n'ai vu que des temps troublés, d'extrêmes déchirements dans la société, et d'immenses destructions ; j'ai pris part à ces troubles », annonce-t-il. Ainsi par ces petits ouvrages, Debord a pu nous quitter en laissant une œuvre parfaitement achevée : il explique qui il est (Panégyrique I et II), répond à ses détracteurs (Cette mauvaise réputation… et Considérations sur l'assassinat (de J. Lebovici)), toujours dans ce style à nul autre pareil, caractérisé selon Roger-Pol Droit par des formules effilées comme un scalpel, à une prose froide, d'une dureté exemplaire. Celui-ci ajoute d'ailleurs que : « Vingt ans après, le diagnostic qui a fait sa renommée et assuré son influence — considérable en certains milieux — paraît largement confirmé par les faits ».
Comme Guy Debord méprisait la presse, ne donnait jamais d'interview, ne passait aucune notice biographique, ni bien entendu de photos sur la couverture de ses livres, des rumeurs diverses et nombreuses se sont répandues sur sa personne. Ces quatre ouvrages s'emploient à rétablir la vérité.
Si toute son œuvre est d'un extrême intérêt, c'est avant tout à sa très grande lucidité qu'elle le doit : ainsi dit-il et nous le croyons sans peine : « Je n'ai jamais cru aux valeurs reçues par mes contemporains, et voilà qu'aujourd'hui personne n'en connaît plus aucune ».
Critique des critiques abondantes qui lui ont été adressées suite à l'assassinat de G. Lebovici, Guy Debord a ainsi décidé de répondre à des organes aussi divers et variés que Le Journal du Dimanche, Le Nouvel Observateur, France Soir, Le Provençal, Globe, Le Soir, Le Matin, Le Monde, Libération, Minute, Présent, Le Point, Le Quotidien de Paris ou VSD.
Il est d'ailleurs assez amusant que la plupart des auteurs de ces critiques sont d'anciens soixante-huitards recentrés dans cette clef de voûte de la société de consommation : c'est justement les média, transformés en vaste spectacle qui vont utiliser la discrétion de Debord pour monter une kabbale contre lui et le mettre en accusation, faisant comme ils le font si souvent, leurs choux gras de rumeurs exploitées au service du sensationnalisme. La fin de sa vie aura donc été marquée par l'assassinat le 5 mars 1984 de son éditeur et ami Gérard Lebovici qui l'avait édité et avait racheté une salle de cinéma du Quartier Latin pour n'y projeter que ses œuvres. En dehors d'une immense majorité d'ouvrages largement présentables, Lebovici, outre Debord, avait, pour asseoir carrément sa mauvaise réputation, édité également L'instinct de mort de Jacques Mesrine.
La fantasmagorie du moment établit alors que G. Debord entretient des liens — ouh le méchant ! — avec les milieux terroristes d'extrême-gauche (Action Directe en France, Brigades Rouges en Italie, Bande à Baader en Allemagne). Il s'est dès lors répandu la rumeur qu'il avait disparu après 1968, entre autre pour faire parler les bombes, un peu le même genre d'élucubrations que pour Jacques Vergès, à propos de la période dite “cambodgienne” de celui-ci. Comme tous les gens indépendants et qui n'appartiennent à aucune coterie, il sera accusé par les journaux de gauche d'être payé par la CIA, mais aussi — on n'est pas à une contradiction près — par les Soviétiques dans les journaux de droite, stratégies classiques pour discréditer les ennemis du système. Par exemple, aujourd'hui, on peut laisser entendre que les Ligues (dont la Ligue savoisienne et la mouvance padanienne de Bossi) sont payées par la Deutsche Bank (Donnerwetter, il fallait y penser !), la CIA, les mondialistes conspirateurs de Wall Street, pour affaiblir le pauvre nationalisme hexagonal qui veut tant de bien à ses administrés… Les diffamateurs ne pensent pas que leurs interlocuteurs peuvent simplement adhérer à ces mouvements identitaires, parce que le sentiment identitaire existe à l'état brut et que c'est le plus naturellement du monde que Savoisiens et Padaniens épousent les thèses fédéralistes. Quant au situationnisme, il traduisait tout bonnement la dérision qu'éprouvaient les gens à vivre dans la société gaullienne de l'époque, où l'on prenait assez souvent les Français pour des écoliers un peu simplets à qui il ne convenait pas de dire toutes les vérités.
Les vraies raisons de son ostracisation, Debord nous les expose car ce qu'il pensait a toujours été exposé au grand jour dans la plus grande transparence d'autant qu'il n'a jamais employé de pseudonymes. Mais ce qu'on lui reproche, c'est d'être resté fidèle à son choix de refuser cette société, ses célébrités, son spectacle du mensonge et donc aussi à la clandestinité où on l'a rejeté et ce que l'on veut confondre bien entendu avec de la clandestinité politique.
À la fin de sa vie son l'œuvre est close. Il a dit ce qu'il avait à dire, il le sait et son personnage désormais légendaire, semble-t-il pour longtemps, est forgé. Il veut que tout soit parfaitement clair par rapport à son œuvre et tient à mettre absolument les choses au point. Le but que s'était fixé l'Internationale Situationniste : ridiculiser la société gaulliste de l'époque a été atteint en donnant naissance au mouvement de mai 1968. En contrepartie, il sera, bien entendu, qualifié de tous les noms : Maître à penser, nihiliste, pseudo-philosophe, pape, solitaire, mentor, magnétiseur, pantin sanglant, fanatique de lui-même, diable, éminence grise, âme damnée, professeur ès-radicalisme, gourou, révolutionnaire de bazar, agent de subversion et de déstabilisation au service de l'impérialisme soviétique, Méphisto de pacotille, nuisible extravagant, fumeux, énigmatique, mauvais ange, idéologue, mystérieux, sadique fou, cynique total, lie de la non-pensée, envoûteur, redoutable déstabilisateur, enragé, théoricien. Certes tout n'est pas parfait dans le monde de l'après-gaullisme mais Debord était bien trop lucide pour croire en un changement de la nature humaine par la création de conseils ouvriers ou autres balivernes, en un mot, il prône un doute radical par rapport à quiconque se prononce pour une quelconque évolution de l'espèce humaine.
Il restera toujours aussi critique avant qu'après mai 1968, ne manquant jamais de dénoncer toutes les tares qui subsistent et même se multiplient avec toutes ses nuisances et ses miroirs aux alouettes, comme par exemple cette phrase qui veut dire beaucoup de choses comme c'est si souvent le cas chez Debord : « Il est vrai que je n'ai pas été souvent porté à expérimenter la “nouvelle cuisine” où quelque poivre vert essaie de couvrir le goût de l'élevage chimique des bestiaux, ni les dames aux voix factices qui font dans des termes risiblement similaires l'éloge des bonheurs-du jour ».
Il est cependant un passage étonnant dans son Panégyrique : oui, Debord a aimé quand même beaucoup de choses qu'il faut aimer en ce bas monde, je dirai même l'essentiel : il a aimé l'Auvergne, la nature, le bruissement du vent dans les branches, les orages, la voie lactée, la neige avec ses congères, les bûches qui crépitent dans l'âtre d'une maison de campagne isolée, c'est un Debord écologiste, panthéiste et romantique, sorte de Chateaubriand de l'Auvergne, Bellevue-la-Montagne étant son Combourg et qui montre indubitablement que le concept de patrie charnelle, même pour quelqu'un d'apparemment aussi parisien, n'est pas un vain mot mais au contraire un enchantement pour celui qui a toujours cultivé le scepticisme et qu'ici, pour la première fois, se laisse aller. Il faut avoir lu ces quatre pages, véritable hymne à la Haute-Loire, passage inattendu et sublime qui mériterait de prendre immédiatement place dans n'importe quelle anthologie de la littérature panthéiste.
Avant d'en finir, Debord avait sélectionné une série de photo de son album personnel agrémenté de citations. Il parait aujourd'hui chez Fayard. Il avait indiqué par une note à l'éditeur comment il devait être précisément composé. Le troisième tome ainsi que les suivants restés à l'état de manuscrit furent brûlés dans la nuit du 30 novembre 1994, jour de sa mort, selon sa volonté. Le 9 janvier 1995, Guy Debord, son art et son temps est diffusé sur Canal+. Par une lettre datée du 14 novembre 1994, le directeur de la chaîne avait été autorisé à programmer « une soirée Guy Debord, quand vous voudrez dans le mois de janvier 1995 ». Fidèle à sa parole, Guy Debord, lui, n'y était pas. Le 30 novembre, il réalise un dernier Potlatch, sa mort eut ceci d'admirable qu'elle ne peut passer pour accidentelle, en se suicidant.
Le but de cet ouvrage posthume est donc seulement de montrer quelle était l'apparence de l'auteur à différents âges et quels genres de visage l'ont toujours entouré (Alice Beckerho, sa compagne, le peintre Asger Jorn, etc.), quels lieux il a habités, et aussi la photographie de certains slogans graphités ça et là et qui ont fait date comme celui de 1953 « Ne travaillez jamais » ou « L'humanité ne sera heureuse que lorsque le dernier des bureaucrates aura été pendu avec les tripes du dernier des capitalistes », sur les murs de la Sorbonne en mai 1968. Oui, décidément, ces slogans ont eu une postérité incroyable encore aujourd'hui. Et son inspirateur se dévoile, son œuvre définitivement achevée.
Quant à l'étiquette, elle-même, de situationniste qui a collé à Debord, celui-ci en pense en 1983 exactement la même chose qu'en 1960, dans le numéro 4 de la revue Internationale Situationniste : « Il n'y a pas de “Situationnisme”. Je ne suis moi-même situationniste que du fait de ma participation, en ce moment et dans certaines conditions, à une communauté pratiquement groupée en vue d'une tache, qu'elle saura ou ne saura pas faire ». Et en 1983, il livre sa réflexion en ajoutant : « Je pense depuis 1968 que, pour l'essentiel, elle a su ». Nous pourrions ajouter que c'est à nous maintenant de savoir faire une nouvelle révolution. Au prix de l'exil (mais il eut « les plaisirs de l'exil comme d'autres ont les peines de la soumission »), Debord dresse un bilan très positif de sa vie car : « Il est beau d'avoir contribué à mettre en faillite le monde. Quel autre succès méritions-nous ?»
Aujourd'hui, ceux qui font semblant de croire à cette société du spectacle et y collaborent activement ont, bien sûr, lu ses livres. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous avons pu voir le soir de la mort de l'auteur, en commençant son journal télévisé, Patrick Poivre d'Arvor annoncer ce qui venait de se passer et citer la traditionnelle phrase de conclusion des auteurs issus du siècle d'or en lisant cette dernière phrase de Panégyrique : « Ici l'auteur arrête son histoire véritable. Pardonnez lui ses fautes ». Debord, pour une toute dernière fois, sera fidèle à ses écrits ; c'est ce qui s'appelle réaliser la quadrature du cercle.
► Pascal Garnier, Nouvelles de Synergies Européennes n°30-31, 1997.
Bibliographie :
- Guy DEBORD, "Cette mauvaise réputation…", Gallimard, 1993, 128 p.
- Panégyrique, tome premier, Gallimard, 1993, 85 p.
- Panégyrique, tome second, Fayard,1997, 85 p.
- Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici, 1993, 91 p.

 “Potlach” : succès posthume d'une revue
“Potlach” : succès posthume d'une revueCeux qui n'entendent pas se noyer dans la littérature “pataphysique” et veulent garder un regard serein et lucide sur le jeu social de notre belle société fin de siècle liront avec profit la reproduction d' une revue dont Guy Debord était l'un des principaux rédacteurs Potlatch. Cet auteur était encore bien jeune mais cela ne l'empêchait pas d'afficher un style déjà très particulier.
Ce livre qui en résulte est d'abord un témoignage sur une époque : celle de la reconstruction de l'après-guerre qui marque aussi le départ de ce que l'économiste Jean Fourastié a nommé d'une expression depuis passé à la postérité — “Les trente glorieuses” — époque pendant laquelle l'économie occidentale a connu une croissance jusqu'alors inédite dans l'histoire de l'humanité.
Mais cet ouvrage est également l'aventure d'un groupe contestataire qui allait beaucoup faire parler de lui : c'est “la bande à Guy Debord”, nommée d'abord “Internationale lettriste”, scission de la gauche lettriste intervenue en 1952 et qui ensuite allait devenir la fameuse “Internationale Situationniste”.
Potlatch était envoyé gratuitement à des adresses choisies par sa rédaction, et à quelques-unes des personnes qui sollicitaient de le recevoir. Il n'a jamais été vendu. Potlatch fut à son premier numéro tiré à cinquante exemplaires. Son tirage, en augmentation constante, atteignait vers la fin environ 500 exemplaires. Ce bulletin paru 27 fois, entre le 27 juin 1954 et le 5 novembre 1957. Debord et ses amis allaient ensuite s'exprimer dans d'autres revues de l'Intemationale Situationniste (1).
Au premier abord, cela parait proprement incroyable qu'un bulletin gratuit et au tirage aussi modeste connaisse une pareille notoriété posthume, grâce à de gros tirages d'abord en 1985 par les éditions Gérard Lebovici (ex-Champ libre) puis maintenant par des éditions de poche (10 à 15.000 exemplaires au minimum). Oserions-nous imaginer pareil sort pour la collection de Nouvelles de Synergies Européennes !
À sa première lecture, on est d'abord surpris par l'originalité de ses prises de position et on s'interroge pour savoir comment dans les années cinquante, dans le petit monde parisien, on pouvait ne pas s'extasier devant la politique américaine, la construction des grands ensembles et des grands magasins, l'avènement de la consommation, des médias et des sports de masse et les élucubrations d'Elvis Presley. Une croissance économique exponentielle, des loisirs en pleine explosion et des syndicats assez consensuels pour obtenir un bout de gras de la bête qui grandit… bref le bonheur pour tous dans cette machine à faire l'Occident qui tourne à plein régime… Il leur en fallait donc du courage ou bien alors de l'inconscience pour défier dès 1954 ce qu'ils appelaient déjà notre « sinistre civilisation occidentale ◄♣. Et surtout une incroyable dose de lucidité et une méfiance instinctive face à l'idéologie du progrès véhiculée par le capitalisme libre-échangiste mettant en place l'univers, le nôtre maintenant, qui se profilait alors à l'horizon à grands pas.
Raymond Aron, Henri Michaux, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Mauriac, Malraux, Le Corbusier, Queneau mais aussi le Parti Communiste, la bourgeoisie ou l'art abstrait, aucune des vedettes de la société du spectacle qui se met en place ne sont épargnées par le démasquage judicieux des situationnistes si prompts à dénoncer la chape de plomb faite de bêtise et de conformisme qui commence à s'abattre sur la société et dont bien peu arrivent à percevoir les mécanismes par lesquels les impostures finissent par occuper le devant de la scène. Leurs adversaires les accusent d'être purement nihilistes. Je pense qu'il ne faut pas être aussi catégorique et que derrière cette apparence, on peut deviner un solide bon sens qui lutte avec les moyens du bord sans avoir aucune possibilité concrète de résister autrement.
C'est ainsi qu'en dehors de toutes leurs exécrations, nous retrouvons tous ces florilèges judicieux qui ne peuvent que nous réjouir : « Même les plus imbéciles meneurs des bourgeoisies européennes comprendront plus tard à quel point les succès de leur “indéfectibles alliés” les menacent, les enferment dans leur contrat irrévocable de gladiateurs mal payés de l'“American Way of Life”, les condamnent à marcher et à crever patriotiquement dans les prochains assommoirs de l'Histoire, pour leurs quarante-huit étoiles légèrement tricolores ». Nous voyons en 1997, où nous en sommes dans le cadre de la politique mondiale imposée par les États-Unis.
Ensuite leur lucidité n'est pas moindre dans le domaine de l'urbanisme qui bouleverse la société : « Nos ministres et architectes urbanistes ont mis au point quelques taudis-types, dont les plans servent aux quatre coins de la France […]. Dans leurs œuvres un style se développe, qui fixe les normes de la pensée et de la civilisation occidentale du vingtième siècle et demi. C'est le style “caserne” et la maison 1950 est une boîte.[…] Les casernes civiles qui s'élèvent à leur place ont une laideur gratuite qui appelle les dynamiteurs ». C'est exactement ce que le système lui-même est arrivé à faire avec certaines grandes tours (tours des Minguettes à Vénissieux et aussi en banlieue parisienne par ex.). Avec leur regard d'une acuité étonnante, ils devinaient déjà le futur problème des banlieues lorsqu'ils notaient : « L'aspect morne et stérile de la plupart des quartiers nouveaux » pouvant produire des effets psychologiques sur les populations amenées à y habiter. Ils ne pouvaient donc mieux dire. En dehors de la rationalité marchande à l'œuvre, ils nommaient responsables les architectes, larbins des ministres qui acceptaient de faire ces basses œuvres à cause de : « leur pauvreté spirituelle et créatrice, leur manque total de simple humanité ».
Enfin pour “enrober” ce beau monde, l'alliance de l'humanitarisme et du show-business parachève l'édifice pour endormir le bon peuple. Le commentaire sur Chaplin dans le rôle du Bernard Koutchner de l'époque et de l'abbé Pierre (déjà) intitulé “Flic et curé sans rideau de fer” mérite d'être cité dans son intégralité : « Chaplin en qui nous dénoncions dès la sortie tapageuse de Limelight [comme] “l'escroc aux sentiments, le maître chanteur de la souffrance” continue ses bonnes œuvres. On ne s'étonne pas de le voir tomber dans les bras du répugnant abbé Pierre pour lui transmettre l'argent “progressiste” du Prix de la Paix. Pour tout ce monde, le travail est le même : détourner et endormir les plus pressantes revendications des masses. La misère entretenue assure ainsi la publicité de toutes les marques : la Chaplin's Metro Paramounty gagne, et les Bons du Vatican ». Par la suite cette pensée alors assez réactive allait donner naissance aux chefs d'œuvre de la pensée situationniste.
L'univers décrit par Potlatch est exactement le même que celui qu'en 1981 le cinéaste libertaire Rainer Werner Fassbinder racontait dans son sublime film Lola, histoire d'une femme allemande où justement en 1957, à Cobourg, petite ville du nord de la Bavière, se déroulait sous le regard acerbe du réalisateur le spectacle cruel d'une société qui déjà subissait les dégâts causés par le libéralisme américain en train de s'imposer dans cette Allemagne de la reconstruction : arasement des valeurs traditionnelles, prostitution généralisée et corruption des élites politiques, administratives et économiques. Les situationnistes n'employaient pas le mot de “corruption” sans doute pas encore passé dans le vocabulaire courant comme c'est la cas actuellement et sans doute parce qu'ils estimaient aussi que, dans son essence, même le système porte les germes de ce phénomène.
Bien entendu dans sa préface de 1985, Guy Debord ne cachait pas sa délectation d'assister au triomphe de ses thèses : « On sait aussi que personne, en dehors de l'Internationale situationniste, n'a plus jamais voulu formuler une critique centrale de cette société, qui pourtant tombe autour de nous ; déversant en avalanche ses désastreux échecs, et toujours plus pressées d'en accumuler d'autres ». Nous voyons où nous en sommes aujourd'hui… Pour les raisons contenues dans cette phrase, il n'est pas inutile de lire ce livre et par là même d'un peu mieux comprendre le monde d'aujourd'hui.
• Guy Debord présente Potlatch 1954-1957, édition augmentée. Gallimard / Folio n°2906, 1996, 291 p.
► Pascal Garnier, Nouvelles de Synergies Européennes n°30-31, 1997.
(1) Dans une prochaine livraison nous rendrons compte du volume paru chez Fayard, qui reproduit en fac-similé la revue de l'Internationale Situationniste.

 Debord : la révolution au service de la poésie
Debord : la révolution au service de la poésieVincent Kaufmann publie Guy Debord, la révolution au service de la poésie. Il écrit en introduction : « L'improbable lecteur sans qualités que j'imagine être ne demande rien à Debord. Ne demandant rien, il est aussi le contraire d'un lecteur frustré, lui reprochant d'être ceci plutôt que cela, ceci moins que cela, ou l'accusant de duplicité, ou lui faisant des scènes parce qu'il n'aurait pas été capable de produire la théorie de la prochaine révolution, et encore moins de s'y engager, avec ou sans bombes. Il ne demande rien, et peut-être reçoit-il du même coup plus, ayant alors la possibilité d'entrevoir Debord tel qu'il est, tel qu'il a été. Voir Debord tel qu'il est, c'est voir en lui l'enfant perdu qu'il a toujours voulu être, expert en perdition ou sensible à l'irrémédiable passage du temps. C'est voir en lui le guerrier mélancolique, qui est aussi un joueur, celui qui fait de la guerre un grand jeu. C'est voir l'amoureux des passions et l'expert en plaisirs, ceux de l'amour comme ceux de la dérive à travers les villes, qui construit des internationales pour vivre ces passions. Et c'est surtout voir comment ces différents aspects d'une même personnalité se fondent dans une œuvre, dans un style. Debord écrit en stratège, il fait de la politique en poète, il fait la guerre par goût du jeu, et il construit des avant-gardes par mélancolie, comme s'il prévoyait d'emblée leur dissolution à venir. Et il le fait en étant toujours lui-même, en restant le même. Tout compte fait, il n'est pas sûr que Debord soit un auteur difficile à comprendre ».
♦ Vincent Kaufmann, Guy Debord, la révolution au service de la poésie, 2001, Fayard, 412 p.
► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°57-58, 2002.
***
Archives et documents situationnistes
Chez Denoël est paru le n°1 des Archives et documents situationnistes dirigés par Christophe Bourseiller. Il écrit : « Les temps ont changé. Le spectacle n'a certes pas relâché le joug, mais l'Internationale situationniste ne saurait être appréhendée comme elle le fut auparavant. L'IS n'existe plus et Guy Debord est parti. Dans un tel contexte, il nous a paru essentiel d'oser passer à la recherche. Changement d'époque, changement de ton. Comme son titre l'indique, la revue se donne pour dessein l'étude de l'Internationale situationniste et des mouvements qui l'ont précédée ». À noter, un entretien avec Pierre-André Taguieff, sans doute l’élément le plus intéressant du dossier, et une étude très politiquement correcte de Bourseiller intitulée « Récupération à tous les étages. L'Internationale situationniste, Guy Debord et l'extrême droite ».
♦ Archives et documents situationnistes, 2001. Denoël. 172 p.
► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°57-58, 2002.
***
Situationnisme
Dans la lignée d'un des rares mouvements intelligents (en dépit des limitations de sa perspective) de la seconde moitié de ce siècle existe le Bulletin de la Bibliothèque des Émeutes. Son n°8 s'intitule « Le véritable contenu de la prochaine insurrection ». Au sommaire : « De l'histoire », « Remettre en marche la théorie des Conseils », « Du jeu », « Deux briseurs de jeu » (ou comment Jean-Pierre Voyer survit à Jacques Mesrine), « Catalogue », « La Bibliothèque des émeutes, du début à la fin ».
♦ Bulletin de la Bibliothèque des Émeutes n°8, Belles Émotions, Paris, 1995, 154 p.
► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°17, 1996.
***
Correspondance avec Guy Debord
Jean-François Martos publie Correspondance avec Guy Debord aux éditions “Le fin mot de l’Histoire”. Il écrit : « Intervenir dans le présent offre aussi l’intérêt non négligeable d’attiser plusieurs sujets encore brûlants. Et au-delà de cette évidence qu’une correspondance est à elle-même son propre but, ces lettres constituent objectivement une espèce de rapport, relatif notamment aux diverses façons de mieux perturber une si misérable époque. On n’est jamais si bien servi que par soi-même : si ce n’est qu’en 1932 que l’on put commencer à lire en français la correspondance entre Marx et Engels, le lecteur aura sensiblement moins attendu pour la présente. Comme je m’en suis occupé, il peut être sûr de son contenu : les aléas de l’écriture virtuelle, comme ses rectificatifs bien réels, n’auront aucune prise en la matière. En outre, l’état actuel de délabrement de l’édition fait que les éditeurs sont de moins en moins adéquats, quand ils ne sont pas franchement douteux ; aussi est-il souvent judicieux de s’auto-éditer chaque fois que cela est possible ».
• Jean-François MARTOS, Correspondance avec Guy Debord, Le fin mot de l’Histoire - BP n°274, F-75.866 Paris Cedex 18, 1998. 320 p.
► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°40, 1999.
***
Ligne de risque : organe du “Parti de la Scission”
Animée par Yannick Haenel, Ligne de risque est une revue non conformiste. Nous lisons dans l’éditorial du n°8-9 : « Un spectre hante le monde : celui de la servitude généralisée. La société planétaire est régie en fonction des impératifs du contrôle marchand, et cela à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le monde politique est partout l’apanage d’un ramassis désolant de pitres merdeux. L’oppression économique, dont ces pitres sont les valets, n’admet plus aucune contestation – ou alors le système prétend désigner ses adversaires. Le faux monnayage médiatique exhibe ainsi des alternatives qu’il prend soin de choisir ou grotesques ou abjectes, de telle manière qu’à la fin ne subsiste que son propre mensonge. Quelques intellectuels parlent avec légèreté de “fin de l’histoire” sans comprendre que cela signifie l’animalisation de l’homme. (…) Ligne de risque n’intervient pas directement dans la guerre sociale. L’émancipation de l’humanité n’est pas, n’a jamais été son but ; pas plus qu’il n’était celui du Marquis de Sade. Cela ne nous empêche pas d’entrer en rapport avec tous ceux qui entendent RÉSISTER à l’accroupissement général. Essentiellement, Ligne de risque veut être en 1998 la force la plus audacieuse du PARTI DE LA SCISSION, ce parti qui désigne la division comme son objectif et qui ne tend par lui-même à rien de social. “Nous sommes donc devenus, écrit Debord, les émissaires du Prince de la Division, de 'celui à qui on a fait du tort', et nous avons entrepris de désespérer ceux qui se considéraient comme les humains” ».
• Ligne de risque, 16, rue Lauriston, F-75.016 Paris.
► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°40, 1999.

pièces-jointes :
Un stratège de la subversion : Guy Debord, l’irrécupérable
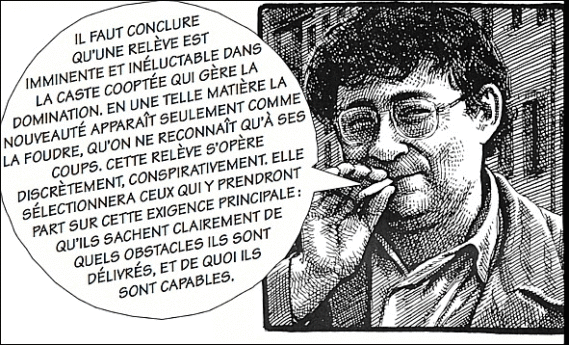 La publication, en près de deux mille pages, des Œuvres de Guy Debord (1931-1994) fournit l’occasion d’aller au-delà de la légende situationniste, et de saisir la prodigieuse cohérence d’une pensée qui, parce qu’elle n’a jamais renié sa dimension révolutionnaire, nous offre les meilleures clés pour comprendre notre temps.
La publication, en près de deux mille pages, des Œuvres de Guy Debord (1931-1994) fournit l’occasion d’aller au-delà de la légende situationniste, et de saisir la prodigieuse cohérence d’une pensée qui, parce qu’elle n’a jamais renié sa dimension révolutionnaire, nous offre les meilleures clés pour comprendre notre temps. Situation paradoxale que celle de Guy Debord, dans le panorama intellectuel français ; d’un côté, tout le monde le cite, fait référence à lui, jusqu’aux agents même du spectacle dont il aura été toute sa vie l’adversaire ; d’un autre côté, on ne peut qu’être frappé de l’étrange discrétion de la presse devant la parution en volume de l’ensemble de ses œuvres (1). Un tel livre, pourtant, qui rassemble, outre ses ouvrages déjà publiés, tout un précieux recueil de lettres, de directives, d’interventions, d’articles parus en revues, de notes inédites, est d’évidence un événement : permettant, tout à la fois, d’éclairer le cheminement de cette pensée, année par année, et d’en saisir l’impressionnante cohérence. Mais tout se passe comme si Debord, désormais, se devait d’être ramené à quelques clichés, à quelques formules stéréotypées et affadies sur la « société du spectacle » ; et cela, au détriment du parti pris indéfectiblement révolutionnaire de celui qui n’aura eu d’autre objectif, dans ses textes comme dans sa vie, que de nuire à l’ordre établi — ou, du moins, de ne rien lui concéder.
Au début des années 1950, Debord est au centre d’un petit groupe de jeunes gens qui s’évertuent, dans la lignée de certaines avant-gardes du début du siècle, à soutenir que l’art est mort en tant qu’entité « séparée », que la poésie doit désormais passer dans la vie. Dada, pensent-ils, a voulu supprimer l’art sans le réaliser ; le surréalisme a voulu réaliser l’art sans le supprimer : c’est précisément cet antagonisme qu’il s’agit de dépasser. Chaque vie doit être inventée, et non subie ; la ville (en l’occurrence Paris) est le territoire même des « dérives », des aventures (d’où le scandale fomenté, par exemple, contre Le Corbusier, coupable selon eux de soutenir une conception de l’urbanisme visant à « détruire la rue »). L’objectif est de « créer des situations » — ce qui implique un dédain affirmé envers tout l’art existant, et plus généralement envers toute culture « aliénée », coupée de l’expérience directe. Tout au plus peut-on prendre acte de la « décomposition » de cette culture, et imaginer (après Lautréamont) les techniques permettant de la « détourner »…
Dans une deuxième période (correspondant, en gros, au passage de l’Internationale lettriste à l’Internationale situationniste), Debord va très nettement élargir le champ d’action — c’est-à-dire le politiser. La contestation de la culture débouche logiquement sur celle de la société. La rencontre avec Marx était inévitable — encore qu’il s’agisse, en ce cas, d’un marxisme hétérodoxe, aux antipodes du communisme officiel (pour Debord et ses amis, c’est la « contre-révolution » qui a triomphé, au XXe siècle, lorsque l’État totalitaire s’est substitué en Russie au pouvoir des soviets, ou lorsque les soulèvements libertaires de la guerre civile espagnole ont été écrasés par la bureaucratie stalinienne).
Debord, surtout, perçoit ceci : la logique de la « marchandise », dont Marx avait analysé le lien au système de production, s’étend désormais à tous les aspects de la vie quotidienne ; la part de « loisir » dégagée par l’évolution technique, loin de susciter des libertés supplémentaires, débouche sur l’expansion du spectacle, propulsant des besoins factices sans cesse renouvelés, soumettant nos vies à des représentations manipulées et falsifiées, qui deviennent notre rapport au monde. C’est l’époque, pour Debord, de nouvelles complicités internationales, d’alliances tactiques scandées par des « manifestes » (le groupe ne cesse de se recomposer), et aussi d’une intense élaboration théorique — ce qui débouchera, en 1967, sur ce livre décisif qu’est La Société du spectacle, implacable ensemble de thèses impeccablement martelées.
« Le spectacle, écrit Debord, n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images » ; la « société du spectacle » n’est pas seulement l’hégémonie du modèle médiatique ou publicitaire, mais, au-delà, le « règne autocratique de l’autonomie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable, et l’ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne ». On connaît la suite : la propagation souterraine de ces thèses, leur ramification dans le milieu étudiant, de Strasbourg à Nanterre, et pour finir l’explosion de Mai 68, dont l’esprit situationniste apparaît comme le foyer secret, brûlant, irradiant, peut-être moins par son influence directe (notamment, à la Sorbonne, sur le Comité pour le maintien des occupations) que par son inspiration diffuse. C’est lui qui vibre alors dans les slogans, les affiches, les inscriptions qui envahissent les rues.
La suite est plus sombre. Debord se rend compte, assez vite, que ce qu’il a propulsé risque, par extension, de sombrer dans le lieu commun, c’est-à-dire d’être dilué dans une « contestation » banalisée, conformiste. D’où la dissolution de son « Internationale » (qui n’a jamais, au mieux, compté qu’une quinzaine de membres), le repli, les exils volontaires (notamment en Italie, occasion de démontrer la vraie nature du « compromis historique » sollicité par les communistes, et d’indiquer, avec une imparable lucidité, la manipulation et l’infiltration des Brigades rouges par le pouvoir d’État).
Rencontre, ensuite, avec un mécène, Gérard Lebovici, dont les éditions publieront les auteurs de prédilection de Debord (de Gracián à Orwell), et qui consacrera une salle à la diffusion exclusive de ses films (car toute cette aventure aura été ponctuée par une singulière activité cinématographique, visant à détruire le spectacle de l’intérieur, avec ses propres armes retournées). Lebovici, un jour, sera assassiné, dans des circonstances mal élucidées. Debord, lui, de plus en plus irréductible, de plus en plus isolé dans sa radicalité, à l’heure où la plupart des soixante-huitards se rallient à l’ordre libéral établi, consacrera ses derniers efforts à riposter aux images (le plus souvent calomnieuses) qui sont données de lui, et de ses œuvres.
S’engageant dans une écriture à la fois classique, subversive, souveraine, condensée, désabusée, n’hésitant plus désormais (ce qui culmine dans le prodigieux Panégyrique) à évoquer sa propre expérience, à la première personne — non par narcissisme (car le narcissisme est aussi l’un des ingrédients du spectaculaire), mais plutôt pour suggérer que la résistance au monde intégralement marchandisé revient aussi à affirmer, envers et contre tout, qu’une autre façon de vivre est possible que celle qui nous est imposée.
Le livre majeur de cette ultime période, c’est sans doute les Commentaires sur la société du spectacle, de 1988, où Debord étend et approfondit ses analyses de 1967, en nous livrant le diagnostic le plus pénétrant qui soit sur le monde contemporain, et les principales clés permettant de le comprendre. Un an avant la chute du mur de Berlin, il pressent que l’opposition entre la forme « concentrée » du spectacle (les régimes communistes) et sa forme « diffuse » (le capitalisme occidental) est sur le point d’être surmontée, fondue dans un « spectaculaire intégré » régnant désormais planétairement sans partage. Ses traits caractéristiques ? Le « renouvellement technologique incessant » (par ex., la marchandise informatique imposée, transformant tout utilisateur en client assujetti) ; la « fusion économico-étatique » (l’absorption de l’État dans le marché) ; le « secret généralisé » (les vraies décisions sont inaccessibles, le modèle mafieux triomphe dans l’instance politique) ; le « faux sans réplique » (pour la première fois, les maîtres du monde sont aussi ceux de ses représentations) ; le « présent perpétuel » (abolition de toute conscience historique).
Cela crée un univers de servitude volontaire sans précédent (la véritable nouveauté du spectacle, selon Debord, c’est « d’avoir pu élever une génération pliée à ses lois ») : « Qui regarde toujours, pour savoir la suite, n’agira jamais, et tel doit bien être le spectateur. » L’heure, d’évidence, n’est plus aux grandes utopies collectives, le spectacle a tout envahi, tout absorbé, y compris les critiques partielles, localisées, de son système, qui n’en visent que les effets périphériques — il n’en est pas moins possible de refuser radicalement ce système. Ce qui, au demeurant, chez Debord, n’exclut pas une certaine tonalité de nostalgie : la régression est telle, désormais, qu’il peut être révolutionnaire de regretter certains aspects révolus du passé — ceux, justement, que le spectacle a anéanti…
Au total, donc, un volume passionnant, où l’on peut suivre le parcours de Debord dans toutes ses étapes — dont aucune n’est le reniement des précédentes. À noter : la fulgurance de certains textes ici publiés, jusqu’alors inédits, ou introuvables. Par exemple, cette « Adresse aux révolutionnaires d’Algérie », de 1965, à l’époque où le putsch de Houari Boumedienne évinça M. Ahmed Ben Bella ; ou cet étonnant article de 1967 sur la révolution culturelle chinoise, analysée dans toutes ses contradictions ; ou encore, plus près de nous, ces « Notes inédites sur la question des immigrés » (décembre 1985) — où Debord pose la question dérangeante entre toutes de savoir à quoi, exactement, les immigrés sont sommés de « s’intégrer », au moment où le spectacle est en passe de complètement américaniser ce qui reste de la France…
Autant d’analyses précises, clairvoyantes, anticipatrices, ne cédant à aucun lieu commun (aux antipodes, notamment, des stéréotypes et des aveuglements de la gauche conformiste). Il ne s’agit pas seulement, ici, de remarquer que Debord n’a jamais manifesté la moindre complaisance envers le « camp socialiste », ou les dictatures du tiers-monde ; ou encore faut-il se demander pourquoi, chez lui, c’est la recherche du point de vue le plus révolutionnaire qui génère, sur tous ces sujets, le maximum d’intelligence et de lucidité.
À noter aussi l’extraordinaire intérêt de ses textes cinématographiques. Car même s’il s’agissait, pour lui, de détruire ce code de l’intérieur (en brisant toute fascination spectatrice, en dissociant systématiquement l’image et le son, en affirmant le primat de la pensée sur le « visuel », le plus souvent ramené à des images documentaires ou à des plans détournés), il n’en reste pas moins que les films de Debord (et par-dessus tout ce chef-d’œuvre qu’est In girum imus nocte et consumimur igni) représentent une tentative inouïe de projeter du côté de la conscience (historique et subjective) un art en principe voué à l’évacuer. D’où des films qui tiennent à la fois de l’essai, de la confession, de la méditation, de la compréhension du monde à travers ses images, et qui ne peuvent se comparer à rien d’autre — sinon, peut-être, aux ultimes réalisations de Jean-Luc Godard (et l’on se prend du reste à regretter qu’aucun dialogue entre ces deux géants, qui se détestaient cordialement, n’ait jamais pu s’établir) (2)…
Il est permis, certes, de ne pas adhérer aveuglément à tout ce qu’a écrit ou soutenu Debord. De trouver excessive et injuste, par ex., sa répudiation quasi systématique de tout l’art et de toute la littérature de son temps — alors qu’il est clair désormais que c’est précisément toute l’effervescence créatrice du XXe siècle que le spectacle tend à détruire, ou à rendre « illisible ». Ou encore : il n’est pas interdit de trouver quelque peu suspecte la tendance de Debord à opérer, dans les groupes dont il s’est entouré, des suites régulières de ruptures, d’exclusions, d’épurations, visant parfois ceux qui lui étaient les plus proches, réduisant d’autant la portée collective (donc politique) de ses positions. Mais peut-être tout cela, au fond, n’était-il que la rançon obligée de son intransigeance, de son exigence quasi absolue de radicalité — lui qui savait que tout groupe subversif doit s’attendre à être, tour à tour, « égaré, provoqué, infiltré, manipulé, usurpé, retourné ».
C’est cette radicalité, en somme, qui permet à la pensée de Debord d’être la seule, aujourd’hui, à pouvoir rendre compte de façon critique de tous les aspects de la marchandisation du monde, et de la « fausse conscience » qu’elle a pu propager. En définitive, c’est même en cela que Debord demeure, malgré tous les effets de mode destinés à rendre sa pensée inoffensive, profondément irrécupérable. « Il est assez notoire, écrivait-il, que je n’ai nulle part fait de concessions aux idées dominantes de mon époque. » Telle est, en effet, la grande leçon qu’il nous lègue — et qu’il faut savoir, comme lui, faire passer dans nos vies.
► Guy Scarpetta, Le Monde Diplomatique n°629, août 2006.
◘ L'auteur : écrivain. A publié L’Âge d’or du roman (Grasset, 1996), Pour le plaisir (Gallimard, 1998), Variations sur l’érotisme (Descartes et Cie, 2004).
(1) Guy Debord, Œuvres, Gallimard, coll. "Quarto", 2006, 1904 pages, 31 € ; édition établie et annotée par Jean-Louis Rançon, en collaboration avec Alice Debord.
(2) Cette proximité contradictoire entre Debord et Godard a été très bien pointée par Cécile Guilbert (Pour Guy Debord, Gallimard, 1996), dans l’un des meilleurs essais qui lui ont été consacrés.

 Debord est mort… Vive Debord !
Debord est mort… Vive Debord !Guy Debord, fondateur et principal théoricien de l’Internationale situationniste, s’est donné la mort le 30 novembre 1994 à l’age de 62 ans. Contempteur de la « société du spectacle », ce stratège de la révolte du fut aussi le dernier grand animateur d’avant-garde de notre siècle. Avec lui s’éteint une époque.
[Ci-contre : Guy Debord, Michèle Bernstein et Asger Jorn à Paris, 1961. Photo : Ib Hansen ©]
« J’ai mérité la haine universelle de la société de mon temps, et j’aurais été fâché d’avoir d’autres mérites aux yeux d’une telle société » (1). Celui qui exprime ainsi l’exécration de son époque, teintée d’une misanthropie hautaine, ne se nomme ni Lacenaire ni Bakounine, ni Maldoror, ni Mafarka, bien qu’il tienne un peu de tous ceux-là : il s’agit de Guy Debord.
Débauches parisiennes
De sa vie, nous ne savons que ce qu’il a voulu en laisser transparaître, c’est-à-dire bien peu de choses : l’homme avait un goût immodéré pour la discrétion, et se plaisait à entretenir le secret autour de toutes ses activités — un luxe peu commun, à l’heure où dominent les vendeurs d’images et les acheteurs de réputation. Se flattant de ne point chercher compagnie — « mon entourage n’a été composé que de ceux qui sont venus d’eux-mêmes et ont su se faire accepter. Je ne sais pas si un seul autre a osé se conduire comme moi, dans cette époque » —, Debord n’accorda jamais une interview, et les rares photographies que l’on possède sont usées à force d’avoir été surexploitées par les rédactions. Ses proches ont respecté la « loi du silence » qu’il s’imposait à lui-même, et pas un n’a livré de détails biographiques. De sorte que l’on est bien obligé de laisser à Debord le soin d’évoquer Debord — et de se référer au Panégyrique (2) qu’il a immodestement dressé de sa propre personne.
On y apprend à vrai dire l’essentiel en peu de pages. lssu d’un milieu familial propice à la germination du virus révolutionnaire (c’est-à-dire petit-bourgeois et provincial, de surcroît ruiné par la crise de 1929), Debord cesse assez rapidement ses études pour se consacrer paresseusement à la vie de bohème. Il s’installe à Paris, errant dans un quadrilatère sis « au sud de la Seine et au nord de la rue de Vaugirard, à l’est du carrefour de la Croix-Rouge et à l’ouest de la rue Dauphine » — précisions d’importance car, pour Debord, les lieux ne sont jamais neutres mais déterminent au contraire par leur conformation la façon dont les hommes pourront les habiter. « C’était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n’importe où ailleurs. […] On n’en avait pas encore chassé et dispersé les habitants. Il y restait un peuple, qui avait dix fois barricadé ses rues et mis en fuite les rois. C’était un peuple qui ne se payait pas d’images. On n’aurait pas osé, quand il vivait dans sa ville, lui faire manger ou lui faire boire ce que la chimie de substitution n’avait pas encore osé inventer. Les maisons n’étaient pas désertes dans le centre, ou revendues à des spectateurs de cinéma, qui sont nés ailleurs, sous d’autres poutres apparentes. La marchandise moderne n’était pas encore venue nous montrer tout ce que l’on peut faire d’une rue. Personne, à cause des urbanistes, n’était obligé d’aller dormir au loin » (3).
« Un extrême nihilisme »
Debord a vingt ans et son tempérament révolté n’a pas encore trouvé d’exutoire politique ou littéraire (« l’extrémisme s’était proclamé indépendant de toute cause particulière, et s’était superbement affranchi de tout projet »). Ses dieux se nomment alors Lacenaire, Lautréamont et Arthur Cravan. Il communie avec eux en louche compagnie : « Plus de la moitié des gens que, tout au long des années, j’ai bien connus avaient séjourné, une ou plusieurs fois, dans les prisons de divers pays ; beaucoup, sans doute, pour des raisons politiques, mais tout de même un plus grand nombre pour des délits ou des crimes de droit commun ».
Ces premiers temps, « où un extrême nihilisme ne voulait plus rien savoir, ni surtout continuer, de ce qui avait été antérieurement admis comme l’emploi de la vie ou des arts », placèrent Debord dans une position de réfractaire qu’il ne devait jamais quitter par la suite, prenant soin de toujours s’entourer « des gens bien sincèrement prêts à mettre le feu au monde pourvu qu’il ait plus d’éclat ». Ce panache teinté d’anarchisme et de nihilisme, ce souci du style collera au personnage, et donnera à lui seul tout son sel à l’aventure situationniste.
Le dernier héritage de cette jeunesse insoumise fut enfin un penchant immodéré pour la boisson, que Debord résuma ainsi dans de très belles pages consacrées à l’ivresse : « Quoique ayant beaucoup lu, j’ai bu davantage. J’ai écrit beaucoup moins que la plupart des gens qui écrivent ; mais j’ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent. […] Je suis d’ailleurs un peu surpris, moi qui ai dû lire si fréquemment, à mon propos, les plus extravagantes calomnies ou de très injustes critiques, de voir qu’en somme trente ans, et davantage, se sont écoulés sans que jamais un mécontent ne fasse état de mon ivrognerie comme d’un argument, au moins implicite, contre mes idées scandaleuses » (4).
À la conquête des avant-gardes
Le jeune Debord va se trouver à la confluence des avant-gardes de l’après-guerre : l’Internationale des artistes expérimentaux (1948-1951) qui publiait la revue Cobra (pour Copenhague-Bruxelles-Amsterdam), le lettrisme première époque (1946-1952), fondé par Isidore Isou, le Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste, créé en 1953 par Asger Jorn (5). Ces groupes — dont l’influence comme la notoriété furent toujours très minces — avaient en commun la volonté de se substituer au vieux surréalisme comme contestation des formes dominantes de l’art et de la vie : critique des récupérations marchandes de l’art moderne (et de son essoufflement créatif), refus de l’architecture fonctionnaliste alors triomphante, dislocation du langage articulé (dans la veine « motlibriste » du premier futurisme).
C’est aussi l’époque des joyeuses provocations : celle où Michel Mourre pénètre dans Notre-Dame de Paris déguisé en dominicain et lance un sermon nietzschéen en pleine messe de Pâques ; celle où l’atelier d’art expérimental organise en Europe les expositions d’un artiste nommé Congo, qui recueille l’assentiment de bien des critiques avant-gardistes et se révèle être… un chimpanzé.
Guy Debord, affilié aux lettristes, s’en distingue toutefois par une volonté révolutionnaire tranchée, plus politique qu’artistique, plus vécue que pensée ou représentée. Il groupe autour de lui les éléments les plus radicaux du mouvement — Serge Berna, Jean-Louis Brau et Gil Wolman — et la rupture sera consommée en 1952. Détail amusant : c’est la venue de Charlie Chaplin en Europe qui sera à l’origine de la scission. Un groupe mené par Debord diffuse un tract violemment hostile au cinéaste américain et perturbe ses conférences de presse. Le tract commence par des lignes vengeresses — « cinéaste sous-Mack Sennett, acteur sous-Max Linder, Stavisky des larmes des filles-mères abandonnées et des petits orphelins d’Auteuil, vous êtes Chaplin, l’escroc aux sentiments, le maître chanteur de la souffrance » — et s’achève par un catégorique « Go home Mister Chaplin ! ». Les lettristes, embarrassés par le scandale, se désolidarisent des signataires, qui créent alors l’Internationale lettriste (IL). Le 22 juin 1954 paraît le premier numéro de Potlatch, bulletin d’information du groupe français de l’IL, dont le ton se fait nettement plus activiste : « Potltach est la revue la plus engagée du monde : nous travaillons à l’établissement conscient et collectif d’un nouvelle civilisation ». Guy Debord collabore également avec les surréalistes révolutionnaires de la revue belge Les Lèvres nues, où il publie un « Mode d’emploi du détournement » (n°6) et une « Théorie de la dérive » (n°10). Entre 1955 et 1958 sont ainsi mis en place les éléments fondateurs de l’Internationale situationniste, dont Debord allait être le principal théoricien durant près de quinze ans.
 La conférence de Cosio d’Arroscia
La conférence de Cosio d’Arroscia[Ci-contre : Les participants de la Conférence de Cosio d’Arroscia le 27 juillet 1957, qui verra la naissance de l’Internationale situationniste. De gauche à droite : Pinot-Gallizio, Piero Simondo, Elena Verrone, Michèle Bernstein, Guy Debord, Asger Jorn, Walter Olmo]
L’Internationale situationniste va naître de la Conférence de Cosio d’Arroscia (27 juillet 1957), où se réunissent les délégués de l’Internationale lettriste, du MIBI (Mouvement international pour un Bauhaus Imaginiste) et du Comité psychogéographique de Londres. L’objet principal de cette conférence est en fait la discussion du rapport préparatoire rédigé par Guy Debord au début de l’année (Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale).
L’ouverture de ce Rapport ne laisse aucun doute quant à l’esprit de son auteur : « Nous pensons d’abord qu’il faut changer le monde. Nous voulons le changement le plus libérateur de la société et de la vie où nous nous trouvons enfermés. Nous savons que ce changement est possible par des actions appropriées ». Il s’agit en premier lieu de désigner clairement l’ennemi : c’est bien sûr la civilisation bourgeoise, la « domination rationnelle des nouvelles forces productives ». Si, en 1957, Debord n’a pas encore identifié le spectacle comme forme achevée de la suprématie bourgeoise, il souligne déjà avec acuité les procédés nouveaux de récupération des pensées subversives. La grande industrie accomplit la banalisation de la vie quotidienne que propose l’idéologie dominante. En même temps, le monde bourgeois fragmente à l’infini la culture moderne, au point de tolérer, voire d’encourager dans ses marges les minorités contestataires dont l’action est recyclée pour renforcer le système tout en cautionnant son apparent pluralisme. Paradoxe du révolutionnaire : sa révolution a toujours une valeur d’usage ou une valeur d’échange pour la société qu’il veut contester.
Debord écrit ainsi : « Une des contradictions de la bourgeoisie, dans sa phase de liquidation, se trouve être ainsi de respecter le principe de la création intellectuelle et artistique, de s’opposer d’emblée à ces créations, puis d’en faire usage. C’est qu’il lui faut maintenir dans une minorité le sens de la critique et de la recherche, mais sous condition d’orienter cette activité vers des disciplines utilitaires strictement fragmentées, et d’écarter de la critique et de la recherche d’ensemble. Dans le domaine de la culture, la bourgeoisie s’efforce de détourner le goût du nouveau, dangereux pour elle à notre époque, vers certaines formes dégradées de nouveauté, inoffensives et confuses. Par les mécanismes commerciaux qui commandent l’activité culturelle, les tendances d’avant-garde sont coupées des fractions qui peuvent les soutenir, fractions déjà restreintes par l’ensemble des conditions sociales. Les gens qui se sont fait remarquer dans ces tendances sont admis généralement à titre individuel, au prix des reniements qui s’imposent : le point capital du débat est toujours le renoncement à une revendication d’ensemble et l’acceptation d’un travail fragmentaire, susceptible de plusieurs interprétations. c’est ce qui donne à ce terme même d’"avant-garde", toujours manié en fin de compte par la bourgeoisie, quelque chose de suspect et de ridicule » (6).
L’Internationale situationniste visera donc à dépasser le mouvement épuisé des avant-gardes du début de siècle (dadaïsme, futurisme, surréalisme) en prenant la mesure nouvelle du monde bourgeois et, surtout, en proposant d’autres pratiques et d’autres concepts. Le tort des avant-gardes, selon Debord, est d’avoir limité leur rôle au seul statut du négatif : négatif de l’art, de l’écriture, de la représentation, de la conscience, de la raison, etc. Mais cette visée a été rejointe et finalement assimilée par l’évolution du monde occidental, marquée par le phénomène de « décomposition idéologique et culturelle » : destruction des grands récits, des normes, des doxas et intégration de tous les phénomènes présents dans la répétition monotone et stupide des slogans (commerciaux à l’Ouest, carcéraux à l’Est).
Voilà pourquoi, selon Debord, une action révolutionnaire ne doit plus emprunter les chemins de la créativité (désormais confisquée par la bourgeoisie, qui place l’art moderne dans les musées et la culture dans les ministères). Il s’agit plutôt de définir « de nouveaux désirs », de construire « des ambiances nouvelles » en détournant les éléments préfabriqués de la culture dominante. Ainsi sera l’IS, telle que l’on peut encore aujourd’hui la percevoir en relisant ses textes et en étudiant ses manifestations : non seulement une critique idéologique rigoureuse, mais aussi, et surtout, une ambiance, une atmosphère, un style. Un air de fête et de révolte, une subversion en acte : « La formule pour renverser le monde, nous ne l’avons pas cherchée dans les livres, mais en errant. C’était une dérive à grande journée, où rien ne ressemblait à la veille ; et qui ne s’arrêtait jamais. Surprenantes rencontres, obstacles remarquables, grandioses trahisons, enchantements périlleux, rien ne manqua dans cette poursuite d’un autre Graal néfaste, dont personne n’avait voulu » (7).
 Détruire l’idée bourgeoise du bonheur
Détruire l’idée bourgeoise du bonheur[Ci-contre : Affiche placardée à Nanterre, le 30 janvier 1968. Si les situationnistes ne parvinrent pas à démultiplier les effets de la révolte étudiante, comme ils l’espéraient, ils lui donnèrent au moins le meilleur de son style]
Le Rapport se conclut par une invite impérative à l’action, « Nos tâches immédiates », où Debord écrit notamment : « Nous devons soutenir, auprès des partis ouvriers et des tendances extrémistes existant dans ces partis, la nécessité d’envisager une action idéologique conséquente pour combattre, sur le plan passionnel, l’influence des méthodes de propagande du capitalisme évolué ; opposer concrètement, en toute occasion, aux reflets du mode de vie capitaliste d’autres modes de vie désirables ; détruire, par tous les moyens hyper-politiques, l’idée bourgeoise du bonheur. » Les concept de dérive et de détournement, que Debord avait proposés à l’époque lettriste, devront désormais s’orienter vers « la construction des situations, c’est-à-dire la construction concrète d’ambiances momentanées de la vie, et leur transformation en une qualité passionnelle supérieure ».
De 1958 à 1972, l’Internationale situationniste va donc se livrer à une agitation révolutionnaire permanente, dont on peut retrouver les échos en lisant les douze numéros de son Bulletin (8). Le point culminant en sera bien sûr mai 68, où les situationnistes, alliés pour la circonstance avec le mouvement des Enragés de Nanterre, se placeront dès l’origine dans le camp des jusqu’au-boutistes en s’opposant violemment à la récupération marxiste (stalinienne ou maoïste) de la révolte. Ils sont là le 10 mai, lorsque soixante barricades s’élèvent pour isoler la Sorbonne et combattre les forces de l’ordre. Ils fondent le 15 mai le Comité d’occupation de la Sorbonne, qui appelle sitôt formé à la grève sauvage dans tous le pays et à la formation des Conseils ouvriers (contre le patronat, bien sûr, mais aussi contre les syndicats qui souhaitent une reprise du travail et l’engagement de réformes gouvernementales).
Le reflux de la contestation va amorcer le déclin de l’IS, née de la révolte, morte dans la révolte. Dès juillet 1969, Debord n’assume plus la rédaction du Bulletin. Il amorce une critique de son propre mouvement, s’en prenant autant aux « situs » historiques, qui ne sont pas suffisamment parvenus à incarner leurs révoltes, qu’aux « pro-situs », carriéristes de la révolution qui profèrent des slogans radicaux et se gardent bien d’en imaginer la concrétisation historique. L’IS s’auto-dissout en 1972.
L’expérience situationniste appelle bien sûr des critiques. On peut d’abord lui reprocher son sectarisme, et lui appliquer cette remarque que Debord formulait déjà à l’encontre des lettristes : « L’IL, entre 1952 et 1955, après quelques épurations nécessaires, s’est orientée continuellement vers une sorte de rigueur absolue menant à un isolement et à une inefficacité également absolus, et favorisant à la longue un certain immobilisme, une dégénérescence de l’esprit de critique et de découverte » (9). Le moins que l’on puisse dire, c’est que les situationnistes (à commencer par Debord lui-même) n’ont guère pris la mesure de cet avertissement : sur 70 membres effectifs, on ne compte pas moins de 45 exclusions, 19 démissions et 2 scissions ! (10).
Si les situationnistes passèrent maîtres dans l’art de la révolte, il leur manqua surtout une réflexion sur le sujet historique de leur révolution. Bien que férus de stratégies (Debord se plaisait à citer abondamment Sun-Tsu et Clausewitz), ils restèrent aveugles devant le mouvement général d’embourgeoisement du prolétariat, accéléré lors des Trente Glorieuses, mouvement qui privait la rhétorique anarcho-marxiste de toute base concrète dans la société. Mais telle fût sans doute la grandeur de l’IS : rassembler quelques esprits forts et indépendants, dont le destin individuel était assurément plus riche d’enseignements que leurs dérisoires assauts collectifs contre l’ordre bourgeois. Ainsi doit se comprendre l’évolution de Guy Debord après 1968, toujours plus enfermé dans une solitude hautaine, acérant son style. Son propos gagna en pertinence ce que mai 68 avait dissipé en violence, et la distance prise à l’égard du monde n’en rendit que plus implacable sa critique.
La société du spectacle
C’est en 1967 que parut la première édition de l’essai fondamental de Guy Debord, La Société du spectacle, aussi peu lu qu’universellement récupéré (11) — au point que l’expression paraît aujourd’hui largement galvaudée par cet usage généralisé, bien que les thèses n’aient rien perdu de leur puissance analytique et mobilisatrice. Le théoricien situationniste y expose une nouvelle dimension des sociétés marchandes, le spectacle, conçu comme accumulation de représentations. Désormais, plus rien n’est vécu directement, tout passe par la médiation d’images-signes spécialisées, manipulées et diffusées à l’échelle planétaire. « Inversion concrète de la vie », le spectacle sépare ce que l’expérience unissait autrefois : informations, propagandes, publicités, divertissements dessinent désormais le monde réel, tandis que par ce subterfuge sont mises hors d’atteinte les structures socio-économiques qui le sous-tendent.
Le spectacle n’est pas seulement un ensemble d’images, « mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images » (12). Sens commun de notre époque, il en fixe aussi l’emploi du temps, de manière insidieuse et pourtant directive : c’est « l’auto-portrait du pouvoir à l’époque de sa gestion totalitaire des condition d’existence ». On fixait jadis les individus dans des ordres et des statuts immuables ; on leur assigna ensuite une place dans les usines, les casernes, les prisons ou les asiles ; on les enchaîne maintenant devant leur poste de télévision. L’accumulation des images donne ainsi l’idée que tout est permis, mais signifie concrètement que plus rien n’est possible. Regardez, mais surtout ne touchez à rien ! Le monde moderne devient un musée, sans autre gardien que la passivité des spectateurs domestiqués (et, de temps en temps, la matraque hertzienne des flics cybernétiques).
Alors qu’autrefois, le sacré définissait ce que l’on ne devait pas faire (et donc appelait la transgression comme Dieu appelle le Diable), le spectacle montre désormais ce que l’on fait, abolissant du même coup les contestations en plaçant tous les individus de la planète devant l’évidence de ce qui est et ne peut être autrement. De même que le loisir n’est que du non-travail, le spectacle n’est qu’une non-vie : « Le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout » (13). Chacun se trouve séparé d’autrui par cette « production circulaire de l’isolement » : « De l’automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire ont aussi ses armes pour le renforcement constant des conditions d’isolement des "foules solitaires". Le spectacle retrouve toujours plus concrètement ses propres présuppositions » (14).
Le spectacle est encore défini par Debord (qui trouve ici, à son grand dam certainement, des accents heideggeriens), comme accomplissement tardif d’une théologie et d’une philosophie occidentales fondées sur la passivité du voir et sur une conception séparée de l’être et de la vie, où toujours s’impose l’illusion d’un paradis à venir, d’un au-delà à découvrir. À travers le prisme du spectacle, « c’est la vie la plus terrestre qui devient opaque et irrespirable. Elle ne rejette plus dans le ciel, mais elle héberge chez elle sa récusation absolue, son fallacieux paradis. Le spectacle est la réalisation technique de l’exil des pouvoirs humains dans un au-delà ; la scission achevée à l’intérieur de l’homme » (15) .
« Circulez, vous avez tout vu ! »
Le caractère foncièrement tautologique de la domination spectaculaire rend hasardeux son renversement : ce qui apparaît comme image est désormais accepté comme réalité, et ce qui est accepté comme réalité n’est que ce qui apparaît comme image. « Le but n’est rien, le développement est tout. Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre qu’à lui-même. » (16). À la première dégradation bourgeoise de l’être en avoir succède la seconde, de l’avoir en paraître : tout n’est que propriété médiatisée, richesse de la montre, étalement de la parure vulgaire.
Au spectaculaire diffus du monde libre et au spectaculaire concentré des régimes totalitaires a désormais succédé le spectaculaire intégré : celui-là est parvenu à éduquer une génération entière, qui ne s’est jamais frottée au monde réel de jadis et pour laquelle il est définitivement évident que la nature comme la culture sont destinées à être soumises, transformées et polluées par les moyens et les intérêts de la raison marchande. Le spectacle abolit ainsi l’histoire — « mesure d’une nouveauté véritable » — pour mieux gérer chaque instant à sa guise : « La fin de l’histoire est un plaisant repos pour tout pouvoir présent. Elle lui garantit absolument le succès de l’ensemble de ses entreprises, ou du moins le bruit de ses succès » (17). Même l’événement contemporain se noie dans l’incertain, le douteux, l’invérifiable ou l’incalculable : toute discussion est close avant d’être ouverte puisqu’il est dit une fois pour toutes que le monde est bien trop complexe pour la compréhension moyenne et profane.
Alors que faire ? Debord n’eut pas d’autre objectif que la lutte incessante et tenace qui occupa sa vie entière. Ses livres, ses films, ses articles et ses provocations furent autant de réponses cinglantes à l’universel affadissement du goût et du jugement de ses contemporains. Ce combat fut sa gloire, et l’échec son seul remords : « Ici, l’auteur arrête son histoire véritable : pardonnez-lui ses fautes » (18).
► Charles Champetier, éléments n°82, 1995.
Notes :
- (1) In girum imus nocte et consumimur igni, éd. Gérard Lebovici, 1990, p. 22.
- (2) Cf Panégyrique, Gallimard, 1993 ; et aussi « Cette mauvaise réputation… », Gallimard, 1993. Les œuvres complètes de Guy Debord ont été rééditées chez Gallimard.
- (3) In girum …, op. cit., pp. 30-31. On notera ici le détournement du Quinzième Chant du Paradis de Dante parlant de l’ancienne Florence : « les maisons n’étaient pas encore désertes […] Sardanapale n’était pas encore venu pour nous montrer tout ce qu’on peut faire dans une chambre ».
- (4) Panégyrique, op. cit., p. 42.
- (5) Cf. sur celte période Documents relatifs à la fondation de l’Internationale situationniste (1948-1957), Allia, 1985.
- (6) Rapport…, in : Documents relatifs…, op. cit.,
- (7) In girum…, op. cit., p. 50.
- (8) Réédités en un volume : Internationale situationniste (1958-1969), éd. G. Lebovici, 1989. Voir aussi Jean-François Martos, Histoire de l’Internationale situationniste, éd. G. Lebovici, 1989 ; René Viénet, Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, Gallimard, 1968.
- (9) In : Documents relatifs…., op. cit., p. 616.
- (10) Cf. Jean-Jacques Raspaud et Jean-Pierre Voyer, L’Internationale situationniste : Protagonistes, chronologies, bibliographie (avec un index des noms insultés), Champ Libre, 1972. Peu soucieuse de respectabilité, l’IS a généralement préféré l’insulte au débat. Raspaud et Voyer ont dressé l’index des personnalités, institutions ou simples militants insultés par les situationnistes. Ont entre autres été voués aux gémonies André Frossard (« commensal de Dieu »), Roger Garaudy (« curé rangé, stalinien défroqué »), Jean Cau (« comparse compromettant »), John Cage (« bouddhiste, débile mental »), Michel Butor (« bricoleur de sous-spectacles »), Louis Aragon (« la gâteuse, renégat »), Raymond Aron (« aime le travail » [!]), Simone de Beauvoir (« bassesse fondamentale »), Paul Claudel (« penseur à gage »), Jacques Delors (« adapté social »), Marguerite Duras (« falsificatrice, tartine racornie de la déconfiture actuelle du milieu littéraire moderniste, jobarde, déchet »), Youri Gagarine (« cosmonaute bureaucrate, professeur de survie »), Gaston Gallimard (« père du raté, grand-père du con »), Saint-Exupéry (« dit des bassesses à grande altitude, militaire, patriote, idiot »), Pierre Vianson-Ponlé (« erreur pompeuse, impudent nécrophage »), Le Monde (« Le journal officiel de tous les pouvoirs »), etc.
- (11) La société du spectacle, Buchet-Castel, 1967. Réed. Gallimard, 1993. Voir également Commentaires sur La société du spectacle, Gallimard, 1994.
- (12) La Société du spectacle, op. cit., p. 10.
- (13) Ibid., p. 21.
- (14) Ibid., p. 20. (15) Ibid., p. 16. (16) Ibid., p. 13.
- (17) Commentaires…, op. cit., p. 24.
- (18) Panégyrique, op. cit., p. 86.

Petit lexique situationniste
SITUATION CONSTRUITE : Moment de la vie concrètement et délibérément construit par l’organisation collective d’une ambiance unitaire et d’un jeu d’événements.
SITUATIONNISTE : Ce qui se rapporte à la théorie ou à l’activité pratique d’une construction des situations. Celui qui s’emploie à construire des situations. Membre de l’Internationale situationniste.
SITUATIONNISME : Vocable privé de sens,abusivement forgé par dérivation du terme précédent. Il n’y a pas de situationnisme, ce qui signifierait une doctrine d’interprétation des faits existants. La notion de situationnisme est évidemment conçue par les anti-situationnistes .
PSYCHOGÉOGRAPHIE : Étude des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
DÉRIVE : Mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine : technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Se dit aussi, plus particulièrement, pour désigner la durée d’un exercice continu de cette expérience.
DÉTOURNEMENT : S’emploie par abréviation de la formule : détournement d’éléments esthétiques préfabriqués. Intégration de productions actuelles ou passées des arts dans une construction supérieure du milieu. Dans ce sens il ne peut y avoir de peinture ou de musique situationniste, mais un usage situationniste de ces moyens. Dans un sens plus primitif, le détournement à l’intérieur des sphères culturelles anciennes est une méthode de propagande, qui témoigne de l’usure et de la perte d’importance de ces sphères.
► Paru dans le Bulletin de l’Internationale situationniste n°1, juin 1958, pp. 13-14.

Le cinéma selon Guy Debord
Entre 1952 et 1978, Guy Debord a réalisé 6 films. Leur style se résume dans l’avant-propos paradoxal du premier d’entre eux, Hurlements en faveur de Sade (1952) : « Il n’y a pas de film. Le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat ». Le cinéma de Debord se contentera donc de juxtaposer des images détournées et des commentaires de son cru, entrecoupés de longues plages de silence où l’écran reste noir (et où le spectateur se prend à raisonner sur sa propre aliénation en contemplant le vide, dans l’attente désespérée de ce « message » qui ne viendra précisément pas — puisque la vraie vie est ailleurs). Johnny Guitar est ainsi convié à réfléchir sur la paralysie de la mémoire par la vitrification spectaculaire, tandis que les images de « La Charge héroïque » illustrent une réflexion sur la bureaucratisation du pouvoir communiste. Quelques-unes de ces intuitions — le texte coupant brutalement le récit, le commentaire ou le dialogue décalé par rapport à l’image — seront reprises par la Nouvelle Vague, notamment par Godard. Il faut enfin signaler un documentaire réalisé pour la télévision (et diffusé sur Canal+ au début de l’année) : Guy Debord, son art, son temps. Film-testament (Debord savait alors qu’il était atteint d’une maladie rarissime et incurable), où le penseur lança son dernier assaut contre l’ordre du monde. Comme dans un journal télévisé, les images de nos désastres quotidiens se succèdent — pluies acides, collèges de banlieue dévastés, guerres de toutes espèces, vide de la consommation, vacuité de la télévision, ennui de la vie —, mais elles ne sont plus encadrées de commentaires insipides ni égayées de fausses joies. Devant une telle déchéance ainsi dépouillée de ses oripeaux, on se prend à relire Lautréamont, le cœur plein d’amertume et l’âme pleine de rage : « J’ai vu, pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes, aux épaules étroites, faire des actes stupides et nombreux,abrutir leur semblable, et pervertir leur âme par tous les moyens » (Les Chants de Maldoror, 1, 5).
Guy Debord, Œuvres cinématographiques complètes, Gallimard, 1994.

Misère de l’homme moderne
Comme le mode de production les a durement traités ! De progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu’ils avaient, et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d’exploitations du passé ; ils n’en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu’ils sont parqués en masse, et à l’étroit, dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres ; mal nourris d’une alimentation polluée et sans goût ; mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées ; continuellement et mesquinement surveillés ; entretenus dans l’analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leurs provinces ou de leurs quartiers, dans un paysage nouveau et hostile, suivant des convenances concentrationnaires de l’industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles.
Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments,à chaque innovation technique profitables aux multiples entrepreneurs d’un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d’existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants, à qui il suffit de dire : "il faut’’, et ils veulent bien le croire. Mais surtout, on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n’importe quoi en leur disant n’importe comment ; et aussi bien le contraire le lendemain.
Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat aux faits, perte qui leur interdit le moindre dialogue ; séparés par leur incessante concurrence, toujours pressés par le fouet, dans la consommation ostentatoire du néant, et donc séparés par l’envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque satisfaction, ils sont même séparés de leurs propres enfants, naguère encore la seule propriété de ceux qui n’ont rien. On leur enlève, en bas âge, le contrôle de ces enfants, déjà des rivaux, qui n’écoutent plus du tout les opinions informes de leurs parents,et sourient de leur échec flagrant ; méprisent non sans raison leur origine, et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ces domestiques qui les ont par hasard engendrés : ils se rêvent les métis de ces nègres-là. Derrière la façade du ravissement simulé,dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n’échange que des regards de haine…
► Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, éd. Gérard Lebovici, 1990.

Sur les situationnistes
Entretien inédit d’Henri Lefebvre avec Kristin Ross
 La « critique de la vie quotidienne » d’Henri Lefebvre a nourri les situationnistes au cours d’une amitié qui a duré « environ quatre à cinq ans » Dans cet entretien inédit réalisé par Kristin Ross en 1983, Henri Lefebvre raconte comment s’est noué ce rapport, autour de quelles thématiques : de nouvelles manières d’arpenter la ville, la nécessité de transformer l’urbain, et la Commune de Paris comme fête. Entre Amsterdam, Strasbourg, Navarrenx et Paris, du groupe CoBrA à Mai 68, Lefebvre retrace la grande fresque du moment « situ », de ses audaces et de ses sectarismes. Entre récit de rupture et témoignage bienveillant, Lefebvre revient sur une séquence d’innovations théoriques, artistiques, militantes qui ont bouleversé la théorie et la pratique révolutionnaires.***
La « critique de la vie quotidienne » d’Henri Lefebvre a nourri les situationnistes au cours d’une amitié qui a duré « environ quatre à cinq ans » Dans cet entretien inédit réalisé par Kristin Ross en 1983, Henri Lefebvre raconte comment s’est noué ce rapport, autour de quelles thématiques : de nouvelles manières d’arpenter la ville, la nécessité de transformer l’urbain, et la Commune de Paris comme fête. Entre Amsterdam, Strasbourg, Navarrenx et Paris, du groupe CoBrA à Mai 68, Lefebvre retrace la grande fresque du moment « situ », de ses audaces et de ses sectarismes. Entre récit de rupture et témoignage bienveillant, Lefebvre revient sur une séquence d’innovations théoriques, artistiques, militantes qui ont bouleversé la théorie et la pratique révolutionnaires.***• Kristin Ross : À quand remonte votre amitié avec les situationnistes ?
Henri Lefebvre : Elle remonte au groupe CoBrA. C’est lui qui a été l’intermédiaire : un groupe qui s’est créé avec des architectes, avec Constant [Nieuwenhuys] notamment, l’architecte d’Amsterdam, puis avec Asger Jorn, un peintre, et d’autres, des gens de Bruxelles. C’est un groupe nordique, un groupe qui avait des ambitions considérables, qui voulait renouveler l’art, renouveler l’action de l’art sur la vie. C’est un groupe qui a été extrêmement intéressant et actif, qui s’est constitué vers les années 1950, et un des livres inspirateurs du groupe CoBrA était mon livre Critique de la vie quotidienne. C’est ce qui explique que j’ai eu des relations assez tôt avec eux. L’homme pivot était donc Constant Nieuwenhuys, l’architecte utopiste, qui a fait très tôt les plans d’une ville utopique, la Nouvelle Babylone – ce qui est une véritable provocation puisque dans tous les milieux protestants, Babylone, c’est la figure du mal. New Babylon, ça devait être la figure du bien mais qui reprenait le nom de la ville maudite pour en faire la ville d’avenir. Le plan de New Babylon date de 1950. En 1953, Constant Nieuwenhuys publie et écrit un texte qui s’appelle Pour une architecture de situation. C’est le texte fondamental qui part de l’idée que l’architecture va permettre de transformer la réalité quotidienne. C’est là où que se situe la relation avec Critique de la vie quotidienne : créer une architecture qui permettra elle-même de créer des situations nouvelles. Et ce texte, c’est le point de départ de toute une recherche qui se développe dans les années suivantes. D’autant plus que Constant est très populaire, et qu’il est un des animateurs du mouvement des provos.
• Alors, il y avait une relation directe entre Constant et les provos ?
Ah oui ! Il était reconnu par eux comme leur penseur, leur chef, l’homme qui voulait transformer la vie et la ville. Leur rapport était direct ; il était leur animateur. Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est le contexte de l’époque. Au point de vue politique, l’année 1956 est une année très importante parce que c’est la fin du stalinisme. Il y a le fameux rapport de Khrouchtchev au XXe Congrès du Parti communiste d’URSS, où il démolit la figure de Staline – rapport qui sera discuté et contesté. En France, on prétendra que le rapport était un faux, un faux inventé par les services secrets américains. En réalité, c’était tout à fait l’œuvre de celui qui a succédé à Staline, après quelques péripéties, et qui démolissait complètement la figure de son prédécesseur. Alors il faut comprendre la périodisation, n’est-ce pas ? Pendant les années d’après-guerre, la figure de Staline est dominante. Et le mouvement communiste reste le mouvement révolutionnaire. Et puis, à partir de 1956-1957, le mouvement révolutionnaire va passer en dehors des partis organisés, notamment avec Fidel Castro. Le situationnisme n’est pas isolé. Il prend sa source en Hollande, à Paris aussi et il se lie à beaucoup d’événements à l’échelle mondiale, notamment le fait que Fidel Castro arrive à une victoire révolutionnaire tout à fait en dehors du mouvement communiste et du mouvement ouvrier. Et moi-même, en 1957, il faut que je rappelle mes interventions : j’ai publié une espèce de manifeste, Le Romantisme révolutionnaire, qui est lié à l’affaire Castro et à tous les mouvements que je sens, un petit peu partout, en dehors des partis. C’est le moment où je quitte le parti communiste. Je sens qu’il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en dehors des partis institués et des mouvements organisés, comme les syndicats. Il va y avoir une spontanéité en dehors des organisations et des institutions. C’est ce que veut dire ce texte de l’année 1957. C’est ce texte qui m’a mis en relation avec les situationnistes, parce qu’ils y ont attaché une certaine importance, quitte ensuite à l’attaquer. Ils avaient des critiques à faire, bien sûr. Il n’y avait pas un accord complet avec eux, mais c’était une base pour une certaine entente qui a duré environ quatre à cinq ans, puisqu’on se retrouvait sans cesse.
• Alors, est-ce que c’est déjà à ce moment que vous travaillez sur votre deuxième volume de la Critique de la vie quotidienne ?
Oui, j’y travaille déjà. Et il y a un projet de volume sur la Commune de Paris qui est aussi en route.
• Alors, vous faites tout ça en même temps ? Les deux livres ?
C’est ça, tout ça se passe en même temps, dans une grande confusion. C’est le moment où je quitte le parti. Il y a des tas d’histoires. C’est le moment de la guerre d’Algérie. Je n’étais pas dans l’université, j’étais directeur de recherche au CNRS et j’ai failli être révoqué pour avoir signé des manifestes pour les Algériens et avoir apporté un soutien — faible, certainement mais enfin, un certain soutien quand même — aux Algériens. Tout ça, c’est donc un moment de fermentation intense. Même en France, le soutien aux Algériens ne passait pas par le parti ou les syndicats, il était en dehors des institutions. Le parti communiste — le Parti socialiste a combattu la guerre d’Algérie — n’a soutenu les Algériens que du bout des lèvres et en apparence. En fait, le parti les aidait très peu et ensuite, les Algériens en ont beaucoup voulu au parti. Eh bien, l’opposition dans le parti, puis le mouvement en dehors du parti a soutenu les Algériens.
Par ailleurs, il y avait des mouvements d’avant-garde un peu extrémistes comme le mouvement d’Isidore Isou, les lettristes. Eux aussi avaient de grandes ambitions à l’échelle internationale. Mais c’était de la rigolade, pratiquement. Ça se traduisait par le fait qu’Isidore Isou venait déclamer des poèmes dadaïstes faits de syllabes et de mots interrompus et dépourvus de sens. Il déclamait ça dans les cafés. Il gagnait sa vie comme ça. Je me souviens très bien l’avoir rencontré plusieurs fois dans Paris. Mais ça montrait une certaine fermentation dans la vie profonde en France, qui se traduit par le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958, une crise de la démocratie due à la guerre d’Algérie, une fermentation en dehors des partis. Le parti communiste a montré une incapacité profonde en ne comprenant pas le stalinisme, en ne faisant rien pour les Algériens, et en ne s’opposant que très mal au retour du Général De Gaulle au pouvoir, se bornant à traiter De Gaulle de fasciste, ce qui n’était pas exact. De Gaulle voulait régler la question de l’Algérie. Il était seul à pouvoir la régler. On s’en est aperçu par la suite. Mais à travers tout ça, il y avait une grande fermentation comparable à celle qui s’est produite en 1936.
• Est-ce que la théorie situationniste de construire les situations a un rapport assez direct avec votre théorie à vous, qui est la théorie des moments de la vie ?
Oui, ça a été la base de notre accord. Ils m’ont dit, dans les discussions, des discussions qui duraient des nuits entières : « Les « moments », ce que tu appelles « les moments », c’est ce que nous appelons des situations, mais nous, nous allons plus loin que toi. Toi, tu acceptes comme « moments » tout ce qui s’est présenté au cours de l’histoire : l’amour la poésie, la pensée. Nous, nous voulons créer des moments nouveaux. »
• Mais justement, comment faire cette transition entre un « moment » et une construction consciente ?
L’idée de moment nouveau, l’idée d’une situation nouvelle est déjà dans le texte de Constant de 1953, Pour une architecture de situation. Parce que l’architecture de situation, c’est une architecture utopique qui supposait une société nouvelle. Mais l’idée de Constant, c’est qu’il fallait transformer la société non pas pour continuer à vivre de façon ennuyeuse, mais pour créer quelque chose d’absolument nouveau, c’est-à-dire des situations.
• Où se situe la « ville » dans cette construction de situations nouvelles ?
Alors, les « situations nouvelles », ça n’a jamais été clair. Quand on en parlait, moi je donnais toujours comme exemple – mais alors, ils n’en voulaient pas de mon exemple – de l’amour. Je leur disais : l’Antiquité a connu la passion amoureuse mais n’a pas connu l’amour individuel, l’amour pour un être individuel. C’était une espèce de passion cosmique, physique, physiologique, telle que la décrivent les poètes de l’Antiquité. Mais l’amour pour un être individuel apparaît au Moyen Âge avec un mélange de traditions musulmanes, islamiques, chrétiennes, et notamment dans le Midi de la France. L’amour individuel, c’est déjà l’amour de Dante pour Béatrice. Il l’explique lui-même dans un texte qui s’appelle La Vita nova, la vie nouvelle. C’est l’amour de Tristan et Yseult, l’amour tragique, c’est l’amour courtois dans le Midi de la France. Dans mon pays à côté de Navarrenx, je vous l’ai peut-être montrée, il y a la tour du prince Gaston Phébus qui a été le premier prince-troubadour à chanter des chansons d’amour individuelles : « Quand je chante, je ne chante pas pour moi, mais je chante pour mon amie qui est près de moi », c’est déjà l’amour individuel. C’est un amour plus tragique que l’amour antique qui n’est jamais que mélodrame Il y a cette tragédie d’amour individuel qui passe à travers les époques, à travers La Princesse de Clèves, à travers des romans, des pièces de théâtre, à travers la Bérénice de Racine, à travers toute une littérature.
• Pour les situationnistes, l’idée de construire des situations doit avoir un rapport avec l’urbanisme…
Oui, ça on était d’accord. Je leur disais : l’amour individuel a créé des situations nouvelles. Mais ça ne s’est pas fait en un jour. Ça a mûri. Alors leur idée, c’est que peut-être, dans la ville, et ça se relie aussi à des expériences de Constant, on pouvait créer des situations nouvelles, par exemple en mettant en rapport des parties, des quartiers de la ville qui étaient séparés dans l’espace. Et c’était ça le premier sens de la « dérive ». Ça s’est fait à Amsterdam au début de la technique des talkies-walkies. Il y avait une équipe qui allait dans une partie de la ville et qui pouvait communiquer avec des gens dans une autre partie.
• Et les situationnistes se sont servis de cette technique aussi ?
Oui, en tout cas, Constant s’en est servi. Mais il y a eu des expériences situationnistes de l’urbanisme unitaire. L’urbanisme unitaire consistait à faire communiquer des parties de la ville. Ils ont fait des expériences, mais je n’y ai pas assisté. J’en ai entendu beaucoup parler. Et ils se servaient de toutes sortes de moyens de communication. Mais le talkie-walkie, je ne sais pas en quelle année ça a été utilisé. Je sais que ça a été utilisé dans des expériences à Amsterdam et à Strasbourg.
• Et vous connaissiez les gens de Strasbourg à cette époque ?
 C’étaient mes étudiants. Mais les rapports avec eux ont été aussi extrêmement difficiles. Quand je suis arrivé à Strasbourg en 1958 ou 1959, c’était en pleine guerre d’Algérie, et j’étais à Strasbourg depuis peut-être 3 semaines ou un mois, quand je vois arriver un groupe de garçons. C’étaient les futurs situationnistes de Strasbourg – ou ils étaient déjà peut-être un petit peu situationnistes. Ils me disent : « Monsieur, nous avons besoin de votre appui. Nous allons faire un maquis dans les Vosges. Et alors, nous allons installer une base militaire dans les Vosges, et de là, nous rayonnerons sur tout le pays. Nous ferons dérailler les trains ». Moi je leur dis : « Mais vous savez que l’armée et la gendarmerie… le soutien de la population, vous n’en êtes pas sûrs… Vous allez au devant de la catastrophe ». Alors, ils ont commencé à m’insulter en me disant que j’étais un traître. Et puis, au bout de quelques temps, de quelques semaines, ils sont venus me revoir et ils m’ont dit : « Et oui, vous avez raison : ce n’est pas possible. C’est pas possible d’installer un maquis dans les Vosges, dans la forêt ; on se fera un autre projet ». Alors, je me suis trouvé bien avec eux, et c’est après que le même groupe est devenu situationniste. Mais vous savez, les relations avec eux étaient très difficiles […] parce qu’ils se fâchaient pour pas grand chose. Mustafa Khayati, l’auteur de la fameuse brochure De la misère en milieu étudiant, faisait partie de ce groupe.
C’étaient mes étudiants. Mais les rapports avec eux ont été aussi extrêmement difficiles. Quand je suis arrivé à Strasbourg en 1958 ou 1959, c’était en pleine guerre d’Algérie, et j’étais à Strasbourg depuis peut-être 3 semaines ou un mois, quand je vois arriver un groupe de garçons. C’étaient les futurs situationnistes de Strasbourg – ou ils étaient déjà peut-être un petit peu situationnistes. Ils me disent : « Monsieur, nous avons besoin de votre appui. Nous allons faire un maquis dans les Vosges. Et alors, nous allons installer une base militaire dans les Vosges, et de là, nous rayonnerons sur tout le pays. Nous ferons dérailler les trains ». Moi je leur dis : « Mais vous savez que l’armée et la gendarmerie… le soutien de la population, vous n’en êtes pas sûrs… Vous allez au devant de la catastrophe ». Alors, ils ont commencé à m’insulter en me disant que j’étais un traître. Et puis, au bout de quelques temps, de quelques semaines, ils sont venus me revoir et ils m’ont dit : « Et oui, vous avez raison : ce n’est pas possible. C’est pas possible d’installer un maquis dans les Vosges, dans la forêt ; on se fera un autre projet ». Alors, je me suis trouvé bien avec eux, et c’est après que le même groupe est devenu situationniste. Mais vous savez, les relations avec eux étaient très difficiles […] parce qu’ils se fâchaient pour pas grand chose. Mustafa Khayati, l’auteur de la fameuse brochure De la misère en milieu étudiant, faisait partie de ce groupe.• Quel a été l’effet de la brochure et de sa distribution ? À combien d’exemplaires a-t-elle été tirée ?
Cette brochure a eu beaucoup de succès. Mais au début, elle s’est répandue seulement à Strasbourg, puis Guy Debord et les autres l’ont diffusée à Paris. Elle a été diffusée à des dizaines de milliers d’exemplaires chez les étudiants, ça ne fait aucun doute. C’est une très bonne brochure, c’est très bien fait. L’auteur, Mustafa Khayati, est un Tunisien. Il y avait plusieurs Tunisiens dans ce groupe, beaucoup d’étrangers dont on a moins parlé par la suite. Même Mustafa Khayati ne s’est pas trop mis en avant parce qu’il aurait pu avoir des ennuis à cause de sa nationalité. Il n’avait pas la double nationalité, il était resté Tunisien.
À Paris, à partir de 1957-1958, je les rencontre beaucoup, et je vois Constant à Amsterdam. C’est à ce moment-là que se développe le mouvement des Provos qui devient très puissant à Amsterdam, avec l’idée de garder la vie urbaine intacte, d’empêcher que la ville soit éventrée par les autoroutes, empêcher qu’elle soit ouverte aux voitures. Ils voulaient que la ville se conserve et se transforme au lieu d’être livrée aux voitures ; ils voulaient aussi la drogue ; ils semblaient compter sur les drogues pour créer des situations nouvelles. L’imagination était semée par le LSD. C’était le LSD à ce moment-là. […]
• Revenons à l’urbanisme unitaire. C’est une façon de relier les quartiers qui n’est pas homogène, chaque quartier garde ses aspects distincts, c’est ça ?
Oui, c’est ça, ils ne sont pas fondus, ils sont déjà un tout, mais ce tout est pour ainsi dire encore fragmenté et n’est qu’à l’état virtuel. L’idée, c’est de faire de la ville un tout, mais un tout en mouvement, un tout en transformation. Les plans de New Babylon ont été transportés au Musée national de La Haye. Ils étaient dans l’atelier de Constant qui se situait dans un immeuble en briques à moitié démoli. La chose la plus frappante que je me rappelle de l’atelier de Constant, c’était dans une immense cage en verre, un iguane.
• Alors, voilà une nouvelle situation ! Est-ce que le projet de Constant faisait l’hypothèse de la fin du travail ?
Oui, dans une certaine mesure c’est le point de départ : la mécanisation complète, l’automatisation complète du travail productif, donc la disponibilité. C’est un de ceux qui ont posé le problème.
• Et les situationnistes aussi ?
Oui.
• Alors, est-ce que vous situez votre travail dans cette lignée ? Qui irait de Lafargue jusqu’à… ?
Dans cette lignée oui, mais de Lafargue, non. Je pense que le point de départ a été un roman de science fiction qui s’appelle Demain, les chiens. C’est un roman américain de Clifford Simak dans lequel tout le travail est fait par des robots. Les hommes ne peuvent pas supporter cette situation. Ils meurent parce qu’ils sont trop habitués à travailler. Ils meurent et les chiens profitent de la situation. Les robots travaillent pour eux, les nourrissent, etc. Et les chiens sont parfaitement heureux parce qu’ils ne sont pas déformés par l’habitude du travail. Je me souviens du rôle joué par ce roman dans les discussions. Je ne connais pas la date de parution du livre en Amérique. J’ai l’impression que c’est un des premiers romans de science-fiction à avoir eu un retentissement et de l’influence, mais c’est peut-être seulement dans ces années-là. De toutes façons, c’était le point de départ de Constant : une société libérée du travail. Et c’était dans l’orientation du Droit à la paresse de Lafargue mais renouvelée par la perspective de l’automatisation qui commence dans ces années-là. Alors donc : discussions intenses et changement complet du mouvement révolutionnaire qui laisse de côté vers 1956-57 les organisations classiques. D’autre part, il y a la voix de petits groupes qui prennent de l’influence.
• L’existence même d’une microsociété comme celle des situationnistes constitue une nouvelle situation ?
Dans une certaine mesure. Mais enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Combien étaient-ils seulement ? Vous savez que l’Internationale situationniste n’a jamais compté plus de dix membres. Et encore… Il y avait deux ou trois Belges, deux ou trois Hollandais, comme Constant. Mais ils étaient exclus tout de suite. Guy Debord suivait l’exemple d’André Breton. On était exclus. Moi, je n’en ai jamais fait partie, du groupe. J’aurais pu, mais je m’en gardais bien, connaissant le caractère et les allures de Guy Debord, et la manière qu’il avait d’imiter André Breton, en excluant tout le monde pour garder un petit noyau pur et dur. Finalement, les membres de l’Internationale situationniste étaient Guy Debord, Raoul Vaneigem et Michèle Bernstein. Il y avait des corpuscules plus ou moins extérieurs dont j’étais, et puis il y avait des gens comme Asger Jorn. Asger Jorn a été exclu, ce pauvre Constant a été exclu. Sous quel prétexte ? Lui ne construisait pas. C’était un architecte. Mais il a été exclu parce qu’un type qui avait travaillé avec lui a construit une église en Allemagne : exclusion de Constant pour influence désastreuse. C’est de la foutaise. C’était vraiment pour se garder à l’état pur, comme un cristal. Guy Debord suivait l’exemple de Breton : extrêmement dogmatique. Et puis d’ailleurs, d’un dogmatisme sans dogme parce que la théorie des situations, de la création de la situation, a très vite disparu pour faire place seulement à la critique du monde existant, et c’est là où on s’est retrouvé d’ailleurs, avec la Critique de la vie quotidienne.
• Comment est-ce que cette association avec les situationnistes a changé ou inspiré votre pensée sur la ville ?
Tout ça était corollaire, parallèle. Ma réflexion sur la ville a des sources tout à fait différentes. C’est que, dans mon pays, j’ai longtemps étudié les questions agricoles. Un beau jour, on a vu des bulldozers arriver, raser des arbres : on y avait trouvé du pétrole. Il y a des puits de pétrole dans mon pays et il y a eu l’une des plus grandes usines d’Europe à Lacq-Mourenx. Alors j’ai vu construire une ville nouvelle là où il y avait auparavant des champs de maïs et des forêts de chênes. J’ai peu à peu laissé les questions agricoles, en me disant : « Voilà quelque chose de neuf, de nouveau, qui va prendre de l’extension ». Je ne m’attendais d’ailleurs pas à l’urbanisation tellement brutale qui a suivi. Cette ville nouvelle, ça s’appelle Lacq-Mourenx. Tout de suite, comme j’étais à la recherche scientifique, j’ai envoyé des gens sur place pour en suivre le développement. Je voulais même écrire un livre, que je n’ai jamais écrit, comme beaucoup de projets, intitulé « Naissance d’une cité ». C’est là le point de départ. Mais en même temps, j’ai rencontré Guy Debord, j’ai rencontré Constant, j’ai su que les Provos d’Amsterdam s’intéressaient à la question de la ville. J’ai été je ne sais combien de fois à Amsterdam voir ce qui se passait : comme ça, regarder la forme que prenait le mouvement, s’il prenait une forme politique. Il y a eu des Provos élus au conseil municipal d’Amsterdam. Ils ont remporté, je ne sais plus en quelle année, une grande victoire aux élections municipales. Puis après, ça s’est dégradé, c’est tombé. Alors, tout ça allait ensemble. Et puis, à partir de 1960, ça a été le grand mouvement d’urbanisation. D’ailleurs, les autres ont abandonné la théorie de l’urbanisme unitaire, parce que la théorie de l’urbanisme unitaire n’avait de sens précis que pour une ville historique comme Amsterdam qu’il s’agissait de renouveler, de transformer. Mais à partir du moment où la ville historique a éclaté en périphéries, en banlieues, comme ça s’est passé à Paris, et dans toutes sortes d’endroits, comme ça continue de se passer à San Francisco, comme ça s’est passé pour Los Angeles, la théorie de l’urbanisme unitaire perdait de son sens. Et alors, je me rappelle de discussions très fortes avec Guy Debord. Il disait : « L’urbanisme devient une idéologie ». Ce qui était exact, à partir du moment où, officiellement, il y a eu une doctrine de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme en France date de 1961, je crois. Cela ne voulait pas dire que le problème de la ville était résolu. Au contraire.
Et puis, je crois que même la « dérive », les expériences de « dérive » ont été peu à peu délaissées. Je ne suis pas sûr de la manière dont ça s’est passé, parce que c’est le moment où je me suis brouillé avec eux. Après tout ça, il y a le contexte politique et social de la France. Il y a aussi les relations personnelles. Il y a des tas d’histoires extrêmement compliquées. L’histoire la plus compliquée est venue du fait qu’ils sont venus chez moi, dans les Pyrénées. Et on a fait un voyage merveilleux. On est parti en voiture de Paris. On s’est arrêtés aux grottes de Lascaux, qui ont été fermées peu de temps après. On a été saisis par le problème des grottes de Lascaux. Elles sont profondément enfouies. Il y a même un puits presque inaccessible. Et tout ça est rempli de peintures. Comment ces peintures ont-elles été faites, et à qui étaient-elles destinées, puisqu’elles n’étaient pas destinées à être vues ? C’est l’idée que la peinture a commencé par être critique. D’autant plus que toutes les églises de la région ont des cryptes, notamment à Saint Savin. Nous sommes passés à Saint Savin, où il y a des fresques sur la voûte de l’église et une crypte pleine de peintures. Une crypte où il est très difficile d’accéder aux profondeurs car elle est tout à fait obscure. Qu’est-ce que des peintures qui ne sont pas destinées à être vues ? Et comment ont-elles été faites ? C’était le sujet de discussions passionnées.
Enfin, on est descendu. On a fait un festin fabuleux à Sarlat. J’avais peine à conduire. J’ai eu une contravention. On a failli être arrêtés parce que j’ai traversé un village à 120 à l’heure. Et ils sont restés plusieurs jours chez moi. On a élaboré un texte programme. Et ce texte, au bout de la semaine qu’ils ont passé chez moi, ils l’ont gardé. Je leur avais dit : « vous le tapez » — c’était manuscrit. Et comme je me suis servi du texte, ils m’ont taxé de plagiat. En réalité, c’est d’une mauvaise foi parfaite. Le texte qui a servi, pour faire le livre sur la Commune, était une œuvre commune, d’eux et de moi. Et l’idée de la Commune comme fête, je l’ai lancée dans les débats après avoir consulté un inédit sur la Commune qui est à la Fondation Feltrinelli, à Milan. C’est un journal sur la Commune. Celui qui a fait ce journal, qui a été d’ailleurs déporté, et qui a ramené son journal de déportation quelques années plus tard, vers 1880, raconte comment le 18 mars 1871, les soldats de Thiers sont venus chercher les canons qui étaient à Montmartre et sur les hauteurs de Belleville ; comment les femmes qui se levaient de très bonne heure, ont entendu du bruit, sont toutes sorties dans la rue et ont entouré les soldats. Les femmes, elles ont entouré les soldats en s’amusant, riant, les accueillant fraternellement, puis elles ont été chercher du café, elles l’ont offert aux soldats, et ces soldats, qui venaient chercher des canons, ont été emportés par le peuple. D’abord les femmes, puis les hommes, sont sortis, dans une atmosphère de fête populaire. Il raconte enfin qu’il n’y a pas du tout de héros qui seraient arrivés avec des armes contre les soldats qui venaient chercher les canons. Ça ne s’est pas du tout passé comme ça. C’était le peuple qui fêtait, qui sortait. Il faisait très beau, c’était une première journée de printemps, le 18 mars, une journée ensoleillée : les femmes sortent tôt, trouvent des soldats, les embrassent, elles sont débraillées, etc., les soldats sont noyés là-dedans, dans la fête populaire parisienne. Après, des théoriciens des héros de la Commune, m’ont dit : « c’est un témoignage, on ne peut pas écrire une histoire sur un témoignage ». Et les petits copains situationnistes ont écrit aussi des choses dans ce genre-là. Je ne les ai pas lues. Moi, j’ai fait mon travail. Il y a eu des idées lancées dans des conversations communes, rédigées dans des textes communs. Et puis ensuite, moi, j’ai fait mon travail sur la Commune. J’ai été travailler des semaines et des mois à Milan, à l’Institut Feltrinelli. J’ai trouvé une documentation inédite, je m’en suis servi, et c’est tout à fait mon droit. Ces accusations de plagiat, je m’en fous. J’ai toujours eu des embêtements de cet ordre-là. Mais alors, je ne sais pas ce qu’ils ont écrit dans leur revue, je ne me suis pas donné la peine de le lire. Je sais que j’ai été traîné dans la boue.
[…] Ça m’est un peu resté sur le cœur. Pas beaucoup, mais un petit peu. On travaille ensemble à Navarrenx, jour et nuit, on se couchait vers neuf heures du matin. Ça c’était leur habitude : ils se couchaient dans la matinée, dormaient toute la journée. On ne bouffait rien. Ah, c’était épouvantable. Moi, j’ai souffert pendant cette semaine, on ne mangeait pas, on buvait. On a bu au moins une centaine de bouteilles. En quelques jours. À cinq. Mais on travaillait en buvant. C’était presque un résumé doctrinal sur tout ce que nous pensions y compris sur les situations, sur les transformations de la vie ; c’était un texte pas très long, de quelques pages, écrit à la main. Ils l’ont emporté, ils l’ont tapé, et puis après, bon, ils ont pensé qu’ils avaient des droits sur les idées.
• Mais revenons un peu à cette idée de la dérive. Est-ce que vous croyez que ça a apporté quelque-chose de nouveau sur la théorie de l’espace, ou bien la théorie de la ville ? Dans la façon dont elle souligne les jeux expérimentaux, la dérive est-elle plus productive qu’une vision purement théorique de la ville ?
Oui. Pour moi, c’était une pratique plutôt qu’une théorie. Ça mettait en évidence la fragmentation croissante de la ville. Le fait qu’elle a été une puissante unité organique au cours de son histoire. Mais déjà depuis pas mal de temps, cette unité organique se défait, se fragmente ; et bon, on en prenait des exemples, parce qu’on discutait déjà de la place où on va construire maintenant le nouvel Opéra de Paris. La place de la Bastille, c’est la fin d’un Paris historique, et au-delà, c’est le Paris de l’industrialisation, de la première industrialisation du XIXe siècle. La place des Vosges, c’est encore un Paris aristocratique du XVIIe siècle, qui s’étend déjà beaucoup, mais qui reste un Paris historique aristocratique. Quand on arrive à la Bastille commence un autre Paris : c’est le Paris de la bourgeoisie, le Paris de l’extension industrielle, commerciale. Au moment d’ailleurs où la bourgeoisie commerciale et industrielle s’empare du Marais, du centre de Paris, elle s’étend au-delà de la Bastille, de la rue de la Roquette, de la rue du Faubourg Saint-Antoine, etc. Et déjà la ville se fragmente, sans que son unité organique soit complètement brisée. Elle a ensuite été balisée par les périphéries et les faubourgs. Mais à ce moment-là, elle n’est pas encore balisée, et on pense que la pratique de la dérive révèle l’idée de la ville dans sa fragmentation. Mais c’est surtout à Amsterdam que ça a été expérimenté. L’expérience consistait à rendre simultanés des aspects de la ville, des fragments de la ville qu’on ne voit que successivement et même très successivement, de telle sorte qu’il y a même des gens qui n’ont jamais vu ces quartiers de la ville.
• Tandis que la dérive doit prendre la forme d’une narration…
C’est ça. On va un peu au hasard et on raconte ce qu’on voit.
• Mais on ne peut pas la raconter de façon simultanée.
Ah ben si, si on a un talkie-walkie ; le but c’était d’atteindre quand même une certaine simultanéité. C’était le but. Ça n’a pas toujours été rempli.
• Alors une espèce d’histoire synchronisée ?
Oui, c’est ça, une histoire synchronisée. C’était ça le sens de l’urbanisme unitaire : unifier ce qui a une certaine unité, mais une unité perdue, une unité en perdition.
• Et c’était pendant que vous connaissiez les situationnistes à cette époque que l’idée de l’urbanisme unitaire a perdu de sa force ?
Au moment où vraiment l’urbanisation est devenue massive, c’est-à-dire à partir de 1960, et où Paris a complètement éclaté. Vous savez, il y avait très peu de banlieue à Paris. Il y avait des banlieues, mais ce n’était presque rien. Et puis tout d’un coup, ça s’est rempli, couvert de pavillons, très loin, avec des villes nouvelles, Sarcelles. Sarcelles, c’en est devenu un mythe. On parlait d’une espèce de maladie qui s’appelait la « sarcellite ». Alors l’attitude de Guy Debord change, il passe de l’urbanisme unitaire à la thèse de l’idéologie urbanistique. Du moins dans mon souvenir.
• Qu’est ce que c’est au juste, cette transition ?
C’est plus qu’une transition, c’est l’abandon d’une position pour adopter une position tout à fait inverse. Entre l’idée d’élaborer un urbanisme et la thèse selon laquelle tout urbanisme est une idéologie, il y a une modification très profonde. En fait, en disant que tout urbanisme est une idéologie, une idéologie bourgeoise, ils abandonnaient le problème de la ville. Tandis que moi, j’ai continué à m’y intéresser à penser que l’éclatement de la ville historique était justement l’occasion de trouver une théorie plus large de la ville et non un prétexte pour abandonner tout le problème. D’ailleurs, la théorie des situations elle-même était abandonnée, peu à peu. Or la revue elle-même est devenue un organe politique. Ils se sont mis à injurier tout le monde. Ça faisait partie de l’attitude de Debord, et aussi peut-être de ses difficultés : il s’est brouillé avec Michèle Bernstein. Je ne sais pas, il y a eu toutes sortes de circonstances qui l’ont rendu peut-être plus polémique, ou plus amer, ou plus violent.
Mais ce que je voudrais dire aussi, c’est que leur rôle dans les événements de 1968, ils l’ont énormément grossi par la suite. Le mouvement de 68 ne vient pas des situationnistes. Il y avait à Nanterre, le petit groupe minuscule de ceux qui s’appelaient « Les enragés ». Bon, eux aussi insultaient tout le monde, mais c’est eux qui ont fait le mouvement. Le mouvement du 22 mars a été fait par des étudiants, dont Daniel Cohn-Bendit, qui n’étaient pas des situationnistes. C’était un groupe actif qui s’était constitué au fur et à mesure des événements, sans programme, sans projet, un groupe informel, auquel les situationnistes se sont joints, mais ce n’est pas eux qui l’ont constitué. Ça s’est fait en dehors d’eux. Le mouvement du 22 mars, les situs s’y sont joints, mais aussi les autres, les trotskistes, tout le monde s’y est joint peu à peu. On appelait ça « prendre le train en marche ». Alors, il est possible que les situationnistes de Nanterre se soient joints au groupe dès le début, mais ils n’en n’ont pas été les animateurs, les créateurs. En fait, le mouvement a commencé dans le grand amphithéâtre où je faisais un cours qui était archibondé, et où des étudiants que je connaissais bien m’ont demandé : « est-ce qu’on peut nommer des délégués pour aller protester contre la liste noire à l’administration ? » Je leur ai dit : « Bien sûr. » Et c’est sur le podium où j’étais qu’a eu lieu l’élection des étudiants délégués auprès de l’administration pour protester contre l’affaire de la liste noire. L’administration tentait de constituer une liste noire des étudiants les plus turbulents pour prendre des sanctions contre eux. Et ont participé à l’élection de ces délégués toutes sorte de gens dans toutes les groupes actifs : aussi bien trotskistes que situationnistes.
Le groupe du 22 mars s’est constitué à la suite de ces négociations et de ces contestations avec l’administration. Puis ils ont occupé les locaux de l’administration de même que le préau. L’élément stimulant, ça a été l’affaire de la « liste noire », et c’est moi qui l’ai concoctée cette « liste noire ». Pour être exact, l’administration a téléphoné à mon département en demandant les noms des étudiants les plus agités. Je les ai envoyé promener. Et j’ai eu plusieurs fois l’occasion de dire au doyen : « Je ne suis pas un flic. » La « liste noire » n’a jamais existé noir sur blanc. Mais ils essayaient de la faire. Et j’ai dit aux étudiants : « Vous savez, ils veulent faire une liste noire, ils sont en train de la faire, défendez-vous ». J’ai un petit peu agité le mélange détonnant. On a ses petites perversités.
Je raconte toujours l’histoire. Le vendredi soir, 13 mai, on est sur la place Denfert-Rochereau. Autour du lion de Belfort, il y a 70-80 000 (peut-être plus) étudiants, et on discute de ce qu’on va faire. Ça se divise suivant les opinions politiques. Les maoïstes disent qu’il faut aller vers les banlieues, que le cortège doit se diriger vers Ivry etc., soulever les banlieues. Les anarchos et les situs disent qu’il faut aller faire du bruit dans les quartiers bourgeois. Les trotskistes disent qu’il faut aller dans le quartier du prolétariat de Paris, vers le XIe. Ce sont les étudiants de Nanterre qui disent qu’il faut aller vers le Quartier latin. Il y a eu tout d’un coup des gens qui ont crié : « Nous avons des copains à la Santé, la prison de la Santé, faut leur dire bonjour ! » Et alors, tout le cortège s’est ébranlé en direction de la prison de la Santé à partir de la place Denfert-Rochereau. On a repris le boulevard Aragon. On est passé devant la prison de la Santé. On a vu des mains aux fenêtres. On a crié des tas de choses. Et on s’est engouffré vers le quartier Latin. Un hasard. Ou pas tout à fait un hasard quand même. Il devait y avoir un mouvement, une aspiration à revenir au Quartier latin, à ne pas s’éloigner du centre de la vie étudiante. La télévision était là. Vers minuit la télévision est partie. Il est resté Europe1, donc la radio. Et vers 3h du matin un type de la radio a tendu le micro à Daniel Cohn-Bendit, qui a eu l’inspiration géniale, il a tout simplement dit : « la grève générale, la grève générale, la grève générale. » Et c’est là qu’il y a eu une action. C’est ça qui a surpris la police, c’est là qu’ils ont été pris de court. Les étudiants faisaient du chahut, il y avait eu quelque bagarres, quelques blessés, des grenades lacrymogènes, des pavés, des barricades, des bombes. Les enfants de la bourgeoisie se donnaient du bon temps. Ah, oui, mais la grève générale, hein, ça c’était pas de la rigolade.
***
♦ lire aussi : A note on Lefebvre and Cheype (Michèle Bernstein, 2014)

◘ Prolongements :
• « Debord », Pierre Guillaume, in : La Vieille taupe n°1, Paris, 1995
• « Les situationnistes, Instructions pour une prise d'armes », Jean-Pierre George, in : Le Magazine littéraire n°14, janvier 1968.
• « Le déclin et la chute de l’économie spectaculaire-marchande », Guy Debord, in : Internationale Situationniste n°10, mars 1966.
• « Sur l’emploi du temps libre », Guy Debord, in : Internationale situationniste n°4, juin 1960.
• Les Situationnistes, Une avant-garde totale, Éric Brun, CNRS Éditions, 2014, 454 p. [extrait postface]



