-
Par EROE le 27 Octobre 2012 à 07:31
NOTE SUR UNE LIGNÉE D'ÉCRIVAINS :
DE STENDHAL À DOSTOÏEVSKI ET ERNST VON SALOMON
[Ci-dessous : Freikorps à Berlin en 1920]
 « Timidement, je caresse la reliure avec le dos de ma main. Je tourne la feuille de garde et je lis : Stendhal, Le Rouge et le Noir ». Ainsi s'achève l'un des chapitres du roman d'Ernst von Salomon (1902-1972), Les Réprouvés (Die Geächteten) (1), œuvre phare de l'époque des corps-francs en Allemagne après la défaite de 1918. L'admiration envers Stendhal (1783-1842) dont témoigne la phrase de von Salomon suscite évidemment une réflexion sur les rapports que l'on peut établir entre ces 2 écrivains, éloignés d'un siècle dans le temps, et a priori fort différents par leur culture. Mais le débat devra encore être élargi grâce à un aphorisme de Nietzsche (1844-1900), qui marque un relais dans la filiation Stendhal / von Salomon, en introduisant la personnalité de Dostoïevski (1821-1881). Dans Le Crépuscule des Idoles en effet (2), Nietzsche relève : « Dostoïevski est, soit dit en passant, le seul psychologue qui ait eu quelque chose à m'apprendre. — Je le compte au nombre des plus belles aubaines de ma vie, plus encore que ma découverte de Stendhal ».
« Timidement, je caresse la reliure avec le dos de ma main. Je tourne la feuille de garde et je lis : Stendhal, Le Rouge et le Noir ». Ainsi s'achève l'un des chapitres du roman d'Ernst von Salomon (1902-1972), Les Réprouvés (Die Geächteten) (1), œuvre phare de l'époque des corps-francs en Allemagne après la défaite de 1918. L'admiration envers Stendhal (1783-1842) dont témoigne la phrase de von Salomon suscite évidemment une réflexion sur les rapports que l'on peut établir entre ces 2 écrivains, éloignés d'un siècle dans le temps, et a priori fort différents par leur culture. Mais le débat devra encore être élargi grâce à un aphorisme de Nietzsche (1844-1900), qui marque un relais dans la filiation Stendhal / von Salomon, en introduisant la personnalité de Dostoïevski (1821-1881). Dans Le Crépuscule des Idoles en effet (2), Nietzsche relève : « Dostoïevski est, soit dit en passant, le seul psychologue qui ait eu quelque chose à m'apprendre. — Je le compte au nombre des plus belles aubaines de ma vie, plus encore que ma découverte de Stendhal ».C'est donc cette lignée d'écrivains que nous allons tenter d'appréhender ici, sachant que, plutôt qu'à leur style, c'est à leur démarche intellectuelle, à leur idéologie, que nous nous attacherons prioritairement. Car Julien Sorel, le héros stendhalien apparaît comme le prototype de tout un courant d'idées dont le XXe siècle a vu — et voit encore — se développer la descendance, au travers de personnages que l'on a qualifié de nihilistes, mais qui sont en fait des révolutionnaires détachés des contingences de la société bourgeoise.
La haine sociale
À propos du Rouge et le Noir, Paul Bourget notait en effet : « Plus nous avançons dans la démocratie, plus le chef-d'œuvre de Stendhal devient actuel » (3). C'est une manière de projeter le roman dans le XXe siècle, et donc de poser le principe d'un rapport direct, si l'on veut, avec Les Reprouvés de von Salomon. La grande figure de Julien Sorel incarne en effet « la rébellion moderne », selon les termes de Maurice Bardèche (4). Cette rébellion, personne mieux qu'Ernst von Salomon ne l'a décrite :
« Nous étions enragés, écrit-il. Des drapeaux de fumée noire jalonnaient notre route. Nous avions allumé un bûcher où il n'y avait pas que des objets inanimés qui brûlaient : nos espoirs, nos aspirations y brûlaient aussi, les lois de la bourgeoisie, les valeurs du monde civilisé, tout y brûlait, les derniers vestiges du vocabulaire et de la croyance aux choses et aux idées de ce temps, ce bric-à-brac poussiéreux qui traînait encore dans nos cœurs » (5).
Libération, purification, régénération, telles sont les thèses que pose ainsi Ernst von Salomon dans son roman. La question est finalement de retrouver l'homme au sein du dédale social. L'identité humaine, la recherche passionnée du moi, sont ainsi les seules valeurs qui subsistent aux yeux de l'écrivain.
Mieux que dans Les Réprouvés cependant, l'analyse de la révolte contre l'ordre établi se rencontre dans Le Rouge et le Noir. « La haine extrême qui animait Julien contre les riches allait éclater », écrit Stendhal au chapitre IX, puis : « Il ne vit en Mme de Rénal qu'une femme riche, il laissa tomber sa main avec dédain, et s'éloigna » (6). Ce sentiment d'abjection envers tout ce qui médiatise l'homme pour en faire un être social, empêtré dans des idées préétablies, forme le fond de l'attitude de Julien Sorel, quand bien même il cherche à entrer dans cet univers maniéré qu'il perçoit cependant comme ridicule. Car il n'y croit pas. Dès le premier contact avec la société policée, il se sent étranger, différent. Il aspire avant tout à se libérer du carcan social, pour se retrouver lui-même, homme. Supérieurement intelligent, ce cérébral ne pouvait laisser Nietzsche indifférent. Il possède son effet en lui les qualités du surhomme, capable de se surpasser, de transgresser les valeurs. La réflexion, l'analyse et finalement le crime de Julien Sorel trouvent un écho dans la démarche de Rodion Romanovitch Raskolnikov, le héros de Crime et Châtiment, œuvre de Dostoïevski (7).
La recherche de l'homme intégral
Raskolnikov, conscient lui aussi de sa supériorité, cherche également à se libérer du bourbier social, et sa pensée se fixe sur une vieille usurière, Aliona Ivanovna. « Quelle importance a-t-elle dans la balance de la vie, cette méchante sorcière ? », se dit-il. Mais au-delà de la seule réflexion sociale, qui fait finalement le fond du roman de Stendhal, Dostoïevski introduit de plus une dimension psychologique propre à son œuvre. Si la vieille est l'obstacle social à abattre pour se libérer — « Ce n'est pas une créature humaine que j'ai assassinée, c'est un principe » — l'idée du crime germe aussi comme un défi à la propre libération du héros. « Suis-je capable d'exécuter cela ? », se demande Raskolnikov.Car le héros étouffe entre les murs de la morale officielle. Il se sent, comme Julien Sorel, différent du troupeau de l'humanité. Le destin l'a désigné pour, ainsi que le dit Henri Troyat (8), « la terrible aventure de l'indépendance spirituelle ». Des êtres comme lui possèdent le droit de dépasser les limites du social. Leur but unique est la recherche de l'homme intégral. Cette démarche en fait des surhommes nietzschéens. Car ni Julien Sorel, ni Raskolnikov ne regrettent leur crime. « Après tout, je n'ai tué qu'un pou, un sale pou, inutile et malfaisant », s'écrie Raskolnikov, tandis que Julien Sorel attend son exécution avec sérénité, entièrement libéré et purifié. « J'ai aimé la vérité… dit-il, Où est-elle ?… Partout hypocrisie, ou du moins charlatanisme (…). Non, l'homme ne peut pas se fier à l'homme ».Leur recherche est donc essentiellement celle de l'humanité sincère. Par-delà les considérations sociales, Julien Sorel analyse ainsi la situation : « Avant la loi, il n'y a de naturel que la force du lion, ou le besoin de l'être qui a faim, qui a froid, le besoin en un mot ». Car ajoute-t-il, en rupture totale avec la pensée rousseauiste sur laquelle s'appuie la société bourgeoise du XIXe (et du XXe) siècle, "il n'y a point de droit naturel". Au droit, il substitue le besoin, à la société, il oppose l'homme. Cette position est celle, nous l'avons vu plus haut, d'Ernst von Salomon, dégagé de toute contrainte avec ses camarades des corps-francs.
Chez Stendhal et Dostoïevski se trouvent les prémisses de la pensée libératrice de Nietzsche. L'homme est une créature naturelle, et comme telle, il est un prédateur. Tout homme supérieur a le droit et le devoir de prélever sa proie dans le troupeau. C'est pourquoi Raskolnikov se demande pour quelle raison son acte apparaît aussi odieux à son entourage : « Parce que c'est un crime ? Que signifie le mot crime ? Ma conscience est tranquille ». Et, tout comme Julien Sorel, il s'offre en pâture à la société : « Certes, j'ai commis un assassinat… Eh bien ! pour respecter la lettre de la loi, prenez ma tête et n'en parlons plus… ». C'est à peu de choses près ce qu'exprime Julien Sorel au juge venu le visiter dans sa prison : « Mais ne voyez-vous pas, lui dit Julien en souriant, que je me fais aussi coupable que vous pouvez le désirer ? Allez, monsieur, vous ne manquerez pas la proie que vous poursuivez ».
Napoléon, modèle de liberté
La parallélisme entre Raskolnikov et Julien Sorel rencontre encore un autre écho dans l'admiration semblable qu'ils portent à Napoléon :« Un vrai maître, à qui tout est permis, songe le héros de Dostoïevski, canonne Toulon, organise un massacre à Paris, oublie son armée en Égypte, dépense un demi million d'hommes dans la campagne de Russie, et se tire d'affaires, à Vilna, par un jeu de mots. Et c'est à cet homme qu'après sa mort on élève des statues. Ainsi donc, tout est permis… ».C'est là la terrible conclusion de Dostoïevski, qui hante toute son œuvre (9). Cette conclusion, nous la retrouvons chez Stendhal, bien que moins nettement dégagée : « Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée » (10). Ernst von Salomon écrit quant à lui : « Dans une armoire, j'avais encore un portrait du Corse que j'avais décroché au début de la guerre [de 1914] ». Cette phrase montre là encore la totale admiration de tous les révolutionnaires pour Napoléon, quand bien même ils condamnent l'expansionnisme français.Un prédateur régénéré dans la violence
Car ni Dostoïevski, ni von Salomon ne sont des adulateurs de l'Empereur. Leur nationalité limite l'enthousiasme que l'on ressent chez Julien Sorel. Abstraction faite de cette réserve, Napoléon est cependant un modèle absolu, celui de l'homme libéré du carcan social, du poids des considérations sociales. Lui seul porte à agir Julien Sorel et Raskolnikov, qui brûlent, l'un comme l'autre, de passer à l'action, et que les conditions sociales de leur époque empêchent de donner leur mesure. Le meurtre apparaît ainsi comme le substitut à l'héroïsme qu'on ne leur offre pas. Stendhal relève d'ailleurs dans son roman : « Depuis la chute de Napoléon (…) l'ennui redouble » (11). Ce sont ces contraintes qui poussent parfois Julien Sorel à se dévoiler violemment : « L'homme qui veut chasser l'ignorance et le crime de la terre doit-il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard ? ». Nous tenons là le véritable lien qui relie Stendhal à Ernst von Salomon.
Prédateur, l'homme ne peut se régénérer que dans la violence, que déchaînent la guerre ou la révolution. Or, à l'inverse de Julien Sorel et de Raskolnikov, le destin d'Ernst von Salomon — héros de son propre roman — se dessina dans une époque de périls pour l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale. Comme le personnage de Stendhal, il fut, en tant qu'élève à l'école des Cadets, frustré de "sa" guerre. Mais il put cependant se libérer grâce à l'épopée des corps-francs. Il ne s'agissait d'ailleurs pas seulement d'une lutte pour sauvegarder l'intégrité du territoire allemand, il s'agissait aussi — et peut-être surtout — de mettre en pratique cette nouvelle mentalité révolutionnaire, en conquérant de nouveaux espaces. Ce fut l'aventure du Baltikum qui permit de dépasser le nihilisme et de briser l'individualisme…
Le lieutenant Erwin Kern, compagnon de von Salomon, et l'un des assassins de Walter Rathenau en 1922, également héros du roman, recoupe entièrement ce que pensent Julien Sorel et Raskolnikov, lorsqu'il dit :
« Pourquoi sommes-nous différents ? Pourquoi existe-t-il des hommes comme nous, des Allemands comme nous, étrangers au troupeau, à la masse des autres Allemands ? Nous employons les mêmes mots et pourtant nous ne parlons pas le même langage. Quand ils nous demandent 'Que voulez-vous ?', nous ne pouvons pas répondre. Cette question n'a pas de sens pour nous. Si nous tentions de leur répondre, ils ne nous comprendraient pas. Quand ceux d'en face disent intérêt, nous répondons purification » (12).
Purification, c'est-à-dire libération, surhumanisation nietzschéenne.
De la liberté à la politique
Si la filiation s'établit assez facilement de Stendhal et Dostoïevski à Nietzsche et Ernst von Salomon, il existe cependant une grande différence entre les XIXe et XXe siècles. Les personnalités des différentes figures que nous avons considérées s'expliquent parfaitement d'un point de vue social et psychologique. Cependant, la révolte de Julien Sorel ou de Raskolnikov n'est pas la révolution programmée d'Ernst von Salomon, annoncée par Nietzsche (et d'autres penseurs). Il ne s'agit plus de se reconnaître différent en tant qu'individu, il s'agit de combattre les causes de la destruction de l'humanité. Dès lors, 2 tendances vont se conjuguer, la réflexion et l'action, qui toutes 2 se trouvaient en germe dans le romantisme. Le but suprême est la lutte contre la société bourgeoise, et par là-même, la régénération de l'humanité.
De là naîtra le mouvement que l'on nomme Révolution conservatrice, dont Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) a certainement donné la meilleure définition :
« Un révolutionnaire, écrit-il, n'est pas celui qui introduit des nouveautés, mais au contraire celui qui veut maintenir les traditions anciennes » (13).
Il ne nous appartient pas ici d'étudier ce courant d'idées (14). Notre dessein n'est que d'en repérer les origines et la continuité au travers d'un type de héros de roman. Cependant si Ernst von Salomon nous autorise à poser Le Rouge et le Noir de Stendhal comme étant une des sources des idées de la Révolution conservatrice, il est permis de se demander pour quelles raisons les penseurs français classés à gauche, Zola ou Aragon (15), ont également tenté de récupérer la figure de Julien Sorel.
Certes, la lutte anti-sociale du héros explique leur position. Mais c'est oublier une dimension essentielle de la personnalité de Julien Sorel, paramètre qui n'a pas en revanche échappé à von Salomon. Inférieur socialement aux personnages qu'il côtoie, Sorel se sent cependant supérieur à eux. Il considère l'injustice sociale non sur le plan strict du droit, mais sur le plan humain. Il ne cherche même pas à égaler ses maîtres, il revendique sa différence intellectuelle. Selon lui, tout comme pour Raskolnikov d'ailleurs, les mérites tiennent aux talents, nullement à la position sociale.
Or, cette supériorité n'a pas été remarquée — volontairement ? — par les critiques de gauche. En cela, on peut dire que leur annexion de Julien Sorel est abusive. Ce qui n'est pas le cas chez certains penseurs de droite. On se souviendra comment E. von Salomon s'éloigna du national-socialisme, parce qu'il considérait ce parti politique comme trop plébéien. Seule sa notoriété lui valut de ne pas être inquiété durant la période hitlérienne. Cette position d'extrême conscience de sa valeur avait également été celle de Stendhal durant son existence.
 Psychologie du révolutionnaire
Psychologie du révolutionnaire[Ci-contre Raskolnikov sous la pluie. « Il y a une tyrannie à laquelle nous ne pourrons jamais nous soumettre, c'est celle des lois économiques. Car, étant donné qu'elle est complètement étrangère à notre nature, il nous est impossible de progresser sous elle. Elle devient insupportable parce qu'elle est d'un rang trop inférieur. C'est là que se trouve le critère ; c'est là qu'il faut choisir même sans demander de preuves. On a ou non le sens de la hiérarchie des valeurs, et toute discussion est impossible avec ceux qui nient cette hiérarchie », Ernst Von Salomon, Les Réprouvés]
Nous avons vu se dessiner, dans ce qui précède, la psychologie du révolutionnaire. Mettons de côté cependant la problématique propre de Dostoïevski, qui est celle du rachat de l'homme marqué par la perspective chrétienne du Salut — encore que les considérations religieuses et sociales ne soient pas absentes du Rouge et le Noir —, et étudions en revanche la pathologie de ces personnages, si proches les uns des autres. On a souvent dit que les héros de Dostoïevski étaient tous des psychopathes. C'est possible. Mais une telle constatation, formulée dans le vocabulaire réducteur de l'aliénisme matérialiste, n'explique pas tout, bien au contraire.
Car Stendhal, qui n'a guère fouillé la psychologie de Julien Sorel — en dehors de ses réactions sociales — note rapidement au chapitre XL : « Deux ou trois fois par an, il était saisi par des accès de mélancolie qui allaient jusqu'à l'égarement ». C'est déjà l'annonce des crises des personnages de Dostoïevski, qui par-delà les démonstrations, fouille leur psychologie. Ainsi, après son crime, Raskolnikov se trouve-t-il en proie à un délire et à une inactivité qui révèlent une personnalité irrégulière, déréglée. C'est aussi l'explication que l'on peut donner au cri poussé par E. von Salomon au fond de sa prison. Captif de la société qui cherche à l'annihiler, le héros n'a plus d'autre solution que de hurler sa détresse. Réfractaire à toute mise au pas, désespéré, il laisse échapper sa soif de liberté dans un cri.
La société bourgeoise : un leurre
Conscients de leur supériorité intellectuelle, tous ces personnages se perçoivent si différents des gens établis, qu'ils en sont écrasés. Ecrasés parce qu'ils sont seuls face à la société. Leur sursaut est une déviation de l'action, qui passant par une sorte de dépression, les fait tomber dans le crime en les élevant. Mais ce n'est pas la dépression qui explique leur position face à la société. Cela doit être bien compris. La dépression n'est qu'un résultat. Elle n'est nullement originelle. Parce que la société les brime, les contraint, elle apparaît devant eux. Non l'inverse. Ainsi, ces personnalités s'analysent en fonction du cadre social dans lequel elles évoluent. Sans l'injustice, sans l'imbécillité, sans la lâcheté, sans l'ennui, toutes les figures que nous avons vues, auraient pu s'exprimer librement. Jamais elles ne seraient tombées dans la mélancolie — voire dans la folie comme ce fut le cas pour Nietzsche — si elles avaient été garanties par des sociétés libres. Toute leur réflexion démontre que la société bourgeoise n'est pas naturelle. Elle n'est pas la liberté. Elle n'est qu'un leurre, un piège. L'homme ne peut être libre que dans la nature, qui offre au plus fort la possibilité de la lutte.
Pourquoi tant de mouvements gymnastiques naquirent-ils en Allemagne dès la fin du XIXe siècle ? Précisément pour faire contrepoids à une société bourgeoise étriquée, n'offrant à l'homme que des possibilités de jouer des rôles, sans que jamais il puisse s'épanouir pleinement. Or, ces rôles, Julien Sorel, Raskolnikov ou Ernst von Salomon en avaient dès l'abord décrypté l'hypocrisie. Originellement, ils ne sont pas des personnages déséquilibrés. Seule la société bourgeoise, artificielle, les a forgés comme ils sont, les a poussés dans leurs retranchements. Et c'est toute leur noblesse que de la refuser et de combattre pour l'élaboration d'une autre société, naturelle et humaine.
L'égalitarisme démocratique est donc condamné en bloc par ces personnalités, qui ne rêvent que de sociétés fortes et viriles. Là en fait se situe la carence des psychologues, qui ne font que constater des faits, et qui ignorent délibérément un paramètre essentiel, le contexte social. Psychopathes, à tout le moins dépressifs, Julien Sorel ou Raskolnikov le sont sans doute selon les normes bourgeoises. Mais ils le sont parce qu'ils sont incapables de rentrer dans une société qui ne leur convient pas, une société de médiocres calculateurs, une société mercantile, essentiellement faite pour les faibles.
Or, ce sont ceux-ci qui jugent et condamnent ces personnages, sans être à même de les comprendre. Parce qu'ils ont été piégés par la société. Parce qu'ils manquent de grandeur morale. Parce qu'ils manquent simplement d'intelligence et de courage. Il faut en effet être particulièrement fort pour se mesurer à la société et à soi-même. C'est ce qu'affirment dramatiquement ces 3 héros de la révolte européenne.
► Jérémie Benoît, Vouloir n°134/136, 1996.
• Notes :
(1) Die Geächteten, Berlin, Rowohlt Verlag, 1930, tr. fr. : Les Réprouvés, Plon, 1931, p. 396.
(2) Le Crépuscule des Idoles, (1888) "Divagation d'un Inactuel", # 45.
(3) P. Bourget, Essai de Psychologie contemporaine, 1889.
(4) M. Bardèche, Stendhal romancier, 1947.
(5) Les Réprouvés, op. cit. p. 120-121.
(6) Le Rouge et le Noir, 1830, chap. X.
(7) Crime et Châtiment, publié dans Le Messager russe en 1866.
(8) H. Troyat, Dostoïevski, Paris, Fayard, 1960, p. 239.
(9) Cette idée que tout est permis à l'homme, parce qu'il n'y a pas de dieu, se retrouve en particulier dans les réflexions d'Ivan Karamazov. C'est en s'inspirant de lui que Smerdiakov, le bâtard, sorte de double infernal de son maître, tue le père Karamazov. Car, comme le fait observer H. Troyat, op. cit., p.356, « Smerdiakov confond la liberté avec l'arbitraire ». On remarquera à ce propos que Dostoïevski, tout comme Stendhal d'ailleurs, n'a écrit qu'un seul roman, n'a créé qu'un seul type de héros, déclinés sous tous leurs aspects.
(10) Est-ce un hasard si Stendhal écrivit une Vie de Napoléon, éditée seulement en 1876 ?
(11) On se souviendra à ce propos de ce qu'écrivait Alfred de Vigny (1797-1863) dans Servitude et grandeur militaires (1835) : « Cette génération née avec le siècle qui, nourrie de bulletins par l'Empereur, avait toujours devant les yeux une épée nue, et vint la prendre au moment même où la France la remettait dans le fourreau des Bourbons ». À quoi répondait Alfred de Musset (1810-1857) dans La confession d'un enfant du siècle (1836) : « Alors s'assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse. Tout ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre ».
(12) Cité par D. Venner, Histoire d'un fascisme allemand : Les corps-francs du Baltikum et la Révolution conservatrice, Pygmalion/Gérard Watelet, 1996, p.251.
(13) A. Moeller van den Bruck, La Révolution des peuples jeunes, Pardès, 1993, p.137. On relèvera par ailleurs que Moeller van den Bruck fut un excellent connaisseur de Dostoïevski qu'il traduisit en allemand. Selon lui, « Dostoïevski était révolutionnaire et conservateur à la fois » (op. cit., p. 136).
(14) Sur ce point, on lira en particulier les publications des éditions Pardès, dont Armin Mohler, La révolution conservatrice en Allemagne, 1918-1932, 1993. On relèvera aussi le fait que parmi les maîtres penseurs de ce courant idéologique, Ernst Jünger avait d'abord pensé à intituler son roman Orages d'acier (1920), "Le gris et le rouge", par référence à Stendhal.
(15) L. Aragon, La lumière de Stendhal, Denoël, 1954.
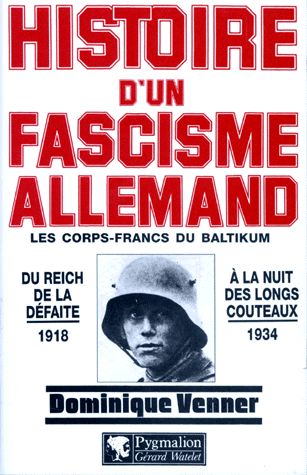 Des Corps Francs à la Révolution allemande
Des Corps Francs à la Révolution allemandeLe renouveau des idées nationales dans le monde entier semble avoir inspiré l’ancien chef charismatique d’Europe Action : fini (provisoirement ?) les excellents livres sur les armes, il faut dire aussi que son ami intime et spécialiste ès-vennerie François de Grossouvre est maintenant décédé. Par contre, nous avons assisté au lancement avec succès de sa luxueuse et toujours intéressante revue Enquête sur l’histoire, à la publication d’un livre autobiographique Le cœur rebelle et de plusieurs essais historiques Gettysburg, Histoire critique de la Résistance et maintenant cette Histoire d’un fascisme allemand, version remaniée et enrichie de son maître-ouvrage Baltikum paru en 1974. Ce livre d’une grande profondeur philosophique est également une synthèse de bonne facture sur la “Révolution allemande”.
L’action se déroule durant la République de Weimar et la situation politique, économique et sociale rappelle la situation d’aujourd’hui : culture cosmopolite et composite, corruption à tous les niveaux, crise économique grave se traduisant par notamment un chômage de masse, la présence humiliante pour les citoyens allemands des années 20 des soldats français et sénégalais sur les rives du Rhin, anticipant le phénomène actuel de l’immigration ou de l’occupation américaine… À mon sens cependant deux différences essentielles :
- les pathologies de la civilisation étaient bien moins présentes (voir en ce moment la montée de la petite délinquence, de la consommation de psychotropes, et autres divers échappatoires de la société qui se décompose).
- l’inexistence (hormis la presse) du système médiatique qui abrutit les masses en pensant évidemment au premier d’entre eux, la télévision.
Et c’est ce qui explique que les populations ne réagissent plus, n’aient plus cette envie instinctive de se battre les armes à la main afin de pouvoir encore exister en tant qu’entité culturelle et biologique. C’est la raison pour laquelle le lecteur du livre de Venner peut parfois avoir du mal à comprendre que des milliers et des milliers de combattants des Corps-francs aient pu mourir au combat, le plus souvent contre la volonté de leur propre armée et de leurs gouvernants pour défendre leur patrie. Pour l’instant ce phénomène de guerre civile semble nous être épargné dans ses épisodes les plus sanglants et nous ne pouvons que constater que le système médiatique et l’opulence matérielle annihilent la volonté des protagonistes d’en découdre manu militari, le combat se déroulant à “fleurets mouchetés”, de bons nerfs étant plus utiles que le courage physique. De toutes manières, dans de telles époques, l’individu actif conserve son autonomie et son pouvoir pour accroître le désordre, agir dans le sens de la destruction, mais ce pouvoir lui est refusé pour bâtir.
Les écrits de ce temps reflètent cette violence et tout cela le Jünger de la période nationale-révolutionnaire l’avait bien compris. Dominique Venner nous rapporte une de ses citations qui le rapproche de l’esprit d’un soldat politique : « L’ordre est l’ennemi commun… La destruction est le seul programme qui remplisse les exigences nationalistes ». Le célèbre chef de Corps-francs, Roßbach lui-même, en termes encore plus crus, ne disait pas autre chose : « Rassembler des hommes pour en faire des soldats, se quereller, boire, rugir et casser des fenêtres, détruire et mettre en pièces ce qui doit être détruit. Être sans scrupules et inexorablement dur. L’abcès doit faire couler beaucoup de sang rouge. Et il faut le laisser couler un bon moment, jusqu’à ce que le corps soit purifié ». Et c’est vrai qu’un certain nombre de responsables de la République de Weimar finissent leur vie exécutés par des groupes armés : Gareis, Rathenau, Erzberger, etc.
À la lecture de ce livre, aussi minutieux que vivant, nous comprenons d’une manière très complète l’état d’esprit des Corps-francs : le guerrier de la Première Guerre mondiale laisse la place à une sorte de lansquenet des temps modernes, influencé par l’image toujours présente des Wandervögel ; rarement ils haïssent les communistes et ne les méprisent jamais. En revanche, leur dégoût pour les bourgeois, les politiciens, les intellectuels et les Juifs (Zeitgeist oblige…) est certain. Ils savent aussi faire preuve d’une grande adaptabilité dans leur comportement. Pour ne citer qu’un seul exemple, certains Corps-francs, lorsque leur existence légale est menacée, se transforment alors en communauté de travail agricole, sorte de phalanstères guerrières mais aussi réponse au penchant germanique pour la colonisation militaire. L’auteur situe la fin de la Révolution des Corps-francs le jour du putsch de Munich, le 9 novembre 1923. Après le temps de ces lansquenets viendra le temps des politiques. En effet, Adolf Hitler veut utiliser la légalité pour arriver au pouvoir. Beaucoup de Corps-francs vont le lui reprocher : ils se perdront irrévocablement dans ce combat politique.
Ainsi Venner aime ces périodes troubles et agités qui permettent à des chefs de bande de donner la pleine mesure de leur capacité. Clin d’œil de l’histoire : comme les Corps-francs se sont levés après l’humiliation du traité de Versailles, la France, après avoir cédé l’Algérie, verra une bande de jeunes gens se dresser face à la décadence. Son chef en était Dominique Venner, la bande c’était Europe-Action. Beaucoup d’entre eux continuent une carrière brillante non seulement au sein du mouvement national mais aussi ailleurs. Venner a été d’une certaine manière leur guide spirituel comme Ernst Jünger celui des anciens des Corps-francs. Venner entretient depuis quelque temps une correspondance avec celui, centenaire aujourd’hui, qui a été la conscience politique et philosophique de la Révolution conservatrice.
Et aussi comme Jünger l’avait fait à partir de 1929, Venner, dans les années 70, s’est retiré de tout militantisme politique pour se consacrer à son œuvre. Mais le bon grain avait été semé. Il est vrai également que tous les deux éprouvaient le besoin de faire une pause dans ce parcours commencé si tôt par un engagement dans la légion dès l’âge de 15 ans. Étrange parallèle de ces deux destins à un demi siècle de distance. Sans doute, est-ce la raison pour laquelle Venner a rajouté deux très beaux chapitres sur la Révolution conservatrice, sorte d’espace métapolitique allemand des années 20, et une analyse très fine de l’œuvre de Jünger, hommage de l’élève à son maître.
♦ Dominique Venner, Histoire d’un fascisme allemand : Les Corps Francs du Baltikum et la Révolution Conservatrice, Pygmalion / Gérard Watelet, Paris, 1996, 380 p.
► Pascal Garnier, Nouvelles de Synergies Européennes n°22, 1996.
***
« Ils comprirent subitement qu’un nouveau vouloir demande de nouvelles lois, des lois qui se formulaient dans les cerveaux inlassablement en travail de ces lutteurs solitaires, et qui les chargeaient d’une si monstrueuse responsabilité que seuls pouvaient l’assumer ceux qui étaient disposés à se donner sans restriction. […] Ce sont les hommes qui décident et non pas les faits. »
Ernst von Salomon, Les Réprouvés
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Textes supplémentaires :
Les hommes des corps-francs sont les fils de la guerre, de la défaite et de la révolution de novembre. Ils sont directement apparentés aux arditi de Fiume et aux squadristes qui surgissent un peu plus tard en Italie, constituant un type d’homme bien spécifique qu’on ne reverra plus. Ils ont été façonnés d’abord par les combats des tranchées de la guerre. Celle-ci avait trié entre les hommes que l’épreuve a nerveusement ou moralement écrasés, et ceux qui en sont sortis plus forts et plus durs qu’avant. Parlant d’eux, Jünger les comparera aux lansquenets d’autrefois qui n’avaient plus d’autre patrie que leur drapeau. Ce sont des hommes chez qui la guerre a aboli toute différence sociale, les égalisant selon un standard sans support avec celui de la vie civile. Ils ont remplacé les distinctions de classe par celle de l’audace et du courage. Et cette nouvelle échelle de valeurs, ils voudront plus tard la transposer dans la vie civile d’après-guerre. À leur façon ce sont des socialistes. Mais leur socialisme est militaire, sans lien avec la recherche de la sécurité et du bonheur matériel. Ils ne reconnaissent plus d’autre hiérarchie que celle du mérite. Tous partagent la même foi dans le pouvoir de la volonté et un goût évident pour les méthodes expéditives.
En eux ne se résume sans doute pas toute l’essence du fascisme et du national-socialisme, mais ils en portent une part fondatrice dans la mesure où ils incarnent la révolte la plus radicale contre le monde bourgeois de leur temps.
► Dominique Venner, Le Siècle de 1914.
***
ERNST VON SALOMON (1902-1972)
Vous ne le connaissez pas ?… Vous avez tort. Un bon tiers de la littérature contemporaine procède de ce Prussien violent, sarcastique et taciturne, chez qui Hemingway et Malraux sont allés chercher l'idée du roman-reportage, tellement en usage aujourd'hui qu'on ne s'en aperçoit plus. (…) C'est bien l'auteur des Cadets qui, le premier, sut mettre dans la narration littéraire le mouvement et le ton du témoignage direct, sans en affaiblir l'objectivité.
Le résultat conjugue rigueur et passion ; il remplace la psychologie par l'élan vital et prête à l'interrogation du destin l'allure familière du journaliste, sur les pas duquel se lève, comme une fumée, un pathétique pur, qu'il feint d'ignorer. Du Maupassant 'engagé', qui a retroussé ses manches de chemise et fonce, la pipe aux dents, à travers les tumultes de l'histoire.
Entre 1925 et 1940 il fut, quoi qu'on en pense, le plus original et le plus vigoureux des écrivains allemands. Si vous n'avez lu ni Les Réprouvés, ni La Ville, hâtez-vous de combler cette lacune de votre culture. En 1950, il résuma toute l'imbécilité des vainqueurs et des vaincus dans Le Questionnaire, livre qui vaut Swift et Cervantès, pour la causticité de la satire, relevée par un sentiment héroïque. (…)
Ernst l'Européen est parti avec son secret. Qui est, hélas, le nôtre.
► Billet de Robert Poulet paru dans l'hebdomadaire Pan du 23 août 1972.***
Ernst von Salomon, mémorialiste de la Révolution conservatrice allemande
Assez récemment, les éditions Bartillat ont eu l’excellente idée de rééditer Ernst von Salomon, auteur culte, certes, mais seulement pour un petit nombre d’adeptes. Et ses livres majeurs n’étaient plus disponibles depuis plusieurs années. Jean Mabire notait, dans son Que lire ? de 1996, pour le regretter, que « la mort d’Ernst von Salomon, en 1972 n’avait « pas fait grand bruit, et, aujourd’hui, on parle fort peu de cet écrivain singulier ». Et bien parlons-en, précisément dans ce numéro de Synthèse nationale, car l’auteur des Réprouvés est certainement, avec Ernst Jünger, l’écrivain qui a le mieux raconté la Révolution conservatrice allemande. Car il en a été aussi un acteur majeur.
La famille von Salomon descendait semble-t-il de protestants français ayant émigré au moment des guerres de religion. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater que cet ancien cadet se voulait l’héritier des chevaliers teutoniques. Quant à son nationalisme, il est avant tout prussien. Né en 1902 à Kiel, le grand port de guerre allemand, von Salomon s’engage dans une école militaire — ces fameux cadets —, alors même que la guerre vient de s’achever sur l’humiliation de la défaite de 1918, et que le pays sombre dans la révolution et la guerre civile. Il participe aux aventures politico-militaires des corps francs, reçoit le baptême du feu à Berlin et combat les spartakistes (bolcheviques). Il est de tous les complots : depuis le putsch de Kapp (1920) jusqu’à l’assassinat du ministre Rathenau (1922). « Nous voulions liquider tout ce qu’il y avait en Allemagne comme politiciens favorables à la politique “réaliste” — avouera-t-il, peu avant sa mort, en 1972, dans un long entretien télévisé. Nous voulions les tuer les uns après les autres, jusqu’à ce que le peuple se réveille ».
À la suite de ce dernier attentat, von Salomon est arrêté, et condamné à 5 années de forteresse, et c’est en prison qu’il va écrire Les Réprouvés, publié en Allemagne en 1930, et en France l’année suivante. C’est un livre militant, ardent, qui traduit une pensée aristocratique, médiévale. Von Salomon n’est pas un doctrinaire, et pour lui, l’action et la volonté se justifient en soi. « La patrie brûlait sourdement dans quelques cerveaux hardis ». Cette phrase, on la trouve dans Les Réprouvés. Elle fut reprise bien des fois, aussi bien par les jeunes fascistes français d’avant-guerre et de l’Occupation, que par de jeunes résistants, ou encore par les activistes de l’OAS. Et von Salomon devint le maître à vivre (plus que le maître à penser) de beaucoup d’intellectuels qui se rêvaient hommes d’action. À commencer par Drieu la Rochelle.
Une grande partie du récit des Réprouvés est consacrée à la préparation du meurtre de Rathenau. Et comme le note Jean Mabire, le livre semble prôner « l’action pour l’action, dans une optique de violence et de pureté qui se soucie peu des préoccupations doctrinales ». À peine libéré, von Salomon se rue à nouveau dans l’action. Il est une nouvelle fois condamné à 3 ans de prison, après une violente bagarre. Libéré, il se lie avec Ernst Jünger et les cercles politico-littéraires de la Révolution conservatrice. Mais il entend rester d’abord un activiste, et le voici compromis dans la révolte armée des paysans du Schleswig-Holstein contre le pouvoir central. Von Salomon dirige leur journal, et on le soupçonne d’avoir participé à une série d’attentats à la bombe. À cette époque (1929), rappelle le journaliste Jean-Pierre Bonicco, qui a postfacé la réédition des Cadets [Bartillat, 2008], les 4 fils von Salomon sont tous en prison en raison de leurs engagements extrémistes, parfois opposés, d’ailleurs.
Le roman La Ville parait en 1932 (en 1933 en France). C’est le portrait d’un agitateur vagabondant dans le radicalisme absolu, c’est encore une sorte d’autobiographie, autour de ses engagements “paysans”. Puis sont publiés Les Cadets (1933), dont la traduction française ne paraitra, pour la première fois, que vingt années plus tard, récit à la première personne de son intégration à l’école des Cadets royaux, texte essentiel : « C’est ici que tout a commencé. Ici s’est forgée sa formidable capacité de résister aux pouvoirs établis… Ici, il a découvert ses affinités électives avec le prussianisme considéré non pas comme un système, un ordre substitué à d’autres, mais bien comme “le système, l’ordre sans appel possible” » (François Nourissier, La Nouvelle NRF, mai 1953).
Curieusement l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, le 30 janvier 1933, ne remplit pas von Salomon de joie. C’est pourtant bien l’écrasement du Rote Front et l’avènement d’un régime à la fois socialiste et nationaliste, que l’on pourrait penser assez proche des idéaux de la Révolution conservatrice. Mais von Salomon a commencé à perdre sa fibre militante. Peut-être après la Nuit des longs couteaux, où furent assassinés tant de ses anciens camarades des Freikorps. Ou parce que sa compagne était d’origine juive. Ou plus simplement parce que, pour lui, comme pour tous les vrais révolutionnaires de droite, « c’est dans l’échec seul que la liberté vit », selon la formule du polémiste Philippe Murray. J’aurais tendance à privilégier cette dernière hypothèse.
Pendant l’Occupation, il voyage, en France, notamment, mais ne participe pas au culte national-socialiste, pas plus qu’au complot contre Hitler. Néanmoins il est interné par les Américains, en 1945, qui l’ont classé big nazi. Cet internement de 18 mois (son quatrième emprisonnement, en fait) va être l’occasion, une fois de plus, pour lui, d’écrire un nouveau chef d’œuvre : Le Questionnaire. Dans cet énorme livre (800 pages dans la version allemande, 650 pages dans la traduction française de Gallimard), von Salomon subvertit le « questionnaire de dénazification » en 131 questions qui lui a été soumis, et le transforme en un formidable pamphlet consacré aux 50 dernières années de l’histoire de l’Allemagne. Le livre est un grand succès, de part et d’autre de la frontière (publié en 1951 en Allemagne, et en 1953 en France).
Mort en 1972, von Salomon n’a pas connu la chute du mur de Berlin, la fin du communisme, la réunification de l’Allemagne. Ses dernières années, il les avait passées, tranquillement, dans une maison au toit de chaume près de Hambourg. François Brigneau et Dominique Venner le rencontrèrent l’un et l’autre peu avant sa mort. Ils avaient cherché en vain dans « ce visage replet » les traits du jeune aventurier terroriste qu’il avait été. Mais c’est dans ses livres qu’ils sont gravés, et à jamais. Les Réprouvés, La Ville, Les Cadets et Le Questionnaire constituent donc l’essentiel de l’œuvre de von Salomon. Commencez par Les Cadets (1), puis reprenez l’ordre chronologique de parution. Vous reconstituerez alors l’autobiographie de notre aventurier, une autobiographie transcendée par ce sens de la rébellion absolue qui fascina tant un Drieu la Rochelle ou un Roger Stéphane.
► Francis Bergeron, Synthèse nationale n°21, 2011.
***Les Réprouvés
Dans les sagas islandaises, les réprouvés étaient des hommes refusant de se plier au règlement des castes et des familles et qui, pour cette raison, furent chassés des régions de l’ordre. En 1918, Ernst Von Salomon s’engage à 17 ans dans les corps-francs pour aller combattre les bolcheviques dans les pays baltes. Mais le Traité de Versailles signé par la République de Weimar vient stopper cet élan patriotique et oblige l’Allemagne à dissoudre son armée. Déçu et perdu face à cette situation, Salomon comme des milliers de jeunes Allemands va entrer en rébellion et se lancer à corps perdu dans un combat contre le gouvernement et les « rouges ». Ce roman autobiographique est un témoignage saisissant de l’Allemagne d’après-guerre où règne le chaos où s'engouffrent des organisations combattantes clandestines.► Extraits :
◘ La guerre est finie ; les guerriers marchent toujours
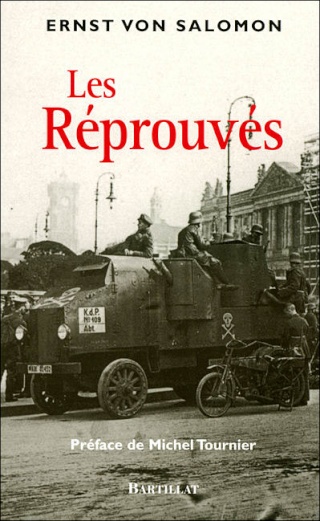 Au milieu de décembre les troupes allemandes rentrant du front traversèrent notre ville. Ce n'était qu'une division qui venait de la région de Verdun. (…)
Au milieu de décembre les troupes allemandes rentrant du front traversèrent notre ville. Ce n'était qu'une division qui venait de la région de Verdun. (…)L’horreur était-elle toujours dans leurs yeux, serrait-elle toujours leurs gorges, la guerre ne les avait-elle pas encore rendus à eux-mêmes ? Ils venaient directement du front, ils venaient de régions que nous ne connaissions pas, desquelles nous ne savions rien ; ils venaient d’une terre qui était brûlante comme un creuset dans lequel ils auraient été fondus, calcinés, purifiés, ils venaient d’un monde qui ne ressemblait à nul autre. De ce que ces yeux, qui sous les casques étaient là braqués sur le vide, avaient vu, nous n’avions rien su, de cela nous n’avions entendu parler que vaguement, nous n’avions lu que des rapports déformés et regardé que de mauvaises images. Ils marchaient muets, solitaires et toujours comme sous la menace de la mort. Peuple, patrie, devoir. Oui, cela nous l’avions dit, c’étaient les mots du jour – n’y croyions-nous pas vraiment ? Si, nous y croyions ! Mais ceux-là ? Le front qui défilait dans la rue sous nos yeux ?
Les unes après les autres les compagnies passaient, des groupes pitoyablement petits, mais qui apportaient avec eux un souffle redoutable, une atmosphère de sang, d'acier, de matières explosives et de décisions immédiates. Haïssaient-ils la révolution, marchaient-ils contre elle ? Se rangeront-ils, eux, ouvriers, paysans, étudiants, dans notre monde, deviendront-ils tels que nous, adopteront-ils nos soucis, nos volontés, nos luttes et nos buts ?
Et soudain la lumière se fit en moi : allons-donc, ceux-là n'étaient pas des ouvriers, des paysans, des étudiants, ils n'étaient pas des artisans, des employés, des commerçants, des fonctionnaires, ils étaient des soldats ! Non pas des hommes déguisés, non pas des hommes qui obéissaient à un commandement, non pas les délégués d'autres hommes, ils étaient des hommes qui obéissaient à un appel intérieur, à l'appel secret du sang et de l'esprit, ils étaient des volontaires d'une façon ou d'une autre, des hommes qui avaient appris une rude fraternité et appris à connaître ce qu'il y a derrière les choses et qui avaient trouvé dans la guerre une patrie. Patrie, peuple, nation. Voilà de grands mots, mais quand nous les prononcions, ils sonnaient faux. Et c'était pour cela qu'ils ne voulaient pas être des nôtres, et cela expliquait cette entrée muette, imposante, fantomale.
Car la patrie était en eux et en eux la nation. Ce que nos voix proclamaient, ce dont nous nous vantions devant le monde, avait revêtu chez eux un sens secret ; c'était pour cela qu'ils avaient vécu, c'était pour cela qui leur avait commandé de faire ce que nous plaisions à appeler le devoir. Subitement la patrie était en eux, elle avait changé de place, elle avait été saisie par le tourbillon gigantesque des dernières années et emportée au front. Le front, c'était leur pays, c'était leur nation, leur patrie. Et jamais ils n'en parlaient. Jamais ils n'avaient cru aux paroles, ils ne croyaient qu'en eux-mêmes. La guerre les tenait, la guerre les dominait, la guerre ne les laisserait jamais échapper et jamais ils ne pourraient revenir ni nous appartenir tout à fait. Ils auront toujours la guerre dans le sang, la mort toute proche, l'horreur, l'ivresse et le fer. Ce qui se passait maintenant, ce retour, cette rentrée dans le monde paisible, ordonné, bourgeois, c'était une transplantation, une fraude et qui ne pouvait pas réussir. La guerre est finie ; les guerriers marchent toujours.
***
◘ Ordre ou Chaos ?
 En 1918 les hommes qui étaient sortis des tranchées avaient senti qu'il nous avait fallu perdre la guerre pour gagner la nation. Ils avaient éprouvé en eux un grand bouleversement et ils avaient vu que rien de nouveau n'avait été construit et que tout était encore possible. Ils étaient revenus, encore hantés par le paysage guerrier et ils avaient trouvé le Reich semblable à une plaie ouverte dont les bords, pressés par des mains brutales, laissaient couler le sang et le pus. Ils étaient maintenant debout devant ces ruines et, pleins d'étonnement et d'incrédulité, ils écoutaient les paroles et les programmes qu'on leur présentait, à grands coups de tam-tam, comme les valeurs de l'avenir et comme la sagesse et la vérité de l'heure présente. Et parce que sous la menace constante de la mort ils avaient appris à discerner le son de la vérité de celui du mensonge, il leur était aisé d'être incorruptibles. En silence ils se mettaient à la besogne.
En 1918 les hommes qui étaient sortis des tranchées avaient senti qu'il nous avait fallu perdre la guerre pour gagner la nation. Ils avaient éprouvé en eux un grand bouleversement et ils avaient vu que rien de nouveau n'avait été construit et que tout était encore possible. Ils étaient revenus, encore hantés par le paysage guerrier et ils avaient trouvé le Reich semblable à une plaie ouverte dont les bords, pressés par des mains brutales, laissaient couler le sang et le pus. Ils étaient maintenant debout devant ces ruines et, pleins d'étonnement et d'incrédulité, ils écoutaient les paroles et les programmes qu'on leur présentait, à grands coups de tam-tam, comme les valeurs de l'avenir et comme la sagesse et la vérité de l'heure présente. Et parce que sous la menace constante de la mort ils avaient appris à discerner le son de la vérité de celui du mensonge, il leur était aisé d'être incorruptibles. En silence ils se mettaient à la besogne.Beaucoup d'entre eux s'en allaient avec une grimace sceptique, ne désespérant de rien, mais n'ayant foi qu'en eux-mêmes. Ils suivaient une route bizarre, ces congédiés du front, ces revenants de la grande guerre ; ils se rendaient à leur travail, à leurs bureaux, à leurs soucis, très solitaires, très dégrisés, et parfois ils s'adressaient à l'univers avec d'étranges revendications, mais personne ne les écoutait.
Il en existait d'autres que la guerre ne laissait pas s'échapper de ses griffes ; ils ne voyaient partout que la résignation et ils croyaient qu'ils devaient être des sauveurs et poursuivre leur marche en accomplissant inflexiblement un devoir qui était aussi leur soutien. Parmi ceux-ci certains avaient le sentiment qu'une mission était à remplir et que cette mission était confiée à leurs soins. Quelle était cette mission, personne ne le savait, et tous se pliaient donc à la nécessité de l'heure. Mais il y avait beaucoup de ces nécessités. La lutte pour l'existence de l'Empire commença.
L'accord ne s'était pas encore fait entre la raison et tout ce qu'au dedans de nous nous sentions être le vrai. Aussi nous étions prêts à agir sous la seule impulsion de nos sentiments ; et il importait peu que l'on pût démontrer par la suite la justesse de nos actes. Ce qui importait c'est qu'en ces jours des actes fussent accomplis. L'avenir de l'Allemagne était maintenant livré aux mains de chacun et chacun s'identifiait ainsi avec la destinée allemande pendant quelques instants uniques et bénis.
Et nous marchions. La vie était gaie, et joyeux nous criions : « Laissez la voie libre ! Fermez les fenêtres ! » Les éléments les plus actifs du front allemand marchaient, parce qu'ils avaient appris à marcher ; ils marchaient le fusil sur l'épaule, à travers les villes, remplis d'une colère sourde, d'une fureur impétueuse et sans but, sachant qu'à cette heure il fallait lutter et lutter à tout prix. Ils marchaient les uns pour la gauche, les autres pour la droite.
Mais nous qui luttions sous les anciennes couleurs, nous avons sauvé la patrie du chaos. Que Dieu nous pardonne, ce fut notre péché contre l'esprit. Nous avons cru sauver le citoyen et nous avons sauvé le bourgeois.
Le chaos est plus favorable au devenir que l'ordre. La résignation est l'ennemie de tout mouvement. En sauvant la patrie du chaos nous fermions la porte au devenir et nous ouvrions les voies à la résignation.
Celui qui comprenait cela cherchait à la lutte, un sens plus élevé. Après la débâcle, partout où se trouvaient des hommes qui ne voulaient pas renoncer, l'Est faisait germer en eux un espoir indécis. Les premiers qui osèrent imaginer l'empire futur devinèrent d'instinct que l'issue de la guerre devait rompre brutalement toute attache avec l'Ouest. Les renouer cela signifiait se soumettre, cela signifiait se plier au rythme inflexible qui donnait à l'occident sa puissance énorme sur le globe. C'était fausser la signification de la guerre allemande, brusquement reconnue sur des champs éventrés, pendant les heures implacables que nous avions vécu.
***
Pour nous qui étions accourus vers ces provinces baltiques, ce mot « marche en avant », prenait une signification grosse de mystère et délicieusement dangereuse. Dans l’attaque nous espérions trouver une délivrance, une suprême exaltation de nos forces ; nous espérions trouver la confirmation que nous étions à la hauteur de notre destin, nous espérions sentir en nous les véritables valeurs du monde. Nous marchions, nourris par d’autres certitudes que celles qui avaient cours dans notre pays. Nous croyions aux instants où toute une vie se trouve ramassée, nous croyions au bonheur d’une prompte décision. « Marche en avant » ne voulait pas dire pour nous la marche vers un but militaire, vers un point de la carte, vers une ligne qu’il fallait conquérir. « Marche en avant », c”était pour nous la naissance d’une force nouvelle qui pousse le guerrier vers un sommet plus haut, c’était la rupture de tous les liens qui nous attachaient à ce monde corrompu, à ce monde à la dérive, avec lequel un véritable guerrier ne pouvait plus rien avoir de commun.

APPRENDRE À MOURIR
 ► Le texte ci-dessous, tiré de la revue Exil n°4-5 (1974), est un extrait retranscrit et retraduit (par Simone Coulter) d'un important entretien de plusieurs heures accordé en Allemagne les 1er et 2 juillet 1972 par Ernst von Salomon, un mois avant sa mort, aux Archives du XXe Siècle de la Télévision française (ORTF).
► Le texte ci-dessous, tiré de la revue Exil n°4-5 (1974), est un extrait retranscrit et retraduit (par Simone Coulter) d'un important entretien de plusieurs heures accordé en Allemagne les 1er et 2 juillet 1972 par Ernst von Salomon, un mois avant sa mort, aux Archives du XXe Siècle de la Télévision française (ORTF).- À 11 ans vous quittez votre famille pour devenir pensionnaire. Parlez-nous de cette expérience.
 ES : Nous habitions Francfort où mon père était fonctionnaire de la police. Je suis allé dans une Musterschule, excusez l'expression qui signifie « école très privilégiée », puis au Lycée Lessing, très coté. Mais je ne m'y suis pas trop bien distingué et mon père m'a inscrit au Kadettenkorps, les Cadets Royaux de Prusse, tout d'abord à Karlsruhe [ci-contre : en tenue de cadet à 12 ans]. Je n'eus pour ainsi dire plus de contact avec ma famille. J'étais cadet, je découvris une nouvelle patrie, un monde nouveau. Monde très dur. L'éducation dans le Kadettenkorps, avait un but précis, comme je l'ai raconté dans mon livre Les Cadets. Notre première leçon nous fut donnée par un lieutenant : « Messieurs », — car à dix ans on nous disait déjà vous —, « Messieurs, vous êtes ici pour apprendre à mourir ». Cela m'a beaucoup plu, je trouvais que c'était magnifique : les vertus qui me furent enseignées étaient les plus fortes qui peuvent jaillir de l'idée de nation ; elles ont déterminé toute mon existence. Je suis un cadet, avec une éducation de cadet — quoique je doive avouer que je n'aimais pas être cadet.
ES : Nous habitions Francfort où mon père était fonctionnaire de la police. Je suis allé dans une Musterschule, excusez l'expression qui signifie « école très privilégiée », puis au Lycée Lessing, très coté. Mais je ne m'y suis pas trop bien distingué et mon père m'a inscrit au Kadettenkorps, les Cadets Royaux de Prusse, tout d'abord à Karlsruhe [ci-contre : en tenue de cadet à 12 ans]. Je n'eus pour ainsi dire plus de contact avec ma famille. J'étais cadet, je découvris une nouvelle patrie, un monde nouveau. Monde très dur. L'éducation dans le Kadettenkorps, avait un but précis, comme je l'ai raconté dans mon livre Les Cadets. Notre première leçon nous fut donnée par un lieutenant : « Messieurs », — car à dix ans on nous disait déjà vous —, « Messieurs, vous êtes ici pour apprendre à mourir ». Cela m'a beaucoup plu, je trouvais que c'était magnifique : les vertus qui me furent enseignées étaient les plus fortes qui peuvent jaillir de l'idée de nation ; elles ont déterminé toute mon existence. Je suis un cadet, avec une éducation de cadet — quoique je doive avouer que je n'aimais pas être cadet.Si cette éducation m'a marqué, c'est au delà des idées politiques ou nationales. Le mot Prusse renferma pour moi une patrie, non point par le hasard biologique de la naissance, mais comme notion spirituelle. Je ne trouve dans aucun autre État une idée nationale comme elle vivait alors en Prusse. Quand je dis que je suis Prussien, je ne veux pas dire que la Prusse pourrait renaître dans sa forme antérieure — cela, c'est mort — ou qu'elle puisse être reconstituée, ou qu'il existe une couche sociale assez importante pour faire revivre la Prusse. Non. Elle a existé en tant qu'exemple, par l'esprit, l'esprit prussien. Attention encore : il n'existe pas de philosophie prussienne, de conception prussienne. Il existe une attitude prussienne. J'ai beaucoup étudié Bismarck, qui est considéré comme le prototype du Prussien. Mais vous ne trouverez le mot Hegel ni dans ses livres, ni dans ses discours, ni dans ses lettres. Or tout le monde dit que Hegel est l'inventeur, le philosophe de l'idée nationale prussienne. Bismarck a fait ses études à Göttingen au moment où Hegel, le grand philosophe de la prussianité, enseignait à Berlin, Hegel, célèbre dans le monde entier et qui biologiquement n'était pas Prussien lui non plus mais Souabe. Or c'est la vie de Bismarck qui démontre, si je puis employer ce mot, ce que je veux dire. Il vivait de l'expérience, de l'attitude, de la tradition de la Prusse.
- Votre âge ne vous permet pas de participer à la Première Guerre mondiale. Voudriez-vous nous parler de cette période ?
ES : Ah oui, voyez-vous, cela s'y rapporte étroitement. Lorsque la guerre tira à sa fin je n'avais plus qu'un seul désir : y participer. J'étais encore trop jeune, je ne le pouvais pas. À ce moment-là, dans le Kadettenkorps, nous priions pour que la guerre continue afin d'y ailler ; c'est le véritable esprit de ce corps. Dans la préface de mon livre Les Cadets, j'ai écrit que je rends honneurs aux Cadets de Saumur qui ont attaqué les chars allemands en uniforme d'apparat. Ce qui signifie que, selon moi, l'esprit du corps était vivant chez eux, même s'ils n'étaient pas des Prussiens, même s'ils étaient des Français. J'aimerais dire que, pour moi, Clemenceau, De Gaulle, en tant que personnages, en tant qu'hommes politiques, qu'hommes d'État, sont des Prussiens français. C'est un peu exagéré, mais vous voudrez bien comprendre. Cet esprit me mena tout droit, lorsque vint la débâcle, en 1918, dans le Freikorps, les corps-francs. Je me suis joint aux soldats et très rapidement ces soldats, au sein de la révolution, devinrent soldats de l'État ! C'était l'État qui m'importait. Naturellement, j'étais monarchiste. Mais même en tant que monarchistes il nous fallait être plus fermes que le monarque, qui avait fui. Nous sommes donc restés, mais nous n'avions rien à voir avec les buts politiques que nous servions. C'était la révolution. En Allemagne nous n'avions pas de révolution mais une guerre civile latente, au début des années 20. Le prolétariat s'est vraiment battu dans les rues mais la bourgeoisie s'est fait défendre par les corps-francs qui, au fond, n'avaient absolument rien à voir avec la bourgeoisie, étant aux frontières et à l'intérieur, au service de l'idée de l'État.
- En 1920 — vous avez 18 ans — éclate le putsch de Kapp et Ludwig. Vous avez quelquefois salué cet événement comme un acte positif, destiné à restaurer l'autorité. Quelquefois aussi vous en avez parlé avec scepticisme. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ?
 ES : Cela aussi ressortit de l'esprit du Freikorps, que j'aimerais désigner comme l'esprit prussien. C'est une chose bien étrange. Je sentais qu'une révolution se préparait. Une révolution commence par la révolte des idées et finit sur les barricades. Et nous, du fait de la démence de l'histoire, nous montâmes sur toutes les barricades, mais nous n'avions pas encore précisé nos propres idées. Il fallut tout repenser : le concept de l'État, le concept de la nation, tout ce qui, jusque là, avait servi de base à la pensée politique. Ce fut la seule bénédiction des années 20, les « années dorées » comme on dit quelquefois, ces années vingt qui considérées du point de vue historique, ont été des années atroces : une tentative de renouvellement grandiose, une tentative qui étouffa les vieilles formes de la démocratie. Car je veux encore une fois insister là-dessus : jusqu'à ce jour, la démocratie n'a pas été reconnue par nous, les Allemands, elle nous a été imposée après que nous avons perdu la guerre, et non dans les formes où nous aurions peut être pu la créer nous-mêmes. Et il en est encore ainsi aujourd'hui.
ES : Cela aussi ressortit de l'esprit du Freikorps, que j'aimerais désigner comme l'esprit prussien. C'est une chose bien étrange. Je sentais qu'une révolution se préparait. Une révolution commence par la révolte des idées et finit sur les barricades. Et nous, du fait de la démence de l'histoire, nous montâmes sur toutes les barricades, mais nous n'avions pas encore précisé nos propres idées. Il fallut tout repenser : le concept de l'État, le concept de la nation, tout ce qui, jusque là, avait servi de base à la pensée politique. Ce fut la seule bénédiction des années 20, les « années dorées » comme on dit quelquefois, ces années vingt qui considérées du point de vue historique, ont été des années atroces : une tentative de renouvellement grandiose, une tentative qui étouffa les vieilles formes de la démocratie. Car je veux encore une fois insister là-dessus : jusqu'à ce jour, la démocratie n'a pas été reconnue par nous, les Allemands, elle nous a été imposée après que nous avons perdu la guerre, et non dans les formes où nous aurions peut être pu la créer nous-mêmes. Et il en est encore ainsi aujourd'hui.J'ai participé à tous les putschs. J'ai participé au putsch Kapp, en 1920, dans la formation de la Brigade Ehrhardt, mais ce putsch devait échouer et pour moi, il est bon qu'il ait échoué, parce que les conditions qui auraient pu, à l'époque, placer le pouvoir entre les mains des nationalistes allemands, étaient absentes. De plus, ce pouvoir, ils n'auraient pas pu l'utiliser correctement. Dès que j'eus compris que les conditions spirituelles de ma volonté politique n'existaient pas, je me suis jeté dans l'action. J'étais très jeune. J'avais seulement 19 ans lorsque je me trouvai mêlé à l'événement qui détermina toute mon existence d'une façon bien différente de ce que j'avais imaginé. Je suis allé rejoindre la petite troupe — Gœthe a dit qu'on doit toujours se joindre à la plus petite troupe — ; j'avais choisi la plus petite et la plus active, celle du Capitaine Ehrhardt lorsqu'il avait fait sa tentative. Le putsch avait échoué. Nous avons lutté alors en Haute-Silésie et aux frontières, en tant que formation d'auto-défense. J'ai également participé aux actions contre les séparatistes en Rhénanie ; puis je suis entré dans les milieux de la Warte et là nous n'étions que quelques uns, une trentaine, les plus actifs des corps-francs, de la brigade des volontaires d'Ehrhardt.
La vraie tête du mouvement était un jeune homme de 24 ans, Erwin Kern. Kern — vous allez voir tout de suite que c'était de nouveau le destin, puisqu'au Kadettenkorps on m'avait enjoint : « Vous êtes ici pour apprendre à mourir » — Kern partait du point de vue suivant : « Nous ne nous sommes pas tirés une balle dans la tête lorsque nous avons perdu la guerre donc nous avons violé notre serment au drapeau : au fond, nous sommes déjà morts ». C'était auparavant, je tiens à le dire, la devise des anarchistes. Je suis devenu auteur d'attentats, avec la volonté, la conscience que cela signifiait ma mort. À cette époque j'ai compris le principe de la troupe perdue du Moyen-Âge. Lorsque les 2 armées s'approchaient, formaient 2 masses porteuses de lances, entre les 2 se lançait la Troupe Perdue. Des gens qui ne possédaient qu'une longue épée qu'ils tenaient à 2 mains, qu'on ne pouvait tenir qu'à 2 mains. Ils arrivent, se précipitant sur la masse ennemie, pour ouvrir une brèche. Si, du premier coup, ils n'y parvenaient pas, ils étaient transpercés par les lances. Cette conception romanesque, acquise dans la lecture, mais correspondant à mon éducation, me lia à Kern.
Jusqu'à ce moment, l'O.C. n'existait pas. On savait dans la police prussienne, que le capitaine Ehrhardt continuait son agitation en Bavière et qu'il opérait sous le nom d'un consul. La police nomma cela : l'Organisation Consul. Lorsque nous l'avons appris, cela nous a beaucoup plu, car cette formule magique, inventée par la police, nous ouvrait toutes les portes. La proportion de ceux qui voulaient nous aider était très importante. Nous n'avions qu'à entrer et à dire : « Ordre du Chef, Organisation Consul » nous obtenions ce que nous voulions. Nous avons reçu des voitures, des armes. Nous voulions liquider tout ce qu'il y avait en Allemagne comme politiciens favorables à la politique « réaliste ». Nous voulions les tuer les uns après les autres, jusqu'à ce que le peuple se réveille. C'était, encore une fois, une idée erronée de la révolution.
Lorsque nous avons, par ex., tué le ministre Rathenau — il était le plus important de tous — le peuple s'est soulevé, mais contre nous. Malgré la grande vague nationaliste. Une heure après l'attentat, je savais qu'encore une fois nous nous étions trompés, qu'encore une fois nous avions complètement échoué. Je savais aussi que tout au long de ma vie je demeurerais à l'ombre de cette affaire ; pourtant j'avais le sentiment que, si l'on se trouve dans l'ombre, on ne peut en sortir qu'en projetant sa propre lumière.
- En effet le capitaine Ehrhardt, chef de l'organisation Consul, a condamné le meurtre de Rathenau — qu'Ernst Jünger d'ailleurs n'a pas approuvé. Or Rathenau a été assassiné juste à son retour de Rapallo, c'est-à-dire au moment où il venait d'inaugurer la politique de rapprochement avec la Russie et beaucoup de conservateurs étaient favorables à cette politique de rapprochement avec la Russie. Voudriez-vous nous expliquer cette situation complexe ?
 ES : Oui, j'avais naturellement le point de vue du garçon de 19 ans que j'étais alors, sans vue générale de l'ensemble. Rathenau se vantait — ce n'était pas à Rapallo, mais à Gênes — de mettre au point avec l'Ouest, surtout avec Lloyd George, un règlement raisonnable des dommages de guerre beaucoup trop lourds infligés à l'Allemagne. C'est Poincaré qui a pour ainsi dire poussé Rathenau à se mettre d'accord avec les Russes, afin de s'assurer une contrepartie en face des exigences françaises. Il s'est aussitôt mis en relation avec Lloyd George. Mais la politique française a su faire craindre que l'accord entre les Russes et les Allemands inaugurait une alliance future qui aurait pour but d'exercer un chantage sur la France, c'est-à-dire contre l'Ouest — ce qui n'était pas du tout dans les intentions de Rathenau. Comme vous le savez, encore tout récemment, le Chancelier Adenauer ne voulait guère entendre parler de Rathenau à cause de Rapallo. Il disait : « Plus jamais de Rapallo, plus jamais d'alliance avec les Russes, car cela nous éloigne de l'Occident ».
ES : Oui, j'avais naturellement le point de vue du garçon de 19 ans que j'étais alors, sans vue générale de l'ensemble. Rathenau se vantait — ce n'était pas à Rapallo, mais à Gênes — de mettre au point avec l'Ouest, surtout avec Lloyd George, un règlement raisonnable des dommages de guerre beaucoup trop lourds infligés à l'Allemagne. C'est Poincaré qui a pour ainsi dire poussé Rathenau à se mettre d'accord avec les Russes, afin de s'assurer une contrepartie en face des exigences françaises. Il s'est aussitôt mis en relation avec Lloyd George. Mais la politique française a su faire craindre que l'accord entre les Russes et les Allemands inaugurait une alliance future qui aurait pour but d'exercer un chantage sur la France, c'est-à-dire contre l'Ouest — ce qui n'était pas du tout dans les intentions de Rathenau. Comme vous le savez, encore tout récemment, le Chancelier Adenauer ne voulait guère entendre parler de Rathenau à cause de Rapallo. Il disait : « Plus jamais de Rapallo, plus jamais d'alliance avec les Russes, car cela nous éloigne de l'Occident ».Nous les jeunes, nous sommes arrivés pleins d'élan au beau milieu de ces circonstances compliquées et avons dit : « Nous ne voulons rien payer du tout ». Ce fut le côté passionnel de cette affaire. L'erreur, c'est que nous pensions pouvoir mener à bien une révolution. Cette révolution n'eut pas lieu. Il est vrai que certains groupes politiques, déjà à cette époque, menaient une politique très personnelle. Je ne parle pas des nationaux-socialistes, je parle de l'Armée, de la Reichswehr. Je veux dire que déjà à cette époque l'Abwehr, Seeckt, le général von Seeckt, avait d'importantes relations avec les Russes, que les aviateurs allemands étaient formés en Russie, des troupes armées allemandes également. À un moment donné Rathenau a dû reconnaître que sa politique de Rapallo ne pouvait être acceptée par les Français. À cette seconde-là, à cette seconde historique, nous sommes arrivés sans rien savoir, nous avons tiré. C'est cela, notre faute ; nous avons mis fin à la possibilité d'une politique qui était absolument adéquate et aurait pu nous faire progresser politiquement.
Un homme comme le capitaine Ehrhardt l'avait compris ; cet homme n'a jamais été ce pour quoi nous le faisions passer, c'est-à-dire un combattant actif. Certes c'était un homme d'action, et les jeunes hommes qui le suivaient étaient des hommes d'action, et lorsque ces hommes dépassaient les bornes — c'est tout à son honneur — il se mettait devant eux, leur servait de bouclier. Le capitaine Ehrhardt est mort récemment, à l'âge de 90 ans et, jusqu'à la fin, lui et moi nous étions plutôt sceptiques l'un vis-à-vis de l'autre, car j'étais l'un de ces jeunes gens qui avaient été couverts par lui sans qu'il ait pu les rallier à sa politique. Je crois qu'il a été brisé par nous, le capitaine. Sa conception était beaucoup plus simple, dirigée vers la droite bourgeoise ; nous étions contre la bourgeoisie, nous étions pour l'aventure, pour la révolution, une révolution dirigée aussi contre la bourgeoisie.
- Dans votre œuvre il n'y a pas une phrase antisémite et votre compagne a été longtemps une Juive. Mais pourquoi l'antisémitisme était-il à ce moment-là si puissant en Allemagne ?
ES : Non, il n'y avait pas d'antisémitisme en Prusse, il n'y jamais eu de ghettos en Prusse. Lors d'une réunion de la Diète, au siècle dernier, la question a été posée concernent les Juifs : « Pourquoi un Juif ne peut-il devenir officier en Prusse ? Ou fonctionnaire ? » Et Bismarck, comme député conservateur, a répondu en mettant tout sur le compte de la religion : « Lorsqu'un Juif pratiquant devient fonctionnaire, ou officier, il se trouve nécessairement en conflit avec sa conscience par le simple fait que les Juifs respectent le sabbat et ne peuvent faire quoi que ce soit pendant leurs jours fériés, cela crée un conflit avec leur conscience ». Or Rathenau n'a jamais appartenu à aucune communauté juive. Bien des gens ne savaient même pas qu'il était juif. Dans ses ouvrages il a parlé des « hordes asiatiques dans les sables brandebourgeois ». Il était cuirassier et lorsque, comme cuirassier, il a voulu devenir officier dans son régiment, il n'a pas pu le devenir. On lui a dit : « Il faut d'abord vous convertir, changer de religion ». Alors Rathenau a dit non, parce qu'il ne pouvait pas le faire à ce prix. Non pas parce qu'il professait le judaïsme, mais parce qu'il considérait cette manière de poser le problème comme fausse. Mais il y avait aussi en Prusse des provinces qui étaient catholiques. Là il y avait eu des ghettos, et là les Juifs durent lutter pour leur liberté.
- Le chant de la Brigade Ehrhardt commençait par : « Croix gammée aux casques d’acier ». Mais que signifiait la croix gammée pour ces jeunes gens ?
ES : La croix a des crochets ; on parle de roue solaire ou de choses comme ça. Mais le crochet représente le doute, un doute envers la Croix, parce que la Croix est un emblème universaliste, celui d'une religion destinée à tous les peuples. Il y a toujours quelque chose de païen dans la croix gammée. En France, ce n'est qu'au pays basque qu'on trouve également la croix gammée, tournée à l'envers d'ailleurs. Un Français nous éclaire à ce sujet : Gobineau avec sa théorie des races a joué un rôle important dans la littérature allemande et les nationaux-socialistes s'en sont inspirés tout les premiers ; on a, en littérature, évoqué la pureté de la race, quoiqu'aucun autre peuple ne soit aussi mélangé que le peuple allemand. Mais pour nous, c'était l'aspiration vers une unité, qui s'exprimait par la croix gammée. D'ailleurs cet emblème était parfois porté par la Brigade Ehrhardt, certains préféraient la tête de mort. C'est une très curieuse conception que de se sentir ainsi lié à la mort. Clemenceau l'avait déjà constaté, il a dit : « Les Allemands aiment la mort. Cela les différencie de tous les autres peuples. » Ceci s'applique aux Prussiens et non aux autres Allemands. Ils aiment la mort.
- Après le meurtre vous vous rendez à Munich, auprès du Capitaine Ehrhardt ; je voudrais que vous nous reparliez de la personnalité d'Ehrhardt.
 ES : (en français) C'est comme ça, alors il était mon capitaine, il était le commandant de la formation où j'étais et je le connaissais. Eh bien, il était officier de la marine. Son père était pasteur à Lorach et la famille venait de Suisse. Alors il n'était pas Prussien. Dans la marine allemande, il y avait beaucoup d'Allemands du sud. Mais je parle tout le temps en français ! Voilà ce que c'est, voyez-vous ! (en allemand) Je vais maintenant poursuivre en allemand. Ehrhardt n'était pas un homme politique éminent. C'était un soldat honnête et il couvrait ses hommes. Il voulait rassembler toutes les organisations nationales. Or parmi ces organisations il y avait aussi un tout petit parti — 7 hommes —, avec un homme à sa tête qui savait parler. Cela, aucun des vieux officiers, comme aucun de nous, ne savait le faire. C'est ainsi qu'Hitler a été engagé par le bloc national, comme on le nommait, en tant qu'orateur. C'est en tant qu'orateur qu'Hiler est devenu influent, qu'il s'est approprié toutes les idées qu'on lui apportait, qu'il les a essayées, en retenant tout ce qui pouvait attirer les foules. Constatons qu'Hitler a toujours indiqué pour profession : « écrivain », mais il a toujours déclaré dans ses discours que les grands révolutionnaires de l'histoire mondiale n'étaient jamais des écrivains, toujours des orateurs. Là il avait tout à fait raison. C'est un fait certain que les grands héros populaires n'étaient pas des intellectuels mais tous des orateurs. Or nous, à l'opposé d'Hitler, nous étions pour l'État et non pas pour le peuple. C'est peut-être sur ce point-là que la divergence de notre pensée, au sein du nationalisme allemand, a été la plus révélatrice.
ES : (en français) C'est comme ça, alors il était mon capitaine, il était le commandant de la formation où j'étais et je le connaissais. Eh bien, il était officier de la marine. Son père était pasteur à Lorach et la famille venait de Suisse. Alors il n'était pas Prussien. Dans la marine allemande, il y avait beaucoup d'Allemands du sud. Mais je parle tout le temps en français ! Voilà ce que c'est, voyez-vous ! (en allemand) Je vais maintenant poursuivre en allemand. Ehrhardt n'était pas un homme politique éminent. C'était un soldat honnête et il couvrait ses hommes. Il voulait rassembler toutes les organisations nationales. Or parmi ces organisations il y avait aussi un tout petit parti — 7 hommes —, avec un homme à sa tête qui savait parler. Cela, aucun des vieux officiers, comme aucun de nous, ne savait le faire. C'est ainsi qu'Hitler a été engagé par le bloc national, comme on le nommait, en tant qu'orateur. C'est en tant qu'orateur qu'Hiler est devenu influent, qu'il s'est approprié toutes les idées qu'on lui apportait, qu'il les a essayées, en retenant tout ce qui pouvait attirer les foules. Constatons qu'Hitler a toujours indiqué pour profession : « écrivain », mais il a toujours déclaré dans ses discours que les grands révolutionnaires de l'histoire mondiale n'étaient jamais des écrivains, toujours des orateurs. Là il avait tout à fait raison. C'est un fait certain que les grands héros populaires n'étaient pas des intellectuels mais tous des orateurs. Or nous, à l'opposé d'Hitler, nous étions pour l'État et non pas pour le peuple. C'est peut-être sur ce point-là que la divergence de notre pensée, au sein du nationalisme allemand, a été la plus révélatrice.
- Les Réprouvés ont été un succès mondial et je voudrais vous poser 2 questions à ce sujet. Première question : les raisons de ce succès en Allemagne sur le plan littéraire, dans la mesure où il marquait définitivement un retour à l'objectivité contre l'expressionnisme (dans votre manière de traiter a prose allemande). Deuxième question : son contenu.
ES : Pendant mon procès, je voyais le tribunal comme un ensemble qui fonctionnait merveilleusement mais qui ne me concernait pas. Mon procès à moi était intérieur, mon expérience de l'affaire ; les faits évoqués par le tribunal n'avaient aucun rapport avec mon acte. J'avais le sentiment que je devais opérer une synthèse à partir de cette schizophrénie des faits, du procès et de l'expérience intérieure de l'accusé. En prison j'ai récapitulé et j'ai essayé de raconter cette histoire. Cette façon d'écrire fut ressentie comme nouvelle parce que j'avais découvert — (si j'ose me servir d'une expression qui est, je crois, de Le Corbusier), le « roman-documentaire ». Évidemment cette expression est inexacte. Mon livre n'est pas un rapport sur des choses vécues, mais une tentative pour confronter les expériences intérieures avec les expériences extérieures. Or l'objectivité [Sachlichkeit] ne peut pas le faire. L'expressionnisme n'a pas pu le faire non plus, il n'était qu'extase, il ne se frottait pas à la dure vérité des faits. Dans mon récit les faits étaient vécus et l'extase devait s'enflammer à leur contact. Il en a toujours été ainsi, dans tous mes livres ultérieurs. Ainsi dans Le Questionnaire où je me suis servi de simples questions objectives, entremêlées, pour raconter le procès vécu, pour dérouler le fil rouge des faits avec tout ce qui s'y trouvait.Après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, les « années dorées », quelque chose a surgi qui n'exista même plus après la Deuxième Guerre mondiale : une formidable littérature de guerre. Tous ceux qui s'y étaient trouvés mêlés écrivaient sur la guerre. L'un des plus grands fut Ernst Jünger. Il avait participé à la guerre comme officier dans les tranchées, comme petit lieutenant, puis il a écrit un livre [Orages d’Acier] qui, pour moi, encore maintenant, est l'ouvrage le plus vrai sur la Première Guerre mondiale. Car celui qui désire savoir ce que c'est qu'une sape, il le trouvera dans son livre ; celui qui veut savoir comment cela se déroule, par le détail, il l'y trouvera. Mais il a su faire plus que cela, ce que personne d'autre n'a fait, il a posé la question : quel est le sens de cette guerre ? C'est la première fois que l'homme en la personne du guerrier, rencontrait la matière. La matière, l'écrasante matière. La matière était, ou pouvait être, la plus forte, mais pas pour l'individu. Pour l'individu, ce qui comptait, c'était de faire ses preuves devant la matière et cela, à mon avis, c'est la venue d'une ère nouvelle, d'une nouvelle ère historique. Pour la première fois, les choses s'émancipent, la matière face à l'homme. Moi aussi, pendant ma première détention, et plus tard, pendant ma seconde détention à Moabit, je me posai la question quant au sens de mon action. C'est cette question-là qui me mena vers Ernst Jünger.
Nous fondâmes alors, nous essayâmes d'écrire une nouvelle encyclopédie, parce que je continuais mes activités révolutionnaires… je me prenais pour un révolutionnaire. Je disais : ce que je veux maintenant, c'est la révolution de l'esprit. Par où faut-il commencer ? Les Français nous l'ont enseigné : écrire une nouvelle encyclopédie, réviser tous les concepts. Nous l'avons fait. Et les jeunes écrivains ont surgi sur la droite, ce qui a épaté le monde. Jusque là c'était la phrase de Thomas Mann qui comptait, reprise ensuite par tous les hommes de lettres : « À droite il n'y a pas d'esprit. L'esprit n'est pas à droite, il est à gauche. » Moi je me disais : « La droite ou la gauche, cela ne me concerne pas. Le parlementarisme, qu'en ai-je donc à faire ? C'est l'affaire de ceux qui siègent au parlement. Ce qui m'intéresse se trouve dans le conservatisme : l'esprit de corps. Soudain nous pensions reconnaître l'État dans son élément premier, dans l'esprit de l'ordre. Les associations portaient alors le nom d'Ordre des Jeunes Allemands. L'« Ordre », en tant que cellule germinale de l'État, c'est cela que nous cherchions. Nous l'avons trouvé. Mais quand nous l'avons exprimé on ne nous a pas compris, car entre temps une grande vague avait déferlé au-dessus de nous, la vague du national-socialisme, qui n'acceptait pas nos thèmes.
Nous posions comme nouveau principe : Qu'est-ce que l'État ? Qu'est-ce que la nation ? Qu'est-ce que le peuple ? Et soudain nos réponses retentirent dans toutes les rues, à la radio, partout. Mais le national-socialisme utilisa toutes nos conceptions à contresens. Du point de vue intellectuel, c'était Dieu et le diable, la falsification de toutes nos idées. Nous ne pouvions pas nous allier avec lui ; peut-être étions-nous les seuls qui ne pouvaient pas accepter un compromis avec lui, avec Hitler, avec ce qu'il apporta. Nous l'avons expliqué, cela fut très bien compris. Entre-temps, Jünger et moi, nous étions devenus si connus à travers le monde qu'il ne pouvait pas risquer de prendre des mesures contre nous. [en français] Il a fait des grands mots. Quand il a parlé, tout le monde… il était comme un dieu et tout était parfait. Mais c'était le diable, le Grand Inquisiteur de Dostoïevski, pour nous. Je voudrais continuer en allemand. [en allemand] Toute la littérature d'Hitler, toute sa théorie, son Rosenberg avec son livre, sa vision du monde, tout cela n'est pas vrai. Il est allé chercher sur toutes les étagères ce qui lui semblait efficace sur le moment, il l'a présenté comme étant la vision du monde nationale-socialiste. Il n'existait pas de vision-du-monde nationale-socialiste, il n'existait pas de philosophie nationale-socialiste : c'était un ramassis des opinions les plus absurdes. Vous ne pouvez pas avoir idée, il ne savait rien de Hegel, il ne savait rien, de rien, rien. La race, ça n'existe pas. Sa race à lui ? Mais regardez-le ! Où est la race ? Où est la figure germanique ? Hess ! Goering ! Où ? Où ? Dans les Waffen SS ! Ah oui, Himmler ?… Les Allemands sont devenus fous, fous. Et après, quand les Américains sont arrivés, ils sont devenus, aussi, fous.
=================================
◘ Courte notice biographique sur Ehrhardt Hermann (1881-1971)
 Hermann Ehrhardt naît le 29 novembre 1881 à Diesburg en Bade, d’un père pasteur. En 1899 il entre dans la marine et devient cadet. Promu lieutenant en 1902, il se bat en Afrique du Sud Ouest contre les Hottentots. Capitaine en 1909, il participe à la Première Guerre mondiale comme officier de marine. Il commande un destroyer dans la Mer du Nord. En 1917 il est capitaine de corvette
Hermann Ehrhardt naît le 29 novembre 1881 à Diesburg en Bade, d’un père pasteur. En 1899 il entre dans la marine et devient cadet. Promu lieutenant en 1902, il se bat en Afrique du Sud Ouest contre les Hottentots. Capitaine en 1909, il participe à la Première Guerre mondiale comme officier de marine. Il commande un destroyer dans la Mer du Nord. En 1917 il est capitaine de corvetteEn 1918, durant la révolution de novembre, il forme un corps de 300 officiers de marine, d’où va naître le Freikorps « Brigade de Marine Ehrhardt ». Il écrase en 1919 la république des Conseils de Munich, puis en 1920 il prend sous les ordres de Lüttwitz le quartier des ministères à Berlin, inaugurant ainsi le putsch de Kapp. Après l’échec de Kapp, la brigade se bat contre les communistes dans la Ruhr. Mais en avril il est poursuivi à cause de sa participation au putsch de Kapp. Il fuit en Bavière où il n’est pas poursuivi.
Avec quelques membres de sa brigade qui n’ont pas été incorporés dans la Reichsmarine, il forme à Munich l’organisation secrète « Consul » qui se rend responsable de nombreux meurtres, dont ceux d’Erzberger et de Rathenau. Après la mort de Rathenau il doit fuir et part en Hongrie. Il revient à Munich sous de faux papiers hongrois pour préparer une « Marche sur Berlin », mais ne travaille pas avec Hitler. En 1922 il est arrêté et condamné pour sa participation au putsch de Kapp. En juillet 1923 il réussit à fuir au Tyrol autrichien. Il met fin à sa carrière politique.
En 1931 il se lie avec Otto Strasser. Il applaudit à la prise de pouvoir de Hitler, mais, se sentant menacé après l’épuration des SA, il fuit en Suisse. En 1936 il s’établit comme agriculteur à Krems en Autriche. Il est arrêté après l’attentat du 20 juillet, un de ses adjudants ayant été un collaborateur de l’amiral Canaris. Mais il est relâché à l'automne 1944. Il reprend sa vie d’agriculteur. Il meurt à Krems le 27 septembre 1971.

Le Capitaine Hermann Ehrhardt : ennemi de la République de Weimar et combattant clandestin
 Le Capitaine de corvette Hermann Ehrhardt était, au début des années 20, plus connu qu’Adolf Hitler. Il était l’espoir et la figure du chef pour la droite radicale allemande sous la République de Weimar. Il avait participé au putsch de Kapp ; il avait combattu dans les Corps Francs ; il avait été un “terroriste politique”, avait tiré les ficelles de plusieurs attentats politiques et était propriétaire terrien. À propos de sa personne, on affabulait et on brodait : on l’imaginait en permanence ourdissant des complots. Avec ses compagnons de combat, il était de toutes les conversations sous la République de Weimar, faisait souvent la une des journaux. Par 2 fois, ce chef bien connu des Corps Francs a dû prendre la fuite en Autriche poursuivi par les sicaires de la police politique. La seconde fois, il est resté durablement sur le territoire de la république alpine et, en 1948, est devenu citoyen autrichien. Il est mort le 27 septembre 1971 dans son château à Brunn am Walde dans le Waldviertel. Quand il est mort, il y a 40 ans, son nom et son itinéraire politique avaient été oubliés depuis longtemps. Son décès n’a suscité qu’une brève notule dans le Spiegel de l’époque. Qui donc était cet homme qui, jusqu’à la fin des années 20, avait été considéré comme l’ennemi le plus dangereux de la jeune République de Weimar ?
Le Capitaine de corvette Hermann Ehrhardt était, au début des années 20, plus connu qu’Adolf Hitler. Il était l’espoir et la figure du chef pour la droite radicale allemande sous la République de Weimar. Il avait participé au putsch de Kapp ; il avait combattu dans les Corps Francs ; il avait été un “terroriste politique”, avait tiré les ficelles de plusieurs attentats politiques et était propriétaire terrien. À propos de sa personne, on affabulait et on brodait : on l’imaginait en permanence ourdissant des complots. Avec ses compagnons de combat, il était de toutes les conversations sous la République de Weimar, faisait souvent la une des journaux. Par 2 fois, ce chef bien connu des Corps Francs a dû prendre la fuite en Autriche poursuivi par les sicaires de la police politique. La seconde fois, il est resté durablement sur le territoire de la république alpine et, en 1948, est devenu citoyen autrichien. Il est mort le 27 septembre 1971 dans son château à Brunn am Walde dans le Waldviertel. Quand il est mort, il y a 40 ans, son nom et son itinéraire politique avaient été oubliés depuis longtemps. Son décès n’a suscité qu’une brève notule dans le Spiegel de l’époque. Qui donc était cet homme qui, jusqu’à la fin des années 20, avait été considéré comme l’ennemi le plus dangereux de la jeune République de Weimar ?Hermann Ehrhardt était né le 29 novembre 1881 à la lisière de la Forêt Noire, dans la localité de Diersburg dans le Pays de Bade. En 1899, il s’engage comme cadet de la mer dans la marine impériale allemande et y achève une carrière typique d’officier de marine. En 1904, alors qu’il a acquis le grade de sous-lieutenant (Leutnant zur See), il participe, sous les ordres du Lieutenant-Colonel Ludwig von Estorff, aux opérations destinées à mater la révolte des Hereros dans le Sud-Ouest africain, à l’époque colonie allemande. Ehrhardt lui-même décrira cette aventure, ainsi que d’autres épisodes de sa vie mouvementée, dans un livre intitulé Kapitän Ehrhardt – Abenteuer und Schicksale (Capitaine Ehrhardt – Aventures et destinées) et paru en 1924, alors que sa notoriété était à son zénith ainsi que son influence sur les droites politiques de l’époque de Weimar.
Quand éclate la Première Guerre mondiale, Ehrhardt était Kapitänleutnant et chef d’une demie flotille de torpilleurs. En cette qualité, il avait participé à la bataille du Skagerrak, notamment aux opérations qui avaient conduit à la destruction du destroyer britannique “HMS Nomad” de 1.000 tonnes. La demie flotille d’Ehrhardt fut alors envoyée en Flandre en octobre 1916 pour lancer des opérations de reconnaissance et des raids dans la Manche, afin de protéger l’action des sous-marins. En 1917, Ehrhardt est promu Korvettenkapitän. En septembre de la même année, il devient le commandant de la IXe flotille de torpilleurs, fonction qu’il conserve jusqu’à la fin des hostilités. Après l’armistice, en 1919, il conduit son unité à Scapa Flow, où les équipages font saborber les torpilleurs. Ehrhardt n’a pas assisté lui-même au sabordage de sa flotille car, avec la plupart de ses hommes, il était déjà retourné à Wilhelmshaven.
Le 27 janvier 1919, les communistes proclament la République des Conseils de Wilhelmshaven. Réagissant à cette mutinerie des matelots de Wilhelmshaven, Ehrhardt rassemble autour de lui 300 officiers de marine, des hommes de sa propre flotille ainsi que d’autres unités, et donne l’assaut, le soir même de la proclamation de cette “République des Conseils”, au quartier général des révolutionnaires. Le 17 février, il fonde, après une intense campagne de recrutement parmi les marins non communistes, la Marinebrigade Ehrhardt, l’un des premiers Corps Francs de l’après-guerre allemand. Elle compte environ 1.500 hommes.
Avec ce Corps Francs, l’un des plus connu dans l’espace allemand entre 1918 et 1923, Ehrhardt participe à l’élimination des “républiques des conseils” de Munich et de Braunschweig en avril et en mai 1919. Dans le centre du pays aussi, la Brigade Ehrhardt met un terme à plusieurs foyers insurrectionnels. En août 1919, la Brigade est engagée contre la première insurrection polonaise en Haute-Silésie. À la fin de l’année 1919, la troupe se voit renforcée par des éléments issus des unités ayant opéré dans les Pays Baltes, si bien qu’elle finit par compter 4.000 hommes. À la charnière des années 1919 et 1920, Ehrhardt et ses hommes sont au repos et casernés dans le camp d’entraînement de Döberitz près de Berlin, où la dissolution de tous les Corps Francs, y compris la Brigade de Marine d’Ehrhardt, doit avoir lieu, comme l’exigent les vainqueurs.
Au début du mois de mars 1920, Ehrhardt entre en rébellion contre l’ordre de dissolution et rejoint le putsch dit de Kapp, mené par un haut fonctionnaire prussien, Wolfgang Kapp, et par un général d’infanterie, Walther von Lüttwitz. La mission de la Brigade Ehrhardt était d’occuper le quartier gouvernemental de la capitale. Au cours de ce putsch, Ehrhardt a fait savoir ce qu’il entendait par “application de la violence” en cas de coup d’État : après que les fonctionnaires berlinois aient refusé de travailler pour le gouvernement putschiste, Ehrhardt aurait dit : « Eh bien, nous allons coller au mur les trois premiers fonctionnaires qui refusent de travailler. On verra bien alors si le reste va se mettre à travailler ou non ». Lorsque Kapp refusa d’appliquer cette mesure drastique, Ehrhardt a lâché ce commentaire : « Alors le putsch est fichu ! ».
Après l’échec du putsch de Kapp et la dissolution effective de la Brigade, le 31 mai 1920, la tête d’Ehrhardt fut mise à prix en Prusse. Il prit la fuite et se réfugia en Bavière, à Munich, où les nationaux tenaient le pouvoir sous la houlette du premier ministre bavarois, le Chevalier Gustav von Kahr. Celui-ci toléra sa présence sur le sol bavarois et ne le fit pas extrader. Alors qu’une partie de ses anciens soldats et compagnons s’engageaient dans la Reichswehr nouvellement reconstituée, une autre partie choisit la clandestinité : par l’intermédiaire de l’Organisation Consul, ils participèrent à l’organisation et à l’exécution de nombreux attentats politiques. Ainsi, Matthias Erzberger, Karl Geis et Walter Rathenau ont été éliminés par d’anciens combattants de la Brigade Ehrhardt. Immédiatement après l’attentat perpétré contre Erzberger, Ehrhardt se réfugia en Hongrie car il craignait d’être arrêté, accusé d’avoir tiré les ficelles du complot fatal. Vu l’état de l’opinion publique après les premiers attentats, la Bavière n’offrait plus un refuge sûr pour le Capitaine.
En novembre 1922, Ehrhardt revient de son exil hongrois. Il est immédiatement arrêté. Mais, en juillet 1923, avec l’aide de ses hommes, Ehrhardt réussit une évasion spectaculaire et se réfugie en Suisse, puis revient à Munich sous une fausse identité. Dans les cercles nationalistes de la capitale bavaroise, il s’oppose de manière véhémente et ferme contre le putsch manigancé par Hitler et Ludendorff, car, à son avis, il avait été préparé de manière fort peu professionnelle.
Dès ce moment, les nationaux-socialistes considèreront Ehrhardt comme une personnalité peu fiable. Le Capitaine a perdu aussi beaucoup de son prestige dans les rangs des droites allemandes. En avril 1924, vu l’imminence d’un procès pénal, Hermann Ehrhardt quitte le Reich pour l’Autriche ; il revient en octobre 1926 après une amnistie générale décrétée par le Président Paul von Hindenburg. En 1931, Ehrhardt fonde le groupe Gefolgschaft (littéralement : la “Suite”), qui, malgré la perte de prestige subie par Ehrhardt, parvient encore à rassembler plus de 2.000 de ses adhérents, ainsi que des nationaux-socialistes et des communistes déçus. Ils voulaient empêcher Hitler de prendre le pouvoir et fustigeaient la “mauvaise politique de la NSDAP”. Ehrhardt entretenait des rapports avec Otto Strasser et l’aile socialiste de la NSDAP. En 1933, Ehrhardt s’installe sur les terres du Comte von Bredow à Klessen dans le Westhavelland. En juin 1934, quand Hitler élimine Röhm, Ehrhardt aurait normalement dû faire partie des victimes de la purge. Il a réussi à prendre la fuite à temps devant les SS venus pour l’abattre, en se réfugiant dans la forêt toute proche. Les sicaires ne l’ont que mollement poursuivi car, dit-on, beaucoup de membres de sa Brigade avaient rejoint les SS. Ehrhardt s’est d’abord réfugié en Suisse puis, en 1936, en Autriche, où son épouse, le Princesse Viktoria zu Hohenlohe-Öhringen possédait un château à Brunn im Walde dans le Waldviertel. Ehrhardt n’a plus fait autre chose que gérer ces terres, que participer à des chasses au gibier et que s’adonner à la sylviculture. Il s’est complètement retiré de la politique.
Après l’Anschluss, Hitler fit savoir à Ehrhardt qu’il pouvait vivre en paix dans le Waldviertel à condition qu’il ne s’exprime plus politiquement et renonce à tout activisme. Après la Seconde Guerre mondiale, Hermann Ehrhardt est devenu citoyen autrichien en 1948. Après sa mort, il a été enterré dans le cimetière de la commune de Lichtenau im Waldviertel. La pierre tombale, sous laquelle reposent Ehrhardt et son épouse (décédée en 1976), est décorée de l’insigne de la Brigade, présentant un drakkar viking.
► Jan Ackermeier, zur Zeit n°41/2011.

Les Corps-Francs (1918-1923) : patriotes… et réprouvés Depuis le retour de l'armée impériale, en décembre 1918, nous avons vu se former 2 groupes différents au sein du corps des officiers : d'une part, les modérés, hésitant à heurter de front le gouvernement républicain, préférant temporiser, cherchant à éluder un conflit dont l'issue risquerait d'anéantir ce qui subsiste de leur autorité, mesurant à sa juste valeur la profondeur des remous qui agitent le pays ; de l'autre, les ultras, turbulents, partisans de la manière forte, pressés d'en finir par une action d'éclat qui portera le coup de grâce à la République et nullement conscients de l'ampleur des transformations subies par l'Allemagne depuis l'écroulement de l'Empire.
Depuis le retour de l'armée impériale, en décembre 1918, nous avons vu se former 2 groupes différents au sein du corps des officiers : d'une part, les modérés, hésitant à heurter de front le gouvernement républicain, préférant temporiser, cherchant à éluder un conflit dont l'issue risquerait d'anéantir ce qui subsiste de leur autorité, mesurant à sa juste valeur la profondeur des remous qui agitent le pays ; de l'autre, les ultras, turbulents, partisans de la manière forte, pressés d'en finir par une action d'éclat qui portera le coup de grâce à la République et nullement conscients de l'ampleur des transformations subies par l'Allemagne depuis l'écroulement de l'Empire.Ce qui distingue les membres de ces 2 clans, ce n'est pas une idéologie précise mais une différence de tempérament. Sans doute vouent-ils une haine égale au communisme et à la démocratie, mais ils sont divisés sur des questions de tactique. Les modérés préconisent une guerre d'usure qui aboutira à la prise de possession légale du pouvoir par le dedans ; les ultras accordent leur préférence à l'esprit offensif qui permettra, par une série de coups de force, de procéder à la conquête du pouvoir par le dehors. Hindenburg et Groener sont les porte-paroles des uns ; Ludendorff et Lüttwitz servent de pôle d'attraction aux autres.
Tout au long de la première et de la deuxième révolution, ces 2 tendances se sont affrontées au sein du Grand État-Major et l'ont emporté alternativement, tandis que grandissait le spectre d'une scission redoutée. À présent, la rupture est consommée. Entraînés par leur impatience, les ultras ont tenté leur chance — et ils ont perdu la partie. En obligeant Ltittwitz à abandonner son commandement, l'échec du coup d'État de mars 1920 a consacré le triomphe des modérés.
Car en pratiquant des coupes sombres dans la Reichswehr provisoire, von Seeckt ne cherche pas seulement à grouper autour de lui "les meilleurs d'entre les meilleurs". Il a une conception très précise du rôle de l'officier dans l'État et ne veut s'entourer que d'éléments dont il soit sûr. Au dernier moment, Ltittwitz a été débordé par ses propres troupes et le chef de la Heeresleitung ne veut pas s'exposer à la même surprise : encore un putsch manqué, et c'en sera fait de l'armée allemande. Il n'y a pas de place, dans la Reichswehr nouvelle, pour les tempéraments impulsifs ou les aventuriers. Les Pabst, les Rossbach, les Ehrhardt en sont impitoyablement bannis.
Sans doute le Traité de paix oblige-t-il von Seeckt à ne conserver que 100.000 hommes sur 350.000. Mais il le laisse libre de les choisir comme il l'entend. Or son choix suit presque exactement le clivage qui sépare, depuis 1918, les modérés des ultras. Désormais, le corps des officiers se trouve scindé en 2 : d'un côté, l'armée régulière, les représentants officiels de la tradition militaire allemande, les "élus" qui serviront de cadre et d'exemple à la nation ; de l'autre, les "réprouvés", les condottieri et les hommes de main, toujours liés à leurs camarades par des liens qu'aucune disposition légale ne saurait briser, mais que leurs camarades plus heureux feignent souvent d'ignorer, et qui doivent accepter cette humiliation en silence.
Sans doute, les officiers de la Reichswehr connaissent-ils, eux aussi, des épreuves pénibles. Ils sont souvent en butte aux injures d'une population hostile et doivent servir sous les couleurs noir-rouge-or de la République qu'ils haïssent. Mais ils s'en consolent en regardant flotter les anciens drapeaux prussiens, à l'heure de la relève de la garde, quand leurs régiments, marchant au pas de parade, remontent l'Unter den Linden au son des fifres et des tambours.
Combien moins enviable, en revanche, est le sort de leurs anciens compagnons d'armes, qui n'avaient d'autre patrie que leurs bataillons dissous ! Vont-ils se résigner à leur sort et disparaître, absorbés par la vie civile ? Pas tous, loin de là. "J'ai quitté l'uniforme, écrit l'un d'eux à Rudolf Mann, mais je reste soldat quoi qu'il advienne." Un autre se laisse arracher cet aveu significatif : "J'ai cherché à apprendre un métier. J’ai accepté les travaux les plus durs. J’ai tout fait pour oublier la vie militaire. C'est impossible. Quand on a ça dans le sang, on ne peut plus faire autre chose." Lorsque l'armée impériale s'était volatilisée dans cette fournaise chauffée à blanc qu'était l'Allemagne révolutionnaire, les corps-francs s'étaient constitués spontanément autour de quelques chefs résolus. Ils avaient pris eux-mêmes l'initiative de l'action, décidés à périr plutôt que de subir.
À présent, le même phénomène se reproduit une seconde fois mais dans un cadre différent. Incapables de se réadapter à la vie civile, les anciens volontaires d'Ehrhardt, de Bischoff et de Rossbach vont se grouper dans les innombrables formations illégales qui continueront à graviter autour de la Reichswehr : Heimwehren et Selbstschütze, ligues clandestines et associations secrètes, sans cesse dissoutes et toujours reformées, mystérieuses et insaisissables, dissimulant des dépôts d'armes dans des fermes isolées et entretenant dans le pays une atmosphère de fièvre, d'inquiétude et de meurtre. Dans la patrie classique des complots et des conjurations, les sociétés secrètes vont proliférer à l'infini. Renouvelant les exploits de la Sainte-Vehme, leurs membres trameront dans l'ombre leurs coups de main et leurs attentats, convaincus qu'ils n'ont pas à obéir aux lois, puisqu'ils ne reconnaissent pas le régime qui les a instituées.
D'autres préféreront quitter l'Allemagne et s'expatrier. Ils iront à travers le monde, en Autriche et en Irlande, au Japon et en Bolivie, en Mandchourie et dans le Riff. On les rencontrera partout où se préparent des soulèvements, partout où l'on a besoin d'instructeurs et de soldats perdus. Tels les vestiges de quelque gigantesque naufrage, on retrouvera leurs corps consumés par la fièvre ou déchiquetés par les balles dans les marais du Chaco, au pied de la muraille de Chine ou dans les sables africains.
 Quant aux relations qui peuvent exister entre la Reichswehr et les associations secrètes, celles-ci sont très malaisées à définir car elles varient suivant les cas et, dès qu'on s'efforce de préciser leur nature, on se heurte à une série d'obstacles — écrans de silence et polémiques passionnées, démentis officiels et témoignages contradictoires — qui ne facilitent guère la recherche de la vérité. D'une façon générale, il faut garder présent à l'esprit le fait que, sur les 40.000 officiers de la Reichswehr provisoire, seuls 4.000 ont trouvé place dans la Reichswehr de métier. Pour ces derniers, les officiers licenciés ne sont pas seulement des exaltés, qui ont gravement compromis l'armée au moment du putsch de Kapp : ce sont des rivaux qui jalousent leur place et n'hésiteraient pas à la prendre si on la leur offrait. Il s'agit donc de n'avoir avec eux que des relations espacées et — surtout — d'éviter toute collusion qui prendrait des allures de complicité.
Quant aux relations qui peuvent exister entre la Reichswehr et les associations secrètes, celles-ci sont très malaisées à définir car elles varient suivant les cas et, dès qu'on s'efforce de préciser leur nature, on se heurte à une série d'obstacles — écrans de silence et polémiques passionnées, démentis officiels et témoignages contradictoires — qui ne facilitent guère la recherche de la vérité. D'une façon générale, il faut garder présent à l'esprit le fait que, sur les 40.000 officiers de la Reichswehr provisoire, seuls 4.000 ont trouvé place dans la Reichswehr de métier. Pour ces derniers, les officiers licenciés ne sont pas seulement des exaltés, qui ont gravement compromis l'armée au moment du putsch de Kapp : ce sont des rivaux qui jalousent leur place et n'hésiteraient pas à la prendre si on la leur offrait. Il s'agit donc de n'avoir avec eux que des relations espacées et — surtout — d'éviter toute collusion qui prendrait des allures de complicité.Cependant, les officiers de la Reichswehr ne renient pas pour autant leurs anciens compagnons d'armes. Le but auquel ils travaillent n'est-il pas identique ? Tout en conservant les distances, ils les approuvent au fond d'eux-mêmes. Eux qui sont assermentés à la Constitution, ils leur savent gré d'aller hardiment de l'avant, de les débarrasser de leurs adversaires les plus gênants, de déblayer le terrain où ils s'installeront un jour. La plupart du temps, la Reichswehr ignore les auteurs des attentats politiques et, lorsqu'elle les connaît, elle ne les dénonce pas. C'est à la police de les découvrir, aux tribunaux de les juger. Quand un meurtre aura été commis, la Reichswehr fermera les yeux.
Très différente, en revanche, est l'attitude des membres des associations illégales à l'égard des officiers de la Reichswehr. Tout en enviant leur situation, ils les méprisent en secret. Ils ont, pour eux, le sentiment du loup envers le chien de la fable. Pour leur part, ils ont tout sacrifié au triomphe de leur cause : sécurité, foyer, et même l'honneur. Mais eux, du moins, ne portent pas le collier de la République et leur fanatisme se nourrit d'une sombre exaltation. Ils sont les instruments d'un avenir qu'ils appellent de tous leurs vœux mais dont ils ignorent encore comment il se réalisera. À l'heure où leur courage fléchit et où leur conscience se cabre, ils se bornent à répéter tout bas la formule rédemptrice : "Nous ne sommes pas des assassins, nous sommes des justiciers !"
À partir de mars 1920, l'armée allemande prend l'aspect d'un fleuve qui se divise en 2 bras : d'un côté l'armée légale, c'est-à-dire la Reichswehr ; de l'autre, l'ensemble des formations illégales ou secrètes.
En gros, ces formations peuvent se répartir en 3 groupes caractérisés par leur degré croissant d'illégalité. Les premières sont ouvertement constituées et dépendent de certains organismes du gouvernement. Les dernières vivent en marge de la loi et leur existence est entourée d'un halo de mystère. En passant des unes aux autres, on a l'impression de s'enfoncer au cœur d'une forêt vierge. Les lisières de la forêt sont encore claires et aérées. Mais plus on avance, et plus la végétation devient touffue. Les arbres et les lianes ont tôt fait de cacher le ciel. Pour finir, la piste se perd dans les ténèbres de la jungle…
Le premier groupe se compose des gardes civiques, des Engagés temporaires, des Troupes de secours techniques et des Gardes d'habitants.
Lorsque les Alliés eurent imposé à l'Allemagne de ramener son armée à 100.000 hommes, les autorités du Reich crurent pouvoir tourner la difficulté en créant divers systèmes de milices en marge de la Reichswehr.
Les premières d'entre elles furent les Gardes civiques, ou Volkswehren, chargées d'assurer la surveillance des casernes et la police des villes. Ces Gardes civiques conservaient un caractère local et ne devaient pas être employées en dehors de leurs garnisons. C'est en cela seulement qu'elles se distinguaient de la Reichswehr, dont elles conservaient, par ailleurs, l'armement, la structure, la solde et la discipline. Elles portaient au col, au lieu d'un numéro d'ordre, l'écusson de la ville où elles étaient casernées.
Aux Gardes civiques, de caractère strictement défensif, les autorités du Reich adjoignirent bientôt une milice offensive : les Engagés temporaires, ou Zeitfreiwilligen, composée de soldats engagés pour une durée de 3 mois. Ces troupes étaient destinées à renforcer la Reichswehr en cas de troubles sociaux et à venir grossir ses effectifs, soit en tant que formations complémentaires, soit en s'incorporant directement à ses unités.
Concurremment avec les Engagés volontaires, le Reich constitua des troupes de secours techniques, ou Technische Nothilfe, composées d'ingénieurs, de chimistes, d'étudiants des grandes écoles, de contremaîtres et d'ouvriers volontaires. Destinées à parer aux occupations d'usines, pratiquées par les Spartakistes, leur mission consistait à assurer, en cas de grève, la marche des services indispensables à la vie de la nation : eau, gaz, électricité, transports, etc. Placées sous le commandement d'un corps d'ingénieurs, les troupes de secours techniques étaient directement rattachées au ministère de la Reichswehr.
Enfin, des Gardes d'habitants, ou Einwohnerwehren, avaient été instaurées dans toutes les communes d'Allemagne, en vertu d'une ordonnance du 25 avril 1919. Rattachées elles aussi au ministère de la Reichswehr, les Einwohnerwehren avaient pris rapidement une grande extension. Militaires quant à leurs cadres, mais civiles quant à leurs effectifs, ces milices bourgeoises étaient destinées à veiller sur la sécurité publique dans les villages et dans les villes. Recrutées par l'entremise des commandants de place, encadrées d'officiers ou de sous-officiers qui s'étaient distingués au front, leur armement consistait en carabines et en fusils, en pistolets et en mitrailleuses. Un ceinturon avec un sabre ou un bâton, un casque d'acier, une musette et une gourde, 2 bandes de pansement et un brassard spécial, constituait leur équipement.
Les articles 177 et 178 du traité de Versailles ayant interdit toutes les organisations armées en dehors de la Reichswehr et de la police des États, les autorités du Reich enlevèrent les Gardes d'habitants au ministère de le Reichswehr pour les rattacher au ministère de l'Intérieur, où elles passèrent sous les ordres d'un Commissaire civil. Mais leur armement resta le même et le décret spécifia que les Gardes d'habitants, une fois mobilisées, pourraient repasser immédiatement sous le commandement des autorités militaires.
Dès le 1er décembre 1919, les Alliés se virent obligés d'intervenir pour demander la dissolution de ces formations qui constituaient de véritables réserves instruites, où l'État-Major n'aurait eu qu'à puiser, en cas de mobilisation.
« Tout en protestant, écrit le général Nollet, le gouvernement [du Reich] transmit aux divers États les injonctions des Alliés. Il les invita même à supprimer les Einwohnerwehren, sauf à leur substituer telles autres organisations de protection qu'ils jugeraient à propos, sous réserve que la création de ces dernières ne pût faire conclure à une violation du Traité. La plupart des États entrèrent dans la voie qui leur était indiquée. Ils s'évertuèrent à trouver un compromis entre les exigences des Alliés et les vœux de leurs populations. Seules, la Prusse-Orientale et la Bavière se refusèrent catégoriquement à composer », — la Prusse-Orientale parce qu'elle se sentait menacée par une invasion de l'armée soviétique, la Bavière parce qu'à la suite du putsch de Kapp, elle était devenue le refuge de toutes les forces réactionnaires du Reich et que l'Einwohnerwehr bavaroise, issue de l'Orgesch, était un des piliers du gouvernement de von Kahr.
À partir de ce moment, la discussion entre les Alliés et le gouvernement allemand prit un tour plus aigre.
Afin de couper court aux récriminations de Berlin, les Alliés, réunis à la conférence de Boulogne, exigèrent purement et simplement la dissolution de toutes les Gardes d'habitants existantes avant le 1er janvier 1921, faute de quoi ils procéderaient à l'occupation d'une nouvelle partie du territoire allemand.
Effrayé par cette perspective, le Reich promulgua une loi "Sur le désarmement des populations civiles" (8 août 1920), suivie, le 22 mars 1921, d'une seconde loi "Sur l'exécution des articles 177 et 178 du Traité", mais la Bavière n'en persista pas moins dans son refus. Bravant à la fois les Alliés et les autorités d'Empire, le Cabinet de Munich répondit que les Einwohnerwehren ne tombaient pas sous le coup des paragraphes invoqués, et qu'elles subsisteraient, en Bavière, sous leur forme actuelle, car la défense de la patrie était un devoir moral, supérieur à toute obligation politique.
Irrités par cette résistance obstinée, les Alliés, réunis à Londres, adressèrent, le 5 mai 1921, un nouvel ultimatum au Reich, le sommant de dissoudre toutes les troupes d'autodéfense avant le 30 juin 1921, faute de quoi les sanctions prévues seraient immédiatement appliquées.
Du coup la situation devint franchement mauvaise. Les États allemands conjurèrent le gouvernement bavarois de céder afin de ne pas envenimer la discussion entre le gouvernement du Reich et les Alliés et ne pas exposer le pays à des représailles. Pris entre les dangers d'une scission et d'une seconde action exécutive de la Reichswehr, le gouvernement bavarois finit par se soumettre. Il décréta la dissolution de l'Einwohnerwehr. Celle-ci ne disparut d'ailleurs pas complètement : la plupart de ses membres se regroupèrent dans des associations illégales, notamment dans le corps-franc Oberland.
Venons-en à présent au deuxième groupe, qui comprend l'ensemble des associations illégales : Rossbach, Oberland, Aulock, Heydebreck, Hubertus, Arnim, Schmidt, etc. L'activité de ces corps-francs forme un des épisodes les plus curieux de cette époque et rien ne saurait en donner une image plus saisissante que de suivre, pas à pas, la vie d'un de ces groupements.
En décembre 1918, le jeune lieutenant Gerhard Rossbach, du 175e régiment d'artillerie, constitue de sa propre autorité une compagnie de Grenzschutz, qui prend bientôt le nom de Section d'Assaut des volontaires de Rossbach (Freiwillige Sturmabteilung Rossbach). C'est, à cette époque, un détachement de 180 hommes, où toutes les armes sont représentées. Le 29 janvier 1919, les volontaires de Rossbach s'emparent de la ville de Culmsee, en Prusse-Occidentale, occupée à cette époque par des milices polonaises. À la suite de ce coup de main audacieux, la Section d'Assaut est incorporée à la Reichswehr provisoire, sous le nom de 37e bataillon de Chasseurs (Reichswehr Jägerbataillon 37).
Le 28 juillet 1919, le Traité de paix est signé. Indigné par ce qu'il appelle la "capitulation honteuse du gouvernement de Weimar", Rossbach déchire ses insignes et se donne un nouveau drapeau : 2 bandes transversales en argent, surmontées d'un grand "R" brodé, sur fond noir. Puis il fait prêter serment à ses hommes et déclare : "À partir de ce jour, le bataillon est assermenté."
Malgré la défense formelle des autorités du Reich, Rossbach décide d'aller rejoindre la Division de Fer, qui lutte devant Riga sous les ordres de Bermondt-Awaloff. Au moment où il s'apprête à pénétrer en Lituanie, dans la nuit du 30 octobre 1919, il reçoit la visite d'un émissaire du général von Seeckt, le major Hess, qui lui notifie l'interdiction de quitter le territoire du Reich.
— Nous ne céderons qu'à la force, répond Rossbach, qui fonce à travers la frontière avec armes et bagages, entraînant à sa suite une partie des troupes venues pour l'arrêter.
Les effectifs du corps s'élèvent à ce moment à 1.500 hommes. Le 7 novembre, Rossbach arrive à Mitau, où il apprend que les troupes allemandes battent partout en retraite. Bondissant en avant, Rossbach se précipite sur Thorensberg, où il réussit à délivrer un bataillon de la Division de Fer, encerclé par les Lettons. Mais le repli s'accentue et Rossbach est obligé de suivre le mouvement. Au début de décembre, les volontaires de la Baltique évacuent la Courlande. Le 12, Rossbach rentre en Allemagne, où il est inculpé de désertion, et sa troupe exclue de l'armée pour insubordination. Mais Rossbach refuse de laisser dissoudre son bataillon. Il fait paraître une annonce dans les journaux, offrant ses services aux particuliers qui voudraient l'employer dans un but d'intérêt national. Les milieux qui préparent le putsch de Kapp — peut-être l'Union nationale — lui fournissent des subsides pour lui permettre de survivre.
En mars 1920, le putsch de Kapp se déclenche. Appelé à Berlin par le général von Lettow-Vorbeck, le corps-franc de Rossbach est réintégré dans la Reichswehr sous son ancienne dénomination. Un mois plus tard, le putsch ayant échoué, le bataillon Rossbach est dissous pour la seconde fois. Mais, comme en 1919, ses membres refusent de se disperser. D'accord avec la Ligue agraire poméranienne (Pommersche Landbund), le bataillon se transforme en Communauté de travail ou Arbeitsgemeinschaft. Les armes, déposées à Gilstrow lors de la dissolution du corps, lui sont envoyées en Poméranie sous la désignation de pièces dértachées.
Cette Communauté de travail est une organisation semi-militaire, semi-agricole, du genre de celles que von der Goltz se proposait d'installer dans les Pays Baltes. Ses membres sont hébergés chez de grands propriétaires terriens, dont ils cultivent les domaines en attendant de reprendre les armes.
 Ce moment ne tarde guère. Au printemps de 1921, Rossbach rassemble ses volontaires pour les mener en Haute-Silésie. Le corps compte alors 4.000 hommes environ. En 48 heures, 2 régiments et une compagnie de cyclistes sont sur pied. Le corps comprend en outre des sections d'autos et de camions, qui transportent le service sanitaire, la clique et les bagages. Pendant plus de 3 mois, les volontaires de Rossbach se battent contre les Polonais, en liaison avec les corps-francs Oberland, Aulock, Schmidt et Heydebreck.
Ce moment ne tarde guère. Au printemps de 1921, Rossbach rassemble ses volontaires pour les mener en Haute-Silésie. Le corps compte alors 4.000 hommes environ. En 48 heures, 2 régiments et une compagnie de cyclistes sont sur pied. Le corps comprend en outre des sections d'autos et de camions, qui transportent le service sanitaire, la clique et les bagages. Pendant plus de 3 mois, les volontaires de Rossbach se battent contre les Polonais, en liaison avec les corps-francs Oberland, Aulock, Schmidt et Heydebreck.En juillet 1921 un armistice est conclu par le général Hofer, et les troupes d'autoprotection sont dissoutes en Haute-Silésie. Elles doivent remettre leurs armes à la Commission de désarmement mais parviennent à les dissimuler dans des fermes et des châteaux. Échappant au contrôle de la police, les formations de Rossbach rentrent en Poméranie où elles reprennent leur ancienne activité au sein de l'Arbeitsgemeinschaft. Leurs armes les y rejoignent quelques semaines plus tard.
Mais, entre-temps, la Communauté de travail a été interdite, en vertu de la loi sur l'application des articles 177 et 178 du traité de Versailles (22 mars 1921). Cette mesure est renforcée, le 24 novembre 1921, par un décret prescrivant la dissolution des corps-francs illégaux dans tout le Reich (et notamment Rossbach, Oberland, Heydebreck, Hubertus et Aulock).
Rossbach transforme alors sa Communauté de travail en Mutuelle d'épargne, ou Sparvereinigung, dont le centre est à Kalsow, dans le Mecklembourg, et les bureaux à Berlin-Wannsee 2. Arrêté le 11 novembre 1922, pour complot contre la sûreté de l'État, Rossbach est relâché quelques jours plus tard. Le 16 novembre, un décret du ministre Severing interdit la Mutuelle. Le 18, Rossbach fonde l'Union pour la formation agricole (Verein für Landwirtschaftliche Berufsbildung). Le 24, un nouveau décret de Severing interdit l'Union pour la formation agricole.
Dans cette lutte acharnée contre les pouvoirs publics, Rossbach ne se décourage pas. "Je fonderai des associations, déclare-t-il, plus vite que les autorités ne pourront les dissoudre." En décembre 1922 il est â Munich, où il célèbre le quatrième anniversaire de la constitution de son corps-franc. Tous les anciens Baltes résidant en Bavière — ils sont près de 150 — sont conviés à la cérémonie. Ils y viennent avec leurs insignes et leurs brassards. La plupart portent l'uniforme sous leurs manteaux civils.
Rossbach entre alors au parti National-Socialiste, dont il devient le délégué dans le Mecklembourg. Il y organise des Unions de Jeunesses sportives ou Turnerschaften. Arrêté une deuxième fois en octobre 1923, Rossbach réussit à gagner Munich ou il prend une part active au putsch du 9 novembre. Après l'échec de ce coup d'État, il se réfugie à Vienne ou les autorités autrichiennes lui accordent le permis de séjour.
 L'histoire du corps-franc Oberland présente une grande analogie avec celle du bataillon Rossbach, à cela près que cette formation n'a jamais fait partie de la Reichswehr provisoire : elle est issue de l'Einwohnerwehr bavaroise.
L'histoire du corps-franc Oberland présente une grande analogie avec celle du bataillon Rossbach, à cela près que cette formation n'a jamais fait partie de la Reichswehr provisoire : elle est issue de l'Einwohnerwehr bavaroise.Appelé dès l'automne de 1920 par la section silésienne de l'Orgesch, le corps-franc Oberland est un des premiers à se rendre en Haute-Silésie. Les convois d'armes passent d'abord par la Saxe ; puis, quand le gouvernement saxon s'y oppose, par Berlin. Le corps prend une part active à tous les combats contre les Polonais. Lorsqu'en juillet 1921, les troupes doivent évacuer la région soumise au plébiscite, la Commission de contrôle exige qu'elles déposent leurs armes avant de partir. L'opération doit avoir lieu à Leobschütz, le 9 juillet. Mais les chefs du corps-franc Oberland ne remettent aux officiers de contrôle qu'une masse de fusils brisés et de mitrailleuses hors d'usage.
Une moitié du corps-franc se réfugie en Bavière. L'autre, restée en Silésie, se transforme en colonie agricole. En décembre 1921, la Commission de contrôle exige la dissolution de toutes les Arbeitsgemeinschaften installées en Silésie. Celles-ci protestent énergiquement et refusent de se disperser, malgré les injonctions réitérées du gouvernement de Berlin. C'est seulement en février 1922 que l'État-Major du corps-franc se décide à faire rentrer ses derniers hommes en Bavière. En 1923, le gouvernement bavarois, pressé par les autorités du Reich, donne l'ordre au corps-franc Oberland de se dissoudre définitivement. Ses membres se regroupent alors dans l'Union Oberland, puis dans l'association Treu-Oberland et dans le Blücherbund.
Le corps-franc Aulock connaît une destinée semblable. Formé au début de 1919 par le chef d'escadron Aulock, de l'ancien 4e régiment des Hussards bruns, nous le retrouvons en Haute-Silésie, où il combat aux côtés de Rossbach et d'Oberland. Après l'armistice de juillet 1921, Il se transforme, lui aussi, en communauté de travail et s'installe dans le Riesengebirge où ses hommes se livrent à des travaux forestiers. Les autorités du Reich lui ordonnent de se dissoudre, mais les soldats menacent de se défendre par les armes si l'on touche à leur association. Décimé par les combats meurtriers auxquels il a pris part, le corps-franc Aulock ne compte plus que 800 hommes au début de 1922. Aussi finit-il par disparaître, faute de moyens financiers, de même qu'un grand nombre d'autres petits corps-francs, telles les formations Arnim, Heydebreck, Hubertus, etc.
Le chemin que nous avons suivi, nous a menés des Einwohnerwehren aux corps-francs illégaux, et des corps-francs illégaux aux communautés de travail. À présent nous pénétrons au cœur de la forêt. Car après leur dislocation, corps-francs illégaux et communautés de travail s'émiettent à leur tour en associations rigoureusement secrètes. Composées en majeure partie d'anciens officiers et d'étudiants, celles-ci conservent, suivant leur origine, un caractère militaire plus ou moins accusé.
Insaisissables et protéiformes, pourvues de ramifications aussi nombreuses que ténues, elles changent constamment d'aspect, de résidence et même de nom, soit pour échapper aux investigations de la police, soit pour éliminer ceux d'entre leurs membres qui leur paraissent suspects. Comme pour les corps-francs de 1919, il ne peut être question d'en donner ici une liste complète. Bornons-nous à en énumérer quelques-unes :
- À Berlin et dans le Brandebourg : le Bismarkbund, le Selbstschutz-Charlottenburg, le Sportklub-Olympia, du général von Heeringen, dont plusieurs chefs seront inculpés de complot contre la sûreté de l'État, à la suite d'une perquisition dans les locaux du club ; le Bund der Aufrechten dont les dirigeants sont le général von Stein, ancien ministre de la Guerre de Prusse, le comte Westarp et le prince Oscar de Hohenzollern ; le Bund für Freiheit und Ordnung, etc.
- À Hambourg et à Altona : la Wehrkraft-Hamburg, l'association Lücke, fondée par l'industriel du même nom, le Bund der Niederdeutschen, qui possède plusieurs dépôts d'armes clandestins, le Jungdeutscher-Bund, dont le chef est l'amiral von Scheer.
- En Prusse-Orientale, les associations sont particulièrement nombreuses. On y trouve : la Tatbereitschaft (à Koenigsberg), composée en majeure partie d'élèves des écoles techniques ; la ligue Graf Yorck von Wartenburg (à Pillkallen), la ligue Alt-Preussen (à Kaukehmen), la ligue JungPreussen (à Ragnitz), la ligue Neu-Preussen (à Gumbinnen), le Kœnigsberger Wander und Schutzverein, la ligue Preussen (à Tilsit), la ligue von Lützow (à Budwethen), la ligue von Schill (à Lengwethen), etc.
- En Bavière : Le Vikingbund, qui groupe un grand nombre d'anciens volontaires de la brigade Ehrhardt, le Blücherbund, issu du corps-franc Oberland après sa dissolution, l'Andreas Hofer Bund, l'Arminius-Bund, le Roland-Bund, le Bund Frankenland, etc.
Mentionnons encore un certain nombre d'associations de jeunesses nationalistes, encadrées par d'anciens officiers d'active, qui s'efforcent de maintenir le culte de l'armée dans le milieu des écoles et des universités, telles le Jungdeutscher-Orden ou Jungdo, dont les membres sont répartis en groupes et en sections d'assaut, le Germanen-Orden, le Deutscher Waffenring, la ligue Adler und Falke (Aigle et Faucon), à Fribourg-en-Brisgau, le Deutschvölkischer Jugendbund, à Rathenow-an-der-Havel, le Scharnhorst-Bund, le Jugendbund Yorck von Wartenburg, fondé par le lieutenant Ahlemann, la ligue Jung-Deutschland, fondée par le capitaine Wullenweber, le Helmuth von Mücke Bund, etc.
Ce foisonnement de groupes et d'associations de toutes sortes entraîne la désagrégation et l'émiettement des forces nationalistes. Peu à peu, les ligues oublient le but en vue duquel elles ont été créées, pour se jalouser et se combattre comme les factions du Moyen Âge.
Tantôt c'est un chef qui a été insulté, ce qui entache l'honneur de l'association tout entière. Tantôt c'est le recrutement des adhérents qui provoque des querelles, car chaque association cherche à s'agrandir au détriment de ses rivales. Le plus souvent, les troubles naissent à la suite des mesures d'épuration qui excluent périodiquement des ligues un certain nombre d'individus initiés à leurs secrets. Ceux-ci, pour se venger, vont alors à la police et racontent tout ce qu'ils savent. Or, c'est là ce que les ligues redoutent par-dessus tout, car la plupart d'entre elles possèdent des dépôts d'armes clandestins qu'elles dissimulent jalousement aux autorités du Reich. Souvent, ces dépôts n'excèdent pas quelques caisses de cartouches et 200 ou 300 fusils "empruntés" aux unités de l'armée dissoute. C'est plutôt leur multiplicité qui les rend inquiétants. Mais les ligues y tiennent comme à un bien inestimable, car ces dépôts d'armes justifient leur existence et leur permettront de s'armer le jour — prochain peut-être — du "grand soulèvement national". Et comme il y a de tout dans les associations secrètes, non seulement d'anciens officiers et des patriotes fervents, mais aussi des agents provocateurs et des repris de justice, les dénonciations sont fréquentes, et les représailles implacables.
D'autant plus implacables que les associations secrètes, vivant en marge de la loi, ne peuvent en appeler aux tribunaux pour régler leurs différends. Elles doivent faire elles-mêmes leur propre justice. Malheur à ceux qui refusent d'obéir à leurs chefs, ou qui dénoncent des dépôts d'armes aux autorités civiles ! Condamnés par leurs camarades, ils seront exécutés par eux, au nom de la Sainte-Vehme. Ils disparaîtront un jour sans laisser de traces et on ne retrouvera leurs corps que beaucoup plus tard, étranglés au coin d'un bois ou noyés dans un canal.
Ces mesures de répression entretiennent, au sein des ligues, une atmosphère de violence et de terreur perpétuelles. Traqué, espionné, poursuivi, chaque membre des associations secrètes sait que sa vie est constamment en danger et que, s'il échappe aux mailles de la police, il succombera peut-être à la vindicte de ses camarades. À force de vivre en dehors des lois, il ne tarde pas à se considérer au-dessus d'elles.
« Ces hommes, pour reprendre la formule de Georges Sorel, sont engagés dans une guerre qui doit se terminer par leur triomphe ou par leur esclavage, et le sentiment du sublime doit naître tout naturellement des conditions de la lutte. »
Ce sentiment peut tremper leur volonté, mais il brouille leurs idées et les rend de moins en moins conscients du but qu'ils poursuivent. Enivrés par un orgueil chaque jour plus effréné, ils agissent sans plan d'ensemble et sans programme défini.
« S'enrôler en masse dans les corps de francs-tireurs, mourir en héros les armes à la main, voilà de quoi étaient capables les meilleurs représentants de la jeunesse allemande. Mais il aurait été vain d'attendre de cette jeunesse une participation à une politique réfléchie : elle ne possédait ni les capacités ni les moyens de faire triompher ses idées, d'ailleurs vagues et nébuleuses. »
Cette remarque de Constantin de Grunwald sur les corps-francs de 1812, s'applique mot pour mot aux ligues de 1921.
Alors, un certain nombre de jeunes gens, pour la plupart des Baltes et des membres de l'ancienne brigade Ehrhardt, écœurés par les querelles intestines et l'impuissance des ligues, décident d'agir pour leur propre compte et de passer à l'action directe. Puisque la Sainte-Vehme supprime ceux qui trahissent les secrets de leurs associations, n'ordonne-t-elle pas, à bien plus forte raison, d'abattre ceux qui trahissent le Reich et que la presse nationaliste dénonce, jour après jour, comme les artisans du déshonneur allemand ? Sans doute certains chefs révolutionnaires ont-ils déjà été assassinés. Cependant Erzberger, Auer, Rathenau, Scheidemann vivent encore, et tant qu'ils sont vivants, l'Allemagne est en péril…
Sitôt ce principe admis, le contact s'établit de lui-même entre les conjurés.
« Dans les mois qui suivirent, écrit l'un d'eux, un filet résistant, invisible, élastique se forma, dont chaque maille réagissait, sitôt que dans un endroit quelconque un signal était donné. Nos hommes s'étaient infiltrés dans toutes les associations, dans tous les camps, dans tous les métiers. Une grande et unique volonté les animait. Ils agissaient avec cette certitude enivrante : à savoir que la situation étant partout la même, elle donnait partout naissance aux mêmes décisions.»
Ces actes de terrorisme, fréquemment répétés, témoignent évidemment d'un mépris total de la vie humaine. "C'est la guerre qui a ramené chez nous ces mœurs abominables !" s'écrie le député démocrate Erkelenz, à la tribune du Reichstag. Mais les conjurés haussent les épaules devant ces cris d'indignation. N'ont-ils pas fait eux-mêmes abstraction de leur vie ? Et peut-on nommer paix, le spectacle qu'offre l'Allemagne, labourée par les émeutes et les coups d'État continuels ? Libre aux partis de gauche de mettre leur espoir dans les actions de masse. Pour les conjurés de droite, c'est l'individu qui fait l'histoire. Ils savent qu'il suffit de tuer ses chefs pour paralyser toute une armée.
Pourtant, malgré la certitude d'agir pour le bien de leur pays, ces réprouvés sont incapables de formuler le but qu'ils poursuivent.
« Lorsqu'on nous demandait : Que voulez-vous au juste ? Nous ne pouvions rien répondre, écrit Ernst von Salomon, parce que nous ne comprenions pas le sens de cette question et que, si nous avions tenté de nous expliquer, notre interlocuteur n'aurait pas compris le sens de notre réponse. Les deux adversaires ne luttaient pas sur le même plan. Pour ceux d'en face, il s'agissait de conserver des biens matériels. Pour nous, il s'agissait de purification. Nous n'agissions pas, les choses agissaient en nous. Ce que nous espérions s'exprimait en un langage muet… Nous cherchions autour de nous l'homme capable de prononcer le mot libérateur. Mais lorsque nous jetions les yeux sur nos milieux dirigeants, nous ne pouvions que sourire et détourner le regard. Y avait-il, en dehors du silencieux von Seeckt, un seul homme susceptible de marquer dans l'histoire, un seul homme qui fût plus que la vedette d'un moment ? »
Peut-être un individu puissant émergera-t-il un jour du chaos des factions rivales. Mais les conjurés ne peuvent se contenter de cette vague espérance. Pour que cet homme puisse surgir, il faut lui frayer la voie. Pour faire une brèche dans les partis de gauche, il faut les frapper à la tête. Pour hâter la résurrection du Reich, — il faut décapiter la République.
► Jacques Benoist-Méchin, Histoire de l'armée allemande 1918-1937 (t. 1), Robert Laffont / Bouquins.
 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique





