-
Lépante
Entre le XIVe et le XVIIe siècle, la menace ottomane est la source de l'une de ces grandes inquiétudes qui agitent l'Europe chrétienne. La crainte d'une destruction totale se propage surtout dans l'onde de choc causée par la prise de Constantinople (1453). Cette angoisse, particulièrement vive dans les territoires les plus exposés à la progression territoriale ottomane, favorise l'émergence d'une identité européenne qui se construit notamment en opposition au monde ottoman. Son emprise territoriale comprend en effet la Cappadoce, le Pont, la Bythinie et presque toute l'Asie qu'on appelle mineure, et, après le franchissement de l'Hellespont, elle englobe la Grèce et a porté ses étendards jusqu'à la Save et au Danube. En Méditerranée, sa suprématie navale est totale depuis le règne de Soliman le Magnifique (1521-1566). La peur des Turcs connaît son point d'orgue dans la péninsule italienne quand son successeur, Sélim II, entreprend la conquête de Chypre : le 1er août 1571, les Vénitiens de Famagouste capitulent, ce qui provoque un grand émoi en Europe. La république de Venise réagit en demandant son aide aux puissances chrétiennes voisines. Le pape Pie V entreprit avec Philippe II d'Espagne, Gênes et les chevaliers de Malte les négociations qui aboutirent à la formation de la « Sainte Ligue ». Une flotte chrétienne de 240 galères est alors constituée et placée sous la direction de Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint et demi-frère du roi d'Espagne Philippe II. Le dimanche 7 octobre 1571, au large de Lépante, près du golfe de Corinthe, la coalition hispano-vénitienne inflige une sévère défaite à la flotte ottomane, comprenant 300 galères et dirigée par le grand-amiral Alī Pacha. Seuls une trentaine de navires turcs échappent à la destruction. Au total, 8.000 Espagnols et Italiens perdirent la vie, 21.000 furent blessés, et les Turcs perdèrent entre 20.000 et 30.000 hommes. Malgré sa célébrité pour avoir mis fin au mythe de l'invincibilité de l'Empire ottoman, cette victoire navale chrétienne eut peu de conséquences dans le rapport des forces en Méditerranée : en effet, dès 1573, la conquête turque de Chypre est consacrée par un traité de paix passé entre l'Empire ottoman et Venise affaiblie, marquant ainsi un redéploiement de réseaux consulaires et négociants en Méditerranée orientale. Et, en 1574, avec l'aide de leur marine qu'ils ont eu le temps de reconstituer, les Ottomans s'emparent de Tunis qui appartenait aux Espagnols. Malgré le mépris de Voltaire pour cette victoire (célébrée comme providentielle par l'Église), il est certes loisible de se demander quel eût été le sort de la chrétienté si la fortune des armes avait changé de camp. Mais que retenir de cette histoire à l'heure de l'UE et de l'empire ottoman liquidé ? Si de nos jours la politique des États européens considère la Turquie comme un interlocuteur avant d'en trouver un partenaire, ce dialogue nécessite néanmoins de limiter sur un plan géopolitique toute recherche d'extension de son influence via un double-jeu avec la puissance américaine. C'est à une telle vigilance que nous invite ci-dessous l'humble étude rétrospective de R. Steuckers.

 7 octobre 1571 : Bataille de Lépante
7 octobre 1571 : Bataille de LépanteRéflexions historiques et géopolitiques sur l’aboutissement d’un conflit trois fois séculaire
1571 : Bataille de Lépante. Victoire européenne. Défaite turque. Un choc brutal, de grande ampleur pour l’époque, mais un choc bref. La bataille, en effet, ne dure que de 3 à 5 heures. Mais, et c’est surtout cela qu’il faut rappeler aujourd’hui, elle s’inscrit dans une vaste épopée : celle de l’Europe, toujours divisée en fractions rivales, incapable de bander toutes ses forces dans un effort unique sur le long terme. Mais en dépit des incohérences européennes, l’esprit européen, celui que nous aimerions voir se perpétuer, s’est forgé dans la lutte contre les faits turcs, barbaresques et islamiques, qu’on le veuille ou non, qu’on le déplore au nom d’une solidarité euro-arabe de gaullienne ou de tercériste mémoire ou qu’on l’applaudit parce qu’on partage la vision de Samuel Huntington (“le choc des civilisations”) ou du turcologue français, récemment décédé, Jean-Paul Roux (“un choc de religions”).
Cette épopée commence certes avec les Croisades, lancées par le pape Urbain II après la victoire seldjoukide de Manzikert (1071) contre les forces exsangues de l’empire byzantin. C’était 500 ans avant Lépante... Dans son discours à Clermont-Ferrand, Urbain II évoque “l’irruption dans la Romania d’une race barbare”, dont il faut contrecarrer les desseins. Ce discours, affiché en 2004 dans la cathédrale de Mayence où se tenait une remarquable exposition sur les croisades, contient finalement peu de références chrétiennes : le Pape qui s’adresse à la chevalerie franque évoque bien plus nettement la “Romania”, dont Byzance était la partie orientale, certes en bisbille avec Rome, mais qu’il fallait sauver du naufrage provoqué par des tribus qui prenaient le relais des Huns qui, eux, avaient jadis culbuté l’Empire romain et scellé sa disparition. Jugée schismatique ou non, la Rome orientale, parce qu’elle constituait un espace qui jadis avait été romain, ne pouvait pas tomber entre les mains de “barbares”, considérés à tort ou à raison comme les héritiers des Huns.
Effervescence nomade et “ghazi” djihadistes
Malgré leur échec final, les Croisades bloqueront l’arrivée des tribus turques en Anatolie, en cette partie hautement stratégique de l’ancienne Romania, pendant un peu plus de 2 siècles. Mais l’histoire est systole et diastole, avancées et reculades. Dès la fin du XIIIe siècle, l’empire byzantin, moribond, est devenu aussi mou que le yoghourt, explique l’historien anglais de l’empire ottoman, Jason Goodwin. Comme dans les années qui ont précédé la bataille de Manzikert, les tribus pastorales turques, avec leurs troupeaux de moutons, s’installent en Anatolie et y font souche. Elles fondent des émirats et des sultanats de modeste envergure, sans aucune perspective d’unité entre eux. Les nouveaux arrivants sont envoyés aux frontières occidentales pour grignoter les territoires résiduaires de Byzance. Les grands empires musulmans du Moyen Orient n’avaient pu les absorber : ils les avaient poussées en avant, à toutes fins utiles. Ces éléments susceptibles de provoquer des troubles ou de bouleverser les ordres établis avaient été invités à quitter les grands centres du “Dar el-islam” (la maison de la paix) pour être expédiés aux confins du “Dar el-harb” (la maison de la guerre), selon une stratégie éprouvée.
Dans une phase ultérieure de ce mouvement de populations, les petits sultanats et émirats d’Anatolie intérieure imitent les grands empires musulmans car, eux non plus, ne peuvent tolérer la présence en leur sein de nomades non organisés selon des critères étatiques, qui ne paient pas d’impôts et demeurent rétifs à toute forme de sédentarité. L’effervescence nomade est donc jugée tout à la fois subversive par les pouvoirs turcs établis de la Transoxiane à la Perse et de la Perse à Bagdad, et utile dans la mesure où, sur les frontières de l’Oumma, elle défie les empires infidèles, les harcèlent, les grignotent, les appauvrissent. À la fin du XIIIe siècle, les tribus turques sont sur la Méditerranée, sur les côtes de l’Égée, face à une Grèce encore entièrement byzantine. Non seulement, elles ne se bornent plus à surplomber les littoraux de la Mare Nostrum du haut du plateau anatolien, en les menaçant perpétuellement, comme au temps du discours d’Urbain II, mais l’immense monde turc, dont les sources se situent au cœur même du continent asiatique, a désormais une fenêtre sur la Méditerranée.
Par ce simple fait, la donne géopolitique planétaire change dès les dernières décennies du XIIIe siècle. L’arrivée face à Rhodes de “ghazi” (seigneurs de la guerre) turcs, plus ou moins dépendants du sultanat seldjouk de Rum (Iconium ou Konya), ne constitue sans doute pas un événement considéré comme “majeur” par la plupart des historiens, un événement que l’on retient dans les manuels d’histoire : il n’en demeure pas moins que ces “ghazi” aventuriers ont été le fer de lance, sans doute inconscient, d’une dynamique historique nouvelle, et non encore close, dans le bassin oriental de la Méditerranée. La tribu turque des Danishmends, elle, avait conquis les cités byzantines de la côte pontique occidentale. Ainsi, petit à petit, la Romania anatolienne devenait une Turquie et se déshellénisait.
Des razzias à cheval à la création d’une petite flotte qui écume l’Égée
Au même moment, l’Europe, de la Baltique à l’Adriatique, soutient, tant bien que mal, le choc des Mongols, qui battent les Impériaux et les Polonais en 1241 et déboulent sur les côtes dalmates en 1242. Ils venaient de détruire l’empire du Khwarzem du Shah Djalal ad-Din, dont les Seldjouks d’Iconium étaient vassaux. Ceux-ci seront battus à leur tour par les Mongols en 1242, qui atteindront, avec Hülagü, l’apogée de leur puissance, pour disparaître encore plus rapidement à la mort de leur grand khan. L’empire mongol, malgré la prise de Bagdad, ne parvient pas à maîtriser à temps l’ensemble du Proche- et du Moyen-Orient ; immédiatement après les troubles suscités par la mort d’Hülagü, les mamelouks d’Égypte balaient les derniers cavaliers mongols de Palestine et font de l’Euphrate leur frontière orientale : quelques décennies avant Lépante, les Ottomans absorberont et le Proche-Orient et l’Égypte, devenant de la sorte la principale puissance du monde au XVIe siècle. C’est avec les ressources de la Mésopotamie et de l’Égypte qu’ils affronteront Charles-Quint et Philippe II, pour la maîtrise de l’ensemble du bassin méditerranéen.
Avant l’arrivée de quelques “ghazi” inconnus face à l’île de Rhodes au XIIIe siècle, la logique d’expansion des peuples hunniques et turco-mongols avait été cavalière et continentale. Dès l’arrivée des premières tribus sur les côtes de l’Égée, d’audacieux précurseurs, aidés par des renégats grecs, arment de maigres navires et écument l’espace égéen. Ils pillent les navires chrétiens et rançonnent les côtes de la Grèce et de la Thrace. Ce sont les premières manifestations de la présence turque dans l’espace euro-méditerranéen. Une présence toujours actuelle, d’ailleurs, en dépit de toutes les défaites ultérieures de l’empire ottoman. Ces petites flottes de l’Égée amorcent donc une guerre navale qui atteindra son apogée à Lépante, près de 300 ans plus tard. Nous avons donc affaire à une “guerre longue”, comme on dit aujourd’hui, surtout chez les historiens anglo-saxons. Effectivement, il serait arbitraire, et erroné, de détacher la seule Bataille de Lépante de son vaste contexte et de l’extraire de la durée véritable de cette “guerre longue”, dont elle n’est finalement qu’une étape et non l’aboutissement.
On ne peut pas considérer les guerres de l’histoire comme des conflits limités à quelques années et à quelques batailles : toutes, autant qu’elles sont, s’inscrivent dans des cycles longs, s’étendent très souvent sur plusieurs siècles : les querelles gréco-turques en Égée pour le contrôle des plateaux continentaux, l’occupation de la portion septentrionale de l’île de Chypre par les forces armées turques depuis 1974, les interventions indirectes de la Turquie dans le Caucase et en Mer Noire, le chantage exercé aujourd’hui sur l’Arménie enclavée pour qu’elle retire ses troupes du Haut-Karabakh, ne s’inscrivent-ils pas dans une continuité parfaite avec les événements qui se sont déroulés du XIIIe siècle à Lépante et de Lépante à l’effondrement de l’empire ottoman en tant que superpuissance sous les coups du Prince Eugène de Savoie-Carignan au début du XVIIIe siècle ?
Angevins contre Aragonais : la bataille pour la Sicile
Au moment où les “ghazi” s’apprêtent, avec les nomades venus du monde turc d’Asie centrale, à bousculer les Byzantins désunis, ceux-ci sont effectivement divisés en fractions rivales, arcboutées sur des territoires aux dimensions finalement dérisoires, entre une Byzance redevenue grecque en 1261, un empire latin sous la houlette de Charles d’Anjou, maître de la Sicile (mais plus pour longtemps !), un empire de Nicée et les podestats d’Épire. Au moment où l’espace égéen et anatolien est ainsi fragmenté, une deuxième guerre navale éclate qui oppose une fois de plus Gênes à Venise (1293-1299) pour les bases égéennes et pontiques (en Mer Noire), celles qui permettent justement de contrôler les principales routes commerciales vers l’Asie centrale et la Chine. En fait, celles-ci seront le principal enjeu de la lutte entre l’Espagne de Philippe II et l’empire ottoman. 10 ans avant le choc entre Venise et Gênes en Égée, une guerre avait opposé Charles d’Anjou et Pierre III d’Aragon pour la Sicile. Après la mort de Frédéric II de Hohenstaufen, Charles d’Anjou avait reçu du Pape le royaume de Sicile. La papauté ne voulait plus voir régner aucun rejeton de la famille des Hohenstaufen en Italie ou en Sicile. Elle y avait placé les Angevins pour les remplacer définitivement. Mais le peuple sicilien rejette le pouvoir du prince français et, lors des fameuses Vêpres siciliennes, en 1282, massacre tous les Angevins qui lui tombent entre les mains.
Les Aragonais de Pierre III, qui revendique une parenté avec les Hohenstaufen, occupent la Sicile : elle restera aragonaise, puis espagnole, pendant plusieurs siècles, grâce à l’habilité des marins catalans qui gagnent successivement plusieurs batailles sur mer : à Messines en septembre 1282 où l’Aragonais Perez défait Henry de Murs ; à Naples, où Roger di Lauria bat son propre fils Charles et conquiert la Calabre, ce qui induit Philippe III de France à envahir, en vain, la Catalogne. Les 9 et 10 septembre 1285, Roger di Lauria dégage la Catalogne de l’étau français à la bataille de Las Hormigas, où la flotte royale est décimée. En juin 1287, la Sicile est définitivement aux mains des Aragonais, qui poussent immédiatement vers l’Égée, prenant le contrôle de la côte orientale du Péloponnèse grec et de l’île de Chios. Trois ans plus tard, les Maures d’Afrique du Nord attaquent l’Espagne mais leur flotte est détruite par les Castillans du Roi Sancho IV (1284-1295) en face de Tanger.
La bataille pour la Sicile dévoile les futurs enjeux du XVIe siècle
Pourquoi évoquer ces 2 conflits de la fin du XIIIe siècle dans un récit de la Bataille de Lépante ? Parce qu’ils jettent véritablement les bases de la situation conflictuelle en Méditerranée pendant les 3 siècles qui ont précédé Lépante et révèlent les enjeux qui seront aussi ceux de 1571. D’abord, l’enjeu essentiel : l’Europe a besoin d’un accès facile, sans verrou, à l’Asie centrale, à l’Inde et à la Chine, via les routes terrestres, dont la fameuse “Route de la Soie”. Ensuite, la conquête aragonaise de la Sicile venge le sort affreux que la Papauté avait réservé à la descendance de Frédéric II de Hohenstaufen : elle arrache l’île aux convoitises de la Papauté et de son allié français. La Sicile est au centre de la Méditerranée ; elle verrouille l’accès de la Méditerranée occidentale à tout envahisseur venu du bassin oriental. Elle est un tremplin vers l’Égée et c’est dans ses ports que la flotte de Don Juan d’Autriche s’organisera pour cingler vers Lépante. Le conflit entre Catalans et Français pour la maîtrise de la Sicile explique les motivations françaises pendant les guerres d’Italie de la fin du XVe et du début du XVIe, puis la volte-face de François Ier, évincé d’Italie après Pavie (1525), qui deviendra l’allié des Ottomans.
La France veut être présente en Méditerranée occidentale, et y être la puissance prépondérante dès qu’elle prend indirectement pied en Provence en 1246. Elle veut y parvenir par l’intermédiaire des Anjou, futurs maîtres de la Sicile. Après la guerre de Cent Ans, elle voudra, fin du XVe, ajouter à la Provence le bassin du Pô et la fenêtre sur l’Adriatique qu’il offre. Les héritiers de Pierre III d’Aragon, Philippe le Beau de Bourgogne, époux de Jeanne dite la Folle d’Aragon-Castille, puis Charles-Quint, chercheront tous à torpiller ce projet. Malgré les querelles entre royaumes ibériques, l’Aragon, en affrontant les Français et le Pape, et la Castille, en affrontant, sur un autre front, les Maures d’Afrique du Nord, font dans la seconde moitié du XIIIe siècle cause commune et annoncent la fusion Castille / Aragon qu’opèreront, par leur mariage, Ferdinand et Isabelle à la fin du XVe siècle. Le décor premier de ce “cycle long” est planté : d’un côté, les Français, certains papes (ceux qui s’opposeront à Charles-Quint et à Philippe II) toujours hostiles à une présence impériale en Italie et en Sicile car toute présence impériale rappelle l’œuvre de Frédéric II de Hohenstaufen et, comme alliés de revers, les Maures de Tanger et leurs héritiers barbaresques, devenus vassaux des Ottomans ; de l’autre, le binôme Aragon / Castille, l’Empire, Gênes, les papes favorables à un Saint-Empire fort, les Chevaliers de Rhodes et de Malte, avec, de temps en temps, comme allié de revers, la Perse ; entre les 2, au gré de ses intérêts commerciaux, Venise, république marchande détestée par les pouvoirs traditionnels portés par des principes posés comme transcendants.
Les Chevaliers de Rhodes tiennent la mer
 Au tout début du XIVe siècle, en septembre 1302, les querelles pour la maîtrise de la Sicile cessent par la signature de la “Paix de Caltabellotta”. Les États croisés de Palestine et du Liban étaient tombés sous les coups des Mamelouks d’Égypte (Tripoli du Liban tombe en 1289 et Acre en 1291, scellant par cette chute la fin des Croisades proprement dites). L’Ordre de Saint-Jean ou Ordre des Johannites, fondée en Terre Sainte en 1099, à la suite de la première Croisade, celle de Godefroid de Bouillon, avait dû, lui aussi, quitter la Palestine. Il ne s’estime pourtant pas vaincu. Il décide de s’accrocher dans le bassin oriental de la Méditerranée. De respecter son serment de ne jamais désarmer face à l’islam et de ne jamais faire la guerre à des peuples chrétiens. L’Ordre décide de se donner une puissante marine de guerre, organisée selon une discipline inhabituelle pour l’époque.
Au tout début du XIVe siècle, en septembre 1302, les querelles pour la maîtrise de la Sicile cessent par la signature de la “Paix de Caltabellotta”. Les États croisés de Palestine et du Liban étaient tombés sous les coups des Mamelouks d’Égypte (Tripoli du Liban tombe en 1289 et Acre en 1291, scellant par cette chute la fin des Croisades proprement dites). L’Ordre de Saint-Jean ou Ordre des Johannites, fondée en Terre Sainte en 1099, à la suite de la première Croisade, celle de Godefroid de Bouillon, avait dû, lui aussi, quitter la Palestine. Il ne s’estime pourtant pas vaincu. Il décide de s’accrocher dans le bassin oriental de la Méditerranée. De respecter son serment de ne jamais désarmer face à l’islam et de ne jamais faire la guerre à des peuples chrétiens. L’Ordre décide de se donner une puissante marine de guerre, organisée selon une discipline inhabituelle pour l’époque. Entre 1306 et 1309, les chevaliers johannites s’emparent de l’île de Rhodes. Ils amorcent ainsi la longue guerre navale contre les Turcs, en emportant, dès 1312, une victoire appréciable devant l’île grecque d’Amorgos, au beau milieu de l’Égée. La même année Chevaliers de Rhodes et Cypriotes unis battent une nouvelle fois les Turcs devant Éphèse. En 1319, Chevaliers et Génois détruisent une escadre turque devant Chios. Les Turcs vont riposter : ils attaquent Rhodes avec 80 bateaux, mais les chevaliers s’emparent de presque toutes leurs embarcations. Il faudra attendre 200 ans pour chasser les Chevaliers de leur île. L’épopée continue : en septembre 1334, une alliance momentanée entre Chevaliers, Français et Vénitiens parvient à battre une flotte turque devant Smyrne, qu’ils ne prennent pas. Le port deviendra la principale base d’attaque des Turcs au XIVe siècle. L’émir Omar d’Aydin (ou Oumar-Beg) prend l’initiative, transforme Smyrne en port de guerre et vise le contrôle total de l’Égée. Les Chevaliers répliquent et forgent une alliance entre Venise, Gênes, le Pape et Chypre pour contester l’Égée aux galères d’Omar. 10 ans après la première bataille devant Smyrne, les flottes européennes, sous le commandement du patriarche latin de Constantinople, Henri d’Asti, gagnent la partie, annihilent la flotte d’Omar, débarquent leurs troupes et prennent le contrôle de Smyrne que les Chevaliers tiendront jusqu’en 1402.
L’Âge d’or du Royaume de Chypre
En 1346, Gênes reconquiert Chios contre les Byzantins, qui réarment une flotte que les Génois coulent dans le Bosphore même. L’année suivante, les Chevaliers, qui ne sont pas intervenus dans la guerre qui opposait Gênes à Byzance, détruisent une flotte turque dans les eaux de l’île d’Imbros. Un nouvel acteur chrétien va toutefois marquer la seconde moitié du XIVe siècle : Chypre. L’île appartenait depuis 1192 à la famille de Lusignan. Sous le roi Pierre Ier (1359-1369), qui a épousé Eléonore d’Aragon, elle connaîtra l’apogée de sa gloire. Pierre Ier de Chypre veut raviver l’esprit des Croisades. Il souhaite faire de son royaume insulaire la base inexpugnable de toutes les flottes européennes dans le bassin oriental de la Méditerranée, face aux côtes du Liban et de la Palestine, face au delta du Nil. Il fait le tour des cours d’Europe. Il ne sera guère entendu. Mais il ne se contentera pas d’attendre des secours papaux, espagnols ou français, génois ou vénitiens : il passera à l’acte. Avec succès. En 1361, avec l’appui des Chevaliers, il organise une razzia contre les ports anatoliens de Satalia et Korykos, dont il s’empare (l’actuelle Antalya).
4 ans plus tard, Pierre Ier rassemble une flotte de 115 bâtiments cypriotes, johannites et vénitiens et attaque Alexandrie en Égypte, qui est pillée dans toutes les règles de l’art : 70 bateaux bourrés de butin cinglent vers Chypre, avec 5.000 prisonniers. La vision de Pierre Ier était celle d’un bassin oriental entièrement contrôlé par les flottes européennes pour faire pièce à la reconquête mamelouk du Liban et de la Palestine et pour pallier les conquêtes ottomanes sur terre. Pour réaliser ce projet, il fallait rétablir l’idéal de la chevalerie et raviver l’esprit des croisades. Ses projets n’auront malheureusement aucun lendemain. Les caisses de l’État sont vides. Il se querelle avec son épouse, parce qu’il a une maîtresse et, elle, un amant. Il meurt assassiné le 16 janvier 1369 par 3 vassaux conspirateurs. Sa mort scelle la fin de l’âge d’or cypriote et le début du déclin politique de cette île de valeur hautement stratégique. Ses successeurs, à commencer par son fils mineur d’âge, Pierre II (1369-1382), ou “Pierrin”, ne parviendront pas à maîtriser la furie des 2 villes-États italiennes, Gênes et Venise, qui s’entredéchireront pour obtenir le contrôle de l’île et, avec elle, tout le commerce venu d’Asie pour aboutir aux ports du Liban et venu d’Afrique pour arriver dans le delta du Nil.
L’Europe occidentale, elle, pendant ce temps, se désintéresse du bassin oriental de la Méditerranée : les Croisades sont un vague souvenir, marqué par l’amertume de l’ultime défaite face aux Mamelouks d’Égypte. L’heure n’est plus aux grands projets : on revient à ses mauvaises habitudes, on s’étripe entre soi et chez soi. La France et l’Angleterre mènent la Guerre de Cent Ans. L’Église est déchirée par le schisme qui oppose Rome et Avignon. Chypre a donc perdu le contact avec l’Europe de l’ouest. Son déclin sera couronné d’une défaite humiliante : l’armée des Mamelouks envahira l’île en 1426. Les armées cypriotes sont écrasées, le roi Janus est prisonnier, les chevaliers francs de sa garde impitoyablement massacrés. Janus est promené dans les rues du Caire, les mains liés dans le dos, monté sur un âne boiteux, sa bannière trainée dans la poussière. Avec la disparition des féodaux francs, l’île se ré-hellénise, sous l’impulsion de la reine Hélène Paléologue.
La mort lente de Byzance et l’avancée turque dans les Balkans
Le rappel de la geste des Chevaliers de Rhodes nous permet de comprendre l’importance cruciale de Rhodes dans le dispositif européen en Méditerranée orientale. Avec Rhodes, et avec Chypre, l’Europe garde la maîtrise de la mer, en dépit de la conquête ottomane des Balkans et de la Grèce. Rhodes, Malte et Chypre sont d’ailleurs les enjeux des guerres euro-turques du XVIe siècle. Et l’intransigeance turque dans l’actuelle question cypriote s’explique encore et toujours par l’histoire mouvementée de l’île.
Si les Chevaliers parviennent, pendant tout le XIVe siècle, et jusqu’à la prise de Constantinople en 1453, à assurer la maîtrise du bassin oriental de la Méditerranée, les Ottomans, sur terre, ne rencontrent que peu d’obstacles. Pour comprendre leurs succès, il faut comprendre l’état désastreux de division dans lequel le monde byzantin était plongé depuis 1204, année où la quatrième croisade franco-flamande prend Constantinople et en fait le centre d’un nouvel “empire latin d’Orient”. Baudouin Ier et Baudouin II de Flandre le gouverneront entre 1204 et 1261. Cet empire comprendra à peu près toute la Grèce actuelle, la Thrace aujourd’hui turque et une bande côtière sur la rive asiatique de la Mer de Marmara. Au beau milieu de cet empire, se trouvait le Royaume de Thessalonique d’Henri de Montferrat. La latinisation de l’empire ne rencontre évidemment pas l’approbation des orthodoxes fidèles aux rites et aux traditions grecs.
3 entités étatiques grecques se créeront par dissidence et par refus de soumission à l’empereur franco-flamand : 1) l’empire de Trébizonde, à l’est du littoral anatolien-pontique ; cet empire aura le soutien des Géorgiens et des Arméniens et se maintiendra jusqu’en 1461, 8 ans après la chute de Constantinople ; son histoire et son sort nous expliquent le pourquoi des tensions turco-arméniennes et, pour partie, l’imbroglio caucasien actuel sur fond de crise russo-géorgienne ; 2) le despotat d’Épire (sur le territoire de l’actuelle Albanie), qui absorbera par conquête le royaume de Thessalonique, et entrera ainsi en conflit avec l’empire de Nicée, troisième entité étatique orthodoxe-byzantine ; 3) l’empire de Nicée qui, d’emblée, cherchera, avec l’alliance des Bulgares, à éliminer l’empire latin. Les Nicéens mèneront cette tâche de main de maître ; successivement, entre 1222 et 1254, l’empereur nicéen Jean III Vatatzes reprend pied en Thrace et en Grèce, récupère Thessalonique en 1246 et tient en échec ses rivaux ou anciens alliés épirotes et bulgares. L’île d’Eubée (le “Negroponte”) et la Crète demeurent vénitiennes.
Osman Ier et Orhan : la puissance par la maîtrise du tremplin “Bythinie”
 Pour réaliser cette entreprise de restauration byzantine, toutefois, toutes les forces nicéennes étaient passées sur la rive européenne de la Mer de Marmara. Venise et Charles d’Anjou, alors maître de la Sicile, s’allient pour restaurer l’empire latin. Le Basileus Michel s’allie avec Pierre III d’Aragon, vainqueur final des guerres pour la domination de la Sicile. Tous ces efforts ont épuisé la nouvelle Byzance, dès le successeur du Basileus Michel Paléologue, le déclin s’amorce et le XIVe siècle s’ouvre par un renforcement de l’orthodoxie, qui s’opère par le truchement du monachisme, puis par des guerres civiles. Sur le territoire, à partir duquel l’empire de Nicée avait lancé l’offensive pour restaurer l’empire byzantin, s’institue d’abord un vide que comblera un chef de “ghazi” turcs, vassal des Seldjouks de Rum (Rum = “empire romain” en turc). Il s’appelle Osman Ier et proclame, sur le territoire même de feu l’empire de Nicée, le sultanat ottoman. C’est l’acte de naissance d’une future superpuissance. Nous sommes en 1301.
Pour réaliser cette entreprise de restauration byzantine, toutefois, toutes les forces nicéennes étaient passées sur la rive européenne de la Mer de Marmara. Venise et Charles d’Anjou, alors maître de la Sicile, s’allient pour restaurer l’empire latin. Le Basileus Michel s’allie avec Pierre III d’Aragon, vainqueur final des guerres pour la domination de la Sicile. Tous ces efforts ont épuisé la nouvelle Byzance, dès le successeur du Basileus Michel Paléologue, le déclin s’amorce et le XIVe siècle s’ouvre par un renforcement de l’orthodoxie, qui s’opère par le truchement du monachisme, puis par des guerres civiles. Sur le territoire, à partir duquel l’empire de Nicée avait lancé l’offensive pour restaurer l’empire byzantin, s’institue d’abord un vide que comblera un chef de “ghazi” turcs, vassal des Seldjouks de Rum (Rum = “empire romain” en turc). Il s’appelle Osman Ier et proclame, sur le territoire même de feu l’empire de Nicée, le sultanat ottoman. C’est l’acte de naissance d’une future superpuissance. Nous sommes en 1301. En 1326, le fils d’Osman Ier, Orhan, prend Boursa et complète la conquête totale de la Bythinie, région-clef, selon le grand historien britannique Arnold J. Toynbee qui était byzantinologue, rappellons-le. Qui contrôle la Bythinie, contrôle toute la région pontique et égéenne puis, par extension, le bassin oriental de la Méditerranée. Telle est la thèse majeure de Toynbee, étayée par l’étude de la Grèce antique, de l’empire romain, de Byzance et de l’empire ottoman. Le fait ottoman a pu advenir sur la scène de l’histoire parce qu’aucune puissance européenne n’a été capable de contrôler à temps la petite province de Bythinie. Sur son territoire, l’esprit “ghazi”, esprit guerrier et aventureux, va accéder à un stade supérieur, il ne sera plus simplement le terminus territorial inorganisé d’un itinéraire migratoire de nomades venus d’Asie centrale : dès la maîtrise de la Bythinie, les Ottomans commencent à s’organiser en un État viable, doté d’un projet, et à structurer leurs armées, avec les troupes légères, les akindjis, et la cavalerie du pacha. Cela donnera plus tard les fameux sipahis (parmi lesquels on trouvait beaucoup de renégats chrétiens) et les janissaires, recrutés par levée obligatoire parmi les peuples balkaniques vassalisés.
Guerres intestines à Byzance et progrès des marins turcs en Égée
De 1321 à 1341, l’empire byzantin subit une succession de guerres civiles, où l’empereur, en tentant de mater en vain la révolte des Andronic, lève des mercenaires turcs qui interviennent en Thrace et dans les Balkans, découvrant ainsi la richesse de ces régions, qu’ils ne cesseront plus de convoiter. C’est dans le cadre de ce désordre permanent qu’Osman Ier s’empare de Boursa, ce qui lui permet d’occuper la zone d’Asie Mineure qui fait directement face à la Thrace et à Constantinople : elle est le passage obligé vers les Balkans. Avec Andronic III (1328-1341), devenu empereur, l’empire byzantin connaît un répit et consolide ses positions dans les Balkans. Mais cela ne dure pas : avec l’aide des Bulgares, Andronic III s’en prend aux Serbes du roi Étienne, dans l’espoir de contrôler toute la péninsule balkanique, jusqu’à l’Adriatique. En 1330, les Serbes, vainqueurs à Velbuzd / Kustendjil, élargissent les territoires sous leur contrôle et deviennent la principale puissance balkanique orthodoxe, dans un entrelacs conflictuel inter-orthodoxe, opposant Serbes, Bulgares et Byzantins. L’enjeu est de savoir si l’ensemble de la péninsule balkanique sera dominé depuis les Balkans occidentaux (Serbie et Épire / Albanie) ou par les Bulgares dont le territoire est ouvert sur les steppes d’Ukraine par la Dobroudja ou encore par les Byzantins. Cet enjeu a été ravivé lors de la guerre russo-turque de 1877-78, où la Bulgarie a retrouvé son indépendance, et lors des guerres balkaniques de 1912-13. L’empereur, après sa défaite de Velbuzd / Kustendjil, se retourne contre ses anciens alliés bulgares puis, seconde étape, tente de mettre les Albanais au pas, à l’aide de troupes turques...
Les visées balkaniques de Byzance, épuisée, empêchaient l’empereur Andronic III de contrecarrer l’avancée des “Osmanlis”, qui, au départ, formaient l’entité turque la plus faible d’Anatolie. Andronic III perd ainsi Nicée (Iznik) et Nicodémie (Izmit). Orhan, successeur d’Osman Ier, s’empare de Pergame, que possédait l’émir de Mysie. Andronic III n’intervient pas : il réserve toutes ses forces pour combattre les “ghazis” marins et pirates comme l’émir de Saroukhan ou Omour-beg (Omar), émir d’Aydin et maître de Smyrne ou encore, Khidr-beg d’Ephèse, qui ravagent l’Égée et s’attaquent tant aux Byzantins qu’aux Latins ou aux Vénitiens. En 1333, l’émir de Saroukhan, à la tête d’une flotte de 75 navires, attaque la Thrace, pille la ville de Samothrace et rembarque quand l’armée impériale s’approche des côtes. Mais les Turcs marins ne renoncent pas pour autant à leurs raids : ils débarquent à plusieurs reprises dans les environs immédiats de Constantinople. L’empire n’a pas les moyens de se doter d’une marine suffisamment forte pour purger l’Égée des pirates turcs. Venise propose une ligue des marines chrétiennes avec la bénédiction du Pape mais les Grecs ne veulent aucune concession religieuse tandis que Français et Anglais amorcent la Guerre de Cent Ans et ne se préoccupent plus de l’Orient. Le projet, intelligent, n’aura aucune suite. La discorde entre Européens ne permet pas d’affronter le danger mortel qui se pointe dans la Mer Égée.
Les Turcs prennent Gallipoli
En 1341, Andronic III meurt, laissant un enfant de 9 ans comme héritier légitime. Contre la veuve de l’empereur, Anne de Savoie, Jean Cantacuzène prend alors le contrôle de Byzance, avec l’appui des moines hésychastes (quiétistes). À la suite d’une longue guerre civile, une de plus, il se proclame empereur et appelle les zélotes sociaux-révolutionnaires, les Serbes, les Bulgares et les Seldjouks à son secours, alors qu’il avait contribué à les faire chasser de Thrace, en même temps que les pirates turcs. Battu plusieurs fois de suite par les soldats de l’impératrice, Jean Cantacuzène fait appel à Omour-beg de Smyrne, pour repousser les Serbes d’Étienne Douchan, fidèles à Anne de Savoie, et les Bulgares du Tsar Jean Alexandre. Malgré ces succès, Jean Cantacuzène est incapable de parachever ses victoires. Il doit alors faire appel à Orhan, qui répond favorablement : une première armée de 6.000 Turcs débarque en Thrace ; elle sera bientôt suivie par d’autres, comptant jusqu’à 20.000 hommes. Le nouvel empereur parvient à reconquérir l’Épire en 1349 mais, en 1354, les Turcs qui retournent en Bythinie, sont surpris par un tremblement de terre qui fait s’effondrer devant eux la forteresse grecque de Gallipoli. Ils s’installent dans les ruines et remettent la place forte en état. Les Turcs sont non seulement sur les rives de l’Égée, y entretiennent des flottes offensives mais possèdent désormais une forteresse-clef sur la rive européenne de la Mer de Marmara. Ils peuvent passer en Europe par le passage le plus aisé : aucun obstacle naturel ne les retient plus. L’année 1354 est donc une année fatidique pour l’Europe entière. Personne ne reprendra plus Gallipoli aux Turcs.
Les Turcs à Andrinople – L’émergence de l’empire serbe
Déjà présents en Thrace dans des garnisons au service de l’empereur byzantin, les Turcs d’Orhan contrôlent désormais l’accès de Byzance par l’Égée. L’empereur Jean VI négocie pour récupérer Gallipoli : Orhan lui répond qu’il “ne peut rendre ce qu’Allah lui a donné”. L’alliance est rompue. Le Turc est dans la place. Il peut passer en Thrace à sa guise. En 1362, les Osmanlis s’emparent d’Andrinople (Édirne) et en font leur capitale, à l’Ouest de Constantinople, aux confins de la Bulgarie. Le fait turc s’est bel et bien installé en Europe, face à une Byzance secouée de querelles et sans plus aucune assise territoriale solide. Le Basileus est de facto un vassal des Osmanlis. Il est reclus dans Constantinople, dont l’arrière-pays thrace est déjà largement turquisé.
Dès la prise d’Andrinople, le sort des autres puissances orthodoxes des Balkans était scellé. La Serbie avait acquis un statut de grande puissance entre 1331 et 1355 sous la férule d’Étienne Douchan, qui s’était proclamé “empereur des Serbes et des Grecs” à Skopje en 1346. À partir de 1349, ses états sont organisés à la byzantine, selon une codification nationale, la “Zakonik”. Les Hongrois ne répondent pas à ses appels à une croisade commune anti-turque. Sous son successeur, l’État qu’il avait construit se délite. La Bulgarie n’est pas mieux lotie. Elle se disloque également entre héritiers de Jean Alexandre et grands féodaux. L’empereur byzantin Jean V se brouille avec son fils Andronic : une nouvelle dissension affaiblit l’empire et les Turcs, avec une rouerie consommée, soutiennent tantôt un parti tantôt l’autre. Le tableau est donc noir, très noir ; un contemporain, Démétrius Cydonès, écrit en 1378 : “Tous ceux qui sont hors des murs de la ville (= Constantinople) sont asservis aux Turcs et ceux qui sont à l’intérieur succombent sous le poids des misères et des révoltes”. Les Hongrois n’en profitent pas pour unir sous leur égide les autres peuples balkaniques et cherchent par tous les moyens à mener une politique égoïste sans s’imaginer que le danger turc sera bien plus mortel !
Les Ottomans, établis à Andrinople, sont devenus de fait la principale puissance dans les Balkans. Ils vont le prouver. Sous le commandement de leur sultan Mourad, ils vont attaquer les villes de Serrès et de Thessalonique, toutes 2 gouvernées par Manuel, le fils favori de Jean V. Thessalonique se défendra pendant 4 ans, entre 1383 et 1387. Après la chute de la ville portuaire de la Mer Égée, toute la Macédoine est désormais aux mains des Osmanlis. De même, l’Épire, au Sud de l’Albanie actuelle, dont les clans, divisés par des vendettas immémoriales, s’étaient unis, mais trop tard, contre les Turcs. Les clans épirotes et albanais sont battus à Sawra en 1385, bon nombre d’entre eux passent à l’islam. Les Osmanlis sont tout près de l’Adriatique. Et cherchent, en toute bonne logique, à s’emparer des points stratégiques sur le Danube. Pour réussir cette entreprise et occuper ainsi la principale artère fluviale d’Europe, Mourad occupe les nœuds routiers de Sofia (1386) et de Nis (1387) qui mènent à l’Adriatique, à l’Égée et au Danube. Ce vieux réseau romain de routes terrestres mène aussi, il faut le savoir et se le rappeler, vers le cœur de l’Europe : vers Budapest (Aquincum), où se concentraient plusieurs légions pour défendre la “trouée de Pannonie” contre les invasions venues des Jeunes Carpathes et des Tatras ou de la plaine ukrainienne, vers Vienne (Vindobona) et, au delà de Vienne, vers l’Allemagne du Sud.
Cette partie de l’Allemagne actuelle, c’est-à-dire les antiques provinces romaines de la Raetia et du Noricum, avait été organisée par l’empereur Vespasien (69-79) ; il avait fait joindre le système routier du Rhin à celui du Danube en ordonnant la construction d’une route à travers le Kinzigtal (une vallée de la Forêt Noire). Le réseau de routes romaines relie donc la partie du Würtemberg baignée par le Danube aux régions qui lui sont limitrophes et constituent le cœur même de l’Europe : la Forêt Noire chère à Heidegger, l’Alsace et la Rhénanie. La tactique ottomane, dès le XIVe siècle, est de récupérer au profit des Osmanlis l’héritage de Byzance et de Rome. Le sultan Mehmed II se rend parfaitement compte qu’il est, par la force des choses, non seulement un prince guerrier turc dont les racines lointaines plongent au cœur de l’Asie centrale, mais aussi l’héritier de la Rome orientale, Byzance, et que cette Rome orientale a toujours aspiré à reprendre la Rome occidentale comme au temps du grand empereur byzantin Justinien (527-565) qui avait repris la Dalmatie, toute l’Italie, les îles de Corse, Sardaigne et Sicile, l’Afrique du Nord, de la Libye au Nord du Maroc actuel, et le Sud de l’Espagne, avec les Baléares. Le programme de Mehmed II, et de ses successeurs dont Soliman le Magnifique, est de refaire (au moins) l’empire de Justinien, en s’appuyant cette fois sur l’idée informelle d’une translatio Imperii ad Turcos.
La défaite serbe au Champ des Merles
[Bataille de Kosovo (1389), Petar Radičević, 1987]
 Donc dès le moment où les Ottomans sont en Épire et ont occupé les nœuds routiers des Balkans méridionaux, les Serbes et les Bosniaques se rendent compte qu’ils seront les prochains dominos culbutés par la stratégie mise en œuvre par les Turcs, qui reprennent tout simplement à leur compte les projets de Justinien. Le Prince Lazare de Serbie et le Roi Tvrtko de Bosnie unissent leurs forces contre Mourad qui envoie un corps expéditionnaire en Bosnie. Les Turcs sont battus à Plochnik, Rudnik et Bilece (27 août 1388). Cette série de victoires, non décisives, entraîne une révolte généralisée dans les Balkans : Albanais, Bulgares et Valaques se serrent autour de Lazare, écrit l’historien français Louis Bréhier. Mourad aura pourtant le dernier mot : il bat d’abord les Bulgares de Sisman et, au printemps 1389, avance ses armées contre Lazare. Le choc a lieu le 15 juin 1389 au Kosovo, sur le “Champ des Merles”. Longtemps indécise, la bataille tourne au désavantage des Serbes, quand un prince balkanique, Vuk Brankovic, décide de quitter la bataille avec ses 12.000 cavaliers. Le Sultan est tué dans sa tente par un noble serbe, Obilic, et le pouvoir passe à Bayazid, dit le “Tonnerre” ou la “Foudre” (“Yildirim”). La dernière puissance balkanique autochtone est éliminée : l’ensemble des Balkans, à part quelques forteresses résiduaires au nord, est aux mains des Turcs. L’héroïsme des Serbes ne leur a pas donné la victoire : le souvenir douloureux de cette bataille est demeurée écrite en lettres de sang dans le cœur de chaque Serbe digne de ce nom. La terre du Kosovo est une terre sacrée pour les Serbes, le lieu de leur sacrifice suprême, de leur Golgotha : les événements de ces 2 dernières décennies l’ont amplement prouvé.
Donc dès le moment où les Ottomans sont en Épire et ont occupé les nœuds routiers des Balkans méridionaux, les Serbes et les Bosniaques se rendent compte qu’ils seront les prochains dominos culbutés par la stratégie mise en œuvre par les Turcs, qui reprennent tout simplement à leur compte les projets de Justinien. Le Prince Lazare de Serbie et le Roi Tvrtko de Bosnie unissent leurs forces contre Mourad qui envoie un corps expéditionnaire en Bosnie. Les Turcs sont battus à Plochnik, Rudnik et Bilece (27 août 1388). Cette série de victoires, non décisives, entraîne une révolte généralisée dans les Balkans : Albanais, Bulgares et Valaques se serrent autour de Lazare, écrit l’historien français Louis Bréhier. Mourad aura pourtant le dernier mot : il bat d’abord les Bulgares de Sisman et, au printemps 1389, avance ses armées contre Lazare. Le choc a lieu le 15 juin 1389 au Kosovo, sur le “Champ des Merles”. Longtemps indécise, la bataille tourne au désavantage des Serbes, quand un prince balkanique, Vuk Brankovic, décide de quitter la bataille avec ses 12.000 cavaliers. Le Sultan est tué dans sa tente par un noble serbe, Obilic, et le pouvoir passe à Bayazid, dit le “Tonnerre” ou la “Foudre” (“Yildirim”). La dernière puissance balkanique autochtone est éliminée : l’ensemble des Balkans, à part quelques forteresses résiduaires au nord, est aux mains des Turcs. L’héroïsme des Serbes ne leur a pas donné la victoire : le souvenir douloureux de cette bataille est demeurée écrite en lettres de sang dans le cœur de chaque Serbe digne de ce nom. La terre du Kosovo est une terre sacrée pour les Serbes, le lieu de leur sacrifice suprême, de leur Golgotha : les événements de ces 2 dernières décennies l’ont amplement prouvé. La bataille du 15 juin 1389 ne relève dès lors pas d’un passé résolument révolu pour le Serbe : elle est toujours présente, elle l’interpelle, il ne peut s’y dérober. Il doit encore et toujours venger Lazare : Peter Scholl-Latour rappelle qu’entre 1942 et 1944, les Tchetniks royalistes, premiers et farouches résistants aux occupations allemande, italienne, bulgare et hongroise, s’attaquaient systématiquement aux villages “turcs” (= musulmans) pour ramener les Balkans à la situation d’avant 1389 et de rétablir, in fine, l’empire de Stefan Dusan, qui aurait été restauré dans sa plénitude si Lazare avait vaincu au Champ des Merles. Le siège de Sarajevo, dans les années 90 du siècle dernier, relève aussi de cette volonté de re-slaviser et de re-christianiser le centre de la péninsule balkanique, en effaçant définitivement tous les souvenirs de la présence allochtone turque. Dans le camp musulman, on était tout aussi conscient de l’enjeu et on entendait manifester sa solidarité avec les habitants musulmans de Sarajevo : Tansu Ciller, premier ministre turc, et sa consœur pakistanaise Benazir Bhutto, rendront visite à la ville encerclée, sous la protection de militaires britanniques ou canadiens.
Les Hongrois aux premières loges
Après le désastre du “Champ des Merles”, les Hongrois sont aux premières loges : ils devinent sans trop d’efforts que l’objectif suivant est la maîtrise du “Moyen Danube” entre Szeged (Hongrie) et Belgrade (Serbie) selon l’axe nord-Sud et entre Osijek/Essig (Croatie) et Timisoara (Roumanie) selon l’axe ouest-est. Pour les Turcs, il s’agit, lors d’une prochaine étape, de maîtriser le système fluvial danubien dans une région-clef où confluent les eaux du grand fleuve et celles de la Save, de la Drave et de la Tisza. La Voïvodine, au nord de Belgrade, avec une forte minorité hongroise, demeure une pomme de discorde entre Serbes et Hongrois, comme pendant la seconde guerre mondiale, où cette région avait été annexée par la Hongrie. Osijek et Vukovar (sur la Drave et sur le Danube) ont d’ailleurs fait l’objet d’âpres combats entre Croates et Serbes dans les années 90, chacun des protagonistes essayant de maîtriser la plus grande portion possible de cette aire de confluences fluviales, stratégiquement capitale. La région n’a rien perdu de son importance stratégique. Au XIVe siècle, le roi de Hongrie, Louis Ier, dit le Grand, détricote le pouvoir des magnats, qui sont un frein à l’organisation efficace du pays, et favorise les villes. Il se rend compte de la menace. Au sud-est, tous ses voisins sont désormais vassaux des Ottomans, notamment sur le cours inférieur du Danube, en Valachie et en Moldavie, 2 territoires qui avaient été ouverts aux invasions pètchénègues (en 1048 et en 1171) et tatars (en 1285 avec Nogaï Khan). Aux mains des Turcs, elles risquent donc bien de redevenir des tremplins stratégiques pour une nouvelle invasion de la plaine hongroise et, partant, des régions européennes limitrophes, dont l’Autriche, la Dalmatie et l’Italie du Nord.
Dans l’optique des Hongrois, comme dans celle de l’empereur germanique Sigismond, il faut mettre un terme à cette situation problématique, qui fragilise très dangereusement le cœur de l’Europe, le tient à la merci d’invasions venues de la steppe ou des Balkans. Il faut, aux yeux de Sigismond, empereur de la Maison de Luxembourg et époux de la fille aînée de Louis Ier de Hongrie, créer, pour une branche de la famille, un grand empire slave au sud de la Hongrie, regroupant les Serbes et les Bulgares. Il persuade le Pape de prêcher une croisade en 1395. En France et dans les États bourguignons, les volontaires affluent. Jean de Nevers, futur Duc de Bourgogne sous le nom de “Jean-Sans-Peur”, prend la direction de l’expédition avec Jean de Vienne, un Franc-Comtois devenu Amiral de France, Jean Le Meingre dit “Boucicaut”, Maréchal de France, et Guillaume de La Trémoille, Maréchal de Bourgogne. L’armée franco-bourguignonne, flanquée de quelques nobles anglais, quitte Dijon et Montbéliard en avril 1396. Elle rejoint les Bavarois par la route longeant le Danube, arrive en juin à Vienne et en juillet à Buda en Hongrie. Là, un contingent polonais s’ajoute à la vaste armée en mouvement, ainsi que quelques Chevaliers de Rhodes, conduits par le grand-maître Philibert de Naillac. Avec l’armée hongroise de Sigismond, l’impressionnante cohorte européenne va s’avancer vers le Sud pour affronter les Turcs. L’objectif ? Prendre la place de Nicopolis sur le Danube (l’actuelle ville de Nikopol en Bulgarie) et en faire la base d’une reconquête de la Thrace, de la Bulgarie et des côtes de l’Égée, après avoir détaché la Valachie de la tutelle ottomane.
Le désastre de Nicopolis
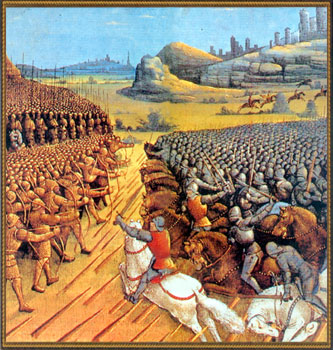 Sigismond avait misé gros : il avait aliéné une bonne part de son héritage de la Maison de Luxembourg pour financer l’entreprise. Stratégiquement, il n’avait pas tort. Le plan était bon. Mais l’armée composite qui l’accompagne ne s’est pas donné la logistique adéquate, elle parade et s’amuse, chasse et dîne, court la gueuse et se querelle pour des prestiges futiles. Dans l’anthologie de la pensée stratégique de Gérard Chaliand, on trouve encore une description de cette sublime indiscipline, donnée en lecture aux officiers actuels comme exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Les Croisés assiègent Nicopolis dès le 12 septembre 1396. Mais Bayazid contre-attaque : le 24 septembre, il est déjà devant eux. Le choc est inévitable. Les Hongrois connaissent les stratégies des Turcs. Ils conseillent la prudence. Les chevaliers impétueux de la suite du Sire de Boucicaut veulent une attaque pleine de panache, une charge fatidique, comme celles qui avaient déjà fait la ruine de la vieille chevalerie française à Courtrai ou à Crécy. Ils n’écoutent pas les Hongrois. Ils chargent, lances hautes. Le sultan manœuvre et les enveloppe, après avoir sacrifié sa première ligne, écrasée par la fureur des Franco-Bourguignons. La défaite fut totale : elle est qualifiée, dans la langue de l’époque, de “mortelle déconfiture”. Sigismond parvient à peine à s’échapper. Le soir, c’est le massacre. Les chevaliers franco-bourguignons sont décapités les uns après les autres et leurs têtes empilées devant la tente du sultan, jusqu’à ce qu’un chevalier picard, le Sire de Heilly, sauve notamment Jean Sans Peur et Boucicaut, car, explique-t-il au sultan, ils peuvent rapporter de fortes rançons. Philippe le Hardi de Bourgogne paiera 700 kg d’or pour faire libérer son fils.
Sigismond avait misé gros : il avait aliéné une bonne part de son héritage de la Maison de Luxembourg pour financer l’entreprise. Stratégiquement, il n’avait pas tort. Le plan était bon. Mais l’armée composite qui l’accompagne ne s’est pas donné la logistique adéquate, elle parade et s’amuse, chasse et dîne, court la gueuse et se querelle pour des prestiges futiles. Dans l’anthologie de la pensée stratégique de Gérard Chaliand, on trouve encore une description de cette sublime indiscipline, donnée en lecture aux officiers actuels comme exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Les Croisés assiègent Nicopolis dès le 12 septembre 1396. Mais Bayazid contre-attaque : le 24 septembre, il est déjà devant eux. Le choc est inévitable. Les Hongrois connaissent les stratégies des Turcs. Ils conseillent la prudence. Les chevaliers impétueux de la suite du Sire de Boucicaut veulent une attaque pleine de panache, une charge fatidique, comme celles qui avaient déjà fait la ruine de la vieille chevalerie française à Courtrai ou à Crécy. Ils n’écoutent pas les Hongrois. Ils chargent, lances hautes. Le sultan manœuvre et les enveloppe, après avoir sacrifié sa première ligne, écrasée par la fureur des Franco-Bourguignons. La défaite fut totale : elle est qualifiée, dans la langue de l’époque, de “mortelle déconfiture”. Sigismond parvient à peine à s’échapper. Le soir, c’est le massacre. Les chevaliers franco-bourguignons sont décapités les uns après les autres et leurs têtes empilées devant la tente du sultan, jusqu’à ce qu’un chevalier picard, le Sire de Heilly, sauve notamment Jean Sans Peur et Boucicaut, car, explique-t-il au sultan, ils peuvent rapporter de fortes rançons. Philippe le Hardi de Bourgogne paiera 700 kg d’or pour faire libérer son fils.L’irruption de Tamerlan – vingt ans de répit pour l’Europe
 Résultat du désastre de Nicopolis : l’empire des Slaves du Sud ne verra pas le jour. Les Turcs se voient consolidés dans leurs positions. Ils acquièrent la réputation d’être invincibles et gagnent ainsi la guerre psychologique sur leur front occidental : peu de princes oseront encore les affronter dans une expédition de l’ampleur de celle de Nicopolis. À l’est pourtant, un nouvel ennemi pointe à l’horizon, qui donnera à l’Europe une vingtaine d’années de répit. Timour le Boiteux ou Timour Leng ou Tamerlan venait d’envahir l’Iran et l’Irak actuels pour le compte de son Khan, maître de la Transoxiane [Ouzbékistan actuel]. Nous sommes en 1393, 3 ans avant Nicopolis. Au départ de cette base territoriale, celle de l’antique empire perse, il monte une armée permanente, destinée à remporter une campagne chaque année. En 1395, il s’attaque à la Horde d’Or qui gouverne le cours inférieur de la Volga, prend leur capitale Saraï et, surtout, s’empare de leur trésor. En 1398, 2 ans après Nicopolis, il s’avance vers l’Inde, pille Dehli, fait décapiter une bonne partie de la population, empile les têtes tranchées aux portes de la ville mise à sac.
Résultat du désastre de Nicopolis : l’empire des Slaves du Sud ne verra pas le jour. Les Turcs se voient consolidés dans leurs positions. Ils acquièrent la réputation d’être invincibles et gagnent ainsi la guerre psychologique sur leur front occidental : peu de princes oseront encore les affronter dans une expédition de l’ampleur de celle de Nicopolis. À l’est pourtant, un nouvel ennemi pointe à l’horizon, qui donnera à l’Europe une vingtaine d’années de répit. Timour le Boiteux ou Timour Leng ou Tamerlan venait d’envahir l’Iran et l’Irak actuels pour le compte de son Khan, maître de la Transoxiane [Ouzbékistan actuel]. Nous sommes en 1393, 3 ans avant Nicopolis. Au départ de cette base territoriale, celle de l’antique empire perse, il monte une armée permanente, destinée à remporter une campagne chaque année. En 1395, il s’attaque à la Horde d’Or qui gouverne le cours inférieur de la Volga, prend leur capitale Saraï et, surtout, s’empare de leur trésor. En 1398, 2 ans après Nicopolis, il s’avance vers l’Inde, pille Dehli, fait décapiter une bonne partie de la population, empile les têtes tranchées aux portes de la ville mise à sac. Les Ottomans ne craignent rien : l’Inde est bien loin de l’Asie Mineure. Ils se trompent : Tamerlan entre en guerre avec les Mamelouks qui tiennent la Syrie et pille Damas et Alep. Et puis, sous un vague prétexte, c’est au tour des Ottomans de subir ses foudres : Bayazid accepte le défi, mobilise toutes ses troupes, y compris les vassaux serbes et quelques prisonniers européens de Nicopolis, dont l’écuyer bavarois Johannes Schiltberger, qui nous laissera un récit des événements. L’armée de Bayazid sera écrasée par les Tatars de Tamerlan, largement supérieurs en nombre, à Angora (Ankara) en 1402. Le sultan captif sera promené en Asie Mineure et assistera, impuissant, au détricotage complet de son œuvre d’unification en Anatolie : Tamerlan délie tous les vassaux turcs de Bayazid de leurs serments et reçoit la soumission des branches mineures des Osmanlis. Bayazid avait été très dur avec les petits chefs turcs d’Anatolie et avec l’émir de Karaman. Les vaincus tenaient ainsi leur revanche.
En 1404, Tamerlan retourne à Samarcande, sa capitale, pour préparer une invasion de la Chine. Il mourra en chemin et la Chine sera épargnée, elle ne connaîtra pas le sort effroyable de la Perse pré-timouride et de l’Inde ravagée. Pour l’historien écossais Colin McEvedy, il y a une certaine ironie dans le destin de Tamerlan : tous les empires qu’il a détruits étaient musulmans, alors qu’il se réclamait d’un islamisme rigoureux, et il n’a affronté des non musulmans qu’à 2 reprises : il a rançonné et saccagé la Géorgie à chaque passage, ruinant son statut de puissance chrétienne héritière de Byzance et il a délogé les Chevaliers de Rhodes de Smyrne qu’ils occupaient depuis 1344.
Guerres hussites et révoltes des derviches
Toutefois, les Ottomans se remettront bien vite des coups que leur avait portés Tamerlan. Ils parviennent à réunifier l’Asie Mineure sous leur égide, en restaurant les liens de vassalité qui les unissaient aux petits émirats de la région. Mais la transition dure tout de même 10 ans. Elle sera aussi une décennie de guerres fratricides entre les fils de Bayazid, dont il sort un vainqueur : Mehmed. Les Européens n’ont pas profité de cette déliquescence ottomane : l’alliance entre le pape et Sigismond, Empereur germanique et roi de Hongrie, demeure intacte mais elle reste tétanisée par le souvenir cuisant de Nicopolis. La France ne participe pas : elle est en pleine Guerre de Cent Ans et son roi refuse de recevoir un prélat mandaté par le Pape pour lancer une éventuelle croisade. L’Angleterre est également embourbée dans le conflit, même si celui-ci connaît une période plus calme avant Azincourt (1415). Pire : dans les domaines de Sigismond, l’hérésie hussite secoue la Bohème. Jan Hus périt sur le bûcher à Constance en 1415 mais ses adeptes se dressent contre les 2 institutions-piliers de l’Europe : l’Église et l’Empire. Les guerres contre les Hussites tchèques vont durer 14 ans, de 1420 à 1434, clouant les armées impériales et hongroises en Europe centrale. C’est ce répit-là qui permettra aux Ottomans de reconstituer leurs forces. Eux aussi avaient eu à affronter des rébellions religieuses et hérétiques en Asie Mineure.
À partir de 1413, Mehmed Ier règne mais, en 1420, au même moment où éclatent les guerres hussites en Bohème, il doit affronter en Anatolie la “révolte des derviches”. On appelle “révolte des derviches” un ensemble de troubles religieux, chacun différent des autres, qui visaient à abattre le pouvoir des Osmanlis et à récupérer une relative liberté dans un empire ottoman de plus en plus balkanique et de moins en moins anatolien. Dans cet ensemble de troubles, nous distinguons la révolte orchestrée par un cheikh panthéiste, Bedreddin. Ensuite, il y eut une révolte sociale, prêchant communisme et pauvreté, sous la direction de Bürklüce Mustafa ; ensuite, des bandes turkmènes, excitées par le secte des “Torlaks”, se joignent aux “mustafistes”. Mehmed Ier finira par les vaincre tous avant d’affronter le prétendant Mustafa, qui disait être un fils de Bayazid disparu dans la tourmente qui suivit la défaite ottomane d’Angora / Ankara en 1402 face aux Tatars de Tamerlan.
Avec la soumission d’Ibrahim, dernier prince indépendant de la Karamanie en 1430, la fragmentation de l’Anatolie, voulue par Tamerlan, n’est plus qu’un mauvais souvenir pour les Ottomans. Ils ont les mains libres à l’est et le successeur de Tamerlan, Shah Roukh, qui règne sur la Perse et le Tarim, ne songe pas, comme son père, à conquérir le monde mais à maintenir ses acquis les plus sûrs. Jamais il n’avancera ses armées en direction de l’Anatolie et n’interviendra pas en Karamanie contre les Osmanlis. Mehmed Ier parvient donc à vaincre tous ses challengeurs intérieurs avant Sigismond, plus longtemps paralysé par les guerres hussites. La dissidence religieuse hussite a donc fait perdre à l’Europe sa dernière chance de rejeter les Ottomans hors d’Europe et, éventuellement, de reprendre pied en Bythinie. Le souvenir du temps perdu pour une guerre de religion hantera à coup sûr les pouvoirs européens ; il explique la hantise de Charles-Quint et de Philippe II, d’avoir à combattre simultanément les Turcs, les Barbaresques, les Français et les dissidents protestants en Allemagne et aux Pays-Bas. Hussites et Protestants ont effectivement empêché la concentration de toutes les forces européennes contre l’ennemi extérieur.
Les hostilités reprennent : elles aboutiront à la prise de Constantinople
Dès 1422, immédiatement après avoir maté toutes les révoltes anatoliennes, dites des “derviches”, Mourad II, fils de Mehmed Ier, met le siège devant Constantinople. En vain. Il doit le lever. Il ne dispose pas de machines de guerre suffisamment efficaces pour entamer les murailles de la capitale de l’empire romain d’Orient. En 1428, sur le cours inférieur du Danube, que les Hongrois entendent reconquérir, une première confrontation entre les armées de Sigismond et de Mourad II a lieu, à Galamboc. La bataille est indécise mais les Hongrois ne s’emparent pas de la forteresse et les Serbes se détachent de la suzeraineté hongroise pour devenir vassaux des Turcs. La paix est signée mais des unités d’akindjis s’infiltrent en territoire hongrois et ravagent la Transylvanie. Les Turcs reprennent leurs tactiques de harcèlement. En 1427, l’empereur byzantin Manuel vend Thessalonique à Venise. 3 ans plus tard, en 1430, la ville portuaire, débouché maritime des Balkans sur l’Égée, est aux mains des Ottomans, qui se vengent ainsi du soutien continuel apporté par Venise à leurs ennemis, comme le prétendant Mustafa et le prince de Karamanie.
En 1431, profitant des querelles dynastiques entre clans albanais, le Sultan devient suzerain de l’Épire et de l’Acarnanie. Il est sur l’Adriatique, face à l’Italie et dans les eaux dominées par Venise. En 1437, les Valaques, faute de soutien impérial et hongrois, sont contraints de se soumettre à leur tour. En 1439, l’offensive reprend, cette fois en direction du Moyen Danube : Mourad II assiège la forteresse serbe de Semendria (Smederevo), à quelques encablures au sud-est de Belgrade, et la prend, avant l’arrivée des Hongrois d’Albert, héritier de Sigismond, qui meurt de maladie en pleine campagne. Avec la prise de Semendria / Smeredevo, le pouvoir ottoman s’ancre véritablement au cœur des Balkans européens. Les Hongrois, affaiblis par les guerres hussites et sans renforts venus d’Europe occidentale, avaient pu mener des opérations ponctuelles, souvent victorieuses comme en 1442 en Transylvanie (“Sept Districts”), mais non pas une croisade de grande envergure.
Désastre de Varna et réorganisation de la Hongrie par Janos Hunyadi
Pourtant une opération de cette ampleur s’avère nécessaire. Sans plus aucune bande hussite dans le dos, les Hongrois vont l’organiser, sous la houlette de leur nouveau roi polono-lithuanien, Vladislav Ier Jagellon (en hongrois : Ulàszlo Ier),un jeune homme de 16 ans, qui n’a pas l’aval des héritiers de Sigismond... Vladislav veut conjurer le danger turc qui menace en permanence les provinces méridionales slaves du royaume hongrois. Il attaque. Il arrive avec ses armées sur les côtes de la Mer Noire, à Varna en Bulgarie. Nouvelle défaite : l’armée hongroise, composée de magnats, de nobles et de féodaux, est écrasée le 10 novembre 1444 ; le jeune Vladislav Ier, âgé de 20 ans, tombe les armes à la main face aux armées du sultan. Un nouveau martyr sacrifié pour la défense de l’Europe. Il avait été trop impétueux, aveuglé par son idéalisme et sa jeunesse.
Il avait commis la même erreur que le Sire de Boucicaut à Nicopolis en 1396. Et pire : la flotte vénitienne de l’Amiral Lorédan, qui devait embarquer les croisés à Varna pour les amener à Constantinople avant l’arrivée des troupes ottomanes, s’était attardée. Manque de coordination chez les Européens ! L’arrière-garde hongroise, commandée par un petit hobereau transylvanien, Janos Hunyadi, est également détruite mais Hunyadi s’échappe. Vu ses mérites et ses succès en Serbie moravienne lors des campagnes de 1442-1444, il est nommé “Gubernator” de Hongrie en attendant la majorité du futur roi Ladislas V, un Habsbourg, protégé par le nouvel empereur germanique Frédéric III, père de Maximilien Ier, le grand-père de Charles-Quint. Hunyadi est un excellent chef de guerre, dont Sigismond admirait les talents. Et un bon administrateur politique, qui va transformer la Hongrie en un État militaire efficace, débarrassé des pesanteurs du système féodal. Il veut faire des Hongrois, considérés encore comme des “sauvages” dans le reste de l’Europe, les “athletae Christi”, les défenseurs et les protecteurs de la chrétienté.
La Hongrie est décrite aussitôt comme le rempart, la muraille, la forteresse de l’Europe. Hunyadi se rend compte que le système féodal traditionnel, basé sur les humeurs des barons, ne permet pas l’entretien d’une armée permanente, capable de barrer la route aux Turcs. Il faut une armée nombreuse, populaire, bien entraînée, correctement payée, levée dans les masses paysannes, auxquelles il faut accorder des droits et des protections. Le pape lui envoie pour adjoint un prédicateur farouche, qui sait enflammer les esprits et faire accepter les réformes indispensables : le Franciscain Giovanni di Capistrano. Sans l’aide de Venise, qui a signé la paix avec le Sultan le 25 février 1446, Hunyadi forme ses troupes et passe à l’attaque en 1456, 3 ans après la chute de Constantinople, enlève Belgrade et conjure le danger turc pour 70 ans ! Mais une peste ôte la vie du “Gubernator” et du fougeux franciscain. Les 6 années et quelques mois du pouvoir tenu par Hunyadi et di Capistrano ont fait de la Hongrie un État pré-moderne, une nation en armes, que contesteront encore les “magnats”, au risque d’en détruire la pugnacité face aux Ottomans.
Skanderbeg et Alphonse d’Aragon tiennent l’Albanie
La Morée grecque (le sud du Péloponnèse actuel) était devenue le principal môle de résistance byzantin mais la défaite hongroise de Varna n’avait laissé aucun espoir aux Byzantins, malgré le passage au catholicisme romain de l’empereur Jean VIII lors du Concile de Ferrara et malgré l’Union de Florence de 1439, mettant théoriquement fin au schisme. L’Église grecque n’acceptera pas cette Union, jetant par là même les bases de dissensions civiles graves, qui mineront encore davantage l’empire moribond et encerclé. Mourad ravage la Morée en 1446, y installe un gouverneur pantin à sa dévotion. Les Hongrois ne sont pas encore battus et il reste les Albanais de Skanderbeg, nom turc et nom de guerre de Georges Castriota ou Kastriotis. Contrairement aux Hongrois et à leur jeune roi polonais, le chef albanais — ancien janissaire formé par les Turcs à la suite de l’enlèvement forcé des meilleurs garçons des Balkans pour les dresser à la chose militaire — n’est pas vaincu en 1444 ; avant le désastre de Varna en novembre, il avait écrasé une armée turque le 29 juin 1444, récoltant l’admiration de l’Europe entière : celle du Pape Eugène IV, pontife pugnace et dépourvu des naïvetés ou de l’avidité habituelles des hommes d’église, celle de Philippe le Bon, qui concocte des projets de Croisade et celle, bien sûr du jeune Vladislav de Hongrie. Skanderbeg est à l’époque l’un des espoirs de l’Europe combattante.
Si les Albanais avaient pu être présents à Varna, sans doute l’Europe aurait-elle vaincu. Mais Skanderbeg veut faire alliance avec le Roi de Naples, Alphonse d’Aragon et former un bloc hispano-italo-albanais capable de verrouiller la Méditerranée et l’Adriatique. Ce projet contrarie Venise qui s’y opposera, voulant garder seule le passage hautement stratégique que représente le Canal d’Otrante. L’hostilité de Venise donne un répit au Sultan : Skanderbeg, Alphonse d’Aragon et le Serbe Georges Brankovic tournent leurs forces contre Venise et l’affrontent pendant 2 ans, en 1447 et 1448. Il naîtra de cette guerre une méfiance entre Aragonais (puis Espagnols au XVIe siècle) et Vénitiens qui durera jusqu’à Lépante. Hongrois, Serbes de Brankovic et Albanais de Skanderbeg, allié aux Aragonais, Napolitains et Siciliens d’Alphonse d’Aragon constituent un bloc solide, qui barre aux Turcs la route de l’Adriatique et du Canal d’Otrante, voie maritime fort étroite entre les péninsules balkanique et italique. Cette alliance mobilise de nombreuses forces ottomanes : celles-ci tiennent les Hongrois en échec en 1448 dans la plaine du Kosovo, à l’endroit même où Lazare avait été vaincu. En 1450, les tentatives turques d’enlever la forteresse de Croïa en Albanie se soldent par un cuisant échec : Skanderbeg est victorieux. Cette pression hungaro-albanaise a réussi à donner du répit à Constantinople et a protégé l’Italie et Venise, malgré elle.
La chute de Constantinople, de la Morée et de Trébizonde : fin de la civilisation byzantine
 Les querelles religieuses ne cessent plus de miner Byzance et la Morée. Certains Grecs préfèrent le “turban du sultan” aux “chapeaux des cardinaux” romains. Le 12 décembre 1452, le nouveau Basileus Constantin XI Dragasès impose par une grand messe tenue à Sainte Sophie l’Union avec l’église de Rome. Cette Union suscite la furie des prêtres grecs hostiles à toute réconciliation avec Rome. Face à la situation, Mehmed II, fin stratège, attaque en Albanie pour empêcher Skanderbeg et Alphonse d’Aragon de porter secours à Constantinople. Les Albanais sont vainqueurs, à la veille de la chute de la ville. De mars à août 1452, Mehmed II fait construire la forteresse de Rouméli-Hissar à l’endroit où le Bosphore est le plus étroit, permettant ainsi aux canons turcs d’empêcher tout trafic et donc tout secours naval sur la voie d’eau. Deux navires vénitiens, apportant du blé de la Mer Noire, sont coulés devant Rouméli-Hissar. Tous les liens avec le littoral de la Mer Noire sont rompus. La ville est isolée. Louis Bréhier nous rappelle que le siège commence dès février 1453 par l’occupation de toutes les places grecques défendant l’accès à la ville. Les banlieues sont ravagées et l’investissement proprement dit débute entre le 2 et le 6 avril 1453. Les Ottomans de Mehmet II le Conquérant prennent Constantinople le 29 mai 1453. Le Basileus meurt les armes à la main. Un chroniqueur demeuré inconnu écrit :
Les querelles religieuses ne cessent plus de miner Byzance et la Morée. Certains Grecs préfèrent le “turban du sultan” aux “chapeaux des cardinaux” romains. Le 12 décembre 1452, le nouveau Basileus Constantin XI Dragasès impose par une grand messe tenue à Sainte Sophie l’Union avec l’église de Rome. Cette Union suscite la furie des prêtres grecs hostiles à toute réconciliation avec Rome. Face à la situation, Mehmed II, fin stratège, attaque en Albanie pour empêcher Skanderbeg et Alphonse d’Aragon de porter secours à Constantinople. Les Albanais sont vainqueurs, à la veille de la chute de la ville. De mars à août 1452, Mehmed II fait construire la forteresse de Rouméli-Hissar à l’endroit où le Bosphore est le plus étroit, permettant ainsi aux canons turcs d’empêcher tout trafic et donc tout secours naval sur la voie d’eau. Deux navires vénitiens, apportant du blé de la Mer Noire, sont coulés devant Rouméli-Hissar. Tous les liens avec le littoral de la Mer Noire sont rompus. La ville est isolée. Louis Bréhier nous rappelle que le siège commence dès février 1453 par l’occupation de toutes les places grecques défendant l’accès à la ville. Les banlieues sont ravagées et l’investissement proprement dit débute entre le 2 et le 6 avril 1453. Les Ottomans de Mehmet II le Conquérant prennent Constantinople le 29 mai 1453. Le Basileus meurt les armes à la main. Un chroniqueur demeuré inconnu écrit : « L’empereur grec se défendit bravement et résista aux païens, tant et si bien, qu’ils le laissèrent. Et c’est en ce lieu qu’il fut tué. Un janissaire lui trancha la tête, alors qu’il était déjà mort, l’emmena et la porta aux pieds du sultan et dit : ‘Heureux seigneur, tu vois là la tête du pire de tes ennemis’. Le sultan demanda alors à un prisonnier, un ami de l’empereur grec nommé Andreas, de qui était cette tête. Andreas répondit : ‘C’est la tête de notre empereur, de notre seigneur’ ».
La ville est livrée au pillage, d’atroces massacres ont lieu, le Sultan entre dans Sainte Sophie et foule le maître-autel aux pieds. Après Byzance, la Morée tombe aux mains de Mehmed II, à l’exception de la place de Monemvasia qui restera vénitienne jusqu’en 1540. L’État de Trébizonde suit en 1461, malgré son alliance avec Ouzoun-Hassan, chef de la Horde turque du Mouton Blanc, qui a épousé la sœur du Basileus de Trébizonde, Theodora Comnène. Mais les troupes d’Ouzoun-Hassan sont battues par les Ottomans et contraintes d’accepter une paix fort humiliante. David, dernier empereur de Trébizonde, est exilé. Theodora ne désarme pas : elle enjoint en 1467 David et les siens d’envoyer un de leurs fils à la cour des Moutons Blancs, pour qu’avec leur appui il redevienne Basileus de Trébizonde. Mehmed II l’apprend et, furieux, ramène la famille exilée à Constantinople, veut les obliger à se convertir ; devant leur refus, il fait décapiter David et ses 7 fils. Louis Bréhier écrit, pour terminer son livre magnifique sur l’histoire byzantine : « Par l’héroïsme avec lequel il accepta le martyr, le dernier Basileus de Trébizonde se montra digne du dernier Basileus de Constantinople ». La civilisation byzantine venait d’expirer sans plus aucun espoir de renaissance. Les Turcs ottomans sont désormais face aux forces disparates de la Rome d’Occident, divisée en puissances antagonistes. Ils espèrent pouvoir appliquer à leur profit le plan de reconquête mis en œuvre par Justinien, 900 ans auparavant.
Mehmet II continue à accroître sa puissance : de 1456, année où les Hongrois de Hunyadi reprennent Belgrade, à 1480, il avance ses pions dans les Balkans et, de 1463 à 1479, il entre en guerre avec Venise, qui n’avait pas voulu faire cause commune avec les Albanais de Skanderbeg et Alphonse d’Aragon. Le Sultan profite de toutes les dissensions entre puissances chrétiennes, selon des stratégies éprouvées depuis les tout premiers succès des Osmanlis d’Othman et d’Orhan. Les Turcs chassent ensuite les Génois de la Mer Noire : le ressort principal du commerce médiéval se voit ainsi brisé. On avait coutume de dire à l’époque : “Amène n’importe quelle marchandise dans la Mer Noire (ou en Crimée) et tu es sûr qu’elle sera vendue”. En effet, les caravanes mongoles venaient les y chercher et les amenaient vers les camps de yourtes des grands khans, vers la Perse, l’Inde et la Chine.
La double chute de Constantinople et de Trébizonde, avant la découverte de l’Amérique et le contournement de l’Afrique par les Portugais, isole l’Europe, la coupe des immensités asiatiques et des débouchés qu’elles autorisent, la condamne à n’être plus qu’un petit promontoire acculé à un océan immense ne menant apparemment nulle part, sauf pour quelques pêcheurs de morues, scandinaves ou normands, initiés aux vieilles routes vikings menant au Groenland et au Labrador. La Hongrie, elle, résiste, forme un verrou et protège le cœur germanique et alpin de l’Europe. Le Sultan ne peut pas menacer Vienne, tant que les Hongrois tiennent Belgrade. En 1472, Venise, alliée au Pape et au Royaume de Naples, lance une vigoureuse contre-offensive : la flotte de la Sérénissime, commandée par Pietro Mocenigo, et celle du Saint Siège, commandée par le Cardinal Caraffa, attaque Satalia et Smyrne, qui est pillée. Les Européens restent maîtres de la mer et, sur terre, règne le statu quo, grâce à la bonne organisation des défenses hongroises.
Premier siège de Rhodes et prise d’Otrante
Le dernier quart du XVe siècle n’est pas aussi glorieux pour les Ottomans. Ceux-ci décident toutefois de 2 coups de force en 1480. En mars, Mehmed II attaque Rhodes parce que les Chevaliers, par leur présence et par leurs initiatives, lui contestent la maîtrise de la mer. Le siège dure plusieurs mois, mais c’est l’échec. Les Chevaliers résistent. Rhodes tient. L’Europe garde son bastion et sa base dans le bassin oriental de la Méditerranée. En août, 90 galères turques, flanquées de 20 navires de transport, attaquent le port d’Otrante, en Apulie, dans le talon de la botte italique, là où l’Adriatique est la plus étroite, une largeur de 75 km. à peine. Après 2 semaines de siège, la ville tombe, le 11 août. Ses défenseurs ont été héroïques mais trop peu nombreux pour faire face à une armée ottomane que les sources estiment entre 18.000 et 100.000 hommes. De plus, la garnison d’Otrante ne disposait pas d’artillerie. Malgré sa faiblesse, elle avait refusé la reddition immédiate. Elle est livrée au pillage et au massacre. L’archevêque Stefano Pendinelli est massacré sur le maître-autel de la cathédrale. Après la ville, les campagnes environnantes subissent un sort tout aussi cruel.
Les Ottomans disposent d’une tête de pont en Italie et cherchent très vraisemblablement à prendre la “pomme rouge”, c’est-à-dire Rome, de façon à ce que Mehmed II soit l’héritier des 2 empires romains, ce qui était son rêve. En même temps qu’elle constitue une tête de pont sur le sol italien, Otrante verrouille l’Adriatique et permet de tenir Venise en échec, de la couper de ses possessions dans le bassin oriental de la Méditerranée. Mais l’Apulie, à l’époque, est possession aragonaise : l’honneur hispanique est donc bafoué. Mehmet II vient, en violant le sol italien, de se donner des ennemis implacables : les Aragonais, qui, bientôt alliés aux Castillans, vont lutter sans relâche contre les flottes turques, jusqu’à Lépante. Sitôt la chute d’Otrante connue, le fils du roi Ferdinand, Alphonse, Duc de Calabre, marche à la tête d’une armée vers Otrante, bien décidé à bloquer les Ottomans, qui promettent, pour le printemps, l’arrivée d’une nouvelle armée de 120.000 hommes, prête à conquérir, annoncent-ils, toute la péninsule italique.
L’inquiétude est à son comble en Italie. La zizanie règne cependant entre les nombreux états et villes-États d’Italie. Aucune décision claire et tranchée n’émane de cette cacophonie d’intérêts contradictoires et de jalousies mutuelles. Seul le Pape promet argent et renfort. Finalement, les secours ne viendront que d’Espagne, mandés par les Rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Mais le 3 mai 1481, avant le choc entre les 2 armées, Mehmet II meurt inopinément. Le Duc de Calabre reprend la ville et tous les prisonniers turcs, qu’il y faits, sont envoyés aux galères. Pour la première fois, des musulmans rameront sur les galères européennes. En 1489, Venise prend possession de Chypre, dont la chute, quelques mois avant Lépante, provoquera une volonté de résistance et conduira à l’émergence de la “Sainte Ligue” de 1571.
Nous arrivons au XVIe siècle. Le décor est déjà planté. Le binôme Aragon-Castille, présent en Italie du Sud et en Sicile, est bien décidé à ne plus tolérer d’opérations ottomanes en Apulie ou en Sicile, a fortiori dans le bassin occidental de la Méditerranée. Venise entre en guerre avec les Turcs en 1499 et subit plusieurs revers, à La Sapienza (au sud de la Grèce actuelle) et dans la Baie de Navarin. Ensuite, lors de la première bataille de Lépante, le 25 août 1499, la flotte vénitienne est une nouvelle fois battue. En 1500, nouveaux revers en Grèce. Venise doit faire appel à l’Espagne qui affronte les Turcs pour la première fois dans une opération navale d’envergure : la flotte du Capitaine-Général Gonzalo de Cordova entre en action à l’automne 1500 et taille quelques solides croupières aux Turcs. Mais, en fin de compte, les Ottomans sont victorieux : lorsque la paix est signée en août 1503, Venise doit renoncer à toutes ses places fortes grecques. Les Ottomans possèdent désormais une flotte capable de damer le pion aux Européens, de leur contester au moins l’accès à la Méditerranée orientale. La France promet des secours mais ne les envoie pas. Seule l’Espagne est décidée à en découdre avec les Turcs. Mais elle doit avoir les mains libres en Méditerranée occidentale et la débarrasser des pirates barbaresques.
L’Espagne passe à l’attaque en Afrique du Nord
La future alliance de Lépante se dessine déjà à l’horizon, bien qu’elle connaîtra bon nombre de lézardes au cours des 7 premières décennies du XVIe siècle, dues à l’incapacité congénitale des Européens à faire front commun sur le long terme contre un ennemi, qui, lui, a de la suite dans les idées, une stratégie unitaire et un plan sur le très long terme. À l’époque seuls les Espagnols et les Chevaliers de Rhodes conçoivent une stratégie de même ampleur. Au moment même où les Vénitiens sont contraints d’accepter les conditions du sultan et d’évacuer la plupart de leurs bases grecques, les Chevaliers de Rhodes passent à l’attaque et détruisent une flotte turque en août 1503, qui avait harcelé les côtes de l’île que contrôlait leur Ordre de Saint-Jean. Pour affronter les Ottomans sur la ligne Otrante/Malte et leur barrer la route de la Méditerranée occidentale, les Espagnols doivent préalablement liquider les flottes barbaresques qui écument le bassin occidental, razzient les côtes espagnoles, italiennes et provençales, ainsi que les Baléares.
Une fois le danger français éliminé en Italie en 1504, les Ibériques passent à l’offensive en Afrique du Nord, sous l’impulsion d’un Cardinal qui, assurément, préfère réfléchir aux meilleures stratégies navales qu’aux arcanes fumeuses de la théologie : il s’appelle Francisco Ximenes de Cisneros et est devenu Cardinal en 1507, par la grâce du pape Jules II, pontife guerrier et protecteur des arts et de Michel-Ange. Deux ans après sa nomination comme primat d’Espagne, Francisco Ximenes de Cisneros décide une offensive de grande envergure en direction de l’Afrique du Nord, dont les pirates ne cessent de menacer les côtes espagnoles et italiennes. Le 18 mai 1509, les troupes hispaniques, menées par le Cardinal en personne, prennent la ville d’Oran, qui, depuis, en dépit de toutes les vicissitudes de l’histoire, revient de droit à l’Espagne. Peut-être qu’un jour le drapeau “sang et or” flottera-t-il à nouveau sur la ville ? Prions pour qu’alors, ce soit pour l’éternité. L’armée espagnole ne prend pas seulement Oran, elle prend aussi Bougie, après un débarquement dirigé par Pedro Navarro, et enlève ensuite Tripoli en Libye, où elle installe une base qui demeurera inexpugnable pendant quelques décennies. Elle ne peut pas aller plus loin, malheureusement. Elle ne parvient pas à prendre pied à Djerba, au large de la Tunisie. Elle doit lever le siège et une tempête détruit une bonne partie de ses navires. Le Roi Ferdinand décide d’arrêter les opérations en septembre 1511.
Les Chevaliers de Rhodes prouvent qu’ils détiennent à l’époque la meilleure intelligence géopolitique des enjeux. En 1510, ils détruisent une flotte égyptienne à proximité d’Alexandrette. Immédiatement après leur victoire sur mer, les Chevaliers débarquent dans le port et détruisent tous les chantiers navals qui s’y trouvent parce qu’ils travaillaient à armer une flotte mamelouk, destinée à lutter contre les Portugais en Mer Rouge. Le contournement du bloc musulman par les Portugais était l’entreprise stratégique de longue haleine la plus audacieuse de l’Europe à l’époque. Elle avait commencé par les conquêtes de Henri le Navigateur au XVe siècle, par la maîtrise de Madère, des Açores et des Iles du Cap Vert. Les Portugais étaient maintenant bien présents dans l’Océan Indien. Il ne fallait pas que leur présence y soit mise en danger. Les Chevaliers y ont veillé en 1510. Aussitôt, bien évidemment, les Turcs prennent conscience du danger mortel que représente leur présence à Rhodes. Ils savent désormais qu’il est impératif pour eux de prendre l’île.
Sélim Ier s’empare de la Syrie et de l’Égypte
En 1515, une flotte espagnole commandée par Don Luis de Requesens bat une flotte barbaresque à proximité de l’île de Pantelleria. En 1516, les Espagnols débarquent près d’Alger dans l’espoir de prendre la ville et d’éliminer ainsi la principale base de la piraterie nord-africaine. Aroudj Barberousse, principal capitaine des Barbaresques, les bat sur terre et l’escadre est détruite par une tempête. Sélim Ier, devenu Sultan à Constantinople en 1512, est, de fait, coincé entre un Occident européen désuni, dont la principale puissance est désormais l’Espagne, qui passe à l’offensive, et un Orient perse, hostile aux Ottomans, parce qu’ils leur barrent la route vers la Méditerranée. Par la force des choses, par les lois de la géographie, Sélim est devenu, en dépit de ses origines et de ses références turques, l’héritier du territoire de Byzance, faute d’être l’héritier de son esprit grec et orthodoxe. En tant que tel, il affronte un ouest et un est, qui sont, peu ou prou, les mêmes que ceux qu’affrontait Justinien, géographiquement parlant du moins.
3 faiblesses marquent son empire si on le compare justement à celui de Justinien : il ne franchit pas la ligne Otrante / Malte ; il n’a aucune base d’appui sur le continent africain ; sa frontière orientale reste très vulnérable, face à une Perse qui renait alors de ses cendres sous l’impulsion du fondateur de la dynastie séfévide, Shah Ismail I. Celui-ci s’empare en effet de l’Azerbaïdjan en 1501 et de Bagdad en 1509. Sur mer, le danger vénitien semble conjuré depuis la victoire ottomane de 1503, mais l’Espagne, maîtresse du Royaume de Naples, de la Sicile et de la Sardaigne, se montre très offensive en Méditerranée occidentale. Si elle s’assure une domination non partagée dans cette partie de la Grande Bleue, elle disposera de bases solides pour passer à l’offensive en Méditerranée orientale, où l’Égypte des Mamelouks, en pleine déliquescence, est le maillon faible du monde musulman voire une proie potentielle pour une croisade arc-boutée sur Chypre et Rhodes.
Sélim Ier n’a pas beaucoup de choix : il doit trancher, il doit faire la guerre. Et il la veut. Il accuse les Égyptiens de favoriser les desseins des Perses, en laissant des troupes perses passer en Anatolie, via les terres de la Haute Mésopotamie que contrôlent les Mamelouks. En 1516 et en 1517, à la suite de campagnes rondement menées et avec l’appui d’une puissante artillerie dont ne disposent pas les Égyptiens, Sélim Ier s’empare de la Syrie, de la Palestine et de l’Égypte, qui sont absorbées dans l’empire ottoman. Le Caire fut pillé de fond en comble et Touman, le successeur de Kansouh, Sultan d’Égypte, qui avait tenté de barrer la route aux Ottomans victorieux est pendu le 13 avril 1517, après la décollation de 3 à 4.000 Mamelouks, dont une soixantaine d’émirs. L’ancienne élite est exterminée sans pitié et remplacée par une nouvelle élite entièrement ottomanisée.
Les Barberousse s’emparent de l’Afrique du Nord par le fer et par le feu
Sélim Ier, par des campagnes éclairs, s’est donné des atouts géopolitiques majeurs : la frontière orientale est sécurisée ; l’Anatolie ne peut plus être envahie par le sud ; toute la côte orientale de la Méditerranée est sous domination ottomane et potentiellement fermée au commerce des villes italiennes ; la puissance ottomane a pris pied en Afrique, de la Mer Rouge à la Cyrénaïque. Le Sultan peut faire sa jonction historique avec les Barbaresques et absorber dans l’orbe ottomane presque tous les territoires nord-africains que Justinien avait conquis en commençant par s’attaquer à la puissance maritime des Vandales, établis sur le territorie de la Tunisie actuelle. Justinien avait reconquis le sud de l’Espagne contre les Wisigoths : avec l’aide des Maures d’Afrique du Nord, des pirates des côtes algériennes et des Morisques demeurés en Espagne après 1492, il compte bien, lui aussi, s’y établir. Par tous les moyens, y compris les moins délicats.
Les Barberousse, une famille d’origine albanaise résidant au départ à Mytilène, une île de l’Égée, vont passer du bassin oriental au bassin occidental de la Méditerranée, conquérir sans ménagement l’Afrique du Nord, y introduire des armées de janissaires ottomans et y affronter les Espagnols. Virtuellement, par l’intermédiaire de cette famille, les Ottomans s’emparent du Maghreb, sauf du Maroc. En 1516, les Barberousse prennent Alger, qui est soumise au pillage et au viol. On n’est pas plus tendre avec les musulmans d’Alger qu’on ne l’a été avec les chrétiens d’Otrante en 1480 !
En 1517, c’est au tour de Tlemcen de subir un sort aussi peu enviable. Les 7 fils du roi local sont égorgés et leurs corps pendus aux remparts de la ville. Les Espagnols les vengeront l’année suivante : Aroudj, poursuivi, est rattrapé, tué et décapité. L’Oranie et les confins du Maroc échappent à l’emprise des Barberousse et de l’empire ottoman. En revanche, les Espagnols ne prennent pas Alger. Kheir-ed-Din Barberousse, le dernier survivant de sa phratrie, défend la ville avec succès en 1518. En maîtrisant Alger et bientôt l’ensemble de la Tunisie, en pacifiant par le fer et par le feu la Kabylie, en soumettant la population autochtone à une régime d’une sévérité inouïe, Kheir ed-Din reconstitue, en quelque sorte, le royaume maritime et corsaire du chef vandale Genséric, et s’attaque aux côtes de la Sicile et de l’Italie.
En 1519, ils écument le littoral de la Provence. Ils ne trouvent pas d’adversaire à leur taille. Les Musulmans sont maîtres du bassin occidental avant même d’être les maîtres incontestés du bassin oriental. En effet, Rhodes tient toujours, alors que Kheir ed-Din, à Alger, dame le pion aux Espagnols qui ne peuvent pas encore aligner un capitaine aussi intrépide. Sauf peut-être cet Andrea Doria qui, en 1519, protège avec succès, pour le compte du roi de France, les côtes provençales. Il refera parler de lui. En attendant, l’oumma dispose de meilleurs pions en Méditerranée occidentale, avec les corsaires barbaresques, qu’en Méditerranée orientale, parce que les Chevaliers de Rhodes y sont toujours présents, alors que la plus grande puissance musulmane est maîtresse de toutes les terres de l’Orient méditerranéen.
Soliman Ier le Magnifique s’empare de Rhodes
En attendant, fort des succès de Kheir ed-Din dans le bassin occidental, le nouveau Sultan, Soliman Ier, bientôt surnommé le “Magnifique”, décide, à son tour, de passer à l’offensive : en 1521, il s’empare de Belgrade, démantelant du même coup le système de défense hongrois dans les Balkans. La frontière méridionale de la Hongrie est “démembrée” pour reprendre le vocabulaire de Richelieu et de Vauban. La voie est ouverte pour une invasion future. Elle ne tardera pas. Soliman Ier ne règle pas tout de suite le compte de ses ennemis hongrois. En juin 1522, il fait débarquer 300.000 hommes à Rhodes, avec la ferme intention de détruire la base des Chevaliers, afin d’être enfin maître de la Méditerranée orientale. Le siège va durer 6 mois. L’île de Rhodes a grosso modo la forme d’une ellipse, disposée selon un axe nord-est / sud-ouest. La ville de Rhodes, et donc sa principale forteresse, se trouve sur la pointe nord-est de l’île. Le 26 juin 1522, face aux troupes innombrables de Soliman, il y a seulement 700 chevaliers, 500 archers crétois et 1.500 mercenaires d’origines diverses, auxquels se joignent bien entendu tous les habitants chrétiens de l’île, mobilisés jusqu’au dernier homme. Cette maigre garnison a toutefois l’avantage d’être à l’abri de murs réputés imprenables et d’être dotée de réserves de munitions, d’eau et de nourriture suffisantes. Le principal danger qui guettait les défenseurs étaient les sapes des Ottomans, cherchant par tous les moyens à ébranler les murailles de Rhodes, sans devoir donner un assaut qui coûterait horriblement cher.
En effet, en septembre déjà, les Chevaliers doivent constater que les Turcs ont creusé une cinquantaine de tunnels sous les murailles de la forteresse. Sous la direction d’un ingénieur militaire italien, Gabriele Tadini, les assiégés parviennent très souvent à les détecter et les mettre hors d’usage. Mais Tadini ne pouvait pas espérer gagner à tous les coups. En septembre, une mine ottomane explose sous la section tenue par les Chevaliers anglais, provoquant une brèche de 30 pieds (de 9 à 10 m.), dans laquelle tentent immédiatement de s’engouffrer les premières troupes de Soliman. 2 heures de combats au corps à corps s’ensuivent : les Chevaliers tiennent, les Ottomans doivent se retirer. Ce sera quasiment le seul combat sur les remparts de Rhodes. Seul l’épuisement des réserves fera fléchir les Chevaliers. Le lendemain du jour de Noël, le Grand Maître Philippe de Villiers de l’Isle Adam accepte la capitulation et invite le Sultan à Rhodes même pour négocier les termes de la reddition. Devant les portes de la ville, Soliman Ier congédie ses gardes en leur disant : “Ma sécurité est garantie par la parole du Grand Maître des Hospitaliers, ce qui est finalement plus sûr que toutes les armées du monde”.
Le 1er janvier 1523, les Chevaliers quittent Rhodes pour la Crète : Soliman Ier, dans un geste de magnanimité, leur a laissé la vie sauve et ne les a pas réduits à l’esclavage. La chute de Rhodes est ressentie comme une épouvantable catastrophe : en effet, Rhodes se trouve à mi-chemin entre Constantinople et Le Caire, selon l’axe nord-sud, à mi-chemin entre la Grèce et la Syrie, selon l’axe ouest-est. Pour l’historien anglais Barnaby Rogerson : “Rhodes exerce une pression, comme celle d’un pouce, sur les 2 artères des communications ottomanes”, du moins depuis la double conquête de la Syrie et de l’Égypte. Pour Soliman Ier, en effet, la présence des Chevaliers était devenue intolérable, une question de survie, à laquelle il ne pouvait pas ne pas répondre. Mais la question que tous se posent en Europe est la suivante : où Soliman Ier va-t-il attaquer la prochaine fois ? Quels coups terribles va-t-il bientôt infliger à la chrétienté européenne, déchirée par le conflit qui oppose Charles-Quint à François Ier pour la maîtrise du Milanais, de la plaine du Pô et de la fenêtre sur l’Adriatique qu’elle offre ?
Victoire de Pavie et trahison du Pape Clément VII
Le Pape Giulio de Medici, alias Clément VII, 2 ans après la chute de Rhodes, n’appelle pas les grandes puissances européennes à enterrer leurs conflits périphériques ; il n’exhorte pas François Ier et Charles-Quint à unir leurs forces et leurs ressources pour sauver la Méditerranée. Non, en reniant la politique pro-impériale et anti-turque de ses prédécesseurs, il s’allie secrètement, en 1524, à la France de François Ier, en même temps que Florence et Venise, contre l’Espagne et le Saint-Empire qu’il estime être redevenu “gibellin”, comme au temps des Hohenstaufen, dont la couronne d’Aragon, finalement, était l’héritière en Sicile et à Naples. Pour ce pape à courtes vues, pas question d’avoir un héritier des Hohenstaufen tout à la fois en Italie du Nord et en Italie du Sud, coinçant du même coup les États pontificaux entre une enclume napolitaine et un marteau milanais. Fort de cette bénédiction d’un pape sans culture géopolitique, le vaniteux François Ier, dans l’intention de se saisir du Milanais, franchit les Alpes au Mont Cenis et envahit la plaine du Pô. En octobre 1524, il s’empare déjà de Milan et marche aussitôt sur Pavie, où il compte passer l’hiver.
Le 21 février 1525, l’armée impériale l’y surprend ; elle est commandée par le Connétable Duc de Bourbon, un Français de haut lignage que François Ier a lésé et offensé. L’armée de François Ier est essentiellement composée de lansquenets suisses, maîtres dans l’art de manier la pique. Face à eux, une armée impériale drillée à l’espagnole, c’est-à-dire entraînée à combiner piques et arquebuses, une stratégie qui parvient à briser les charges de cavalerie par le double effet des murs de piques et des salves darquebuses. Au soir de la bataille, François Ier est prisonnier : il a rendu son épée au Comte Charles de Lannoy. Transféré à Madrid, le roi de France promet de renoncer définitivement à la Bourgogne, à Naples et à Milan. Une fois libéré, il s’empresse de renier sa parole et de faire décréter le Traité de Madrid “nul et non avenu”.
Le 22 mai 1526, François Ier adhère à la “Ligue de Cognac”, concoctée par le Pape Clément VII, petit nationaliste avant la lettre, qui veut une Italie sans présence impériale ou espagnole, avec, uniquement, à la rigueur, une armée française comme masse de manœuvre pour contrer les autres et à laquelle il ferait appel, si bon lui semble, avant de la congédier à sa guise. Du danger turc ante portas, il n’a aucune idée, il ne prépare aucun projet pour le conjurer. Charles Quint n’a pas la moindre intention de défier l’église ou de supprimer la papauté comme le demandent les luthériens qui embrasent l’Allemagne et en disloquent la cohésion. Mais il ne peut pas admettre un pape aux vues aussi mesquines, allié à des cités marchandes qui n’ont pas conscience de l’intérêt général du continent et ne visent que leurs profits à court terme et à un roi de France vaniteux qui ne se rend pas compte des enjeux réels en Méditerranée ni de l’exiguïté de l’orbe euro-méditerranéen ni du danger que représente une armée ottomane à Belgrade pour tout le centre de l’Europe.
François Ier n’a même pas conscience de l’intérêt à long terme de la France : les Ottomans à Belgrade, cela signifie la présence d’une volonté géopolitique non romaine, donc non européenne, sur une position clef des réseaux fluvial et routier de l’Europe. Une volonté géopolitique ennemie à Belgrade, cela signifie la porte ouverte vers Budapest, Vienne, le Danube jusqu’à la Forêt Noire et, enfin, jusqu’à la trouée de Bâle que les Allemands appellent la “Porte de Bourgogne”. Qui franchit la “Porte de Bourgnogne” se trouve facilement en Bourgogne, par le Doubs, sur le plateau de Langres, en Champagne et en Ile-de-France. Ce savoir géographique, même en l’absence de cartes précises, était connu et maîtrisé du temps des Romains. Et les Ottomans le connaissaient aussi.
Quand il adresse l’une de ses lettres de remontrances au pape, Charles Quint lui rappelle, dans la langue de l’époque, compénétrée de vocables religieux, qu’il “a failli à ses devoirs envers la chrétienté, l’Italie et même le Saint Siège”. Faillir à ses devoirs envers la chrétienté, cela signifie, en clair, faillir à ses devoirs envers l’Europe, avoir désobéi aux lois de la géopolitique européenne. Le pape paiera cher son étourderie : ses alliés milanais seront vaincus, François Ier ne volera pas à son secours et, finalement, le 6 mai 1527, une armée impériale germano-espagnole, sous le commandement du Connétable de Bourbon, entre dans Rome. Presque immédiatement, le Connétable est tué d’un coup d’arquebuse. Ses hommes vont le venger. Et très durement. Rome, qui a trahi l’Europe et donc aussi la romanité, sera mise à sac pendant 4 jours et 4 nuits, avant l’arrivée de Pompeio Colonna, un Romain fidèle à l’Empire et à l’Espagne qui rétablira l’ordre avec ses 8.000 soldats.
Le désastre de Mohacs et le premier siège de Vienne
La Hongrie était restée un bastion inexpugnable tant qu’y dominait le système efficace, mis en place par Janos Hunyadi et son fils Matthias Corvinus. Mais 2 rois, Vladislas II Jagellon et Louis II ruinent l’œuvre politique des 2 grands “Gubernatores” de la Hongrie du XVe siècle. L’armée redevient une “ost” médiévale, tenue par une aristocratie trop faible en nombre. Le paysannat est privé de tout droit et n’est plus appelé à servir pour faire masse face aux armées ottomanes. Les Ottomans avaient déjà emporté une petite victoire significative en avançant leurs troupes dans la vallée de la Save. En 1521, ils s’emparent de Belgrade. Louis II sait que son armée féodale est insuffisamment nombreuse pour endiguer l’invasion. Il fait appel aux souverains occidentaux : empétrés dans leurs propres guerres, ils ne répondent pas à l’appel de la Hongrie, imaginant sans doute qu’elle est toujours le solide bastion qu’en avaient fait Hunyadi et Corvinus.
Le 29 août 1526, alors que l’empereur Charles Quint doit toujours faire face à l’alliance fatidique du pape Clément VII et du roi de France François Ier, les Turcs passent à l’offensive et battent à Mohacs l’armée royale hongroise de Louis II, qui est tué dans la mêlée, avec l’archevêque Tomory de Kalocsa, dont la tête sera promenée en trophée dans le camp ottoman. Parmi les morts : un autre archevêque, celui de Gran, et 5 de ses évêques. Des 28.000 soldats hongrois, slavoniens et pontificaux qui participèrent à la bataille, il n’y eu que 4.000 survivants. Le 10 septembre, le Sultan entre triomphal dans la capitale, Buda, mais s’en retire dès le 17. Le poète hongrois Vörösmarty écrivit un poème au XIXe siècle, résumant la tragédie hongroise de Mohacs :
“Mohacs, champ de deuil,
Trempé du sang des héros,
Où furent submergés les guerriers
Par le flot des Ottomans.
Mohacs, sur ton sol,
On porta en terre,
Le demi millénaire de grandeur
Du Royaume de Hongrie”.Il s’ensuivit une querelle intérieure : qui doit succéder au roi qui vient de mourir au combat ? Janos Szapolyai, un Hongrois, ou Ferdinand de Habsbourg, frère de Charles-Quint ? Et la querelle s’envenime, alors que les Turcs n’avaient pas exploité immédiatement leur victoire et s’étaient retirés vers le sud, sans doute par crainte de tomber sur l’armée impériale. Les Européens, une fois de plus, perdent un précieux temps à se quereller entre eux plutôt que d’affronter, toutes forces mobilisées, l’ennemi commun. Ferdinand offre aux Hongrois cruellement vaincus par les Turcs la garantie du secours de l’armée impériale en cas de nouvelle offensive ennemie.
Szapolyai, en fin de course, s’allie aux Turcs et à François Ier, rappellant ainsi l’armée de Soliman Ier en Hongrie. Elle s’avancera profondément dans l’espace danubien et mettra une première fois le siège devant Vienne en 1529. En effet, le Sultan estime la Hongrie trop éloignée de ses bases balkaniques et anatoliennes, il préfère agir par personne interposée ; avec l’appui de Szapolyai, il veut faire de la Hongrie un État tributaire et tampon, qu’il n’annexe pas directement à son empire. La Hongrie est alors divisée en 2 : la partie inféodée aux Ottomans par la soumission de Szapolyai et celle que contrôle Ferdinand qui, en plus, s’empare définitivement de la Bohème, de la Moravie et de la Silésie.
Après la défaite des Serbes et des Bulgares à la fin du XIVe siècle, après celle des Hongrois à Mohacs en 1526, le bloc de Ferdinand, avec l’Autriche, la Bohème, la Moravie et la Silésie constitue dorénavant la première ligne européenne, au beau milieu du continent. L’affrontement n’a plus lieu en périphérie du bloc civilisationnel euro-chrétien, loin des centres névralgiques du continent, mais en son centre même. Si celui-ci tombe, le continent est perdu. Et le choc ne tarde pas.
Le Sultan plante sa lance, ornée à la mode turco-mongole d’une queue de cheval, dans le sol autrichien, devant les murs de Vienne, que les Turcs appellent poétiquement la “pomme d’or”. Nous sommes le 12 septembre 1529. le Sultan a bien calculé son coup : Charles-Quint, il le sait, affronte François Ier à l’Ouest et ne pourra donc pas voler au secours de son frère. Il espère se saisir de la “pomme d’or”, du siège de l’impérialité germanique. Vienne est défendue par 8.000 lansquenets et 1.700 reîtres cuirassés, sous le commandement du vieux Comte Niklas von Salm. 3 fois, les Ottomans, qui n’ont pas d’artillerie lourde mais seulement quelques pièces légères, ouvrent des brèches dans les murailles de la cité danubienne. Chaque fois, les assauts des janissaires sont repoussés par les lansquenets allemands. L’hiver arrive au secours des Impériaux. Le froid et les pluies glacées, les frimas et la neige, ont raison du moral des Ottomans, habitués à des climats plus cléments. Ferdinand rameute catholiques et protestants et avance à marches forcées pour bouter dehors les Turcs.
Avant l’arrivée de ces soldats, qui ne craignent pas l’hiver, Soliman Ier lève le siège le 16 octobre. Les 150.000 soldats ottomans retournent à Buda, avant de reprendre le chemin du sud. Ils reviendront narguer les Viennois en 1532, en passant sous leurs murs, avant de ravager la Styrie et de repartir vers la Hongrie. L’ami de Soliman Ier, Ibrahim Pacha, menace : “Nous soutiendrons le roi Janos (Szapolyai) tant et si bien que, lorsqu’il le voudra, nous réduirons non seulement Ferdinand en poussière mais aussi ses amis (c’est-à-dire l’empereur Charles) et, avec les sabots de nos chevaux, nous transformerons leurs montagnes en plaines”. Après Mohacs, après les démonstrations de force devant Vienne en 1529 et en 1532, les Ottomans sont bel et bien les vainqueurs sur terre.
1530 : l’année où le vent a tourné
Au moment où Soliman Ier quitte Vienne en octobre 1529, Kheir ed-Din attaque en mer, dans le bassin occidental. Il envoie son lieutenant, le capitaine Caccia Diabolo, comme le nomment les Italiens, vers les Baléares, où il bat la flotte espagnole. Les Barbaresques pillent alors de fond en comble les côtes du pays de Valence et reviennent en triomphe à Alger, chargés de butin, avec des centaines de Morisques d’Espagne qui ont demandé à se réfugier en Afrique du Nord, et 1.000 galériens musulmans libérés. L’année 1529 a donc été une année terrible pour l’Europe : les Ottomans se sont enfoncés profondément vers le cœur de l’Europe danubienne, ils ont promené leurs chevaux au pied des Alpes de Carinthie, ils ont mis la Styrie à feu et à sang. Les Barbaresques ont démontré, avec Caccia Diabolo, qu’ils circulaient, combattaient et pillaient à leur guise en Méditerranée occidentale. Tout cela, à cause de la sottise et de l’impéritie d’un pape, Clément VII, et de la trahison du roi de France, qui fournit aux pirates algérois des pièces d’artillerie lourde, qu’ils utiliseront un an plus tard contre les Espagnols qui tiennent toujours la Tour de Navarro en face du port d’Alger. En cette année fatidique, l’Europe a frôlé l’anéantissement total.
L’Europe, malgré ses divisions, malgré son incapacité à penser son propre destin géopolitique, finit toujours par se sauver in extremis. L’historien anglais Barnaby Rogerson estime, pour sa part, que c’est le revirement de l’Amiral génois Andrea Doria qui va faire tourner la fortune des armes. Gênes était l’alliée de François Ier, donc, par ricochet, des Barbaresques et du Sultan. Andrea Doria a le sentiment de servir là une bien mauvaise cause, d’autant plus que l’arrogance des Français l’insupporte, car ils jouent de surcroît double jeu en occupant les places fortes de Gênes, sous prétexte de les protéger, et s’apprêtent à en ouvrir les portes aux Barbaresques, comme ils le feront plus tard à Toulon. Refusant cette mainmise française sur les terres génoises, Doria passe avec armes et bagages dans le camp de la légitimité impériale et offre ses services à Charles Quint, qui ne pourra que s’en féliciter. L’empereur lui laisse une grande liberté de manœuvre, y compris pour ses activités de course. Les résultats ne se feront pas attendre : Doria attaque le port de Cherchell à l’ouest d’Alger en 1531. L’année suivante, il passe à l’attaque dans le bassin oriental, et débarque en Grèce pour y mener avec succès des opérations de harcèlement. L’Empire ottoman était loin d’être vaincu, mais nous assistons aux premiers coups d’épingle de l’Europe assiégée, qui se bat pour éviter l’étranglement total, où quelques esprits hardis commencent à voir le véritable enjeu et le mortel danger que court la chrétienté.
La prise de Tunis
En 1530, Charles-Quint confie l’île de Malte et la place de Tripoli en Libye aux Chevaliers de Rhodes. Ils feront de l’île une forteresse inexpugnable. Dès 1531, ils alignent une grande caraque, la “Sant Anna”, bien dotée en canons, qui, un jour, seule, met en déroute une flotte turque de 25 bateaux. Pour venger ses déboires en Grèce et face à la “Sant Anna”, Barberousse ravage la Calabre en 1534, prend la ville de Reggio et réduit toute la population en esclavage, qui est amenée à Constantinople. Charles Quint décide de réagir : l’armée hispano-impériale débarque en juin 1535 à Tunis, que commande l’empereur lui-même. La flotte avait été assemblée à Barcelone pour transporter 12.000 soldats. Elle passe ensuite au large des Baléares puis mouille en Sardaigne, où 22.000 autres hommes de troupe s’embarquent pour la Croisade : les peuples de la Méditerranée occidentale ont la claire volonté de se défendre, d’éradiquer la piraterie nord-africaine, et savent que la meilleure défense, c’est l’attaque.
Le 16 juin, la flotte impériale arrive dans le port de Carthage et établit son camp, défendu par une centaine de pièces d’artillerie. Les Européens sont revenus dans l’ancienne province romaine d’Africa. Forteresse du lieu, La Goulette tombe en une matinée, le 14 juillet 1535, alors qu’elle est pourtant défendue par une armée de 14.000 Turcs. Le 20 juillet, l’armée impériale marche sur Tunis et rencontre en chemin la formidable armée de Kheir ed-Din : 150.000 hommes. Les Impériaux sont à 1 contre 5. Ils repoussent les Barbaresques qui tentent de se réfugier dans la médina et, là, surprise, les esclaves chrétiens, révoltés, leur en barrent l’accès. Kheir ed-Din doit fuir vers Bône, puis vers Alger. Il échappe de justesse à la capture. Tunis est maintenant aux mains de l’empereur, qui délivre 20.000 Européens que les Musulmans avaient réduits à l’esclavage. Charles-Quint remet en place le roi de Tunis, qui lui fait allégeance car il est hostile à Kheir ed-Din et à la présence des Turcs dans le Maghreb oriental. Une garnison hispano-napolitaine tiendra La Goulette et les forts.
Au retour, Messine fait à Charles Quint un triomphe inédit : le petit peuple est en liesse, accourt pour le saluer car son roi et empereur l’a sauvé des raids barbaresques. L’Europe célèbre “le divin Charles, victorieux de l’Afrique”. On le compare à Scipion, vainqueur d’Hannibal. À Rome, en 1536, devant toutes les autorités de la Ville et du Saint-Siège, devant la noblesse italienne et les ambassadeurs de France et de Venise, il déclare qu’après avoir vaincu Kheir ed-Din en Afrique, il est bien décidé à se retourner contre l’allié principal du pirate : François Ier. Charles Quint entre alors en Provence, avec ses troupes espagnoles et italiennes, tandis que Doria bloque les côtes.
La Provence, qui avait été impériale jadis, puisque située sur la rive gauche du Rhône, doit, dans l’esprit de Charles Quint, revenir dans le giron du Saint-Empire et être réunie à la Savoie, pour reformer la Bourgondie ou l’Arélat du XIe siècle. Charles-Quint avance jusqu’à Aix-en-Provence puis jusqu’aux portes de Marseille. Mais François Ier, échaudé depuis Pavie, refuse la bataille et pratique la politique de la “terre brûlée” : la pauvre Provence est transformée en un désert inhospitalier, dans lequel aucune armée ne peut aisément manœuvrer ni s’assurer une logistique convenable. L’empereur Charles, tenu en échec par cette stratégie, doit rebrousser chemin, retourner à Gênes. Kheir ed-Din court toujours et le roi François n’a pas été vaincu : au contraire, il ravage les Pays-Bas. C’est là-bas qu’il faut maintenant courir et porter le fer. Même si d’autres projets, de ce fait, ne peuvent se réaliser.
30 ans de guerre sur mer avant Lépante
La longue guerre, qui conduira à Lépante, se poursuit sur mer. La flotte turque harcèle sans arrêt les littoraux d’Italie, razziés systématiquement pour le butin et les esclaves. Andrea Doria, à la tête des escadres espagnoles, désormais alliées à Venise, contre-attaque en Mer Égée. Les Turcs s’empressent de riposter : en 1538, ils s’en prennent aux comptoirs vénitiens de l’Égée, qui avaient justifié l’intervention de Doria, pillent et rançonnent la Crète sous domination vénitienne et passent en Mer Ionienne, en face du grand golfe que constitue l’Adriatique, ce bras de mer qui mène directement au cœur de l’Europe centrale.
Le 26 septembre 1538, c’est le choc. La flotte ottomane, commandée par Kheir ed-Din en personne, se heurte à la flotte européenne d’Andrea Doria. Celle-ci dispose de 171 bâtiments de combat, flanqués de 2 bonnes centaines de petites embarcations de transport, destinées à amener 50.000 soldats en Grèce occidentale. Les Européens tentent de débarquer à proximité de Preveza. Le débarquement échoue. La flotte doit se retirer. Une brève bataille navale s’engage avec l’arrière-garde chrétienne, un affrontement où Kheir ed-Din l’emporte, en dépit de son infériorité numérique. Il capture 7 galères. Venise craint pour son commerce. La “Sérénissime” demande la paix : elle s’incline devant le fait accompli, les Turcs dominent presque entièrement le bassin oriental, ils y sont la puissance hégémonique dorénavant inexpugnable. Venise ne conteste plus ce fait et garde seulement la Crète, comme comptoir et base avancée de son commerce.
33 ans plus tard, Lépante sera aussi, aux yeux des Espagnols et des Vénitiens, la revanche pour l’échec de Preveza. Les hostilités se poursuivent dans le bassin occidental : en juin 1540, les Espagnols battent une escadre barbaresque au large de la Corse et capturent son chef Turgut Raïs (ou Dragut), qui sera d’abord condamné à ramer sur la galère de Doria puis sera libéré, moyennant une forte rançon. Un jour, le Grand Maître de l’Ordre de Saint-Jean, Jean de La Valette, lui rend visite sur son banc de chiourme et lui dit, laconiquement, “Usanza de guerra” (Coutume de guerre), sur quoi le Barbaresque enchaîné aurait répondu “Y mudanza de fortuna” (Et changement de fortune). En effet, Jean de La Valette avait lui-même été prisonnier et avait ramé sur une galère barbaresque. En septembre, les pirates algérois pillent Gibraltar et détruisent tous les navires à quai, sans oser s’en prendre à la forteresse, bien défendue. Le 1er octobre, une escadre de 13 bateaux, sous le commandement de Bernardino de Mendoza, se heurte à un parti barbaresque près d’Alboran. Les Espagnols sont vainqueurs, prennent 400 prisonniers et délivrent 700 esclaves chrétiens, mais au prix de lourdes pertes. L’année suivante, c’est le désastre d’Alger : Charles-Quint voulait en finir avec le principal repère de la piraterie nord-africaine et protéger ainsi les littoraux de ses domaines contre les razzias qu’elle ne cessait de perpétrer. Il envoie une flotte de galères pour prendre la ville. Une tempête la détruit : 8.000 hommes sur 25.000 périssent noyés ou sont faits prisonniers et réduits en esclavage.
L’alliance franco-ottomane
Les malheurs de l’empereur ne sont pas terminés. En 1542, François Ier s’allie officiellement aux Ottomans. Pendant 17 ans, la guerre fera rage entre le binôme franco-turc et les autres puissances européennes. Le premier acte de guerre a lieu en mai 1543 : la flotte de Charles Quint quitte Barcelone sous les ordres de l’empereur lui-même, tandis qu’au même moment la flotte turque, commandée par Kheir ed-Din, quitte Modon / Methoni, un port du Péloponnèse. Elle est forte de 110 galères et de 40 bateaux à voiles. Son objectif ? Ravager le bassin occidental, à commencer par Reggio en Calabre. La malheureuse cité n’est pas la seule à recevoir la visite de Barberousse : Terracina, Civitavecchia et Piombino partagent bien vite son sort.
Après avoir mis les côtes italiennes à feu et à sang, Kheir ed-Din cingle vers Marseille pour faire jonction avec la flotte française, dont le capitaine général est le Duc d’Enghien. Ensemble, ils prennent Nice, alors italienne, et la mettent à sac. Les Français accordent aux Turcs et aux Barbaresques le droit de mouiller et de passer l’hiver à Toulon, qui est transformée en une enclave musulmane en terre provençale, une enclave que les Français doivent alimenter et approvisionner en toutes sortes de matériels. Après l’hiver, sur le chemin du retour, les Turcs et les Barbaresques pillent à nouveau les côtes italiennes et ravagent l’île de Lipari : 7.000 Italiens, réduits en esclavage, sont ramenés à Constantinople et y sont vendus au marché.
Pour leur barrer la route, pour verrouiller le bassin occidental, pour éviter toute réédition de la campagne de 1543-44, les Espagnols décident de prendre la place de Mahdia en Tunisie, afin de créer une ligne de défense, à l’entrée du bassin occidental, joignant Mahdia, Malte et la Sicile. De plus, les Chevaliers tiennent toujours Tripoli en Libye. La stratégie des Espagnols et de l’Ordre de Saint-Jean est d’avancer un premier pion dans le bassin oriental, d’y revenir et d’y contre-attaquer. Le 10 septembre 1547, sous les coups d’une batterie flottante, montée sur place, la forteresse tombe aux mains de l’armée de Charles-Quint, ses murailles sont pulvérisées. L’enjeu de la guerre sera désormais la maîtrise de la mer entre la Sicile, la Tunisie et la province libyenne de Tripolitaine.
Mais 1547 est aussi une année-charnière dans l’histoire du XVIe siècle. Kheir ed-Din et Martin Luther meurent en 1546. Henri VIII et François Ier en février et en mars 1547. Le siècle perd ainsi 4 de ses figures emblématiques. De plus, Ferdinand de Habsbourg a été contraint de faire la paix, vu la menace permanente qui pèse désormais sur Vienne, avec les Turcs en Hongrie. Qui pis est, l’Allemagne est déstabilisée par les guerres de religions. Et les troupes françaises peuvent à tout moment attaquer les Pays-Bas ou envahir la Lorraine. Le cœur du continent est disloqué de l’intérieur et fragilisé sur toutes ses frontières extérieures.
Soliman Ier le sait. Son armée permanente est faite pour faire la guerre, sans trêve ni repos. Il la déménage sur la frontière avec la Perse, car les Séfévides au pouvoir là-bas sont, de facto, les alliés de revers de Charles-Quint. Les Espagnols et les Italiens réalisent en ce moment un vaste programme de fortification des côtes, dressant partout des réseaux de tours de guet et de tours de signalisation permettant de repérer les corsaires barbaresques avant qu’ils ne débarquent et de faire donner des troupes mobiles, capables de les refouler. Les espions de Soliman Ier le renseignent ; il sait dès lors que le danger n’est pas imminent en Méditerranée. Ce qui lui permet de ramener sa flotte de la Mer Rouge au foyer, afin d’attaquer les Portugais dans l’Océan Indien.
Ressac corsaire en Méditerranée, banqueroute espagnole, chaos au Maghreb et guerre dans la Corne de l’Afrique
Mais la paix demeure précaire dans la zone maritime entre la Tunisie et la Sicile. Dragut, qui remplace Kheir ed-Din décédé, prend Tripoli et en chasse les Chevaliers en août 1551. L’élément le plus avancé de la ligne de défense des Espagnols et des Chevaliers est perdu. Cette perte est toutefois compensée par l’efficacité du nouveau système de défense des côtes : “l’âge d’or des corsaires barbaresques touche à sa fin, écrit Barnaby Rogerson, car les défenses côtières espagnoles fonctionnaient toujours plus efficacement”. Le butin raflé lors des raids s’amenuise. Seules victoires franco-ottomanes : l’invasion de la Corse en 1554 et 1555, après qu’elle ait été reprise par les troupes de Gênes. Dans la région de Bastia, 6.000 captifs sont amenés en esclavage. Les défenses côtières de la Corse sont partiellement détruites pour faciliter une prochaine invasion française. Cependant, force est de constater que les campagnes de Dragut n’apportent pas grand chose en matière de gains territoriaux à l’empire ottoman, sauf, sans nul doute, la prise de Bougie en 1555, l’année où Charles-Quint abdique à Bruxelles en faveur de son fils Philippe II.
En 1557, l’Espagne, épuisée par une guerre sur plusieurs fronts, doit se déclarer en état de banqueroute. Charles Quint, pour financer ses guerres et malgré l’apport du trésor des Incas, envoyé par Pizzaro pour permettre la prise de Tunis en 1535, a accumulé une dette colossale : 20 millions de ducats ! L’empereur ne peut même plus payer les intérêts de cette créance. Mais les banquiers lui font quand même confiance ! Ils savent que les lingots d’argent vont arriver du Pérou et en quantité suffisante. En Afrique du Nord, la bonne fortune de l’Espagne vient de la désunion entre musulmans : en Algérie, les tribus de l’intérieur supportent mal le pouvoir du commandant des janissaires, Hasan Qusru. Elles recevront l’appui d’une nouvelle dynastie marocaine qui conteste aux Ottomans le droit d’administrer l’Afrique du Nord. Elle apporte son soutien à l’ancienne dynastie zayyanide, exclue du pouvoir par les Turcs. Ses adversaires marocains, les représentants de l’ancienne dynastie évincée des Wattasides, eux, cherchent la protection ottomane. Ces dissensions permettent aux Espagnols de se maintenir à Oran, tout en soutenant les Saad chérifains du Maroc. Mais ils ne font que se maintenir : ils ne progressent pas vers l’intérieur du pays.
Dans l’Océan Indien, l’amiral et cartographe ottoman Piri Raïs attaque les Portugais à Ormuz, prend la ville mais non la forteresse. C’est l’échec et Soliman Ier, aigri, fait exécuter cet excellent stratège, géopolitologue et tacticien, mais donne tout de même l’ordre de réaliser les directives qu’il avait données, avant de périr ignominieusement par la main de son maître ingrat : créer une flotte pour le Golfe Persique et défendre les côtes de la Mer Rouge. Pour suivre les instructions de Piri Raïs, l’Oumma attaque ainsi l’Ethiopie copte au départ de la base de Suez. Les Portugais aident l’empereur d’Abyssinie à lutter contre les tribus des Afars et des Somalis, converties à l’islam. Un chef de guerre, Ahmad Gragn, s’était rendu maître de Harare et c’est au départ de cette base maritime somalienne qu’il harcèlera cruellement les Abyssins. Un chroniqueur, cité par Rogerson, a décrit le sort tragique de l’Abyssinie copte :
« En chaque lieu où ils triomphèrent, ils ne laissèrent que destructions et ravages, transformèrent le pays en désert. Ils emportèrent des églises les calices d’argent et d’or, les précieux tissus d’Inde, ornés de pierres précieuses... et puis mirent le feu aux édifices, avant de jeter bas leurs murs sur le sol. Ils massacrèrent tous les chrétiens adultes qu’ils trouvèrent sur leur chemin et emportèrent les jeunes gens et les jeunes filles pour les vendre comme esclaves... Neuf hommes sur dix renièrent le christianisme et se convertirent à l’islam. Une terrible famine s’abattit sur le pays ».
En 1541, un fils de Vasco de Gama arrive avec une garnison portugaise pour épauler les Abyssins. Le gouverneur ottoman du Yémen envoie 900 janissaires de sa garnison pour aider Ahmad Gragn. Le choc tourne au désastre pour les Portugais et les Abyssins. La tête de Vasco de Gama, plantée sur une javeline, est envoyée au Yémen en guise de trophée. Mais les Portugais et les Abyssins se vengeront : le 21 février 1543, un nouveau corps expéditionnaire portugais, arrivé quelques mois plus tôt en Abyssinie en provenance des comptoirs lusitaniens d’Afrique orientale, affronte les bandes d’Ahmad Gragn, qui tombe au combat, frappé en pleine poitrine par la balle d’un arquebusier portugais. Il faudra une campagne de 3 ans pour bouter les tribus afars et somalies hors de l’Abyssinie copte, dévastée de fond en comble. Celle-ci retrouve son indépendance et entame immédiatement sa reconstruction. Elle n’aura jamais la force, malgré une présence portugaise constante pendant un siècle, de reconquérir les côtes somaliennes.
La situation actuelle dans la Corne de l’Afrique, avec la piraterie somalienne et le conflit larvé de la Somalie avec l’Ethiopie, présente d’étonnantes similitudes avec celle du XVIe siècle. N’oublions pas que le destin de l’Europe s’est également joué dans cette lointaine Corne de l’Afrique, que les opérations menées dans cette région au XVIe siècle ont exigé des Ottomans qu’ils y envoient des forces qui ont manqué en Méditerranée et que la présence portugaise dans l’Océan Indien, solidement implantée, a continuellement fragilisé le flanc sud de la masse territoriale ottomane dans la péninsule arabique et permis à l’Europe de contrôler entièrement, sans rivaux, les voies de communications avec l’Inde et la Chine, tout en explorant le Pacifique, afin de le préparer, à son tour, à son “européanisation”.
Le désastre chrétien de Djerba (1560)
En 1559, un an après la mort de Charles-Quint, dans sa retraite de Yuste en Castille, la Paix de Cateau-Cambrésis met en terme à la guerre contre la France, que les troupes espagnoles, “tercios” irlandais, castillans, allemands et wallons confondus avaient durement étrillée en Picardie. Mais la France s’est rendue maîtresse de la Lorraine, de la place de Metz en particulier, et des Trois Évêchés depuis 1552 ; elle tient donc les Pays-Bas, le Luxembourg et le Palatinat à sa merci. La guerre, si elle se poursuit, risque d’être interminable, de ruiner tous ses protagonistes. Les 2 camps décident donc de signer la paix. La guerre contre les Turcs et les Barbaresques, elle, se poursuit. En 1560, les Espagnols veulent reconquérir Tripoli en Libye. Le Duc de Medinaceli s’y prépare activement dans les ports de Sicile. Les troupes appelées à débarquer sont sous le commandement du général Alvaro de Sande et la flotte sous celle du petit-neveu d’Andrea Doria, Gianandrea, âgé de 20 ans seulement. Son grand-oncle, toujours de la partie, l’épaule avec la flotte génoise. Napolitains, Chevaliers de Malte, Siciliens et marins du Pape se joignent à l’expédition, qui compte 50 galères et soixante navires à voiles. L’objectif premier, avant la reconquête de Tripoli, est de prendre Djerba, pour compléter le dispositif de défense et de quadrillage de la Petite Syrte. L’île est prise sans grande difficulté. L’Europe chrétienne dispose donc d’une base insulaire supplémentaire, mais cet atout ne sera conservé que très brièvement.
Alerté, Piali Pacha, nouveau commandant de la flotte ottomane, arrive le 11 mai 1560 devant Djerba avec 100 galères. C’est la panique chez les chrétiens, qui ne s’attendaient pas à une réaction aussi rapide et à un tel déploiement de force. Ils reculent en désordre et Piali Pacha leur prend 27 galères et 20 voiliers. Il fait débarquer ses troupes, met le siège devant la place forte espagnole, qui tombe au bout de 2 mois. 18.000 hommes sont tués ou prisonniers. C’est une victoire turque retentissante, qui empêche la reprise de Tripoli et le contrôle de la Tripolitaine, un territoire situé à mi-chemin entre le Maghreb et l’Égypte. L’Europe a perdu la maîtrise de la Petite Syrte. C’est un ressac stratégique important. Entre la victoire ottomane de Djerba et la victoire chrétienne de Lépante, la puissance ottomane aura atteint son zénith en Méditerranée, avec la prise de Djerba et la non reconquête de Tripoli.
Piali Pacha, enfant trouvé en Serbie et enrôlé dans le janissariat ottoman, va vite exploiter sa victoire. Il attaque en Mer Tyrrhénienne. Il capture force galères siciliennes. En mai 1563, le vice-roi Hassan Qusru d’Alger attaque la garnison espagnole d’Oran, tandis que Dragut bloque la ville par la mer avec une petite flotte barbaresque. Francisco de Mendoza vient sauver les assiégés avec 34 galères, avant l’arrivée des renforts turcs. Les Barbaresques sont vaincus au large de Mers-El-Kébir. En septembre 1564, Garcia de Toledo conquiert avec 100 navires et 16.000 fantassins le Penon de Velez de Gomera, qui est toujours, aujourd’hui, territoire sous souveraineté espagnole, malgré l’hostilité marocaine à toute présence européenne sur les rivages de la Méditerranée nord-africaine. On se souviendra de l’affaire de l’Ile du Persil (Perejil), en juillet 2002, où une section de gendarmes marocains avaient délibérément envahi l’îlot, qui fait également partie intégrante du territoire espagnol. L’Espagne l’avait repris quelques jours plus tard. Les guerres du XVIe siècle ne sont donc pas terminées... Elles sont suceptibles de réémerger à tout moment.
Le siège de Metz
Au cours des 2 décennies suivantes, disons de 1540 à 1564, l’Espagne, principale puissance méditerranéenne capable de faire face aux Barbaresques et aux Turcs, connait aussi une histoire mouvementée. En 1547, son roi, l’empereur germanique Charles-Quint, bat à Mühlberg les protestants de la Ligue de Smalkalde, qui fragilisaient ses arrières et favorisaient par leur sédition le maintien de la présence ottomane en Hongrie et les menées de François Ier et de Henri II, qui venait de prendre sa succession, en Lorraine et aux Pays-Bas. La Paix d’Augsbourg, qui s’ensuit, ne satisfait personne. Henri II en profite pour occuper les Trois Evêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, 3 positions clefs en direction du Rhin qui, en passant entre ses mains, disloquent totalement le Duché de Lorraine, démembrent ses frontières et compliquent ses communications internes. Les Impériaux ne parviennent pas à reprendre Metz, en dépit du ralliement des protestants à Charles Quint, qui, en tant qu’Allemands, ne peuvent accepter la présence française à Metz, une présence qui menace directement le Luxembourg, l’Alsace et la Rhénanie.
Le commandant des troupes impériales allemandes, qui se présentent devant Metz, le 19 octobre 1552, est un Espagnol, le fameux Duc d’Albe. Pour l’appuyer, il y a l’armée des Pays-Bas, accourue des places-fortes de Namur et de Luxembourg, à l’initiative de la Régente Marie de Hongrie. À ces 2 colonnes s’ajoute celle d’un gentilhomme à moitié brigand, qui tente d’abord de se vendre au plus offrant, le Marquis Albert de Brandebourg. Il finit par se soumettre à Charles Quint. La place de Metz est tenue par le Duc de Guise. Elle est quasi imprenable et l’empereur n’a plus assez d’argent pour payer ses soldats et a fortiori pour en recruter d’autres. L’hiver arrive et les épidémies se répandent dans le camp impérial, qui se mue en un cloaque immonde où pourrissent cadavres d’hommes et de chevaux. Il faut lever le siège. Metz est perdue pour le Saint-Empire.
Union anglo-espagnole et guerre en Picardie
En 1554, l’héritier de la couronne d’Espagne et du Cercle de Bourgogne (les Pays-Bas), Philippe II, épouse Mary Tudor, Reine d’Angleterre. Ce mariage fusionnera, on l’oublie trop souvent, l’Angleterre et l’Espagne en un bloc. Mary Tudor, fille d’Henri VIII et de Catherine d’Aragon, s’emploiera à re-catholiciser l’Angleterre et, ainsi, à la resouder au continent. La réaction anti-protestante, qu’elle déclenche, est brutale : les partis anglican et protestant, qui parleront dorénavant d’elle en la surnommant avec horreur et mépris “Mary la Sanglante”, subissent une répression féroce, assortie de quelques 300 exécutions capitales. Pendant 4 ans donc, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Espagne, le Milanais et le Royaume de Naples et des Deux-Siciles connaîtront une direction unique, celle de Philippe II, allié aux Habsbourgs d’Autriche, qui détiennent la titulature impériale. Les troupes anglaises de Mary Tudor appuient les forces impériales et espagnoles en Picardie contre Henri II, qui a, face à lui, un capitaine exceptionnel, Emmanuel-Philibert de Savoie.
Celui-ci écrase l’armée française à La Fère, mais sans prendre immédiatement Saint Quentin. La route de Paris est toutefois ouverte. Mais Philippe II temporise, surtout parce que l’espace entre les régions de Flandre et de Hainaut, provinces densément peuplées, et Paris est bien plus vide, doté de bien moins de réserves confiscables, pour nourrir l’armée en campagne. Les routes sont longues et les approvisionnements ne se font pas à temps. Le siège de Saint Quentin, lui aussi, dure trop longtemps. Henri II peut en profiter pour reconstituer son armée, avec des mercenaires suisses, et aussi en rameutant le ban et l’arrière-ban de la noblesse et en ramenant toute une armée d’Italie. Paris, où la panique avait régné, respire. Le Duc Philibert prend encore Noyon, mais, face à lui, la nouvelle armée de Henri II s’approche, forte de 50.000 hommes. Paris est sauvé. Et Philippe II n’a plus d’argent, l’Espagne est en état de faillite. Henri II peut reprendre l’offensive et s’emparer de Calais, qu’il arrache à Mary Tudor, dès le 7 janvier 1558. L’Angleterre perd définitivement ce port sur la rive continentale de la Mer du Nord, auquel elle tenait beaucoup.
Le 21 septembre 1558, Charles Quint meurt à Yuste. Sa belle-fille Mary Tudor le suit de près, elle s’éteint le 17 novembre. Les conséquences de cette mort prématurée sont catastrophiques pour l’Espagne, les Pays-Bas, le Saint-Empire et, finalement, l’Europe entière. L’unification européenne, presque achevée, s’effrite et perd les Iles Britanniques. La France va survivre. L’empire ottoman va continuer encore longtemps à régner sur la péninsule balkanique et la Hongrie, à dominer la Méditerranée, et, évidence plus funeste encore, la piraterie barbaresque ne sera pas éradiquée avant le débarquement des troupes françaises en 1830, sous le commandement du Maréchal de Bourmont. La fin du binôme anglo-espagnol est l’une des pires catastrophes de l’histoire européenne ; en effet, imaginons la présence de marins anglais sous une direction commune européenne en Méditerranée occidentale, imaginons le débarquement de “tercios” irlandais, anglais et écossais en Oranie pour appuyer leurs homologues castillans, galiciens et aragonais. La bataille de Lépante n’aurait peut-être pas eu lieu, parce que le problème turc aurait été réglé plus tôt, et Chypre ne serait pas tombée aux mains des Ottomans.
Anarchie dans les Pays-Bas et révolte des Alpujarras
Le Traité de Cateau-Cambrésis, signé le 3 avril 1559, laisse les Trois Evêchés à la France, qui, en revanche, doit rendre aux Lorrains et aux Espagnols (aux Luxembourgeois) Thionville (Diedenhofen), Montmédy et Danvilliers. Philippe II épouse en troisièmes noces Isabelle de Valois, fille de Henri II. La sœur du Roi de France, elle, épouse Emmanuel-Philibert de Savoie. La paix est signée et une nouvelle période de paix s’ouvre, scellée par une alliance dynastique. Philippe II n’est toutefois pas au bout de ses peines. En 1566, les iconoclastes, des fondamentalistes protestants hostiles aux cultes des saints et de la Vierge, ravagent la Flandre et le Hainaut, brisant toutes les œuvres d’art religieuses qui leur tombent sous la main. Les Pays-Bas sont livrés au désordre, à une anarchie semée par des fanatiques religieux intraitables, ne respectant aucune convention, aucune tradition dans un pays plutôt iconodule.
Il faut envoyer une armée aux Pays-Bas, sous le commandement du Duc d’Albe, qui se heurtera à un sentiment local de liberté, surtout dans une noblesse habituée aux fastes de l’ancienne cour de Bourgogne, appréciés par Charles Quint, et assez rétive à l’austérité espagnole, chère à Philippe II. Liquider les “casseurs” de 1566, oui, mais attenter aux libertés traditionnelles en introduisant une inquisition aussi rigoureuse qu’en péninsule ibérique, non. Cette mécompréhension mutuelle et cette confusion n’arrangent pas les choses ; le pouvoir de Philippe II, incarné par l’ecclésiastique franc-comtois Granvelle, vacille dans les Pays-Bas. Philippe II perd la confiance d’une noblesse qui, pourtant, avait suivi fidèlement Charles Quint dans toutes ses aventures. Le roi d’Espagne craint aussi la contagion huguenote en Catalogne. Il s’affolle et demande à l’Inquisition de donner encore un tour de vis. Pire pour le royaume d’Espagne, la piraterie anglaise infeste le Golfe de Gascogne au risque de couper durablement les communications entre la Galice et les Flandres.
Le 1er janvier 1567, en Espagne même, Philippe II fait appliquer les mesures qu’il a décidées en novembre 1566, en l’occurrence : interdiction aux Morisques d’Espagne d’user de la langue arabe et de se vêtir à la façon mauresque. Philippe II veut l’unité religieuse de son royaume, l’unité des mœurs et des coutumes, et surtout craint la présence d’une “cinquième colonne” potentielle en cas de débarquement turc ou barbaresque. Un complot musulman avait été éventé en 1565 : en cas de victoire ottomane à Malte, les musulmans d’Andalousie devaient amorcer une révolte pour favoriser un débarquement et jeter les bases d’une reconquête de la péninsule ibérique. La nuit de Noël 1568, une bande de hors-la-loi musulmans, sous la direction d’un certain Farax Abenfarax, fait irruption dans la ville de Grenade et annonce que les Alpujarras, dans le pays de Grenade, dans les montagnes et les hautes vallées, sont entrés en rébellion. L’insurrection musulmane va durer 2 ans en Andalousie et répéter une révolte antérieure, qui avait eu lieu en 1499. Les Turcs ne l’exploiteront pas, surtout parce que les révoltés ne tiennent aucun port et luttent dans les montagnes, inaccessibles depuis la mer. Finalement ce sera Don Juan d’Autriche, demi-frère du roi, le futur vainqueur de Lépante, qui matera définitivement la révolte : les Morisques d’Andalousie seront dispersés dans toute la péninsule, pour éviter qu’une trop grande concentration de musulmans constitue un danger permanent dans une province exposée à l’invasion. Nous sommes à l’automne 1570, un peu moins d’un an avant Lépante.
L’échec ottoman devant Malte (1565)
La guerre sur mer, elle, connaît pendant la période de paix, suite au traité de Cateau-Cambrésis, un événement majeur : l’échec ottoman devant Malte de mai à septembre 1565. Si, au début de son règne, Soliman Ier devait prendre Rhodes pour s’assurer le contrôle complet du bassin oriental et pour couvrir les conquêtes syriennes et égyptiennes de son prédécesseur, il doit, plus de 40 ans plus tard, en toute bonne logique, déloger les Chevaliers de leur nouvelle position, Malte. Au départ de l’île, en effet, les Chevaliers ne cessent de perpétrer des incursions en Égée. À 2 reprises, le Chevalier Romegas attaque le delta du Nil. Par ses espions, le Sultan apprend que Philippe II investit une bonne part du trésor espagnol dans les chantiers navals de Barcelone, de Gênes et de Messine.
Il faut agir avant que cette nouvelle flotte espagnole soit opérationnelle. Et il faut prendre Malte comme Piali Pacha a pris Djerba 5 ans plus tôt. L’empire ottoman sera alors maître de la Méditerranée centrale et pourra passer, avec les Barbaresques, à l’offensive dans le bassin occidental. La flotte ottomane quitte ses bases vers la mi-avril 1565 et arrive à Malte le 18 mai. Piali Pacha commande la flotte et Mustafa Pacha les troupes terrestres qui vont débarquer. Dans les forts de l’île, 700 Chevaliers, 4000 fantassins et cavaliers maltais et un bon nombre de gentilhommes volontaires et de mercenaires sont prêts à recevoir les envahisseurs. Les Français sont les plus déterminés car ils veulent rendre à leur pays son honneur, perdu, estiment-ils, à la suite de l’alliance franco-ottomane qui est une trahison envers l’esprit de croisade qu’ils ont toujours incarné.
Philippe II hésite à s’engager, justement, parce que les Chevaliers sont français pour la plupart, et il doute de leur fiabilité : le XVIe siècle fait émerger les premiers réflexes particularistes et nationalistes et disparaître l’esprit européen et croisé, multinational dans son essence. De plus, les Chevaliers ont fait allégeance au pape et, celui-ci, Pie IV, est farouchement hostile à l’Espagne, parce qu’il veut une Italie débarrassée de toute présence étrangère. On a beaucoup épilogué sur le comportement de Philippe II : a-t-il délibérément “trainé les pieds” ou a-t-il espéré garder Malte pour lui, de peur que des Chevaliers français la remettent un jour aux mains de son ennemi le roi de France ? Ou, plus simplement, n’avait-il plus assez d’argent pour envoyer des secours, ayant misé tout sur ses chantiers navals ?
Malte était défendue par 2 forts, le Fort Saint-Elme et le Fort Saint-Ange. Les Ottomans vont d’abord concentrer leurs attaques et leurs bombardements sur le Fort Saint-Elme, qui encaissera le choc le plus violent. La garnison tiendra longtemps. Elle recevra même le renfort de 42 Chevaliers allemands, accompagnés de 600 fantassins. Le 21 juin, les canons maltais tirent une salve qui emporte Dragut (Turgut) Pacha. Sa succession est prise par Ouloudj Ali, Italien converti à l’islam, qui s’illustrera 6 ans plus tard à Lépante. Avant de mourir, Dragut avait hermétisé l’encerclement du Fort Saint-Elme. Ni renforts ni vivres ni munitions ne peuvent plus venir en aide à la garnison.
Après un premier assaut ottoman, repoussé in extremis, “il n’y avait plus un seul homme qui ne soit pas couvert de son propre sang et de celui de l’ennemi et plus aucun n’avait encore de munitions”. Saint-Elme va tomber : tous les Chevaliers pris prisonniers, à l’exception de 9 d’entre eux, seront égorgés, leurs corps dénudés, démembrés, on leur coupera les mains, la tête et les parties génitales, ensuite on entaillera leurs torses d’un motif cruciforme et on clouera leurs troncs sur des croix de bois que les Ottomans lanceront à la mer pour que les oiseaux charognards s’en repaissent.
Outré, Jean de la Valette ordonne des représailles : tous les prisonniers musulmans sont amenés au sommet des donjons, décapités et jetés bas les murailles. Leurs têtes sont catapultées dans le camp ottoman. Dans la forteresse Saint-Ange règne une hygiène rigoureuse, inspirée de la tradition hospitalière. La garnison ne connaît pas d’épidémies. Dans le camp turc en revanche, les cadavres ne peuvent être enterrés profondément, la terre maltaise étant trop chiche. Les Chevaliers disposent de citernes d’eau douce abondante. L’approvisionnement en eau est problématique pour les Ottomans, pourtant habitués, eux aussi, à une grande hygiène. La maladie se répand au plus fort de l’été dans les campements des soldats turcs. Barnaby Rogerson écrit :
« Vers la moitié de l’été, les corps en putréfaction, à demi-enterrés dans les tranchées ou ensevelis sous les décombres des murailles ou dans les tranchées bombardées, ajoutent l’élément complémentaire qui répandra la maladie. Un déserteur ottoman apprend aux défenseurs que les blessures des soldats turcs ne guérissent pas, que la maladie régnait dans le camp et qu’ils ne recevaient qu’une ration de biscuit de 10 onces par jour ».
Les Turcs tentent un assaut général le 7 août : il est repoussé et la cavalerie maltaise opère une vigoureuse sortie qui sème le désordre dans le camp ottoman. Le siège va encore durer 30 jours. Mais la famine et la maladie minent le moral des Turcs, qui craignent de voir débouler la flotte espagnole, qui, effectivement, est en Sicile, avec autant de bâtiments que compte la flotte de Piali Pacha. Une tempête retarde les Espagnols. Le 5 septembre 1565, 5.000 hommes débarquent à Malte pour soulager les assiégés. Les Turcs se retirent en bon ordre. La dernière galère ottomane quitte Malte le 12 septembre. Un tiers des Chevaliers ont été tués, tous les autres avaient été blessés. Jean de la Valette avait 9.000 hommes sous ses ordres au début du siège : quand les Ottomans abandonnent la partie, il n’en a plus que 900.
Débarquement turc à Chypre et chute de Nicosie
Soliman Ier meurt en 1566 : il laisse à son héritier un empire ottoman qui s’est transformé au fil des décennies en une machine qui fonctionne à la perfection et qui s’étend sur 2.500.000 km2. Selim II, dit Selim le Sot vu sa propension pour la dive bouteille, prend sa succession. Mais Sélim II n’est pas aussi “sot” que veulent bien le croire ses adversaires. Pendant les 8 années où il exercera le pouvoir, il défendra bien les positions de l’empire ottoman, même si c’est sous son règne que les Turcs perdent la bataille de Lépante. Les Turcs n’ont pas pris Malte mais ils vont, dès 1567, arrondir leurs possessions en Égée : ils prennent Naxos. Le commandant général de la flotte espagnole de la Méditerranée, Garcia de Toledo, cède sa place à Don Juan d’Autriche, encore occupé à mater la révolte des Alpujarras en Andalousie. Les événements qui vont immédiatement précéder Lépante se mettent en place : nous savons que l’île de Djerba est tombée en 1560, que Malte a failli être enlevée aux Chevaliers en 1565 ; en 1570, Ouloudj Ali reprend Tunis mais est contraint de laisser la forteresse de La Goulette aux Espagnols.
En février 1570, un ambassadeur turc arrive à Venise et demande la rétrocession de Chypre. Sélim II croit qu’un incendie a ravagé de fond en comble l’arsenal de Venise et que la ville marchande n’a plus de flotte pour défendre ses possessions. En réalité, l’incendie n’a détruit que 4 galères. Délibérément les Ottomans provoquent les Vénitiens : l’ambassadeur de Venise s’entend dire par le vizir Sököllü que “Chypre appartient historiquement à l’empire ottoman”. Les marchands vénitiens sont arrêtés à Istanbul et les embarcations vénitiennes saisies. Le 1er juillet 1570, la flotte de Piali Pacha débarque les troupes ottomanes, fortes de 52.000 hommes, sur la côte méridionale de Chypre. Ils commencent la conquête de l’île.
Nicosie tombe le 9 septembre 1570. Ses murailles étaient trop anciennes, n’avaient pas pu résister à un bombardement d’artillerie. La garnison, commandée par Niccolo Dandolo, était mal équipée et mal entraînée ; les soldats n’avaient reçu aucune instruction pour manier les 1.040 arquebuses que Venise avait livrées. Dandolo était un chef timoré, qui a sans doute raté quelques bonnes occasions d’étriller l’armée turque, mais, malgré les lacunes qu’on a pu lui reprocher, il tient 45 jours devant les soldats de Lala Mustafa et repousse 14 assauts d’envergure. Au moment de la reddition, habillé de velours rouge pour recevoir dignement le vainqueur, Dandolo a la tête tranchée par un Turc, avant d’avoir pu prononcer un mot. “Massacres, écartèlements, empalements, profanations d’église et viols d’adolescents des deux sexes”, s’ensuit, écrit l’historien anglais Julius J. Norwich. La flotte de secours, qui cingle vers Chypre, apprend la chute de Nicosie et hésite à entrer en action.
La chute de Famagouste et le sort épouvantable de Marcantonio Bragadin
[Situation en mer ionienne en 1571. Les territoires en rouge sont des possessions vénitiennes]
 Lala Mustafa ne perd pas de temps : le 11 septembre, il envoie aux défenseurs de Famagouste un ultimatum leur ordonnant de se rendre sans tergiverser et, pour appuyer son ordre, joint la tête tranchée du malheureux Dandolo. Malgré leur supériorité en nombre et en matériel, les Turcs avaient buté pendant 45 jours contre une cité mal défendue. Famagouste, au contraire, est une ville correctement fortifiée et commandée par 2 officiers de belle prestance : Marcantonio Bragadin et Astorre Baglioni de Pérouse (Perugia). Le siège sera long : il va durer du 17 septembre 1570 au 5 août 1571.
Lala Mustafa ne perd pas de temps : le 11 septembre, il envoie aux défenseurs de Famagouste un ultimatum leur ordonnant de se rendre sans tergiverser et, pour appuyer son ordre, joint la tête tranchée du malheureux Dandolo. Malgré leur supériorité en nombre et en matériel, les Turcs avaient buté pendant 45 jours contre une cité mal défendue. Famagouste, au contraire, est une ville correctement fortifiée et commandée par 2 officiers de belle prestance : Marcantonio Bragadin et Astorre Baglioni de Pérouse (Perugia). Le siège sera long : il va durer du 17 septembre 1570 au 5 août 1571. Les assiégés, peu nombreux mais bien entraînés, feront de nombreuses sorties, menant bataille jusqu’au centre même du camp de Lala Mustafa. Ce dernier fait appel à des sapeurs arméniens pour creuser des sapes sous les murailles de Famagouste. Un impressionnant réseau de tranchées entoure la ville. 10 tours de siège canardent les défenseurs de haut. En juillet, tous les animaux de la ville ont été mangés : il ne reste aux assiégés que du pain et des fayots. Des 8.000 hommes de la garnison, il n’y en a plus que 500 de valides et ils tombent de sommeil et d’épuisement. Il faut se rendre. Les 2 commandants font hisser le drapeau blanc sur les remparts.
Lala Mustafa, écrit J. J. Norwich, fait une offre très chevaleresque : tous les Italiens pourront rembarquer, et tous les autres habitants, quelle que soit leur nationalité, pourront les accompagner. Le document porte la signature de Lala Mustafa et le sceau du sultan. En outre, Lala Mustafa complimente ses adversaires pour leur courage et leur ingéniosité à défendre leur ville. Bragadin et Baglioni se rendent alors, en grande pompe, dans le camp de Lala Mustafa pour lui remettre solennellement les clefs de la cité vaincue. Dans un premier temps, il reçoit la délégation avec courtoisie puis, soudain, change d’attitude, injurie de la manière la plus obscène ses interlocuteurs, sort un coutelas et tranche une oreille de Bragadin, tout en ordonnant à l’un de ses assistants de lui couper l’autre oreille et le nez. Les gardes, eux, reçoivent l’ordre d’exécuter immédiatement tous les membres de la délégation. Baglioni est décapité ainsi que le capitaine des artilleurs vénitiens, Luigi Martinengo. Près de 350 têtes seront ainsi empilées devant la tente du pacha, furieux, en fait, d’avoir perdu près de 50.000 hommes dans l’aventure.
Bragadin est emprisonné, ses plaies, non soignées, deviennent purulentes. Il est dans un état de faiblesse épouvantable. Les Turcs l’extraient de sa prison, le chargent de sacs de pierres ou de terre et le promènent, ainsi chargé, autour des murs de la ville. On le hisse ensuite, ligoté sur une chaise, au mât du navire amiral turc, pour l’exposer aux moqueries des marins, qui lui lancent : “Vois-tu, chien, ta flotte de chrétiens approcher ?”. Sur une place de Famagouste, on l’attache à une colonne et le bourreau commence à l’écorcher vif. Bragadin meurt quand l’exécuteur lui entame la taille. Son cadavre est décapité, puis écartelé. On emplit sa peau de paille et de coton, on hisse ce sinistre mannequin sur une vache et on le promène dans les rues.
Quand Lala Mustafa retourne à Istanbul, il emporte avec lui les têtes de ses principaux adversaires et le mannequin confectionné avec la peau de Bragadin : il exhibe ces trophées à son sultan. Le sort de Marcantonio Bragadin crie vengeance. Pie V avait appelé Espagnols et Vénitiens à la réconciliation : déjà, en juillet 1570, pendant le siège de Nicosie, le projet d’une nouvelle “Sainte Ligue” est soumis et aux doges et à Philippe II. Le 25 mai 1571, sa constitution est officiellement proclamée sous les voûtes de Saint-Pierre à Rome. Cette Ligue devait être perpétuelle, offensive aussi bien que défensive et dirigée contre l’empire ottoman et ses vassaux nord-africains.
La Sainte-Ligue et la bataille de Lépante
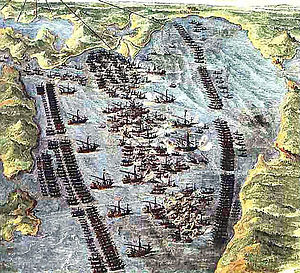 Après avoir quitté Chypre, les Turcs cinglent vers la Mer Ionienne et l’Adriatique ; ils débarquent à Corfou et sur les côtes dalmates. Ils pensent que rien ne les arrêtera et qu’ils seront bientôt à Venise même. La flotte de la Sainte-Ligue, dont ils avaient sous-estimé l’ampleur, s’est rassemblée à Messine en août. Son centre est commandé par Don Juan d’Autriche, demi-frère de Philippe II, par le Vénitien Venier et le Romain Colonna, amiral de la flotte papale. L’aile droite est sous les ordres de Doria. L’aile gauche sous les ordres du Vénitien Augustino Barbarigo. 2 petites escadres, servant d’avant-garde et d’arrière-garde, sont sous le commandement de Don Juan de Cardona et du Marquis de Santa Cruz. En apprenant que cette formidable armada s’approche de leurs positions, les Turcs se réfugient dans leurs bases grecques. Les Européens ont réellement envie d’en découdre. Ils viennent d’apprendre le sort de Bragadin et veulent à tout prix le venger.
Après avoir quitté Chypre, les Turcs cinglent vers la Mer Ionienne et l’Adriatique ; ils débarquent à Corfou et sur les côtes dalmates. Ils pensent que rien ne les arrêtera et qu’ils seront bientôt à Venise même. La flotte de la Sainte-Ligue, dont ils avaient sous-estimé l’ampleur, s’est rassemblée à Messine en août. Son centre est commandé par Don Juan d’Autriche, demi-frère de Philippe II, par le Vénitien Venier et le Romain Colonna, amiral de la flotte papale. L’aile droite est sous les ordres de Doria. L’aile gauche sous les ordres du Vénitien Augustino Barbarigo. 2 petites escadres, servant d’avant-garde et d’arrière-garde, sont sous le commandement de Don Juan de Cardona et du Marquis de Santa Cruz. En apprenant que cette formidable armada s’approche de leurs positions, les Turcs se réfugient dans leurs bases grecques. Les Européens ont réellement envie d’en découdre. Ils viennent d’apprendre le sort de Bragadin et veulent à tout prix le venger. Les 2 flottes se rencontrent à l’aube du 7 octobre, à l’entrée du Golfe de Patras. La Sainte-Ligue aligne 206 galères ; chacune d’elle transporte de 200 à 400 hommes, dont 100 soldats. Sur la proue de chaque galère, on a installé une plateforme avec 5, 6 ou 7 canons. Les Vénitiens alignent en plus 6 galéasses, de grosses galères de 6 mâts, portant une cinquantaine de canons. La flotte turque, elle, dispose de 220 galères, portant peu de canons. Les Ottomans n’ont pas de galéasses : ils ignorent l’existence de cette arme, inspiré par la grande caraque “Sant’Anna” de l’Ordre de Saint-Jean. Comme convenu à Messine en août, Don Juan dispose sa flotte en 3 parties : le centre, qu’il commande lui-même, une aile gauche et une aile droite. Devant chacune de ces formations, Don Juan fait placer 2 galéasses. Les Turcs optent pour une dispositif similaire.
Leur centre est constitué de 90 galères dirigées par Ali Pacha, grand amiral ottoman. L’aile gauche est commandée par Ouloudj Ali, le rénégat calabrais, et composée pour l’essentiel de galères algéroises, également 90 en tout. L’aile droite est sous les ordres de Mohammed Scirocco et aligne 60 galères. Les effectifs embarqués de la Sainte-Ligue s’élèvent à 80.000 hommes, dont 40.000 rameurs, condamnés ou volontaires, mais quasiment tous chrétiens. Les effectifs ottomans sont du même ordre, mais les galériens sont des chrétiens réduits à l’esclavage. Le temps est beau, la tempête des jours précédents s’est apaisée. “Assez de paroles, le temps des conseils est passé : ne vous préoccupez plus que de combattre”, réplique Don Juan à ceux qui veulent encore délibérer, avant la bataille, au sein d’une alliance somme toute fragile. Les soldats l’acclament, il inspire l’enthousiasme et l’obéissance. Sur le plan moral, il a déjà gagné.
Le feu irrésistible des galéasses des frères Bragadin
[Ci-dessous : La galiace, emprunté de l'italien galeazza (XVe s.). Type de galère lourde, munie d'une importante artillerie, en usage aux XVIe et XVIIe siècles, qui n'existait que chez les Vénitiens et les Turcs, et que ceux-ci appelaient mahonne. Elle devait rassembler sur un même bâtiment les qualités des galions (robustesse, tonnage, autonomie, artillerie) et des galères (manœuvrabilité, indépendance par rapport au vent), mais elle était en fait presque incapable de manœuvrer. Équipée d'un pont qui recouvrait les rameurs, elle portait une puissante artillerie qui la rendait redoutable au combat. Ce sont ces navires qui ont contribué à la victoire des Vénitiens à Lépante. Les Espagnols tentèrent de l'alléger en construisant la galizabra, que l'on continua d'appeler ailleurs galéasse. Une division de 4 galères de ce type fit partie de l'Invincible Armada]
 Dès qu’elles s’aperçoivent, les 2 flottes avancent l’une vers l’autre, chacune selon un dispositif en croissant, avec les ailes légèrement avancées par rapport au centre. Le front de la bataille est de 7 km maximum. Les ailes adverses, que les commandants ont placées au nord de leurs dispositifs, sont proches de la côte. L’artillerie des galéasses vénitiennes amorce la bataille. Ces énormes embarcations, une innovation des ingénieurs vénitiens, sont très mobiles, combinent rames et voiles, et peuvent faire feu dans toutes les directions. 4 d’entre elles vont détruire en une demie-heure le tiers de la flotte d’Ali Pacha. Parmi les commandants de ces galléasses, 2 frères de Marcantonio Bragadin, Antonio et Ambrogio. Ils vont venger le martyr de Famagouste. Ils hurlent leurs ordres à leurs canonniers pour qu’ils arrosent d’un feu nourri les galères turques. On est bien d’accord sur toutes les galères et galéasses de Venise que pour venger Dandolo, Baglioni, Martinengo et surtout Bragadin, on ne fera aucun prisonnier. Avant même que la bataille ne commence vraiment, les galéasses avait mis hors de combat ou tué 10.000 Turcs. La mer était déjà couverte de noyés, de mâts ou de rames rompus, de morceaux de coque et de débris de toutes natures : jamais on n’avait encore vu de telles destructions lors d’une bataille navale, en si peu de temps.
Dès qu’elles s’aperçoivent, les 2 flottes avancent l’une vers l’autre, chacune selon un dispositif en croissant, avec les ailes légèrement avancées par rapport au centre. Le front de la bataille est de 7 km maximum. Les ailes adverses, que les commandants ont placées au nord de leurs dispositifs, sont proches de la côte. L’artillerie des galéasses vénitiennes amorce la bataille. Ces énormes embarcations, une innovation des ingénieurs vénitiens, sont très mobiles, combinent rames et voiles, et peuvent faire feu dans toutes les directions. 4 d’entre elles vont détruire en une demie-heure le tiers de la flotte d’Ali Pacha. Parmi les commandants de ces galléasses, 2 frères de Marcantonio Bragadin, Antonio et Ambrogio. Ils vont venger le martyr de Famagouste. Ils hurlent leurs ordres à leurs canonniers pour qu’ils arrosent d’un feu nourri les galères turques. On est bien d’accord sur toutes les galères et galéasses de Venise que pour venger Dandolo, Baglioni, Martinengo et surtout Bragadin, on ne fera aucun prisonnier. Avant même que la bataille ne commence vraiment, les galéasses avait mis hors de combat ou tué 10.000 Turcs. La mer était déjà couverte de noyés, de mâts ou de rames rompus, de morceaux de coque et de débris de toutes natures : jamais on n’avait encore vu de telles destructions lors d’une bataille navale, en si peu de temps. Pour galvaniser les Turcs, qui avaient paniqué devant le feu dense des galéasses, la galère amirale d’Ali Pacha, la “Sultana”, fonce vers “La Reale” de Don Juan, accompagnée de 96 autres galères. En voyant foncer ainsi le centre du dispositif turc sur eux, les prêtres espagnols et italiens, qui, tous, portent l’épée et ont bien l’intention de s’en servir, bénissent rameurs et soldats. Don Juan harangue ses troupes quelques minutes avant le choc : “Mes enfants, nous sommes ici pour conquérir ou pour mourir, comme le Ciel le voudra”. Les Européens, ce jour-là, sont chauffés à blanc : ils se batteront comme des possédés, mus essentiellement, sinon par la foi chrétienne, par l’ivresse de la vengeance pour les atrocités ottomanes commises à Chypre et à Corfou. Les soldats espagnols et italiens, issus des villes littorales, veulent venger les leurs tués ou enlevés lors des razzias ottomanes ou barbaresques, perpétrées depuis des décennies.
Don Juan à la pointe du combat sur la Sultana d’Ali Pacha
 Et c’est le choc, brutal, les soldats espagnols et allemands de Don Juan, sautent sur le pont de la Sultana d’Ali Pacha, qui est une merveille esthétique mais ne dispose pas de balustrades et de parapets pour protéger ses superstructures, comme leur propre galère amirale, La Reale. C’est sur le pont de la Sultana que la bataille rangée aura lieu. Les soldats de la Sainte Ligue ont l’avantage d’être cuirassés et casqués, face aux Turcs coiffés de turbans. Par 2 fois, ils approchent la personne d’Ali Pacha, mais les petits bâtiments turcs déversent sans cesse des renforts sur la Sultana, en espérant que le nombre et le courage des janissaires viendra à bout de ces soldats bardés de fer, qui manient l’arquebuse à merveille, avec une discipline de groupe sans pareille. Les embarcations espagnoles ont un pont surélevé par rapport à leurs équivalentes turques : de là, les arquebusiers des tercios peuvent canarder les Turcs et surtout leurs archers, qui sont, dans le camp ottoman, les combattants les plus dangereux.
Et c’est le choc, brutal, les soldats espagnols et allemands de Don Juan, sautent sur le pont de la Sultana d’Ali Pacha, qui est une merveille esthétique mais ne dispose pas de balustrades et de parapets pour protéger ses superstructures, comme leur propre galère amirale, La Reale. C’est sur le pont de la Sultana que la bataille rangée aura lieu. Les soldats de la Sainte Ligue ont l’avantage d’être cuirassés et casqués, face aux Turcs coiffés de turbans. Par 2 fois, ils approchent la personne d’Ali Pacha, mais les petits bâtiments turcs déversent sans cesse des renforts sur la Sultana, en espérant que le nombre et le courage des janissaires viendra à bout de ces soldats bardés de fer, qui manient l’arquebuse à merveille, avec une discipline de groupe sans pareille. Les embarcations espagnoles ont un pont surélevé par rapport à leurs équivalentes turques : de là, les arquebusiers des tercios peuvent canarder les Turcs et surtout leurs archers, qui sont, dans le camp ottoman, les combattants les plus dangereux. Longtemps, c’est une mêlée effroyable, sur l’espace restreint de quelques planches flottantes. La fumée de la poudre aveugle tous les combattants. Don Juan est devant, en première ligne, à côté de ses valeureux soldats. Don Luis de Requesens l’exhorte à ne pas s’exposer. Il répond : “Ma vie ne vaut pas mieux en ce moment que celle du dernier des soldats. Je vaincrai ou je mourrai l’épée à la main : ne pensez qu’à votre devoir, comme je pense au mien. Chacun de nous est maintenant à la miséricorde de Dieu”. Don Luis obtempère et la fine fleur de l’aristocratie espagnole se range autour du jeune chef aimé et incontesté. Il y a là le Comte de Priego, Rodrigo de Benavidès, Luis de Cardora, Philippe de Heredia, Ruy Diaz de Mendoza, Juan de Guzman et une flopée de jeunes nobles qui veulent, ce jour-là, dans cette effroyable mêlée, gagner quelques morceaux de gloire. Ils attaquent. Ils sont repoussés. Ils attaquent encore. Le régiment de Sardaigne de Don Lopez de Figueroa plie sous l’assaut turc.
[Ci-dessous : Bataille navale de Lépante (détail), Andrea Micheli dit Il Vicentino]
 Don Bernardino de Cardenas est renversé par un coup d’espingole et Don Juan le remplace aussitôt à la tête de ses soldats. En face d’eux, Ali Pacha en personne, qui délaisse son arc pour combattre au corps à corps son adversaire, le fils de Charles Quint. À ce moment-là, nous rappelle l’écrivain wallon Maurice des Ombiaux, le capitaine général de la chrétienté, le brave amiral du pape, Marco Antonio Colonna, avec le navire du bey ottoman de l’Eubée (le Négropont) dont il vient de s’emparer, fonce à toute vitesse sur la Sultana. La proue de la galère turque capturée s’enfonce profondément dans le navire amiral d’Ali Pacha. Les arquebusiers du pape mitraillent les Turcs et Don Juan lance un nouvel assaut. Le fils de Charles Quint tient une hache et une épée à large lame. Sardes et Espagnols sont galvanisés : plus rien ne les arrête, leur fureur balaie le pont, plus aucun janissaire ne résiste. Ils prennent l’étendard du Prophète venu de La Mecque. Ali Pacha est blessé, une balle d’arquebuse l’a frappé au front. Il s’écroule. Un soldat lui tranche la tête et la fiche sur une pique. Don Juan est horrifié et fait immédiatement jeter la tête à la mer. Le centre de la Sainte Ligue a gagné la partie : la Sultana est aux mains de ses soldats. Parmi eux, Miguel de Cervantès, qui vient de perdre sa main gauche dans un corps à corps, pour la “plus grande gloire de la droite”, qui écrira le fameux roman Don Quichotte, où est évoquée la bataille de Lépante.
Don Bernardino de Cardenas est renversé par un coup d’espingole et Don Juan le remplace aussitôt à la tête de ses soldats. En face d’eux, Ali Pacha en personne, qui délaisse son arc pour combattre au corps à corps son adversaire, le fils de Charles Quint. À ce moment-là, nous rappelle l’écrivain wallon Maurice des Ombiaux, le capitaine général de la chrétienté, le brave amiral du pape, Marco Antonio Colonna, avec le navire du bey ottoman de l’Eubée (le Négropont) dont il vient de s’emparer, fonce à toute vitesse sur la Sultana. La proue de la galère turque capturée s’enfonce profondément dans le navire amiral d’Ali Pacha. Les arquebusiers du pape mitraillent les Turcs et Don Juan lance un nouvel assaut. Le fils de Charles Quint tient une hache et une épée à large lame. Sardes et Espagnols sont galvanisés : plus rien ne les arrête, leur fureur balaie le pont, plus aucun janissaire ne résiste. Ils prennent l’étendard du Prophète venu de La Mecque. Ali Pacha est blessé, une balle d’arquebuse l’a frappé au front. Il s’écroule. Un soldat lui tranche la tête et la fiche sur une pique. Don Juan est horrifié et fait immédiatement jeter la tête à la mer. Le centre de la Sainte Ligue a gagné la partie : la Sultana est aux mains de ses soldats. Parmi eux, Miguel de Cervantès, qui vient de perdre sa main gauche dans un corps à corps, pour la “plus grande gloire de la droite”, qui écrira le fameux roman Don Quichotte, où est évoquée la bataille de Lépante.L’aile gauche venge cruellement la mort atroce de Bragadin
 L’aile gauche de la Sainte Ligue, commandée par le Vénitien Barbarigo encaisse d’abord un assaut impétueux, lancé par Mohammed Scirocco, qui tente de pousser ses ennemis vers la côte. Barbarigo, inébranlable, électrise ses soldats et ses marins, qui retournent la situation en leur faveur : cette fois, ce sont les Turcs qui sont acculés au littoral. Pour se dégager, ils doivent donner l’assaut, mais sous le feu nourri des arquebusiers vénitiens. Un archer ottoman envoie une flèche dans l’œil de Barberigo qui lui transperce la moitié du crâne. Il mourra après la bataille. Son neveu, Giovanni Mario Contarini, prend le commandement. Les janissaires, plus nombreux que leurs adversaires, montent à l’abordage et sont refoulés ; les soldats croates, italiens et dalmates de la Sérénissime s’emparent rapidement de la galère de Scirocco.
L’aile gauche de la Sainte Ligue, commandée par le Vénitien Barbarigo encaisse d’abord un assaut impétueux, lancé par Mohammed Scirocco, qui tente de pousser ses ennemis vers la côte. Barbarigo, inébranlable, électrise ses soldats et ses marins, qui retournent la situation en leur faveur : cette fois, ce sont les Turcs qui sont acculés au littoral. Pour se dégager, ils doivent donner l’assaut, mais sous le feu nourri des arquebusiers vénitiens. Un archer ottoman envoie une flèche dans l’œil de Barberigo qui lui transperce la moitié du crâne. Il mourra après la bataille. Son neveu, Giovanni Mario Contarini, prend le commandement. Les janissaires, plus nombreux que leurs adversaires, montent à l’abordage et sont refoulés ; les soldats croates, italiens et dalmates de la Sérénissime s’emparent rapidement de la galère de Scirocco. La discipline des soldats de la Ligue, leur habilité à manier l’arquebuse et leurs casques et cuirasses compensent facilement leur infériorité numérique. Scirocco, vice-roi d’Alexandrie, est tué, décapité et jeté à la mer. Une première vengeance vénitienne pour la mort de Bragadin. Mais ce ne sera pas tout : les Vénitiens de Barbarigo et Contarini vont systématiquement massacrer tous les marins et soldats turcs qui tomberont entre leurs mains. Les 15.000 galériens chrétiens de la flotte de Mohammed Scirocco sont libérés. Les galères turques, prises de panique, se rabattent sur la côte et s’échouent. Il ne reste rien, absolument rien de la flotte du vice-roi d’Alexandrie. Au nord de l’aire de combat, la victoire est acquise à la Sainte Ligue mais au prix fort : les capitaines Contarini, Barbarigo et Querini sont morts au combat ou succomberont à leurs blessures.
Bonnes manœuvres et erreur d’Ouloudj Ali
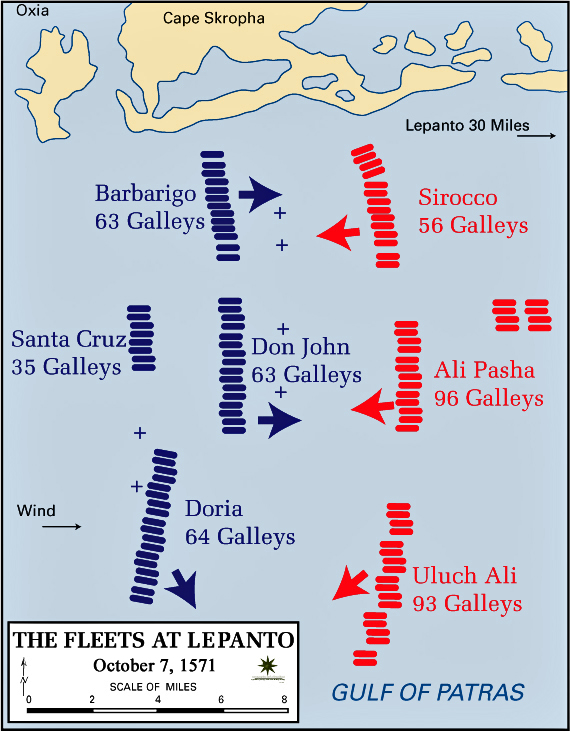 Au sud, Gianandrea Doria s’était laissé enveloppé par le redoutable corsaire algérois Ouloudj Ali. Le centre, qui vient de vaincre et n’a plus devant lui que des carcasses de galères incendiées, se voit subitement menacé sur ses arrières par les galères d’Ouloudj Ali. La capitane de Malte fait face à 7 galères algéroises, 10 navires vénitiens sont encerclés. Les arrières-gardes de Don Juan de Cardona et du Marquis de Santa-Cruz foncent à la rescousse. Les 2 commandants sont touchés mais restent à leur poste. Doria se rend compte de son erreur et revient en toute hâte au combat. Don Juan rameute une douzaine de galères encore en bon état et fonce sur le dispositif d’Oulouch Ali.
Au sud, Gianandrea Doria s’était laissé enveloppé par le redoutable corsaire algérois Ouloudj Ali. Le centre, qui vient de vaincre et n’a plus devant lui que des carcasses de galères incendiées, se voit subitement menacé sur ses arrières par les galères d’Ouloudj Ali. La capitane de Malte fait face à 7 galères algéroises, 10 navires vénitiens sont encerclés. Les arrières-gardes de Don Juan de Cardona et du Marquis de Santa-Cruz foncent à la rescousse. Les 2 commandants sont touchés mais restent à leur poste. Doria se rend compte de son erreur et revient en toute hâte au combat. Don Juan rameute une douzaine de galères encore en bon état et fonce sur le dispositif d’Oulouch Ali. La situation est redressée de justesse et la majeure partie des pertes européennes, en cette journée de Lépante, sont dues aux coups du pirate algérois. Qui a commis toutefois une erreur grave : au lieu de s’attaquer à davantage de galères chrétiennes, il fait une pause pour tenter de remorquer ses prises, dont 3 galères de l’Ordre de Saint-Jean. Il perd un précieux temps qui permet aux arrière-gardes espagnoles et à Don Juan de passer à l’attaque. Il n’emportera même pas ses prises, il doit les larguer pour fuir plus vite. Ouloudj Ali n’a plus qu’une solution : sauver sa flotte, quitter le lieu des combats et se réfugier à Alger, sa place forte.
Pourquoi la Sainte Ligue a-t-elle vaincu à Lépante ?
 La victoire est totale pour la Ligue. Comment les écoles militaires expliquent-elles aujourd’hui cette victoire ? Le professeur américain Victor Davis Hanson attribue cette victoire aux galéasses, bien évidemment, et à leur puissance de feu, qui valait celle d’une douzaine de galères ottomanes. Don Juan avait fait scier les proues de ses navires pour installer des canons capables de tirer de face et non pas latéralement. Ce dispositif permettait de tirer des boulets sur la ligne de flottaison des galères ottomanes. Privées de ce dispositif, les galères turques tiraient généralement trop haut, ne provoquant aucun dommage chez leurs adversaires. L’infanterie espagnole et allemande (7.300 mercenaires levés en Allemagne pour un total de 27.800 soldats de Philippe II) a prouvé sa supériorité lors de la bataille de Lépante ; elle disposait d’arquebuses relativement légères (de 7,5 à 10 kg) dont la portée était de 350 à 450 m. ; elle était cuirassée et casquée ; elle misait sur la solidarité du groupe et sur la discipline, non sur l’héroïsme personnel. Ensuite, bien sûr, la qualité de l’artillerie vénitienne et l’excellence de la tactique du feu nourri qu’elle inaugurait, ont largement contribué à la victoire de la Ligue. Hanson rappelle aussi que la Ligue disposait de 1.815 canons et les Turcs de 750 seulement. Ce sont ces atouts-là, dit Hanson, voix très écoutée aujourd’hui en matière d’histoire militaire, qui ont donné la victoire à Don Juan. La bataille n’a duré que 4 bonnes heures, nous rappelle l’historien militaire américain. Au cours de ce laps de temps finalement fort bref, 150 hommes ont été tués par minute, ce qui nous amène à quelque 40.000 morts, un taux de mortalité effrayant comparable à celui de la bataille de la Somme pendant la première guerre mondiale.
La victoire est totale pour la Ligue. Comment les écoles militaires expliquent-elles aujourd’hui cette victoire ? Le professeur américain Victor Davis Hanson attribue cette victoire aux galéasses, bien évidemment, et à leur puissance de feu, qui valait celle d’une douzaine de galères ottomanes. Don Juan avait fait scier les proues de ses navires pour installer des canons capables de tirer de face et non pas latéralement. Ce dispositif permettait de tirer des boulets sur la ligne de flottaison des galères ottomanes. Privées de ce dispositif, les galères turques tiraient généralement trop haut, ne provoquant aucun dommage chez leurs adversaires. L’infanterie espagnole et allemande (7.300 mercenaires levés en Allemagne pour un total de 27.800 soldats de Philippe II) a prouvé sa supériorité lors de la bataille de Lépante ; elle disposait d’arquebuses relativement légères (de 7,5 à 10 kg) dont la portée était de 350 à 450 m. ; elle était cuirassée et casquée ; elle misait sur la solidarité du groupe et sur la discipline, non sur l’héroïsme personnel. Ensuite, bien sûr, la qualité de l’artillerie vénitienne et l’excellence de la tactique du feu nourri qu’elle inaugurait, ont largement contribué à la victoire de la Ligue. Hanson rappelle aussi que la Ligue disposait de 1.815 canons et les Turcs de 750 seulement. Ce sont ces atouts-là, dit Hanson, voix très écoutée aujourd’hui en matière d’histoire militaire, qui ont donné la victoire à Don Juan. La bataille n’a duré que 4 bonnes heures, nous rappelle l’historien militaire américain. Au cours de ce laps de temps finalement fort bref, 150 hommes ont été tués par minute, ce qui nous amène à quelque 40.000 morts, un taux de mortalité effrayant comparable à celui de la bataille de la Somme pendant la première guerre mondiale.  L’historien militaire allemand Helmut Pemsel détaille dans son ouvrage destiné aux officiers de la Bundesmarine les pertes de la journée de Lépante : les Turcs auraient perdu 150 navires, dont 110 sont pris par la Sainte Ligue et 30 échoués sur les côtes du Cap Scrophia, à l’entrée du Golfe de Patras. On aurait dénombré 25.000 morts chez les Turcs et 5.000 prisonniers. Les marins de la Sainte Ligue auraient libéré 12.000 galériens chrétiens (et non 15.000 comme l’affirment d’autres sources). Les chrétiens auraient perdu 8000 hommes au combat et leurs rangs auraient compté 20.000 blessés, dont Cervantès. Ils n’auraient perdu en outre que de 12 à 15 bateaux, surtout sur le front tenu par Ouloudj Ali. Pemsel conclut : « Lépante a été l’une des plus grandes batailles navales de l’histoire, la dernière bataille de galères et, pour une longue période, la dernière bataille décisive dans l’espace méditerranéen. Mais la bataille n’a eu aucun effet stratégique sur le long terme, car la coalition chrétienne s’est rapidement disloquée ». Après l’hiver, en effet, les partenaires de la Sainte Ligue ne parviennent plus à accorder leurs violons. Philippe II est très réticent. Il se borne à maintenir sa flotte dans les eaux italiennes, au cas où une flotte turque reconstituée, ou la flotte d’Ouloudj Ali, qui a échappé au désastre, reviendrait ravager l’Adriatique ou la Tyrrhénienne.
L’historien militaire allemand Helmut Pemsel détaille dans son ouvrage destiné aux officiers de la Bundesmarine les pertes de la journée de Lépante : les Turcs auraient perdu 150 navires, dont 110 sont pris par la Sainte Ligue et 30 échoués sur les côtes du Cap Scrophia, à l’entrée du Golfe de Patras. On aurait dénombré 25.000 morts chez les Turcs et 5.000 prisonniers. Les marins de la Sainte Ligue auraient libéré 12.000 galériens chrétiens (et non 15.000 comme l’affirment d’autres sources). Les chrétiens auraient perdu 8000 hommes au combat et leurs rangs auraient compté 20.000 blessés, dont Cervantès. Ils n’auraient perdu en outre que de 12 à 15 bateaux, surtout sur le front tenu par Ouloudj Ali. Pemsel conclut : « Lépante a été l’une des plus grandes batailles navales de l’histoire, la dernière bataille de galères et, pour une longue période, la dernière bataille décisive dans l’espace méditerranéen. Mais la bataille n’a eu aucun effet stratégique sur le long terme, car la coalition chrétienne s’est rapidement disloquée ». Après l’hiver, en effet, les partenaires de la Sainte Ligue ne parviennent plus à accorder leurs violons. Philippe II est très réticent. Il se borne à maintenir sa flotte dans les eaux italiennes, au cas où une flotte turque reconstituée, ou la flotte d’Ouloudj Ali, qui a échappé au désastre, reviendrait ravager l’Adriatique ou la Tyrrhénienne. Pour le reste, le roi d’Espagne se dit plus préoccupé des troubles aux Pays-Bas et de la situation en Angleterre, où les pirates, avec la complicité tacite de la nouvelle reine Élizabeth Ire d’Angleterre, risquent fort bien de s’en prendre aux ports galiciens ou asturiens et de couper les communications entre l’Espagne et les Flandres. Qui plus est, les corsaires anglais attaquent les navires espagnols dans les Caraïbes. Philippe II rappelle une bonne partie de sa flotte pour protéger les Pays-Bas que menacent un débarquement anglais ou une intervention huguenote française en faveur des insurgés calvinistes et protestants de Hollande. Il faut aussi préciser que l’Espagne est présente depuis février 1565 dans le Pacifique, dans les Philippines. 3 et 4 ans après Lépante, en 1574 et 1575, Juan de Salcedo, commandant de la garnison espagnole des Philippines, réussit à enrayer la conquête de l’archipel par les pirates chinois de Li-Ma-Hong.
Quelques réflexions sur l’après-Lépante
Lépante, comme le dit bien Pemsel, est une des dernières batailles décisives en Méditerranée, avant que les enjeux stratégiques majeurs, y compris pour l’Espagne, ne passent de l’antique “Mare Nostrum” des Romains à l’Atlantique. Philippe II, poussé par ces contingences nouvelles, concentre désormais ses efforts sur l’Atlantique et laisse, dans le bassin occidental de la Grande Bleue, une œuvre inachevée : la piraterie barbaresque y est toujours présente et ne cessera définitivement de menacer l’Europe, y compris sa façade atlantique, qu’au début du XIXe siècle. En 1823, la Ligue Hanséatique de Hambourg se plaint d’un raid de corsaires algériens ou marocains dans les eaux de la Mer du Nord ! La conquête française de l’Algérie mettra un terme à ces actions de piraterie.
L’après-Lépante est marqué par l’inaction. Venise ne récupère pas Chypre. Les Ottomans réarment une flotte. Le sultan peut dire avec ironie : “En prenant Chypre, nous vous avons coupé le bras. En détruisant notre flotte, vous nous avez rasé la barbe. Un bras ne repousse jamais ; la barbe repousse toujours”. De fait, la perte de Chypre est un désastre pour l’Europe et l’acharnement des gouvernements turcs successifs à vouloir conserver à tout prix la reconquête de l’île, réalisée pendant l’été 1974, s’inscrit bien dans la logique géopolitique et stratégique qui se profile derrière la boutade du sultan ottoman. Pour la Turquie, c’est une question de prestige de rester à Chypre, même si la non reconnaissance par Ankara de l’État cypriote grec empêche l’État turc de devenir membre à part entière de l’UE. Où le sultan s’est avéré moins pertinent, c’est quand il a évoqué sa nouvelle flotte. Elle était certes aussi nombreuse que celle perdue à Lépante, mais nettement moins bien dotée en canons que ses homologues vénitiennes ou espagnoles. Les forges de l’arsenal de Venise étaient bien plus efficaces que les pauvres ateliers ottomans. Pire, ajoute Hanson, les Ottomans dotent encore, après Lépante, leurs galères de canons pris à l’ennemi. La structure économique de l’empire ottoman, ajoute-t-il, ne permet pas de créer des manufactures capables de produire en masse un armement standardisé et moderne.
Les combats sur mer en Méditerranée après Lépante
Sur le terrain, 10 mois après Lépante, Colonna rencontre la nouvelle flotte turque au Cap Matapan. C’est Ouloudj Ali qui la commande et elle compte 225 galères. Celle de Colonna est composée de 127 galères, 6 galéasses et 24 voiliers. Ouloudj Ali préfère éviter le combat. Il se retire sans perdre un navire. Une vingtaine de jours plus tard, les Espagnols rejoignent Colonna, avec, à leur tête, Don Juan. Les 2 flottes font jonction à Corfou, mais aucun engagement n’a lieu. En 1573, Venise signe une paix séparée avec les Turcs : la sainte Ligue cesse automatiquement d’exister. L’âme de l’unité de la Sainte Ligue, Pie V, était décédé en mai 1572. Le principal événement à signaler dans l’après-Lépante, c’est la reprise de Tunis en octobre 1573 par les Espagnols de Don Juan. Victoire éphémère : Ouloudj Ali reprend définitivement la ville en juillet 1574, avec 70.000 hommes qu’amène son futur successeur, Sinan Pacha. La perte définitive de Tunis scelle la fin du rêve espagnol de contrôler l’Afrique du Nord. L’Espagne se tourne pour de bon vers l’Atlantique, car c’est au-delà de l’Atlantique que réside désormais sa richesse et son empire. L’annexion du Portugal en 1580 accentue encore davantage ce tropisme atlantique. La Turquie abandonne aussi l’idée d’intervenir dans le bassin occidental car elle entre dans une longue guerre contre les Perses qui durera de 1578 à 1590. En juillet 1586, 7 galères algéroises attaquent Lanzarote dans les Canaries et capturent 200 Canariens : c’est la première attaque des Barbaresques d’Algérie dans l’Océan Atlantique.
Il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour revoir des combats sporadiques en Méditerranée. À signaler : une bataille au large de la Sardaigne, le 3 octobre 1624, où une flotte italienne détruit un parti algérois. En août 1640, la flotte des Chevaliers de Malte, sous la direction du Comte Ludwig von Hessen, capture 6 grands voiliers barbaresques devant Tunis. Le 28 septembre 1644, 6 galères maltaises capturent au large de Chypre un galéon turc avec, à son bord, l’une des épouses favorites du sultan. Le 4 avril 1655, l’Amiral anglais Blake, avant de se tourner contre l’Espagne, détruit Porto Farina près de Tunis et fait taire les canons du fort à l’aide de ses propres batteries : c’est la première fois qu’une artillerie montée sur vaisseaux parvient à neutraliser une citadelle.
 Il faudra attendre la guerre de Crète (1645-1669) pour qu’un conflit d’envergure, s’inscrivant dans la longue guerre euro-turque, réanime le théâtre méditerranéen et pour que l’empire ottoman enregistre l’un de ses derniers triomphes. Le prétexte de cette guerre est la capture en 1644 de la belle épouse du sultan par les Chevaliers de Malte. En représailles, les Turcs débarquent en Crète et s’emparent de l’île, que personne ne pourra leur arracher. Venise ne parvient pas à briser les lignes de communications turques : elle doit demander la paix et abandonner la Crète. La dernière grande île du bassin oriental tombe aux mains des Turcs, 98 ans après Lépante. Avec la marche de Kara Mustafa sur Vienne en 1683, ce sera le chant du cygne de l’empire ottoman. La défaite devant Vienne annonce la perte de la Hongrie et du Nord de la péninsule balkanique. La Sublime Porte est sur le déclin, sous les coups de boutoirs des armées habsbourgeoises, dirigées par ce génie militaire que fut le Prince Eugène de Savoie-Carignan. L’empire ottoman ne menacera plus l’Europe. Et les Européens s’empresseront d’oublier le danger turc.
Il faudra attendre la guerre de Crète (1645-1669) pour qu’un conflit d’envergure, s’inscrivant dans la longue guerre euro-turque, réanime le théâtre méditerranéen et pour que l’empire ottoman enregistre l’un de ses derniers triomphes. Le prétexte de cette guerre est la capture en 1644 de la belle épouse du sultan par les Chevaliers de Malte. En représailles, les Turcs débarquent en Crète et s’emparent de l’île, que personne ne pourra leur arracher. Venise ne parvient pas à briser les lignes de communications turques : elle doit demander la paix et abandonner la Crète. La dernière grande île du bassin oriental tombe aux mains des Turcs, 98 ans après Lépante. Avec la marche de Kara Mustafa sur Vienne en 1683, ce sera le chant du cygne de l’empire ottoman. La défaite devant Vienne annonce la perte de la Hongrie et du Nord de la péninsule balkanique. La Sublime Porte est sur le déclin, sous les coups de boutoirs des armées habsbourgeoises, dirigées par ce génie militaire que fut le Prince Eugène de Savoie-Carignan. L’empire ottoman ne menacera plus l’Europe. Et les Européens s’empresseront d’oublier le danger turc. Aujourd’hui, avec le déclin démographique de l’Europe et l’amnésie généralisée qui s’est emparé de nos peuples dans l’euphorie d’une société de consommation, le danger turc est pourtant bien présent. Une adhésion à l’UE submergerait l’Europe et lui ferait perdre son identité géopolitique, forgée justement pendant plus d’un millénaire de lutte contre les irruptions centre-asiatiques dans sa périphérie ou carrément dans son espace médian. L’Europe doit être vigilante et ne tolérer aucun empiètement supplémentaire de son territoire : à Chypre, dans l’Égée, dans le Caucase, sur le littoral nord-africain où subsistent les “presidios” espagnols, dans les Canaries, il faut être intransigeant. Mais dans quel esprit doit s’inscrire cette intransigeance ? Dans l’esprit de l’Ordre de Saint-Jean, bien évidemment, qui a toujours refusé de lutter contre une puissance chrétienne ou de s’embarquer dans des alliances qui s’opposaient à d’autres pactes où des puissances chrétiennes étaient parties prenantes : on a en tête les alliances contre-nature que concoctaient les Byzantins sur leur déclin et qui ont amené les Turcs en Thrace. L’Ordre a toujours su désigner l’ennemi géopolitique et en a tiré les conséquences voulues.
L’idéal bourguignon du XVe siècle, très bien décrit dans le beau livre de Bertrand Schnerb, correspond parfaitement à ce qu’il faudrait penser aujourd’hui, au-delà des misères idéologiques dominantes et des bricolages insipides de nos intellectuels désincarnés ou de nos médiacrates festivistes. Notre idéal remonte en effet à Philippe le Bon, le fils de Jean sans Peur et d’une duchesse bavaroise, qui prête à Lille, le 17 février 1454, le fameux “Vœu du Faisan”, un an après la chute de Constantinople. Le “Vœu du Faisan” est effectivement resté un simple vœu, parce que Trébizonde est tombée à son tour. Les Ducs de Bourgogne voulaient intervenir en Mer Noire et harceler les Ottomans par le Nord. Deux hommes ont tenté de traduire ce projet dans les faits : Waleran de Wavrin et Geoffroy de Thoisy. L’idéal de la Toison d’Or et l’idéal alexandrin de l’époque s’inscrivent aussi dans ce “Vœu” et dans ces projets : il convient de méditer cet état de choses et de l’actualiser, à l’heure où ces mêmes régions balkaniques, pontiques et caucasiennes entrent en turbulences. Et où, avec Davutoglu, la Turquie s’est donné un ministre des affaires étrangères qui qualifie ses options géopolitiques de “néo-ottomanes”.
Lépante est l’aboutissement d’une guerre longue. Nous l’avons vu. Après Lépante, cette guerre longue a connu une accalmie. Plusieurs signes indiquent aujourd’hui que les quelques braises aux trois quarts éteintes qui sommeillaient encore vaille que vaille dans les reliefs du vieil incendie sont en train de se raviver, de rougeoyer dangereusement. Allumeront-elles un nouvel incendie ? Sans doute. La longue mémoire, dans les guerres longues, est une arme redoutable. Songeons-y. Et préparons-nous.
► Robert Steuckers, achevé à Forest-Flotzenberg, 15 novembre 2009.
• nota bene : retrouvez ce texte ainsi que d'autres de R. Steuckers sur le blog dédié à ceux-ci

♦ Bibliographie :
• Paul AUPHAN, Histoire de la Méditerranée, La Table Ronde, Paris, 1962
• Jack BEECHING, Don Juan d’Austria – Sieger von Lepanto, Prestel-Verlag, München, 1983
• Wim BLOCKMANS, Keizer Karel – 1500-1558 – de utopie van het keizerschap, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2000-2001
• Alain BLONDY, Geschiedenis van Cyprus, Uitgeverij Voltaire, ’s Hertogenbosch, 2000
• Henry BOGDAN, Histoire de la Hongrie, PUF (qsj?, n°678), 1966
• Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand Colin, 2 tomes, 1966-1985 (6ème éd.)
• Fernand BRAUDEL, Autour de la Méditerranée, Fallois (Livre de Poche, coll. “Références”, n°460), 1996
• Louis BRÉHIER, Vie et mort de Byzance, Albin Michel, 1946-1969
• Gérard CHALIAND, Guerres et civilisations, Odile Jacob, 2005
• Edmonde CHARLES-ROUX, Don Juan d’Autriche, bâtard de Charles-Quint, éd. Racines, Bruxelles, 2003
• Aymeric CHAUPRADE, “Civilisations turque et européenne : 3.000 ans d’opposition”, in Revue française de géopolitique n°4, “Géopolitique de la Turquie”, Ellipses, 2006
• André CLOT, Soliman le Magnifique, Fayard, 1983
• Philippe CONRAD, “Tableau historique de l’affrontement entre Européens et Turcs”, in Revue française de géopolitique n°4, “Géopolitique de la Turquie”, Ellipses, 2006
• Roger CROWLEY, Empires of the Sea – The Final Battle for the Mediterranean – 1521-1580, Faber and Faber, London, 2008
• Dolores CRUZ & Carmen UTRERA, Cronologia de la Historia de España (II) – Desde los Reyes Catolicos hasta Carlos IV (Siglos XVI, XVII y XVIII), Acento Editorial, Madrid, 1999
• Ghislaine DE BOOM, Les voyages de Charles-Quint, Office de publicité, Bruxelles, 1957
• Maurice DES OMBIAUX, Le dernier des paladins – Don Juan, fils de Charles-Quint, L’édition d’art, Paris, 1926
• Hellmut DIWALD, Der Kampf um die Weltmeere, Droemer Knaur, München/Zürich, 1980
• John H. ELLIOTT, Imperial Spain – 1469-1716, Penguin, Harmondsworth, 1970
• Claire-Eliane ENGEL, L’Ordre de Malte en Méditerranée (1530-1798), Rocher, Monaco, 1957
• Dominique FARALE, Les Turcs face à l’Occident – Des origines aux Seldjoukides, Economica, 2008
• Dominique FARALE, La Turquie ottomane et l’Europe. Du XIVe siècle à nos jours, Economica, 2009
• Orestes FERRARA, Philippe II, Albin Michel, 1961
• Giuliana GEMELLI, Fernand Braudel e l’Europe universale, Marsilio Editore, Venezia, 1990
• Jacques GODECHOT, Histoire de Malte, PUF (coll. qsj?, n°509), 1952
• Jason GOODWIN, Lords of the Horizons - A History of the Ottoman Empire, Vintage Books, London, 1999
• Victor Davis HANSON, Why the West Has Won – Carnage and Culture from Salamis to Vietnam, Faber and Faber, London, 2001
• Jacques HEERS, Les Barbaresques – La course et la guerre en Méditerranée – XIVe-XVIe siècle, Perrin, coll. Tempus, n°220, 2001
• Jérôme HELIE, Petit atlas historique des temps modernes, 2ème éd., A. Colin, 2007
• Philipp HILTEBRANDT, Der Kampf um Mittelmeer, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1940
• Charles KING, The Black Sea – A History, Oxford Univ. Press, 2004
• Dimitri KITSIKIS, L’empire ottoman, PUF (QSJ? n°2222), 1985
• Angus KONSTAM, Lepanto 1571 – The Greatest Naval Battle of the Renaissance, Osprey, Oxford (UK), 2003 (Illustrated by Tony Bryan)
• Henry LEMONNIER, Henri II, la lutte contre la Maison d’Autriche 1519-1559, Tallandier, 1983
• Paul LENDVAI, Die Ungarn – Eine tausendjährige Geschichte, Goldmann, München, 2001
• Michel LESURE, “Qui a gagné la bataille de Lépante?”, in Les collections de l’Histoire, oct-déc. 2009, pp. 34-37
• Ferenc MAJOROS / Bernd RILL, Das Osmanische Reich – 1300-1922 – Die Geschichte einer Grossmacht, F. Pustet/Styria, Regensburg/Graz, 1994
• Noel MALCOLM, Bosnia – A Short History, Macmillan/Papermac, London, 1994
• Robert MANTRAN, Histoire de la Turquie, PUF (qsj?, n°539), 7ème éd., 1993
• Colin McEVEDY, The New Penguin Atlas of Medieval History, Penguin, London, 1961-1992
• John Julius NORWICH, The Middle Sea – A History of the Mediterranean, Vintage Books, London, 2007
• Geoffrey PARKER, “Le monde politique de Charles-Quint”, in Hugo SOLY (éd.), Charles Quint 1500-1558 – L’empereur et son temps, Fonds Mercator, Anvers, 1999
• Helmut PEMSEL, Seeherrschaft – Eine maritime Weltgeschichte von den Anfängen der Seefahrt bis zur Gegenwart, Berard & Graefe Verlag, 1985
• Henri PIGAILLEM, La Bataille de Lépante (1571), Economica, 2003
• Barnaby ROGERSON, The Last Crusaders – The Hundred-Year Battle for the Centre of the World, Little/Brown, London, 2009
• Jean-Paul ROUX, Histoire des Turcs – Deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée, Fayard, 1984
• Jean-Paul ROUX, Un choc de religions – La longue guerre de l’islam et de la chrétienté – 622-2007, Fayard, 2007
• Ferdinand SCHEVILL, A History of the Balkans – From the Earliest Times to the Present Day, Dorset Press, New York, 1991
• Reinhold SCHNEIDER, Philipp der Zweite oder Religion und Macht, Fischer, Frankfurt a. M., 1953-1958
• Bertrand SCHNERB, L’État bourguignon 1363-1477, Perrin (coll. Tempus, n°105), 2005 (pour le chap. 8, consacré au désastre de Nicopolis ; pour le chap. 19, sur les projets bourguignons de Croisade)
• Peter SCHOLL-LATOUR, Im Fadenkreuz der Mächte – Gespenster am Balkan, C. Bertelsmann, München, 1994
• Peter SCHOLL-LATOUR, Allahs Schatten über Atatürk – Die Türkei in der Zerreissprobe – Zwischen Kurdistan und Kosovo, Goldmann, Munich, 2001 (livre consacré à l’actualité turque mais illustré de nombreuses références et exemples historiques, nous permettant de lier l’actualité à l’histoire)
• Jean-François SOLNON, Le turban et la stambouline – L’empire ottoman et l’Europe, XIV°-XX° siècle, affrontement et fascination réciproques, Perrin, 2009
• Yves TERNON, Empire ottoman – le déclin, la chute, l’effacement, éd. Michel de Maule / Félin, s. l., 2005
• Carmen UTRERA & Dolores CRUZ, Cronologia de la Historia de España (I) – Desde la Prehistoria hasta el siglo XV, Acento Editorial, Madrid, 1999
• Chris VAN DER HEIJDEN, Zwarte Renaissance – Spanje en de wereld 1492-1536, Olympus, s.l., 1998-2003
• Hendrik VERBRUGGE, Keizer Karel – Testament van een Habsburger, Lannoo, Tielt, 2000
• Michael W. WEITHMANN, Balkan-Chronik – 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident, Pustet/Styria, Regensburg/Graz, 1995
• Michael W. WEITHMANN, Die Donau – Ein europäischer Fluss und seine 3000-jährige Geschichte, Pustet/Styria, Regensburg/Graz, 2000
• Andrew WHEATCROFT, The Enemy at the Gate – Habsburgs, Ottomans and the Battle for Europe, Pimlico, London, 2008
• Alvise ZORZI, Histoire de Venise – La République du Lion, Perrin, coll. Tempus, n°95, 2005 (3ème éd.)
Texte repris dans :
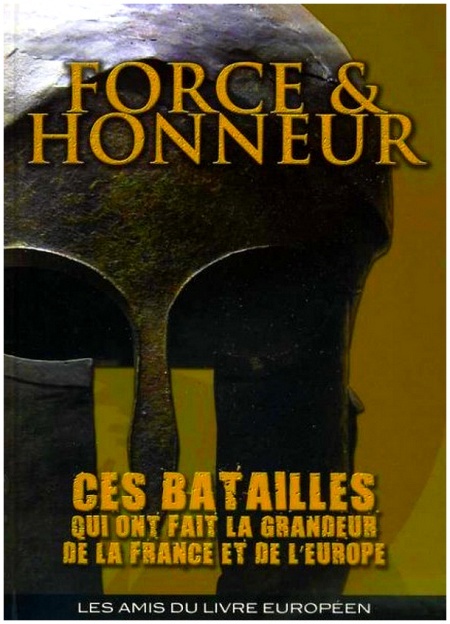 ♦ Force & Honneur
♦ Force & HonneurForce & Honneur : Ces Batailles qui ont fait la grandeur de la France et de l'Europe (ouvr. coll.)
Présentation éditeur : Parce qu'ils ont accepté de mourir quand d'autres se contentaient de vivre, c'est de leurs glaives que sont nés la France et l'Europe. Ce sont ces hommes de guerre qui ont écrit Notre Histoire pluri-millénaires. Par leurs larmes et leur sang, ils ont donné à notre vieille nation et à notre continent ses lettres de noblesse. En portant haut et fier leur Honneur, la Fidélité, le Courage, ils ont créé l'aristocratie des valeurs européennes. En faisant preuve de Discipline, d'Héroïsme, de Patriotisme, ils ont vertébré l'Européen. Du défilé des Thermopyles à la plaine brumeuse de Poitiers, des Croisades aux remparts de Vienne, du plateau d'Austerlitz aux tranchées de Verdun, de la neige de Russie aux pitons de Dien Bien Phû, ils ont tout sacrifié pour sauver notre trésor le plus magnifique : la civilisation helléno-chrétienne, la liberté, notre identité. Dans cet ouvrage, ce sont plus de deux mille ans d'histoire qui se déroulent et viennent opportunément nous rappeler que la guerre est notre mère à tous, Européens qui entendons demeurer dignes et souhaitons nous souvenir. Ce livre se veut un appel vibrant à la jeunesse d'Europe qui, à défaut de repères solides, travestit en modèles quelques idoles médiocres et frelatées. Dans les pages de cet ouvrage, ils trouveront des modèles, des attitudes pour renouer avec eux-mêmes, mais aussi pour tirer les conclusions qui s'imposent : on ne se dérobe pas au combat parce que le combat, c'est la loi de la vie. Trente batailles symboliques inscrites au plus profond de nous-mêmes, toutes illustrées par le trait sûr de Guy Sajer. Sept entretiens avec des hommes de guerre exceptionnels : un livre majeur pour tous ceux pour qui, envers et contre tout, l'Honneur s'appelle toujours Fidélité !
Caractéristiques : Ce livre de 352 pages, édité dans un format A4 et illustré par l'auteur de bandes dessinées Dimitri, alias Guy Sajer (auteur du célèbre Soldat Oublié), retrace l’histoire de la France et de l’Europe au travers de 30 batailles symboliques et représentatives de la geste européenne. 30 contributeurs issus d’horizons différents, jeunes et moins jeunes, connus et moins connus vous feront donc vivre au travers de ce livre plus de 2.000 ans d’histoire européenne ! Le livre se conclut par une série de 7 entretiens avec des hommes de guerre ayant participé aux conflits des 60 dernières années.
Plan détaillé :
♠ 1ère partie : des batailles
- Préface : Jean-Pierre Papadacci
- Les Thermopyles (– 480) : Christian Segré
- Marathon (– 490) : Romain Lecap
- Issos (– 331) : Quentin Hélène
- Gergovie (– 52) : Joseph Maie Joly
- Zama (– 202) : André Lama
- Teutoburger Wald (– 9) : Pascal Lassalle
- Tolbiac (496) : Hubert Kohler
- Les champs catalauniques (541) : Arnaud Derville
- La bataille de Toulouse et la bataille de Poitiers (732) : Gilbert Sincyr
- Hastings (1066) : Erik Fuchs
- La prise de Jérusalem (1099) : Pierre Vial
- Las Navas de Tolosa (16 juillet 1212) : Jean Kapel
- La bataille de Bouvines (1215) : Jean-Christophe Hartmann
- Tannenberg (1242) : Arthur Lorc’h
- Azincourt ou la mort de la chevalerie française (1415) : Jean Denègre
- La prise d'Orléans (1429) : Thierry Bouzard
- Le siège de Vienne (1529) : Philippe Conrad
- La bataille de Lépante (1571) : Robert Steuckers
- La bataille de Torfou (1793) : Arthur de Lascaux
- Austerlitz, la bataille des trois empereurs (1805) : Louis Samagne
- Camerone (1863) : Alain Sanders
- Mourir pour Verdun (1916) : Philippe Fraimbois
- Le siège de l’Alcazar de Tolède (1936) : Olivier Grimaldi
- Stalingrad (1943) : Pierre Gilieth
- Le débarquement du commando Kieffer (1944) : Jean André
- La bataille de Berlin (1945) : Chris Chatelet
- Dien Bien Phu (1954) : Éric Fornal
- L’insurrection de Budapest (1956) : Lajos Marton
- La bataille d'Alger (1957) : François-Xavier Sidos
- Le siège de Sarajevo (1992) : Pierre-Henri Bunel
♣ 2ème partie : et des hommes de guerre
Le général Yves Derville, qui participa à la première guerre du Golfe ; le colonel Jean Luciani, ancien des FFI et vétéran de Dien Bien Phu ; le capitaine Dominique Bonelli ancien du 1er BEP puis du 1er REP en Indochine et en Algérie ; l’adjudant-chef Jean Laraque, les sergents Alexis Arette et Roger Holeindre, le caporal-chef Aimé Trocmé, autres “sentinelles de l’Empire”.
♦ Préface :
« C’est la guerre qui a fait des hommes et des temps ce qu’ils sont… Et toujours, si longtemps que la roue de la vie danse en nous sa ronde puissante, cette guerre sera l’essieu autour duquel elle vrombit. » Ernst Jünger, La guerre notre mère
« On ne se dérobe pas à la loi du combat, parce que c’est la loi de la vie. » Pierre Drieu la Rochelle
« L’avenir appartient à qui recueille et sème l’éternelle fleur du passé. » Charles Maurras
« La vie d’une grande nation n’est qu’un combat. Elle a ses jours d’épreuve. Mais comme l’a dit Montaigne : l’adversité est une fournaise à recuire l’âme. » Maxime Weygand
Le calendrier mémoriel de nos pères était, autrefois, parsemé de noms de saints, de soldats héroïques et aussi de grandes batailles. Ces noms, gravés dans l’histoire des peuples, étaient toujours évocateurs : Ils constituaient une mémoire collective et forgeaient les identités nationales. Chaque nation vénérait ses saints, exaltait ses héros et communiait dans le souvenir de ses grandes batailles. Le souvenir de celles-ci, gagnées ou perdues, était perpétué par des cérémonies patriotiques, véritables liturgies, qui cimentaient les peuples en reliant les vivants et les morts.
Aujourd’hui, ce culte de la mémoire, propre aux vieilles nations historiques, est contrôlé, contesté pour ne pas dire condamné car il dérange les tenants du nouvel ordre mondial. L’idéologie universaliste règne désormais en maîtresse, elle déforme, révise, détourne le passé en attendant de le faire disparaître. C’est dans cet esprit que le bicentenaire de la victoire d’Austerlitz a été effacé, ignoré et que la commémoration du 90ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale a été transformée en promotion de l’Union européenne et de son prétendu “avenir radieux”. On n’évoque plus les guerres que pour les condamner ou pour jeter l’opprobre sur les combattants. On réhabilite les mutins, on glorifie les déserteurs, les traîtres, les objecteurs de conscience et on les offre en modèle. Les combats futurs ne se dérouleront plus que dans les stades ou dans les temples de la Bourse et les héros ne seront plus que des sportifs ou des traders. On nous promet un univers de paix et de prospérité qui implique l’oubli de notre identité et l’abandon de notre nationalité : le monde n’est plus qu’un marché soumis à la religion du Veau d’Or et notre avenir est assuré à jamais à condition d’en devenir les consommateurs.
Beaucoup de ceux qui confondent rêves et réalités peuvent se convertir aux utopies mondialistes mais nous, qui fûmes les enfants de Dien-Bien-Phu et de Budapest, nous refusons d’entrer dans ce marché de dupes. Nous savons que la vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Nous savons que nous sommes les héritiers de générations qui ont œuvré, souffert et parfois sacrifié leur vie pour nous transmettre une patrie. Nous savons que notre nationalité est un titre de propriété sur notre terre, sur nos biens et sur notre culture. Nous savons que nous sommes des débiteurs et que nous avons le devoir de faire fructifier et de transmettre le patrimoine que nous avons reçu. Nous savons qu’il ne serait pas digne d’oublier les sacrifices de nos anciens et encore moins de les stigmatiser ou de les renier. Enfin nous sommes convaincus que la nation reste la clef de voûte de l’ordre mondial. C’est pourquoi nous avons décidé de relater les grandes batailles qui ont marqué l’histoire des nations. Elles rappelleront à ceux qui l’oublient que la vie est avant tout un combat et que notre premier devoir est de rester fidèles à tous nos compatriotes qui, au cours des siècles, n’ont pas hésité à donner leur vie pour assurer la pérennité de leur nation.
Jean-Pierre Papadacci, Français d’Empire
♦ Recension : émission Méridien-Zéro.
♦ Éditions : Les Amis du Livre Européen, 2010, 352 p., 45 €, 1.000 exemplaires seulement.
♦ Commandes : Les Amis du Livre Européen, 1 place Paul Verlaine, 92100 Boulogne-Billancourt.
♦ Libre Journal des Lycéens du 15/01/11 consacré à la sortie de l'ouvrage collectif Force & Honneur avec pour invités : les éditeurs Eugène Krampon et Gérard Vaudan, Pascal Lassalle (sur la bataille de Teutobourg), Lajos Marton (sur l'insurrection de Budapest) et Robert Steuckers (concernant la Bataille de Lépante). Seconde partie de l'émission en compagnie de Tomislav Sunic (pour son opus Homo-Americanus : rejeton de l'ère post-moderne) et de Georges Feltin-Tracol (Europe Maxima).

La leçon de Lépante : qui l'a retenue ?
Le 7 octobre 1571, l'Europe impériale coalisée infligeait une sévère défaite sur mer à l'Empire ottoman
430 années ont passé depuis l'un des plus grands événements militaires de l'histoire mondiale. Ce jour-là, 7 octobre 1571, une large fraction de l'Europe chrétienne avait laissé de côté les vieilles haines et les divisions fratricides pour se lancer dans une bataille décisive contre l'ennemi mortel qui l'avait continuellement agressée et qui cherchait à l'annihiler. L'héroïsme et le sacrifice de nos ancêtres a permis à notre civilisation de vivre et de poursuivre sa route dans l'histoire — pour le meilleur et pour le pire. Ce jour-là, l'Europe a pu compter sur certains de ses fils (la plupart !), ceux qui ont répondu à l'appel du destin, ceux qui ont eu le courage de se jeter dans la bataille, et ceux qui se sont retirés du jeu, qui se sont contentés de regarder le combat de loin, en laissant aux autres la tâche de défendre l'héritage commun. Et il y a eu ceux qui ont pactisé avec l'ennemi (que la honte les étouffe pour les siècles des siècles !). Ce jour-là, 7 octobre 1571, on a vu à quels hommes on avait affaire, on a vu les justes et on a vu les traîtres. Parlons d'abord de la composition de la flotte impériale européenne : sur 208 bateaux, 110 étaient vénitiens, 22 génois, 3 piémontais, 12 appartenaient à l'ordre de chevalerie toscan de Saint Étienne, 9 appartenaient aux Chevaliers de Malte, 8 relevaient de la Papauté et 44 du Saint Empire. Les équipages des bateaux arborant le pavillon de Saint Marc venaient de Vénétie (60), de Crète (30), des Iles Ioniennes (7), de Dalmatie (8) et des villes de la terre ferme (5). Les troupes de fantassins embarquées étaient en majorité impériales et composées de soldats venus de Castille, de Catalogne, du Pays Basque, de Hollande, de Lombardie, d'Allemagne et du Pays de Naples. L'infanterie de Venise était composée de Vénétiens, de Lombards, de Frioulans et de “Slavons” (Croates de Dalmatie et Serbes de la Krajina).
Presque toute l'Europe catholique était présente. Parmi les absents, certains étaient parfaitement excusables, comme les Autrichiens, les Polonais, les Allemands et les Hongrois, car ils luttaient pied à pied contre les Turcs sur le front continental. Le premier assaut turc contre Vienne avait été brisé en 1529 et les affrontements n'avaient plus cessé depuis en Slovénie, en Hongrie et en Valachie. Deux absences me semblent toutefois injustifiables. Les Portugais étaient entrés en rivalité avec les Espagnols et n'avaient pas accepté de se soumettre au commandement d'un chef espagnol. L'opposition entre les deux puissances ibériques n'était pas d'ordre idéologique mais politique : en réalité, les Portugais menaient une longue guerre contre les Musulmans sur les côtes atlantiques du Maroc et lançaient d'audacieuses incursions en territoire islamique en Orient, parmi lesquelles une tentative malheureuse, l'expédition en Mer Rouge de 1517.
Une pure trahison à l'endroit des intérêts vitaux de l'Europe
Les Français, eux, n'avaient aucune raison valable pour ne pas être présent à Lépante. Dans le passé, les Francs avaient toujours été aux avant-postes dans la lutte pour la défense des frontières de l'Europe, depuis Poitiers jusqu'aux Croisades. Leur absence s'explique sans doute par la rivalité qui les opposait à l'Espagne. Mais surtout par leur politique de rapprochement avec les Ottomans, concrétisée par des traités de coopération et d'amitié. Cette politique est devenue au fil du temps une pure trahison à l'endroit des intérêts vitaux de l'Europe. La politique française ne peut pas davantage se justifier pour des motifs économiques : Venise, Gênes et les autres puissances européennes avaient passé des accords commerciaux avec les Musulmans mais n'avaient jamais eu l'idée, en les signant, de trahir l'esprit de défense de la civilisation européenne. Les seuls Français et Occitans présents à Lépante pour défendre l'honneur de leurs terres dans la défense commune de l'Europe se trouvaient dans les rangs des héroïques chevaliers de Malte et sur les bateaux niçois du Comte de Savoie.
Le christianisme avait provoqué en Europe une division, celle du schisme entre l'Occident et l'Orient, entre Rome et Byzance ; il venait d'en provoquer une nouvelle par la Réforme. Les positions des diverses fractions de la chrétienté européenne devant l'agression ottomane étaient différentes. Le monde orthodoxe, depuis la chute de Constantinople, fruit amer de la division entre peuples christianisés, languissait largement sous l'oppression turque mais résistait vaillamment dans des zones non pacifiées, notamment en Transylvanie et dans les montagnes serbes du Kosovo et de la Métohie. La Russie, la plus grande nation orthodoxe, avait recueilli l'héritage symbolique et politique de Byzance. Elle avait engagé une bataille terrible contre les potentats islamiques d'Asie centrale. En 1571, l'année de Lépante, les Tatars de Crimée, alliés des Ottomans, avaient lancé des attaques cruelles contre la terre russe, poussant jusqu'à Moscou qu'ils avaient incendiée. Les Orthodoxes ont donc participé, ces années-là, à la lutte commune de l'Europe contre son ennemi mortel. De plus, les équipages de 37 navires vénitiens venaient de Candie et des Iles Ioniennes, sans compter les “Slavons” de la Krajina, derrière les côtes dalmates.
La “Prière contre les Turcs” de Luther
Les Protestants ont été les grands absents, d'abord pour des raisons géographiques, l'Europe nord-occidentale étant très éloignée du danger islamique et ne le percevant pas correctement. Mais ils avaient également des raisons “idéologiques” : dans une de ses thèses, Luther avait dit : « C'est un péché de résister aux Turcs, car la Providence se sert de cette nation infidèle pour punir les iniquités de son peuple ». Luther avait toutefois modifié son attitude première dans deux ouvrages ultérieurs : Prière contre les Turcs et De la guerre contre les Turcs. Toutefois sa thèse de non résistance a servi d'alibi au non engagement des Protestants dans la lutte commune. Le ressentiment anti-catholique a sans doute permis à certaines franges puritaines de sympathiser avec l'islamisme, plus virulent dans son zèle religieux.
Aujourd'hui l'Europe vit des expériences qui ressemblent dramatiquement à celles de ce XVIe siècle tragique. La pression islamique se fait sentir de plus en plus durement non plus sur les frontières de l'Europe ou sur les côtes méditerranéennes, mais à l'intérieur même des villes du cœur de l'Europe. Dans un tel contexte, notre Padanie a un rôle d'avant-garde à jouer dans cette nouvelle lutte, parce qu'elle doit se souvenir qu'elle a livré les deux tiers des navires de combat de la bataille de Lépante, qu'elle a donné au Saint Empire de grands commandeurs militaires et un Pape piémontais, Saint Pie V, qui, [ndlr : à rebours des discours "multicultureux" de l’Église d'aujourd'hui], avait appelé les Européens à s'unir en une grande armée paneuropéenne pour battre l'ennemi turc. Aujourd'hui, la Padanie est toujours en première ligne car les infiltrés islamiques s'installent sur son territoire. C'est donc chez nous que devra renaître l'esprit de résistance européen. Comme à Lépante, on pourra compter les présents et les absents.
► Gilberto Oneto, Nouvelles de Synergies Européennes n°50, 2001.
(article paru dans La Padania, 4 février 2000)

◘ Lépante, entre mythe et réalité
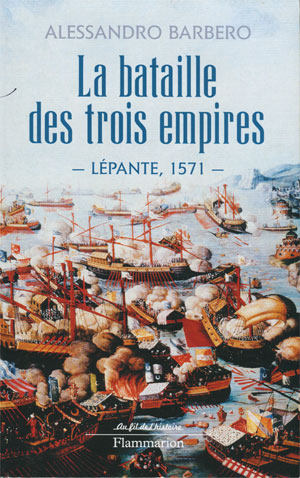 Un historien italien fait revivre la bataille navale de Lépante qui, en 1571, vit la victoire des Etats chrétiens sur l'Empire ottoman. En situant l'événement dans sa complexité géopolitique
Un historien italien fait revivre la bataille navale de Lépante qui, en 1571, vit la victoire des Etats chrétiens sur l'Empire ottoman. En situant l'événement dans sa complexité géopolitiqueCe jeune Espagnol n'était qu'un des 100 000 hommes qui s'affrontèrent au large des côtes grecques, le 7 octobre 1571, dans le golfe de Lépante. S'il avait été tué, un chef-d'œuvre manquerait à la littérature mondiale : il s'appelait Miguel de Cervantès, et écrirait plus tard les aventures de Don Quichotte. Lépante ? Que sait-on de cette bataille, sinon qu'elle mit aux prises des États chrétiens et l'Empire ottoman ? Alessandro Barbero, professeur à l'université du Piémont Oriental de Vercelli, est un spécialiste d'histoire militaire qui est aussi un romancier et un conteur hors pair. Plusieurs de ses livres — sur Waterloo, les grandes invasions ou les croisades — ont été traduits en français. Son dernier ouvrage, en 32 chapitres qui sont autant de tableaux vivants, restitue l'événement Lépante dans toute sa complexité.
D'abord le contexte. En 1453, les Turcs, déjà maîtres des Balkans, s'emparent de Constantinople. Au XVIesiècle, le sultan fait de son empire une puissance maritime, pendant que l'Espagne s'impose dans le bassin méditerranéen à partir de ses ports de Catalogne et de ses possessions italiennes. En 1516 et en 1527, les Ottomans occupent la Syrie et l'Égypte, et poursuivent leur pénétration en Europe centrale. De son côté, le roi François Ier, qui veut conquérir le Milanais, fief de la couronne espagnole, cherche une alliance de revers contre son rival Charles Quint. Il la trouve, en 1535, en concluant un accord avec les Turcs. Au grand scandale des contemporains, on verra des opérations conjointes franco-ottomanes en Méditerranée.
Une coalition nouée par Pie V
D'autres États comptent dans ce jeu. Au premier chef Venise qui, utilisant ses nombreux comptoirs en Adriatique et en Méditerranée, commerce avec le Levant, parfois en bonne entente avec les Ottomans. Ensuite Malte, île gouvernée par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem depuis que les Turcs ont pris Rhodes. Il faut encore citer Gênes, où Andrea Doria, prestigieux capitaine, sert successivement l'Espagne et la France… Ce que démontre Alessandro Barbero, c'est donc l'extrême subtilité de la géopolitique méditerranéenne dans les années qui précèdent Lépante.
En 1570, Chypre, possession de la République de Venise, tombe aux mains des Ottomans. À Rome, le pape Pie V s'efforce depuis longtemps de nouer les fils d'une coalition qui réunirait les États catholiques décidés à contrer l'expansion turque. La France de Charles IX, alors plongée dans les guerres de Religion et toujours alliée à la Porte, n'est pas concernée. La chute de Chypre, en l'occurrence, facilite la diplomatie pontificale. Appelant à la croisade contre les Turcs, le souverain pontife parvient à constituer une Sainte Ligue qui se dote d'une force navale destinée à porter le fer chez l'ennemi.
La victoire de Juan d'Autriche
 L'escadre chrétienne, formée pendant l'été 1571, se compose de navires espagnols et vénitiens, pour l'essentiel, avec l'appoint de vaisseaux du Saint-Siège, de Gênes, d'autres petits États de la péninsule italienne, du duché de Savoie et des Hospitaliers de Malte. Au milieu du mois de septembre, cette flotte quitte Messine. Le commandement est confié à l'infant Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint et demi-frère du roi d'Espagne Philippe II. L'escadre turque, au même moment, mouille devant le fort de Lépante (aujourd'hui Naupacte, non loin de Patras, en Grèce), sous la direction du capitaine de la mer Ali Pacha, qui est secondé par Euldj Ali, le gouverneur d'Alger. Ne se méfiant pas, les Ottomans se laissent prendre dans la nasse.
L'escadre chrétienne, formée pendant l'été 1571, se compose de navires espagnols et vénitiens, pour l'essentiel, avec l'appoint de vaisseaux du Saint-Siège, de Gênes, d'autres petits États de la péninsule italienne, du duché de Savoie et des Hospitaliers de Malte. Au milieu du mois de septembre, cette flotte quitte Messine. Le commandement est confié à l'infant Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint et demi-frère du roi d'Espagne Philippe II. L'escadre turque, au même moment, mouille devant le fort de Lépante (aujourd'hui Naupacte, non loin de Patras, en Grèce), sous la direction du capitaine de la mer Ali Pacha, qui est secondé par Euldj Ali, le gouverneur d'Alger. Ne se méfiant pas, les Ottomans se laissent prendre dans la nasse.La surprise — et le choc — ont lieu au petit matin du 7 octobre. 300 bateaux ottomans font face à 220 navires chrétiens, dont l'infériorité numérique est largement compensée par la puissance de feu. Dès le début de la bataille, les canons des six galéasses de Venise, premiers navires cuirassés, font des ravages. Les Espagnols, eux, prennent à l'abordage les galères ennemies, dont les équipages sont décimés par les hommes des tercios. Le navire amiral ottoman est pris à son tour, et Ali Pacha décapité. Quand sa tête apparaît au bout du mât du navire amiral espagnol, c'est la débandade chez les Turcs, Euldj Ali étant le seul à retraiter en bon ordre. À midi, l'affrontement est terminé. Il a été relativement bref, mais d'une extrême violence. La flotte chrétienne déplore 8.000 morts et 20.000 blessés ; les Ottomans, 30.000 morts ou blessés et 3.500 prisonniers. Sur les galères turques, 15.000 forçats chrétiens ont été libérés. Seulement une trentaine de navires ottomans se sont échappés : la flotte du sultan est anéantie. Les États chrétiens, eux, n'ont perdu qu'une douzaine de vaisseaux. À 24 ans, l'infant Juan d'Autriche entre dans la gloire…
« L'importance historique de Lépante — note Alessandro Barbero — tient surtout à son énorme impact émotif et à la propagande qui s'ensuivit. » Cette bataille montra aux Européens que les Turcs n'étaient pas invincibles, et le roi Philippe II se posa en rempart de la chrétienté. Mais d'un point de vue pratique, Lépante n'eut guère de conséquences : les dissensions entre chrétiens les empêchèrent de poursuivre leur avantage, les décourageant de tenter la reconquête des Dardanelles ou de Constantinople, rêve un temps caressé. En 1573, deux ans après cette bataille historique, Venise, asphyxiée par le coût de la guerre et par l'arrêt de son commerce avec l'Orient, négociera pourtant avec les Turcs et leur abandonnera Chypre, le prétexte initial du conflit. Le pape Pie V avait beau donner un sens mystique à la victoire de Lépante, la realpolitik, celle-là même qu'on reprochait au roi de France, reprenait ses droits dans l'Europe catholique.
◊ La Bataille des trois empires : Lépante, 1571, Alessandro Barbero, Flammarion. Traduit de l'italien par Patricia Farazzi et Michel Valensi.
► Jean Sévillia, Le Figaro Magazine, 07/09/2012.

Lépante a-t-elle sonné le glas de l’expansion ottomane ? Retour sur une bataille titanesque
Le 7 octobre, les forces coalisées du pape, du roi d’Espagne et de la République de Venise ravagent la flotte ottomane après avoir longtemps tergiversé. Récit coloré et vivant d’un grand événement historique, vu des deux côtés, chrétien et turc
De ce côté-ci de la Méditerranée, c’est sans doute une des batailles navales les plus représentées à l’époque moderne — difficile de parcourir un musée italien sans croiser au moins un tableau reproduisant l’affrontement des vaisseaux turcs et chrétiens au large de Lépante (aujourd’hui Naupacte) à la fin du XVIe siècle. Victoire éclatante et à vrai dire assez inespérée d’une coalition hispano-vénitienne mise sur pied par le pape Pie V contre la marine ottomane, l’événement a fait date dans la mémoire occidentale. S’agit-il pour autant d’un choc décisif des civilisations ? Du point d’arrêt mis par la fortune des armes à l’inexorable avancée turque vers le nord-ouest ? Ou la journée du 7 octobre 1571 n’a-t-elle finalement pas changé grand-chose à un processus déjà engagé ? Tous les grands événements historiques suscitent ce type d’interrogation mais peu y sont aussi propices que celui-ci, tant le hasard et les rendez-vous manqués semblent avoir joué un rôle dans l’issue du combat.
Esprit sceptique et conteur hors pair, Alessandro Barbero s’y engage avec maestria dans un récit coloré et vivant où le souci du détail événementiel habille la démarche critique sans jamais l’éclipser. Dans toute la mesure où les sources le permettent, il s’efforce de restituer aussi bien le point de vue ottoman que celui, reflété dans une abondance de récits, Mémoires, journaux et procès, des acteurs italiens et espagnols du drame. Chez ces derniers, c’est la rivalité, voire la méfiance et la duplicité qui dominent. À la tête chacun d’un empire méditerranéen fragilisé par l’avancée turque, le roi d’Espagne et la République de Venise ont autant d’ambitions concurrentes que d’intérêts communs. Et l’antagonisme est particulièrement vif entre la Sérénissime et Gênes, banquière et vassale de Philippe II. Sans la volonté de Pie V, passé de l’Inquisition au Saint-Siège, pourfendeur de juifs et d’hérétiques en tout genre, de faire l’unité des chrétiens face à la menace musulmane, la coalition n’aurait sans doute jamais vu le jour.
L’occasion se présente en 1570 avec la décision de Selim II de reprendre Chypre à Venise qui l’occupe depuis un siècle. Pour le jeune sultan, monté sur le trône quatre ans plus tôt à la mort de Soliman le Magnifique dont il est très loin d’avoir la trempe, il s’agit d’asseoir sa légitimité par une campagne victorieuse. Et comme le représente le vizir Sokullu Mehmet à l’ambassadeur de la Sérénissime à Constantinople, Marcantonio Barbaro, Chypre est si proche des côtes turques et si loin de la République qu’on se demande ce que cette dernière a à y faire… Si personne ne s’oppose franchement à la suggestion du pape de faire front commun contre l’offensive turque, chacun y va avec ses arrière-pensées, dont la plus répandue est qu’en s’y prenant adroitement, on évitera l’affrontement. Il faut dire qu’armer une flotte n’est chose facile d’aucun côté des Dardanelles. Tout fait problème : le bois, raréfié par la déforestation des côtes méditerranéennes, les charpentiers, la place dans les arsenaux, les rameurs et les soldats. Sans compter le typhus, qui ravage les équipages chrétiens en 1570 pour fondre sur les galères turques à l’automne suivant.
À ce moment, le camp chrétien a enfin réussi à s’unifier dans la Sainte Ligue dont la flotte, la plus importante jamais armée à ce jour, a pris tout l’été pour se rassembler à Messine, où elle a été placée sous le commandement de don Juan, frère cadet — et bâtard — de Philippe II. De Chypre, on ne parle plus guère : Nicosie est tombée en septembre 1570 déjà et Famagouste a capitulé deux mois plus tôt. Le gros de l’escadre turque est en Adriatique, où elle harcèle les possessions vénitiennes. La saison des combats touche à sa fin et, dans le camp chrétien, on est partagé entre le désir de gloire et celui de conserver ses galères intactes pour l’année suivante. Finalement, Selim II, en intimant à ses commandants de rester en Méditerranée plutôt que de revenir hiverner à Constantinople comme ils le voulaient, scelle le sort de sa flotte. Apprenant que cette dernière campe, affaiblie par un été belliqueux, dans le golfe de Lépante, Don Juan n’a plus d’autre choix que d’attaquer.
La bataille dure de midi au crépuscule. Plus nombreuses, les forces de la Sainte Ligue sont aussi beaucoup mieux pourvues en artillerie et elles peuvent compter sur l’appui dans les combats d’une partie de leurs rameurs, engagés volontaires. La flotte turque sort laminée de l’affrontement. Du côté chrétien, on songe un instant à continuer sur sa lancée pour attaquer quelque possession turque — Durazzo ou Valona dans l’Adriatique, voire Chypre ou même Constantinople. Mais on est déjà le 8 octobre, les dégâts sont importants et les vivres manquent. Finalement, l’avantage acquis sur le Turc ne sera pas exploité. Malgré cela, la victoire, on l’a dit, marque durablement les mémoires. La flotte reconstituée par le sultan au cours de l’hiver n’a pas la qualité de la précédente et ne sera pas en position de modifier en sa faveur les équilibres en Méditerranée. Stoppée sur terre devant Vienne en 1529, l’avancée turque est définitivement enlisée. Le poids précis de la victoire de Lépante dans un processus amorcé en amont dans les dynamiques internes propres à l’Empire ottoman est incertain. Mais l’événement reste décisif pour tous ceux qui, amiraux ou galériens, hommes ou femmes, ont été pris dans sa fabrication. Et dont Alessandro Barbero, jamais oublieux de la dimension humaine du récit historique, s’attache à détailler le sort, abject ou magnifique.
► Sylvie Arsever, Le Temps, sept. 2012.

Alessandro Barbero revisite la bataille de Lépante
La bataille de Lépante, qui opposait en 1571 l'Empire ottoman à l'Espagne de Philippe II et à la République de Venise, a bouleversé les empires et installé durablement un nouvel ordre mondial.
C'est très simple, la bataille de Lépante. En 1571, dans le détroit de Corinthe, une armada chrétienne écrabouille la flotte ottomane. La Sublime Porte y perd son hégémonie méditerranéenne tandis que Cervantès y gagne d'être manchot. C'est très simple, mais c'est complètement faux. Alessandro Barbero, dans un de ces virtuoses récits de bataille dont il a le secret, nous en convainc magistralement. Réglons d'abord le cas de Cervantès. Il n'en est pas question une seconde dans cette Bataille des trois empires. Non qu'il n'y ait pas participé, mais combattant parmi cinquante mille, il ne se distingue pas spécialement dans la mêlée. Pour le reste, c'est-à-dire, le principal, voici le récit d'une bataille, et surtout de sa préparation, qui nous conduit à réviser l'idée qu'ordinairement on s'en fait.
Alessandro Barbero nous invite, d'abord, à prendre la mesure des protagonistes. En intitulant son ouvrage La Bataille des trois empires, il désigne l'Empire ottoman, l'Espagne de Philippe II et la République de Venise. L'Espagne et Venise sont, en effet, les principales puissances adverses de Sélim II, le fils de Soliman le Magnifique. L'Espagne règle ses comptes avec ses morisques et dispute aux Turcs la maîtrise des ports de l'Afrique du Nord. De son côté, Venise redoute que Sélim II s'en prenne à ses possessions en Dalmatie et au Levant. A ces trois-là, il convient d'ajouter le pape, qui donne le ton de la croisade, et Gènes, qui met notamment le savoir-faire d'Andrea Doria au service de la flotte espagnole. On remarquera l'absence du royaume de France qui, dans cette affaire, est tout bonnement du côté du Turc.
Les hostilités sont ouvertes par les Turcs qui s'emparent de Chypre, possession vénitienne. D'abord, en prenant Nicosie puis, plus laborieusement, Famagouste. Pour réagir, pendant près d'un an, la coalition navale chrétienne va difficilement se constituer. L'Espagne hésite à s'engager, Venise ne peut affronter seule l'ennemi, le pape n'aligne qu'un nombre symbolique de galères. Au terme de ce long prélude à la constitution de la coalition, où la chrétienté a moins à voir que les conflits d'intérêts entre puissances, la bataille s'engage. Les Turcs sont écrasés pour une raison simple : ils ont trois fois moins de navires, d'armes et d'hommes. Est-ce alors la fin de l'hégémonie ottomane sur la Méditerranée ? Rien de tel. Un an plus tard, les Turcs ont reconstitué leur flotte, ils se sont durablement implantés en Afrique du Nord et ils gardent Chypre. Pour une victoire de la chrétienté, on repassera. Et pour les Turcs, c'est ce qui s'appelle perdre une bataille et gagner la guerre !
► Marc Riglet, Lire, sept. 2012.

L’épate Lépante : Chronique d’une bataille qui vit naître la propagande
Dans la mémoire occidentale, peu de batailles sont autant chargées de symbole que celle de Lépante. Dans les eaux de ce golfe de l’ouest de la Grèce s’affrontèrent plus de 100.000 hommes, le 7 octobre 1571, dans une gigantesque bataille navale qui s’acheva sur l’écrasement de la flotte ottomane par les forces pour la première — et dernière — fois réunies de Venise, du Saint-Siège et de l’Espagne sous la bannière d’une Sainte Ligue, parrainée par Pie V.
Elle fut célébrée comme un miracle qui sauva la chrétienté, voire Rome elle-même, de la déferlante turque. Avec l’imprimerie naissante, des libelles furent imprimés partout et se multiplièrent des tableaux montrant le triomphe de la flotte de la Croix commandée par Don Juan d’Espagne. « L’importance historique de Lépante tient surtout à son énorme impact émotif et à la propagande qui s’ensuivit. La nouvelle de la victoire fut accueillie dans les capitales catholiques avec un enthousiasme sans précédent, et ce d’autant plus qu’elle arrivait après des années de frustration et de disette », relève l’historien Alessandro Barbero, qui a su redonner toutes ses lettres de noblesse à ce genre d’«histoire des batailles » trop longtemps décrié.
Prophétie.
Comme il l’avait déjà fait pour Waterloo et Andrinople (la plus grosse défaite de l’Empire romain finissant en 378), il met tout son talent de conteur — car il est aussi romancier — à narrer ces 2 années, entre la conquête de Chypre par les forces ottomanes et leur défaite à Lépante, qui auraient fait basculer l’histoire de l’Europe. Les historiens, à commencer par le grand Fernand Braudel, ont pourtant mis en doute l’effet réel de Lépante. C’est aussi le point de vue d’Alessandro Barbero. La flotte ottomane était vieillie, mal équipée, affaiblie par les épidémies et la saison était déjà avancée. En ces temps, on ne faisait la guerre sur mer que l’été et les galères chrétiennes ou turques rentraient à leur port d’attache stambouliote fin octobre. Même si elle avait gagné, la flotte ottomane n’aurait donc pas pu aller plus loin, prendre Corfou, « l’œil de Venise dans l’Adriatique », et encore moins menacer la «pomme d’or» — la coupole de Saint-Pierre comme l’appelaient les Ottomans, convaincus selon une prophétie que bientôt ils auraient conquis Rome. En outre, un an plus tard à peine, la flotte est reconstituée. Plus nombreuse, plus moderne, avec canons et arquebuses, elle est surtout placée sous le commandement du grand Kilic Ali Pacha, renégat calabrais, devenu l’un des plus fameux pirates barbaresque et qui, seul lors de la bataille, réussit à enfoncer les galères chrétiennes et à ramener ses navires. « Ils m’ont juste coupé un poil de la barbe », commenta Selim II apprenant cette défaite dont il fut le premier responsable.
Année cruciale.
Petit-fils du conquérant de La Mecque et des lieux saints, fils de Soliman le Magnifique qui arriva jusqu’aux portes de Vienne, le nouveau sultan contrefait et alcoolique avait besoin d’une grande victoire pour asseoir son pouvoir. Les oulémas sans cesse lui rappelaient que, selon la tradition, seuls les tributs de chrétiens nouvellement soumis devaient payer les projets architecturaux dont il rêvait. Il pensa un moment secourir les morisques — musulmans convertis — qui venaient de se révolter en Andalousie. Contre l’avis d’une bonne partie de ses conseillers, il choisit de conquérir Chypre, déclenchant une guerre contre Venise, de longue date pourtant partenaire commercial de la Sublime Porte. Ainsi commença une guerre absurde qui devint rapidement, avec un pape Pie V tentant de monter une nouvelle croisade, celle de la Méditerranée chrétienne contre le péril turc. Seule la France resta fidèle à son alliance de revers nouée entre François Ier et Soliman.
Alternant récits vus du côté ottoman et des pays chrétiens, s’appuyant sur de nombreux témoignages de l’époque dont ceux de l’ambassadeur vénitien à Istanbul, Alessandro Barbero prend le ton de la chronique pour narrer cette année cruciale tout en montrant en filigrane les enjeux économiques de la guerre navale de l’époque. C’était déjà une guerre industrielle avec des chantiers navals et des arsenaux pour armer les galères. Il fallait trouver les hommes pour la chiourme. Lépante fut peut-être la dernière bataille globale en Méditerranée. « Plus jamais autant d’hommes ne se sont affrontés en un seul jour et en un espace aussi étroit » dans les eaux de cette mer, note l’historien. Le monde était déjà en train de basculer avec la colonisation des Amériques.
► Marc Semo, Libération 13-09-2012.
[habillage musical : Trevor Jones - The Kiss / Brian Briggs - Aeo (Parts 1 & 2)]
 Tags : guerre, Turquie
Tags : guerre, Turquie


