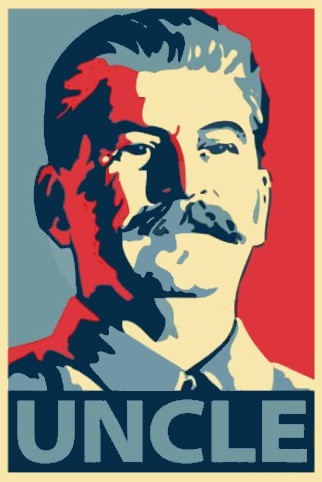-
Staline
 21 décembre 1879 : Naissance en Géorgie de Joseph Vissarionovitch Dougachvili, qui sera connu sous le nom de Staline, l’Homme de fer. Né dans le foyer d’un cordonnier géorgien et d’une Ossète (Ekaterine Geladse), dont les ancêtres étaient serfs, il fut quasiment le seul leader bolchevique à être issu d’un milieu aussi modeste. Après une scolarité brillante, il est admis au séminaire orthodoxe de Tiflis, une école connue pour son opposition au tsarisme. Dans le cadre de cette école, il entre en contact avec des propagandistes marxistes dès l’âge de 15 ans, qui lui communiquent des ouvrages, souvent français, interdits de lecture en Russie (Letourneau, Victor Hugo). À 18 ans, le jeune Joseph est actif dans les cercles socialistes géorgiens, ce qui conduit à son exclusion du séminaire en 1899.
21 décembre 1879 : Naissance en Géorgie de Joseph Vissarionovitch Dougachvili, qui sera connu sous le nom de Staline, l’Homme de fer. Né dans le foyer d’un cordonnier géorgien et d’une Ossète (Ekaterine Geladse), dont les ancêtres étaient serfs, il fut quasiment le seul leader bolchevique à être issu d’un milieu aussi modeste. Après une scolarité brillante, il est admis au séminaire orthodoxe de Tiflis, une école connue pour son opposition au tsarisme. Dans le cadre de cette école, il entre en contact avec des propagandistes marxistes dès l’âge de 15 ans, qui lui communiquent des ouvrages, souvent français, interdits de lecture en Russie (Letourneau, Victor Hugo). À 18 ans, le jeune Joseph est actif dans les cercles socialistes géorgiens, ce qui conduit à son exclusion du séminaire en 1899.Certes, son activisme avait motivé cette exclusion, mais aussi quelques solides échecs dans des examens importants, ratés parce qu’il avait été trop zélé dans son militantisme. Il finira par être arrêté une première fois en 1902, à la suite d’une manifestation à Batoum. Plusieurs relégations en Sibérie s’ensuivront, assorties d’autant d’évasions successives, qui le conduiront à un premier exil en Autriche-Hongrie en 1912 (Cracovie et Vienne). Entre-temps, il avait rencontré Lénine en 1905 et suivi son option “bolchevique”, lors du schisme entre minimalistes et maximalistes au sein du mouvement social-démocrate russe.
[ci-dessus ; Joseph Staline en 1902]
L’option maximaliste bolchevique, contrairement à l’option minimaliste “menchevique”, visait l’organisation d’une révolution violente, portée par des “révolutionnaires professionnels”. Pour financer cette révolution, Joseph Dougachvili organise des braquages de banques ; le plus célèbre de ces braquages eut lieu à Tiflis en 1907, où les bolcheviques parviennent à dérober la somme de 250.000 roubles. Arrêté à son retour en Russie fin 1912, il vivra en exil forcé, de 1913 à 1917, à Touroukhansk, où il restera cois, sans chercher à s’évader, pour ne pas être incorporé de force dans l’armée russe combattant les Allemands, les Autrichiens et les Turcs. Il revient de cet exil sibérien en 1917, accompagné de Lev Kamenev, son compagnon de détention. Il est nommé membre du “Comité exécutif central” des bolcheviques à la suite du Congrès panrusse des Soviets de juin 1917.
Le 7 novembre 1917, après le triomphe des bolcheviques, il devient Commissaire du Peuple aux Nationalités, alors que les nationalités non russes de l’Empire faisaient sécession et proclamaient leur indépendance. Les Bolcheviques ne contrôlaient plus qu’un espace correspondant peu ou prou à la Moscovie du temps d’Ivan le Terrible. Les seules nationalités qui se joignirent à la révolution furent les Tatars et les Bachkirs. Au départ de la Moscovie et des régions voisines du Tatarstan et du Bachkortostan, les Bolcheviques devront reconquérir les terres de l’ancien Empire russe, aux mains des troupes blanches, des armées ethniques sécessionnistes et de troupes alliées envoyées à la rescousse. En juin 1918, Staline parvient à reconquérir le cours inférieur de la Volga, dont la ville de Tsaritsyn qui deviendra Stalingrad en 1925. Au départ de cette position-clef sur la Volga, Staline entreprendra la reconquête du Caucase ; cette reconquête s’effectuera en plusieurs étapes : en février 1920, tous les peuples du Caucase septentrional sont incorporés dans l’Union Soviétique, à la suite d’une révolte générale contre le général blanc Denikine. Les Tchétchènes se révolteront ensuite contre les Soviétiques, ce qui induisit Staline à prononcer ce discours, qu’on relira avec étonnement, sur fond de la crise tchétchène actuelle : « Chaque peuple — les Tchétchènes, les Ingouches, les Ossètes, les Kabardines, les Balkars — doivent avoir leurs propres soviets. S’ils peuvent apporter la preuve que la Charia est nécessaire pour parvenir à cette fin, alors j’autorise la Charia. Si l’on peut m’apporter la preuve que les organes de la Tcheka ne comprennent pas le mode de vie propre et les autres particularités de la population et ne s’y adaptent pas, alors, il est clair que des changements devront intervenir dans cette région » (Discours tenu aux peuples de la région du Terek, 17 novembre 1920). Un mois plus tard, l’ensemble du Caucase, sauf la Géorgie, tombe aux mains des troupes soviétiques de Staline.
En février 1921, avec l’appui de son ami de jeunesse Sergo Ordchonikidse, la Géorgie, à son tour, entre dans le nouvel ordre soviétique. Cette victoire de Staline dans le Terek et le Caucase font de lui un héros respecté de la nouvelle Union Soviétique. Lénine est malade. Le pouvoir est détenu par une sorte de triumvirat, comprenant Staline, Kamenev et Zinoviev, tous trois hostiles à l’autre homme fort du régime, Léon Trotski. Staline se concentrera sur la consolidation de l’appareil bolchevique : ce qui amènera en bout de course à l’élimination de facto de Trotski, qui partira en exil au Turkestan puis à l’étranger en 1927, et au limogeage de Kamenev et Zinoviev dès 1926 (ils seront éliminés lors des purges de 1937). Staline devient alors maître absolu de l’URSS. Il inaugure sa politique de “socialisme dans un seul pays”, soit la réorganisation de l’URSS, et rejette l’idée d’une “révolution mondiale” préalable, le credo de Trotski, tout simplement parce qu’une telle révolution exigerait des moyens que ne possède pas la Russie soviétique exsangue et épuisée. Mondialiser la révolution la condamnerait à l’échec rapide devant les forces anti-bolchevistes du monde entier, et notamment de l’Empire britannique.
De 1927 à 1938, le pays connaîtra la collectivisation forcée, avec l’élimination de la classe paysanne des “koulaks”, et la persécution inlassable des dissidents, trotskistes et opposants à Staline, avec un instrument policier, le NKVD. Staline semble avoir poursuivi l’objectif de restaurer l’ancien Empire des Tsars sur toute l’étendue territoriale qui fut la sienne avant 1917 : guerre contre la Pologne et Pacte germano-soviétique, conquête de la Bessarabie, guerre contre la Finlande, succès diplomatiques à Yalta, annexion de la Ruthénie subcarpathique. Seule la Finlande a échappé à l’annexion directe. De même que la “Pologne du Congrès”.
Vainqueur avec l’appui américain en 1945, il reçoit une bonne moitié de l’Europe, afin de la maintenir dans le frigo et de l’arracher aux industries ouest-européennes, et surtout à la machine économique allemande, pour empêcher toute ré-émergence d’un concurrent pour les États-Unis sur la rive eurasienne de l’Atlantique Nord. Autre objectif de cette générosité de Roosevelt : fermer l’artère danubienne et empêcher toute projection européenne vers la Mer Noire.
Le seul intérêt de l’ère stalinienne après 1945, réside dans la volonté de contrer l’internationalisme américain (appuyé par les dissidences trotskistes, qui deviendront “néo-conservatrices” avec l’avènement de Reagan et de Bush-le-père, tout en contaminant les démocrates américains sous Clinton). Autre coup de théâtre diplomatique intéressant : les notes de 1952, où Staline propose la réunification de l’Allemagne et sa neutralisation. La proposition était intéressante et aurait permis plus tôt un envol de l’Europe occidentale hors de toute immixtion américaine. On imagine aisément l’aubaine qu’aurait été une Allemagne neutre, au moment où De Gaulle se désengageait de l’OTAN, après les troubles d’Algérie. Staline meurt, probablement empoisonné, le 5 mars 1953 à Kuntzevo près de Moscou. (Robert Steuckers)

 La diplomatie de Staline
La diplomatie de Staline[Ci-contre : Churchill, Roosevelt, Staline à la conférence de Yalta, fév. 1945]
L'histoire de notre siècle est enseignée du point de vue américain. Il en va ainsi de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre Froide et de la Guerre du Golfe. Dans l'optique américaine, le XXe siècle est le “siècle américain”, où doit s'instaurer et se maintenir un ordre mondial conforme aux intérêts américains, qui est simultanément la “fin de l'histoire”, le terminus de l'aventure humaine, la synthèse définitive de la dialectique de l'histoire. Francis Fukuyama, à la veille de la guerre du Golfe, affirmait qu'avec la chute du Rideau de fer et la fin de “l'hégélianisme de gauche” que représentait l'URSS, un seul modèle, celui du libéralisme américain, allait subsister pour les siècles des siècles. Sans que plus un seul challengeur ne se pointe à l'horizon. D'où la mission américaine était de réagir rapidement, en mobilisant le maximum de moyens, contre toute velleité de construire un ordre politique alternatif.
Quelques années avant Fukuyama, un auteur germano-américain, Theodore H. von Laue, prétendait que la seule véritable révolution dans le monde et dans l'histoire était celle de l'occidentalisation et que toutes les révolutions politiques non occidentalistes, tous les régimes basés sur d'autres principes que ceux en vogue en Amérique, étaient des reliquats du passé, que seuls pouvaient aduler des réactionnaires pervers que la puissance américaine, économique et militaire, allait allègrement balayer pour faire place nette à un hyper-libéralisme de mouture anglo-saxonne, débarrassé de tout concurrent.
Si l'hitlérisme est généralement considéré comme une force réactionnaire perverse que l'Amérique a contribué à éliminer d'Europe, on connaît moins les raisons qui ont poussé Truman et les protagonistes atlantistes de la Guerre Froide à lutter contre le stalinisme et à en faire également un croquemitaine idéologique, considéré explicitement par von Laue comme “réactionnaire” en dépit de son étiquette “progressiste”. Cette ambiguïté envers Staline s'explique par l'alliance américano-soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, où Staline était sympathiquement surnommé Uncle Joe. Pourtant, depuis quelques années, de nombreux historiens révisent intelligemment les poncifs que 45 ans d'atlantisme forcené ont véhiculé dans nos médias et nos livres d'histoire.
L'Allemand Dirk Bavendamm a démontré dans deux ouvrages méticuleux et précis quelles étaient les responsabilités de Roosevelt dans le déclenchement des conflits américano-japonais et américano-allemand et aussi quelle était la duplicité du Président américain à l'égard de ses alliés russes. Valentin Faline, ancien ambassadeur d'URSS à Bonn, vient de sortir en Allemagne un ouvrage de souvenirs historiques et de réflexions historiographiques, où ce brillant diplomate russe affirme que la Guerre Froide a commencé dès le débarquement anglo-américain de juin 1944 sur les plages de Normandie : en déployant leur armada naval et aérien, les puissances occidentales menaient déjà une guerre contre l'Union Soviétique et non plus contre la seule Allemagne moribonde.
Staline, diplomate traditionnel
Une lecture attentive de plusieurs ouvrages récents consacrés aux multiples aspects de la résistance allemande contre le régime hitlérien nous oblige à renoncer définitivement à interpréter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'alliance anglo-américano-soviétique selon le mode devenu conventionnel. L'hostilité à Staline après 1945 provient surtout du fait que Staline entendait pratiquer une diplomatie générale basée sur les relations bilatérales entre les nations, sans que celles-ci ne soient chapeautées par une instance universelle comme l'ONU. Ensuite, après avoir appris que les deux puissances anglo-saxonnes avaient décidé seules à Casablanca de faire la guerre à outrance au Reich, de déclencher la guerre totale et d'exiger la capitulation sans condition de l'Allemagne nationale-socialiste, Staline s'est senti exclu par ses alliés. Furieux, il a concentré sa colère dans cette phrase bien ciselée, en apparence anodine, mais très significative : « Les Hitlers vont et viennent, le peuple et l'État allemands demeurent ».
Staline ne concevait pas le national-socialisme hitlérien comme le mal absolu ou même comme une essence impassable, mais comme un accident de l'histoire, une vicissitude contrariante pour la Russie éternelle, que les armes soviétiques allaient tout simplement s'efforcer d'éliminer. Mais, dans la logique diplomatique traditionnelle, qui est restée celle de Staline en dépit de l'idéologie messianique marxiste, les nations ne périssent pas : on ne peut donc pas exiger de capitulation inconditionnelle et il faut toujours laisser la porte ouverte à des négociations. En pleine guerre, les alliances peuvent changer du tout au tout, comme le montre à l'envi l'histoire européenne. Staline se borne à réclamer l'ouverture d'un second front, pour soulager les armées soviétiques et épargner le sang russe : mais ce front n'arrive que très tard, ce qui permet à Valentin Faline d'expliquer ce retard comme le premier acte de la Guerre Froide entre les puissances maritimes anglo-saxonnes et la puissance continentale soviétique.
Cette réticence stalinienne s'explique aussi par le contexte qui précéda immédiatement l'épilogue de la longue bataille de Stalingrad et le débarquement des Anglo-Saxons en Normandie. Quand les armées de Hitler et de ses alliés slovaques, finlandais, roumains et hongrois entrent en URSS le 22 juin 1941, les Soviétiques, officiellement, estiment que les clauses du Pacte Molotov / Ribbentrop ont été trahies et, en automne 1942, après la gigantesque offensive victorieuse des armées allemandes en direction du Caucase, Moscou est contrainte de sonder son adversaire en vue d'une éventuelle paix séparée : Staline veut en revenir aux termes du Pacte et compte sur l'appui des Japonais pour reconstituer, sur la masse continentale eurasiatique, ce “char à quatres chevaux” que lui avait proposé Ribbentrop en septembre 1940 (ou Pacte Quadripartite entre le Reich, l'Italie, l'URSS et le Japon). Staline veut une paix nulle : la Wehrmacht se retire au-delà de la frontière fixée de commun accord en 1939 et l'URSS panse ses plaies.
Plusieurs agents participent à ces négociations, demeurées largement secrètes. Parmi eux, Peter Kleist [auteur de Zwischen Hitler und Stalin, 1939-1945], attaché à la fois au Cabinet de Ribbentrop et au Bureau Rosenberg. Kleist, nationaliste allemand de tradition russophile en souvenir des amitiés entre la Prusse et les Tsars, va négocier à Stockholm, où le jeu diplomatique sera serré et complexe. Dans la capitale suédoise, les Russes sont ouverts à toutes les suggestions ; parmi eux, l'ambassadrice Kollontaï et le diplomate Semionov. Kleist agit au nom du Cabinet Ribbentrop et de l'Abwehr de Canaris (et non pas du Bureau Rosenberg qui envisageait une balkanisation de l'URSS et la création d'un puissant État ukrainien pour faire pièce à la “Moscovie”). Le deuxième protagoniste dans le camp allemand fut Edgar Klaus, un Israëlite de Riga qui fait la liaison entre les Soviétiques et l'Abwehr (il n'a pas de relations directes avec les instances proprement nationales-socialistes).
Aux origines de l'attentat du 20 juillet 1944
Dans ce jeu plus ou moins triangulaire, les Soviétiques veulent le retour au statu quo ante de 1939. Hitler refuse toutes les suggestions de Kleist et croit pouvoir gagner définitivement la bataille en prenant Stalingrad, clef de la Volga, du Caucase et de la Caspienne. Kleist, qui sait qu'une cessation des hostilités avec la Russie permettrait à l'Allemagne de rester dominante en Europe et de diriger toutes ses forces contre les Britanniques et les Américains, prend alors langue avec les éléments moteurs de la résistance anti-hitlérienne, alors qu'il est personnellement inféodé aux instances nationales-socialistes ! Kleist contacte donc Adam von Trott zu Solz et l'ex-ambassadeur du Reich à Moscou, von der Schulenburg.
Il ne s'adresse pas aux communistes et estime, sans doute avec Canaris, que les négociations avec Staline permettront de réaliser l'Europe de Coudenhove-Kalergi (sans l'Angleterre et sans la Russie), dont rêvaient aussi les Catholiques. Mais les Soviétiques ne s'adressent pas non plus à leurs alliés théoriques et privilégiés, les communistes allemands : ils parient sur la vieille garde aristocratique, où demeure le souvenir de l'alliance des Prussiens et des Russes contre Napoléon, de même que celui de la neutralité tacite des Allemands lors de la guerre de Crimée. Comme Hitler refuse toute négociation, Staline, la résistance aristocratique, l'Abwehr et même une partie de sa garde prétorienne, la SS, décident qu'il doit disparaître. C'est là qu'il faut voir l'origine du complot qui allait conduire à l'attentat du 20 juillet 1944.
Mais après l'hiver 42-43, les Soviétiques reprennent pied à Stalingrad et détruisent le fer de lance de la Wehrmacht, la VIe Armée qui encerclait la métropole de la Volga. La carte allemande des Soviétiques sera alors constituée par le Comité Allemagne Libre, avec le maréchal von Paulus et des officiers comme von Seydlitz-Kurzbach, tous prisonniers de guerre. Staline n'a toujours pas confiance dans les communistes allemands, dont il a fait éliminer les idéologues irréalistes et les maximalistes révolutionnaires trotskistes, qui ont toujours ignoré délibérément, par aveuglement idéologique, la notion de patrie et les continuités historiques pluriséculaires.
Finalement, le dictateur géorgien ne garde en réserve, à toutes fins utiles, que Pieck, un militant qui ne s'est jamais trop posé de questions. Pieck fera carrière dans la future RDA. Staline n'envisage même pas un régime communiste pour l'Allemagne post-hitlérienne : il veut un “ordre démocratique fort”, avec un pouvoir exécutif plus prépondérant que sous la République de Weimar. Ce vœu politique de Staline correspond parfaitement à son premier choix : parier sur les élites militaires, diplomatiques et politiques conservatrices, issues en majorité de l'aristocratie et de l'Obrigkeitsstaat prussien. La démocratie allemande, qui devait venir après Hitler selon Staline, serait d'idéologie conservatrice, avec une fluidité démocratique contrôlée, canalisée et encadrée par un système d'éducation politique strict.
Les Britanniques et les Américains sont surpris : ils avaient cru que l'Uncle Joe allait avaliser sans réticence leur politique maximaliste, en rupture totale avec les usages diplomatiques en vigueur en Europe. Mais Staline, comme le Pape et Bell, l'Evêque de Chichester, s'oppose au principe radicalement révolutionnaire de la reddition inconditionnelle que Churchill et Roosevelt veulent imposer au Reich (qui demeurera, pense Staline, en tant que principe politique en dépit de la présence éphémère d'un Hitler). Si Roosevelt, en faisant appel à la dictature médiatique qu'il tient bien en mains aux États-Unis, parvient à réduire au silence ses adversaires, toutes idéologies confondues, Churchill a plus de difficulté en Angleterre. Son principal adversaire est ce Bell, Évêque de Chichester.
Pour ce dernier, il n'est pas question de réduire l'Allemagne à néant, car l'Allemagne est la patrie de Luther et du protestantisme. Au jusqu'au-boutisme churchillien, Bell oppose la notion d'une solidarité protestante et alerte ses homologues néerlandais, danois, norvégiens et suédois, de même que ses interlocuteurs au sein de la résistance allemande (Bonhoeffer, Schönfeld, von Moltke), pour faire pièce au bellicisme outrancier de Churchill, qui s'exprima par les bombardements massifs d'objectifs civils, y compris dans les petites villes sans infrastructure industrielle importante. Pour Bell, l'avenir de l'Allemagne n'est ni le nazisme ni le communisme mais un “ordre libéral et démocratique”. Cette solution, préconisée par l'Évêque de Chichester, n'est évidemment pas acceptable pour le nationalisme allemand traditionnel : il constitue un retour subtil à la Kleinstaaterei, à la mosaïque d'États, de principautés et de duchés, que les visions de List, de Wagner, etc., et la poigne de Bismarck avaient effacé du centre de notre continent.
“L'ordre démocratique fort” suggéré par Staline est plus acceptable pour les nationalistes allemands, dont l'objectif a toujours été de créer des institutions et une paedia [éducation] fortes pour protéger le peuple allemand, la substance ethnique germanique, de ses propres faiblesses politiques, de son absence de sens de la décision, de son particularisme atavique et de ses tourments moraux incapacitants. Aujourd'hui, effectivement, maints observateurs nationalistes constatent que le fédéralisme de la constitution de 1949 s'inscrit peut-être bel et bien dans une tradition juridico-constitutionnelle allemande, mais que la forme qu'il a prise, au cours de l'histoire de la RFA, révèle sa nature d'octroi. Un octroi des puissances anglo-saxonnes…
Face aux adversaires de la capitulation inconditionnelle au sein de la grande coalition anti-hitlérienne, la résistance allemande demeure dans l'ambiguïté : Beck et von Hassell sont pro-occidentaux et veulent poursuivre la croisade anti-bolchevique, mais dans un sens chrétien ; Goerdeler et von der Schulenburg sont en faveur d'une paix séparée avec Staline. Claus von Stauffenberg, auteur de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, provient des cercles poético-ésotériques de Munich, où le poète Stefan George joua un rôle prépondérant. Stauffenberg est un idéaliste, un “chevalier de l'Allemagne secrète” : il refuse de dialoguer avec le Comité Allemagne Libre de von Paulus et von Seydlitz-Kurzbach : « on ne peut pas accorder foi à des proclamations faites derrière des barbelés ».
Les Notes caucasiennes d'Ernst Jünger
Les partisans d'une paix séparé avec Staline, adversaires de l'ouverture d'un front à l'Est, ont été immédiatement attentifs aux propositions de paix soviétiques émises par les agents en place à Stockholm. Les partisans d'une “partie nulle” à l'Est sont idéologiquement des “anti-occidentaux”, issus des cercles conservateurs russophiles (comme le Juni-Klub ou les Jungkonservativen dans le sillage de Moeller van den Bruck) ou des ligues nationales-révolutionnaires dérivées du Wandervogel ou du nationalisme soldatique. Leur espoir est de voir la Wehrmacht se retirer en bon ordre des terres conquises en URSS et se replier en-deçà de la ligne de démarcation d'octobre 1939 en Pologne. C'est en ce sens que les exégètes contemporains de l'œuvre d'Ernst Jünger interprètent son fameux texte de guerre, intitulé Notes caucasiennes.
Ernst Jünger y perçoit les difficultés de stabiliser un front dans les immenses steppes d'au-delà du Don, où le gigantisme du territoire interdit un maillage militaire hermétique comme dans un paysage centre-européen ou picard-champenois, travaillé et retravaillé par des générations et des générations de petits paysans opiniâtres qui ont maillé le territoire d'enclos, de propriétés, de haies et de constructions d'une rare densité, permettant aux armées de s'accrocher sur le terrain, de se dissimuler et de tendre des embuscades.
Il est très vraisemblable que Jünger ait plaidé pour le retrait de la Wehrmacht, espérant, dans la logique nationale-révolutionnaire, qui avait été la sienne dans les années 20 et 30, et où la russophilie politico-diplomatique était bien présente, que les forces russes et allemandes, réconciliées, allaient interdire à tout jamais l'accès de la “forteresse Europe”, voire de la “forteresse Eurasie”, aux puissances thalassocratiques, qui pratiquent systématiquement ce que Haushofer nommait la politique de l'anaconda, pour étouffer toutes les velleités d'indépendance sur les franges littorales du Grand Continent (Europe, Inde, Pays arabes, etc.).
Ernst Jünger rédige ses notes caucasiennes au moment où Stalingrad tombe et où la VIe Armée est anéantie dans le sang, l'horreur et la neige. Mais malgré la victoire de Stalingrad, qui permet aux Soviétiques de barrer la route du Caucase et de la Caspienne aux Allemands et d'empêcher toute manœuvre en amont du fleuve, Staline poursuit ses pourparlers en espérant encore jouer une “partie nulle”. Les Soviétiques ne mettent un terme à leurs approches qu'après les entrevues de Téhéran (28 novembre - 1er décembre 1943). À ce moment-là, Jünger semble s'être retiré de la résistance. Dans son célèbre interview au Spiegel en 1982, immédiatement après avoir reçu le Prix Goethe à Francfort, il déclare : « Les attentats renforcent les régimes qu'ils veulent abattre, surtout s'ils ratent ».
Jünger, sans doute comme Rommel, refusait la logique de l'attentat. Ce qui ne fut pas le cas de Claus von Stauffenberg. Les décisions prises par les Alliés occidentaux et les Soviétiques à Téhéran rendent impossibles un retour à la case départ, c'est-à-dire à la ligne de démarcation d'octobre 1939 en Pologne. Soviétiques et Anglo-Saxons se mettent d'accord pour “déménager l'armoire Pologne” vers l'Ouest et lui octroyer une zone d'occupation permanente en Silésie et en Poméranie. Dans de telles conditions, les nationalistes allemands ne pouvaient plus négocier et Staline était d'office embarqué dans la logique jusqu'au-boutiste de Roosevelt, alors qu'il l'avait refusée au départ. Le peuple russe paiera très cher ce changement de politique, favorable aux Américains.
Réunification et “ordre démocratique fort”
Après 1945, en constatant que la logique de la Guerre Froide vise un encerclement et un containment de l'Union Soviétique pour l'empêcher de déboucher sur les mers chaudes, Staline réitère ses offres à l'Allemagne exsangue et divisée : la réunification et la neutralisation, c'est-à-dire la liberté de se donner le régime politique de son choix, notamment un “ordre démocratique fort”. Ce sera l'objet des notes de Staline de 1952. Le décès prématuré du Vojd soviétique en 1953 ne permet pas à l'URSS de continuer à jouer cette carte allemande.
Khrouchtchev dénonce le stalinisme, embraye sur la logique des blocs que refusait Staline et ne revient à l'anti-américanisme qu'au moment de l'affaire de Berlin (1961) et de la crise de Cuba (1962). On ne reparlera des notes de Staline qu'à la veille de la perestroïka, pendant les manifestations pacifistes de 1980-83, où plus d'une voix allemande a réclamé l'avènement d'une neutralité en dehors de toute logique de bloc. Certains émissaires de Gorbatchev en parlaient encore après 1985, notamment le germaniste Vyateslav Dachitchev, qui prit la parole partout en Allemagne, y compris dans quelques cercles ultra-nationalistes.
À la lumière de cette nouvelle histoire de la résistance allemande et du bellicisme américain, nous devons appréhender d'un regard nouveau le stalinisme et l'anti-stalinisme. Ce dernier, par exemple, sert à répandre une mythologie politique bricolée et artificielle, dont l'objectif ultime est de rejeter toute forme de concert international reposant sur des relations bilatérales, d'imposer une logique des blocs ou une logique mondialiste par le truchement de cet instrument rooseveltien qu'est l'ONU (Corée, Congo, Irak : toujours sans la Russie !), de stigmatiser d'avance tout rapport bilatéral entre une puissance européenne moyenne et la Russie soviétique (l'Allemagne de 1952 et la France de De Gaulle après les événements d'Algérie). L'anti-stalinisme est une variante du discours mondialiste. La diplomatie stalinienne, elle, était à sa façon, et dans un contexte très particulier, conservatrice des traditions diplomatiques européennes.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°17, 1996.
♦ Voir aussi ces 2 articles de Luc Nannens sur la diplomatie durant l'entre-deux-guerres : Relations germano-soviétiques de 1918 à 1944, Relations germano-espagnoles de 1936 à 1940.
◘ Bibliographie :
- Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 1914-1939, Herbig, München, 1983.
- Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Krieg 1937-45 und das Rätsel von Pearl Harbour, Herbig, München, 1993.
- Valentin FALIN, Zweite Front. Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition, Droemer-Knaur, München, 1995.
- Francis FUKUYAMA, La fin de l'histoire et le dernier homme, Flamm., 1992.
- Klemens von KLEMPERER, German Resistance Against Hitler. The Search for Allies Abroad. 1938-1945, Oxford Univ. Press/Clarendon Press, 1992-94.
- Th von LAUE, The World Revolution of Westernization. The Twentieth Century in Global Perspective, Oxford Univ. Pr., 1987.
- Jürgen SCHMÄDEKE/Peter STEINBACH (Hrsg.), Der Widerstand gegen den National-Sozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Piper (SP n°1923), München, 1994.
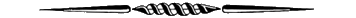
La géopolitique de Staline
• Avant-propos : La question territoriale russe a été primordiale. Immédiatement après la Révolution de 1917. Néo-nationaliste russe d’aujourd’hui, Sergueï Constantinov dévoile dans son texte — qui choquera sans doute beaucoup d’Occidentistes sinon d’Occidentaux — ce que retiennent les patriotes actuels du stalinisme. Ils reprochent à Lénine et à Gorbatchev d’avoir accepté le principe de la sécession et adhèrent au principe stalinien de l’autonomie sans droit de sécession. Ces questions peuvent paraître vaines à l’observateur ouest-européen d’aujourd’hui, mais le débat entre Lénine et Staline sur les questions nationalitaires dans l’ex-empire russe ou dans l’ex-URSS constituent un débat de base sur toute organisation continentale. En effet, un peuple a pleinement droit à son autonomie ou à son indépendance culturelle. Il n’a pas le droit d’opérer une sécession en faisant simultanément le jeu d’un adversaire global, dont les bases se situent sur un autre continent, ayant intérêt à organiser le chaos sur les rives qui lui font face. Mais les franges frontalières de l’ex-empire russe ne pouvaient pas admettre d’être coupées du reste de l’Europe. La pratique de la sécession, dans leur cas, peut être acceptée d’un point de vue ouest-européiste mais non d’un point de vue eurasien ou d’un point de vue qui donnerait à l’OSCE le rôle d’organiser organiquement et militairement le destin des peuples d’Europe et de l’ex-URSS.
***
Après la Restauration des Bourbons en 1814, toute l’histoire de France, de Mirabeau et Robespierre jusqu’à Napoléon, fut rayée des mémoires et des manuels ou frappée de malédiction ; de même, en Russie, la période stalinienne de l’histoire nationale fut livrée au plus cruel des ostracismes et non plus étudiée objectivement. D’une certaine façon, on peut le comprendre : les individus, enivrés par l’idéologie libérale du marché, n’auront de chances de succès dans un pays dont l’intégrité territoriale, l’économie et la culture ont été ravagées de fond en comble, où domine désormais une conscience nationale dégradée, que s’ils parviennent à imposer une relation sado-masochiste à l’égard des temps d’héroïque abnégation du peuple soviétique et de son chef Staline. Tout comme autrefois en France Robespierre et Napoléon furent soumis, à titre posthume, au jugement de la valetaille et des débris de l’aristocratie bourbonnaise, aujourd’hui, en Russie, Staline est livré au jugement posthume des valets du “nouveau mode de pensée” gorbatchevien dont les spécialistes démographes seraient bien avisés, d’ailleurs, de dresser le bilan du nombre des victimes.
Génie et scélératesse
L’histoire a réfuté — et continue à réfuter — la formule de Pouchkine selon laquelle « génie et scélératesse sont deux choses incompatibles ». Tous les grands empires mondiaux furent créés précisément par ceux qui combinaient en eux génie et scélératesse. La malédiction portée contre l’empire que fut l’URSS est un défi à la logique de toute l’histoire mondiale. Ce n’est pas par hasard que la fraction anti-nationale de l’élite soviétique, ayant maudit et abjuré l’URSS, s’oriente maintenant à grands pas vers le rabaissement de l’ensemble du passé impérial de la Russie séculaire : les ennemis de toute forme d’empire comprennent parfaitement que les sentiments impériaux du peuple représentent l’un des principaux obstacles sur la voie de notre défaite définitive dans la “guerre froide” menée contre les États-Unis et leurs alliés.
La qualité géopolitique des plans et des actes de Staline doit faire l’objet d’une étude honnête et sérieuse, indépendamment de tout cliché idéologique, étude destinée à contribuer au rétablissement de nos aspirations géopolitiques eurasiennes perdues, sans la réalisation desquelles la Russie est vouée au rôle de colonie impitoyablement exploitée par les bâtisseurs du “nouvel ordre mondial” qui décideront dans quelles frontières il lui faudra exister. Ainsi, en avril 1992, dans le projet de politique extérieure de Fonds américain du Patrimoine, Kim R. Holmes et Jay P. Kozminski conseillaient avec insistance à l’administration des États-Unis de tout faire afin que « l’Union Soviétique ou un État semblable ne puisse plus jamais apparaître ». Plus loin dans ce rapport, on vise à prévenir le possible rétablissement de l’URSS ou d’un État similaire, et on recommande au Pentagone de « continuer les recherches et les applications dans les domaines de la défense anti-sous-marine, des armes de grande précision, des technologies anti-satellites » et autres formes d’armement. Tout cela afin que l’Amérique puisse continuer « même par la suite à jouer un rôle global (…) nécessaire pour la défense des États-Unis (…) de ne pas admettre le contrôle par des puissances hostiles aux États-Unis des principaux centres industriels d’Europe et d’Asie, ainsi que sur cette région-clé pour les matières premières, le Golfe Persique ».
Le potentiel de la géopolitique de Staline
Les patriotes de Russie, en s’appuyant sur les meilleurs travaux nationaux de géopolitique, doivent s’opposer à un schéma aussi impitoyable. Et ici, le potentiel de la géopolitique de Staline est susceptible de rendre un éminent service. C’est à ce titre que Staline doit intéresser aujourd’hui les patriotes : non pas comme “fossoyeur de la révolution” et “combattant contre le sionisme”, mais comme géopoliticien, étatiste et homme d’empire ayant résolu une série de problèmes fondamentaux en faveur de la Russie avec une dimension véritablement impériale et une force devant laquelle durent plier et battre en retraite les principaux impérialistes de ce XXe siècle, eux aussi politiciens assez retors, Roosevelt et Churchill.
Staline, le rassembleur de la Russie
En 1951, la célèbre historien S. P. Melgounov écrivit dans l’un de ses articles qu’il n’y a pas en Russie « de combustible dont l’allumage pourrait mener à la désintégration du pays. Le mal bolchevik contemporain, lui-même, peut rendra un grand service : le bolchevisme lie puissamment antre elles les nationalités de Russie ; le pouvoir sinistre de la dictature du Kremlin, quoiqu’il en soit, existe dans l’intérêt immédiat de l’unité nationale ». Pour connaître le rôle joué par Staline dans le maintien de l’unité nationale russe, il suffit d’examiner les faits.
Le Staline étatiste et unitariste s’était formé déjà dans la période d’avant octobre de l’histoire du bolchevisme. Dans son ouvrage fondamental, Marxisme et question nationale (1913), il voyait la seule solution possible de ce problème dans l’autonomie régionale d’« unités déterminées comme la Pologne, la Lituanie, l’Ukraine, le Caucase, etc. », sans faire aucune allusion à une possible séparation.
Au cours de cette même année 1913, la réunion du CC du POSDR à Poroninskoe (à laquelle Staline, alors en exil, n’assistait pas) adopta la résolution rédigée et présentée par Lénine dans laquelle le droit des nations à l’auto-détermination était considéré comme le droit de chaque peuple de Russie à la sécession et à la formation d’un État indépendant. Il est intéressant de remarquer que Lénine avait l’intention de neutraliser par l’instinct anti-séparatiste de Staline les effets spontanés et fortuits pour les bolcheviks de cette bombe à retardement dirigée contre l’intégrité territoriale de la Russie. Ainsi, la résolution de Poroninskoe stipulait que « la question du droit des nations à l’autodétermination est indissolublement liée à la question de la rationalité de la séparation d’une nation quelconque ». Cette proposition reproduisait presque textuellement la thèse stalinienne selon laquelle la social-démocratie n’était aucunement obligée et ne comptait d’ailleurs pas « défendre n’importe quelle exigence des nations ».
Le désaccord entre Lénine et Staline concernant l’utilité pratique pour l’intégrité territoriale de la Russie du mot d’ordre de l’auto-détermination des nations prit des contours plus nets peu après la révolution de février 1917. À la 7ème Conférence du POSDR (b) qui eut lieu en avril de cette même année, Staline, contrairement à Lénine, évita les prévisions provocantes en mentionnant le nom des régions de Russie qui, de la manière la plus vraisemblable et avant les autres, accompliraient leur droit à la sécession. Alors que Lénine déclarait avec légèreté : « Nous sommes indifférents, neutres vis-à-vis du mouvement séparatiste ; il n’y a rien de mal à ce que la Finlande, la Pologne et l’Ukraine se séparent de la Russie » ; Staline, lui, déclarait prudemment mais fermement : « Je peux reconnaître à une nation le droit de se séparer, mais cela ne signifie pas que je l’aie obligé à le faire. Personnellement, par exemple, je me prononcerais contre la sécession de la Transcaucasie ».
L’anti-fédéralisme de Staline
Staline, au surplus, exprimait son assurance qu’après l’abolition du tsarisme, « les neuf dixièmes des nationalités n’aient pas envie de se séparer… L’attraction en direction de la Russie devrait croître ». Il m’apparaît intéressant de noter qu’avant octobre 1917, Staline fut un adversaire conséquent de la fédéralisation de la Russie, ce qu’on ne peut nullement dire à propos de Lénine, lequel méditait encore sérieusement, au début de 1916, sur la possibilité de l’implantation artificielle d’une fédération dans notre pays. C’est ainsi que Lénine considérait que, tout en restant un adversaire résolu de la fédération, on pouvait cependant « préférer la fédération à une inégalité nationale en droit comme unique voie vers un socialisme démocratique intégral ». Dans un article de mars 1917, intitulé « Contre le fédéralisme », Staline démontrait, quant à lui, qu’il était absurde pour la Russie à chercher à « établir une fédération vouée à la disparition par la vie même », dans la mesure où il était « absurde et réactionnaire de rompre les liens économiques et politiques existants, liant les régions entra elles ».
Staline fédéraliste
Après octobre 1917, cependant, Staline non seulement devint partisan de la fédéralisation de la Russie mais réalisa encore, en qualité de commissaire du peuple aux affaires des nationalités, la décentralisation pratique du pays conformément au plan de Lénine. Pour comprendre les raisons qui poussèrent Staline à passer subitement au fédéralisme, il convient d’examiner la signification géopolitique de la lutte des bolcheviks contre leurs adversaires.
Il faut souligner, premièrement, que le démembrement de la Russie avait commencé déjà avant l’arrivée au pouvoir des bolcheviks. Le 20 juin 1917, au premier Congrès national des Soviets des députés ouvriers et soldats, où la représentativité des bolcheviks était deux fois et demie moindre que celle des socialistes-révolutionnaires et des mencheviks, une résolution fut adoptée, exigeant que la Russie entra sur la voie de la décentralisation du gouvernement et proclamant « la reconnaissance pour tous les peuples du droit à l’autodétermination y compris jusqu’à la sécession ». Un témoin des événements d’alors, N. N. Choukhanov-Himmer, note dans ses mémoires que la situation était « compliquée et absurde ». « Les petites nationalités russes existantes ou imaginaires qui avaient obtenu leur liberté ne connurent effectivement aucune retenue et déchirèrent en morceaux l’organisme national ». Ce ne furent donc pas les bolcheviks mais bien la démocratie maçonnique qui fut responsable de la chute de la monarchie en février 1917, c’est elle, effectivement, qui asséna le premier et le principal coup à l’intégrité territoriale de la Russie, semant l’ivraie du séparatisme sous couvert d’une démagogique “souveraineté des nations”. Les meneurs de cette démocratie n’étaient rien d’autre que les agents d’influence des pays de l’Entente et des États-Unis : en poursuivant la guerre stupide, provoquée par les atlantistes (i.e. : les thalassocraties marchandes, ndlr), entre la Russie, d’une part, et l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, d’autre part, ils apparaissent nécessairement comme les “traîtres géopolitiques” du point de vue de l’Eurasie.
Deuxièmement, les bolcheviks, une fois arrivés au pouvoir, hâtèrent la fédéralisation de la Russie pour, avant toute chosa, brouiller les cartes de leurs adversaires, à commencer par les anciens alliés de l’Entente qui, en décembre 1917, avaient conclu une convention secrète sur le partage des sphères d’activité dans notre pays. Ce jeu dangereux fut gagné par les bolcheviks. Le célèbre diplomate soviétique G. V. Tchitchérine avait raison lorsqu’il écrivait que le programme national de Lénine « exerça la plus grande influence sur nos adversaires qui commencèrent à hésiter entre le soutien à une Russie blanche “une et indivisible” et la contribution au développement des mouvements contre-révolutionnaires des petites nationalités ».
Les Blancs ont admis le travail unificateur des bolcheviks
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les chefs du mouvement blanc, Koltchak et Denikine, ne contribuèrent pas peu à l’heureuse réalisation de ce programme. C’est du moins ce que reconnut ouvertement dans ses Souvenirs, le responsable aux Affaires du gouvernement sibérien de Koltchak, G. Gins : « Il n’est qu’un point sur lequel le bolchevisme et ses ennemis se rencontraient. (…) C’est la question de l’Unité de la Russie. (…) Ni l’amiral Koltchak, ni le général Denikine ne pouvaient trouver de langage commun avec des individus enclins au séparatisme. Les bolcheviks qui, en tant qu’internationalistes, étaient parfaitement indifférents à l’idée d’Unité de la Russie, en furent effectivement les unificateurs ».
Ironie de l’histoire, c’est précisément la force anti-russe et anti-centralisatrice du bolchevisme qui se trouva être la seule capable de rétablir l’unité de la Russie. Il serait malhonnête, une fois reconnue l’essence terroriste et anti-orthodoxe du bolchevisme, de l’oublier et de ne pas prendre en considération le fait qu’en ces terribles années, c’est tout de même l’Armée Rouge qui défendit l’indépendance nationale contre les menées sans précédent de l’intervention étrangère de 14 pays, provoquée, une fois de plus, par les atlantistes. Les ennemis du bolchevisme, d’ailleurs, le reconnurent aux-mêmes. C’est ainsi que le politicien V. V. Choulguina, proche de Denikine, portant un jugement sur la guerre soviéto-polonaise de 1920, écrivit que « l’Armée Rouge avait battu les Polonais comme des Polonais précisément parce qu’ils s’étaient emparés de régions purement russes ».
Troisièmement, Lénine, et plus particulièrement Staline, comprenaient très bien, en dépit de la décentralisation réalisée en Russie, l’impossibilité de maintenir le pays dans une pareille atmosphère et dans un tel état d’instabilité. Entre Lénine et Staline, cependant, des divergences de principe se manifestèrent progressivement dans le choix de la stratégie et de la tactique de la politique nationale.
Le cas finlandais
L’agitation débridée des bolcheviks en faveur de la sécession des nations les frappa eux-mêmes, dès 1918, comme par un retour du boomerang. C’est ainsi que la Finlande, généreusement affranchie par Lénine, sitôt qu’elle en eût terminé chez elle avec le “droit des travailleurs à disposer d’eux-mêmes” fit connaître ses prétentions territoriales, lesquelles englobaient des régions qui n’avaient même jamais appartenu aux Finnois (Petchenga, la Carélie orientale, Petrozavodsk et même Petrograd) . Cette erreur de calcul fut finalement payée par la cession, en 1920, de Petchenga à la Finlande. Au reste, les choses ne se présentaient pas mieux dans les territoires restés sous domination bolchevique. En mars 1918, Staline écrivit avec humeur que les régions périphériques étaient incapables de se prononcer « clairement et distinctement sur les formas concrètes d’une fédération ».
À partir du printemps 1918, Staline se met à adopter une position toujours plus intransigeante vis-à-vis des communistes des confins, enthousiasmés par le principe de la souveraineté nationale. En avril, dans une interview accordée à la Pravda, il critique violemment la fédéralisme des régionalistes moscovites « s’efforçant de réunir artificiellement 14 provinces autour de Moscou » ; il en vient ensuite à l’importante conclusion que « le fédéralisme en Russie, tout comme en Amérique ou en Suisse, a pour destin de jouer un rôle transitoire sur la voie du futur unitarisme socialiste ». Au printemps 1918 encore, Staline cherche avec insistance à obtenir une claire délimitation des fonctions des pouvoirs centraux et locaux : « Le pays a besoin d’une forte autorité, commune à toute la Russie. (…) La création d’organes de pouvoir souverains locaux et régionaux parallèlement au pouvoir central signifierait en réalité la ruine de tout pouvoir ».
Staline jugeait nécessaire de faire relever entièrement de la compétence du Conseil Central des Commissaires du Peuple, « le département naval, les Affaires étrangères, les chemins de fer, la poste et le télégraphe, la monnaie, les accords commerciaux, l’ensemble de la politique économique, financière et bancaire ». La mise en œuvre d’une telle centralisation du pouvoir n’est pas due aux seuls besoins de la Défense et de l’économie. L’interruption du jeu autour de l’indépendance s’explique aussi essentiellement par des considérations géopolitiques et avant tout, par la nécessité du rétablissement des frontières historiques de la Russie.
C’est en partant d’une telle nécessité, qu’en octobre 1920, Staline déclarait que « la revendication du droit à la sécession des régions périphériques est, au stade actuel de la révolution, profondément contre-révolutionnaire », phrase qui contenait une menace non dissimulée à l’adresse des communistes nationaux. Évoquant une parte possible de la « puissance révolutionnaire de la Russie », Staline rappelait que la scission des confins de la Russie restait l’un des objectifs principaux de l’Entente et que, pour cette raison, « les communistes combattant en faveur de la sécession des colonies des pays de l’Entente ne peuvent pas ne pas lutter simultanément contre la séparation des régions périphériques de la Russie ». Pour éviter l’apparition aux extrémités de la Russie d’États qui, à l’instar de ce qui s’était passé avec les républiques baltes, lui seraient hostiles, il serait nécessaire d’établir un schéma rigoureux d’organisation nationale et d’écraser le national-communisme de la périphérie.
Staline centraliste
La tendance centralisatrice du parti, avec Staline à sa tête, proposait à la direction du PCR de procéder à la construction de l’État sur base d’un principe rigide, fondamentalement unitaire. Staline projetait d’unifier toutes les républiques soviétiques “indépendantes” dans le cadre de la RSFSR, avec droit à l’autonomie, afin que fut réalisée « l’unification effective des républiques en une entité économique avec extension du pouvoir central de Moscou sur les organes centraux de toutes les républiques ». Staline considérait que « l’indépendance des républiques soviétiques fraîchement émoulues avait atteint un tel niveau qu’elle avait presque cessé de travailler » en faveur de l’unité des républiques soviétiques. Les conséquences géopolitiques négatives d’une telle situation étaient manifestes : l’indépendance des confins de la Russie poussée jusqu’à ses dernières limites par des nationaux-communistes du type d’un Mdivani augurait de considérables difficultés dans le maintien, par le pouvoir central, du l’unité du pays. Ce n’est pas par hasard que, dans une lettre adressée à Lénine, Staline signalait le danger que représentait, au point de vue géopolitique, l’indépendance chronique de la nouvelle Géorgie communiste. « Le CC géorgien, écrivait-il, a décidé, à l’insu du CC du PCR d’autoriser la Banque Ottomane (à capital franco-anglais) à ouvrir un bureau à Tiflis, ce qui mènerait indéniablement à la sujétion financière de la Transcaucasie vis-à-vis de Constantinople. À Batoum et Tiflis, la livre turque a, déjà maintenant, évincé du marché l’argent géorgien et russe ».
Lénine, cependant, rejeta le projet stalinien d’autonomisation qu’il prit même violemment à partie. Victime des menées du lobby des nationaux-communistes de la périphérie, combattant impitoyablement la fiction du chauvinisme grand-russe, Lénine fit preuve du plus funeste libéralisme en regard du national-communisme, exigeant pour celui-ci une pleine liberté d’action. Dès le début des années 20, il s’était d’ailleurs, dans sa politique pratique, aligné lui-même sur les positions de ce courant. Rien de fortuit donc dans le fait qu’en 1921, le célèbre écrivain démocrate géorgien K. Gamchakhourian (père du président de Géorgie, Z. Gamchakhourian, récemment renversé) déclarait, dans une lettre ouverte adressée à Lénine et parue dans la presse géorgienne : « Politiquement, il n’y a entre nous qu’une faible distance, et il faudrait que vous réprimandiez certains communistes “russophiles” qui, à l’abri du drapeau rouge, mènent la politique impérialiste et rassembleuse de la Russie ».
Lénine contre le “russophile” Staline
Gamchakhourian ne fut pas trompé dans ses espoirs : en 1922, Lénine tança vertement la politique “russophile” de Staline, visant à l’établissement d’une Russie collective. Jugeant « radicalement funeste et inopportun » le dessein stalinien d’autonomie, Lénine annonça qu’il déclarait « une lutte à mort au chauvinisme grand-russe ». Comme alternative à l’autonomisation, il avança un projet d’unification des républiques soviétiques indépendantes dans une nouvelle fédération, l’URSS. Le 31 décembre 1922 qui plus est, et alors que la proclamation officielle de l’URSS avait déjà eu lieu, Lénine, en dépit de toute logique, se mit à insister sur la décentralisation d’une Union qui n’avait déjà pas besoin de cela pour être instable. Il proposait, en effet, de ne conserver l’unité de l’URSS « qu’au point de vue militaire et diplomatique mais de rétablir dans tous les autres domaines la pleine indépendance des différents narkomat ».
Ne disposant pas, pour réaliser sa politique nationale et étatique des forces suffisantes, Staline fut contraint d’accepter l’ultimatum de Lénine et la création de l’URSS. Il se réservait néanmoins le droit de s’attaquer ultérieurement au modèle d’organisation nationale encombrant et incohérent, inventé par Lénine pour la Russie. Staline, par exemple, prédit que l’existence à Moscou de deux instances législatives suprêmes, le VTsIK et le TsIK de l’URSS « ne donnera rien, hors des conflits » et qu’il faudra procéder à l’avenir à « une utile refonte en profondeur ». Malheureusement, l’actuelle débâcle de l’URSS a, à bien des égards, confirmé les craintes de Staline.
Staline et le “smenovekhovstvo”
Les aspirations staliniennes à la reconstitution d’une Russie unifiée au début des années 20 coïncidaient avec l’adoption par un certain nombre de communistes des idées d’un nouveau courant intellectuel né dans l’émigration russe, le smenovekhovstvo (Les eurasiens russes nommaient “nationaux-bolcheviks” les fondateurs de ce courant, auteurs d’un recueil Smena vekh. c’est-à-dire “Nouveaux Jalons”, paru à Prague en juillet 1921). Par la bouche de leur principal idéologue N. Oustrialov, les smenovekhovtsy déclaraient que « la Russie pouvait rester une grande puissance [si] le pouvoir soviétique travaillait par tous les moyens au rattachement de la périphérie au centre, au nom d’une Russie grande et unique. En dépit de l’infinie divergence des idéologies, il n’existe qu’une seule voie possible ».
Qui plus est, Oustrialov soulignait que c’était précisément le pouvoir soviétique qui pouvait prétendre au rôle de « facteur national de la vie russe contemporaine » et non « notre nationalisme », dans le mesure où « le mouvement anti-bolchevik s’était par trop lié à des éléments étrangers et, partant, avait permis au bolchevisme de s’auréoler d’une relative aura nationale, étrangère au fond à sa nature ». Il est intéressant de noter que même les représentants survivants de la dynastie des Romanov formulaient de semblables opinions “nationales-bolcheviques”. C’est ainsi que l’oncle de Nicolas II, le Grand-Prince Alexandre Mikhailovitch, reconnut dans ses Mémoires que les chefs du mouvement Blanc, en « faisant mine de ne pas remarquer les intrigues de leurs alliés », contribuèrent eux-mêmes à ce qu’à « la garde des intérêts nationaux russes » fût paradoxalement dévolue à « Lénine qui, dans ses constants discours publics, ne ménageait pas ses forces pour protester contre la division de l’ancien Empire russe ».
En conséquence, les smenovekhovtsy se prononçaient pour une collaboration avec le pouvoir soviétique dans la cause du rétablissement d’une Russie une et indivisible. Qui, concrètement, les smenovekhovtsy voyaient-ils dans le rôle de rassembleur de la Russie ? M. Agourski, historien spécialiste reconnu du national-bolchevisme, considère qu’il devait s’agir de Staline dans la mesure où celui-ci, en 1921 encore, était jugé positivement par les smenovekhovtsy de gauche en tant que « russophile et garant de la future amitié et bonne entente des peuples de Russie ». Selon nous, deux circonstances au moins furent susceptibles d’attirer à Staline une telle sympathie.
La première est que Staline était celui qui se prononçait le plus âprement et de la manière la plus conséquente contre le séparatisme national-communiste ; souvenons-nous de sa thèse relative au « caractère contre-révolutionnaire de l’exigence de la sécession des confins par rapport au centre ». Voilà pourquoi, pour les smenovekhovtsy qui considéraient que le pouvoir soviétique viendrait à bout de la pression des forces centrifuges de l’intérieur, Staline apparaissait comme le candidat le plus apte au rôle d’unificateur de la Russie.
La seconde est que les smenovekhovtsy — et, par la suite, les eurasiens russes — considéraient la révolution comme une étape fatidique dans la lutte de la Russie-Eurasie contre l’Occident. C’est dans l’espoir d’une issue heureuse de ce combat que les smenovekhovtsy et les eurasiens soutinrent la lutte anti-coloniale et anti-atlantiste (anti-britanniques en l’occurrence, ndlr) des bolcheviks en Asie et en Afrique. Le smenovekhovets Y. Potekhine écrivait solennellement que « l’influence russe en Asie Mineure, en Perse et, en partie, en Inde, que les stations radio et les instructeurs militaires russes en Afghanistan représentent un succès historique considérable pour la Russie ». Ce furent les eurasiens qui, mieux que les autres, saisirent le sens du recentrage révolutionnaire de la Russie de l’Europe vers l’Asie. Examinant cette volte-face à travers le prisme de la lutte séculaire de l’Est et de l’Ouest, de l’esprit de la steppe et de l’esprit de la forêt, les eurasiens en vinrent à considérer la révolution russe comme « la conclusion d’une période de plus de 200 ans d’européanisation » (P. N. Savitski). C’est la raison pour laquelle les eurasiens, à la suite des smenovekhovtsy, se rallièrent aux bolcheviks dans le rejet des formes politiques et de la culture de “l’Occident romano-germanique” qui, au cours de cette période deux fois séculaire d’européanisation, furent implantées artificiellement au détriment de la Russie. Et c’est dans ce contexte que l’eurasianisme, comme l’écrivit Troubetskoï, se rangea derrière le bolchevisme « dans l’appel à la libération des peuples d’Asie et d’Afrique asservis par les puissances coloniales ».
Or, ce furent précisément Lénine et Staline qui, au sein de la direction du parti bolchevik, poussèrent le Komintern à des actes résolus contre la politique coloniale des puissances occidentales en Asie et en Afrique. Ainsi, en mars 1923, Lénine en vint à la conclusion que l’issue de la lutte contre le capitalisme dépendait « en fin de compte du fait que la Russie, l’Inde, la Chine, etc. constituent l’immense majorité de la population du globe. (…) De ce point de vue, la victoire définitive du socialisme est pleinement et absolument assurée ». Au cours de cette même année, au 12ème Congrès du Parti, Staline déclare en substance que les peuples orientaux de l’ancien Empire russe, « organiquement liés à la Chine et à l’Inde (…) sont d’une importance vitale pour la révolution ». Il entreprend alors de tracer la ligne géopolitique pro-asiatique du bolchevisme. Et il a conclu que si l’Union Soviétique suivait une telle orientation, il lui restait deux solutions : « ou nous secouons l’arrière-front de l’impérialisme — les pays orientaux coloniaux et semi-coloniaux —, (…) ou nous manquons notre but et renforçons par cela même l’impérialisme ».
Le cours ultérieur de l’histoire a prouvé la justesse des plans géopolitiques de Staline relatifs à l’Orient : au cours des années 20 et 30, la politique de l’URSS vis-à-vis de la Chine mena à un affaiblissement considérable de la position des atlantistes en Asie. En fin de compte, le grand triomphe de l’Eurasie, l’alliance de la Russie et de la Chine, entre la fin des années 40 et les début des années 50, plaça l’Occident face à l’horrible perspective de la perte totale de sa puissance géopolitique en Asie du Sud-Est.
► Sergueï Constantinov, Vouloir n°137/141, 1997.
(texte issu d’Elementy, la revue d’Alexandre Douguine ; trad. fr. : Sepp Stalmans)
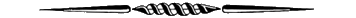
♦ Valentin M. BERESCHKOW, Ich war Stalins Dolmetscher : Hinter den Kulissen der politischen Weltbühne, Universitas, Munich, 1991, 517 p.
Parues dès 1949 sous le titre de Statist auf diplomatischer Bühne (Figurant sur la scène diplomatique), les mémoires de l'interprète de Hitler, le Dr. Paul Schmidt constituent un ouvrage de référence majeur sur l'histoire du IIIe Reich et de sa politique étrangère, un ouvrage qui défie les années. On ne peut en dire autant des mémoires que vient de publier l'interprète de Staline, Valentin M. Bereschkow (en graphie francisée : Berechkov). Celui-ci, né en 1916, est l'un des derniers survivants de l'entourage immédiat du dictateur soviétique. Les pages qu'il consacre à son enfance et à sa jeunesse, ses études et son service militaire dans l'Armée rouge, sont pourtant très intéressantes et riches en informations de toutes sortes.
Par l'intermédiaire de ses supérieurs hiérarchiques à l'armée, Berechkov est entré de plein pied dans le saint des saints de la grande politique soviétique. Grâce à ses connaissances linguistiques de très grande qualité, il est rapidement devenu l'un des collaborateurs les plus proches de Staline. Ce qu'il nous raconte à propos du dictateur géorgien relève de la “perspective du valet de chambre”. Berechkov s'efforce en effet de présenter Staline comme un homme aimable, bon compagnon de tous les jours, incapable de faire le moindre mal à une mouche en privé. Berechkov confesse qu'il n'en croyait pas ses oreilles quand le pouvoir soviétique se mit à dénoncer les crimes de Staline à partir de 1956. C'est bien ce qui distingue l'ouvrage de Berechkov des mémoires de Krouchtchev et de toutes les biographies conventionnelles de Staline…
Le livre de Berechkov nous révèle des anecdotes ou des secrets de première importance lorsqu'il aborde les tractations engagées par Staline avec Ribbentrop, Churchill ou Roosevelt. En fait, rien de tout cela n'est bien neuf mais est replacé sous un jour nouveau. Ce qui intéressera le lecteur en premier lieu sont évidemment les passages qui traitent du rapport entre Staline et l'Allemagne. Berechkov tient absolument à blanchir Staline ; pour l'interprète, le dictateur soviétique ne savait rien des préparatifs allemands d'envahir l'URSS à l'été 1941. Staline refusait d'ajouter foi aux avertissements dans ce sens. Quand l'attaque s'est déclenchée, il en fut si choqué qu'il se retira du monde pendant dix jours, incapable de prendre les décisions politiques et militaires qui s'imposaient.
Berechkov défend donc Staline avec véhémence et insistance, ce qui est d'autant plus suspect que plus d'une analyse politique récente démontre que Staline avait en toute conscience adopté une « stratégie sur le long terme » (Ernst Topitsch), visant à faire basculer l'Union Soviétique dans la guerre. Berechkov cherche donc, selon toute vraisemblance, à dépeindre un Staline «sauveur de la Russie» dans la «grande guerre patriotique» quoique criminel sur le plan intérieur. Pour savoir ce qu'il en est exactement, il faudra attendre que soient enfin ouvertes au public les archives soviétiques. En attendant, les assertions de Berechkov doivent être accueillies avec circonspection.
► Hans Cornelius, Vouloir, 1992.
(recension parue dans Junge Freiheit, mars 1991)
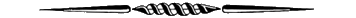
La guerre de Staline
Une nouvelle vision de la guerre à l'Est
 On a dit que Staline avait été le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Cette évidence et la façon dont Staline a contribué à provoquer cette guerre, en appliquant la stratégie du long terme, préalablement définie par Lénine, tel est le contenu d'un livre qui a suscité beaucoup d'attention Outre-Rhin, celui du Professeur de sociologie de Graz (Autriche), le Dr. Ernst Topitsch : Stalins Krieg : Die sowjetische Langzeitstrategie gegen den Westen als rationale Machtpolitik (Günter Olzog Verlag, Munich, 1985 = La guerre de Staline : La stratégie soviétique du long terme contre l'Ouest en tant que politique rationnelle de puissance). Par son livre, le Dr. Topitsch jette un regard complètement nouveau sur l'histoire de la dernière guerre et nous force à émettre des jugements très différents de ceux que l'on a eu l'habitude de poser depuis 1945. Le Dr. Karl Otto Braun nous donne, dans le texte qui suit, son opinion sur cet ouvrage fondamental qui oblige à une révision complète de l'histoire des rapports germano-soviétiques de ces 50 dernières années.
On a dit que Staline avait été le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Cette évidence et la façon dont Staline a contribué à provoquer cette guerre, en appliquant la stratégie du long terme, préalablement définie par Lénine, tel est le contenu d'un livre qui a suscité beaucoup d'attention Outre-Rhin, celui du Professeur de sociologie de Graz (Autriche), le Dr. Ernst Topitsch : Stalins Krieg : Die sowjetische Langzeitstrategie gegen den Westen als rationale Machtpolitik (Günter Olzog Verlag, Munich, 1985 = La guerre de Staline : La stratégie soviétique du long terme contre l'Ouest en tant que politique rationnelle de puissance). Par son livre, le Dr. Topitsch jette un regard complètement nouveau sur l'histoire de la dernière guerre et nous force à émettre des jugements très différents de ceux que l'on a eu l'habitude de poser depuis 1945. Le Dr. Karl Otto Braun nous donne, dans le texte qui suit, son opinion sur cet ouvrage fondamental qui oblige à une révision complète de l'histoire des rapports germano-soviétiques de ces 50 dernières années.Si nous devions faire jouer l'histoire du monde sur une scène de théâtre, l'acte qui narrerait la Seconde Guerre mondiale aurait 4 personnages principaux : Roosevelt, Staline, Churchill et Hitler. Les projecteurs, dont le faisceau lumineux serait dirigé par les vainqueurs et les “juges” de Nuremberg, éclairerait uniquement Adolf Hitler, ses SS et ses camps de concentration. Les actes criminels perpétrés par ses adversaires, eux, en revanche, resteraient dans l'ombre, surtout les massacres collectifs de Staline, ceux qu'il a commis contre ses concitoyens koulaks, contre les Ukrainiens, les Polonais, les juifs sionistes et d'autres. Rappelons que l'on a interdit aux Allemands de procéder à des comparaisons historiques. Toute comparaison, dit-on, fausserait le calcul.
Les historiens qui osent faire dévier le faisceau lumineux de ces projecteurs, on les appelle des “révisionnistes”. Les Allemands, échaudés, tremblants de peur, blêmes de frousse, n'osent pas toucher aux projecteurs. C'est pourquoi, ironie de l'histoire, les historiens américains ont été les premiers à bousculer les tabous et à braquer les projecteurs sur les crimes des Américains ou plutôt sur les crimes de leur Président, qu'ils ont élu 4 fois de suite, Franklin Delano Roosevelt. Plus on libère les documents secrets, plus on s'aperçoit que le peuple américain a choisi comme Président un adepte fanatique du dieu Mars. « Il nous a menti pendant la guerre », disait une publiciste américaine réputée. « He was the greatest liar who ever sat in the White House » (Il a été le plus grand menteur qui ait jamais siégé à la Maison Blanche), me disait en 1983 l'adversaire le plus acharné de Roosevelt sur la scène de la politique intérieure américaine, Hamilton Fish (dont les mémoires sont parues en allemand en 1982 : H.F., Der Zerbrochene Mythos, F. D. Roosevelts Kriegspolitik 1933-1945, Grabert Verlag, Tübingen, 1982 ; = Le mythe brisé : La politique de guerre de F.D. Roosevelt entre 1933 et 1945). Donc les Allemands n'ont pas été les seuls à avoir un “Führer” qui vénérait un peu trop le dieu Mars.
Mis à part quelques prédécesseurs malchanceux, condamnés par la conspiration du silence, comme par ex. Sündermann et von Richthofen, quelques historiens allemands osent enfin, après une sorte de commotion qui dure depuis plus de 40 ans, modifier la position des projecteurs. Parmi eux, Dirk Bavendamm, à qui on doit un ouvrage magistral, [édité à très gros tirages, disponible en livre de poche, ndt] : Roosevelts Weg zum Krieg (Herbig, Munich, 1983 ; = Le chemin de Roosevelt vers la guerre). Son éclairage met en exergue Roosevelt en tant que fauteur de guerre, et confirme les thèses de plusieurs historiens américains comme Beard, Barnes, Chamberlin, Tansill, Hoggan, Martin et quelques autres.
Ernst Topitsch, quant à lui, braque le faisceau du projecteur sur Staline. Il écrit : « Ainsi, nous observons d'importantes mutations de perspective. Hitler et l'Allemagne nationale-socialiste perdent en quelque sorte leur centralité et déchoient pratiquement au rang d'un phénomène épisodique, de pièces dans ce jeu d'échecs qu'était la stratégie à long terme inaugurée par Lénine pour soumettre le monde capitaliste ». Staline, le “Géorgien démoniaque”, est rigoureusement resté fidèle à la conception de Lénine et a hissé la Russie au rang de superpuissance. Topitsch écrit : « Au fur et à mesure que le temps passe, nous nous apercevons de plus en plus clairement que Staline n'est pas seulement un géant de l'histoire russe comme Ivan le Terrible ou Pierre le Grand, mais aussi un géant de l'histoire mondiale » (p. 7).
Hitler, dans sa juste lutte contre les implications du Traité de Versailles, mène des négociations avec les Soviétiques, en concurrence avec les Anglais et les Français qui négocient de leur côté, et gagne cette première manche, surtout parce que ses vues sur la question polonaise plaisent mieux aux Russes, signe ensuite le Pacte Ribbentrop/Molotov et permet ainsi aux Soviétiques d'amorcer leur grande marche vers l'Ouest en conquérant les Pays Baltes et la Bessarabie. Le tribut que Hitler a payé à Staline à modelé le destin du monde à venir. Mais Staline n'était pas prêt à se contenter de ces gains territoriaux, pourtant très importants. Il s'est d'abord attaqué à la Finlande, alors que ce pays du Nord ne l'avait nullement provoqué. Ensuite, il a obligé son ministre des affaires étrangères Molotov à formuler à Berlin en novembre 1940 des exigences que l'Allemagne ne pouvait satisfaire et devait immanquablement rejeter, si elle ne voulait pas capituler sans broncher devant Staline. « Tout autre homme d'État allemand que Hitler, dans une telle situation, aurait réfléchi à la manière d'échapper à temps à cet étranglement » (p. 97).
Lors de l'entrevue de Berlin en novembre 1940, Molotov a une nouvelle fois insisté pour que les exigences soviétiques sur la Finlande soient satisfaites, a rappelé les intérêts russes en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Yougoslavie et en Grèce. Mais il ne s'est pas contenté de réitérer ces vieilles revendications du panslavisme : il a soulevé les problèmes de la neutralité suédoise et du droit de passage dans le Sund, jusqu'au Kattegat et au Skarregak (p. 95). Ensuite, il a demandé à ses interlocuteurs allemands s'ils étaient d'accord pour prendre des mesures diplomatiques et militaires communes avec l'URSS et l'Italie au cas où la Turquie s'opposerait aux projets russes (p. 96). Toutes ces exigences dépassaient de loin les revendications russes traditionnelles, formulées de Pierre le Grand à Alexandre Isvolsky (p. 98). Topitsch estime néanmoins que les revendications de Molotov relèvent d'une « logique implacable ». Molotov voulait provoquer les Allemands, cherchait à faire endosser à Hitler l’opprobre de l'agresseur, de façon à ce que les intentions belliqueuses et conquérantes de Staline passent pour une “guerre patriotique et défensive”.
La stratégie à long terme de Moscou, après l'élimination de la France en 1940, de détruire définitivement le Reich, en tant que dernier bastion contre la domination absolue du bolchévisme en Europe. La réélection de Roosevelt le 5 octobre 1940 donnait le feu vert à Staline. Il pouvait désormais laisser libre cours à sa politique anti-allemande. Mais, but ultime de sa stratégie inspirée de Lénine, il avait également l'intention de jeter les Américains hors d'Europe.
En signant un pacte de neutralité avec le Japon le 13 avril 1941, Staline poursuivait une politique analogue : il voulait impliquer l'Empire du Soleil Levant dans un conflit de longue durée avec les États-Unis, tout comme il avait incité les Allemands à en découdre avec la Pologne (pp. 105-106). Tant les Polonais que Roosevelt adoptèrent aussitôt une attitude provocante. Le Kremlin renforça ses positions en Sibérie et face à la Chine. Il préparait cette dernière à une prise du pouvoir par les communistes, bien qu'officiellement il soutenait Tchang Kai-Tchek. Dans cette volte-face audacieuse, ce coup de poker, Staline a bénéficié non seulement de la « myopie américaine », comme le souligne Topitsch, mais aussi du travail des agents soviétiques influents introduits dans les rouages du pouvoir à Washington, surtout dans le célèbre Institute of Pacific Relations, où ils étaient très nombreux. Parmi les thèmes principaux du livre de Topitsch : le long combat occulte de Staline contre son allié anglo-saxon.
En été 1941, l'attaque allemande a d'abord paru réussir et les plans de grande envergure et les préparatifs militaires de Staline semblaient se solder par un cuisant échec. Le dictateur soviétique avait massé ses divisions offensives trop loin à l'Ouest parce qu'il leur imputait une puissance défensive qu'elles n'avaient en fait pas. Quand la guerre a éclaté, les capacités défensives de l'Armée Rouge se sont révélées nulles. « Les hommes politiques anglo-saxons qui étaient au pouvoir ne se sont pas aperçu qu'ils se trouvaient dans la situation où Staline avait toujours voulu qu'ils soient… Pour cela, il n'y a pas eu besoin d'un “changement d'alliance”, mais seulement d'un dosage adéquat des aides à l'Union Soviétique et des opérations contre l'Allemagne » (p. 134). Topitsch écrit avec raison que c'est ainsi que l'Amérique et l'Angleterre ont gâché le rôle d'arbitres du monde qui leur était tombé entre les mains. En jouant sur les 2 tableaux, ils auraient évité la soviétisation de l'Europe centrale et orientale.
À l'avant-dernière page de son livre, Topitsch évoque « Roosevelt empêtré dans l'internationalisme maçonnique ». En écrivant cette phrase, il fait allusion aux conspirations qui se trament dans les coulisses de l'histoire. Mais il faudrait encore écrire un livre entier sur ces conspirations qui mènent le monde : il serait capital pour tous ceux qui veulent appréhender la vérité historique dans toute sa lumière ; pour l'écrire, il nous faudrait évidemment des historiens capables d'étayer leurs preuves.
Terminons par une remarque critique : nous nous sommes préoccupé à plusieurs reprises des “conversations avec Hitler” de Hermann Rauschning. Cet ouvrage, si largement diffusé, considéré comme un “classique”, est décortiqué aujourd'hui par un historien suisse, membre du Centre de Recherches historiques d'Ingolstadt (Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt). Conclusion de ses recherches : ce best-seller est une compilation de récits falsifiés.
► Dr. Karl Otto Braun.
Bottes de Staline, Memento Park, près de Budapest, Hongrie (ph. : Sylvie Truchet, 2014, livre sur blurb)
Reconstitution des bottes et la Tribune d'honneur par Ákos Eleöd devant l'entrée du parc Mémento. La statue de 8 m. de haut, surplombant la Place des Défilés dans le centre de Budapest, renversée le 23 oct. 1956, ne fut jamais réinstallée en raison de la déstalinisation
 Tags : Russie
Tags : Russie