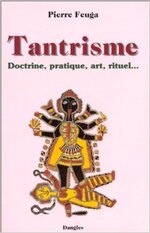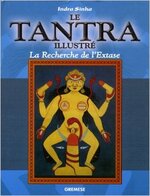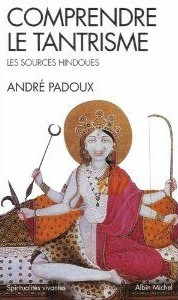-
Tantrisme
Le monde du tantrisme indien
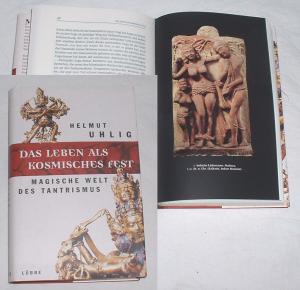 • Analyse : Helmut Uhlig, Das Leben als kosmisches Fest : Magische Welt des Tantrismus, Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1998, 304 p. [rééd. Verlag Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach, 2001] Postface de Jochen Kirchhoff : „Entzückte Weisheit“ – Tantra heute. Das tantrische Universum als Herausforderung für unser Weltverständnis.
• Analyse : Helmut Uhlig, Das Leben als kosmisches Fest : Magische Welt des Tantrismus, Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1998, 304 p. [rééd. Verlag Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach, 2001] Postface de Jochen Kirchhoff : „Entzückte Weisheit“ – Tantra heute. Das tantrische Universum als Herausforderung für unser Weltverständnis.Tantrismus wird zumeist als Liebestechnik missverstanden, bei der mystische Silben gesungen werden. Tatsächlich sind die Bestandteile eines Rituals, dessen Ziel Erlösung ist. Im Mittelpunkt steht das Genießen der fünf “M” : Madya (Wein, Matsya (Fisch), Mamsa (Fleisch), Mudra (geröstetes Getreide) und Maithuna (die geschlechtliche Vereinigung). Doch genauer ist Tantrismus eine Form des tibetischen Buddhismus, die den Menschen in einer kosmische Allverbundenheit sieht, ihn als menschliches Urerlebnis versteht. Helmut Uhlig spürt den Wegen des Tantrismus nach. Er stellt diese Weltanschauung als Alternative zum Materialismus westlich-abendländischer Prägung dar.
Inhalt : Mensch wohin ? – Der tantrische Weg /Vom Geheimnis indischer Höhlen / Asket oder Verführer – eine tantrische Göttergeschichte / Was Tantra bedeutet / Vom Androgyn zum Erkennen der Geschlechter / Das Geheimnis der Großen Göttin von Laussel / Die Große Göttin und der Stier / Hieros gamos – das älteste Ritual der Vereinigung / Die Vieldeutigkeit des Hohen Lieds / Tantrische Selbstbehauptung im Kali-Yuga / Der Schoß, dem alles entstammt / Shakti und Shakta – tantrische Wirklichkeit in Indien / Yoga – ein Weg zur Freiheit / Mantra und Mudra – Kraft der Töne und der Zeichen / Pancatattva – das geheime Ritual / Der Chakrapuja-Reigen / Rati Lila – das intime Liebesspiel / Tantrische Kunst – Signaturen des Seins / Ein Pantheon entfaltet sich / Geheimnisse der tantrischen Ikonographie / Das Mandala – magischer Kreis und Weltsymbol / Guhyasamaja – das Tantra der verborgenen Vereinigung / Wenn der Silbervogel fliegt / Vom Wissen um die Einheit des Seins / Kirche, Satanskult und schwarze Messe / Die kosmische Integration / Das Geheime Mantra des Tsongkhapa / Literaturauswahl

 Né en 1922 et décédé en 1997, Helmut Uhlig, historien des religions, a été pendant toute sa vie fasciné par l’Inde. On lui doit des ouvrages remarqués sur des thèmes aussi diversifiés que la route de la soie, sur le Tibet, sur l’Himalaya, sur l’Anatolie, sur la Grande Déesse, sur le bouddhisme et le tantrisme, etc. Jochen Kirchhoff vient d'en assurer l'édition de son dernier livre sur le tantrisme, resté inachevé, en le complétant d’une postface remarquable, branchant les réflexes mentaux que nous enseignent les voies tantriques sur les acquis de la physique et de la biologie contemporaines.
Né en 1922 et décédé en 1997, Helmut Uhlig, historien des religions, a été pendant toute sa vie fasciné par l’Inde. On lui doit des ouvrages remarqués sur des thèmes aussi diversifiés que la route de la soie, sur le Tibet, sur l’Himalaya, sur l’Anatolie, sur la Grande Déesse, sur le bouddhisme et le tantrisme, etc. Jochen Kirchhoff vient d'en assurer l'édition de son dernier livre sur le tantrisme, resté inachevé, en le complétant d’une postface remarquable, branchant les réflexes mentaux que nous enseignent les voies tantriques sur les acquis de la physique et de la biologie contemporaines.Premier constat d’Uhlig : le monde occidental est atomisé, handicapé psychiquement. Les Occidentaux et les Asiatiques qui les imitent vivent désormais dans un monde d’illusions et de falsifications, où l’esprit de carrière, l’envie, l’obsession de l’avoir et l’orgueil tiennent le haut du pavé. Il écrit (p. 9) : « …l’homme a perdu son fonds originel (Urgrund) religieux et numineux [1], est victime d’une attitude purement matérialiste et pragmatique, qui domine le monde occidental, qui a ses racines intellectuelles dans cette vita activa, issue de l’esprit gréco-romain et du christianisme paulinien ».
Exactement comme Evola, il constate que ce double héritage de l’hellénisme (qui n’est pas la Grèce dorienne des origines, précisons-le !) et du paulinisme distrait dangereusement l’homme, qui devient incapable de saisir le numineux : « Ce sont des éléments que nous pouvons considérer comme des représentations originelles de l’esprit et de la dignité humains qui, au cours des millénaires, n’ont rien perdu de leur force, de leur signification et de leur pouvoir fondateur de sens. Nous les résumons sous le concept de “tantrisme”, un concept encore et toujours mystérieux, à la fois magique et cosmique » (p. 10).
Le tantrisme est donc la religiosité qui se réfère immédiatement au “vécu primordial” (Urerlebnis), et n’est nullement cette pâle caricature que certains tenants du New Age et de la spiritualité de bazar en font. Le boom ésotérique de ces récentes années a fait du vocable “tantrisme” un article de marché, une fadeur exotique parmi tant d’autres. Ceux qui l’emploient à tort et à travers ne savent pas ce qu’il signifie, n’en connaissent pas la profondeur.
Une approche du numineux
« Je vais tenter dans ce livre d’aborder et de révéler le tantrisme comme un phénomène cosmique, comme l’un des vécus primordiaux de l’homme. Ce qui est nouveau dans mon approche du tantrisme, c’est que je ne vais pas le réduire à ses manifestations historiques, comme celles qui nous apparaissent dans l’espace culturel indien et himalayen mais je vais poser la question des origines et de la puissance de la pensée et du vécu tantriques. Car je crois que, dans le tantra, se cache l’un des phénomènes primordiaux de l’Être de l’homme. Ainsi, mon texte est une tentative de retrouver la trace de ce phénomène primordial et de sa constitution cosmique, de la rendre visible, car, dans les dernières décennies du deuxième millénaire, elle acquerra une importance toujours croissante et une puissance réelle, y compris pour le monde occidental » (p. 11). Ensuite, il précise son approche du numineux : « Il existe des aspects de la réalité qui ne sont ni spatiaux ni temporels. Ils n’ont pas de dimension historique. Ils agissent (wirken), mais restent pour nous invisibles, ils viennent du Tout, du cosmos, et sont reconnaissables de multiples manières » (p. 19).
C’est en 1960 que H. Uhlig débarque pour la première fois en Inde. Le Brahmane qui le reçoit et le guide lui déclare, quelques jours après son arrivée : « Nous les Indiens, nous sommes assez tolérants. Le mot de Yahvé qu’on trouve dans la Bible : “Tu n’auras pas d’autres Dieux que moi”, personne ne le comprend ici. Et personne ne le suivrait d’ailleurs, vu le très grand nombre de Dieux qui sont enracinés dans la psyché de notre peuple. C’est aussi la raison pour laquelle les missionnaires chrétiens ont à peine été acceptés en Inde » (p. 14). Le culte de Shiva et des autres divinités indiennes prouve combien profondément enracinée dans l’âme hindoue est la propension “à être toujours bien disposé à l’égard de tous les Dieux à la fois, à ne pas se couper d’eux” (p. 21).
D’où la religiosité tantrique repose sur une acceptation du monde tel qu’il est dans sa pan-imbrication (Allverflechtung), où monde visible et invisible sont unis par mille et un fils (de tapisserie). Uhlig en conclut que des éléments tantriques ont été présents dans toutes les religions primordiales. Mais cette idée centrale de pan-imbrication de tout dans tout est difficile à expliquer et à comprendre, surtout pour les Occidentaux, habitués à penser en termes de césures et de cloisonnements. Le terme “tantra” lui-même dérive d’une racine étymologique, tan, qui signifie “élargir”, “accroître en dimension et en étendue”. Quant à tana, cela signifie tout à la fois “fils” (au pluriel) et “étendue”. Tantawa signifie “fait de fils”, “tissé”. Le tantrisme indique donc ce qu’est la texture du cosmos : un tapis immense fait de milliards et de milliards de fils (p. 28).
Juger le tantrisme sans tabous
 Uhlig : « Nous ne pouvons comprendre et juger correctement le tantrisme que si nous nous libérons de l’emprise des commandements et des principes qui nous sont conventionnels et que l’État et la religion ont imposés chez nous depuis la fin du Moyen Âge. Les critères de valeurs que nous a transmis le christianisme clérical, notamment la doctrine des catégories du bien et du mal, du moral et de l’immoral, troublent notre regard et le grèvent de préjugés, ne nous permettant pas d’entrer dans le monde tel que le saisit et le réalise le tantrisme. Cela vaut surtout pour le jugement que porte l’Occident sur la sphère sexuelle, ses formes d’expression et ses pratiques. Les relations sexuelles entre les personnes ne sont soumises à aucun tabou dans le tantrisme, car elles y sont considérées comme des fonctions centrales et naturelles, qui sont effectivement traduites en actes. Pour la plupart des auteurs occidentaux, qui ont écrit sur le tantrisme depuis une centaine d’années, la sexualité tantrique a suscité d’âpres critiques, formulées dans une terminologie chrétienne, dévalorisant tout ce qui touche à la sexualité.
Uhlig : « Nous ne pouvons comprendre et juger correctement le tantrisme que si nous nous libérons de l’emprise des commandements et des principes qui nous sont conventionnels et que l’État et la religion ont imposés chez nous depuis la fin du Moyen Âge. Les critères de valeurs que nous a transmis le christianisme clérical, notamment la doctrine des catégories du bien et du mal, du moral et de l’immoral, troublent notre regard et le grèvent de préjugés, ne nous permettant pas d’entrer dans le monde tel que le saisit et le réalise le tantrisme. Cela vaut surtout pour le jugement que porte l’Occident sur la sphère sexuelle, ses formes d’expression et ses pratiques. Les relations sexuelles entre les personnes ne sont soumises à aucun tabou dans le tantrisme, car elles y sont considérées comme des fonctions centrales et naturelles, qui sont effectivement traduites en actes. Pour la plupart des auteurs occidentaux, qui ont écrit sur le tantrisme depuis une centaine d’années, la sexualité tantrique a suscité d’âpres critiques, formulées dans une terminologie chrétienne, dévalorisant tout ce qui touche à la sexualité.Ainsi, le tantrisme a été dévalorisé sur le plan éthique, ses cultes ont été diabolisés ; les textes critiques des Occidentaux ne tentaient même pas de comprendre le contexte du tantrisme » (pp. 26-27). Cela vaut également pour le contre-mouvement, où une mode pro-tantrique, portée par des oisifs californiens ou des décadents des beaux quartiers de Londres, a superficialisé les dimensions sexuelles, les faisant basculer dans un priapisme vulgaire et une pornographie bassement commerciale. Le tantrisme ne vise nullement à favoriser une promiscuité sexuelle de nature pornographique, à transformer la Cité en lupanar, mais, plus fondamentalement, à appréhender les secrets les plus profonds de la conscience humaine. Uhlig rend hommage au premier Européen, Sir John Woodroffe (alias Arthur Avalon) qui a traduit et explicité correctement les textes tantriques, si bien que les Indiens adeptes du tantrisme le considèrent comme un sauveur de cet héritage.
Les pratiques tantriques ont un lointain passé, affirme Uhlig, y compris hors d’Inde. La religiosité visant à appréhender les plus profonds secrets de l’âme humaine se retrouve partout : elle a été occultée par le christianisme ou la modernité. Ainsi, pour Uhlig, est tantrique le mythe sumérien d’Inanna et Dumuzi (en babylonien Tammuz), où une hiérogamie [union sacrée] est réalisée au sommet d’un zigourat à 8 niveaux (dans bon nombre de traditions, sauf dans le judaïsme pharisien et le christianisme, le “8” et l’octogone indiquent l’harmonie idéale de l’univers ; cf. le château de Frédéric II de Hohenstaufen, Castel del Monte, les Croix de Chevalier inscrites dans un motif octogonal de base et non sur la croix instrument de torture, les plans des églises byzantines, de la Chapelle d’Aix/Aachen ou de la Mosquée El-Aqsa à Jérusalem, le Lotus à 8 feuilles de l’initiation à la Kalachakra ou “Roue du Temps”, la division de l’orbe terrestre en 4 fois 8 orientations chez les navigateurs scandinaves du haut Moyen Âge ; pour Marie Schmitt, la religion pérenne privilégie l’harmonie du “8”, les religions coercitives et messianiques, le “7”).
L’hiérogamie d’Inanna et de Dumuzi
 Revenons au mythe d’Inanna et de Dumuzi. Dans la chambre hiérogamique se trouvent simplement un lit, avec de belles couvertures, et une table d’or. Il n’y a pas l’image d’un dieu. L’essentiel du culte vise la préservation et la revitalisation de la fertilité. Ce culte a frappé les Israélites lors de la captivité babylonienne, ce qui s’est répercuté dans le texte du fameux “Chant des Chants” [ou, sous son titre biblique, Le Cantique des cantiques], où, en filigrane, il ne s’agit nullement de Yahvé, mais bel et bien d’une hiérogamie, tendrement sexuelle et sensuelle. Martin Buber l’a traduit, restituant sa signification originelle, au-delà de toutes les traductions “pieuses”. Pharisaïsme et christianisme paulinien / augustinien s’ingénieront à occulter ce “Chant des Chants”, joyeuse intrusion pagano-tantrique dans l’Ancien Testament.
Revenons au mythe d’Inanna et de Dumuzi. Dans la chambre hiérogamique se trouvent simplement un lit, avec de belles couvertures, et une table d’or. Il n’y a pas l’image d’un dieu. L’essentiel du culte vise la préservation et la revitalisation de la fertilité. Ce culte a frappé les Israélites lors de la captivité babylonienne, ce qui s’est répercuté dans le texte du fameux “Chant des Chants” [ou, sous son titre biblique, Le Cantique des cantiques], où, en filigrane, il ne s’agit nullement de Yahvé, mais bel et bien d’une hiérogamie, tendrement sexuelle et sensuelle. Martin Buber l’a traduit, restituant sa signification originelle, au-delà de toutes les traductions “pieuses”. Pharisaïsme et christianisme paulinien / augustinien s’ingénieront à occulter ce “Chant des Chants”, joyeuse intrusion pagano-tantrique dans l’Ancien Testament.Ainsi, en 553, lors du deuxième concile de Constantinople, Théodore de Mopsuestia, interprète “sensuel” du “Chant des Chants” est banni, son interprétation ravalée au rang d’une hérésie perverse : « … les zélés pères de l’église ont tout fait pour combattre les interprétations mystiques du “Chant des Chants” : à leur tête Origène, suivi plus tard de Bernard de Clairvaux, de Bonaventure et de François de Sales, qui ont rivalisé pour en donner une interprétation dépourvue de fantaisie, fade » (p. 71).
« Ici se révèle l’un des fondements de l’attitude anti-naturelle du christianisme, qui détruit l’holicité des sens et de l’Être, qui débouche sur un ascétisme qui condamne les corps, et auquel l’église tient toujours, puisqu’elle continue à imposer le célibat des prêtres. Non seulement cela a conduit à faire perdre toute dignité aux prêtres, mais cela a rejeté la femme dans les rôles peu valorisants de la séductrice et du simple objet de plaisirs. La dégénérescence de l’antique union sacrée des corps, don de soi à l’unité mystique, dans la vulgaire prostitution en est le résultat, car la femme n’est plus considérée que comme une prostituée » (p. 71).
En revanche, Inanna/Ishtar était la déesse des déesses, la reine et la conductrice de l’humanité entière. Ce passage du rôle primordial de “déesse des déesses” à celui de vulgaire prostituée constitue le fondement de l’âge sombre, du Kali Yuga [Âge de la discorde]. Il y a assombrissement parce que le culte de la Reine Conductrice est progressivement ignoré, parce qu’il n’y a plus d’hiérogamie sacrée possible car tout accouplement est désormais démonisé.
Plotin et Ammonios Sakkas
Enfin, après avoir exploré le tantrisme dans toutes ses dimensions, Uhlig rend hommage à Plotin (pp. 214-222). Plotin était également opposé à la gnose et au christianisme, rejetant leur “religiosisme”, leurs simplismes de “croyeux”, hostiles à la philosophie grecque. Plotin commence sa quête en 233, année où il rencontre le philosophe Ammonios Sakkas, dont il sera l’élève pendant 11 ans. Pendant cette période, à Alexandrie, il entre en contact (tout comme Origène !) avec des représentants de la spiritualité persane et indienne. Leurs enseignements le fascinent. Si bien qu’il veut aller à la rencontre de leur culture. Il suit l’Empereur Marc-Antoine Gordien III dans sa campagne contre les Perses, espérant atteindre leur pays et découvrir directement leur religion. Uhlig écrit à ce propos (p. 218) : « L’historiographie de la philosophie en Europe n’a consacré que trop peu d’attention à ce fait et n’a jamais étudié l’influence indienne sur la philosophie de Plotin ». Gordien III est assassiné en 244 sur les rives de l’Euphrate par un de ses généraux. Plotin doit fuir vers Antioche puis vers Rome. Son enseignement influence la famille impériale. Il est holiste comme sont holistes les enseignements tantriques. Ses Ennéades évoquent une Gesamtverwobenheit (un tissage cosmique) [2], très proche de la vision tantrique originelle.
L’élimination violente des filons néoplatoniciens et plotiniens dans la pensée européenne a commencé par l’horrible assassinat d’Hypathie, philosophe néoplatonicienne d’Alexandrie, par une foule de chrétiens furieux et délirants qui ont lacéré son corps et en ont traîné les lambeaux dans les rues. Elle se poursuit par l’occultation systématique de ces traditions dans nos principaux établissements d’enseignement. Cette élimination est aux sources du malaise de notre civilisation, aux sources de notre nervosité et de notre cinétisme insatiable, de nos désarrois, de notre incapacité à nous immerger dans l’organon qu’est le monde. La tradition néoplatonicienne chante, comme les filons panthéistes et pélagiens celtiques, la “merveilleuse variété” du monde et de la nature (poikilè thaumatourgia). « Il y a aussi des dieux dans la cuisine », disait Héraclite à des visiteurs inattendus, qui l’avaient trouvé près de son feu, sur lequel cuisait son repas.
Une fête cosmique sans partage et sans dualité
Dans sa postface, Jochen Kirchhoff nous rappelle les exhortations de David Herbert Lawrence dans son plaidoyer pour les religiosités païennes et cycliques, intitulé Apocalypse (1930) [3]. Pour Lawrence, il fallait retourner à la cosmicité, raviver nos rapports avec le cosmos. Ensuite, Kirchhoff rappelle les tentatives de Nietzsche de restaurer les dimensions extatiques et dionysiaques de l’Être pour les opposer au christianisme, ennemi de la vie. L’Être doit être une “fête cosmique”, entièrement, sans partage, sans dualité.
Kirchhoff explore ensuite toutes les possibilités de restaurer la vision tantrique du monde (la pan-imbrication) via les pratiques sexuelles, complétant et actualisant ainsi Métaphysique du sexe et Le Yoga tantrique d’Evola. Il salue un ouvrage à succès de Margo Anand dans les milieux “New Age” (The Art of Sexual Ecstasy : The Path of Sacred Sexuality for Western Lovers) mais constate rapidement les limites philosophiques de la démarche de cet auteur. Le New Age a produit peu de bonnes choses en la matière. Le travail de Margo Anand est bon, écrit Kirchhoff, utile pour une thérapeutique sexuelle, mais reste superficiel, ne permet pas un approfondissement philosophique et métaphysique. Quant à l’Américain Franklin Jones (alias “Da Free John”, “Da-Love Ananda” ou “Adi Da”), il a poussé la caricature du tantrisme jusqu’au ridicule (cf. son ouvrage le plus connu : Dawn Horse Testament). Finalement, le freudo-marxiste Wilhelm Reich a élaboré une théorie et une thérapeutique de l’orgasme plus valable (Kirchhoff est moins sévère qu’Evola), car sa vision de la bio-énergie ou orgon était au moins omni-compénétrante.
Kirchhoff souligne toutefois bien la différence entre les rituels sexuels tantriques et l’obsession moderne de la performance (orgasmique ou non, mais toujours multi-éjaculatoire). Car, dit-il, « il existe des rituels tantriques qui freinent effectivement l’orgasme féminin comme l’orgasme masculin, visant de la sorte une prolongation contrôlée ou un retardement de celui-ci pour atteindre des objectifs (spirituels) supérieurs ou pour obtenir un accroissement du plaisir » (p. 278). En effet, poursuit-il, l’orgasme et/ou l’éjaculation masculine mettent un terme à l’étreinte sexuelle, limitant la durée du plaisir et des caresses partagés. Retenir ses énergies (et son sperme) permet de jouir du plaisir sexuel et de donner à la femme davantage de joie. C’est dans cet exercice, cette ascèse (ce yoga), que réside la qualité inégalée du tantrisme sur le plan sexuel, le hissant très au-dessus du stupide priapisme rapide et bâclé que nous servent les médias contemporains, véhicules de la pornographie populaire.
Une vision tantrique de l’univers réémerge dans la physique moderne
 Mais c’est dans la physique moderne que Kirchhoff place ses espoirs de voir réémerger une vision tantrique de l’univers. Depuis la consolidation de la physique quantique, le monde apparaît à nouveau comme “pan-imbriqué”. Dans les colonnes de la revue polythéiste belge Antaios, Patrick Trousson avait déjà démontré l’étroite similitude entre les acquis de l’antique mythologie celtique et ceux de la science physique actuelle. Kirchhoff répète ces arguments, citant Carl Friedrich von Weizsäcker (Zeit und Wissen, 1992), Frithjof Capra (Le Tao de la physique), le physicien indien Amit Goswami (qui a comparé la philosophie du Vedanta et les acquis de la nouvelle physique), le théoricien systémique Ervin Lazslo, le biochimiste Rupert Sheldrake, etc. L’essentiel dans cette physique est de refuser les dualismes segmenteurs, de réfuter les pensées de la césure.
Mais c’est dans la physique moderne que Kirchhoff place ses espoirs de voir réémerger une vision tantrique de l’univers. Depuis la consolidation de la physique quantique, le monde apparaît à nouveau comme “pan-imbriqué”. Dans les colonnes de la revue polythéiste belge Antaios, Patrick Trousson avait déjà démontré l’étroite similitude entre les acquis de l’antique mythologie celtique et ceux de la science physique actuelle. Kirchhoff répète ces arguments, citant Carl Friedrich von Weizsäcker (Zeit und Wissen, 1992), Frithjof Capra (Le Tao de la physique), le physicien indien Amit Goswami (qui a comparé la philosophie du Vedanta et les acquis de la nouvelle physique), le théoricien systémique Ervin Lazslo, le biochimiste Rupert Sheldrake, etc. L’essentiel dans cette physique est de refuser les dualismes segmenteurs, de réfuter les pensées de la césure.En philosophie, Kirchhoff cite l’Américain Ken Wilber (Eros, Kosmos, Logos : Sex, Ecology, Spirituality), qui lutte contre tous les réductionnismes et les dualismes. Wilber est influencé par le bouddhisme tantrique, mais aussi par les Vedanta.
Le livre d’Uhlig nous dévoile de manière très didactique tous les aspects de la merveilleuse vision du monde tantrique. La postface de son ami Kirchhoff nous ouvre de très larges horizons : en physique et en philosophie. La lutte d’Uhlig (et la nôtre…) contre les mutilations de la pensée n’est pas terminée. Mais nos adversaires doivent désormais savoir une chose : nos arsenaux sont mieux fournis que les leurs…
► Marc Ferssens, Nouvelles de Synergies Européennes n°41, 1999.
◘ Notes en sus :
• 1) Numineux : Terme forgé par Rudolf Otto (1860-1937), philosophe allemand et historien des religions, pour désigner la pure émotion religieuse et la distinguer d'avec les croyances, jugements moraux, spéculations théologiques, associés au concept de sacré. R. Otto se détourne de toute explication rationnelle ou morale de la religion pour décrire le “phénomène” de la conscience religieuse. Il tente d’approcher négativement le “religieux” en le distinguant de toutes ses approximations (la crainte, le mystère, l’énorme, le fascinant). L'expérience religieuse est irréductible en termes d'idée, concept, notion abstraite, précepte moral. D’une façon générale, la notion du sacré s’attache à tout ce qui dépasse l’homme et suscite, plus encore que son respect ou son admiration, une ferveur particulière que R. Otto caractérise comme le « sentiment de l’état de créature » ou sentiment du “numineux” (du latin numen, qui évoque la “majesté divine”, qui qualifie l'exercice tout-puissant d'un dieu, mais abstraitement, à la différence de signum qui désigne la manifestation sensible par laquelle cette volonté divine se fait connaître : vols des oiseaux, prodiges, etc.) :
« Considérons ce qu’il y a de plus intime et de plus profond dans toute émotion religieuse intense qui est autre chose que foi au salut, confiance ou amour, ce qui, abstraction faite de ces sentiments accessoires, peut à certains moments remplir notre âme et l’émouvoir avec une puissance presque déconcertante ; poursuivons notre recherche en nous efforçant de le percevoir par la sympathie, en nous associant aux sentiments de ceux qui, autour de nous, l’éprouvent et en vibrent à l’unisson ; cherchons-le dans les transports de la piété et dans les puissantes expressions des émotions qui l’accompagnent, dans la solennité et la tonalité des rites et des cultes, dans tout ce qui vit et respire autour des monuments religieux, édifices, temples et églises : une seule expression se présente à nous pour exprimer la chose ; c’est le sentiment du mysterium tremendum, du mystère qui fait frissonner. Le sentiment qu’il provoque peut se répandre dans l’âme comme une onde paisible ; c’est alors la vague quiétude d’un profond recueillement.
Ce sentiment peut se transformer ainsi en un état d'âme constamment fluide […] il peut aussi surgir brusquement de l’âme avec des chocs et des convulsions. Il peut conduire à d’étranges excitations, à l’ivresse, aux transports, à l’extase. Il a des formes sauvages et démoniaques. Il peut se dégrader et presque se confondre avec le frisson et le saisissement d’horreur éprouvé devant les spectres. Il a des degrés inférieurs, des manifestations brutales et barbares, et il possède une capacité de développement par laquelle il s’affine, se purifie, se sublimise. Il peut devenir le silencieux et humble tremblement de la créature qui demeure interdite… en présence de ce qui est, dans un mystère ineffable, au-dessus de toute créature. » (Le Sacré, l'élément non-rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel (1917), Payot, 1929, tr. A. Jundt).
2) Maurice de Gandillac, dans La sagesse de Plotin (Vrin, 1966), note :
« À côté des textes catégoriques qui décrivent ainsi le corps comme un obstacle à la vie de l'esprit, d'autres, il est vrai, semblent lui accorder plus de prix et suggèrent une sorte de collaboration entre le somatique et le psychique. Il y a là sans doute, comme dans tout ce qui concerne la théorie plotinienne de la matière, une ambiguïté tenant à la double inspiration du système (et qui n'était pas tout à fait absente ni chez Platon ni même chez Aristote) ; nous croyons cependant qu'on peut ramener à une certaine unité les deux perspectives apparemment opposées, à condition de situer le corps à sa vraie place et de décrire d'abord son étrange situation, à l'extrême limite de diffusion des puissances psychiques.
Tandis que l'Un et l'Intelligence engendrent sans se mouvoir et par simple rayonnement, l'Âme apparaît chez Plotin comme une force mobile. Elle fait sortir d'elle-même l'ensemble des germes vitaux, et, tout en mouvant le grand animal cosmique, se communique par degrés aux vivants, qu'elle dote ainsi de “sensation” et de “nature”, ce dernier mot désignant le plus souvent les fonctions végétatives. En dépit de la multiplicité de ses manifestations, elle reste unique en son dynamisme essentiel et, jusque dans la plus humble mousse, la vie est participation à la Vie supérieure, celle de l'Âme du monde, dont le vrai rôle est de contempler l'intelligible. Mais, à son niveau inférieur, elle rencontre sa limite, qui est la simple indétermination.
À l'intersection de la vie végétale et de la pure matière, l'Âme n'engendre plus rien qui soit vivant, mais, parce qu'elle confère à la matière une sorte de structure élémentaire, “réceptacle” de la force végétative qui l'engendre et la nourrit, le corps animal ou végétal se distingue des minéraux, étant proprement “la dernière trace des choses de là-haut dans la plus infime de celles d'ici-bas” (III, 4, I). Il apparaît comme le produit ultime d'une sorte de synergie entre la “nature” où s'exprime la puissance de l'Âme du monde (ou du Verbe total) et les âmes individuelles qui viennent achever la première ébauche, comme le danseur adapte ses pas au thème dramatique. D'après les notes conservées à la Bibliothèque Victor Coussin semble que Bergson ait été fort séduit par cette théorie de la vie. Il l'interprète comme si des forces “physico-chimiques”, engendrant des structures quasi-biologiques mais impuissantes à achever leur synthèse, rencontraient, venue au devant d'elles, une force “spirituelle” qui n'aurait pu s'imposer seule à la matière. Dans cette hypothèse, à "l'appel d'en haut" répondrait une "aspiration d'en-bas. En réalité, pour Plotin, les 2 impulsions, celle de la "nature" et celle de "l'âme", procèdent de la même puissance originaire, enracinée dans la contemplation de la même Intelligence, et l'univers vitaliste des Ennéades ne fait aucune place à des "forces" purement mécaniques. » (p. 73-75)
3) « Apocalypse : Un commentaire païen de l'Apocalypse selon Saint-Jean » (in Vouloir n°142/145, 1998) :
« L'Apocalypse nous montre ce à quoi nous résistons, résistance contre-nature, nous résistons à nos connexions avec le cosmos, avec le monde, la nation, la famille. Toutes nos connexions sont anathèmes dans l'Apocalypse, et anathèmes encore en nous. Nous ne pouvons pas supporter la connexion. C'est notre maladie. Nous avons besoin de casser, d'être isolés. Nous appelons cela liberté, individualisme. Au-delà d'un certain point, que nous avons atteint, c'est du suicide. Peut-être avons-nous choisi le suicide. C'est bon. L'Apocalypse aussi choisit le suicide, avec l'auto-glorification que cela implique.
Mais l'Apocalypse montre, par sa résistance même, les choses auxquelles le cœur humain aspire secrètement. La frénésie que met l'Apocalypse à détruire le soleil et les étoiles, le monde, tous les rois et tous les chefs, la pourpre, l'écarlate et le cinnamome, toutes les prostituées et finalement tous les hommes qui n'ont pas reçu le “sceau” nous fait découvrir à quel point les auteurs désiraient le soleil et les étoiles et la terre et les eaux de la terre, la noblesse et la souveraineté et la puissance, la splendeur de l'or et de l'écarlate, l'amour passionné et une union juste entre les hommes indépendamment de cette histoire de “sceau”. Ce que l'homme désire le plus passionnément, c'est sa totalité vivante, une forme de vie à l'unisson, et non le salut personnel et solitaire de son “âme”.
L'homme veut d'abord et avant tout son accomplissement physique, puisqu'il vit maintenant, pour une fois et une fois seulement, dans sa chair et sa force. Pour l'homme, la grande merveille est d'être en vie. Pour l'homme, comme pour la fleur, la bête et l'oiseau, le triomphe suprême, c'est d'être le plus parfaitement, le plus vivement vivant. Quoi que puissent savoir les morts et les non-nés, ils ne peuvent rien connaître de la beauté, du prodige d'être en vie dans la chair. Que les morts apprêtent l'après, mais qu'ils nous laissent la splendeur de l'instant présent, de la vie dans la chair qui est à nous, à nous seuls et seulement pour une fois. Nous devrions danser de bonheur d'être vivants et dans la chair, d'être une parcelle du cosmos vivant incarné. Je suis une parcelle du soleil comme mon œil est une parcelle de moi-même. Mon pied sait très bien que je suis une parcelle de la terre, et mon sang est une parcelle de la mer. Mon âme sait que je suis une parcelle de la race humaine, mon âme est une partie organique de l'âme de l'humanité, tout comme mon esprit, une parcelle de ma nation. Dans mon moi le plus privé, je fais partie de ma famille. Rien en moi n'est solitaire ni absolu, sauf ma pensée, et nous découvrirons que la pensée n'a pas d'existence propre, qu'elle n'est que le miroitement du soleil à la surface des eaux.
Si bien que mon individualisme est en fait une illusion. Je suis une parcelle du Grand Tout, et n'y échapperai jamais. Mais je peux nier mes connexions, les casser, devenir un fragment. Alors, c'est la misère.
Ce que nous voulons, c'est détruire nos fausses connexions inorganiques, en particulier celles qui ont trait à l'argent, et rétablir les connexions organiques vivantes avec le cosmos, le soleil et la terre, avec l'humanité, la nation et la famille. Commencer avec le soleil, et le reste viendra lentement, très lentement. »
(D. H. Lawrence, Apocalypse, 1931 ; Balland, 1978 ; Desjonquières, 2002).

◘ Liens :
• Ressources bibliographiques
• Documents audio : Musique & Tantras
• Les Vivants & les Dieux — Tantrisme (09.02.2008)◘ Légende illustrations de haut en bas :
1) Nâga, serpent sacré hermaphrodite de l’hindouisme dont les mues cycliques lui confèrent un caractère d'immortalité, vivant dans les profondeurs de l’eau comme de la terre (grottes, montagnes, forêts), protecteur des récoltes contre les pluies torrentielles, des lieux saints et des écritures sacrées (les autres attributs sont réservés le plus souvent aux seuls initiés, comme dans les cultes rendus à Delphes, où siégeait la Pythie, prêtresse du Python vaincu). Il est souvent représenté sous forme d'une statue ou en gardien de la porte des temples par un être humain terminé par un corps de serpent. Il tient également une grande place parmi les traditions tantriques les plus anciennes de l'Inde (avant l'arrivée des Aryens, 1500 av. JC). Il est la clé de notre vie sur terre. Il sera adopté par le bouddhisme un peu plus tard (600 av. JC) au point de jouer un rôle important lors de l'éveil de Bouddha. On le retrouve dans la danse khmer, lié à un culte très ancien là aussi. Les Apsaras, nymphes des eaux, sont sous la protection de Nâga. Ananta est un immense serpent à mille têtes qui symbolise l'éternité. Il est représenté étendu sur les eaux de l'océan primordial. C'est le roi des Nâgas. Vishnou se repose sur lui pendant une période de résorption entre 2 ères cosmiques (kalpa). Les Maîtres de Sagesse sont appelés en Chine les “Dragons de Sagesse” ou “Rois-Dragons” (Long-Wang), l’équivalent des Naga-Rajas indiens. Ces noms s’expliquent du fait que le serpent des profondeurs est censé rejoindre sa nature céleste originelle, dans l’océan de sagesse. En d’autres termes, cela désigne les initiés qui ont entièrement alchimisé leurs forces intérieures en les transmutant, gagnant ainsi le juste titre d’Hommes Immortels (Xian Ren en Chine). L’allégorie des corps mi-homme mi-serpent doit être comprise selon l’idée que ces hommes sont initiés à la sagesse du serpent. Le serpent possède de multiples significations, englobant les divers savoirs occultes.
2) Bas-relief du temple de Khajurãho, env. Xe s. L'union de la śākti (énergie cosmique mère de toute production) et de la puruṣa (Principe donneur de formes) symbolisée par celle d'un dieu et d'une déesse. Les pratiques sexuelles dans le shâktisme sont un des aspects du tantrisme : ce sont des exercices spirituels centrés sur l'acceptation du mystère de l'énergie divine, et tout mystère demande initiation. C'est donc une voie de maîtrise ouvrant à une transcendance, et non une recherche de plaisir comme dans les stages “californiens” de resensualisation abusant de l'appellation “tantrique”. Cette mécompréhension fait néanmoins sens car elle témoigne du refoulement du corps, et par là de l'âme, dans la culture occidentale, notamment à travers ces hommes des villes, aveugles dans leur étreinte, qui ont perdu le sens de l'amour comme ils ont perdu le sens cosmique de l'art et de la nature, et qui sont par conséquent devenus tristement indifférents à ces forces obscures qui le hantent jusqu'à l'angoisse et l'emportent jusqu'à la sérénité, car ils n'ont plus de contact charnel avec les forces du surnaturel, de l'imaginaire et de la mort, — leurs sens pour les saisir s'étant atrophiés. La richesse théo-anthropocosmisque du tantrisme n'invite à vivre l'effort d'anamnèse, tentant de recoudre le tissu des choses, de réunir spirituel et temporel, vivants et morts, que pour féconder ce à quoi nous œuvrons. En cela elle est une école de sagesse, un chemin de vie, une invite à accomplir et non un exorcisme de l'imaginaire occidental.
3) « La Reine de la Nuit », bas-relief (v. – 1800/1750, sud de l'Irak, British Museum) représentant vraisemblablement Ishtar. La Déesse mésopotamienne, portant une couronne aux nombreuses cornes, tient dans chaque main une tige et un anneau, symbole de sa divinité. Ces ailes sont tournées vers le bas, indiquant qu'il s'agit d'une divinité de l'inframonde. Ses mollets et ses pieds sont ceux d'un oiseau de proie, semblables aux pattes des 2 hiboux qui l'encadrent (encore en référence au Monde de la Nuit). Elle repose sur ce qui me semble être des Lions. Le fond de la plaque devait à l'origine être peint en noir, indiquant qu'elle règne sur la Nuit. Enfin, les spécialistes n'ont apparemment pas tranché complètement : s'agit-il d'un aspect d'Ishtar, la Déesse de l'Amour et de la Guerre ; ou peut être de sa sœur et rivale Ereshkigal, Reine du royaume des morts ; ou même de Lilitu (aussi connue sous le nom biblique de Lilith), un démon du vent et de la tempête, qui pouvait amener maladie, souffrance et mort.

Le Tantrisme est une tradition spirituelle qui demeure peu connue dans sa formulation hindouiste en dépit de quelques bons livres parus à son sujet (ceux d'A. Avalon, de J. Evola, de Lilian Silburn et de Tara Michaël). Sa formulation bouddhiste est devenue plus accessible depuis la création en Occident de nombreux centres du bouddhisme tibétain qui est un bouddhisme tantrique. Il faut donc saluer la parution d'un livre de Pierre Feuga intitulé Tantrisme, Doctrine, pratique, art, rituel… Il constitue une des meilleures introductions à la perspective tantrique sous ses deux principales formes. Il faut rappeler que les enseignements tantriques sont spécifiquement destinés aux hommes vivant dans l'âge sombre, à la simple et redoutable condition de présenter un certain nombre de qualifications. La Voie tantrique est une Voie où seuls d'authentiques Guerriers de la Connaissance peuvent se retrouver. De remarquables approches de l'esprit guerrier propre à cette Voie se trouvent dans les livres du tibétain Chogyam Trungpa (aux éditions du Seuil). Voici un extrait de l'introduction de P. Feuga :
« Plus encore qu'une discipline spécifique, le tantrisme apparaît donc comme une dimension intérieure de l'indianité, un dynamisme constant, à la fois manifeste et secret (ce qui est sa grand force), perceptible partout et cependant caché, tel un cœur vibrant. C'est pourquoi le problème de son “orthodoxie” semble aujourd'hui assez académique. Vishnouisme, shivaïsme, yoga, bhakti, voire Vedānta, ont été si longuement provoqués puis colorés par le tantrisme qu'on imagine plus ce que seraient de tels enseignements sans lui. Même des courants “hétérodoxes” du strict point de vue brahmanique — comme le jaïnisme et surtout le bouddhisme — ont été puissamment marqués ou orientés par l'esprit des Tantras. Cet esprit fulgure à l'évidence dans la tradition tibétaine, dont j'aurai à parler souvent dans ce livre. Mais on retrouve des traces du tantrisme en Chine, au Japon, en d'autres pays d'Asie, y compris musulmans. En toutes ces contrées, le génie tantrique — équilibre subtil de liberté morale, de relativisme intellectuel et de haute technicité spirituelle —, ce génie efficace et détaché s'infiltra, revêtant au besoin tel ou tel masque religieux ou magique, comme demain, dans notre monde rationnel ou qui voudrait tant le paraître, il pourrait emprunter un masque scientifique. Cet esprit de jeu créateur, se servant inlassablement des formes pour se dégager des formes, pour se “transformer” (jouir de ce monde sans être attaché à ce monde est un des traits qui permet le mieux de reconnaître un “héros” tantrique (vira), d'hier ou d'aujourd'hui, distinguant sa voie de toutes les mystiques d'évasion ou de contemplation unilatérale ».
Dans sa conclusion, P. Feuga aborde la question de l'avenir du Tantrisme :
« … la réalisation tantrique est totale, globale, indivise. Elle est dedans et dehors, ici et là-bas. Elle n'exclut rien, peut coexister avec n'importe quelle forme de vie sociale, avec une mentalité poétique ou une mentalité scientifique, avec le magique ou le rationnel, le religieux ou le profane ; elle traverse tout et se rit des contradictions. Se demander par conséquent si le tantrisme a un avenir revient à se demander si l'humanité à un avenir : cela non seulement parce que les Tantras eux-mêmes ont affirmé avec force qu'ils étaient destinés aux hommes des derniers temps, c'est à dire de la fin du cycle humain actuel ; mais surtout parce que, tant qu'il restera un homme et une femme doués de conscience et d'énergie, non résignés au minimalisme spirituel ambiant, le tantrisme — dût-il changer de nom — demeurera présent ou, disons mieux, “possible”. En tant que voie de réintégration, en tant que méthode de libération, il peut même survivre à l'écroulement de toutes les religions, à la déliquescence de toutes les valeurs traditionnelles, — du moins si le fil initiatique ne se rompt pas définitivement et s'il subsiste quelques êtres capables de conserver et de transmettre le “diamant”. Le fait qu'il se soit lié historiquement à l'hindouisme et au bouddhisme n'est certes pas négligeable, mais l'on pourrait imaginer que demain l'esprit tantrique — esprit d'expérimentation plus que de spéculation et de foi — adopterait d'autres formes, nouerait d'autres alliances, pour épouser les rythmes d'un temps nouveau et pour sauver l'essentiel ».
Observons pour finir que l'étude du Tantrisme peut fournir la clé théorique et pratique de nombreux aspects des traditions du Paganisme antique.
◘ Pierre Feuga, Tantrisme. Doctrine, pratique, art, rituel, Éditions Dangles, 1994, 355 p.
► Jean de Bussac, Nouvelles de Synergies Européennes n°10, 1995.

◘ Tantra-Sangha : Tantrisme en Russie aujourd'hui
L'association religieuse tantrique “Tantra-Sangha” (Moscou) a été fondée en 1991 par un moine tantrique d'origine russe, Shripada Sadashivacharya [Sergueï Lobanov], qui avait reçu sa consécration en Inde. Ont adhéré à la “Sangha” les adeptes russes du tantrisme classique, de forme shivaïte-shaktiste, et des éléments se réclamant du paganisme slave ; ils sont présents dans toutes les grandes villes de Russie et des pays de la CEI. Les tantristes russes retournent aux sources de la culture spirituelle russe, vers la religion de tous les anciens Indo-Européens et tendant d'enrichir la tradition païenne russe en s'appuyant sur la tradition hindouiste-tantriste, qui en est fort proche. Ils essayent d'éviter 2 travers extrêmes : 1) promouvoir une “renaissance” artificielle du paganisme slave, tel qu'il a été anéanti par le christianisme et 2) introduire l'hindouisme sans tenir compte des conditions spécifiques russes. Les hindouistes d'Inde, du Népal et des autres pays considèrent que les “Hindous russes” sont leurs véritables coreligionnaires.
Les tantristes adorent un dieu-père, Roudra, qui est en fait Shiva, et une déesse-mère, Shakti, dont la force est illimitée. Les éléments les plus anciens de ce double culte témoignent de l'antiquité véritable de cette religion et, en la pratiquant, les tantristes russes ont l'avantage de s'appuyer sur des sources exclusivement indo-européennes [Roudra est considéré comme équivalent au dieu Rod du panthéon slave]. Selon la tradition, effectivement, les adorateurs de Roudra sont venu de Russie en Inde, il y a 7.000 ans. Ces adorateurs de Roudra sont les fondateurs de la tradition shivaïste-tantriste, religion des centaines de millions d'Indiens et de Népalais contemporains. Aujourd'hui, après l'effondrement du système marxiste et avec la déliquescence du christianisme, cette religion revient en Russie, pays qui fut jadis la patrie des Aryens d'Inde, avant qu'ils ne déboulent dans le sub-continent, au-delà de l'Indus.
La “Tantra-Sangha” coopère avec les organisations hindouistes et cherche à obtenir que l'on bâtisse à Moscou le premier temple hindouiste de Russie. L'association refuse tout contact avec les pseudo-tantristes qui ridiculisent le tantrisme en en faisant une sorte de “yoga sexualiste”. La “Tantra-Sangha” a une activité “missionnaire” et édite une revue, La Voie tantrique, ainsi que des brochures et des livres. En 1992, deux communautés importantes, issues de la “Tantra-Sangha” étaient enregistrées officiellement à Moscou et à Nijni-Novgorod [env. 250 membres]. L'activité de la “Tantra-Sangha” est pilotée par l'Ordre des Avadhoutas et le Gourou Shripada Sadashivacharya.
► Anatoly Mikhaïlovitch Ivanov, - Nouvelles de Synergies Européennes n°13, 1995.

 Jean Varenne : Anthologie de textes tantriques
Jean Varenne : Anthologie de textes tantriques• Recension : L’enseignement secret de la Divine Shakti, Anthologie de textes tantriques, Grasset, 258 p., 1995.
Jean Varenne vient de publier une anthologie de textes tantriques, traduits et commentés par lui-même, sous le titre de L’enseignement secret de la Divine Shakti. Il nous rappelle que les écritures sacrées de l’Inde n’ont été découvertes par l’Occident qu’à la fin du XVllle siècle et que longtemps le Védânta seul attira les philosophes. C’est par le biais du Yoga que le Tantrisme fut découvert. Voie subtile, riche en “moyens habiles”, le Tantrisme met l’accent sur la Puissance de la Déesse, un accent que Jean Varenne explicite en ces termes : « La puissance cosmique fait le lien en effet entre la pure transcendance de l’âtman-brahman et la réalité existentielle dont on discerne mal comment elle peut avoir son principe dans un Absolu qui la dépasse infiniment. Il faut nécessairement pour que tourne la roue de l’univers qu’une Énergie l’anime, une Shakti qui participe à la fois de l’Un (l’Esprit, le Purusha) et de l’autre (le Monde, la Prakriti). II faut aussi qu’elle soit immanente, c’est-à-dire qu’elle soit présente en chaque être puisque la moindre partie de l’Univers doit être mue par elle, pour exister. À ce moment, du raisonnement, le Yoga peut intervenir à son tour en invitant ceux qui le pratiquent à découvrir la shakti en eux sous la forme de la Kundalinî ».
► Jean de Bussac, Nouvelles de Synergies Européennes n°18, 1996.

• Recension : Indra SINHA, Le Tantra illustré, Éd. Gremese International, Rome, 1995, 154 p.
Les éditions Gremese International publient de beaux livres à un prix raisonnable. Parmi les derniers parus, il faut signaler Le Tantra illustré de Indra Sinha. Centré sur le Tantrisme hindou, l’auteur aborde certaines traditions de l’antiquité occidentale. Quelques lignes synthétisent bien le but et la méthode de cette Voie : « Le Tantrisme est une recherche d’intensité vitale dont le but est de répondre à des questions fondamentales comme : Qui suis-je ? Qu’est-ce que l’expérience ? Qu’est-ce que le monde ? Cependant, contrairement à de nombreuses traditions mystiques, il ne rejette pas la participation du corps aux expériences spirituelles les plus élevées. Le corps y est même vu comme quelque chose de sacré : un microcosme qui reproduit l’univers ». L’iconographie est superbe.
► Jean de Bussac, Nouvelles de Synergies Européennes n°18, 1996.

Pièces-jointes :
Le Tantrisme
Le tantrisme a été la dernière découverte de la science occidentale. Si le védisme, le brahmanisme et le bouddhisme sont connus et assidûment étudiés en Occident depuis plus d’un siècle, l’étude du tantrisme est à peine amorcée. Une partie seulement des textes tantriques ont été édités, très peu ont été traduits et l’analyse critique, historique et philosophique de ses doctrines et de ses rituels n’en est qu’à ses débuts. Actuellement, il n’existe pas un seul ouvrage d’ensemble sur le tantrisme, tandis qu’on trouve une dizaine d’excellentes monographies sur le védisme, le brahmanisme et le bouddhisme.
À quoi tient ce retard, ou, disons le mot, cette négligence de l’indianisme occidental ? En premier lieu, à la structure même du phénomène tantrique — phénomène difficilement compréhensible pour un Occidental qui n’a pas encore pénétré les autres grandes synthèses antérieures de la spiritualité indienne. La tantrisme est, en effet, la dernière création de l’Inde. En lui se concentrent, s’interpénètrent et se fécondent réciproquement toutes les traditions, spirituelles de l’Inde, depuis la plus ancienne en date, le ritualisme védique, jusqu’à la plus récente, la mystique vishnouïte.
Mais cette concentration de multiples traditions ne veut pas dire syncrétisme. Il s’agit, sans doute aucun, d’une nouvelle synthèse ; on peut même dire de la plus grandiose création spirituelle de l’Inde post-bouddhiste. Les premiers savants occidentaux qui ont approché les textes tantriques n’ont pas reconnu au prime abord l’importance de ce mouvement religieux. D’une part, ils ne disposaient pas encore d’une connaissance précise des doctrines, des techniques, et, qui plus est, des lexiques secrets tantriques ; d’autre part, ils ont jugé, un peu trop rapidement, la littérature tantrique avec les préventions d’un Occidental du XIXe siècle : ils se sont rebiffés devant ce qu’ils appelaient le fatras et le galimatias des textes tantriques, qu’ils ont considérés comme une somme ennuyeuse de rituels absurdes ou puérils ; ensuite ils ont été indignés devant certains aspects aberrants du rituel tantrique, en premier lieu les cérémonies sexuelles, qu’ils ont interprétées à la lettre et qu’ils ont confondues avec les vulgaires orgies qu’on rencontre aussi en Inde comme on les rencontre un peu partout dans le monde archaïque. Ce n’est que très récemment qu’on a commencé à comprendre que les pratiques secrètes ne sont pas toujours infâmes, et qu’elles ne sont pas dépourvues du plus haut intérêt philosophique. Pendant plusieurs générations, l’Occident a considéré le tantrisme comme une luxuriante et dangereuse dégénérescence de la spiritualité indienne. Jusqu’en ces dernières années, parler du tantrisme était regardé comme une preuve de mauvais goût. Je crois que nous avons le droit de réagir contre ce préjugé qui, en somme, reflète la mentalité positiviste et moralisante de l’Européen moyen de la fin du XIXe siècle. Bien qu’il s’agisse d’un phénomène spirituel étranger à nos traditions et, par conséquent, difficile à comprendre et à assimiler, le tantrisme représente une noble et audacieuse création de l’esprit indien ; en l’occurrence, du même esprit indien qui nous a donné les Upanishads, le Bouddhisme et le Védânta. Du point de vue de la structure il n’y a aucune solution de continuité des Upanishads au tantrisme. Les données du problème sont restées les mêmes, elles se résument dans l’ambiguïté du « réel » et l’illusion du dualisme. Ce qui a changé ce sont les moyens de résoudre ce problème classique de la pensée indienne : ils ne consistent plus uniquement dans la connaissance métaphysique promulguée par les Upanishads et le Védânta, mais font intervenir les techniques rituelles et yogiques ; autrement dit, les instruments spirituels les plus sûrs pour la conquête du réel.
Le terme « tantrisme » est, en lui-même, assez vague. Le mot tantra — littéralement « trame » — signifie entre autres choses « théorie, doctrine, système ». Il est difficile de préciser quand ce terme a pris, dans le sanskrit et les langues vernaculaires indiennes, le sens particulier qu’il possède - aujourd’hui. D’ailleurs, le tantrisme bouddhiste a un nom spécial, Vajrayâna, tout comme le tantrisme hindouïste était connu au moyen âge plutôt sous le nom de çaktisme, çivaïsme et sâhâja. Ce qu’on appelle communément tantrisme ne se laisse pas facilement définir en quelques mots, car il existe une multitude d’écoles et de courants tantriques en perpétuelle osmose : il y a, en premier lieu, les deux grandes traditions, le tantrisme bouddhiste, le Vajrayâna, et le tantrisme hindouïste. En dépit de toute cette énorme efflorescence, en dépit de ce pullulement de sectes et d’écoles, quelques principes communs sont à la base de chacune des innombrables formes du tantrisme. Étant donné le peu d’espace dont nous disposons, c’est uniquement de ces principes fondamentaux que nous pourrons nous occuper dans les pages qui suivent.
Historiquement, la littérature tantrique bouddhiste, à savoir le Vajrayâna, commence à s’affirmer à partir du vie siècle de notre ère, mais c’est seulement entre le VIIIe siècle et le IXe siècle que l’Inde entière, bouddhiste ou brâhmaniste, tombe sous l’emprise de ce qu’on pourrait appeler la « vogue tantrique ». Mais les questions de chronologie sont loin d’être entièrement élucidées. Des principes et des méthodes tantriques se rencontrent dans certaines écoles bouddhistes bien avant le VIIIe siècle, et des savants très distingués croient pouvoir fixer les débuts de la littérature tantrique au IIe siècle après Jésus-Christ. Quoi qu’il en soit, et comme il arrive toujours dans l’Inde, les choses qui paraissent, à première vue, si nouvelles dans le tantrisme sont en fait assez anciennes. Pratiquement, il n’y a "presque rien dans le tantrisme qui ne se trouve déjà, sous une forme plus ou moins élaborée, dans le védisme, le brahmanisme ou le bouddhisme. En effet, par exemple, le secret de l’initiation et de la doctrine révélée est déjà védique ; le ritualisme est un caractère distinctif du brahmanisme ; les méditations et les contemplations appartiennent au domaine pan-indien du Yoga ; l’iconographie et le panthéon sont aussi bien bouddhistes qu’hindouïstes ; la physiologie mystique est à la base du Hatha-yoga ; l’érotique mystique n’est pas inconnue dans les textes brahmaniques, etc.. Même quand il s’agit d’un élément religieux nettement extra-védique et extra-brâhmanique, comme la présence prédominante de la Grande Déesse, cet élément, bien que non aryen, est toujours autochtone et archaïque ; en l’occurrence, il représente l’apport fondamental de la spiritualité aborigène, anaryenne, à la spiritualité hindouïste.
Ainsi, aux yeux des non prévenus, le tantrisme donne l’impression d’un mélange de vieilles traditions, quand en réalité il est une refonte totale de tous ces éléments, une synthèse faite en vue de satisfaire les besoins religieux et philosophiques de l’Hindou de l’âge moderne. L’expression : « besoins religieux et philosophiques » doit être comprise dans le sens indien du terme et signifie avant tout l’obligation de résoudre le problème de la souffrance et de l’ignorance, et d’obtenir, à tout prix, l’illumination suprême, qui équivaut à la délivrance et à la béatitude.
Quant à la désignation : « l’âge moderne », nous la comprenons dans le sens du Kali-yuga, « l’âge ténébreux » qui a commencé il y a bien longtemps et dont le terme, toujours d’après la tradition indienne, n’est plus très éloigné. Quantité de textes tantriques précisent que leur doctrine a été révélée par la Déesse spécialement à l’usage de l’homme moderne, de l’homme du Kali-yuga, c’est-à-dire de l’homme déchu. De ce point de vue, on peut dire que le tantrisme représente la doctrine et la technique spirituelle traditionnelles adaptées aux conditions et aux besoins de cet âge crépusculaire. C’est pour cette raison que dans le tantrisme on reconnaît tant d’éléments archaïques, soit hindouïstes, soit bouddhistes, bien que leur valorisation proprement tantrique leur confère une tout autre importance.
Pour simplifier notre exposé, nous allons rappeler les principes et les techniques tantriques non pas dans l’ordre de leur importance, ni dans celui de leur révélation au cours de l’initiation, mais en tenant compte en premier lieu de quelques traits spécifiques que nous voulons mettre particulièrement en valeur. Comme toute doctrine véritable, le tantrisme est révélé uniquement par une initiation du maître au disciple. La copieuse littérature tantrique ne sert que de commentaire aux vérités révélées directement par le guru. La vraie doctrine, qui est secrète, se transmet de vive voix, d’homme à homme ; littéralement traduit « de bouche en bouche » (vaktrât vaktrântaram), comme dit le Kulachûdâmani Tantra. « Le secret doit être bien gardé des paçu », des « bêtes », des non-initiés, affirme le même texte. Les tantrikas font toujours la distinction entre le sens « extérieur » (bâhya) et le sens « intérieur » (adhyât-mikd) d’un texte ; le premier sens est littéral, le deuxième occulte.
C’est pour une raison similaire qu’une partie considérable des textes tantriques ayant trait aux rites secrets est rédigée en un langage caché, la sandhyâ bhâshâ, un « langage crépusculaire », devenant, de ce fait, presque inintelligible sans l’aide d’un initié. La caractéristique de ce « langage crépusculaire » est la multivalence de significations. Il s’agit d’utiliser la clé exacte pour pouvoir déchiffrer le sens précis du rituel proposé. Car, » dans ce langage obscur à double sens, un état de conscience est exprimé par un terme érotique et la terminologie physiologique est riche en valeurs cosmologiques. C’est ainsi que le « lotus », symbole métaphysique par excellence, est interprété, dans le langage secret, comme bhaga, matrice. Le « foudre », vajra, signifie linga mais aussi çunya, le vide métaphysique. Une veine désigne aussi bien un « organe mystique » qu’une position yogique ou un état de conscience. Par conséquent, des textes en apparence de la plus haute portée spéculative ont une signification occulte érotique, et vice-versa. Voici comme exemple de la première catégorie un vers du Dohâ-Koça (d’après Shahidullah) : « L’immobile englobe la pensée de l’illumination malgré la poussière qui l’orne. On voit la graine du lotus, naturellement prise dans son propre corps. » Le commentaire sanskrit explique ce vers de la façon suivante : si dans le maithuna, c’est-à-dire pendant l’union sexuelle cérémonielle, le çukra reste sans émission, la pensée aussi reste immobile.
Et voici maintenant un deuxième exemple. Un vers du Tantra-tattva nous assure que si : « En buvant, en buvant, en buvant toujours de nouveau on tombe sur terre, et si on se lève et qu’on boit de nouveau — on élude le risque d’une autre existence, d’une existence nouvelle », c’est-à-dire on obtient la libération suprême. Le commentaire explique : « Pendant le premier stade de la satcakra sâdhanâ (la technique yogico-tantrique de la pénétration des six centres nerveux appelés cakrd), le néophyte (sâdhaka) ne peut pas suspendre son souffle pour un temps suffisamment long qui seul lui permettrait de pratiquer la concentration et la méditation (prévue) dans chacun de ces (six) centres. Il ne peut pas, par conséquent, retenir la Kundalinî dans (la veine mystique médiane) sushumnâ au delà de sa capacité d’arrêter son souffle (kumbhaka). Dès lors, il est obligé de revenir sur la terre — ce qui signifie dans le mûlâdhâra cakfa (qui se trouve à la base de l’épine dorsale et qui est le centre de l’ « élément terre »), après avoir bu l’ambroisie céleste. Le néophyte doit pratiquer cet exercice bien des fois, et par une pratique continue la cause d’une nouvelle existence (c’est-à-dire le désir) est définitivement éloignée ».
On se rend compte, d’après ces deux exemples, de l’extrême difficulté de bien comprendre le sens occulte d’un texte tantrique. Toutes les mesures pour égarer les non-initiés ont été prises. Il faut ajouter que la nature même de la discipline tantrique oblige l’auteur d’un texte pareil à employer la sandhyâ-bhâshâ, le « langage crépusculaire ». Car une initiation tantrique peut s’accomplir à des niveaux différents bien qu’homologables. C’est ainsi que certaines écoles tantriques ne pratiquent que très rarement, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le’ rituel de l’union cérémonielle — tandis que d’autres écoles, notamment la Sahajyâ, fondent sur le maithuna le principe même de leur initiation. Néanmoins, les textes de ces différentes écoles sont utilisables par n’importe quel tantrika. Car la vérité révélée est la même, soit qu’on la réalise en la compagnie d’une mudrâ ou d’une nâyîkâ, d’une femme réelle, soit directement par la pensée. En guise d’illustration, nous signalerons qu’il est toujours malaisé d’interpréter le terme dombi, qui désigne la « blanchisseuse », prototype d’une femme de basse caste. On ne peut douter que dans bien des orgies rituelles les femmes de basse caste jouent un rôle. Cependant dans le lexique secret des Dohâkoça, dombi signifie nairâtma, inexistence du moi, ou bien çûnya, la « vacuité ». Un texte comme le suivant : « O dombi ! tu as tout souillé !... Certains te disent laide, mais les sages te retiennent contre leur poitrine... O dombi ! il n’est pas de plus dissolue que toi !... » — un tel texte peut être interprété comme se référant à une expérience réelle, ou à une expérience extatique provoquée par la brusque découverte de la vacuité universelle.
Cette même ambiguïté quant à la structure de l’expérience, on la rencontre dans tous les autres rituels tantriques. On constate une permanente interpénétration des niveaux du réel. Plus exactement, le tantrika s’efforce de s’ancrer, au début, dans le concret le plus immédiat — et de le transfigurer par la suite ; en d’autres termes, de réanimer les énergies cosmiques endormies dans les objets rituels qui l’entourent. Aussi, l’initiation et les cérémonies tantriques accordent-elles une importance de premier ordre aux icônes, aux statues, aux objets rituels (vases, fleurs, encens, etc.). Mais il s’agit toujours de transfigurer ces objets et de retrouver leur véritable essence, qui est, inutile de le répéter, une essence cosmologique. L’exacte prononciation des formules sacrées, mantra ou dhârani — formules et prononciation révélées par le guru aux divers degrés de l’initiation — acquiert dans le tantrisme un rôle capital. Ces formules mystiques, ces liturgies orales ou mentales, formées parfois d’onomatopées, ou de mots inintelligibles, y deviennent un véhicule de la concentration. Un texte canonique comme la Sâdhanamâlâ n’hésite pas à exalter le pouvoir vraiment illimité de ces « mots mystiques » : « Qu’y a-t-il que l’on ne puisse pas réaliser par les montras, si ceux-ci sont appliqués conformément aux règles ? » Le mantra lokanâtha, entre autres, peut absoudre des plus grands péchés et le mantra ekajâta est si puissant que, au moment même où il se prononce, l’homme est à l’abri de tout danger et atteint la sainteté de Bouddha. Toutes les siddhis, les pouvoirs mystiques, de n’importe quelle sorte — depuis le succès dans l’amour jusqu’à la réalisation du salut — sont obtenues par de telles formules mystiques.
L’efficacité illimitée des mantras est due au fait qu’ils sont, ou du moins qu’ils peuvent devenir, moyennant une récitation correcte, les « objets » qu’ils représentent. C’est ainsi que chaque dieu, et chaque degré de sainteté possèdent un bîja-mantra, un « son mystique » qui est leur « semence », leur « support » ou mieux leur être même. En répétant selon les règles ce bîja-mantra, le pratiquant s’approprie son essence ontologique, s’assimile d’une manière concrète et immédiate le dieu, l’état de sainteté, etc.. Le Cosmos entier, avec tous ses plans et ses modes d’être, se manifeste en un certain nombre de mantras ; l’Univers est sonore, au même titre qu’il est chromatique, formel, substantiel, etc.. Un mantra est un « symbole » dans le sens archaïque et primitif du terme : autrement dit, il est en même temps la « réalité » symbolisée et le « signe » symbolisant. Entre le mantra-yâna tantrique et l’iconographie, il y a une parfaite correspondance ; car, à chaque état mystique et à chaque degré de sainteté correspondent une image, une couleur et une lettre spéciales. C’est en méditant sur la couleur ou le son « mystique » qui le représente que l’on pénètre dans une certaine modalité surhumaine, que l’on absorbe ou que l’on s’incorpore un état yogique, un dieu, etc.
Le Cosmos, tel qu’il se révèle dans la conception tantrique, est un vaste tissu des forces magiques ; et les mêmes forces peuvent être réveillées ou organisées dans le corps humain, par les techniques de la physiologie mystique. C’est ainsi que le Kaulajnânanirnaya nous apprend comment il faut situer les différents mantras dans les cakras, dans les « centres » que la physiologie mystique indienne situe à l’intérieur du corps humain. Parfois, les mantras sont fixés dans certaines parties du corps. Pour ne citer qu’un seul exemple, il y a, dans le petit traité Hastapûjâvidhi, qu’a édité et traduit L. Finot, une méditation grâce à laquelle les doigts de la main gauche sont identifiés aux cinq éléments et aux cinq divinités, en même temps que cinq syllabes mystiques « de couleur respectivement blanche, jaune, rouge, noire et verte », dit le texte, sont « imposées » sur les ongles. Ces syllabes représentent Vairocana, Amitâbha, Akshobhya, Ratnasambhava, Amoghasiddhi, lesquels sont les cinq Dhyâna-Bouddhas.
Une conception similaire explique l’importance accordée par le tantrisme à l’iconographie. Les images deviennent des « supports » pour la méditation. Une image doit être « éveillée », ce qui veut dire dynamisée et finalement assimilée. Entre l’iconographie, la liturgie (orale ou mentale), et la méditation yogique il existe une relation organique. L’image comme le son mystique (mantra) n’est qu’un véhicule pour la concentration yogique. Dans le tantrisme, la concentration signifie l’opération par laquelle on construit une image mentale de la divinité et le processus de dynamisation de cette image, son « animation », sa transformation de symbole en expérience. Les images divines ne sont pas seules à être intériorisées, le sont également le culte lui-même, les endroits du culte, etc. Le Kaulajnânanirnaya, notamment, donne des prescriptions concernant l’accomplissement du culte dédié au symbole iconographique de Çiva, le lingam : la première fleur que l’on offre à celui-ci est Yahimsâ, proprement la non-violence ; ensuite on lui offre la maîtrise de soi-même, la douceur, l’idéalisme, etc., bref, une série de vertus indispensables à la concentration et à la pratique Yoga. Dans le même texte, on prescrit d’intérioriser les lieux de pèlerinage célèbres ; les intérioriser, ce qui signifie les localiser dans le corps, les mettre en connexion avec les différentes « veines » ou « nerfs » (nâdî) de la physiologie mystique.
Cette intériorisation ne veut pas dire abstraction. Le corps humain ne perd jamais sa corporéité, mais par la discipline tantrique, le corps physique se dilate, se cosmise, se transsubstantialise. La condition physique et psychologique de l’homme profane est dépassée, sinon abolie ; les activités sensorielles sont étendues dans une proportion, hallucinante, à la suite d’innombrables identifications d’organes et de fonctions physiologiques, aux régions cosmiques, aux astres, aux dieux, etc.. Mais, répétons-le, le corps joue un rôle prépondérant dans le tantrisme, et c’est surtout à cause de cette primauté accordée à la physiologie, à l’expérience charnelle, que le tantrisme doit être considéré comme la doctrine et la technique par excellence de l’homme déchu du Kali-yuga. A notre époque, affirment les textes, l’ascétisme absolu et la contemplation exclusivement métaphysique ne sont plus capables de résoudre le problème posé par la condition humaine, lequel consiste à abolir la souffrance et l’illusion, à reconquérir la liberté et la béatitude. Enlisé dans la matière, l’homme moderne, l’homme du Kali-yuga, doit commencer son ascension à partir de cette matière, même, sans toutefois s’éloigner de sa source vivante, qui reste l’énergie sexuelle. L’ancien ascétisme indien avait réduit le corps à une énorme entrave. Le tantrisme non seulement retrouve le corps, ¦ mais il en amplifie les possibilités mystiques et le tient pour une condition sine qua non de la délivrance. « Sans le corps, dit le Hevajra Tantra, il n’y a pas de béatitude suprême ». « Sans le corps, il n’y a ni, perfection,, ni béatitude », affirme de son côté le Sri-Kâla-cakra-tantra. Et dans le Dohakosha Saraha s’écrie : « Ici, dans le corps, se trouvent le Gange et la Jumnâ, Prayâga et Bénarès, le Soleil et la Lune. Ici sont les lieux sacrés, les Pîthas et les Upapîthas. Je n’ai pas vu une seule place de pèlerinage ni un seul endroit de béatitude comparable à mon corps. ». Un autre texte parle du yogi Kanha qui « jouit dans la cité de son corps d’un état de non-dualité ».
L’importance du corps dans le tantrisme est accrue du fait que non seulement les astres, les lieux de pèlerinages, les temples, les dieux et les états de sainteté sont localisés dans les divers organes mystiques — mais aussi les principes métaphysiques. Ainsi, les trois kâya du bouddhisme mahâyânique sont localisés dans les trois plexus (cakrd). Selon le bouddhisme tantrique, Prajnâ, la Sagesse suprême, manifestation de la Déesse, se trouve endormie dans la région du mûlâdhâra cakra, tandis que Upâya, c’est-à-dire la technique, le procédé assimilé à Bouddha Vajra-sattva, réside dans la région du cerveau. Le but de la discipline tantrique est d’éveiller la Déesse Prajnâ et de la faire remonter à travers le corps jusqu’à atteindre le Bouddha Vajra-sattva et à s’unir avec lui. Dans les diverses formes du tantrisme hindou, Çiva, principe de la Conscience pure, réside dans le sahasrâra, le lotus à mille pétales de la région cérébrale ; Çakti, la déesse, principe de la force créatrice universelle, réside dans le mûlâdhâra-cakra, sous l’aspect d’un petit serpent (Kundalinî). Exactement comme dans le tantrisme bouddhiste, le but de la technique tantrique hindoue est de réveiller la déesse et de l’unir avec le dieu Çiva.
D’ailleurs, nous rencontrons également un grand nombre d’autres localisations et homologations des principes métaphysiques et cosmologiques à l’intérieur du corps humain. C’est ainsi que le côté droit du corps est masculin, et le côté gauche féminin, par imitation du Çiva, sous sa forme androgyne, bi-sexuelle, Ardhanârîçvara. Pour le tantrisme vishnouite, Râdhâ, la bergère légendaire de Vrin-davan, amoureuse du dieu Krishna, correspond au côté gauche de l’homme et Krishna au côté droit. L’homme parfait, en suivant de près Krishna, son modèle divin, est androgyne. Mais dans le Kali-Yuga, l’androgynie humaine, qui équivaut à la perfection et à la béatitude, ne peut plus être obtenue uniquement par des techniques méditatives et contemplatives. Il faut, pour y parvenir, une expérience concrète, de structure sexuelle, seule capable d’éveiller ces deux principes polaires endormis dans le corps humain et, par conséquent, de réaliser l’union de Krishna et de Râdhâ, de Çiva et de Çakti, d’Upâya et de Prajnâ.
Étant donné l’importance métaphysique du principe féminin — représentant, dans le tantrisme hindou, l’aspect actif et créateur de la réalité cosmique — il est facile de comprendre le rôle essentiel joué par la femme dans le mouvement tantrique tout entier. En un certain sens, on peut dire que le tantrisme est le retour à la religion de la Mère, à la religion archaïque qui a dominé l’Inde pré-aryenne de la préhistoire, comme elle a dominé l’aire afro-eurasiatique en sa totalité. Mais cette fois-ci il s’agit de quelque chose de. plus qu’une simple dévotion à la Mère, à la Grande Déesse de la fertilité cosmique : il s’agit de résoudre le problème de la douleur de l’existence et de reconquérir la liberté et la béatitude spirituelles. Le but de l’union cérémonielle est, comme nous allons l’expliquer, l’intégration des principes polaires de l’homme, sa transformation en un androgyne. Mais il y a aussi autre chose : la signification révolutionnaire de ces pratiques tantriques, spécialement les pratiques du bouddhisme tardif. L’importance accordée à la femme, l’union sexuelle promue au rang d’un instrument de salut, l’apologie de l’orgie rituelle — tout cela équivaut à un manifeste révolutionnaire rédigé contre la métaphysique, la morale et la religion anciennes. Les lois sociales et les principes éthiques doivent être abolis puisqu’ils sont illusoires. Dans un monde dépourvu de réalité ontologique, où tout est illusoire, tout est permis — à condition que celui qui jouit de ces libertés ne se comporte pas comme un esclave, comme une « bête » (paçu), mais réalise continuellement le manque de réalité foncière de toute chose profane. Inutiles les rites à l’ancienne mode, védique ; inutile le renoncement ascétique, inutiles les prières. L’important est d’atteindre à la vacuité de toute forme cosmique et à la réalité ultime, cachée aux yeux des non-initiés, des non-illuminés. Par conséquent, en apparence du moins, tout est permis. Et un texte de l’importance du Guhya-samâja Tantra affirme péremptoirement que : « personne ne réussit à obtenir la perfection par des opérations difficiles et ennuyeuses ; mais la perfection peut facilement être acquise par la satisfaction de tous les désirs ». Le même texte précise que la luxure est permise, que le tantrika peut tuer n’importe quel animal, qu’il peut mentir, voler, commettre l’adultère, etc.. Car, comme le dit le Bodhisattva, « la conduite des passions et des attachements (râgacaryâ) est la même que la conduite d’un Bodhisattva (bodhisattvacaryâ), celle-ci étant la conduite la meilleure (agracaryâ) ». Autrement dit, tous les contraires sont illusoires, l’extrême mal coïncide avec l’extrême bien, la condition de Bouddha peut — dans les limites de cette mer des apparences — coïncider avec la suprême immoralité ; tout cela pour le bon motif que seul le « vide » universel est, tout le reste étant dépourvu de réalité ontologique.
Il est facile de comprendre la réaction des milieux orthodoxes devant ces rituels en apparence dénués de toute valeur religieuse. Signalons à ce propos qu’un texte tantrique, le Mahâ-cîna-Kramâcara, raconte comment le sage Vasishta, fils de Brahma, s’en va interroger Viçnou, sous l’aspect du Bouddha, concernant les rites de la déesse Tara. Il pénètre dans le « grand pays de Cîna » et il aperçoit le Bouddha entouré d’un millier d’amantes en extase érotique. La surprise du sage touche au scandale : « Voilà des pratiques contraires au Véda ! » s’écrie-t-il. Une voix dans l’espace corrige son erreur : « Si tu veux, dit la voix, gagner la faveur de Tara, alors c’est avec ces pratiques à la chinoise qu’il faut m’adorer ! » Il s’approche du Bouddha et recueille de sa bouche cette leçon inattendue : « Les femmes sont les dieux, les femmes sont la vie, les femmes sont la parure. Soyez toufours en pensée parmi les femmes ! » [1].
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’il ne s’agit nullement ici d’une orgie ordinaire. Le maithuna, l’union cérémonielle, est un rituel où les acteurs sont transsubstantialisés ; l’acte humain, organique, est devenu un drame de participation à la conscience cosmique, divine. Les textes tantriques répètent souvent cet adage : « Par les mêmes actes qui font brûler certains hommes dans l’Enfer pendant des millions d’années, le yogin obtient son éternel salut 1a « Le plaisir que donnent l’alcool, la viande, les femmes, c’est délivrance pour ceux qui savent, péché mortel pour les non-initiés... le yogin goûte les plaisirs des sens pour aider les hommes, et non point par désir... Il traverse toutes les jouissances et aucun mal ne le salit... Il est toujours pur, comme sont les baigneurs de la rivière » [2].
Pour nous résumer, le tantrisme trahit dans sa structure même le paradoxe de la réalité ultime et celui de la condition humaine. Il s’efforce de s’ancrer dans le concret le plus physiologique, mais seulement pour pouvoir, par la suite, transsubstantialiser ce concret et redécouvrir en lui les principes mêmes de la Vie Cosmique. Il fait appel à la présence féminine, concrète ou idéale, mais uniquement dans le dessein de redécouvrir l’identité foncière entre le principe féminin et masculin. « Toi, ô Devî, dit Çiva à la Déesse dans le Mahânirvâna Tantra, Toi, tu es mon véritable moi-même ! Il n’y a pas de différence entre Toi et Moi. » La doctrine ultime, /et la plus secrète, du tantrisme est justement cette identité des contraires, cette identité entre Çiva et Çakti, entre Krishna et Râdhâ, entre Bouddha et la Déesse — en un mot l’identité de l’aspect négatif, non manifesté, de la réalité et de son aspect manifesté. La libération, la béatitude est l’accomplissement de. cette unité de principes polaires dans son propre être. Mais, contrairement aux autres « philosophies » indiennes, le tantrisme croit que l’homme déchu du Kali-yuga n’a plus la possibilité d’obtenir cette identification des contraires par la seule voie gnos-tique, métaphysique, par la voie de la contemplation èt de la sagesse. L’homme du Kali-yuga ne peut être sauvé qu’à partir de sa propre condition existentielle — qui est, en premier lieu, une condition charnelle, vu l’incapacité d’approcher directement par l’esprit la réalité ultime.
C’est pour cette raison que l’identification des contraires est réalisée dans le tantrisme sous la forme de l’androgynie. L’éveil de la Kundalinî, qui constitue la pratique la plus secrète et la plus dangereuse du tantrisme, ne signifie pas autre chose que l’union de la déesse Çakti avec le dieu Çiva, à l’intérieur du corps humain. Cet éveil et cette union s’obtiennent à travers une pratique yogique extrêmement difficile à exposer. Le premier résultat de l’éveil de la Kundalinî dans l’intérieur de l’homme est sa permanente béatitude, sa délivrance de la douleur de l’existence.
Mais ceci n’est qu’une première étape. L’éveil de la Kundalinî rend possible une pratique encore plus complexe, moyennant laquelle l’homme abolit la durée temporelle et réalise l’immortalité ici-bas. Il existe très peu de textes sur ces pratiques et ils sont, plus encore que les autres, extrêmement obscurs. Tout ce qu’on peut y déceler c’est que ces pratiques, en relation avec l’éveil de la Kundalinî, tendent à unifier, à l’intérieur du corps humain, tous les courants polaires, qu’il s’agisse des rythmes cardiaques respiratoires ou sanguins, ou même des phénomènes physiologiques d’assimilation et de désintégration, A un certain moment de la pratique, le corps devient complètement « unifié, comme un vase clos, symbole d’un Cosmos parfait et serein. Celui qui est parvenu à cette extase a dépassé d’une manière radicale la douleur de l’existence humaine. Il est un jîvan-mukta, un « délivré dans la vie ».
► Mircea Eliade, in : Approches de l’Inde : Tradition et incidences, 1949. [version pdf]
[1] S. LÉVI, Le Népal, vol. I, p. 346 sa. Paris, 1905
[2] Cf. Mircea Eliade, Techniques du Yoga, p. 240. Gallimard, 1948.• Bibliographie essentielle :
Tous les ouvrages et traductions (en anglais) de A. Avalon (Sir John Woodroffe), l’un des plus grands spécialistes du tantrisme.
Mircea Eliade, Yoga : Essai sur les origines de la mystique indienne, Paul Geuthner, 1936.
Technique du Yoga, Gallimard, 1948.
Étude sur le tantrisme
 Le tantrisme n'est pas une religion différente de l'hindouisme, du bouddhisme (ou du jaïnisme). Il n'en est qu'une forme particulière, un “système modelant secondaire”, avec ses normes propres, organisant à sa manière des éléments qui, pour la plupart, sont ceux du système général de la culture hindoue (ou bouddhique) par rapport à laquelle il faut donc le poser. Caractérisé par un ritualisme proliférant, un panthéon envahissant et des pratiques de yoga particulières, il a aussi des traits théologiques et doctrinaux propres, avec une vision originale de la divinité et du monde. Développement intérieur aux religions indiennes, le tantrisme, tout en y formant des courants ésotériques très caractérisés, les a généralement marquées de son empreinte, si bien qu'il est peu aisé, du moins dans l'hindouisme, de repérer exactement ses contours. Répandu avec ces religions hors de l'Inde — au Tibet, dans la péninsule indochinoise et en Indonésie, en Chine et, de là, au Japon (et cela des premiers siècles de l'ère chrétienne à nos jours) —, il y a pris des aspects divers. Si donc le tantrisme fait problème, il apparaît aussi comme un phénomène religieux multiforme, d'une longue durée historique et d'une importance considérable.
Le tantrisme n'est pas une religion différente de l'hindouisme, du bouddhisme (ou du jaïnisme). Il n'en est qu'une forme particulière, un “système modelant secondaire”, avec ses normes propres, organisant à sa manière des éléments qui, pour la plupart, sont ceux du système général de la culture hindoue (ou bouddhique) par rapport à laquelle il faut donc le poser. Caractérisé par un ritualisme proliférant, un panthéon envahissant et des pratiques de yoga particulières, il a aussi des traits théologiques et doctrinaux propres, avec une vision originale de la divinité et du monde. Développement intérieur aux religions indiennes, le tantrisme, tout en y formant des courants ésotériques très caractérisés, les a généralement marquées de son empreinte, si bien qu'il est peu aisé, du moins dans l'hindouisme, de repérer exactement ses contours. Répandu avec ces religions hors de l'Inde — au Tibet, dans la péninsule indochinoise et en Indonésie, en Chine et, de là, au Japon (et cela des premiers siècles de l'ère chrétienne à nos jours) —, il y a pris des aspects divers. Si donc le tantrisme fait problème, il apparaît aussi comme un phénomène religieux multiforme, d'une longue durée historique et d'une importance considérable.1. La question du tantrisme
Le mot tantrisme — du sanskrit tantra, “trame”, d'où “doctrine” et, de là, “traité enseignant cette doctrine” (que celle-ci soit ou non tantrique) — est dû aux orientalistes européens qui, vers la fin du XIXe siècle, découvrirent dans des textes nommés tantras des doctrines et des pratiques différentes de celles du brahmanisme et de l'hindouisme classique issus du Veda et des Upanisad comme du bouddhisme theravada ou du Mahâyâna philosophique qu'ils connaissaient et qu'ils croyaient former le tout de la religion et de la métaphysique de l'Inde. Ce terme désigna donc ce qui leur parut être un ensemble aberrant de pratiques étranges, parfois répugnantes, et de spéculations ésotériques bizarres associées au culte de divinités multiples et souvent effrayantes.
Le progrès des connaissances sur l'Inde, toutefois, fit voir que ce qu'on avait d'abord cru être un phénomène limité et exceptionnel se retrouvait, en fait, à des degrés divers dans toutes les religions indiennes au point d'en devenir, à partir d'un certain moment, un trait général : c'est, en réalité, l'absence de toute trace tantrique qui est l'exception. Mais, du jour où des éléments considérés comme tantriques se rencontraient un peu partout, il devenait difficile de définir le tantrisme en le posant par rapport à ce qui n'était pas lui. Il se trouva même des spécialistes pour dire que le tantrisme n'existait que dans l'esprit des orientalistes — ce qu'on nommait ainsi n'étant guère qu'une des formes prises à partir d'un certain moment par l'hindouisme (ou le Mahâyâna) en général — ou encore qu'il ne constituait que l'aspect rituel et technique de ces religions.
De fait, le terme même de tantrisme est étranger à l'Inde traditionnelle. Il n'existe pas en sanskrit. Il y a, par contre, des textes nommés tantras (mais tous ne sont pas tantriques, alors que nombre de textes tantriques ne se nomment pas tantra). Il y a un tantrasastra, un enseignement tantrique, auquel s'applique en général l'adjectif tântrika. Ce dernier est utilisé par opposition à vaidika, “védique”, ce qui distingue deux formes de la tradition religieuse-rituelle révélée.
L'une, plus “orthodoxe”, repose sur le corpus védique, du Veda aux Upanisad, avec les commentaires accompagnant ces textes, tradition toujours vivante, not. dans le rituel domestique hindou et surtout dans les “sacrements” (samskâra) que doivent recevoir les hindous des trois plus hautes classes (varna). L'autre tradition, la tantrique, se présente comme différente de la révélation védique, sans nécessairement la rejeter mais en la jugeant inapte à mener au salut et en prônant des pratiques et des rites d'une autre sorte, avec les spéculations qui les entourent. Cette tradition se donne comme mieux adaptée que l'autre aux besoins des hommes et, tout en étant initiatique et ésotérique, comme en principe ouverte à tous. Prise au sens le plus large, elle concerne une grande part de l'hindouisme. Les deux traditions subsistent toutefois côte à côte : une même personne, selon les cas, accomplira les rites de l'une ou de l'autre, lesquels se sont d'ailleurs influencés au cours des siècles. Il s'est en effet produit aussi bien une “tantrisation” du milieu brahmanique qu'une “brahmanisation” (ou “védantisation”) du tantrisme. Il s'ensuit une situation ambiguë, rendant difficile de distinguer entre ce qui est tantrique et ce qui ne l'est pas.
La distinction est plus aisée dans le bouddhisme, où les voies et pratiques tantriques diffèrent nettement des doctrines anciennes, même s'il s'agit là, comme pour l'hindouisme, de la réinterprétation dans un esprit nouveau d'une tradition antérieure, dépassée ou relayée, mais non abolie.
Bien que présent aussi dans le bouddhisme (accessoirement dans le jaïnisme), le tantrisme fut probablement d'abord un phénomène hindou. Certes, les plus anciennes traces datables en sont-elles bouddhiques (chinoises, d'ailleurs), mais, dans ses pratiques comme dans son idéologie, il apparaît comme ayant conservé ou développé d'anciens éléments remontant parfois jusqu'au Veda ou provenant de cultes autochtones (ceux not. de divinités féminines). La complexité rituelle, les corrélations micro-macrocosmiques, les spéculations mystico-phonétiques, les manipulations de l'énergie qui le caractérisent sont en effet autant de facteurs hérités du fonds brahmanique.
Si l'on voulait définir le tantrisme, sans doute pourrait-on le caractériser comme un ensemble de rites et de pratiques permettant à un adepte initié d'acquérir des pouvoirs surnaturels et/ou de parvenir à la libération en vie (jivanmukti). Il vise en cela à concilier l'expérience du monde (bhoga) et la libération (moksha), à atteindre le salut par utilisation des moyens du monde. La voie tantrique consiste en des pratiques corporelles-mentales et spirituelles particulières et en de complexes adorations (pûjâ) de divinités afin d'arriver à échapper non seulement à la ronde des renaissances, mais aussi aux limitations de l'existence ordinaire : il s'agit d'être libéré du monde tout en le dominant.
Le libéré-vivant tantrique participe en effet à l'énergie divine, la shakti, qui est animatrice de l'univers et se déploie comme un vaste jeu cosmique. Cette énergie n'est pas séparable d'un dieu masculin dont elle est la force et la parèdre, d'où un symbolisme sexuel omniprésent et quelques pratiques rituelles sexuelles. Le tantrisme forme ainsi un aspect particulier, intense, fortement “magique”, en principe initiatique et ésotérique, de l'hindouisme, où on le trouve soit systématisé en des sectes particulières, soit diffus sous la forme de pratiques rituelles ou yogiques et de spéculations présentes diversement quasiment partout : une part appréciable du panthéon hindou est formée de divinités tantriques (sans d'ailleurs que leurs fidèles se considèrent nécessairement comme tântrikas).
Dans le bouddhisme, c'est à la “conscience d'éveil” (bodhicitta) qu'aspire l'adepte, à la réalisation vécue de la nature du Buddha qui lui est inhérente et qui est celle même de l'univers, les techniques et représentations mises en jeu à cette occasion (et, à certains égards, le panthéon) étant assez similaires à celles de l'hindouisme tantrique. Le tantrisme, par contre, n'y a pas le caractère diffus qu'il a dans l'hindouisme : on y voit mieux ce qui est tantrique et ce qui ne l'est pas. Pour le jaïnisme, les éléments tantriques se bornent à quelques pratiques et divinités, non acceptées par tous : c'est un phénomène très réduit.
Il faut souligner enfin l'extrême étendue de la littérature tantrique en sanskrit (encore peu connue, et largement inédite, d'ailleurs) : agama, samhita, tantra shivaïtes ou vishnouites, tous les sutra, sadhana, etc., bouddhiques, ouvrages de toutes sortes (hymnes ou poèmes, manuels de rituel, de yoga ou de magie, traités d'architecture religieuse, de magie, d'alchimie, etc.). S'y ajoutent des œuvres très nombreuses dans la plupart des littératures de l'Inde, allant du VIe au VIIe siècle, pour le tamoul, ou, pour les autres langues, du “Moyen Âge” à nos jours. Il ne faut pas oublier, en outre, la contribution de l'esprit et des conceptions du tantrisme aux arts plastiques, not. dans la sculpture : on a là une part appréciable de ce que l'Inde hindoue (ou le bouddhisme, pour ce qui est de l'Himalaya et du Tibet — pour ne parler que de ces régions) ont produit de plus intéressant. On ne saurait donc exagérer l'importance du phénomène tantrique — au sens large — dans la civilisation indienne ou dans les civilisations qui ont été tributaires de celle de l'Inde.
2. Histoire, extension, sectes
 La rareté des documents datables dont on dispose, surtout pour la période ancienne, ne permet pas de faire l'histoire du tantrisme. On peut trouver la source première de certains de ses aspects dans la tradition védique accrue d'éléments autochtones archaïques (peut-être dravidiens). Mais ce fonds originel de rites et de spéculations n'a donné lieu que bien plus tard à ce qu'on nomme tantrisme, une fois passées la période des Upanisad et celle où se développa le bouddhisme : à quoi attribuer la reprise de ce fonds quelque mille ans plus tard et surtout son développement “presque jusqu'au délire” (comme on l'a dit) ? Comment est-on passé, par ex., des mantras [formules secrètes] védiques au mandrasastra tantrique ? On ne peut le dire. Voici toutefois ce qu'on peut affirmer dans l'état actuel des connaissances :
La rareté des documents datables dont on dispose, surtout pour la période ancienne, ne permet pas de faire l'histoire du tantrisme. On peut trouver la source première de certains de ses aspects dans la tradition védique accrue d'éléments autochtones archaïques (peut-être dravidiens). Mais ce fonds originel de rites et de spéculations n'a donné lieu que bien plus tard à ce qu'on nomme tantrisme, une fois passées la période des Upanisad et celle où se développa le bouddhisme : à quoi attribuer la reprise de ce fonds quelque mille ans plus tard et surtout son développement “presque jusqu'au délire” (comme on l'a dit) ? Comment est-on passé, par ex., des mantras [formules secrètes] védiques au mandrasastra tantrique ? On ne peut le dire. Voici toutefois ce qu'on peut affirmer dans l'état actuel des connaissances :• 1. Il n'y a jamais eu de tantrisme aux temps védiques et brahmaniques.
• 2. Le tantrisme a dû apparaître par l'effet d'une évolution interne de la religion brahmanique-hindoue, dont toutefois la cause et la nature nous échappent (même si l'on peut y voir, peut-être, l'effet not. de facteurs non aryens).
• 3. Même si les documents tantriques datables les plus anciens sont bouddhiques, le tantrisme est, selon toute probabilité et pour bien des raisons, d'abord un phénomène hindou.
• 4. Enfin, le tantrisme tel que nous le concevons devait être présent en Inde, au moins dès le Ve siècle : l'inscription de Gangdhar atteste l'existence de déités féminines d'allure tantrique en 424, alors que les plus anciens agama shivaïtes peuvent remonter au VIe siècle, les premiers témoignages bouddhiques étant plus anciens encore. Cette période fut celle où s'élabora l'hindouisme puranique et tantrique, la grande efflorescence du tantrisme se situant entre le VIIIe et le XIVe siècle : c'est l'époque d'où paraissent dater les principaux textes, celle des grands auteurs tantriques, les auteurs cachemiriens not., tel Abhinavagupta (env. 950-1025), celle des grands temples de l'Inde centrale — sans oublier les œuvres du Mahâyâna tantrique, qui brilla du VIIe au XIIe siècle. D'un intérêt souvent moindre mais non négligeable, des productions de toute nature et en toutes langues ont continué de paraître depuis lors et jusqu'à des temps récents.
Cette diffusion s'accompagna d'une importante évolution intellectuelle et sociale. Historiquement, en effet, les pratiques et spéculations tantriques ont dû naître dans de petits groupes initiatiques de renonçants, virtuoses visionnaires de l'ascèse et des rites, adorateurs de divinités souvent effrayantes, par lesquelles ils étaient possédés au cours de cultes secrets de caractère souvent transgressif. Ces sectes semblent avoir été d'abord surtout shivaïtes. Tout en subsistant telles quelles, très marginalement, jusqu'à nos jours (Aghoris, Kanpathayogis, Nâthas, etc.), elles évoluèrent assez tôt en donnant naissance à des mouvements plus ouverts, plus respectables, où les pratiques déviantes furent prises surtout symboliquement et s'accompagnèrent de développements philosophiques et théologiques considérables, souvent très subtils.
De cette “brahmanisation” progressive du tantrisme témoignent not. les traditions shivaïtes cachemiriennes mais aussi le tantrisme vishnouite. Alors que les renonçants déviants recherchaient avant tout la domination surnaturelle du monde, les tenants de ces traditions plus “orthodoxes” recherchaient plutôt la délivrance des liens de l'existence (le moksha). L'évolution dans le bouddhisme est un peu différente. Il est vrai qu'elle se fit pour l'essentiel hors de l'Inde. Remarquons enfin que, s'il a peu à peu colonisé presque tout l'hindouisme (et, au Tibet, tout le bouddhisme), le tantrisme ne fut cependant jamais un mouvement de masse. Certes, il a marqué presque toute la religion et une grande partie de l'art, il a produit une immense littérature, mais, en raison de sa nature initiatique et du fait qu'il supposait de ses adeptes l'accomplissement de certaines pratiques, il n'a sûrement jamais été vécu effectivement que par un petit nombre.
Le tântrika accompli est toujours apparu comme un être exceptionnel, semi-divin, un siddha, c'est-à-dire un être ayant atteint le but suprême et doué de pouvoirs surnaturels [siddhi] [1]. Les siddhas ont eu une place importante dans l'hindouisme (sanskrit comme vernaculaire) et dans le bouddhisme tantrique. Leur image est restée un peu celle de certains sadhu [ascète] (le terme vient de la même racine, sadh) de l'Inde actuelle. De nos jours, en effet, le tantrisme garde en Inde (sauf au Bengale, où il est plus ouvertement répandu) une aura de mystère inquiétant, même si l'intérêt qu'il suscite en Occident a pu contribuer un peu à le faire mieux admettre : cela, bien entendu, pour les sectes “officiellement” tantriques. Car, pour la masse des pratiques rituelles ou des éléments de croyances tantriques présents partout dans l'hindouisme, la question ne se pose pas, les croyants et usagers de ces rites ne les ressentant pas comme tantriques. (On retrouve ici l'ambiguïté déjà signalée de la situation du tantrisme.)
Il n'est pas possible de dire dans quelles régions de l'Inde est né le tantrisme. On a parfois tenté d'en expliquer certains traits par des influences extérieures, venues de Chine, du Tibet, ou même du Moyen-Orient ; mais ce sont là de simples hypothèses. Il n'y a pas de raison de voir dans les cultes de possession, par ex., une forme de chamanisme. La possession [âvesha] caractérise d'ailleurs aujourd'hui l'hindouisme “populaire” qu'on ne saurait à proprement parler dire tantrique. Il est certain, par contre, que les zones himalayennes ou proches de l'Himalaya, du Cachemire à l'Assam, ont été des centres majeurs du tantrisme hindou comme bouddhique. L'importance actuelle des cultes tantriques au Népal, le nombre des manuscrits de cette sorte qu'on y trouve encore attestent la vitalité qu'y a conservée cette tendance. Mais le Kerala, au sud, fut aussi un centre du tantrisme, tout comme l'Inde centrale ou l'Orissa (où se trouvent les rares temples de Yoginîs encore existants). Le tantrisme apparaît ainsi comme un phénomène proprement indien qui s'est ensuite répandu en Asie avec l'hindouisme et surtout le bouddhisme.
Comme l'hindouisme en général, le tantrisme se divise, selon les divinités adorées, en des sectes différentes, qui possèdent des enseignements et des rites différents et qui s'excluent mutuellement. Les rares persécutions religieuses qui eurent lieu dans l'hindouisme furent le fait de groupes tantriques. À cet égard, on peut dire que l'esprit du tantrisme s'oppose à celui de la bhakti, la dévotion, qui est à tendance universaliste. Les 2 ne sont toutefois pas inconciliables, d'une part, parce que la dévotion à la divinité et la grâce divine jouent un rôle important dans le tantrisme, d'autre part, parce que des groupes bhakta ont été marqués de tantrisme (cela se retrouve même chez les “saints-poètes” [Sants] du Mahârâshtra, ou même chez Kabir).
Comme l'hindouisme lui-même, les sectes tantriques se divisent en vishnouites et shivaïtes ou shâkta (où l'on adore la Déesse, la Shakti), mais sectes shivaïtes et sectes shâkta sont difficiles à distinguer puisque la shakti est essentielle dans le shivaïsme tantrique et que la Déesse, dans le shaktisme, est toujours associée à une forme de Shiva. Il y eut aussi des Sauras, adorateurs du Soleil (Sûrya), qui ont disparu, et des Gânapatyas, fidèles du dieu Ganapati / Ganesha. Parmi les vishnouites, le groupe principal est celui du Pâñcharatrâ, dont la littérature sacrée est vaste et importante, mais qui aujourd'hui ne se considère pas comme tantrique [car plutôt attentive à une forme particulière de révélation, due à une divinité et différant en cela de la Parole védique, qu'à des conceptions ou pratiques “tantriques” qui se poseraient face à une tradition “orthodoxe” généralement admise]. Au Bengale, les vishnouites Sahajiyâs [qui, du début du XVIe jusqu'au XXe s., ont produit une remarquable littérature mystique vouée au culte et à l'adoration de Krishna et Râdhâ] ont été remarquables par leur érotisme mystique (dont une forme subsiste encore chez les Bâuls [bardes mystiques]).
Les sectes tantriques sont ainsi surtout shivaïtes et shâkta. On peut (en simplifiant beaucoup) les dire issues des groupes shivaïtes anciens des Pāśupata [dévots, vivant en marge, de Pâshupata, Maître des créatures, une des 8 hypostases de Shiva] et des Lâkula [ascètes errant le corps enduit de cendres de bûchers funéraires, portant un bâton (khatvanga) et un bol à aumône fait d'un crâne humain (kâpala)], adorateurs du dieu védique Rudra. De là sont apparus les ascètes baithari Kâpâlikas, porteurs d'un crâne humain, dont les cultes extatiques, visionnaires et transgressifs s'adressaient soit à des aspects de Bhairava, forme terrible de Shiva, soit à des formes non moins terrifiantes de la Déesse. De là sont nées les sectes tantriques les plus caractérisées, productrices de nombreux textes (les tantras de Bhairava, les Yamala — et Shakti-tantra), avec not. la tradition du Kula qui se divisa elle-même en 4 “transmissions” (âmnâya) différentes et s'étendit même au bouddhisme.
Le Kula (ou Uttarâmnâya) donna naissance au Trika, la plus connue des traditions du Cachemire, la plus philosophiquement développée et qui influença not. la Srividya (du Daksina-âmnâya), le culte de Tripurasundari, toujours vivant actuellement. Les autres âmnâya ont donné lieu à diverses autres sortes de cultes de la Déesse, essentiellement de formes de Kâlî, avec, par ex., dans le cas du système Krama, toute une structure cosmique de déesses fonctionnelles, les Kâlî, dont la “roue” anime et résorbe le cosmos. Il est à noter que la tradition shivaïte avait pris aussi la forme du shivaïsme-âgamique, le Saivasiddhanta sanskrit, également tantrique, mais où la shakti joue un moindre rôle. Il est aussi plus ritualiste et, par sa considérable littérature (les 28 Agama), il fournit une sorte de base commune (samanyasastra) shivaïte. Il a eu un rôle important en Inde du Sud où il est encore présent, en particulier dans les temples.
Du côté bouddhique se développèrent de façon analogue plusieurs “Véhicules” (yana), dont on parlera plus loin.
3. Les doctrines
 [Ci-contre : le sage indien Padmasambhava subjuguant un démon local. Il introduisit la forme du bouddhisme tantrique au Tibet au VIIIe siècle. Photo : Thomas Laird, Musée Rubin de l'Art himalayen, New York]
[Ci-contre : le sage indien Padmasambhava subjuguant un démon local. Il introduisit la forme du bouddhisme tantrique au Tibet au VIIIe siècle. Photo : Thomas Laird, Musée Rubin de l'Art himalayen, New York]Formant le noyau secret (ou la superstructure ésotérique) de l'hindouisme et informant une grande part du rituel généralement pratiqué, le tantrisme n'a pas un corps de doctrines qui lui soit entièrement propre. Ses textes sont peu philosophiques, même quand ils comportent une “section de la doctrine” comme c'est (très théoriquement) le cas pour les Agama et les Samhita. Certes, il y a eu d'importants philosophes tantriques, en particulier dans les traditions cachemiriennes, mais ils étaient d'écoles différentes. D'où l'absence d'un ensemble doctrinal original commun. Le fonds des doctrines tantriques hindoues est celui de l'hindouisme : il vient pour l'essentiel des darsana classiques. La cosmogonie repose sur les catégories du Samkhya complétées par en haut en comptant 36 tattva (au lieu de 25) et tient à celle des Purana (eux-mêmes parfois tantrisés). Ses spéculations magico-linguistiques reposent sur la grammaire et la phonétique traditionnelles et empruntent à la Mimamsa. Le yoga tantrique s'est développé sur la base de celui de Patañjali. La métaphysique est de type védantique : dualiste (dans les Agama), dualiste mitigé ou surtout non dualiste (en particulier dans le shivaïsme des Bhairavagama), car cela s'accorde mieux avec la vision tantrique du cosmos et de l'homme. Le Pañcaratra a une conception particulière du déploiement (vyuha) de la création à partir d'hypostases de Vishnou.
Caractéristique du tantrisme est sa conception de la divinité. Celle-ci, au plan suprême, transcende toute dualité, mais elle est, en tant que telle, conçue comme ayant deux aspects inséparables, masculin et féminin (Shiva/Shakti, Vishnou/Sri, etc.), dont l'union, sexuée, marque le point de départ du cosmos comme celui de son retour à l'origine. De ces aspects, c'est le féminin qui est actif, qu'il domine l'autre ou non. La création est l'œuvre de cette énergie féminine : elle en est toute pénétrée et se déploie comme un vaste jeu cosmique. La shakti, qui soutient et anime ainsi l'univers, le résorbe à la fin de chaque cycle. Elle cause, avec la manifestation cosmique, l'esclavage de l'homme en ce monde, mais c'est par elle qu'il se libérera en retournant à sa source. Le tantrisme réinterprète là un schéma cosmique puranique. De plus, le microcosme, qui est lié au macrocosme par un immense jeu de corrélations et de connexions, peut en rejouer le déploiement comme le repliement — par lequel il arrivera au salut dans la fusion (ou “proximité”) avec la divinité.
Il est à noter que, dans cette recherche de la délivrance, si les rites et autres pratiques occupent la place la plus visible, la grâce divine (souvent nommée “descente de l'énergie”, shaktipata, puisque c'est celle-ci qui agit) joue cependant un certain rôle. L'homme répond à la grâce par la dévotion (bhakti) dont il imprégnera ses pratiques. Mais l'ascèse reste avant tout, dans la perspective tantrique, participation au jeu cosmique, la lila. D'où le caractère d'effervescence joyeuse, effrayante parfois, mais toujours ludique qu'a souvent l'ascèse tantrique, qui, à cet égard, porte à leur paroxysme des éléments présents dès le Veda et qui ensuite avaient été occultés. La notion de lila n'est d'ailleurs pas propre au tantrisme. Elle joue un rôle essentiel dans tous les cultes krishnaïtes, dont certains seulement sont tantriques, étant alors de ceux où tantrisme et bhakti se conjuguent.
Le processus cosmique, dans toutes les écoles, est émanationniste. Le monde est l'apparaître (abhasa) du divin, qui reste inaffecté par ce qu'il émet tout en le contenant en lui. Selon les sectes, l'univers sera jugé plus ou moins réel ou irréel, encore que le plus souvent la mâyâ y soit considérée moins comme l'origine de toute erreur, la “grande illusion”, que comme la source de l'infinie diversité cosmique née de la surabondance divine. Cette créativité divine multiforme se manifeste en de vastes cosmogonies, en particulier en celles qui reposent sur le déploiement cosmique de la Parole (vâc), laquelle, dans le tantrisme, est l'énergie par excellence. Celle-ci fait apparaître tous les plans et aspects de l'univers, de la divinité elle-même à la terre, par étapes successives, que ce soit selon l'ordre des lettres de l'alphabet sanskrit ou par l'effet de la puissance et de l'expansion d'un mantra (tels OM, HRIM, SAUH, etc.) en lequel repose la force créatrice de l'absolu. Le tantrisme bouddhique élabora de façon analogue des systèmes cosmiques, où lettres sanskrites aussi bien que mantras jouent un rôle, reposant toutefois sur la métaphysique “idéaliste” du Mahâyâna.
4. Le panthéon
Le panthéon tantrique est difficile à décrire en tant que tel, car il est mêlé à celui de tout l'hindouisme (le cas bouddhique est plus simple). On peut seulement noter quelques traits spécifiques pour tâcher de distinguer ce qui est tantrique de ce qui ne l'est pas, ou de ce qui l'est moins.
Quelle que soit la secte, il émane de la divinité, rassemblant deux pôles, masculin et féminin, toute une hiérarchie de formes et d'entités surnaturelles, de la plus haute à la plus basse, parmi lesquelles toutefois les êtres féminins dominent, puisque le processus cosmique est l'œuvre de la shakti. La déité suprême y est une de celles de l'hindouisme — Vishnou, Shiva, la Déesse —, mais de forme tantrique, associée toujours à une entité correspondante de sexe opposé. Shiva, par ex., pourra être un des aspects de Bhairava, dieu redoutable aux traits transgressifs, dominant surtout dans les tantras. Dans les agama dualistes, ce sera Sadashiva, déité plus paisible. Ou bien l'on aura Kamesvara ou Kulesvara (associés à Kamesvari ou Kulesvari), etc. Surya, le dieu-soleil, est dans le tantrisme une forme de Shiva. Ganesa joue un rôle important dans ce panthéon, où il est associé parfois à Batuka, forme de Bhairava, et toujours accompagné d'une duti, “messagère”. On le trouve parfois multiplié par dizaines. Les 5 “visages” de Shiva, ses 6 “membres” (anga), ses attributs sont des formes divines ; et il en est de même des énergies qui en émanent : les entités surnaturelles surgissent les unes des autres hiérarchiquement.
Très spécialement tantriques sont les formes de la Déesse, celles not. des cultes kâpâlika des Yoginîs, divinités sauvages, assoiffées de sang, porteuses de guirlandes de têtes coupées, parfois thériomorphes, peuplant tout le cosmos d'un réseau omniprésent de puissance (yoginijala), dominant les cycles cosmiques et dont les lieux de puissance (les pitha, où tombèrent les fragments du corps déchiqueté de la Déesse) sont répartis dans toute l'Inde. Ces Yoginîs sont groupées en “familles” (kula), les principales étant celles des 8 “Mères” (matr) : Brahmi, Mahesvari, Kaumari, Vaisnavi, Indrani, Varahi, Camunda, et Mahalaksmi, à qui des cultes secrets sont rendus la nuit sur les lieux de crémation où elles communiquent leur toute-puissance à leurs dévots en les possédant. On ne peut pas passer en revue toutes ces déesses, parmi lesquelles se remarquent not. des formes effrayantes de Kâlî : Guhyakâlî la Secrète, les 12 Kâlîs du système Krama, dominées par la “Destructrice du temps”, Kala-samkarsini, ou les trois déesses du Mata, dont la plus haute se nomme Ghoraghoratara, “la plus Terrible des Terribles”, ou Kubjika, la “Bossue”, unie au beau dieu Navatma, etc. Formes farouches de cultes visionnaires aux rites transgressifs, ces déités ont en même temps fait parfois l'objet de spéculations métaphysiques subtiles, même dans les anciens tantras.
Ainsi, dans ceux du Trika, où les énergies et les dieux sont dominés par la triade des déesses Para, Parapara et Apara, formes de l'absolu siégeant sur les pointes du trident shivaïte issu du “Grand Trépassé” (Mahapreta) qu'est pour cette école Sadashiva, en quoi elle s'affirme supérieure au Saivasiddhanta. Para est alors “Essence des Mères” (Matrsadbhava), le pur absolu transcendant dans lequel l'adepte se fond par la méditation yogique. Mais il y a aussi des déesses plus aimables, telle Tripurasundari, la “Belle des Trois Cités”, dont le culte, fait avec un diagramme (le sriçakra) et un mantra (la srividya) particuliers, subsiste encore, très “védantisé”, en Inde du Sud. De façon analogue, d'autres cultes transgressifs dans leurs débuts seront par la suite “domestiqués” par une interprétation symbolique des rites et des déités. Ainsi le culte kâpâlika de Svacchandabhairava a-t-il quitté les champs de crémation pour devenir le culte domestique, mais ésotérique, des brahmanes du Cachemire. Typiquement tantriques sont les “déesses-parole” (vagdevata), déesses de l'alphabet ou des lettres du sanskrit : Para, Malini, etc.
Quant au panthéon, si nous considérons que toutes les déités peuvent donner lieu à nombre d'épiphanies, que tous leurs aspects peuvent être divinisés, que les instruments et les moments du culte peuvent l'être aussi, que les formules rituelles, les mantras, au nombre, dit-on de 70 millions, sont autant de déités hiérarchisées, que l'univers est empli d'entités surnaturelles que les textes se plaisent à énumérer sans fin, il apparaîtra que le thème est inépuisable. Ce qu'il faut retenir dès lors pour caractériser cet aspect du tantrisme, c'est l'omniprésence et l'infinie multiplication de ces entités hiérarchisées, leur caractère souvent redoutable, le fait qu'elles imprègnent le cosmos tout en étant présentes en l'homme (ce qui est d'ailleurs une notion védique) dont le corps est ainsi divinisé, sa vie prenant une dimension cosmique. Développé au sein de l'hindouisme, le tantrisme l'a colonisé en lui ajoutant ses propres divinités, secrètes, qui, en dépassant les autres et en les englobant, et en envahissant l'univers par leurs puissances, montrent sa supériorité sur la religion exotérique. L'examen du bouddhisme tantrique ferait apparaître une évolution et des phénomènes du même genre, plus faciles toutefois à cerner, puisqu'il se distingue nettement du bouddhisme non tantrique.
5. Rites et pratiques ; la “kundalinî”
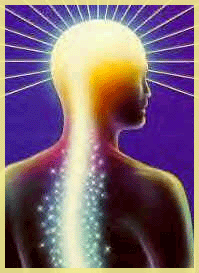 Le tantrisme hindou ou bouddhique a ajouté à ces 2 religions une dimension supplémentaire par l'extrême développement d'un rituel lié à des pratiques corporelles, mentales et de yoga particulières. La pratique tantrique “opérante et efficace” (sadhana, de la racine sanskrite sadh, accomplir, effectuer) implique l'homme entier, corps et esprit, dans l'acte qu'il accomplit ou, plus exactement, dans le monde qu'il crée rituellement. On trouve, certes, un peu de cela dans tout l'hindouisme, qui a une vieille et solide tradition rituelle, mais cela est largement dû à ce que presque tout l'hindouisme a été tantrisé. (Le bouddhisme, par principe hostile au ritualisme, y a cédé à son tour, sous l'influence, peut-on penser, du milieu brahmanique puis hindou qui l'entourait.)
Le tantrisme hindou ou bouddhique a ajouté à ces 2 religions une dimension supplémentaire par l'extrême développement d'un rituel lié à des pratiques corporelles, mentales et de yoga particulières. La pratique tantrique “opérante et efficace” (sadhana, de la racine sanskrite sadh, accomplir, effectuer) implique l'homme entier, corps et esprit, dans l'acte qu'il accomplit ou, plus exactement, dans le monde qu'il crée rituellement. On trouve, certes, un peu de cela dans tout l'hindouisme, qui a une vieille et solide tradition rituelle, mais cela est largement dû à ce que presque tout l'hindouisme a été tantrisé. (Le bouddhisme, par principe hostile au ritualisme, y a cédé à son tour, sous l'influence, peut-on penser, du milieu brahmanique puis hindou qui l'entourait.)La première étape de toute pratique tantrique vécue est l'initiation (dîkshâ), au cours de laquelle l'adepte, soigneusement choisi, reçoit en secret de son maître (guru) un mantra. L'importance de l'initiation et du secret et la nécessité du maître spirituel, qui semblent être des traits généralement hindous, sont en réalité tantriques ou ont été accentués par le tantrisme. Il y a plusieurs sortes et degrés d'initiation visant, selon des rites divers et parfois très complexes, des buts différents. Cette initiation est distincte de l'upanayana, que doit recevoir tout jeune hindou “deux-fois-né”. Elle peut en principe être accordée quels que soient le sexe ou le statut social. Le secret des règles et des pratiques est assuré non seulement par la transmission directe de maître à disciple, mais aussi par l'emploi dans les textes d'un langage codé (sandhabhasa).
Les pratiques les plus typiques sont relatives aux mantras, “instruments de pensée”, formules stéréotypées à usage rituel et mystique ou magique, souvent dépourvues de tout sens apparent, mais censées recéler toute la force des divinités dont elles sont la forme phonique, essentielle. Parole efficace, puisque sa nature est celle de l'énergie divine, le mantra est censé agir par lui-même. Tous les rites tantriques s'accompagnent de leur énoncé, qui peut être émis en mille circonstances. Leur omniprésence est un trait si typiquement tantrique que les termes mantrasastra, “enseignement des mantras”, et tantrasastra, “enseignement tantrique”, sont souvent pris comme synonymes.
Le mantra n'est toutefois efficace que s'il a été d'abord régulièrement reçu par l'adepte puis maîtrisé par lui au terme d'une ascèse particulière (mantrasadhana ou purascarana), généralement longue et complexe. L'importance des mantras dans les rites est telle que ceux-ci peuvent ne consister qu'en leur énoncé. L'image du culte peut même parfois n'être faite que de mantras (mantramâyâ) : rituellement confectionnée avec des formules, sans rien de matériel. L'univers tantrique, hindou comme bouddhique, est celui de la toute-puissance de la parole et de sa constante manipulation rituelle et magique. Les mantras doivent souvent être indéfiniment répétés : jusqu'à des millions de fois. Nommées japa, ces répétitions sont soigneusement codifiées. Associées à des méditations, à des visualisations et à la régulation du souffle, le japa tantrique est souvent proche du yoga.
L'énonciation des mantras s'accompagne parfois de gestes symboliques, les mudrâ (mot qui signifie “sceau”). Gestes des doigts ou des mains, ou bien attitudes ou postures corporelles (imitant ou évoquant en général celles de la déité adorée), les mudrâ peuvent aussi être des “attitudes mystiques”, la posture associée à la méditation visualisante exprimant et causant à la fois l'identification de l'adepte à la divinité. Cette identification se réalise aussi et surtout par une méditation intense créatrice d'images mentales, la bhavana (du sanskrit bhu, devenir, exister, d'où faire être). Par elle, l'adepte fait exister dans son esprit une divinité, un diagramme ou toute autre forme ayant une signification religieuse, dans tous ses détails, avec une précision quasi hallucinatoire et il la perçoit comme présente soit devant lui, soit en lui-même, dans la structure imaginaire de son “corps subtil”. Il s'identifie ainsi au jeu de l'énergie divine ou au cosmos, dont il place en lui les divisions, ou encore à l'image de la déité, qu'il surimpose mentalement à son corps, s'identifiant par là avec elle.
La présence de la divinité ou d'entités surnaturelles ou cosmiques dans le corps de l'adepte est assurée aussi par d'autres pratiques, en particulier par les nyasa, attouchements par lesquels, avec un geste prescrit des doigts, une mudrâ, un mantra recélant l'influx divin est “déposé” et est censé par là même apporter ce qu'il représente, imprégner de sa puissance ou même transformer l'endroit ou l'objet attouché. Comme le japa, le rite de nyasa tend à la multiplication. Quand il précède le culte ou fait partie d'un mantrasadhana, des dizaines de séries d'impositions peuvent se succéder, renforçant ainsi la déification du pratiquant.
Cette déification est un trait essentiel du culte (pûjâ) tantrique des divinités. Celui-ci suppose l'identification préalable de l'officiant à l'être à adorer : « Seul un dieu peut adorer un dieu », dit l'adage. Un ensemble d'actes rituels sera ainsi accompli pour “remplacer” le corps humain de l'officiant par un “corps divin” formé d'éléments purs où la déité pourra résider, l'actant du rite se faisant alors un culte à lui-même (atmapûjâ) — nommé aussi “sacrifice intérieur” (antaryaga) — en tant que divinité. Celle-ci, présente dans le corps ainsi transformé, sera rituellement transférée dans le support matériel du culte (image, diagramme ou autre), généralement avec le souffle de l'officiant. Le culte “extérieur” peut alors se faire.
Le culte intérieur est proprement tantrique. Il est absent de la pûjâ hindoue ordinaire [2]. Réalisé par des visualisations (dhyâna [représentation mentale d'une divinité]) et par des méditations liées au contrôle de la respiration, c'est en réalité une pratique relevant du yoga, lequel, sous des formes appropriées, fait partie intégrante de la pûjâ comme de nombre d'autres rites tantriques. Le yoga, en effet, assure ou renforce la participation somato-psychique de l'officiant au rite qu'il accomplit ; or une telle participation est essentielle dans la vision tantrique du culte. Pour aider encore à cette participation, ou pour la symboliser davantage, l'officiant doit très généralement porter des vêtements et des ornements semblables à ceux de la déité adorée ou adopter l'allure de celle-ci. Par là s'expliquent, dans le cas de divinités féminines, le transvestisme, ainsi que le comportement étrange caractéristique de certains vrata (“vœux” [observances]) tantriques, qui vont parfois jusqu'à mettre leurs adeptes tout à fait en marge de la société.
Le culte tantrique suit d'une façon générale l'ordre du culte hindou ordinaire — lequel, de nos jours, n'est toutefois jamais entièrement exempt d'éléments tantriques, sauf à en avoir été délibérément purgé. Il fait usage en partie des mêmes objets. Il faut noter à cet égard, pour le shivaïsme, que le linga, symbole (originellement phallique) de Shiva, n'a rien de tantrique. Ce qui l'est, c'est de le comprendre comme uni par son socle au yoni [vulve] de la Déesse. Les sacrifices d'animaux, d'autre part, sont une vieille tradition indienne, remontant au Veda, mais ils subsistent aujourd'hui surtout — pas exclusivement — en contexte tantrique. Si les divinités les plus “orthodoxes” sont “végétariennes”, celles qui ne le sont pas ne sont pas forcément tantriques. Il y a, dans le tantrisme comme dans tout l'hindouisme, des pratiques de hautes et de basses castes. Le tantrisme n'est pas de l'hindouisme “populaire”. Il est, au contraire, lié à la tradition savante, même s'il en apparaît comme une forme plutôt déviante.
L'usage de diagrammes (mandala, yantra, çakra), s'il remonte lui aussi par certains côtés au védisme, est un trait caractéristique des cultes tantriques, hindous et bouddhiques. De plan carré et quadrillé, ou faits d'enceintes circulaires ou triangulaires dans un carré (ou inversement), ces diagrammes sont tracés rituellement. Ils sont faits de matières périssables ou durables et peuvent être de toutes tailles : c'est un petit objet ou une enceinte dans laquelle entre l'officiant, mais il délimite toujours une aire sacrée, centrée, orientée, où la déité est appelée à résider pour la durée du rite, qu'elle y soit présente en image (symbolisée par un objet, vase ou autre) ou mentalement visualisée. Ce n'est ordinairement qu'une surface organisée où se déroule un rite, mais ce peut aussi (plus rarement) être un symbole de la divinité dans son activité cosmique. Construit avec l'aide de mantras, il contient un panthéon que l'officiant adorera en allant de l'extérieur vers le centre, accomplissant ainsi un parcours qui va du monde ordinaire à la divinité suprême. De tels mandalas ou autres diagrammes peuvent être intériorisés par la méditation et servir, moyennant une pratique de yoga particulière, à s'unir au jeu cosmique de la déité.
Typique du culte tantrique est enfin l'emploi, en guise d'offrande, des pañcatattva, “les cinq éléments”, ou pañchamakâra, “les cinq lettres ma” : viande [mâmsa], poisson [matsya], alcool [madya], graines [mudrâ] et union sexuelle [maithuna] (dont les noms sanskrits commencent par ma). Les 4 premiers, offerts à la déité, sont ensuite consommés par l'officiant. Le cinquième peut consister en une union sexuelle rituelle avec une jeune femme préalablement initiée et “transformée” par des nyasa et autres rites. L'offrande est alors celle des sécrétions nées de cette union — si elle est effectivement réalisée. Ce rite sexuel peut être collectif, formant alors une chakrapûjâ, “culte en cercle”, fait avec des “yoginîs” [partenaires féminines des yogin, adeptes initiés] : de ce rite très secret et sans doute rare, on a dit qu'il avait dégénéré en orgies.
En fait, ces pratiques sexuelles, très ritualisées et compliquées, ne sont pas plus de simples ébats amoureux que des techniques érotiques raffinées. Comme le dit le Hevajratantra bouddhique, on ne les pratique pas pour y trouver du plaisir. Elles ont toujours été réservées à quelques initiés. Il s'agit de l'utilisation à des fins de puissance et de libération d'une pulsion particulièrement forte et profonde et qui, en outre, reproduit au niveau humain l'acte du désir divin qui a donné naissance au monde. D'autres mouvements intenses de l'être — peur, colère, haine, etc. — peuvent aussi être mis en jeu par des techniques tantriques visant à faire atteindre l'absolu par la dissolution du moi social résultant d'un choc émotif (techniques qu'on trouve aussi dans le bouddhisme tantrique).
L'esprit du tantrisme est, en effet, celui de l'utilisation des éléments du monde, not. du kama, le désir, pour échapper aux limitations du monde. Il vise aussi, dans certains cas du moins, en violant au maximum les règles du comportement “normal”, not. celles qui sont relatives à la pureté rituelle et au respect de l'ordre des castes, à plonger dans le chaos de l'impureté et du désordre, libérant ainsi des forces obscures, dangereuses, mais suprêmement efficaces, que bride habituellement la vie sociale. Ainsi le tântrika atteint-il à la toute-puissance et à la libération. Il ne faut toutefois pas voir là le tout du tantrisme, où l'élément de participation à la joie ou à la fécondité cosmique est sans doute plus important que l'élément transgressif.
On est, dans ces cas extrêmes, à la limite du magique et du religieux, deux éléments — si on peut les distinguer — que le tantrisme associe toujours plus ou moins. Il faut citer à cet égard les “six actions [magiques]” (satkarmani) : enchanter, pacifier, immobiliser, tuer, etc., décrites dans la plupart des textes tantriques, le plus souvent à propos de rites religieux. Ces derniers, de fait, à côté des rites obligatoires (dits nitya), comportent des rites optionnels (kamya), accomplis en vue d'une fin intéressée, mondaine ou non, dont des rites agressifs, destructeurs, qu'on accomplira pour soi ou pour les autres. Certes, ces rites “cruels” (krura) sont parfois condamnés, mais ils existent normalement. C'est qu'il ne s'agit jamais, dans la vision énergétique du cosmos qui est celle du tantrisme, que de mettre en jeu une énergie divine qui n'a par elle-même pas de connotation morale. Des procédés tantriques sont également utilisés dans l'alchimie et ils forment une branche de la médecine traditionnelle indienne.
L'énergie cosmique omniprésente qui anime aussi l'être humain prend chez ce dernier (tout en restant cosmique) la forme de la kundalinî. Celle-ci, imaginée comme un serpent femelle lové à la base de la colonne vertébrale, peut soit s'élever d'elle-même, soit, surtout, être éveillée par des techniques yogiques corporelles et mentales appropriées. Elle monte alors en traversant des centres du “corps subtil” [âme du corps], nommés “roues” (çakra) ou “lotus” (padma). Elle les “perce” successivement et, atteignant le sommet de la tête (ou allant encore au-delà), elle s'unit au principe divin masculin. Ainsi est réalisée l'union des deux pôles de la divinité et donc, pour le yogin, est obtenue la fusion en l'absolu. Celui en qui cela se produit s'éveille à des plans de conscience de plus en plus élevés correspondant aux çakra et mis en corrélation avec des niveaux du cosmos comme avec des divinités.
Il vit donc un processus de “cosmisation” et de divinisation mentale ainsi que corporelle. Cette pratique suppose toujours l'énoncé de mantras, formes phonétiques de l'énergie divine. L'énergie kundalinî est aussi celle de la Parole (vâc). Son éveil correspond donc à l'apparition des plans cosmiques de la parole comme à la naissance en l'homme du langage. Il s'accompagne de phénomènes psychophysiologiques divers. Apparaissent aussi des pouvoirs surnaturels, puisque ceux-ci sont liés aux niveaux de conscience. La montée de la kundalinî peut être provoquée par le yoga sexuel, la fusion en l'absolu coïncidant avec l'orgasme : on trouve cela not. dans le “Grand Sacrifice” (mahayaga) du Kula.
L'image du serpent ascendant de la kundalinî, qui se rattache à un fonds archaïque, est essentielle au yoga tantrique. Elle intervient dans nombre de pratiques et dans le culte. Il n'y a pas d'ascèse yogique tantrique faite avec un mantra sans la montée de la kundalinî. Celle-ci donne lieu parfois à une extraordinaire création d'images mentales, corporellement ressenties dans la mesure où elles sont liées à la structure du “corps subtil”, avec ses (72 000 !) canaux et tous ses centres, représentation fantasmatique dont l'adepte vit le déroulement en lui et hors de lui avec le mouvement et l'immobilisation des souffles vitaux (prâna). Que cette pratique implique ou non l'union sexuelle, on rencontre là certaines des formes les plus curieuses et les plus intenses du yoga tantrique.
6. Le tantrisme bouddhique
[Ci-dessus : Ascète tantrique — Rare photo d'un yogi tibétain pratiquant le Chöd, rituel d'offrande réalisé dans les cimetières. Il tient dans sa main droite un double tambour à fouet, censé représenté le claquement de la foudre et dans sa main gauche, une trompe taillée dans un fémur humain, dont le son a la vertu de subjuguer les démons]
 Les pratiques et spéculations qu'on vient de voir sont aussi étrangères que possible à l'esprit du bouddhisme ancien, qui condamnait l'idolâtrie et la croyance à l'efficacité des rites. Elles se retrouvent pourtant, sous des formes très voisines, dans le Mahâyâna. Peut-être né — développé en tout cas — comme le tantrisme hindou dans la zone himalayenne, le bouddhisme tantrique a dû s'établir en Inde vers le IIIe ou IVe siècle. Il y dura jusqu'au XIIe siècle, où il disparut sous les coups de l'islam. Au cours de cette période, il se répandit en haute Asie, en Chine puis au Japon et en Asie du Sud-Est, régions où il est parfois encore actif (ainsi, dans la secte Shingon au Japon). Secondaire, peut-on penser, par rapport au tantrisme hindou (bien que des interactions [hindhouisme-bouddhisme] aient dû se produire [une partie du canon bouddhique tibétain, le Kanjur, est faite de textes shivaïtes, venant sans soute du Cachemire, traduits du sanskrit en partie par des brahmanes entre le VIIe et le VIIIe s.]), il est attesté avant lui, des éléments tantriques (ou “proto-tantriques”) se rencontrant dès le IVe siècle en Chine. Nous savons par les pèlerins chinois qu'il était largement présent en Inde au début du VIIIe siècle, en particulier dans la célèbre université bouddhique de Nalanda. La période du VIIe au XIIe siècle paraît avoir été celle de sa plus grande floraison.
Les pratiques et spéculations qu'on vient de voir sont aussi étrangères que possible à l'esprit du bouddhisme ancien, qui condamnait l'idolâtrie et la croyance à l'efficacité des rites. Elles se retrouvent pourtant, sous des formes très voisines, dans le Mahâyâna. Peut-être né — développé en tout cas — comme le tantrisme hindou dans la zone himalayenne, le bouddhisme tantrique a dû s'établir en Inde vers le IIIe ou IVe siècle. Il y dura jusqu'au XIIe siècle, où il disparut sous les coups de l'islam. Au cours de cette période, il se répandit en haute Asie, en Chine puis au Japon et en Asie du Sud-Est, régions où il est parfois encore actif (ainsi, dans la secte Shingon au Japon). Secondaire, peut-on penser, par rapport au tantrisme hindou (bien que des interactions [hindhouisme-bouddhisme] aient dû se produire [une partie du canon bouddhique tibétain, le Kanjur, est faite de textes shivaïtes, venant sans soute du Cachemire, traduits du sanskrit en partie par des brahmanes entre le VIIe et le VIIIe s.]), il est attesté avant lui, des éléments tantriques (ou “proto-tantriques”) se rencontrant dès le IVe siècle en Chine. Nous savons par les pèlerins chinois qu'il était largement présent en Inde au début du VIIIe siècle, en particulier dans la célèbre université bouddhique de Nalanda. La période du VIIe au XIIe siècle paraît avoir été celle de sa plus grande floraison.On ne saurait dire comment il est né. Sans doute apparut-il d'abord dans de petits groupes marginaux (en contact peut-être avec des renonçants hindous), pour venir au grand jour plus tard, sans doute vers le VIIe siècle, lorsque la pensée philosophique du Mahâyâna (dont les maîtres ne lui étaient guère favorables) eut perdu de sa force créatrice. Le tantrisme bouddhique reste toutefois lié à cette philosophie, car il a conservé l'enseignement fondamental des écoles madhyamika et yogacara sur la sunyata, la vacuité, qui est la réalité ultime, et sur le fait que tout ce qui constitue le monde n'a en définitive d'autre nature que celle du nirvâna, l'absolu au-delà de l'existant et du non-existant. Cette métaphysique, apparemment négatrice de toute chose, loin de gêner le foisonnement des divinités, des rites, des pratiques magiques, alchimiques ou autres, l'a au contraire favorisé. En effet, si samsâra et nirvâna ne sont en réalité que des états de la conscience, troublée ou pure, il devient normal d'utiliser les moyens du monde — le samsâra — pour atteindre le nirvâna, qui y est déjà présent, invisible seulement pour l'ignorant.
Le bouddhisme avait, d'autre part, repris les anciennes spéculations indiennes sur les corrélations micro-macrocosmiques : inséparable de l'univers, l'homme en retrouve en lui les niveaux, qu'il peut revivre par une ascèse adaptée, laquelle, du plan humain, l'amènera à un absolu qui est en lui. Le Buddha, en son essence — conçue comme cet absolu —, est présent en l'homme. Il n'est que de l'y appréhender et, là encore, l'utilisation des moyens du monde et not. des pulsions humaines se trouvera justifiée. Le corps ne sera pas rejeté, mais transformé, cosmisé. On y vivra directement l'équivalence samhâra [résorption cosmique] / nirvâna en arrivant finalement, par des pratiques à la fois spirituelles, corporelles-mentales et rituelles (cette coalescence des procédés étant caractéristiquement tantrique) à l'Éveil parfait, au-delà de toute dualité. Un tel état, où tous les opposés sont dépassés, où est réalisée la tathata (l'“ainsité” : le fait que tout est “ainsi”, c'est-à-dire au-delà de toute définition conceptuelle), a reçu not. le nom de yuganaddha.
Le tantrisme bouddhique s'est constitué un panthéon où, d'un premier principe absolu (mais insubstantiel), le Vajrasattva, l'Être adamantin, nommé aussi Buddha primordial, Adibuddha, émanent 5 Buddhas (les Jina) régnant chacun sur un secteur du cosmos, ayant sa parèdre, son mantra, sa mudrâ, associés chacun à un Buddha “humain” et à un Bodhisattva, ayant enfin une “famille” (kula) de déités souvent féminines et redoutables : on a là un panthéon hiérarchisé analogue à celui de l'hindouisme tantrique, avec lequel il partage d'ailleurs certaines déités.
Dans les rites sont utilisées les mêmes pratiques, ou presque, que dans l'hindouisme. Les mantras, surtout monosyllabiques, parfois nommés dharani (“porteuse”), y sont efficaces et y sont utilisés de la même manière, not. dans des répétitions liées à des visualisations et à des pratiques de yoga. Les mudrâ, nombreuses, y ont le même rôle symbolique (le mot mudrâ y désigne toutefois aussi la partenaire des rites sexuels, parfois nommée mahamudrâ en tant qu'identique à la Prajña, la Sapience, aspect féminin du suprême.) Les visualisations y ont une valeur particulière puisqu'on est dans un système de pensée où tout est création de l'esprit : l'officiant crée les dieux qu'il adore, ou les résorbe en lui.
Les mandala ont un rôle considérable. Paradigmes de l'évolution cosmique, ils représentent en effet l'identité essentielle du samsâra et du nirvâna : « Le mandala, dit un tantra, est l'essence même de la Réalité. » Leur construction forme parfois un rituel de longue durée. Le yoga du bouddhisme tantrique, enfin, ne diffère que peu de celui de l'hindouisme. Il n'a que 4 çakra, mis en correspondance avec 4 “corps” (kaya) du Buddha, la structure du corps subtil rejoignant ainsi celle de l'univers spirituel, cependant que les “souffles” (prâna), dont le mouvement éveille la “conscience d'éveil” (bodhicitta), sont en correspondance avec le mouvement de l'énergie cosmique. Le même schéma anthropocosmique est mis en œuvre par les pratiques de yoga sexuel, où la félicité née de l'union avec la partenaire fait parvenir à la “grande félicité” (mahasukha), qui est aussi bien physique que mystique.
Les similitudes entre pratiques bouddhiques et hindoues s'expliquent à la fois par le développement des 2 tantrismes dans le même fonds commun indien et, dans certains cas, par une importante influence shivaïte. Les Yoganuttaratantra bouddhiques, en effet, sont directement inspirés de textes shivaïtes kâpâlika, avec des cultes de Yoginîs et des pratiques tout à fait identiques. Il est à noter toutefois que, dans le bouddhisme, l'élément féminin, la prajña, la sapience — par opposition au moyen, upaya, masculin — tout en étant efficace, n'a pas le même dynamisme spontané que la shakti hindoue : c'est l'upaya qui l'éveille.
On distingue dans le tantrisme bouddhique divers “véhicules” (yana), ou doctrines (naya). Il y aurait ainsi fondamentalement un “Véhicule des Mantras” (Mantrayana — ou Mantranaya), pouvant remonter au IVe siècle, où se serait élaboré l'essentiel des pratiques et spéculations et d'où serait issu le Vajrayana (“Véhicule de Diamant”), le vajra, foudre ou diamant, symbolisant la Réalité suprême, personnalisée en Vajrasattva, l'Être adamantin. S'y ajoutent le Sahajayana (“Véhicule de l'Inné”) et le Kalaçakrayana (“Véhicule de la Roue du temps”). Tout le bouddhisme tibétain, comme celui du Bhoutan et du Népal, est tantrique.
Le Sahajayana est intéressant à plusieurs titres. Ses textes sont en langues populaires — aprabhramsa et vieux bengali — et non en sanskrit : ce n'est pas une tradition savante. Ses adeptes étaient soit des renonçants au comportement étrange, errant avec leur parèdre, soit des hommes restés dans le monde, mais sorciers. Il incarnait donc une sacralité transgressive et marginale, des pratiques et une idéologie analogues existant d'ailleurs en milieu hindou chez les Vaisnava-sahajiya. C'était une voie ésotérique extrême, prônant l'appréhension directe de la Réalité innée (sahaja) présente en sa spontanéité en chacun dans la “conscience d'éveil” (bodhicitta), la “grande félicité” (mahasukha) de l'Éveil étant identique à celle de l'union sexuelle.
Le Kalaçakra apparut vers le Xe siècle, not. au Cachemire. Il développe et absolutise la notion de l'Adibuddha, au point de la rendre proche de celle du brahman. Il le décrit comme « Un sans second » et comme « source de la roue du temps », c'est-à-dire de tout le devenir. Il forme ainsi presque une religion à part du bouddhisme. Il a, en particulier, une pratique de yoga par laquelle l'adepte met son souffle en correspondance avec les rythmes cosmiques — ceux du temps : kala — et par là se les assimile pour finalement les dépasser et s'unir à l'absolu, « instant unique, incomparable et indivis » : une pratique tout à fait semblable existe dans le shivaïsme. Un rituel curieux de cette école est celui de l'« entrée en frénésie », ou « possession par une [divinité] redoutable » (krodhâvesa) ; l'adepte s'y laisse posséder par toutes les forces obscures et violentes dormant en lui pour en triompher et les apaiser et, ainsi purifié, devenir apte à recevoir l'initiation. Le Kalaçakra se prolongea au Cachemire, avec d'autres écoles bouddhiques, jusque vers le XIVe siècle. Il fut introduit, de là, au Tibet, aux Xe-XIe siècles.
► André Padoux, Dictionnaire du bouddhisme, Albin Michel/Encyclopædia Universalis, 1999, p. 535 sq.
1 : « Dans le domaine de l'acquisition et de la manipulation de la puissance, (…) il nous faut revenir sur les siddhi, les pouvoirs surnaturels [usés lors d'opérations rituelles]. Ils sont importants car ils ne sont pas le privilège des seuls magiciens ou de quelques êtres d'exception. Tout siddha possède des siddhi. Mais quasiment tous les textes tantriques prescrivant le culte de déités affirment que suivre leur enseignement donne des pouvoirs et la libération (bhuktimuktipradâ). La libération en cette vie (jîvanmukti) tantrique est à la fois dépassement du monde et pouvoir sur le monde. En fait, tout maître spirituel, qu'il soit ou non libéré, est considéré comme ayant des pouvoirs : cela reste vrai aujourd'hui (et pas seulement dans le domaine tantrique). Ces pouvoirs, le libéré vivant peut les rejeter comme liés à un monde qu'il a dépassé, mais il les possède : l'omniscience est libération ; elle est aussi, au moins en principe, omnipotence. C'est vrai dans tout l'hindouisme — et même au-delà », A. Padoux, Comprendre le tantrisme : les sources hindoues, Albin Michel, 2010, p. 211-212.
2 : « Parmi les pratiques, l'adoration rituelle des divinités, la pûjâ, est d'origine tantrique. On peut dire qu'elle est toujours tantrique dans sa structure, mais pas toujours dans son esprit, car une pûjâ peut ne pas s'adresser à une déité tantrique. L'omniprésence des mantras avec les spéculations qui l'accompagnent — le mantrashâstra —, comme le fait que la forme la plus haute des divinités soit celle d'un mantra, ainsi que l'importance de tout ce qui a trait à la parole, vâc, sont tantriques (même si les origines en sont védiques) » (ibid., p. 41).

 Tantrisme hindou et tantrisme bouddhique
Tantrisme hindou et tantrisme bouddhique[Ci-contre : tangka représentant, assis sur un trône de lotus, le couple divin du bouddhisme tantrique, le Bouddha primordial Samantabhadra en union avec sa parèdre Samantabhadri. Leur union montre la nature indissoluble des deux aspects, union qui constitue l'essence même de l'esprit telle qu'elle doit être réalisée - c'est-à-dire reconnue et expérimentée - pour obtenir l'Éveil]
Le tantrisme — terme forgé par les indianistes occidentaux et qui n’a pas d’équivalent exact en sanskrit — est une doctrine et une pratique exposées dans des traités ésotériques appelés tantras (littéralement “chaîne d’un tissu” et aussi “extension”, sous-entendu “de la Connaissance”). Cependant tous les livres intitulés tantras ne contiennent pas des enseignements tantriques et ces derniers se rencontrent dans des ouvrages autrement dénommés : âgamas, nigamas, yâmalas, samhitâs, upanishads, purânas, etc. Ce courant spirituel qui apparaît sous la forme écrite dans les premiers siècles de l’ère chrétienne ne constitue pas une religion à part mais sillonne et “colore” l’hindouisme, le bouddhisme et, dans une moindre mesure, le jinisme, c’est-à-dire les trois “religions” originaires de l’Inde. Arguant de l’antériorité probable de certains tantras bouddhistes (traductions chinoises de textes sanskrits), plusieurs érudits ont soutenu que le tantrisme était issu du bouddhisme. Cela ne paraît pas vraisemblable. Le bouddhisme est une voie de renoncement, une tradition essentiellement monastique. Or une des caractéristiques du tantrisme est qu’il ne rejette pas le monde mais l’accepte pleinement et le divinise tout en s’y “réalisant”. Cette attitude positive et d’une certaine manière “optimiste” s’affirmait déjà dans le Veda, bien avant que l’on parlât de “renoncement”, de “transmigration” et de “Délivrance”. Encore qu’en ce domaine on ne puisse avoir de certitude, nombre d’indices inclinent à penser que le tantrisme (sous sa forme orale) est antérieur aussi bien au bouddhisme qu’au jinisme et lié dès l’origine au Sanâtana Dharma. Il est en quelque sorte la face secrète et tardivement dévoilée du Veda, auquel il ne s’oppose que pour un regard superficiel. Le fait qu’il ait parfois critiqué, voire raillé l’enseignement brahmanique, n’infirme pas ce que nous avançons. Ce besoin “polémique” est inhérent à tout mouvement spirituel se révélant au grand jour et il s’explique par des raisons pédagogiques et initiatiques, en l’occurrence un ton âpre et “vert” propre à la “voie des héros”. Mais, de fait, le Tantra n’abolit pas le Veda, il le complète. Le Veda est révélation, tout l’enseignement découle du haut ; le Tantra est expérience, tout remonte vers le haut ; il permet de “vérifier” le Veda et donc il l’actualise, l’accomplit, — d’où le nom qu’on lui donne volontiers de “cinquième Veda” [1].
Une autre raison qui plaide pour la très haute antiquité du tantrisme et pour son origine hindoue est qu’il a toujours été intimement mêlé au shivaïsme d’une part et à l’adoration de la Mère divine d’autre part. Or Shiva — qu’on le veuille âryen ou dravidien — est un dieu extrêmement ancien en Inde, tout comme le culte des déesses-mères. La “greffe” tantrique sur le bouddhisme a donc dû s’opérer plus tardivement, sans doute par influence shivaïte et par réaction contre le caractère moralisant, “sec” et très “masculin” des premières écoles, — à moins de supposer (quelques tantras le suggèrent) que le Buddha lui-même n’ait déjà donné, sous le secret, un enseignement tantrique à certains de ses disciples choisis. L’équation samsâra = nirvâna est parfaitement acceptable aussi bien pour un tântrika bouddhiste que pour un tântrika hindou (Shakti = Shiva, bhoga = moksha), mais elle appartient à la métaphysique Mâdhyamika, donc à une école déjà éloignée de l’enseignement primitif de plusieurs siècles, même si d’aucuns veulent y voir un retour à celui-ci [2]. Le bouddhisme antique — au demeurant misogyne — n’est en rien tantrique alors que des éléments tantriques ou prétantriques abondent dans le plus ancien Veda et les premières upanishads : sacralisation et cosmicisation du corps, connaissance d’une physiologie occulte, accès de femmes à l’enseignement ésotérique, intégration de la sexualité dans la vie spirituelle et rituelle [3], exaltation de la Puissance et de la Plénitude.
Nous ne nous attarderons pas davantage sur cet aspect historique de l’origine du tantrisme. La chose la plus importante peut-être est que cette tradition se soit manifestée — aussi bien dans l’hindouisme que dans le bouddhisme — à un “moment” qui ne doit rien au hasard et qui correspond à certaines lois cycliques : le tantrisme — discipline élitiste certes mais en un sens uniquement spirituel puisqu’elle ne tient compte ni des races, ni des castes, ni de toutes les distinctions extérieures — est la voie de réalisation appropriée au kali-yuga, précisons même à la dernière phase du kali-yuga. Le fait, aisément observable, que les forces conjuguées de la “contre-initiation” et de la “pseudo-initiation” s’attaquent de nos jours à lui avec une particulière sournoiserie — moins en le combattant de front qu’en l’infiltrant, le dénaturant et le détournant — n’est pas contradictoire avec cette fonction salvatrice et ultime que nous venons de rappeler, bien au contraire : la lumière attire l’ombre et l’ombre prouve la lumière. Si le tantrisme est “dangereux”, comme on le répète à tous les vents, ce n’est pas parce qu’il utilise des méthodes amorales ou licencieuses (à notre époque “libérée” qui pourrait s’en choquer ?) mais, bien au contraire, parce que, enseigné dans son intégralité et sans mystification, il risquerait de rétablir une vision authentiquement sacrée et divine de la vie, ce que certaines forces aujourd’hui dominantes ne veulent à aucun prix. Aussi ont-elles tout intérêt, comme elles ne peuvent détruire le tantrisme, à le présenter sous une figure aussi minimaliste, caricaturale et vulgaire que possible, rendant très difficile le chemin à ceux et à celles [4] qui seraient sincèrement attirés par ce sâdhana et qualifiés pour lui.
Nous reviendrons sur cet “avenir” incertain bien que non complètement désespéré. On peut adhérer au tantrisme à travers l’hindouisme ou à travers le bouddhisme (en laissant ici de côté la forme jaïna, trop spécifique et peu significative). Mais on doit d’abord se poser la question : qu’est-ce qui rapproche et qu’est-ce qui différencie le tantrisme bouddhique (éteint sous ses formes indienne, chinoise et japonaise [5] mais survivant au Tibet et dans d’autres petits pays himâlayens) des trois principales branches du tantrisme hindouiste (shivaïte, shâkta et vishnouïte), pour elles encore assez vigoureuses, quoique ayant perdu de leur sève au fil des temps ? Beaucoup ou peu de chose, selon que l’on voudra élargir ou resserrer son regard. Toutes ces écoles ont ou ont eu en commun d’une part une certaine vision absolutiste et “non dualiste” du monde (plus ou moins radicale ou mitigée bien sûr), un “sens de l’unité avec tout” (advaita-bhâvanâ), et d’autre part, tant sur le plan spéculatif qu’opératif, une attention privilégiée à l’aspect “Énergie” du Divin. Mais le non-dualisme ne s’est pas conçu et formulé de manière identique dans les écoles shivaïtes du Cachemire, par exemple, et dans les écoles du Vajrayâna indotibétain. D’ailleurs, même au sein de l’hindouisme, le non-dualisme tantrisant d’Abhinavagupta (fin du Xe - début du XIe s.) ne saurait être confondu avec celui, purement védântique et plus souvent étudié, de Gaudapâda (VIe ou VIIe s. ?) et de Shankarâchârya (VIIIe s. ?). Et cela mérite quelque développement car si l’on ne comprend pas les soubassements métaphysiques du tantrisme, celui-ci se réduit vite à une simple technique de transe et de pouvoir [6] : c’est alors la Shakti, non plus rayonnante et bienfaisante, mais (illusoirement) détachée de son “Mâle”, Force déchaînée et aveugle qui brûle sans transformer.
Nous avons dit que le tantrisme, dans son ensemble, se ralliait à une vision non dualiste de la Réalité. Mais la grande difficulté de tout monisme — et surtout de tout monisme spiritualiste — est d’expliquer le monde, la présence ou du moins l’apparence encombrante de ce monde (“CECI”, comme disent les Hindous) relatif, changeant, différencié. Si seul le Brahman (“CELA”) est — unique, “sans second”, infini, indéterminé, impersonnel, sans rien d’autre qui lui soit intérieur ou extérieur, opposé ou complémentaire —, alors la logique ne laisse guère que deux solutions : soit dire que le monde n’est pas, soit dire que le monde est Brahman. Le Vedânta shankarien (advaitavedânta ou kevalâdvaita) incline vers la première théorie : à ses yeux le monde de la dualité (prapañca) n’est que fantasme, illusion (mâyâ), une surimposition (adhyâsa) sur la Réalité, causée par l’ignorance (avidyâ). C’est l’exemple bien connu de la corde que l’on prend au crépuscule pour un serpent (rajju-sarpa). Nous croyons voir un serpent mais ce n’est en vérité qu’une corde : le prétendu serpent n’est qu’une surimposition de l’ignorance. De même, ce que nous percevons comme le monde objectif, phénoménal est en réalité Brahman et rien que Brahman. Le serpent — le monde — n’a pas d’existence propre, séparée, indépendante ; il n’a qu’une apparence d’existence, tel le mirage dans le désert. Même quand elle apparaît comme un serpent, à aucun moment la corde n’est véritablement un serpent : elle demeure toujours identique à elle-même. Lorsque la connaissance se fait jour (“ce n’était qu’une corde !”), la nature de la corde n’en est pas davantage modifiée : seule son apparence illusoire — le serpent — est annulée. La corde n’est donc jamais affectée ni par l’apparition ni par la disparition du serpent. Analogiquement, jamais le Brahman, l’ultime Réalité indivisible, n’est affecté par l’apparition ou la disparition du monde relatif. Il est absolument transcendant, sans relation aucune avec l’illusion, ou bien il s’agit d’une relation unilatérale, sans réciprocité : l’apparent dépend du Réel, le Réel ne dépend pas de l’apparent. Ainsi l’unité et l’unicité du Principe suprême se trouvent-elles préservées.
Pour brillante et prestigieuse qu’elle soit, cette théorie laisse un doute sur l’origine de la surimposition. Dans l’analogie de la corde-et-du-serpent, la corde est un substrat neutre, passif et le serpent est surimposé sur lui, comme automatiquement, de l’extérieur. Ce n’est pas la corde (réelle) qui produit le serpent (irréel) : celui-ci ne peut donc être créé que par quelque chose ou quelqu’un d’autre. Mais alors cela implique qu’il existerait une réalité différente de la corde, une seconde réalité, donc une dualité. Autrement dit, si Brahman, à l’instar de la corde, est conçu comme inactif (nishkriya), passif et neutre, et si l’illusion de l’univers est surimposée sur lui (il permet cette illusion, il ne la crée pas), cela conduit à penser qu’il existe une force ou une entité distincte de Brahman, laquelle serait responsable de la surimposition de cet univers. Or la Réalité, maintiennent avec la dernière force les vedântins, est rigoureusement non duelle ! Il y a là — sur le plan de la logique — une sorte de faille ou du moins de mystère que n’éclaircit pas tout à fait la pensée shankarienne, soucieuse de sauvegarder l’absolue neutralité et l’impeccable pureté de l’Un-sans-second, rapportant pour cela toute activité, tout changement, tout devenir à mâyâ (dont nul ne sait au demeurant si elle existe ou n’existe pas), à l’ignorance, son produit, et à l’individu, son sous-produit (sous-produit illusoire d’une illusion !). Mais en vérité faut-il s’étonner de cette “faille”, de ce recours à une mâyâ passe-partout, inexplicable et qui n’explique rien ? Ce qui intéresse essentiellement Shankara, c’est d’établir la non-dualité du Brahman ou Paramâtman (“Soi-même suprême”). Sa perspective est ascétique et contemplative. Tout comme les docteurs Mâdhyamika dont nous parlerons plus loin, son but n’est pas de nous expliquer le monde, mais de nous en dégoûter…
Sans renoncer à la vision non dualiste, le shivaïsme médiéval du Cachemire (Trika) apporte un autre éclairage, sinon plus satisfaisant (chacun en jugera), du moins plus positif, plus large. L’univers, selon lui, bien qu’étant une apparence (âbhâsa) ou un reflet (pratibimba) [7] de Shiva (Brahman), n’est pas, à proprement parler, irréel ; ce serait plutôt une “illusion réelle”, ce qui rejoint le sens de “magie objective” que les anciens textes védiques donnaient à mâyâ. Plus précisément, le monde phénoménal n’est pas une surimposition venue de l’extérieur mais une “auto-production” ou encore une “autœxpansion” de Shiva lui-même, due à la félicité surabondante et infinie (ânanda) du Bienfaisant. C’est que Shiva n’est pas du tout inactif, comme le Brahman de l’advaita. Shiva n’est pas seulement Conscience pure, indéterminée, il est Conscience-de-soi, conscience-de-la-Conscience, resplendissant de sa propre Lumière (prakâsha) directe, immédiate ; il n’est pas seulement Connaissance immuable, il est Connaissance dynamique ; pas seulement Être pur, mais aussi Agent (kârta), activité vibrante et spontanée (kriyâ, spanda, sphurattâ, vimarsha). Il “veut” le monde (icchâ) et le fait jaillir de Lui sans rien perdre de son essence.
Cette puissance agissante, effervescente, inépuisablement créatrice est encore appelée Shakti et elle est symbolisée par la Déesse, la parèdre de Shiva, bien qu’en réalité Shiva et Shakti ne soient qu’un, — la figure androgyne, ardhanârîshvara, les représentant mieux que toute autre car Shakti n’est pas un attribut ou une qualité de Shiva, elle ne lui est ni opposée, ni complémentaire, ni supérieure, ni inférieure, Shakti est Shiva et Shiva est Shakti, aussi inséparables l’un de l’autre que le feu l’est de la chaleur ou que la glace l’est du froid. Ainsi le monde est-il une émanation spontanée, une expression immédiate, une objectivation constante, renouvelée d’instant en instant, de Shiva lui-même. Pour créer, celui-ci se “nie” volontairement, feint de s’oublier : le Sujet devient son propre objet, l’Artiste devient son œuvre. Il ne le fait point par besoin ou par manque quelconque — puisqu’il est Toute-Joie — mais par jeu (lîlâ), tel un roi qui assume le rôle d’un mendiant dans une pièce de théâtre [8]. Ainsi la manifestation cesse-t-elle d’être ce mirage, cette fantasmagorie énigmatique, sans commencement ni fin qu’y voyait Shankara. “CECI” (idam) n’est que “MOI” (Aham) rendu manifeste, et cela, pratiquement, opérativement, change tout. Car il devient dès lors possible de chercher la Délivrance en ce monde au lieu de le fuir, comme font les vedântins et les bouddhistes, les premiers sous prétexte qu’il est “faux”, les seconds sous prétexte qu’il est “impermanent”. Le monde n’est plus l’obstacle. Il devient le lieu, l’occasion, le moyen. Le seul obstacle — et encore est-ce Shiva qui l’a disposé pour lui-même, pour se chercher, pour se retrouver —, c’est le sens de la dualité (dvaitaprathâ ou bhedabuddhi), impureté fondamentale dont toutes les autres découlent ; c’est la croyance têtue en un “autre” ; c’est l’ego, qui nous empêche de reconnaître notre vrai visage divin dans le miroir de l’univers.
Précisons que cette unité de Shiva et du monde n’implique aucun panthéisme au sens philosophique du terme, aucune adoration de la “matière” en tout cas, pour la simple raison que les shivaïtes ne croient pas à l’existence de la matière. En ceci plus “idéalistes” que “réalistes” — pour rester dans la même terminologie occidentale —, ils considèrent le monde objectif comme un rêve de Shiva, un rêve spontané, conscient, un “rêve lucide” cosmique en somme, qui se déroule dans la Conscience divine mais pourrait aussi ne pas s’y dérouler, car Shiva — Réalité impersonnelle, transcendante mais aussi Dieu personnel, immanent — est inconditionnellement libre [9], il danse, rêve et joue, rien — pas même sa Shakti — ne l’oblige à créer (srishti) ou à ne pas créer, à maintenir (sthiti) ou à ne pas maintenir, à détruire (samhâra) ou à ne pas détruire l’univers, à s’occulter (nigraha) ou à se révéler (anugraha). Toutes ces puissances sont l’effet de sa grâce mais celle-ci ne vient pas à l’homme de l’extérieur puisque Shiva réside dans le plus profond de notre cœur à tous, puisque, essentiellement et potentiellement, nous sommes tous Shiva ou, mieux, Shiva-Shakti, — le fait d’appeler cette unique Réalité Parama Shiva (Shiva suprême) ou Parâ Shakti (Shakti suprême) n’étant qu’une question de sensibilité spirituelle et de voie. On saisit donc le caractère englobant, intégraliste de cette doctrine. Là où le Vedânta discrimine, exclut, le Trika inclut, harmonise. Toute négation, limitation et même contradiction ou erreur, tout conflit appartient selon lui à l’Absolu, à la Totalité définie comme pûrna sâmarasya, “Parfait Équilibre”.
Si nous passons maintenant au bouddhisme tantrique (Vajrayâna ou Tantrayâna), nous voyons que, par-delà les oppositions ou ressemblances verbales, son point de vue est plus proche de l’advaïtisme que du shivaïsme cachemirien. Métaphysiquement, le “Véhicule de diamant” a presque tout emprunté aux deux grands systèmes mahâyâniques, la dialectique Mâdhyamika de Nâgârjuna (IIe – IIIe s. ?) et l’idéalisme Yogâcâra d’Asanga (entre IVe et VIe s.). Or pour la première, on le sait, le maître mot est “vacuité” (shûnya ou shûnyata). C’est un concept d’apparence négative mais qui en vérité — quelles qu’aient été les querelles et les polémiques entre vedântins et bouddhistes — n’est pas très différent du Brahman shankarien. Certes les bouddhistes Mâdhyamika (comme tous les autres) nient la réalité du Soi (anâtmavâda), de ce principe transcendant et immanent à la fois de la personnalité qui, dans toute la pensée upanishadique et vedântine, est fondamentale et irréductible [10]. Mais, d’un autre côté, ils souscriront volontiers à la conception shankarienne d’un monde sans valeur (tuccha), illusoire, et ils accepteront de bonne grâce l’analogie de la corde prise pour un serpent, sauf à appeler shûnya (ou nirvâna ou tathatâ ou, chez les tantriques, vajra) ce que le Maître du Kerala nomme Brahman ou Parabrahman (et qui n’est pas distinct de l’âtman, du Soi).
La vacuité n’est pas le néant, ce n’est ni rien ni quelque chose. Le monde existe comme un voile derrière lequel il n’y a rien (rien dont on puisse dire : cela est ou cela n’est pas, ou bien : cela est et à la fois n’est pas, ou encore : cela ni n’est ni n’est pas). Mais du moins, en tant que voile, ce monde existe-t-il (on frôle ici la position du Trika). D’autre part, ce que l’on appelle phénomène, apparence ou illusion (le samsâra, le monde qui s’écoule et transmigre) est nirvâna (“apaisement de la multiplicité”) si l’on se place du point de vue de l’inconditionné. L’expérience du nirvâna comme l’expérience du Brahman — si ces expressions ont un sens — abolit toute notion de dualité. Le nirvâna est déjà dans le samsâra, comme la corde est déjà — a toujours été — dans le serpent. Dès lors, si samsâra et nirvâna, relatif et Absolu, sans être identiques, ne sont pas différents, rien n’interdit d’utiliser les moyens du samsâra pour atteindre le nirvâna ou, comme on dirait en milieu chrétien, d’utiliser les “choses de ce monde” pour atteindre “ce qui n’est pas de ce monde”. Dans cette coïncidence, non pas paradoxale mais en fait ultra-logique, quoique vertigineuse, se trouvent la justification et la base des pratiques tantriques, du point de vue bouddhiste (qui rejoint ainsi le Trika mais en faisant l’économie de Dieu). Les énergies, les formes — y compris les formes divines ou démoniaques — sont éveillées et évoquées pour réaliser que tout est “vide”, un “miroitement de la vacuité, sans nature propre substantielle” [11].
Certes on peut sembler loin de l’advaita-vedânta mais seulement si l’on réduit ce dernier à une ontologie abstraite et à la trop fameuse doctrine illusionniste (mâyavâda). Le plus haut advaita, l’advaita intégral — celui qui flamboie dans les Kârikâ de Gaudapâda et dans certains passages non dogmatiques de Shankara, mais qui ensuite, hélas, se voilà et dégénéra en scolastique hautaine et stérile, désastreuse pour la réalité “mondaine” de l’Inde [12] —, cet authentique “non-dualisme” porte sa vision au-delà de l’être et du non-être, au-delà des notions académiques de “réel” et d’ “irréel”, de “plein” et de “vide”, et en cela — mais uniquement en cela, par en haut — il rejoint la métaphysique bouddhiste du “Juste Milieu” et l’“Équilibre” souverain du Trika. En revanche, si l’on s’arrête à leur aspect premier, à leur “obsession” de l’illusion ou du vide, il est possible que les deux doctrines de Shankara et de Nâgârjuna prêtent le flanc aux mêmes critiques.
L’idée que “tout est illusoire” ou que “tout est irréel” ou que “tout est vide” (du moins tout le monde empirique) amène à une interrogation insolente, dont les tantriques shivaïtes ne se sont pas privés. Si “tout est irréel”, celui qui dit cela — faisant partie intégrante du monde empirique — est lui-même nécessairement irréel, irréelle aussi sa formule, et donc celle-ci se retourne contre lui. Si “tout est vide”, toute thèse établie à propos de choses vides par une pensée vide relevant du monde vide est elle-même vide, — vacuité dénuée de tout intérêt, zéro pas même pointé… En outre, ces deux systèmes soi-disant non dualistes, s’ils nient la réalité du monde, du mental et du corps, admettent la possibilité de l’Éveil ou de la Délivrance ou encore du nirvâna, à partir de ce même monde, de ce même mental et de ce même corps, et, de plus, nous pressent d’y parvenir le plus vite possible ! Cela paraît absolument contradictoire et comiquement chimérique, car comment un individu limité, vide d’être, doté d’un psychisme et d’un corps “en trompe-l’œil”, pourrait-il nourrir l’ombre d’un espoir d’atteindre jamais l’Absolu ? Comment le faux, en s’appuyant sur du faux, pourrait-il se transformer en Vrai ? Comment le non-être viendrait-il à l’Être ? Comment ce qui n’a pas de commencement — la nescience — aurait-il une fin ? Tous les systèmes absolutistes se dévorent eux-mêmes, et leur but n’est peut-être que d’humilier la pensée, de la forcer à un aveu radical d’impuissance : “abandon” du shivaïsme, “lâcher prise” du zen, — fécond désespoir et ultime silence où naîtra spontanément l’Éveil.
Si l’on envisage à présent la seconde grande école mahâyânique, celle du Yogâcâra Vijñânavâda, il n’est pas difficile de voir d’une part en quoi elle se rapproche et s’écarte des doctrines non dualistes précédentes (Vedânta, Trika et Mâdhyamika) et d’autre part comment elle a pu, elle aussi, servir de support intellectuel à des pratiques tantriques d’énergie. À première vue il s’agit — pour continuer d’utiliser nos étiquettes occidentales approximatives — d’un “idéalisme absolu”, ce qui nous rappelle la vision cachemirienne. Pour celle-ci, on s’en souvient, le monde est une apparence projetée ou reflétée dans le miroir de la Conscience cosmique, une projection “idéale” (faite d’“idées” devenues formes) de Shiva ; autrement dit, le monde n’est pas une réalité matérielle mais une réalité dans la Conscience et par la Conscience : ni subjectivisme ni encore moins solipsisme dans cette vision puisqu’il n’est pas question, insistons-y, d’une projection du mental individuel, comme dans le rêve ordinaire où chaque rêveur crée son propre monde, qui n’existe que pour lui et qu’il ne peut partager avec personne ; cette projection divine est, quant à elle, pleinement objective, ce qui ne veut pas dire matérielle (elle est faite d’esprit et non de matière, à moins de voir la matière comme de l’esprit solidifié, coagulé).
Or cette même conception se retrouve en partie dans le Yogâcâra bouddhiste (d’ailleurs historiquement antérieur), mais teintée d’un spiritualisme et d’un subjectivisme plus prononcés. Ici l’univers tout entier est esprit, conscience pure. Les choses n’existent que dans la pensée que nous en avons, elles sont de simples représentations mentales et ce que nous prenons pour un monde “extérieur” n’est que de l’esprit projeté, non différent en soi des visions que nous avons en rêve ou des créations de la méditation. Cette dernière analogie ouvre évidemment des possibilités immenses à la méditation elle-même (du moins à la méditation formelle, “avec objet”) et l’on peut comprendre que ce courant ait développé plus que tout autre le travail de la “conscience-en-acte”, l’art de la visualisation et de l’évocation qui culminera avec le Vajrayâna tibétain. On est ici en plein yoga (d’où le nom de Yogacâra, “exercice du yoga”, donné à l’école) mais un yoga qui joue non sans ambiguïté à la marge du psychique et du spirituel. Le méditant qui contemple, voire anime et intensifie sur son écran intérieur des images radieuses ou terrifiantes ne doit jamais — en principe — oublier qu’elles ne sont toutes que des projections de sa propre pensée et rien d’autre (il en sera de même des visions post mortem, comme le spécifie bien le Bardo thödol).
Toutefois il semble presque superflu de souligner combien les risques de dissociation, d’identification et de possession sont grands si l’on n’est pas guidé par une tradition sûre. Comme le suggéraient déjà certains mythes védiques, le sujet crée l’objet puis se perd en lui, oubliant qu’il est lui ; alors l’objet peut se retourner contre le sujet, la créature peut avaler le créateur. Shiva aussi crée, ou rêve, l’univers mais la différence est que Lui, l’Immaculé, demeure toujours conscient, maître et libre de sa création, capable de projeter tous les mondes en ouvrant les yeux (unmesha) et de les résorber en fermant les yeux (nimesha). On conçoit que dans une voie aussi problématique l’élément théiste — avec ses valeurs de grâce et d’amour [13] — représente une aide puissante et, du moins pendant longtemps, un garde-fou. Cela explique que le Vajrayâna ait “récupéré” tant de divinités du panthéon hindou, à la grande irritation des bouddhistes “orthodoxes” fidèles à l’athéisme des origines et à la doctrine de l’effort personnel nécessaire et suffisant ; et notamment tant de divinités féminines — dâkinîs, yoginîs et autres — car le bouddhisme primitif, on l’a dit, manquait cruellement de “féminité spirituelle” : or il apparaît vite à tout pratiquant du tantrisme — qu’il soit hindouiste ou bouddhiste, oriental ou occidental — qu’il est impossible de progresser dans cette voie sans la médiation de la Femme — “femme intérieure” ou “femme extérieure”.
Cette dernière rexmarque nous amène à considérer une différence symbolique assez troublante entre le tantrisme hindou et le tantrisme bouddhique, dont nous avons suffisamment reconnu le fonds commun métaphysique. Dans le premier, l’aspect Conscience (citi, samvit) ou Connaissance-Lumière (jñâna, prakasha, bodha) est identifié au masculin (Shiva), tandis que l’aspect Énergie (Shakti) ou Activité libre, joyeuse et spontanée (kriyâ, svâtantrya, spanda, vimarsha) est associé au féminin (Parvatî, Kâlî, Umâ, Durgâ, Bhairavî, etc.). Or, chez les bouddhistes, c’est exactement l’inverse : le Mâle est actif, la Femme passive ; à celui-là (Buddha, bodhisattva) sont attribués tout à la fois upâya (le Moyen, la Méthode) et karuna (la Compassion agissante) ; à celle-ci, la Déesse, correspondent la Sagesse (prajñâ) — laquelle, tout en étant potentiellement efficace, ne possède pas le même dynamisme spontané que la Shakti hindoue, car c’est upâya, le masculin, qui l’éveille — et aussi la Vacuité (shûnya).
En vérité, à notre connaissance, aucune explication vraiment satisfaisante n’a été donnée de cette contradiction entre hindouistes et bouddhistes. On a invoqué des raisons historiques (volonté de se démarquer par rapport à la tradition antérieure ou concurrente) ou ethno-sociologiques (prédominance du matriarcat ou du patriarcat dans les milieux d’origine [14]). Peut-être aussi conviendrait-il de rapprocher la conception du masculin et du féminin dans le bouddhisme tantrique de celle des taoïstes pour lesquels le Ciel a le rôle actif, créatif (yang), et la Terre le rôle passif, réceptif (yin), les deux principes ne s’opposant pas irréductiblement mais s’interpénétrant et jouant sans cesse pour produire les “dix mille êtres” (le monde manifesté, le samsâra). Il ne faut d’ailleurs pas oublier que dans ces systèmes la polarité n’est que relative et apparente (car envisagée du point de vue de l’individu limité). Sans l’attraction magnétique de Shiva, Shakti serait inopérante et n’entrerait jamais en mouvement. Réciproquement, sans Shakti, Shiva ne serait qu’un “cadavre” (shava). Aussi, pour chacun d’entre eux, pourrait-on indifféremment parler d’une “passivité active” ou d’une “activité passive”, ce qui rappelle encore le symbole taoïste yin-yang où chacune des deux énergies noire et blanche contient une trace de l’autre, sous forme d’un point de couleur opposée : le principe qui n’agit pas mais “sait” peut être dit plus “puissant” que l’autre ; le principe qui ne connaît pas mais agit a peut-être une sagesse obscure supérieure (l’infaillible Nature). Néanmoins, sur le plan opératif, il est certain que le rôle actif — ou passivement actif — attribué à la femme n’est pas sans application dans les techniques sexuelles initiatiques du vâmâcâra hindou.
Ces techniques ont-elles été différentes dans les sectes bouddhiques (le Sahajayâna du Bengale, par ex.) ? Il ne semble pas [15]. Qu’elles fussent d’origine shivaïte ou vajrayânique, elles impliquaient toujours la transmutation de la semence virile en “nectar d’immortalité”, la fusion du “rouge” et du blanc, la conquête de la “grande félicité” (mahâsukha) et des “trois joyaux” (triratna, tib. nor bu gsum : souffle, sexe, pensée), — et l’immobilité, la “passivité” de l’un ou de l’autre partenaire n’avait qu’une réalité relative et sans doute adaptable. Il ne s’agit donc là, pour l’essentiel, que de conventions symboliques, artistiques et iconographiques, non sans influence au demeurant sur qui contemple ces images et en nourrit sa méditation. Le rôle agissant et même volontiers agressif et féroce attribué à l’homme, par rapport à sa compagne beaucoup plus petite et “faible”, donne à certaines représentations tibétaines (yab yum) un caractère quelque peu déplaisant. À l’inverse, on peut être heurté par ces figurations hindoues de déesses épouvantables chevauchant, piétinant, torturant ou sacrifiant le dieu, quoique celui-ci soit souvent couché avec une expression d’abandon béatifique sur le visage. Mais ce sont là, en termes alchimiques, des “moments de l’œuvre” et l’on devrait se garder d’absolutiser de tels symboles qui ne peuvent être pleinement compris que dans leur contexte et leur climat initiatiques. Tout cela n’a jamais été fait pour plaire artistiquement ni, soit dit en passant, pour être exposé dans les musées.
Nous touchons là au domaine des moyens (upâya). Certes celui-ci ne s’est pas limité aux pratiques sexuelles mais il est incontestable que le maithuna — associé à la consommation rituelle d’alcool, de viande et autres substances prohibées par l’orthodoxie védique — a joué un rôle décisif aussi bien du côté hindou que bouddhiste. Ce sont aussi ces techniques — pourtant sacralisées et maîtrisées — qui ont provoqué le plus d’incompréhension et de scandale parmi les brahmanes et les lamas bien-pensants (sans parler des missionnaires chrétiens qui y virent la marque du diable) mais il ne faudrait rien exagérer. Vécue dans des cercles initiatiques très fermés — où l’on était admis selon des critères rigoureux, après mise à l’épreuve —, cette forme de tantrisme n’a jamais menacé sérieusement l’ordre établi. Il faut être à ce propos très clair, réagir avec la même fermeté contre ceux qui voudraient réduire tout le Tantra à ces disciplines et ceux qui, par un excès contraire, voudraient les éliminer de la tradition, dont elles représenteraient, selon eux, une déviation ou une application aberrante.
Ces derniers, notamment, raisonnent comme s’il existait d’un côté un “tantrisme propre” qu’ils appellent de la “Main droite” et qui, tout au plus, tolérerait dans sa pratique rituelle des substituts “idéaux” de la viande, de l’alcool et de la femme ; et de l’autre côté un “tantrisme sale”, corrompu, détourné qui serait celui de la “Main gauche” (vâmamârga, vâma désignant le côté gauche, féminin de l’Androgyne divin). Or un tel clivage est contraire aussi bien à la vérité historique que métaphysique du tantrisme. La voie de la “Main gauche”, rattachée au shivaïsme et au shâktisme les plus anciens, est parfaitement traditionnelle et légitime en elle-même [16], et c’est plutôt la voie de la “Main droite” (vishnouïte) qui en constitue une version brahmanisée, édulcorée et, en quelque sorte, exotérique. Là où beaucoup veulent voir une épuration et un progrès, nous remarquons pour notre part un effritement, un appauvrissement, une perte de sens, d’audace et même de cohérence. La grande idée des tantras en effet est d’utiliser tout ce qui se trouve dans le monde comme moyen de réalisation spirituelle. Exclure certaines formes sous prétexte qu’elles sont “impures” — elles peuvent être dangereuses ou sans intérêt mais c’est une autre question — prouve à coup sûr que l’on est encore bien englué dans la dualité. En revanche, ce que l’on doit relever, c’est que ces disciplines non conventionnelles, transgressives ne peuvent être pratiquées par tout le monde (pas plus aujourd’hui qu’hier). En Inde elles furent toujours réservées à des “héros” (vîra) au cœur pur et intrépide ; au Tibet la “voie des sens” fait partie de l’anuttara-yoga, c’est-à-dire du yoga le plus élevé et le plus difficile.
Cette dernière remarque nous conduit tout naturellement à évoquer l’autre grand “moyen” (upâya) de réalisation tantrique qu’est le yoga. Assurément il existe des yogas non tantriques : le râja-yoga de Patañjali, le jñâna-yoga de Shankara, le karma-yoga enseigné par la Bhagavad-gîtâ ou le bhakti-yoga des maîtres vishnouïtes (encore que certains éléments érotico-initiatiques se soient glissés dans le culte de Krishna et de Râdhâ). Mais sont spécifiquement tantriques le mantra-yoga (l’art des incantations aussi vivace en Inde qu’au Tibet où l’appellation Mantrayâna remplace parfois Vajrayâna), le hatha-yoga ou “yoga de la force” et le laya-yoga, “yoga de la dissolution”, aussi nommé kundalinî-yoga quand on songe au réveil de la “Femme intérieure” et à son ascension, depuis le sacrum jusqu’à la fontanelle, vers la Conscience shivaïque. Hathayoga et kundalinî-yoga sont d’ailleurs intimement solidaires : le premier, en principe, doit amener au second (qui, lui, cependant, n’a pas forcément besoin de toutes les disciplines hatha-yogiques préparatoires). Voie “violente”, très liée à l’alchimie et à la magie, le hatha remonte à Gorakshanâtha et Matsyendranâtha (VIIe s. ?), deux des 84 siddha ou sages et thaumaturges “parfaits” (et “parfaites” car la tradition compte des femmes) dont la légende flamboyante court tout l’Himâlaya et qui paraissent justement à la jonction des deux tantrismes, le shivaïte et le bouddhiste. La lignée qu’ils ont fondée, celle des Kânphata-yogin ou “oreilles fendues”, subsiste toujours dans le nord de l’Inde et au Népal mais elle n’a plus la vitalité d’antan. Intégralement enseigné — ce qui est bien rare —, le hatha suppose une connaissance, non pas seulement théorique, mais directe, vivante du corps d’énergie avec ses “roues” (cakra), ses “flux” (nâdî) et ses “vents” (vâyu ou prâna). C’est un “signe des temps” que cette science, secrète entre toutes, se soit tant vulgarisée et “empâtée” à une époque récente. Il a existé aussi, notamment au Cachemire, des formes raffinées de hatha où les postures et les mouvements étaient intensément visualisés avant d’être exécutés corporellement (et il n’était pas toujours nécessaire qu’ils le fussent car la réalisation subtile est plus puissante et porte ses propres fruits), — et cela au moyen d’une faculté évocatoire et imaginative (au sens créatif) que les Hindous appellent bhâvanâ et qui est capable de produire des effets tout à fait “objectifs” ; se transmettaient encore d’autres techniques où la “vacuité” était expérimentée dans le corps même, par une fusion de la sensation tactile dans l’espace. Mais les finesses et même l’esprit de cet art paraissent quasiment perdus. L’homme moderne est devenu soit beaucoup trop matérialiste, soit psychiquement trop vulnérable (et parfois les deux) pour pouvoir naviguer avec adresse et en toute sûreté dans des réalités aussi fluides qui relèvent de la “Claire Lumière”. D’un côté, il réclame des explications “scientifiques” à tout ; de l’autre, lorsqu’on lui parle de prolongements subtils du corps, il traduit “dédoublement”, “sortie en astral” et autres coquecigrues. Le plus souvent pourtant, ce qui se présente aujourd’hui sous le label hatha-yoga reste cantonné dans un domaine raisonnable et concret, plus “horizontal” que “vertical”. C’est une discipline psychosomatique, plus ou moins douce ou rigide, qui peut certes avoir son efficacité pour équilibrer un individu mais est bien incapable d’emporter celui-ci au-delà de ses limites.
On “fait du yoga” — cette expression est significative — soit pour apaiser son stress, soit pour améliorer sa santé, bref (un peu comme quand on suit une psychanalyse) pour mieux fonctionner dans la vie personnelle et sociale, — très rarement pour chercher la Libération ou l’Éveil, notions qui n’ont de sens que si l’on se sent sincèrement asservi ou endormi. Pour le shivaïsme tantrique du Cachemire, un tel yoga — s’il avait été connu — aurait au mieux relevé de la “voie inférieure” ou “voie de l’individu” (ânavopâya, aussi appelée “voie de l’homme”, naropâya, ou “voie de l’action”, kriyopâya). Cet upâya inclut en fait tout ce qui nécessite un appui, un support pour la concentration ou pour le rituel : mantra que l’on récite, objet ou image que l’on fixe du regard ; ou bien odeur, saveur, contact ; respiration que l’on observe. Par ces méthodes, souvent recommandées au début d’une ascèse, on reste toujours dans une relation de sujet à objet, et c’est leur faiblesse. Si la pratique ne s’accompagne pas d’un discernement très profond, on risque de demeurer éternellement “collé” à l’objet et, qui plus est, d’y prendre goût. Même à un stade avancé, les tenants de cette voie gardent une vision dualiste des choses (ce qui n’empêche pas nombre d’entre eux de se proclamer, prétentieusement ou naïvement, “non-dualistes”). Ils développent avec assiduité leur personne mais n’en sortent jamais ; ils se fabriquent une chaîne dorée mais c’est toujours une chaîne.
Au-dessus de la “voie de l’individu” se situe la “voie de l’énergie” (shâktopâya), également nommée jñânopâya, “voie de la connaissance” (c’est dire que dans le tantrisme la connaissance est quelque chose d’actif, non pas une simple lumière mais un feu). Cette voie implique pensée délibérée, déterminée (vikalpa), effort, et couvre tout le yoga mental (répétition silencieuse d’un mantra, concentration sur l’identité du soi individuel et du Soi universel, méditation ferme sur le Centre). Fait partie de ce chemin la technique typiquement tantrique des “intervalles” : il faut porter son attention sur le vide interstitiel qui sépare deux souffles consécutifs, ou bien deux pensées, deux émotions, deux objets matériels, deux mouvements, deux pas, deux états de conscience (veille et rêve, sommeil et réveil, etc.). Par cet entraînement contemplatif la vacuité, d’abord perçue comme un simple repos entre deux activités, une “absence”, sera réalisée comme le support véritable et permanent de tout dynamisme, l’écran vierge et stable sur lequel se déroule tout le film de la vie.
Supérieure encore à cette voie — mais rien n’interdit de passer graduellement ou subitement de l’une à l’autre — rayonne shâmbhavopâya, qu’on pourrait définir comme le “yoga spirituel” (par opposition au “yoga physique” et au “yoga mental” des deux degrés précédents). Certains textes précisent qu’il mobilise une pensée non discursive, automatique et spontanée (nirvikalpa). Mais il s’agit en fait d’un état exempt de pensée : demeurer dans la Réalité sans penser à rien. Alors que les autres voies étaient caractérisées par l’action et par la connaissance (objective), celle-ci s’épanouit sous le signe de la volonté pure (iccha), un vouloir absolu, non égotique, issu directement de la Shakti (c’est Elle qui Se veut en nous). Le yogin voit l’univers entier à l’intérieur de soi-même, comme le reflet ou la projection de sa propre conscience, de sa “shivaïté” : tout ceci (le monde objectif) a jailli de Moi, est reflété en Moi, n’est pas différent de Moi. À ce stade, la présence active d’un Maître est presque indispensable car un vertige métaphysique peut emporter l’adepte s’il subsiste en lui ne fût-ce qu’une trace d’ego : on ne peut dire “Je suis Shiva” (Shivo’ham) que quand il n’y a plus de “moi” pour le dire. La pratique sexuelle kaula (kaula sâdhana), dont nous avons dit quelques mots plus haut, participe aussi de cette voie, bien qu’elle n’en soit pas une composante obligatoire. L’homme et la femme initiés qui s’unissent ne sont plus alors deux individus mais Shiva et Shakti.
Enfin, transcendant ces trois upâya, est anupâya (littéralement “pas de moyens” ou “très peu de moyens”, isat upâya, le négatif en sanskrit pouvant être utilisé pour exprimer “le peu” ou alpa). Cette “non-méthode”, cette “non-voie” équivaut à une détente totale dans le Soi, un repos absolu dans l’Être (âtma-vishrânti) et on ne l’atteint qu’après un très haut degré de purification, mais — et c’est là le paradoxe que l’on retrouve dans le taoïsme et le ch’an — sans effort, spontanément. Tandis que les trois voies précédentes étaient progressives et indirectes, celle-ci est abrupte et immédiate. Tout ce qui s’y accomplit est à la fois vrai (satyam), bon (shivam) et beau (sundaram). Selon les mots d’Abhinavagupta (Anuttarâshtikâ 1) : “Ici on ne va nulle part, on n’exerce aucune technique, ni concentration, ni méditation, ni récitation (de mantras), on ne pratique rien, on ne fait pas d’effort, rien. Alors qu’y a-t-il réellement à faire ? Seulement ceci : n’abandonne rien, ne saisis rien, sois en toi-même et jouis de chaque chose telle qu’elle est” [17]. Il ne s’agit pourtant pas d’un quiétisme mystique car, s’il est vrai qu’on n’a plus rien à faire (“rien de spécial”, dirait le zen), rien non plus n’empêche de faire ce que l’on veut, sans limite aucune. C’est la voie de la béatitude libre (ânandopâya), le lieu ineffable et l’instant éternel où moksha (Libération) et bhoga (jouissance sensorielle), non seulement cessent de s’opposer, mais ne se distinguent plus du tout. C’est pourquoi les shivaïtes appellent cette félicité indescriptible Pûrnatva, “Plénitude intégrale”, et ils l’estiment supérieure tant au nirvâna des bouddhistes qu’au samâdhi suprême de Shankara ou de Patañjali, car elle seule comble à jamais le fossé entre la Conscience et le Monde, l’Être et le Mouvant, le Sujet et l’Objet, — sans renoncer à rien. Alors que dans les autres doctrines l’individualité est laminée, effacée, sacrifiée, tenue pour irréelle, vide, rejeton de l’illusion et de l’ignorance, dans le tantrisme shivaïte elle se voit réintégrée dans le Divin, elle devient une expression, une énergie, un masque et un visage étincelant du Divin [18]. Si incroyable est cette coïncidence qu’elle stupéfie l’entendement et provoque l’émerveillement (camatkâra).
C’est encore à l’un des 84 siddha, l’Indien Naropa, que l’on doit les six pratiques de yoga réservées, au Tibet, à des yogin de haut vol, soit moines rattachés à l’école Kagyüpa, soit tog den indépendants, certains chastes, certains mariés, souvent reconnaissables à leurs longs cheveux tressés de laine et roulés en chignon. Ces méthodes appartiennent à la “voie de la forme”, par opposition à la “voie sans forme” (Mahâmudrâ et yoga de la “Grande Libération”) dont nous ne dirons rien ici. Même en ce qui concerne les six enseignements de Naropa, nous ne pouvons songer à les décrire dans leur détail technique (qui relève de la transmission secrète), mais quelques indications permettront de voir combien ils sont en cohérence avec les upâya shivaïtes et shâktas.
◊ 1. Le gtum mo (“feu intérieur”) représente à la fois un prolongement des antiques techniques d’échauffement ascétique (tapas védique, transes chamaniques) et une adaptation du système, plus élaboré et savant, du kundalinî-yoga hindou. Tandis que les shivaïtes du Cachemire reconnaissaient cinq cakra principaux — et d’autres écoles tantriques indiennes six, sept ou davantage —, les Tibétains n’ont retenu que quatre centres énergétiques dont chacun, selon Naropa, “est en forme de parasol ou comme la roue d’un char” (l’image hindoue du lotus est plus rare ; de même le symbole du Serpent pour désigner le feu de base n’a pas séduit les Tibétains). Ces quatre “roues” (ombilic, cœur, gorge, tête) sont mises en correspondance avec les quatre corps du Buddha : nirmânakâya, (corps artificiel ou apparent), dharmakâya (corps de la Loi), sambhogakâya (corps de jouissance, corps “glorieux” des visions suprasensibles) et sahajakâya (corps inné, dit aussi mahâsukha-kâya, “corps de volupté suprême”). La visualisation des trois principales nâdî (tib. rtsa) et l’activation “colorée” des flux énergétiques atteignent une intensité extrême, le courant de gauche, “lunaire” des Hindous (idâ, candra) étant assimilé par les vajrayânistes à prajñâ, la Sapience (on l’appelle en “langage crépusculaire” sanskrit lalanâ, “femme dissolue”, et en tibétain brkyam ma), et le courant de droite, “solaire” (pingalâ, sûrya) étant identifié à upâya, la Méthode (sk. rasanâ, “langue”, tib. ro ma) ; quant au canal médian du corps subtil (la sushumnâ hindouiste), on l’homologue au Vide (shûnya) qui transcende prajñâ et upâya (on l’appelle encore avadhûtî, “ascète féminine” — tib. kun dar ma ou dbus ma) — ou Nairatmyâ, “Impersonnalité”, compagne divine de Hevajra). Il existe donc une incontestable ressemblance entre les deux schémas mais ils ne sont pas superposables, notamment au niveau cosmologique.
◊ 2. Le yoga du corps illusoire (gyu lü) a pour but de faire reconnaître à l’adepte la nature irréelle de son propre corps et de tous les objets de l’univers. À cet effet on recommande tout particulièrement la contemplation du miroir. On a vu que pour les shivaïtes du Cachemire toute chose existe dans le miroir de la Conscience divine ; le réfléchi (Shiva) et le reflet (le monde) sont un ; le miroir, qui symbolise l’absolue liberté de la Volonté divine (svâtantrya), n’est rien d’autre en fait que la Conscience divine elle-même. Comme les bouddhistes, pour leur part, ne croient pas à la “réalité” du monde, le miroir est plutôt utilisé par eux pour en démontrer le caractère illusoire. En premier lieu, le yogin contemple sa propre image dans un miroir, s’interrogeant sur la “réalité” non seulement du reflet mais de l’objet reflété. Ensuite il s’efforce de voir l’image comme si elle se trouvait entre lui-même et le miroir, et ainsi la différence entre le spectateur et l’image est-elle abolie en un acte de sensation pure. L’adepte continue de la fixer longuement et selon divers points de vue, jusqu’à ce qu’il cesse de la juger source d’admiration ou de blâme, de plaisir ou de souffrance, de bonne ou mauvaise renommée. Il comprend qu’il n’est en aucune façon différent de la forme réfléchie, que celle-ci et lui-même sont toutes deux également semblables à un mirage, à des nuages errants, au reflet de la lune dans l’eau, aux fantasmes du rêve, etc. Pour la suite de l’exercice, il utilise l’image de Vajrasattva (un des cinq Jinas ou aspects de la Sagesse-de-Buddha) ou bien de telle ou telle divinité d’élection (sk. ishtadevatâ, tib. yi dam), toujours reflétée dans le miroir. Il médite sur elle jusqu’à ce qu’elle s’anime ; puis il oblige ce reflet vivifié, devenu si substantiel qu’il pourrait le toucher, à se tenir entre lui et le miroir. Il réalise alors la fusion de son propre corps avec celui de la déité, ce qui a pour résultat de faire reconnaître que tous les phénomènes, sans exception, sont les jeux ou les émanations du yi dam, c’est-à-dire, en dernière analyse, de la vacuité. Dirigeant son regard vers le ciel, le yogin fait pénétrer son énergie vitale dans le “canal médian” et saisit intuitivement que même les signes lui annonçant l’unification et l’épanouissement de cette énergie (corps célestes éblouissants, apparition du Buddha), que toutes ces épiphanies merveilleuses sont elles aussi pareilles à un mirage, à des nuages errants, etc. Finalement, renonçant à discriminer entre le mouvant (samsâra) et l’immuable (nirvâna), reconnaissant leur unité non conceptuelle, il atteint l’état suprême.
◊ 3. Le yoga du rêve (mi lam). Par cette technique on apprend à entrer à volonté dans l’état de rêve et à revenir du rêve à la veille sans jamais cesser d’être conscient. C’est d’abord une façon de vérifier que ces deux états sont identiquement dépourvus de réalité objective. C’est ensuite un art d’apprendre à “mourir” chaque nuit et à renaître sans perte de mémoire (ce qui constitue un entraînement à la traversée du Bardo). Par une pratique assidue, le yogin devient capable d’intervenir dans son rêve : il peut se changer en minéral, en végétal, en animal, en mendiant, en roi ; il peut affronter des adversaires, piétiner les flammes qui menacent de le consumer, marcher sur l’eau qui veut le noyer ; il peut visiter des paradis ou des enfers, se mouvoir librement dans l’espace, transformer à son gré la matière onirique, rapetissant ce qui est grand, agrandissant ce qui est menu, multipliant ce qui est unique, etc. On demandera : quel est l’intérêt de tout cela ? C’est un moyen direct et efficace de se rendre compte que toute forme n’est que manifestation mentale, “idée” en mouvement. Ce peut être aussi une occasion de brûler certains résidus karmiques, d’accélérer, de neutraliser ou de déjouer certaines forces du destin. Néanmoins la déviation magique est possible : si le rêveur n’a pas le cœur purifié, il peut être tenté de se servir de cette lucidité merveilleuse et de cette liberté illimitée d’action pour assouvir ses désirs secrets. Aussi ce yoga ne doit-il être dévoilé qu’à des disciples éprouvés. On le trouve évoqué, non seulement dans l’enseignement tantrique du Tibet, mais dans certains tantras shivaïtes comme le Vijñâna-Bhairava (55) : « Si l’on médite sur l’énergie (du souffle) grasse et très faible dans le domaine du dvâdashânta (le sommet du cerveau) et que (au moment de s’endormir) on pénètre dans son (propre) cœur, en méditant (ainsi) on obtiendra la maîtrise des rêves » (trad. L. Silburn).
◊ 4. Le yoga de la “Claire Lumière” (o sel). Il est dit que, peu après la mort physique, chacun est confronté à la “Claire Lumière” du Vide. Seul l’adepte qui en a déjà eu une intuition ou une “prévision” très forte lors de son existence est à même de l’identifier et, par cette reconnaissance immédiate, d’obtenir la Libération, tandis que les êtres moins mûrs, ne pouvant supporter son éclat, la fuient et doivent alors inévitablement revenir au monde des formes divines ou démoniaques, subtiles ou grossières, humaines ou subhumaines. Il est donc du plus grand intérêt d’apprendre à contempler cette “Claire Lumière” dès cette vie-ci. Un des moyens privilégiés est la prise de conscience des “intervalles” (nous retrouvons ici très directement le yoga du Cachemire). Entre la cessation d’une pensée et l’apparition de la suivante brille la “Claire Lumière Mère”. Lorsque prennent fin la réflexion, l’analyse, la méditation, l’imagination passive, toutes ces “maladies de l’esprit”, alors ce dernier retourne à son état naturel de vacuité et jaillit la “Claire Lumière Fille”. La fusion des deux Lumières peut aussi se produire dans le moment qui sépare l’état de veille de l’état de sommeil, à condition bien sûr que l’endormissement soit totalement lucide. Dans le sommeil profond la “Mère” peut se manifester. Entre sommeil et réveil, si la conscience est active, “Mère” et “Fille” fusionneront (“Claire Lumière Résultante”). L’illumination n’est donc point liée au seul état vigile (et d’ailleurs, si elle l’était, elle dépendrait de quelque chose et ne serait plus libre et absolue).
◊ 5. Le yoga du Bardo (Bar do : “entre les deux”). C’est un sujet “à la mode” et sur lequel nous ne nous étendrons pas, le Bardo thödol étant devenu un best seller de l’édition occidentale. On pourrait se demander du reste pourquoi en Inde il n’existe pas d’ouvrage équivalent au “Livre des morts” tibétain. Ce n’est pas que, au niveau populaire, la croyance en la “réincarnation” soit moins prégnante, moins obsessionnelle en milieu hindouiste qu’en milieu bouddhiste. C’est plutôt, nous semble-t-il, que, la “compassion” étant moins valorisée et l’idéal bodhisattvique de sauver tous les êtres apparaissant, dans l’optique vedântine, comme une “illusion” de plus, gurus et brahmanes n’ont pas le même souci que les lamas tibétains de guider les âmes dans les états posthumes. Toutefois ce n’est pas à dire qu’une telle science soit inconnue. Mais elle est moins codifiée, ressortit davantage à la tradition orale et il faudrait aller la chercher auprès de sectes très spécifiques et très redoutées, comme les Kâpâlikas (s’il en reste) et les Aghorîs [19].
◊ 6. Le yoga du transfert de conscience (pho wa ou ap’o ba) peut se définir comme la capacité de faire passer volontairement sa conscience individuelle, n’importe où, à n’importe quel moment, dans le corps d’un autre être, humain ou non humain. Le même pouvoir permet aux maîtres de guider, dans les états post mortem que nous évoquions plus haut, l’âme des non-initiés pour les aider à obtenir une renaissance favorable. À leur propre mort, ces yogins transfèrent leur conscience, par une ouverture correspondant à la fontanelle (“ouverture du Brahman” chez les Hindous) dans l’état suprême (disons mieux le “non-état”) où l’on est délivré du samsâra. Ces divers exemples prouvent assez qu’un “pouvoir» n’est rien en lui-même, tout dépend de son orientation. Ainsi connaît-on en Inde un rite effrayant où le yogin, assis sur un cadavre (shavâsana) lui insuffle sa force vitale afin de le ranimer momentanément et de l’interroger dans un but de divination ou de magie noire (plus rarement dans un but authentiquement spirituel) : c’est pourtant là une application du même pouvoir que nous venons de mentionner, — mais dans un sens “sinistre” qu’il serait bien malaisé de justifier.
Nous n’avons voulu en cet article que rappeler quelques aspects du sâdhana tantrique, sans chercher à être exhaustif ni trop technique. Resterait, entre autres, à examiner le champ immense des passions et des désirs que le tantrisme a pour objet de transmuter, de même que les innombrables et très banales situations de la vie quotidienne qu’il prend comme supports de réalisation. Cela aurait évidemment pour avantage de ramener le tantrisme un peu “sur terre”, après des aperçus qui ont pu paraître trop fantastiques ou folkloriques au lecteur. Mais présenter la tradition dans son caractère abrupt peut avoir une valeur d’épreuve et l’on ne saurait jamais trop répéter que cette voie n’est destinée ni aux purs intellectuels (bien qu’elle s’appuie sur la métaphysique la plus haute) ni aux esprits trop timides ou sentimentaux (bien qu’elle parle au cœur et n’exclue pas la ferveur) |20].
Nous dirons pour finir que cette comparaison, nécessairement schématique, que nous avons tenté d’établir entre tantrisme hindou (shivaïte surtout) et tantrisme bouddhique ne visait nullement à suggérer ou à démontrer une “supériorité” intrinsèque de l’un sur l’autre. Ce qui nous paraît peu contestable, c’est que quiconque veut étudier sérieusement le tantrisme a intérêt à se référer à ses formes hindoues, plus anciennes selon nous et plus complètes, ce qui ne veut pas forcément dire plus efficaces ou plus profondes. En ce qui concerne la réalisation tantrique, elle reste affaire de rencontre, d’initiation (souvent loin des stéréotypes associés à ce mot), de l’affinité mystérieuse entre un vrai disciple et un vrai Maître (l’un étant aussi rare que l’autre), entre une forme traditionnelle et un tempérament. Quoiqu’une telle adéquation soit devenue plus difficile que jamais, nous pensons qu’elle n’est pas tout à fait encore impossible et que la “voie des héros” n’est point fermée.
► Pierre Feuga, Connaissance des religions n°61/64, 2000.
1. À cet égard — et sans vouloir froisser personne — on peut dire que le Tantra est un peu au Veda ce que le Nouveau Testament est — du point de vue chrétien — à l’Ancien. Mais bien sûr sa vocation universaliste, aujourd’hui indéniable (notre époque entière est « tantrique », quoique sur un mode passif, inconscient et tourmenté), n’est pas de la même nature que celle du christianisme et ne devrait jamais prendre un tour missionnaire. On ne se convertit pas au tantrisme car, répétons-le, c’est une voie initiatique, non une religion. L’incompatibilité n’est pas fatale, il faut seulement savoir à quel niveau on se situe. Au Bengale, on trouve des Baûls musulmans qui pratiquent le tantrisme sans cesser d’être musulmans ; le soufisme du Cachemire a été également très imprégné de tantrisme. En milieu chrétien — nous songeons ici à l’Occident — il y a davantage de réticence et de crispation, tant la peur du “syncrétisme” reste forte. On devrait pourtant se souvenir qu’au Moyen Âge, et même après, il y a eu d’excellents chrétiens qui pratiquaient l’alchimie, — or la tradition hermétique, sous sa forme intégrale, est certainement ce qui chez nous est le moins éloigné du tantrisme, et spécialement du shâktisme.
2. Il est vrai que plusieurs tantras hindouistes (Rudrayâmala, Brahmâyâmala, Shaktisangama, Kubjikâ-tantra, etc.) proclament eux-mêmes que leur tradition — notamment sous son aspect de la “Main gauche” (vâmâcâra) — vient d’un pays bouddhiste (bauddhadesha). Il n’est pas facile de déterminer avec précision s’il s’agit de certains confins de l’Inde — Népal, Sikkim, Bhoutan, Assam — ou bien de pays réellement “jaunes” (Tibet, Chine, Mongolie). Il n’est pas exclu que le taoïsme “sexuel” ait influencé le tantrisme hindou par l’intermédiaire du bouddhisme (et réciproquement, le bouddhisme ayant toujours eu le rôle transmetteur). Néanmoins nous pensons que les deux traditions sont autonomes et nous ne pouvons suivre Robert Van Gulik (La Vie sexuelle dans la Chine ancienne, 1971) dans son zèle à faire remonter tout le vâmâcâra à la Chine.
3. « Ô Gautama, la femme est le feu (du sacrifice), son sexe est le bois, sa toison est la fumée, le vagin est la flamme, la pénétration est le charbon, la jouissance est l’étincelle ; en elle les dieux offrent la semence ; et de cette oblation le purusha est né » (Brihadâranyaka-upanishad 6, 2, 13 et, en termes voisins, Chhândogya-up. 5, 8, 1-2). « Brahman est présent dans l’organe sexuel en tant que reproduction, immortalité et joie » (Taittirîya-up., 10, 2, 3). On constate aussi que dans le brahmanisme hindouisant et théiste cette conscience sacrée du sexe perdure : cf. Bhagavad-Gîtâ : « Je suis l’eros dans ce qui procrée » (10, 28) ; « Dans les êtres je suis le désir qui n’est pas contraire au dharma » (7, 11). Le Bhâgavata-Purâna (4, 11, 22) voit dans le désir sexuel la manifestation de Dieu. Le puritanisme est relativement récent dans l’hindouisme et nous le croyons contraire au génie de cette religion.
4. Si nous spécifions “à celles”, c’est que cette voie est éminemment ouverte aux femmes, à la différence du Védânta (traditionnel) réservé aux mâles “deux fois nés”. Et il ne s’agit pas d’une participation décorative, esthétique ou subordonnée. Il existe (ou il a existé) dans certains courants des lignées de maîtres féminins et des traditions d’initiations conférées aux hommes par les femmes. Abhinavagupta assure que les femmes réussissent plus facilement et plus rapidement que les hommes dans la voie tantrique, car elles possèdent une énergie spirituelle plus puissante, elles sont l’Énergie.
5. On pourrait objecter à cela que certains éléments tantriques subsistent dans le Shingon-shû. Néanmoins on ne saurait parler d’un véritable tantrisme japonais qu’à propos de la branche Tachikawa de cette secte fondée par Ninkan (XIIe s.), qui avait étudié la “Voie du yin et du yang” (onmyô-dô), proche du taoïsme, et dont la doctrine fut reprise par Monkan (1278-1357) et Enkan (1281-1356). Malheureusement ces enseignements ne nous sont connus que par les réfutations du Tendai orthodoxe, car le mouvement Tachikawa fut durement réprimé à l’époque Edo. Il semble que ses adeptes pratiquaient des rites sexuels sous l’égide de Matara-jin, divinité d’origine indienne, et soutenaient que l’« obtention en ce corps de l’état de Buddha » devait être réalisée par l’union des deux mandala (jap. mandara) que sont le corps masculin (mandala du Plan de diamant) et le corps féminin (mandala du Plan de la matrice). — Quant au bouddhisme tantrique chinois (mijiao), il fut répandu dans le milieu impérial des Tang par le moine indien Amoghavajra (Bukong) dans la deuxième moitié du VIIIe s., mais il ne “prit” jamais vraiment en Chine, sans doute à cause de la concurrence du taoïsme. En revanche le mijiao pénétra plus tard au Tibet et joua un rôle certain dans la formation de ce qu’on appelle improprement le “lamaïsme”.6. Le bouddhisme tantrique est on ne peut plus explicite à cet égard : il est vain, affirme-t-il, de recourir à la technique (upâya) si celle-ci n’est pas soutenue par la connaissance (prajñâ) et vice versa. Les quatre étapes que distingue le Védânta restent valables pour le tantrisme : d’abord écouter un Maître déjà réalisé ; ensuite réfléchir sur l’enseignement afin d’éliminer les doutes ; méditer ce qu’on a compris intellectuellement mais en abandonnant le raisonnement, l’analyse et les mots (laisser mûrir la compréhension dans le silence) ; enfin réaliser l’Expérience non duelle (cette dernière étape est abrupte et spontanée alors que les trois précédentes sont progressives et volontaires). Abhinavagupta souligne en outre la nécessité de vaincre à la fois l’ignorance intellectuelle (bauddha ajñâna), par l’étude des Écritures sous la direction du guru, et l’ignorance “existentielle” (paurusha ajñâna, c’est-à-dire impliquant le purusha, la personne entière), ce qui n’est généralement possible que par l’initiation (dîkshâ) et un sâdhana approprié, menant à la “Reconnaissance” (pratyabhijñâ) de notre nature véritable, Shiva. Le maître du Cachemire admet cependant (Tantrâloka 13, 150) que l’on puisse atteindre l’illumination par soi-même, sans l’aide d’un guru (sâmsiddhika-jñâna). Ce cas n’est pas si rare dans l’hindouisme (Ramana Maharshi et Aurobindo en sont des exemples assez récents). Il est attesté également dans le bouddhisme (le Buddha lui-même atteignit l’Éveil par son seul effort et on lui prête des paroles telles que “Soyez votre propre lampe” ou “Ne prenez pas refuge auprès des autres”. Dans le bouddhisme tibétain on insiste davantage sur la nécessité du Maître et sur les “initiations” mais sans donner à ce mot tout à fait le même sens que dans le tantrisme hindou).
7. Dans le symbole du miroir, cher aux shivaïtes (et aussi aux bouddhistes tantriques), Shiva est à la fois l’archétype devant le miroir et le miroir où il se reflète. Le reflet tire toute sa réalité de l’archétype mais celui-ci existe indépendamment de son reflet et n’est pas affecté par ce qui arrive au reflet (à supposer qu’une pierre vienne frapper le reflet, le modèle n’en sera pas blessé). De plus, le miroir peut refléter simultanément les formes les plus diverses sans en être modifié. Il faut remarquer enfin que l’image est inversée par rapport au sujet (le monde est un reflet inversé de Shiva). — Un symbole voisin est celui du cristal qui prend l’apparence de multiples couleurs tout en restant un. De même Shiva prend l’apparence des dieux, des hommes, des animaux, des arbres, etc., tout en demeurant inaltéré et “sans forme”.
8. La théorie du “jeu” divin choque parfois le sérieux théologico-philosophique occidental. Mais il faut comprendre que Shiva ne joue pas avec nous (comme un dieu cruel extérieur jouerait avec ses créatures ou ses “marionnettes”) mais joue en nous, jouit en nous, souffre en nous, en nous éprouve la peur, la colère, le désir, etc. Tel est le fondement d’une voie des émotions dans le tantrisme hindou : étant d’origine divine, elles ne doivent pas être rejetées mais en quelque sorte “rendues” à leur créateur. Dans le tantrisme bouddhique, cela n’est pas différent. Alors que le Mahâyâna assimile quasiment la Méthode (upâya) à la “grande compassion” (karuna), pour le Vajrayâna la passion (râga) peut constituer aussi un moyen légitime. Le Védânta ne peut accepter ces points de vue car, pour lui, le Soi n’entre jamais dans l’action ni dans la sensation, il en est seulement le Témoin impassible.
9. La liberté (svâtantrya : liberté de la Conscience, liberté de l’Énergie) est le concept fondamental du shivaïsme cachemirien et son apport principal par rapport aux autres systèmes non dualistes (le Brahman du Védânta est libre de toute limitation, détermination ou impureté, donc il est libre négativement, mais non positivement puisqu’il n’agit pas). Le Trika reconnaît même à l’individu une plus grande liberté de volonté, de choix et par conséquent une plus grande responsabilité relativement au bien et au mal que les autres écoles. La notion de kriyâ – activité spontanée, ludique, joyeuse – pulvérise celle de karma, l’action contraignante et contrainte. Kriyâ est l’activité qui ne laisse pas de traces, pas de résidus karmiques. Le Brahman du Védânta est sat-cit-ânanda (Être-Conscience-Béatitude). Shiva, lui, a cinq “visages” : ces trois mêmes, plus icchâ (Volonté) et kriyâ (Activité).
10. Il y a cependant là une équivoque car les vedântins ne croient pas davantage en l’âtman en tant qu’âme individuelle permanente : une telle âme n’a une existence — et encore sur un mode illusoire, “fonctionnel” en quelque sorte — que jusqu’à la Délivrance (mokska), laquelle consiste justement à prendre conscience que cette âme n’existait pas séparément du Tout. Trop souvent les bouddhistes donnent au terme hindouiste âtman le sens d’individualité ou d’ego, ce qui est non seulement restrictif mais erroné. Ils ne se demandent pas assez non plus qui nie le Soi. « Celui qui nie le Soi, ce négateur lui-même est le Soi » (Sârîraka-bhâshya 1, 1, 4). On n’est pas fondé à dire que les choses “changent” ou “deviennent” si l’on n’admet pas un être immobile. Et inversement celui-ci ne peut prendre conscience de soi (de sa propre immutabilité) que si les choses bougent autour de lui. Toute métaphysique intégrale doit donc inclure l’être et le devenir, sans nier l’un pour exalter l’autre.
11. Advayavajrasamgraha, 8. Pour dépasser la notion d’“impur” opposé à “pur”, le tântrika bouddhiste en appelle à la vacuité, il plonge pur et impur (comme tout autre couple de contraires) dans la vacuité. Le tântrika shivaïte ou shâkta, lui, sait qu’il n’y a ni pur ni impur car tout provient de Shiva. Les deux points de vue ont mené à des pratiques extrêmes similaires.
12. Les tenants du strict advaita sont souvent en Inde les plus farouches partisans des castes. Pour se justifier, ils font valoir qu’il existe deux niveaux de vérité : l’un absolu (pâramârthika) et l’autre pratique (vyâvahârika). Mais c’est une explication un peu facile et qui peut masquer une certaine hypocrisie.
13. La grâce divine (anugraha, kripâ ou shaktipâta, “descente de l’Énergie”) joue un rôle de premier plan dans le shivaïsme. Elle n’est pas arbitraire, quoiqu’on ne puisse lui fixer ni cause ni condition. Elle est opérative à tout moment mais tous les individus ne sont pas également prêts à la recevoir (la pluie tombe équitablement sur différents champs mais la productivité de ceux-ci dépend de leur fertilité particulière). En outre on ne saurait blâmer Shiva d’être partial puisqu’il est à la fois celui qui octroie et celui qui reçoit (ou ne reçoit pas) la grâce. Quant à l’amour dévotionnel (bhakti), il est aussi développé dans la tradition shivaïte que dans le vishnouïsme mais il se confond plus intimement avec la Connaissance.
14. Il est vrai qu’au Kerala ou en Assam, terres fortement marquées de shâktisme, les traditions matriarcales sont puissantes et un rôle actif est volontiers reconnu à la femme dans la relation amoureuse. Mais des formes matriarcales (parfois doublées de polyandrie) sont attestées également parmi les populations himalayennes bouddhistes. Un bon connaisseur du tantrisme, Kamalakar Mishra, propose de son côté l’explication suivante, un peu “simplette” : « Des deux parents d’un enfant, le père est associé à la raison ou à l’intellect qui guide, discipline, réprimande, etc., les enfants, tandis que la mère est fondamentalement conçue comme tout amour et affection envers ceux-ci. Aussi la mère est-elle associée au coeur, qui est le siège des émotions et sentiments. Il est évident que le pouvoir d’agir provient des émotions, le coeur, et non de la raison, la tête. La raison ou l’intellect contrôle l’activité, mais l’activité réelle découle de l’aspect émotionnel de la personnalité. Ainsi peut-on comprendre pourquoi la mère ou la femme, la personne du cœur, est devenue le symbole de la Shakti » (Kashmir Saivism, Rudra Press, 1993).
15. Si l’on transpose au kundalinî-yoga et au gtum-mo (méthodes exigeant en principe une rigoureuse chasteté) ces deux symbolismes, ils gardent également leur cohérence. Hindous et Tibétains situent le principe féminin (shakti ou prajñâ) en bas de la colonne vertébrale et le principe masculin (Shiva ou upâya assimilé à Buddha Vajrasattva) au sommet du crâne. Chez les premiers, c’est l’Énergie qui monte vers la Conscience, qui redevient consciente, le mouvement qui se résorbe dans son Principe immobile ; chez les seconds, c’est la Connaissance qui monte vers la Méthode, qui devient agissante, efficace, et c’est aussi le Vide qui se manifeste en Compassion. Hindouistes et bouddhistes — en ceci comme en bien d’autres domaines — expriment la même Réalité de deux points de vue différents.
16. Ce qui n’exclut pas, bien entendu, qu’il ait pu se produire des déviations au sein des écoles de la “Main gauche” en Inde comme au Tibet, mais cela ne remet pas en question la légitimité de la voie, pas plus que le fait que certains alchimistes se soient épuisés à fabriquer de l’or matériel ne frappe de nullité la tradition hermétique. Même une secte extrémiste comme celle des Aghorîs (qui utilise des substances “objectivement” très impures) n’est pas illégitime d’un point de vue tantrique. Elle est excessive si l’on veut, répulsive même, mais ne relève ni du “satanisme” ni de la “contre-initiation”. En revanche certains mouvements récents, “néo-tantriques” ou “pseudo-tantriques”, sous leur aspect plus anodin nous semblent plus condamnables, d’une part parce qu’ils admettent n’importe qui dans leurs pratiques (les pashu ou “bêtes” qu’excluaient les anciennes initiations) et d’autre part parce qu’ils réduisent l’enseignement à ce qu’il n’a jamais été : un hédonisme doucereux dénué de toute transcendance. Une telle doctrine, si l’on peut même ici parler de doctrine, n’a aucun fondement ni dans les tantras hindous ni dans les tantras bouddhistes. Le Kulârnava-tantra (2, 119) nous avertit non sans ironie : « Si en ayant simplement un rapport sexuel avec une femme on pouvait être libéré, alors toutes les créatures de ce monde seraient libérées (mukta) par l’acte sexuel ». Et le Hevajra-tantra, un des plus anciens et importants tantras bouddhistes, affirme qu’on ne doit pas pratiquer l’union (maithuna) pour y trouver du plaisir. « Les sens, précise-t-il, peuvent être cultivés lorsqu’ils sont rendus inoffensifs par la purification ».
17. Cf., en écho bouddhiste, ce conseil du siddha Tilopa (qui est “l’ancêtre” de la lignée de Marpa, Naropa et Milarepa) : « N’imagine pas, ne conçois pas, n’analyse pas, ne médite pas, ne réfléchis pas, demeure dans l’état naturel ». Cet état naturel (sahaja) est, dans les deux tantrismes, considéré comme l’état suprême et il équivaut à la Plénitude cachemirienne. — On peut songer aussi à la phrase de Ramana Maharshi (qui n’était certes pas tantrique) : « Reste tranquille et sache que Je suis Dieu ».
18. Cela explique que, sur un plan empirique et humain, les tântrika, même réalisés, gardent une “personnalité” haute en couleur, voire extravagante, loin de l’image conventionnelle du “sage” (les légendes concernant les 84 siddha en offrent de multiples exemples savoureux). L’un peut paraître terriblement coléreux, l’autre aimer outrancièrement le vin ou les femmes, etc. Si presque tous les grands vedântins sont des brahmanes, on cite parmi les “saints tantriques” des vagabonds, des mendiants, des danseuses, des prostituées, des brigands, des artisans, des rois et même un dalaï-lama…
19. Le livre Aghora de Robert E. Svoboda (éd. du Relié, 1997), dont nous avons rendu compte dans la revue Connaissance des Religions n°57-58-59, fournit à cet égard des informations intéressantes et authentiques, malgré une certaine “mousse” romanesque.
20. Peut-être aussi nous reprochera-t-on d’avoir fait la part trop belle au courant de la “Main gauche” et d’avoir trop amalgamé shivaïsme et shâktisme. Nous n’ignorons pas qu’il existe une tradition shâkta originale, métaphysiquement et opérativement très remarquable (l’école Shrîvidyâ ou Samayâcâra), qui, elle, se veut “védique” et refuse les rites kaula, mais son étude aurait entraîné des développements qui n’avaient pas leur place ici.

 Le Cœur dans le shivaïsme tantrique du Cachemire
Le Cœur dans le shivaïsme tantrique du Cachemire[Ci-contre : yangra, diagramme mystique, équivalent yogique du mandala bouddhiste. Ce yantra honore Kâlî, un aspect de la mère divine, destructrice du temps et de l’égo : derrière sa façade provoquant la crainte, elle est la mère aimante qui protège ses enfants et leur accorde la grâce de la libération]
On sait que, dans les traditions gnostiques de l'Inde (sâmkhya, vedânta, jñâna-yoga), le cœur (hrid ou hridaya) n'est pas associé au sentiment mais à la connaissance ; il n'est point le siège des sensations, émotions ou passions mais celui de l'intellect, au sens guénonien du terme, de cette pure intuition intellectuelle (buddhi ou mati) qui voit directement les choses dans leur lumière véritable sans passer par l'intermédiaire du mental (manas). Bien plus, depuis les plus anciennes upanishads [1], le cœur est considéré comme le centre de l'“âme vivante” individuelle (jîvâtman), identique en son essence au Principe suprême de l'univers (Paramâtman ou Brahman). Notre individualité humaine est à la fois somatique et psychique ou, en termes hindous, grossière et subtile. C'est de tout ce composé — et pas seulement du corps matériel — que le cœur (la “caverne” ou le “sanctuaire”) du cœur est le centre. En tant que viscère musculaire, qu'organe central de l'appareil circulatoire, il semble certes commander et rythmer la vie et, lorsqu'il s'arrête, la vie apparemment s'arrête. Mais il ne s'agit que de la vie d'un corps, de ce corps “fait de nourriture” (annamaya). La vie subtile, elle, peut continuer, se prolonger sous d'autres formes individualisées, existant à nouveau autour d'un centre, donc, symboliquement, d'un “cœur”.
Mais cela n'est pas encore le plus important. Car, au-delà de la Vie — même écrite avec une majuscule —, au-delà des “vies” — même si l'on ne conçoit pas ces dernières comme une suite mécanique et simpliste de “réincarnations” —, ce cœur métaphysique dont nous parlons demeure en tant que Conscience. Or cette Conscience ne naît ni ne meurt, ne croît ni ne décroît, elle n'est pas plus soumise au temps qu'à l'espace, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de cause, pas d'opposé ou de complément, elle EST. Source de vie, le Cœur (n'hésitons pas ici à employer la majuscule) transcende donc la vie. Il est le “Soi” (âtman) le plus intime de l'être, il est l'Être (sat), il est la Conscience (chit) dont l'unique objet, non distinct d'elle-même, est la Béatitude (ânanda). Il connaît toutes choses mais Lui, nul ne Le connaît (comme on connaîtrait un “autre”). Pour Le connaître, il faut être Lui (“Il Se connaît Lui-même par Lui-même”). Cet enseignement, si simple et insondable, est à son tour au “cœur” de toute la Tradition hindoue ; il en constitue l'essentiel, le noyau indestructible. Il n'est même pas exagéré d'affirmer que quiconque l'aurait compris — intellectuellement compris d'abord puis surtout effectivement “réalisé” — pourrait se dispenser d'étudier tout le reste, toutes les autres spéculations, pratiques ou techniques qui ne sont, selon les expressions védantiques, que des “amusements d'enfants” et des “châteaux dans les nuées”.
De quelque façon que l'on considère le tantrisme — comme une réadaptation orthodoxe (et ultime) du Veda à des temps “obscurcis” (kali-yuga) ou comme une révélation divine entièrement nouvelle et autosuffisante qui rend ce même Veda périmé et inutile — une chose est certaine : la doctrine de l'“identité suprême” entre le Soi individuel et le Soi universel, que nous avons vue être au centre de l'enseignement upanishadique, se trouve dans les Agamas et les Tantras maintenue et préservée, tout comme l'importance attribuée au cœur en tant que symbole de l'âtman et “lieu” de l'identification sans retour ou, en un mot, de l'“Éveil” (unmesha, bodha). Ici le lecteur qui connaîtrait principalement le tantrisme par son système des chakra développé dans le hatha-yoga et le kundalîni-yoga — et malheureusement repris et dénaturé aujourd'hui par toutes sortes d'ouvrages médiocres — songerait peut-être au chakra du cœur ou anâhata à douze pétales. Mais il serait victime d'une confusion car ce lotus, où il est dit que doit être tranché le “nœud de Vishnou” (le nœud de la pensée égotique), n'est pas le séjour du Soi [2]. Et d'autre part le “cœur d'éveil” que nous évoquions n'est pas un chakra parmi d'autres, situé dans la hiérarchie classique des chakra entre manipûra ou nâbhi (le nombril) et vishuddha ou kantha (la gorge). Il est cela sans doute mais il peut être beaucoup plus, au point de rendre presque superflue la considération des autres “roues”. Mais, pour le comprendre pleinement, il faut se tourner vers la branche la plus métaphysique du tantrisme hindouiste, à savoir le shivaïsme non dualiste du Cachemire ou Trika [3], — nom générique en fait pour plusieurs écoles florissantes entre les IXe et XIIe siècles.
On rencontre assez fréquemment dans cette tradition les expressions de “Cœur universel”, “Cœur divin” ou “Cœur du Seigneur”. Elles sont en intime relation avec la notion de “vibration” (spanda). L'univers tout entier, en effet, résulte d'un ébranlement originel (en réalité hors du temps), d'un choc, d'une vibration ou pulsation. L'univers “bat” et vibre. Mieux, il est cette pulsation, cette vibration éternelle. Il est le Cœur du Shiva suprême (Paramashiva), encore appelé Bhairava (le Terrible), tattva ou mahâsattvâ (Réalité ultime), svarûpa (essence), shûnyatâ (vacuité), âtman (Soi) : Conscience absolue (chiti, chaitanya, samvid) dont la caractéristique essentielle est la liberté (svâtantrya). Car c'est parce qu'elle est souverainement libre que cette Conscience peut se nier elle-même, se cacher à elle-même, obscurcir son essence lumineuse à l'aide de sa mâya-shakti (énergie d'illusion), se diviser en sujet et objet, “moi” (aham) et “ceci” (idam), apparaître sous la forme d'un monde multiple et changeant, dans lequel elle “jouera” à se perdre (le jeu étant l'expression même de la liberté) et duquel elle aspirera plus tard, Elle que rien ne saurait enchaîner, à se “libérer”. Dans sa réalité foncière, cependant, Paramashiva est immuable, à l'égal du Parabrahman des upanishads. Il est Lumière indifférenciée, indivise, inaltérable, à la fois conscience-lumière (prakâsha), resplendissant de son propre éclat, et conscience-énergie (vimarsha) ou énergie (shakti) qui prend librement conscience d'elle-même dans un frémissement premier, un acte pur et vibrant (spanda), identique au souffle de vie (prâna). Mais il importe plus que tout de comprendre que ces deux consciences, symbolisées dans le tantrisme par un couple divin (yâmala), n'en font qu'une (il n'y a pas plus trace de dualisme que de panthéisme, de créationnisme ou d'évolutionnisme dans cette doctrine). Shiva-Shakti constituent la réalité indissoluble de Paramashiva ou Cœur universel.
Pour rejoindre celui-ci — ce qui est une façon de parler car en vérité il n'y a rien à acquérir, nous sommes déjà ce cœur —, on parle, selon les écoles, de reconnaissance” (pratyabhijñâ) ou d'“élan” (udyama), deux manières assez voisines de souligner le caractère purement intuitif, immédiat et dynamique de ce qui est demandé. Selon la première conception, il suffit, pour recouvrer sa véritable nature, sa “shivaïté”, de “reconnaître” celle-ci dans son cœur par une prise de conscience fulgurante qui ne laisse aucune place à l'alternative et au doute, illumination non progressive, non programmée, possible à chaque instant dans la perception d'un objet quelconque (on “y est” ou on “n'y est pas”, on ne peut pas y être “à moitié”). Selon la seconde formulation, ce qui permet l'identification avec l'Absolu, c'est un “élan”, une adhésion subite et inconditionnelle de la conscience au phénomène, tel qu'il apparaît dans l'instant, sur le vif, sans surimposition. Et là encore cet acte pur, qui est “émerveillement” (chamatkara), ne peut jamais se produire dans le mental, qui n'utilise que du connu [4], mais uniquement dans le cœur, seul apte à saisir le frémissement initial de l'énergie. Mais, pour que cette vérité puisse nous “percuter”, il faut quitter les abstractions et épouser la voie (qui, dans sa forme supérieure, devient une “non-voie”, anupâya), plonger dans la vie brûlante, faite de surprises et d'obstacles. Le tantrisme, en effet, rappelons-le, a peu d'estime pour la spéculation pure et le renoncement ascétique. Il ne dévoile ses secrets que dans une pratique, au sein d'un monde qu'il tient pour “réel” — à la différence du vedânta shankarien — puisque pour lui Shiva est la Totalité, à la fois transcendante et immanente, et que rien, pas même le changement, pas même l'illusion ou l'ignorance n'est extérieur à Shiva [5]. Aussi, dans la voie tantrique, fait-on feu de tout bois. Comme l'écrit Abhinavagupta, le maître le plus éminent du Cachemire, égal en profondeur à Shankara et Nâgârjuna : « Au moment de pénétrer dans la Réalité suprême, on considère comme un moyen tout ce qui se trouve à portée, fût-ce licite ou illicite ; parce que, d'après le Trika, on ne doit alors se soumettre à aucune restriction » [6].
Cet élan du cœur, qui court-circuite toute raison, les docteurs du Trika le comparent encore à la précipitation haletante du père ou de la mère qui bondit pour sauver la vie de son enfant ; ou bien à l'état intérieur de l'homme qui cherche à se souvenir d'un mot oublié : après des efforts répétés et vains, soudain le mot jaillit dans la conscience, “comme un produit direct du cœur”. Intensifiée, canalisée, maîtrisée, cette énergie brute reçoit alors le nom de bhâvanâ. Il s'agit là d'une faculté tantrique essentielle, qu'il est impossible de rendre d'un seul mot. Elle est à la fois imagination créatrice (imaginatio vera, disaient nos alchimistes, et non imaginato phantastica), puissance intuitive, capacité d'évocation sensorielle (concernant les cinq sens et pas seulement la visualisation, comme on le croit souvent), très grande plasticité psychique et sensibilité spirituelle suraiguë, — et son énergie, en tout cas, est telle qu'on la dit apte à “fixer” la pensée (presque encore au sens hermétique), le paradoxe étant que, pour donner sa pleine mesure, elle ne doit s'accompagner d'aucun effort corporel ou mental. Détente parfaite, apaisement, “état naturel” constituent le terrain ou l'arrière-plan sur lequel bhâvanâ peut pleinement se déployer. Et là aussi toute sensation subtile, toute évocation part du cœur et vient s'y résorber. La moindre interférence mentale ou égotique (ce qui est la même chose, le mental n'existant que pour la survie de l'ego) détruirait l'“émerveillement” et nous replongerait dans le monde de la dualité. C'est pourquoi, dans cette voie, vigilance et lucidité sont indispensables, au moins autant que l'“imagination vraie”. En outre il faut préciser que la spontanéité n'est pas le “spontanéisme”, tel que l'entendent certains courants modernes. Il ne s'agit pas ici d'une “mystique sauvage”, quête aveugle et infra-rationnelle de sensations occultes, recherche de transe ou d'extase à tout prix. Être ouvert à la Totalité ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Comme toute voie indienne, le Trika suppose donc une initiation, un climat spirituel, un encadrement, une perspective. Ce qui en lui peut séduire — l'extraordinaire liberté et variété des moyens proposés — ne doit nullement faire oublier son exigence et son caractère irréductible à toute vulgarisation. Pour y entrer, pour ne pas s'y perdre, on doit avoir une “vocation”, une prédisposition “héroïque” ou “divine”. Élitisme il y a bien, même s'il ne s'établit pas sur des critères de race, de caste, de sexe, de morale conventionnelle ou de savoir livresque. Là encore le choix se fera par le cœur et la transmission s'opérera “de cœur à cœur” [7].
Comment épanouir le cœur, comment d'abord y pénétrer ? Si le cœur est vraiment la porte et la clé, l'ouverture et la voie, “l'accès au sans-accès” selon l'expression shivaïte, existe-t-il des moyens — autres que la simple foi, l'élan, la ferveur — pour transmuer cette certitude théorique en expérience vivante ? Abhinavagupta répond : « Il faut que le sage pénètre dans son cœur au moment où son énergie est fortement stimulée ; quand il s'absorbe dans la pure énergie subjective ; quand il accède à l'extrémité de toutes les nâdî ; lorsque l'énergie se rétracte dans le Soi universel ou encore s'épanouit (en s'intégrant) à tout l'univers ». Ces propos fort elliptiques appellent quelques commentaires et surtout quelques exemples que nous emprunterons en grande partie à l'un des Tantras les plus vénérés du Cachemire : le Vijñâna-Bhairava [8].
Le premier de ces cinq moyens fait allusion à l'“effervescence de l'énergie” (shaktishobha), au choc vibratoire que peut susciter, chez un être de sensibilité affinée et doué également de vîrya (puissance virile concentrée, vitalité profonde et mûre) une impression sensorielle quelconque : son, cri, chant, image, couleur, forme belle, toucher, saveur, odeur, et aussi souvenir, évocation voluptueuse. Tout plaisir sensuel en effet renvoie à l'énergie divine de félicité (ânandashakti) ou “pointe” vers elle (ou en est un reflet si l'on voit les choses en sens inverse) car tout désir profondément est désir du Soi dans sa plénitude. La jouissance, qu'elle soit esthétique ou amoureuse, est donc par nature unifiante, elle abolit ou suspend la dualité entre sujet et objet. Mais alors que le profane ne vit généralement ces moments que dans une saisie avide ou bien comme une compensation à un mal-être — une lueur brève dans une existence terne —, le yogî s'y établit avec une sorte de fraîcheur lucide jusqu'à y retrouver la “saveur” (rasa) de sa vraie nature. Il assiste en lui-même au déploiement et à la résorption de l'énergie, il “retourne”, pour ainsi dire, l'énergie en conscience, il épouse si bien le mouvement passionnel ou émotionnel qu'il s'en rend maître et s'en détache. Telle est la signification profonde des rites secrets de la “Main gauche” (sur lesquels on a dit tant de bêtises), et le fait que, même en Inde, ils aient pu être déformés ou détournés — et cela bien avant notre époque — n'y change rien. Ces moyens prohibés par l'orthodoxie brahmanique — l'alcool, la consommation de viande, l'union sexuelle avec une “messagère” (dûtî) ou une yoginî — ne sauraient “libérer” que des êtres déjà libres d'égoïsme, d'avidité, d'attachement. Pour les autres ils ne seront que ténèbres sur ténèbres, poisons sur poisons. En ce qui concerne l'énergie sexuelle en particulier, il est clair qu'elle n'est spirituellement opérative que si elle coïncide avec la force ascensionnelle de la Kundalinî. C'est à l'intérieur du “canal médian” (madhyanâdî) que les amants doivent éprouver l'afflux de félicité (ânandasamplava) et cela, précisent certaines écoles, de façon “simultanée” (sâmarasya, “saveur commune”). Et c'est dans le rayonnement du cœur que doit se produire la transmutation de la semence chez l'homme et du “sang” chez la femme, fusion du “blanc” et du “rouge” qui constitue, avec la maîtrise du souffle et la mise à mort du mental, un des “trois joyaux” tantriques (triratna).
Cette pratique n'a de toute façon aucun caractère contraignant ni obsessionnel, elle n'a été recommandée — et parfois pour un temps limité — qu'à certains hommes ou femmes doués d'un tempérament approprié. Pour susciter l'émerveillement, pour plonger dans le cœur vibrant (sahridaya), les maîtres du Cachemire nous suggèrent ce moyen mais aussi, comme sur le même plan, beaucoup d'autres. Écoutons Somânanda, fondateur de l'école Pratyabhijñâ :
« On perçoit le premier ébranlement de la volonté dans la région du cœur au moment où l'on se souvient de quelque chose qu'on doit accomplir (mais qu'on avait oublié) ; à l'instant précis où l'on apprend une nouvelle qui cause un grand bonheur ; lorsqu'on éprouve une peur inattendue ; quand on perçoit de façon imprévue une chose que l'on n'avait jamais vue ; à l'occasion de l'épanchement du sperme ou lorsqu'on en parle ; et aussi quand on récite (un texte) d'une façon très précipitée ou lors d'une course (échevelée). Dans ces multiples circonstances, toutes les énergies de la conscience sont frémissantes (vilolatâ) et elles sont brassées les unes avec les autres en un seul acte vibrant » [9].
Ainsi toutes les émotions fortuites de la vie (joie, surprise, appréhension, frayeur, affolement, déception, vexation, frustration, curiosité, colère, faim, soif, vertige et même éternuement…) peuvent-elles être positivement exploitées et réorientées, du moins quand elles atteignent un certain paroxysme, une certaine intensité vibratoire et surtout quand elles sont “dénudées” — pour reprendre le vocabulaire évolien —, c'est-à-dire dépouillées de toute surimposition morale (justification, condamnation, bien, mal), non nommées, non conceptualisées, vécues comme de pures énergies divines (ou parfois démoniaques, si on les refuse ou si on ne peut les intégrer). À l'instant précis de son surgissement, toute émotion ou passion, toute tendance psychique est “pure”, unique, indifférenciée ; la conscience la pénètre totalement, la dualité n'existe pas. L'erreur et le danger ne naissent que quand le “Je”, d'abord un avec l'expérience, s'en distingue (ce qui va très vite), se pense et se pose comme sujet, agent, expérimentateur : je suis furieux, je suis triste, je suis joyeux, etc. Plus le mouvement émotionnel est fort, plus l'ego d'ailleurs est lent à se reconstituer. Il est “débordé” et privé de ses repères. Cet instant de désarroi peut être une chance spirituelle. Le silence, le vide, la dépossession remplacent le tumulte et, n'ayant plus rien à saisir ni à quoi se raccrocher, l'être à bout de ressources peut enfin se trouver face à face avec sa véritable nature, “roi nu”. C'est là, plus que jamais, qu'il doit s'enfoncer dans la vacuité de son cœur et réaliser ce vide non comme un néant, non comme une halte provisoire ou un refuge consolateur mais comme son essence originelle et intemporelle, — ce qu'Abhinavagupta appelait plus haut “s'absorber (ou se résorber) dans la pure énergie subjective (entendons du Sujet transpsychologique)”. C'est alors la “Reconnaissance”, comme de retrouver (mais d'une manière inattendue) un être cher après une longue séparation.
La plupart des moyens d'éveil que nous venons de parcourir sont en quelque sorte fournis par la vie et l'on ne peut guère les provoquer, on peut seulement les accueillir et les transformer lorsqu'ils surgissent. S'ils ont la faveur des shivaïtes, c'est précisément en raison de ce caractère non fabriqué, non mental, non prévisible. En revanche il est d'autres procédés qui relèvent davantage d'une méthode, d'un yoga : yoga différent du râja-yoga de Patañjali sans doute, lequel repose sur un certain fond “dualiste” (le sâmkhya) et sur l'idée d'“union” (étrangère au monisme pur où il n'y a rien à unir) ; différente aussi du hatha-yoga de l'école Nâth, qui est à la fois volontariste, gradualiste et “violente”, trois qualificatifs qu'on ne peut guère appliquer au Trika [10] ; mais yoga tout de même, qui ne croit guère aux “exercices”, aux disciplines, aux refrènements, mais suit son propre chemin, libre et insaisissable pour atteindre l'Éveil. La connaissance approfondie des chakra, des nâdi, autrement dit du corps énergétique, fait partie de cette tradition, même si la description qu'elle en donne diffère parfois de celle des écoles mieux connues en Occident. Ainsi le terme chakra (on en distingue essentiellement cinq) y garde-t-il son sens plein de “roues” tournoyantes et vibrantes [11] ; les nâdi — dans la même perspective dynamique — n'y sont pas des conduits statiques et pour chacun identiques par lesquels les souffles circuleraient mais des “courants”, des “flux” que l'on doit apprendre à capter, à vivifier, à dilater ou à apaiser, notamment à partir du cœur. Le déplacement de ces énergies très subtiles est volontiers décrit comme un fourmillement et le Vijñâna-Bhairava (66) fait même allusion à des techniques d'effleurement ou de “chatouillement” des aisselles ou d'autres endroits particulièrement sensibles pour susciter l'épanouissement de la conscience [12]. Quant au cœur, lorsqu'il n'est pas visualisé comme une roue rayonnante à douze rayons, il est décrit comme une cassette ronde et creuse, faite de deux lotus entrelacés : le lotus supérieur, d'après un commentaire, figure la connaissance et le lotus inférieur, l'objet connu ; entre eux, dans le vide intermédiaire (madhya), réside le sujet connaissant (V.B. 49).
On exalte encore (avec des termes tels que kha, hridâkâsha, vyoman, antarvyoman, paravyoman) l'“espace du cœur”, l'“éther du cœur”, la “voûte” ou le “firmament du cœur”. Ces expressions valent plus par leur puissance évocatoire que par leur rigueur doctrinale. Ils renvoient à la double notion connexe de “milieu” et de “vacuité” (le moyeu vide de la roue qui fait tourner la roue : c'est d'ailleurs un des sens du mot kha) et l'on pourrait certes se demander, en bonne orthodoxie védantique, ce que signifie vraiment un “espace vide” (un “contenant sans contenu”, comme s'interrogeait Guénon). Il faut spécifier d'autre part que la “vacuité” dans la doctrine Trika est différente de celle que l'on rencontre dans les textes Mâdhyamika (bien que des influences réciproques ne soient pas exclues et que, sur un plan opératif, le tantrisme hindouiste et le tantrisme bouddhiste offrent de grandes similitudes). Il ne s'agit pas ici d'évacuer l'être, le Soi (qui pour les Hindous reste indestructible, irremplaçable car il se confond avec la Conscience même), mais de vider cet être, si l'on peut dire, de tout ce qui serait “objectif” (mental ou matériel, nom-et-forme), de le “désobjectiver” [13]. Cela relève d'un art. Évoquer (au moyen de bhâvanâ) la vacuité dans n'importe quelle partie du corps, de manière instantanée et éblouissante ; ou bien étendre cette vacuité à l'“objet corps” tout entier ; méditer sur celui-ci comme s'il ne contenait rien à l'intérieur, la peau n'étant qu'un “mur”, une pellicule diaphane entre deux vides, etc. : tout cela, dans une certaine mesure, s'apprend mais se heurtera souvent à des résistances insoupçonnées. L'individu n'accepte pas facilement de quitter la prison qu'il s'est lui-même construite. C'est une chose que de jouer philosophiquement avec l'idée de vacuité et c'en est une autre que de la réaliser directement dans son corps et dans son mental, jusqu'à n'être plus qu'une forme vide, une énergie sans contours, sans limites, rayonnante et vibrante [14].
Relèvent d'un art également les pratiques de souffle lorsqu'elles sont intériorisées et non pas réduites à une simple jonglerie respiratoire en vue d'obtenir des “pouvoirs”. Le souffle expiré (prâna dans cette tradition) part du cœur et va mourir dans un “point” situé à douze largeurs de doigt du bout du nez (le “dvâdashânta externe”) ; depuis ce point, avec l'inspiration (apâna), le souffle revient se reposer dans le cœur : c'est là le stade élémentaire de la méthode qui, cependant, poursuivi avec sérieux, apporte déjà l'équilibre et la quiétude. Dans un stade ultérieur et supérieur, le souffle sera verticalisé, conduit depuis le cœur, en bas, jusqu'à la couronne de la tête, en haut (le “dvâdashânta interne”), l'expiration étant toujours conçue comme la force ascendante et l'inspiration comme la force descendante. Dans ce transfert (d'ailleurs spontané) de l'horizontalité à la verticalité, de l'“amplitude” à l'“exaltation”, on serait tenté de voir ce que d'autres traditions ont appelé le passage des “petits mystères” aux “Grands Mystères” — et l'on ne peut ici que rendre hommage aux lumineuses intuitions de René Guénon. Si la conquête du cœur exprime le retour à l'“état primordial” ou édénique, si elle équivaut à la réintégration du centre de l'être humain où se reflète le Centre suprême, alors on est obligé d'admettre que cet état, pour élevé et merveilleux qu'il soit, ne représente qu'une étape avant les “cieux” supraformels que symbolisent les chakra supérieurs et enfin la véritable transcendance ou “Délivrance” (moksha) que marque la traversée de la fontanelle. Dans le kundalinî-yoga “classique” — si cette expression a un sens — c'est bien ainsi qu'on doit envisager les choses. Mais dans le Trika il faudrait y regarder plus avant, car cette tradition n'établit pas une hiérarchie aussi nette entre les centres et n'envisage pas la progression de l'un à l'autre d'une manière aussi systématique. Pour elle l'énergie est partout — comme la conscience — et elle peut être épanouie à partir de n'importe quel chakra. S'il est recommandé de l'éveiller à partir du cœur, c'est surtout parce que ce centre, par sa nature “vide” et médiane, possède un pouvoir spontanément unifiant qui se transmet sans effort à tous les autres [15]. Mais, même si l'on situe Shakti dans le cœur et Shiva dans la fontanelle (ou l'inverse qui se rencontre aussi), cela n'implique jamais un rapport de subordination puisque Shakti est Shiva et Shiva est Shakti [16].
Nous avons parlé du mouvement des souffles. Il serait plus juste au fond de parler des intervalles. C'est en effet dans ceux-ci que l'Éveil perce, jaillit et resplendit, tandis que le mouvement, l'alternance nous maintiennent toujours dans la dualité. Intervalles donc entre les souffles (ce qu'exprime mal le mot de “rétention”) mais aussi entre les pensées, les perceptions, les désirs et même les objets matériels (tout ce qui est faille, ouverture, interstice). On tient pour très important, lorsqu'un mouvement psychique s'arrête (de lui-même, par épuisement) de ne point se précipiter mécaniquement dans un autre mouvement, une autre activité, une autre idéation mais de demeurer dans ce repos, sans attente et sans projection. La vacuité alors expérimentée recèle une incommensurable énergie, une potentialité d'éveil, à la condition toujours de ne pas s'identifier à elle car, dans la perspective tantrique, répétons-le, le vide n'est pas ultime : c'est encore un objet, donc un obstacle, tant qu'il s'oppose à un sujet qui le perçoit comme “vide” et se perçoit lui-même comme “étant vide”. Autrement dit, il faut être capable de réaliser le vide lui-même comme vide. Alors ce “vide-de-vide” (expression que l'on trouve aussi dans la spéculation mahâyânique) peut “basculer” et se résorber dans la Plénitude (entendue ici non comme le “contraire” du vide mais comme Paramashiva, le sans-limite, la Totalité, la négation de toute négation, donc l'absolue Positivité).
Intervalles enfin entre les états de conscience et d'abord les deux que connaît l'individu en tant que tel : entre l'état de veille et l'état de rêve, dans l'endormissement, ce passage insaisissable pour l'homme ordinaire entre le monde des objets sensibles et le monde des objets mentaux. C'est alors qu'il faudrait placer sa conscience dans son cœur (nous voulons dire la placer activement car, de fait, ce transfert se produit de lui-même dans le sommeil), afin d'obtenir la “maîtrise des rêves”, c'est-à-dire la capacité de passer de l'état passif et hallucinatoire du rêve habituel, chargé des résidus de l'état de veille, à l'état, pleinement conscient et spirituellement dirigé, du rêve lucide (V.B. 55). L'autre passage, celui du sommeil au réveil, ne devrait pas moins retenir l'attention. De la même façon que Shiva produit — ou en termes judéo-chrétiens “crée” — l'univers en ouvrant les yeux et le résorbe en les fermant, chaque individu crée chaque matin son propre monde en s'éveillant et le résorbe en s'endormant. Le monde en effet n'existe pas indépendamment de la conscience. L'objet apparaît avec le sujet, s'évanouit avec lui. Veillant, rêvant, dormant sans rêve, nous passons d'un monde (c'est-à-dire d'un état de conscience) à l'autre, aucun n'étant ni plus ni moins “réel” que l'autre. Du point de vue ultime, l'univers n'a jamais commencé et ne finira jamais pour la simple raison que le temps continu n'existe pas, pas plus que le passé (simple phénomène de mémoire), le futur (simple projection de la mémoire) ni même le présent (qui, sitôt pensé, est déjà passé). Il n'y a que des instants toujours “actuels” dès que la conscience s'en saisit et il n'existe nulle part d'entité, de substance appelée “Temps” qui relierait ces instants entre eux. L'instant, en vérité, n'est que la “durée d'un acte de conscience” [17]. Seule cette conscience “mesure”, supporte les choses et leur prête une réalité. Le yogî, qui ne croit pas au Temps, sait en revanche se glisser dans le vide interstitiel qui sépare les instants successifs, il les disjoint, les disloque, pour rejoindre le Cœur, l'instant-choc, l'instant éternel.
Au terme de ce voyage au centre du Soi, dont nous n'avons esquissé que quelques aspects, le pèlerin, devenu “roi des yogîs” (yogîndra), aura acquis, sans vraiment le chercher, le double pouvoir de Shiva : celui de rétracter le monde en un seul point (samâdhi aux yeux clos : nimîlaramâdhi) et celui de le manifester, dans une libre et totale expansion des sens (samâdhi aux yeux grands ouverts : unmîlanasamâdhi). Dès lors, que lui resterait-il à accomplir ? Libéré de tout, il est libre pour tout. Rien ne lui est extérieur. Il perçoit tout en lui-même comme son propre Soi et son corps limité est devenu le corps cosmique de Bhairava, la “Merveille cosmique” (vapus). Un avec la Shakti, indiscernable d'elle, “Il Se connaît Lui-même par Elle-même”. Vis-à-vis des “autres” — qu'il ne voit plus comme réellement séparés de lui — il n'est que grâce, amour, ruissellement de dons et de faveurs. S'il n'est pas encore devenu un “délivré vivant” (jîvan-mukta), la mort, qui n'est jamais elle aussi qu'un intervalle, lui donnera l'occasion de se fondre enfin dans le Cœur de Shiva, le Très-Bénéfique.
► Pierre Feuga, Connaissance des religions n°57/59, 1999.
[1] « Quel est donc ce Soi (âtman) ? — C'est cet Être infini (purusha) qui s'identifie avec l'intellect et qui réside au milieu des organes — c'est cette Lumière qui brille au-dedans du cœur » (Brihad-âranyaka-up., IV, III, 7). « Dans ce séjour de Brahman est un petit lotus, une demeure dans laquelle est une petite cavité occupée par l'Éther (âkâsha) ; on doit rechercher Ce qui est dans ce lieu et on Le connaîtra » (Chândogya-up., VIII, I, 1). « Brahman est réalité, connaissance, infinitude. Celui qui sait qu'il est caché dans le creux (du cœur) et au suprême firmament, il réalise tous ses désirs avec le sage Brahman » (Taittirîya-up., II, 1). Pour ce qui est des upanishads plus récentes, on pourrait multiplier des citations analogues.
[2] Celui-ci est figuré par un lotus à huit pétales en dessous du péricarpe de l'anâhata. Cf. le Satcakranirûpana dans la trad. de Michaël Tara : Corps subtil et corps causal (Courrier du Livre, 1979, p. 118-119). C'est sur ce lotus rouge dont la corolle est tournée vers le haut que l'adoration mentale (mânasa-pûjâ) de la divinité d'élection (ishta-devatâ) doit être pratiquée. C'est aussi là que se trouve le “passage” par lequel l'âme du sage s'échappe au moment de la mort.
[3] Trika signifie “triade”, ce qui peut être interprété à différents niveaux : soit la conscience (Shiva), l'énergie (Shakti) et l'individu limité (qui d'ailleurs ne font qu'un) ; soit les trois voies de retour vers l'Absolu qui leur correspondent (voie divine, voie de l'énergie, voie de l'individu) et qu'étudie spécialement l'école Spanda (ou Trika au sens étroit du terme) ; soit encore les trois énergies de Shiva (son “trident”) : volonté, connaissance, activité. Autres triades implicites : sujet connaissant, connaissance, objet connu ; Agama, Spanda, Pratyabhijñâ (les trois sources textuelles ou shâstra que reconnaissent les shivaïtes du Cachemire). Notons enfin que le mantra suprême de ceux-ci, AHAM (le Je universel correspondant au HÛM tibétain), est composé de trois éléments : A + HA + M. A et HA sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet sanskrit, ils symbolisent Shiva et Shakti. M symbolise l'individu. Toutes les lettres comprises entre A et HA représentent les différentes puissances cosmiques présidant à la manifestation, les mâtrikâ.
[4] Le mental est composé de quatre facultés principales : raison, mémoire, volition et imagination (passive, à distinguer de bhâvanâ). Par aucune de ces quatre facultés, ni par leur conjugaison, il n'est possible d'atteindre l'Éveil. Mais, une fois l'Éveil obtenu, on “réalise” que le mental aussi est dans Shiva puisque tout, absolument tout est dans la Conscience. Dès lors la pensée est perçue comme une forme, une manifestation de la Conscience, et elle cesse d'être une entrave. Il faut noter d'ailleurs que la “mise à mort du manas dans le cœur” (qui est un des “trois joyaux” tantriques) n'implique pas la cessation définitive de toute activité mentale. Ce qui est brisé, “tué”, c'est la relation entre l'ego et la pensée. Il reste une pensée mais il n'y a plus de “penseur”.
[5] La principale différence peut-être entre les deux “non-dualismes”, celui du vedânta et celui du Trika, tient à la conception de la liberté. Le vedântin pense essentiellement à “se libérer”, à être “libre de” (en anglais freedom from) et il met pour cela l'accent sur la renonciation, l'élimination, l'isolement. L'approche du Cachemire est, elle, englobante, elle n'exclut rien. C'est être “libre de” mais en un sens positif : “libre de faire” (freedom to). Pour une comparaison approfondie entre les deux doctrines, nous conseillons un excellent livre écrit par un Indien, L. N. Sharma : Kashmir Saivism, éd. Bharatiya Vidya Prakashan, 1972.
[6] Tantrâloka IV, 273-275. Trad. Lilian Silburn.
[7] On présente trop souvent le tantrisme sous un aspect “froid” et “dur”, en raison des excès (réels ou imaginés) de certaines sectes. Pourtant Abhinavagupta, que l'on ne peut guère soupçonner de sentimentalisme, écrit : « L'initiation doit être donnée sans hésiter à ceux qui ont reçu la grâce (shaktipâta) et sont pleins de pitié (kripâ) et d'amour universel (maitri) » (Tantrâloka XXIII, 22-23). Le Vijñâna-Bhairava, de son côté, cite comme des disqualifications rédhibitoires la méchanceté et la dureté de cœur (158).
[8] Ce texte a été pour la première fois traduit en français et commenté magistralement par Lilian Silburn, à laquelle on doit plusieurs autres travaux remarquables sur le shivaïsme du Cachemire (Publications de l'Institut de civilisation indienne, fasc. 15, éd. E. de Boccard, Paris, 1961). J'ai proposé aussi une traduction commentée du Vijñâna-Bhairava (Cent douze méditations tantriques, éd. l'Originel, Paris, 1988).
[9] Traduit et cité par Lilian Silburn dans sa préface au Vijñâna-Bhairava, op. cit., p. 39-40.
[10] Les valeurs de grâce et d'abandon sont beaucoup plus développées dans le Trika (et le shivaïsme en général) que dans les formes de yoga précitées (au Cachemire bhakti et tantrisme n'ont pas été contradictoires). Pour ce qui est du gradualisme, on le trouve dans l'école Krama mais souvent, dans les autres courants, la coloration “subitiste” domine. Quant à la “violence” enfin, même lorsqu'on croit la déceler dans certaines pratiques du Trika (par ex. dans le V.B. 93), elle ne ressemble en rien à l'effort systématique et extrême du hatha-yogin sur soi-même : la douleur qu'on s'inflige est utilisée dans un but d'“ouverture”, non de domination des sens.
[11] Le cosmos lui-même est une Roue immense, homogène et parfaite, dont le moyeu est la Conscience divine, Cœur universel. Cette doctrine est surtout développée dans l'école Krama.
[12] Pour comprendre l'affinité entre la sensibilité tactile et le cœur, il faut se référer au système de correspondances entre les éléments (bhûta), les facultés et organes de sensation (indriya) et les chakra. Le cœur correspond à l'Air, au toucher et à la peau (ainsi qu'à la faculté de jouissance et au sexe, si l'on suit le Satcakranirûpana, mais ce point de vue n'est pas commun à toutes les écoles).
[13] « La vacuité est la Conscience qui, réfléchissant sur elle-même, se perçoit comme distincte de toute l'objectivité en se disant : “je ne suis pas cela (neti, neti)”. Tel est l'état le plus élevé auquel accèdent les yogin » (Tantrâloka VI, 10). On voit donc que, si les Hindous ne renoncent jamais au Soi, ils ne le conçoivent pas non plus comme une limite. Le Soi est à la fois être et non-être, et par-delà être et non-être, par-delà plénitude et vacuité.
[14] La meilleure approche contemporaine de cette voie fut donnée par Jean Klein, un des très rares Occidentaux à avoir reçu en Inde la double tradition de l'advaita-vedânta et de l'ancien yoga du Cachemire.
[15] L'épanouissement de l'énergie dans le cœur peut néanmoins s'accompagner de tremblements incontrôlables, de larmes, etc., réactions parfois dues à des résidus non consumés d'existences antérieures.
[16] Selon un jeu de mots célèbre, Shiva sans Shakti (symbolisée par la lettre I) est unshava (“cadavre”). Quant à Shakti sans Shiva, elle ne serait que destruction pure, aveugle (Kâlî à la fin du cycle cosmique).
[17] Abhinavagupta, Tantrasâra, 60.
***
♦ Pour prolonger :
Du néo-shivaïsme du cachemire (Amandine G., 2020)

Petit dossier pédagogique
Exemple de réception du tantrisme : Julius Evola
[Ci-contre : Les serpents, symboles de l'énergie cosmique, enroulés autour d'un linga invisible (organe mâle), Basohli, vers 1700]
Lorsque l’on dit d’Evola qu’il est un penseur traditionaliste, on entend marquer qu’il ordonne sa pensée à un ensemble de principes métaphysiques ayant valeur normative, dont l’expression, qui peut certes varier selon les lieux et les circonstances, reste permanente, puisque les principes sont, par définition, immuables. Dans une telle perspective, et compte-tenu des conditions propres au monde moderne, la tâche du philosophe est donc de reconnaître ces principes afin de re-valoriser au sens propre du terme la destinée humaine tant au plan de l’individu qu’à celui de la Cité. De ce point de vue, on est en droit de comparer la démarche intellectuelle de Julius Evola à celle dont René Guénon fut le représentant privilégié, en France, entre 1920 et 1950. Le parallélisme des œuvres de ces deux maîtres est particulièrement frappant : à La Crise du monde moderne de l’un répond la Révolte contre le monde moderne de l’autre (1934), aux livres de critique du néo-spiritualisme contemporain du Français (L’Erreur spirite ; Le Théosophisme, histoire d’une pseudo-religion, etc.) correspond l’ouvrage de l’Italien sur les Masques et visages du spiritualisme contemporain (1932) ; on pourrait multiplier les exemples, l’un et l’autre s’intéressant aux mêmes facettes de la Tradition : l’hermétisme, par exemple, ou le mythe du Graal (Evola : La Tradition hermétique, 1931 ; Le Mystère du Graal, 1937).
Et s’il advenait un jour que fussent éditées les œuvres complètes de ces deux seigneurs de la pensée, on verrait à quel point elles représentent les deux visages d’un seul et même mouvement : celui qui tend à rappeler à nos contemporains qu’il existe une autre philosophie que celle qui occupe le devant de la scène depuis quelques décennies, une autre vue du monde que celle qui tend à prévaloir en théorie et en pratique à peu près partout aujourd’hui… Deux visages cependant, non pas un seul, dont les discours se distinguent, bien que soumis à la même inspiration. Bien entendu, il y a d’abord les différences de tempéraments et la disparité des origines sociales ; plus encore, l’appartenance à des aires culturelles distinctes et la vie quotidienne dans des pays où la vie politique n’était pas la même. Au regard impassible du Français, à son attitude purement intellectuelle, s’oppose le dynamisme de l’Italien, tourné vers l’action : n’est-il pas symptomatique que, traitant exactement du même sujet, le premier parle de crise du monde moderne, tandis que le second prône la révolte contre ce même univers ? Assumant l’un et l’autre la même fonction de témoins de la Tradition, l’un se retirera en Égypte, comme pour établir une distance nécessaire à la sérénité de son œuvre doctrinale, cependant que l’autre subira dans sa chair même les conséquences du désordre contemporain.
Que ces deux comportements aient été lucidement acceptés, sinon choisis par les deux hommes, cela se marque à l’évidence dans leurs approches respectives de la spiritualité hindoue. L’étude de la Tradition universelle requiert en effet, pour être complète, une réflexion sur ses formes orientales et notamment sur celle qui s’exprime de diverses façons en Inde : non seulement ce que l’on pourrait appeler l’idéologie védique, dont Georges Dumézil a montré l’harmonie avec celle qui sous-tend l’Antiquité classique, mais également ses dérivés naturels : le bouddhisme des origines et l’hindouisme classique. À l’une et l’autre de ces deux dernières formes, Evola a consacré des livres remarquables : La Doctrine de l’éveil (1943) au premier, Le Yoga tantrique (1949) au second ; tout comme Guénon écrivit une Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues et un ouvrage sur L’homme et son devenir selon le Vedânta. Or le choix de ces deux directions de recherche, le Vedânta d’une part, le tantrisme de l’autre, est hautement significatif, la première étant purement spéculative, la seconde avant tout pratique. Que l’on ne se méprenne pas à ce sujet : l’Inde ignore, comme le font tous les courants traditionnels authentiques, le divorce entre theoria et praxis, le geste pour elle ne va pas sans parole, et quand elle dit l’action elle entend, indissolublement liés, à la fois l’acte et la pensée. Avec Goethe (Faust, première partie) elle dirait volontiers : im Anfang war die Tat (au commencement était l’Action), car elle ne saurait imaginer d’action digne de ce nom qui ne serait en même temps une réflexion sur ses principes et une vision de ses conséquences ultimes. Mais il reste vrai que dans l’éventail des familles spirituelles authentiquement hindoues, les unes s’orientent plutôt vers ce que l’on pourrait appeler “l’action contemplative” (et ce serait, entre autres, le Védânta), cependant que d’autres recherchent par priorité la réalisation pratique (en sanskrit : sâdhana), comme le fait notamment le tantrisme.
Il est vrai, et Julius Evola le souligne dans son livre (Le Yoga tantrique, p. 284), que l’Occident a surtout connu de l’Inde traditionnelle ce Védânta métaphysique, en lequel certains milieux se sont complus à reconnaître « une civilisation qui se serait développée essentiellement sous le signe de la contemplation et du renoncement au monde ». Mais c’est sans doute parce que les œuvres maîtresses de cette école ont été les premières traduites en diverses langues européennes et ont suscité l’enthousiasme de plusieurs philosophes occidentaux, de Schopenhauer à Jaspers. Guénon même a contribué à cette équivoque en présentant plus ou moins le Védânta « comme la quintessence et l’expression la plus pure de la pensée et de la métaphysique hindoue » (Evola, ibid.), à coup sûr parce que lui-même inclinait, de nature, à la pure intellectualité. Evola, au contraire, qui restait fidèle à Nietzsche (L’homme en tant que puissance, 1925 ; Théorie de l’individualisme absolu, 1927 ; Phénoménologie de l’individualisme absolu, 1930), souhaitait montrer que la tradition indienne, dans la mesure même où elle était complète et authentique, ne pouvait avoir négligé l’action. Il va sans dire que cette dernière, tout comme celle sur laquelle médite Faust, ne peut être que “magique”, c’est-à-dire mettant en œuvre toutes les forces latentes de l’univers, tant dans le macrocosme que dans le microcosme humain. Là encore, Evola restait fidèle à lui-même puisque son premier livre “philosophique” fut un recueil d’essais Sur l’idéalisme magique (1925), très tôt suivi d’une Introduction à la magie en trois volumes (1927-1929). Et bien entendu, la magie est dangereuse : son aspect “luciférien” peut entraîner la chute — c’est-à-dire en l’occurrence l’échec, non la faute : mais l’homme d’action ne refuse pas le danger, il le recherche pour le surmonter, le vaincre. Faust, à la fin de la seconde partie, ne l’emporte-t-il pas sur Méphistophélès, par l’action même et malgré les pièges que lui tend son compagnon ? Ainsi en est-il des pratiques tantriques, non moins équivoques dans leurs manifestations immédiates (magie sexuelle, égoïsme apparent de l’adepte qui tend à la surhumanité, etc.), mais dont les initiés savent qu’elles sont ordonnées à la recherche d’un bien supérieur, tout comme la geste guerrière des chevaliers du Graal est une Quête spirituelle “camouflée” en roman héroïque. Par là le tantrisme s’oppose à certaines dégénérescences du spiritualisme hindou qui, comme souvent d’ailleurs, a tendu à se couper du monde, à se réfugier dans une dévotion sentimentale, ou un ritualisme dévoyé qui oublie son objet pour se complaire en lui-même :
« Le tantrisme réagit (…) contre le ritualisme stéréotypé et vide, contre la spéculation ou la contemplation pure et contre tout ascétisme de caractère unilatéral, fait de mortifications, de pénitences. (…) À la voie de la contemplation, il oppose celle de l’action, de la réalisation pratique, de l’expérience directe. La pratique — sâdhana — c’est là son mot d’ordre (…) et nous pouvons trouver là une ressemblance avec la position qui fut adoptée dès l’origine par le bouddhisme, par la doctrine de l’éveil, dans sa réaction au même brahmanisme dégénéré et son aversion pour les spéculations et le ritualisme vide » (Le Yoga tantrique, p. 13).
Cette pratique (sâdhana) dont parle Evola, c’est avant tout la reconnaissance vécue de la Puissance à l’œuvre dans Je monde, sa réalisation dans l’individu (notamment par le yoga), enfin son utilisation dans les conditions propres au monde où nous vivons. Cette Puissance, cette Énergie cosmique, le tantrisme y reconnaît l’Éternel féminin qu’il vénère comme une déesse, la Déesse en tant que telle, à la fois immanente (parce que partout présente dans l’univers, y compris en nous-mêmes) et transcendante (parce qu‘identique au Principe de toutes choses). Il l’appelle Shakti, c’est-à-dire Puissance, et c’est pourquoi on dit parfois shâktisme au lieu de tantrisme, les deux mots étant absolument équivalents : « Le nom de la déesse Shakti, d’après la racine shak (être capable de faire, avoir la force de faire, d‘agir) veut dire “Puissance”. Il s’ensuit, sur le plan spéculatif, qu‘une conception du monde qui voit dans la Shakti le Principe suprême est aussi une conception du monde en tant que puissance » (ibid., p. 17). Reconnaître la présence d’une force active dans le monde, savoir que cette force est une déesse et vénérer en elle l’Absolu, va plus loin qu‘il n’y paraît au premier abord. En effet, comme le dit Evola, en professant cette doctrine, « on enlève, en même temps, à ce monde tous les caractères d’apparence pure, d’illusion ou de mirage — de mâyâ — qui lui étaient attribués dans le Védânta. Le monde n’est pas mâyâ mais puissance » (ibid., p. 16). Et parce qu’il est puissance, ajouterons-nous, il est devenir perpétuel, agir permanent. Regrettons en passant, qu’Evola n’ait pas souligné, ici, que la contradiction apparente (mais vraie, au plan immédiat) entre Védânta et tantrisme se résoud aisément sur le plan métaphysique où le monde, parce qu’il n’est pas l’Absolu, peut être tenu pour un pur néant ; il existe cependant (il est existence, non essence) puisque la shakti y est à l’œuvre ; mais n’est-il pas significatif que le mot sanskrit mâyâ veuille dire à la fois “magie” et “illusion” ? Magie : force effective, puissance efficace, action déterminante, mais en même temps, et par la force des choses, contingence, phénomènes, existence si l’on fait référence à l’Absolu.
Que la mâyâ-shakti puisse cependant, et à bon droit, être reconnue par les tantristes comme une manifestation de l’Absolu, c’est façon de montrer que l’univers doit son existence à l’union d’un couple cosmique que l’Occident appelait la Nature et l’Esprit (en sanskrit : Prakriti et Purusha). Mais le second est impassible, non-agissant, cependant que la première (la Déesse, la Shakti, la Mâyâ) s’active et déploie les prestiges de la Vie et du Devenir. Et, puisque le microcosme humain ne peut être que le reflet du macrocosme divin, on doit retrouver en lui ces deux aspects de la réalité absolue : l’animus et l’anima (en sanskrit : âtman et kundalinî) de chaque individu, et la dichotomie mâlefemelle caractéristique de l’espèce. Ainsi tout le programme du tantrisme sera-t-il d’assumer pleinement (consciemment, en parfaite lucidité) cette particularité de notre existence afin de maîtriser — pour l’utiliser — la Puissance immanente. Réaliste, il part de l’espèce, pour atteindre l’individu et lui permettre de dépasser la condition humaine en jouissant de la liberté intégrale du héros (vîra, en sanskrit), l’homme vraiment « maître de lui, comme de l’univers ».
Ce n’est pas le lieu ici de décrire en détail ce qu’est la voie (yoga) tantrique fort bien décrite par Evola. Qu’il suffise de dire que “partir de l’espèce”, c’est accepter la réalité concrète de la dichotomie mâle-femelle, c’est-à-dire, en fait, la sexualité : « Le sexe est la plus grande force magique de la nature ; en lui agit une impulsion qui tient du mystère de l’Un, même quand, dans les rapports entre homme et femme, presque tout se dégrade dans des embrassements animaux, s’effrite et se disperse dans une sentimentalité fade et idéalisante, ou dans le régime habituel des unions conjugales socialement autorisées » (Métaphysique du sexe, p. 375). Le sexe en effet peut être, doit être, une porte qui ouvre sur l’Absolu ou, plus exactement, un premier pas dans la recherche de cet Absolu. Seuls sans doute les adeptes les plus avancés réaliseront la transcendance à travers l’expérience sexuelle, mais Evola montre bien que « si un reflet quelconque d’une transcendance vécue prend involontairement forme dans l’existence ordinaire, cela arrive à travers le sexe, et, quand il s’agit de l’homme ordinaire, à travers le sexe seulement. (…) Pour l’humanité courante, seul le sexe, fût-ce dans le ravissement, dans le mirage, ou dans l’obscur traumatisme d’un instant procure des ouvertures au-delà des conditionnalités de l’existence purement individuelle. C’est là le véritable fondement de l’importance que l’amour et le sexe ont eue et auront toujours dans la vie humaine, et que n’égale aucune autre impulsion » (ibid., p. 375).
C’est dans les déclarations de ce genre (celle-ci empruntée, comme la précédente, au maître-livre qu’il a consacré au sexe du point de vue de la métaphysique traditionnelle, tant indienne qu’européenne) que l’on saisit le mieux ce qui fait l’originalité d’Evola : cet acharnement qu’il a à “coller à la réalité humaine”. Nous vivons ici et aujourd’hui, nous sommes des hommes, rien que des hommes, et nous vivons à une époque où la Tradition est occultée. Alors que faire pour agir selon la vérité ? Comment retrouver les valeurs normatives sans lesquelles il n’y a pas d’existence véritable ? Au repliement sur soi, à l’abandon du monde, Evola oppose une autre attitude, celle qui consiste à s’appuyer sur le monde tel qu’il est (y compris nous-mêmes) pour le transformer. Aux yeux de la Tradition, il est bien vrai que nous sommes dans le dernier des âges cosmiques, celui que Hésiode appelait l’Âge de fer, celui que les Indiens nomment Kali-yuga, mais, comme le dit l’Italien :
« Lorsque, au dernier âge cosmique, les forces élémentaires, abyssales, sont à l’état libre, il s’agit de les assumer, de les affronter, de courir l’aventure que l’expression chinoise chevaucher le tigre traduit peut-être de la façon la plus significative ; c’est-à-dire d’en tirer profit, selon le principe tantrique qui est de transformer le venin en remède » (Le Yoga tantrique, p. 15).
Chevaucher le tigre, c’est le titre d’un autre livre d’Evola (1961) où ce programme est repris et explicité : même s’il est vrai que le monde est, métaphysiquement, en état d’involution, s’il est inéluctable qu’il doit disparaître — pour renaître —, comme toutes choses, il n’en reste pas moins vrai que des redressements sont possibles pour des périodes limitées (mais cela peut vouloir dire des siècles !) et que les individus ont le devoir de dépasser leur propre condition (ou, si l’on préfère, de faire leur salut) grâce à une pratique qui conduira à l’épanouissement de toutes les latences qui sont en eux. En ce domaine, l’action intérieure et l’action extérieure ne se dissocient pas et concourent toutes deux à l’épanouissement de l’homme. On comprend dès lors que l’étude d’Evola sur le yoga tantrique n’est ni un ouvrage “gratuit” ne visant qu’à l’information du curieux, ni un manifeste de propagande pour une quelconque conversion de ses lecteurs occidentaux à une doctrine spécifique, mais un exemple de ce qu’il est possible de faire en ce XXe siècle, lorsque l’on veut assumer lucidement la condition humaine. Ainsi dit-il en conclusion de son livre :
« Nous ne pensons pas du tout à proposer le tantrisme au monde occidental moderne, à l’importer à l’usage des Occidentaux dans sa forme originale qui (…) est étroitement, inséparablement liée aux traditions locales hindoues et tibétaines et au climat spirituel qui leur correspond. Quelques unes de ces idées de base, toutefois (…) peuvent être examinées par ceux qui veulent affronter la problématique des temps actuels en adoptant les positions les plus avancées afin de tenter une formulation nouvelle et valable des problèmes » (ibid., p. 288).
Puisse ce dernier appel continuer de résonner aux oreilles de “ceux qui cherchent”.
► Jean Varenne, in : Julius Evola, Le visionnaire foudroyé, Copernic, 1977.

♦ Avec le tantrisme, on se trouve confronté à une véritable science de l'homme intégral : une science où s'amalgament les forces cosmiques, physiologiques et d'autres plus subtiles, psychologiques et spirituelles. L'explorant de fond en comble par l'examen attentif de toutes les sources aujourd'hui accessibles, Julius Evola nous offre, dans son Yoga tantrique un exposé qui demeurera longtemps classique. De plus, en exposant les fondements métaphysiques de ce que l'on considère comme l'une des plus anciennes traditions de l'Asie, il nous propose également des comparaisons jusqu'ici mal entrevues avec des doctrines et des pratiques analogues en Occident et ailleurs, notamment le gnosticisme et l'alchimie.
◘ Connaissance et puissance
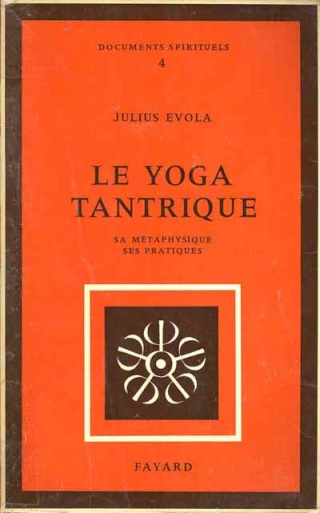 En donnant, comme nous l’avons vu, une valeur particulière à l’action réalisatrice, le tantrisme reprend sous une forme accentuée une conception, ou une idée de la connaissance, qu’on peut dire “traditionnelle” : elle est attestée, en effet, non seulement dans l’aire hindoue depuis les origines, mais aussi dans d’autres civilisations traditionnelles de type supérieur qui se sont développées avant l’avènement de la civilisation moderne, et où il s’agissait d’une connaissance non pas profane mais métaphysique. Il n’est pas inutile d’indiquer brièvement les implications de cette conception.
En donnant, comme nous l’avons vu, une valeur particulière à l’action réalisatrice, le tantrisme reprend sous une forme accentuée une conception, ou une idée de la connaissance, qu’on peut dire “traditionnelle” : elle est attestée, en effet, non seulement dans l’aire hindoue depuis les origines, mais aussi dans d’autres civilisations traditionnelles de type supérieur qui se sont développées avant l’avènement de la civilisation moderne, et où il s’agissait d’une connaissance non pas profane mais métaphysique. Il n’est pas inutile d’indiquer brièvement les implications de cette conception.Pour ce qui est de l’Inde, elle a connu une métaphysique qui se base sur la “révélation” (âkâçâni çruti), ce terme étant pris ici dans un sens différent de celui qui a dans les religions monothéistes, où il se rapporte à quelque chose que la divinité a fait connaître à l’homme et que celui-ci doit accepter purement et simplement, et où une organisation (l’Église chrétienne par ex.) en garde le dépôt sous forme de dogme.
La çruti est, au contraire, l’exposé de ce qui a été “vu” puis révélé (rendu connu) par certaines personnalités, les rshi comme on les appelle, dont la haute stature sert de base à la tradition. Rshi, de drç = voir, veut dire exactement “celui qui a vu”. Les Vedas eux-mêmes, considérés comme le fondement de toute la tradition orthodoxe hindoue, tirent leur nom de vid, qui veut dire voir et, en même temps, savoir : un savoir éminent et direct qui, par analogie, est assimilé à un voir ; dans l’Occident ancien, d’ailleurs, dans l’Hellade, la notion d’“idée” en est l’équivalent, qui, par sa racine id, identique à celle du sanscrit vid (d’où vient Veda), renvoie aussi à une connaissance par vision.
La tradition, sous forme de çruti, enregistre donc et propose ce que les rshi ont “vu” directement, selon une vision qui se rapporte à un plan supraindividuel et suprahumain. La base de toute la métaphysique hindoue, dans ce qu’elle a d’intérieur et d’essentiel, n’est rien d’autre.
Devant un savoir qui se présente en ces termes, on doit avoir la même attitude que devant quelqu’un qui affirme qu’il y a des choses précises dans un continent que soi-même on ne connaît pas, ou devant un physicien qui expose les résultats de certaines de ses expériences. On peut y prêter foi en s’en remettant à l’autorité et à la véracité du témoignage, ou on peut vérifier personnellement la vérité de ce qui a été rapporté, soit en entreprenant un voyage, soit en réunissant toutes les conditions nécessaires pour accomplir soi-même une expérience de laboratoire. Devant ce que dit un rshi, à moins de refuser de se désintéresser de tout ce qui a un lien quelconque avec une “métaphysique”, ce sont là les deux seules attitudes sensées à adopter, car il ne s’agit pas de concepts abstraits, de “philosophie” au sens moderne, ou de dogmes, mais bien d’une matière dont l’existence est vérifiable, où la tradition offre même les moyens et indique les disciplines grâce auxquels on est en état de vérifier de façon évidente, directe et personnelle, la réalité de ce qui est communiqué. Il semble que, dans l’Occident chrétien, pareil point de vue expérimental n’ait été admis que pour la mystique (laquelle, cependant, ne fait pas partie du genre de connaissances dont nous nous occupons, à cause de son fond plus émotif que noétique, et du cadre “religieux” et non métaphysique qui est le sien) que la théologie définit comme cognitio experimentalis Dei, la désignant ainsi comme quelque chose qui va au-delà tant du simple “croire” que de l’agnosticisme.
Or, l’orientation des Tantra s’inscrit dans cette ligne. Ils affirment à maintes reprises qu’un simple exposé théorique de la doctrine n’a aucune valeur ; que ce qui importe pour eux, c’est surtout la méthode pratique de réalisation, les moyens et “rites” à l’aide desquels certaines vérités peuvent être reconnues comme telles. C’est pourquoi ils aiment à se définir comme sâdhana-çâstra — sâdhana vient de la racine sâdh qui veut dire application du vouloir, effort, exercice, activité dirigée vers l’obtention d’un résultat donné. C’est un auteur tantrique qui souligne que « la raison de l’incompréhension des principes du tantrisme (tantra-çâstra) réside dans le fait qu’ils ne deviennent intelligibles qu’à travers le sâdhana ». Il ne suffit pas ainsi, par ex., de s’en tenir à la théorie selon laquelle le Moi profond — l’âtman — et le principe de l’univers, le Brahman, sont une même chose, ou de « rester à ne rien faire en pensant de façon vague au grand éther fait de conscience » ; les Tantra refusent de considérer cela comme une connaissance. L’homme doit, au contraire, se transformer, donc agir, pour connaître vraiment. D’où le mot d’ordre de Kriyâ, ou action. Le tantrisme bouddhique, le Vajrayâna, exprime cette même idée de façon crue, plastique, en la symbolisant par l’union sexuelle de la “méthode efficace” (upâya) et de la connaissance illuminante prajñâ, dans laquelle la première joue le rôle masculin [upâya, en sanskrit, est masculin et prajñâ féminin].
Les formes supérieures du tantrisme adoptent le même point de vue, dans le culte d’abords et, en outre, non seulement en métaphysique, dans la connaissance sacrée et transfigurante, mais aussi dans leur conception de la connaissance de la nature. Pour ce qui est du culte, nous verrons le sens spécial que prend pûjâ dans le tantrisme, avec un ensemble d’évocations et d’identifications rituelles et magiques. Par ailleurs, le principe tantrique veut qu’on ne puisse adorer un dieu qu’en “devenant” ce dieu, ce qui nous renvoie une nouvelle fois à l’expérimentation et qui tranche avec les cultes religieux de type dualiste.
En ce qui concerne les sciences de la nature, il y aurait long à en dire et il faudrait insister de façon générale sur l’opposition entre la connaissance à caractère “traditionnel” et la connaissance de type moderne, dite “scientifique”. Ici, le tantrisme n’est pas seul en question ; il se réfère aux traditions qui l’ont précédé et dont il a repris, adopté et développé les enseignements et principes fondamentaux pour fixer sa cosmologie et sa doctrine de la manifestation.
Voici, brièvement, la situation. Dans la perspective moderne (qui caractérise, du point de vue hindou, la phase la plus poussée de “l’âge sombre”), l’homme peut connaître directement la réalité dans les seuls aspects qui lui en sont révélés par les sens et leurs prolongements que sont les instruments scientifiques — dans ses aspects “phénoménaux”, pour emprunter la terminologie d’une certaine philosophie. Les sciences “positives” réunissent et ordonnent les faits de l’expérience sensorielle, après avoir procédé à un certain tri parmi ceux-ci (excluant ceux qui ont un caractère qualitatif, et n’adoptant que ceux qui sont susceptibles d’être mesurés, “mathématisés”), puis aboutissent par la méthode inductive à certaines connaissances et à certaines lois qui, en elles-mêmes, ont un caractère abstrait, conceptuel : elles ne correspondent plus à une intuition, à une perception directe, ou une évidence intrinsèque. Leur vérité est indirecte et conditionnée ; elle dépend de vérifications expérimentales qui, à un moment donné, peuvent imposer aussi la révision complète du système précédent et sa refonte dans de nouvelles dimensions.
Dans le monde moderne, outre les sciences de la nature, il y a la “philosophie” ; mais ce caractère d’abstraction et de pure spéculation conceptuelle est encore plus visible chez elle ; spéculation qui, d’ailleurs, se morcelle en une multiplicité discordante de systèmes élaborés par des penseurs isolés dont la subjectivité divagante des “philosophes” ignore les limites imposées par la méthode scientifique moderne. Il faut donc reconnaître que le monde de la philosophie est “irréaliste” au plus haut point. L’alternative semble être la suivante : ou une connaissance directe et concrète liée au monde sensoriel, ou une connaissance qui prétend aller au-delà du monde “phénoménal” et de l’apparence, mais qui est abstraite, cérébrale, uniquement conceptuelle et hypothétique (philosophie et théories scientifiques).
Cela signifie qu’a été abandonné l’idéal d’un “voir” ou d’un connaître direct portant sur l’essence de la réalité et ayant un caractère “noétique” objectif ; idéal qu’avait encore conservé la conception médiévale de l’intuitio intellectualis. Il est intéressant de voir que, dans la philosophie critique européenne (Kant), l’intuition intellectuelle est considérée comme la faculté qui, précisément, pourrait saisir, non les “phénomènes”, mais les essences, la “chose en soi”, le noumène ; mais cela uniquement afin d’en priver l’homme (comme l’avait déjà fait la scolastique) et pour mettre en lumière, par contraste, ce qui, selon Kant, serait seul possible pour l’humain : la simple connaissance sensorielle et le savoir scientifique, dont nous avons indiqué le caractère abstrait, non intuitif, et le fait qu’ils peuvent montrer, avec un haut degré de précision, comment agissent les forces de la nature, mais non ce qu’elles sont.
Or, les enseignements sapientiaux, et donc ceux de l’Inde, estiment que cette limite peut être franchie. Comme nous le verrons, on peut dire du yoga classique qu’il offre dans ses articulations yogânga des méthodes pour la dépasser systématiquement. Le principe fondamental est le suivant : il n’existe pas un monde des “phénomènes”, des apparences sensibles, et, derrière celui-ci, impénétrable, la réalité vraie, l’essence ; il existe une donnée unique, qui possède diverses dimensions, et il existe une hiérarchie de formes possibles dans l’expérience humaine (et surhumaine) où ces dimensions se découvrent peu à peu jusqu’à permettre de percevoir directement la réalité essentielle. Le type, ou idéal, de connaissance qu’est la connaissance directe (sâkshâtkrta, aparokshajñâna) d’une expérience réelle et d’une évidence immédiate (anubhava), subsiste dans chacun de ces divers degrés. Comme on l’a dit, l’homme ordinaire, surtout celui des temps derniers, du kali-yuga, n’a une connaissance de ce genre que dans l’ordre de la réalité physique sensorielle. Le rshi, le yogin ou le siddha tantrique vont plus loin dans le cadre de ce qu’on peut définir comme un “experimentalisme” intégral et transcendantal. Il n’existe pas, de ce point de vue, une réalité relative et, au-delà, une réalité absolue impénétrable, mais il y a pour percevoir une réalité unique, un mode fini, relatif, conditionné, et un mode absolu.
Le lien direct entre cette théorie traditionnelle de la connaissance et l’exigence pratique que le tantrisme met au premier plan est évident. En effet, il s’ensuit que toute voie vers une connaissance supérieure est conditionnée par une transformation de soi-même, par un changement existentiel et ontologique de niveau, donc par l’action, le sâdhana. Cela est en net contraste avec la situation générale du monde moderne. En fait, il est évident que si, par ses applications techniques, la connaissance moderne de type “scientifique” donne à l’homme des possibilités multiples et grandioses sur le plan pratique et matériel, elle le laisse démuni sur le plan concret. Par ex., si, dans le domaine de la science moderne, l’homme arrive à connaître approximativement la marche et les lois de constance des phénomènes physiques, sa situation existentielle n’en est pas changée pour autant. En premier lieu, les éléments fondamentaux de la physique la plus avancée ne sont qu’intégrales et fonctions différentielles, c’est-à-dire des entités algébriques dont, en toute rigueur, l’homme ne peut même pas affirmer qu’il en a une image intuitive ni même un concept, car ce sont de purs instruments de calcul (“l’énergie”, la “masse”, la constante cosmique, l’espace courbe, etc., ne sont que des symboles verbaux). En deuxième lieu, après avoir “connu” tout cela, le rapport réel de l’homme avec les “phénomènes” n’est pas changé ; et cela vaut même pour le savant qui élabore des connaissances de ce type et pour le créateur de cette technique : le feu continuera à les brûler ; les modifications organiques et les passions à troubler leur âme ; le temps à les dominer de sa loi ; le spectacle de la nature ne leur dira rien de nouveau, au contraire, il leur apportera moins qu’à l’homme primitif car la “formation scientifique” de l’homme civilisé moderne désacralise entièrement le monde, le pétrifie dans le fantasme d’une extériorité pure et muette qui, à part le savoir de type scientifique, n’admet au plus que des faits subjectifs, tels que les émotions esthétiques et lyriques du poète et de l’artiste qui n’ont évidemment valeur ni de science, ni de métaphysique.
L’alibi le plus courant de la science moderne porte sur la puissance, et cet argument mérite d’être pris en considération dans le contexte présent, étant donné le rôle que jouent dans le tantrisme et dans les courants semblables la Çakti en tant que puissance et les siddhi, les “pouvoirs”.
La science moderne, prétend-on, prouverait sa valeur par les résultats positifs qu’elle a obtenus et, en particulier, en mettant à la disposition de l’homme une puissance dont on dit qu’on n’a jamais vu sa pareille dans toutes les civilisations précédentes. Mais il y a là un malentendu sur ce qu’on entend par puissance ; on ne fait pas la différence entre la puissance relative, extérieure, inorganique, conditionnée et la puissance vraie. Il est évident que toutes les possibilités qu’offrent la science et la technique à l’homme du kali-yuga ressortissent exclusivement du premier type de puissance ; l’action réussit uniquement parce qu’elle se conforme à des lois déterminées que les recherches scientifiques lui ont signalées, qu’elle présuppose et respecte scrupuleusement. Il n’existe donc pas une relation directe entre cette action et l’homme, le Moi et sa volonté libre ; entre l’un et l’autre il y a, au contraire, une série d’intermédiaires qui ne dépendent pas du Moi et qui sont cependant nécessaires pour atteindre à ce qu’on veut. Il ne s’agit pas seulement d’engins et de machines, mais bien de lois, de déterminismes naturels qui sont tels qu’ils sont mais pourraient être autrement, qui restent incompréhensibles dans leur essence, ce qui fait qu’au fond cette sorte de puissance de type mécanique reste précaire. Elle n’appartient en aucune manière au Moi et n’est pas puissance sienne. Ce qui a été dit de la connaissance scientifique s’applique ici aussi : elle ne change pas la condition humaine, la situation existentielle de l’individu, et ne présuppose ni n’exige aucun changement en de domaine. C’est une chose surajoutée, juxtaposée, qui ne comporte aucune transformation de ce qu’on est. Personne ne peut affirmer que l’homme fait montre de supériorité quand, employant un moyen technique quelconque, il devient capable de ceci ou de cela : maître de la bombe atomique, capable de désintégrer une planète en appuyant sur un bouton, il ne cesse d’être un homme et de n’être qu’un homme. Il y a pire : s’il arrivait que, par quelque cataclysme, les hommes du kali-yuga fussent privés de toutes leurs machines, ils se trouveraient probablement, dans la plupart des cas, dans un état de plus grande impuissance devant les forces de la nature et des éléments, que le primitif non civilisé. Parce que les machines, justement, et le monde de la technique ont atrophié les vraies forces humaines. On peut dire que c’est par un véritable mirage luciférien que l’homme moderne a été séduit par la “puissance” dont il dispose et dont il est fier.
Tout autre est la puissance qui ne suit pas les lois de la nature, mais les plie, les change, les suspend et qui appartient directement à certains êtres supérieurs. Cette puissance, cependant, comme la connaissance dont on a parlé, est subordonnée au changement de la condition humaine, au changement de la limite constituée par le Moi que les hindous appellent “physique” (bhûtâtman = Moi élémentaire). L’axiome de tout le yoga, du sâdhana tantrique et des disciplines analogues est nietzschéen : « L’homme est quelque chose qui peut être dépassé », mais il est prit très au sérieux. De même que, dans l’initiation en général, on admet pas que la condition humaine soit un destin, on accepte pas de n’être qu’un homme. Le dépassement de la condition humaine qu’envisagent ces disciplines est aussi, à des degrés divers, la condition nécessaire pour l’obtention d’une puissance authentique, pour l’acquisition des siddhi. À proprement parler, les siddhi ne sont pas un but (les considérer comme tel est au contraire bien souvent tenu pour une déviation), elles découlent comme une conséquence naturelle du status existentiel et ontologique supérieur auquel on atteint et, loin d’être surajoutées et extrinsèques, elles sont le sceau d’une supériorité spirituelle (il est intéressant de voir que siddhi signifie non seulement “pouvoirs extraordinaires”, mais aussi “perfections”). Elles sont personnelles, intransmissibles, et non “démocratisables”.
C’est là donc la différence profonde qui distingue les deux mondes, le traditionnel et le moderne. La connaissance et le pouvoir cultivés par le monde moderne sont “démocratiques”, ils sont à la disposition de quiconque a suffisamment d’intelligence pour faire siennes dans les établissements d’enseignement les vues des sciences modernes sur la nature ; il suffit d’une certaine adresse qui n’engage nullement le noyau le plus profond de l’être pour savoir adopter les moyens d’action mis à la disposition de la technique : un pistolet aura le même effet entre les mains d’un fou, d’un soldat ou d’un grand homme d’état, et de même chacun d’eux peut être transporté par avion en quelques heures d’un continent à l’autre. On peut dire que cette “démocratie” même est le principe guide de l’organisation systématique de la science de type moderne et de la technique. Tandis que, dans l’autre cas, comme nous l’avons vu, la différence réelle entre les êtres est la base d’une connaissance et d’un pouvoir inaliénables, non communicables, donc exclusifs et “ésotériques” par leur nature même et non par artifice : il s’agit d’une culmination exceptionnelle qui ne peut se partager avec toute une société. On ne peut offrir à la société que des possibilités d’ordre inférieur ; celles, précisément, qui se sont développées jusqu’à la fin du dernier âge, dans une civilisation qui, en effet, ne ressemble à aucune autre. Dans les civilisations traditionnelles, ces possibilités matérielles mises à part (dont les limites étroites étaient dues surtout au peu d’intérêt qu’on leur portait), qui le voulait pouvait développer des activités artistiques (souvent à un point remarquable, en particulier en architecture) et, en général, celle-ci étaient caractérisées par les différentes possibilités qu’offrait une vie essentiellement orientée par et vers le haut. Ce climat s’est maintenu en plusieurs pays jusqu’à des temps relativement récents.
► Julius Evola, « Connaissance et puissance », in : Le yoga tantrique, ch. 2, Fayard, 1971. (tr. G. Robinet)

 Les instruments de la réalisation dans le tantrisme
Les instruments de la réalisation dans le tantrisme[Ci-contre : couverture de L’art du tantrisme, P. Rawson, éd. Arts et Métiers graphiques, 1973, republié chez Thames & Hudson, 1996. Elle représente un mandala, diagramme de construction raffinée, utilisé pour concentrer et localiser l'énergie psychique. De cet auteur, Tantra, le culte indien de l'extase (Seuil, 1973) reste dispensable]
I. — La faculté de visualiser exactement et de voir dans la lumière intérieure
La visualisation est indispensable dans la voie tantrique qui, à la différence d’une voie de pur détachement, exige des “évocations” de tout genre. On pourrait parler ici d’une “fantaisie” méthodique, c’est-à-dire de la capacité de voir avec les yeux intérieurs une image donnée, et de la voir nettement, dans tous ses détails, comme si c’était une chose réelle, et même d’une présence plus vivante qu’une chose réelle. C’est là le premier instrument indispensable à la réalisation. Grâce au second, la faculté de concentration ou de “silence”, on acquerra ensuite le pouvoir de s’unir à une telle image, au point qu’elle vive seule dans l’espace intérieur, alimentée par une action semblable à celle d’une lentille qui concentre les rayons du soleil en un point unique où finit par naître une flamme. C’est ce que l’on pourrait nommer la “fantaisie créatrice” (ou “magique” au sens supérieur).
Les réalisations du Yoga, qui paraissent imaginaires à beaucoup de nos contemporains, ont pour fondement un type humain dans lequel ces deux facultés se trouvent développées dans une mesure dont nous pouvons difficilement nous faire une idée (1).
Une telle puissance de “fantaisie” peut subsister aujourd’hui chez des êtres incultes ou parmi des populations sauvages — résidus dégénérés et nocturnes d’antiques races —, elle disparaît de plus en plus chez le “civilisé” moyen. Celui-ci semble avoir perdu jusqu’aux prémices organiques constituées par un rapport spécial du grand sympathique avec le cerveau, et plus précisément avec les strates périphériques plus récentes du cerveau. C’est pourquoi on peut dire que l’homme moderne, dans le domaine subtil, est un véritable paralysé. Si même subsiste en lui cette faculté imaginative, il manque la contrepartie positive, “shivaïque”, c’est-à-dire ce contrôle et cette présence à soi-même qui sont au Yoga des présupposés tout aussi nécessaires. C’est le cas, entre autres, du rêve et des phénomènes d’hypnose. Tout rêveur montre qu’il possède la faculté d’imaginer et de visualiser, mais à l’état passif, sans pouvoir la diriger à sa guise. De même, dans les états hypnotiques, le patient témoigne en puissance d’une imagination semblable à la vivante fantaisie magique, mais il ne peut la manifester qu’à la faveur d’une suspension de sa conscience, par une régression à des stades infra-personnels.
On sait que des substances spéciales — par ex. les extraits de chanvre — peuvent “dynamiser” artificiellement l’imagination pour un temps limité. Mais ici encore, la désagrégation passive l’emporte s’il n’y a pas une préparation spéciale et un concours de circonstances favorables. Les tantriques emploient dans leur rituel secret des boissons enivrantes analogues sans doute aux breuvages sacrés traditionnels, mais il faut faire beaucoup de réserves sur ce point, surtout lorsqu’on décrit ces pratiques aux Occidentaux de notre temps, pour lesquels on ne saurait trop insister sur leur caractère systématique et rigoureusement rituel.
D’autre part, “construire” une imagination avec ses propres forces est une tentative presque désespérée, car l’effort intérieur est déjà employé à inhiber les processus associatifs. C’est pourquoi certains conseillent comme plus facile la méthode du souvenir : fixer d’abord une chose que Ton a placée devant soi, puis la voir avec le regard intérieur; dans l’exercice suivant, l’agrandir ou la diminuer à volonté, la placer devant ou derrière soi ; enfin, dans un autre exercice, la voir devant soi dans l’espace, en gardant les yeux ouverts, comme si c’était la chose réelle.
Si malgré tout le point de départ est une complète cécité de l’œil mental, on ne peut s’avancer beaucoup sur cette voie, et il reste seulement à espérer qu’à un moment donné — apparemment par miracle — en réalité par la conjonction de facteurs impondérables — se produira un brusque changement, semblable dans ses effets à une opération de la cataracte. C’est ce qui semble être arrivé à l’écrivain allemand Gustav Meyrink. Il s’était longuement adonné aux pratiques du Yoga sans parvenir à aucun résultat, justement parce que, comme beaucoup d’intellectuels modernes, il pensait avec des mots, et ne pouvait voir figures, formes et couleurs avec l’œil mental. Il avait abandonné ces disciplines lorsqu’un jour, se trouvant dans un état de paix devant un paysage hivernal, il eut une vision : il “vit” dans le ciel une figure dans la posture caractéristique du bouddha, les jambes croisées. Ce fut comme une ouverture subite et miraculeuse de son œil mental.
En général, une telle “dynamisation” correspond au contact avec une gakti, avec un certain ordre d’“influences” psychiques ou spirituelles, et le phénomène ne reste pas isole, mais amorce (ce qui fut le cas de Meyrink) un profond changement intérieur.
Les tantras tibétains distinguent deux processus de visualisation :
- le premier est instantané, c’est la projection immédiate de l’image complète — “le saut du poisson hors de l’eau” ;
- le deuxième au contraire est graduel : on construit l’image peu à peu, et chacune de ses parties, chacun de ses attributs, joue le rôle d’un nouveau combustible qui intensifie le feu mental.
L’importance de l’imagination tient dans la possibilité qu’elle donne de pénétrer le domaine “subtil”. Celui qui, par l’intensité de son imagination et par son pouvoir de se concentrer sur une seule image, parvient à s’isoler du flux psycho-physique comme du Sentiment de son propre corps, et à voir dans la lumière intérieure, celui-là peut maîtriser des forces et préparer des actions dans le domaine du “corps mental”, du “corps de vie”, ainsi que des “noms”, “sceaux”, “racines” et “éléments” dont parle si souvent le tantrisme. Tout le culte tantrique se nourrit de telles évocations.Celui qui, spontanément, possède déjà un certain pouvoir de visualisation peut le développer dans le sens de ce qu’il faudrait nommer, selon l’expression taoïste, “l’action non agissante”. Considérons par ex. le corps. Il y a deux manières de le mouvoir, l’une directe, au moyen d’un ordre transmis par le cerveau ; l’autre indirecte, par réflexe idéomoteur à travers mie simple image. Un bon exemple d’un tel réflexe pourrait être le contre-coup physiologique et mimique provoqué par la chute subite d’un équilibriste. Un autre, l’excitation sexuelle déclenchée par l’arrêt de l’attention sur des images érotiques. Ces exemples, entre autres, montrent l’existence d’une vertu motrice, “sans effort”, de l’imagination, bien distincte de l’action purement volitive et musculaire. Il s’agit d’entraîner l’imagination dans le sens d’un pouvoir direct capable de supplanter l’intervention de la volonté : susciter des mouvements avec le mental au moyen d’une pensée maîtrisée, aussi précise que dépourvue d’effort. Voici un exercice élémentaire dans ce sens :
Se mettre dans une position commode, en pleine relaxation musculaire, l’esprit apaisé. Après avoir évoqué le silence, se représenter qu’un bras est levé, en éliminant toute autre pensée. On se trouvera avec le bras effectivement levé. On peut compliquer graduellement l’exercice, par ex. jusqu’à se mettre debout. Peu à peu, on s’habituera à prendre conscience du corps, au lieu de l’abandonner à des automatismes avec lesquels on existe dans une confuse coalescence. Les postures rituelles elles-mêmes ne sont vraiment efficaces que lorsqu’elles sont intérieurement préparées par une visualisation correspondante. C’est la voie qui mène à la dissolution du corps physique et à la réalisation du vajra, du corps de “diamant-foudre”.
II. — La concentration
Le deuxième instrument fondamental est l’unification et la concentration de la pensée, du mental. Depuis le traité classique de Patanjali, les manuels de Yoga articulent rigoureusement une discipline progressive.
Ils décrivent le plus souvent cinq états du mental :
- 1) instable, mouvant, fluent (idée de mouvement) ;
- 2) alourdi, confus (idée de pesanteur) ;
- 3) occasionnellement stable ;
- 4) rassemblé en un seul point ;
- 5) complètement maîtrisé.
Les deux premiers états sont ceux de l’homme commun, le pashu. Celui-ci ne pense pas : il est pensé. Les diverses impressions naissent, se développent, s’associent, disparaissent en lui selon un flux kaléidoscopique, qu’il ne contrôle pas, mais auquel, passivement, il s’abandonne. Une image hindoue bien connue compare cet état de dissociation et d’inconsistance mentale au singe qui saute sans arrêt de branche en branche et ne se laisse que très difficilement capturer.Le troisième état, tout en continuant à relever de la vie commune, est déjà différent. Il s’agit de ces cas où l’esprit se concentre pour un temps, comme cela arrive lorsqu’on assiste à un spectacle, lorsqu’on fait une lecture intéressante, lorsqu’on est pris par un sentiment ou par un souci, lorsqu’on s’efforce de résoudre un problème, de percevoir un bruit indistinct, etc. Ce n’est pas cependant un état vraiment positif, mais plutôt une attention passive. Dans la plupart des cas, en effet, c’est l’objet lui-même, ou un intérêt précis, qui impose cette concentration temporaire. Qu’on tente de se concentrer sur quelque chose qui n’offre pas un intérêt immédiat : après quelques secondes, l’esprit est ailleurs.
C’est seulement avec le quatrième état, celui de la concentration active sur un seul point, que le mental devient un bon outil pour le travail intérieur. Mais cet état est lui-même un but qu’il n’est pas facile d’atteindre : le fait que les textes hindous le considèrent comme un point de départ tout naturel ne doit pas créer d’illusion, surtout pour l’Européen d’aujourd’hui, beaucoup plus dispersé, beaucoup plus passif intérieurement que l’Oriental. Il y faut une application et une persévérance à toute épreuve.
La discipline mentale ici s’efforce de réduire le plus possible la part occupée par les états des deux premiers types, pour réaliser une ferme et continue présence à soi-même et une méthodique “désidentification” de soi par rapport aux impressions et, en général, au contenu de l’expérience interne et externe. Le but est atteint quand ces états passifs et dispersés sont détruits sans résidu, c’est-à-dire cessent d’être les états habituels de la conscience ; la coalescence aveugle du mental avec ses propres modifications est alors détruite.
Voici quelques pratiques initiales de “désidentification” :
◊ a) Se mettre dans un état de calme. Abandonner la pensée à elle-même. Assister tranquillement au spectacle des associations mentales qui surgissent alors spontanément et capricieusement, sans intervenir, mais sans perdre la présence à soi-même, sans troubler le flux, mais sans se laisser emporter par lui. Dans ce but, il est très important de repérer mentalement tout ce qui se présente, par ex. en disant : « Voici, j’ai pensé ceci — puis cela après ceci », etc. Souvent, au début, l’attention se laisse distraire : il ne faut pas alors reprendre l’exercice avec la pensée où l’on se retrouve, mais chercher à reconstruire les enchaînements qui ont mené à elle, en partant du moment où l’on était encore conscient.
Certains textes nomment cet exercice celui “du berger”. L’attitude intérieure, en effet, doit être celle du berger qui laisse paître ses bêtes sans les perdre de vue. Le résultat positif est obtenu lorsque — selon une autre image des textes —. on a la sensation de l’homme qui se tient paisiblement sur une berge et voit glisser devant lui les eaux du fleuve.
Une autre méthode, dite du “retranchement”, conduit au même but. On se tient attentif, et l’on supprime toute pensée, toute image, dès qu’elle se présente, comme on couperait un jonc d’un coup sec. Il se présentera immédiatement une autre image que l’on traitera de même, etc. En persévérant, on observera à un moment donné une espèce de fuite serrée de pensées et d’images : c’est ce que l’on appelle la “vision de l’ennemi”, corrélative à un détachement, à une dissociation du moi et des contenus de la conscience; on retrouve alors le point final de l’exercice précédent, l’état de celui qui se tient sur la rive et observe l’eau qui passe.
◊ b) Des exercices de ce genre doivent s’appliquer peu à peu aux actes banals de la vie quotidienne, plus particulièrement frappés d’automatisme : par ex. aux contenus mentaux liés au fait de se déplacer, de manger, de s’habiller, etc., contenus qui, habituellement, se consument moment par moment, sans conscience réelle, si bien que lorsqu’on arrête le flux, on est rarement capable de se rappeler ce que l’on pensait au moment précédent.
◊ c) Avec le progrès de ces exercices, il faut obtenir une désidentification analogue à l’égard des états émotifs. Il est difficile de l’obtenir directement et de faire de nos sentiments et de nos émotions des spectacles observés “du dehors”. Mais il y a un détour possible : c’est de considérer nos sentiments et nos émotions passés avec le même calme que s’ils n’avaient pas été nôtres, de les regarder naître, se développer, se transformer comme dans une personne étrangère, pour nous indifférente. Ainsi, peu à peu grandit un détachement qui finit par s’affirmer, dans le présent, face aux mêmes expériences.
Au total, il s’agit d’obtenir un changement d’être, le passage d’un mode d’existence à un autre. Un résultat positif n’est obtenu que lorsqu’on passe des disciplines particulières à des habitus, à des états qui se maintiennent sans interruption et finissent par être sentis comme naturels et normaux. Naturelles et normales en particulier doivent devenir la calme présence à soi, la dissociation du mental et de ses contenus, et l’absence des états inférieurs de la conscience à quelque moment que ce soit.
Alors on peut passer à un processus intense de concentration et de fixation. D’après une subdivision bien connue, ce processus comprend les grandes phases suivantes :
◊ 1) “Pratyâhâra”.
C’est le pouvoir de freiner et d’exclure à volonté les impressions sensibles, de détacher l’organe interne (manas) des instruments des sens pour le fixer sur un objet déterminé qui devient alors le centre d’une méditation active ou “soutenue”. L’explication de ce pouvoir tient dans la théorie selon laquelle ce n’est pas avec l’œil que l’on voit, ni avec l’oreille que l’on entend, etc., mais bien avec le manas, le mental, qui voit, entend, etc., en se mettant en connexion avec l’œil ou l’oreille. Cette faculté, du reste, existe déjà dans le troisième état de conscience (vikshipta-citta) qui ne sort pas de la vie normale : ainsi d’Archimède, absorbé par un problème au point de ne pas entendre les bruits de l’assaut et de la prise de Syracuse.
On peut maintenant pressentir quel est ce silence auquel nous avons déjà fait allusion. Le rapport du moi avec la pensée est analogue à son rapport avec la parole ; le silence intérieur correspondra donc dans le domaine de la pensée au fait de se taire dans celui de la parole. Ce n’est pas un écrasement de la pensée, mais un recueillement, une prise en main du mental calmement ramené à lui-même. Les images mentales sont ici comparables à autant de paroles prononcées en désordre, involontairement et en hâte. Il s’agit, avec une attention calme, de suspendre un tel processus et de s’envelopper de silence. C’est par un tel silence que doit s’ouvrir toute méditation et toute action interne.
Le silence a plusieurs degrés, et ici n’interviennent que ses formes les plus élémentaires. Pour atteindre aux formes supérieures, il faut dépasser la conscience psychologique et transférer le centre de la conscience dans les “tattvas purs” de “l’organe interne”, et finalement dans la buddhi. En effet, les idées et les pensées qui se forment à travers le cerveau sont seulement des reflets que l’on pourrait dire “lunaires”, car la source réelle des processus profonds qui les suscitent se trouve dans la région subtile du cœur.
Si l’on parvient à neutraliser complètement le mental, en conservant la pleine conscience que symbolise l’image du berger ou celle de l’homme qui regarde le courant, on peut connaître d’étranges expériences : les idées peuvent être perçues sous la forme de bonds ou d’éclairs d’énergie pure qui se libèrent d’un centre profond et percutent le cerveau (2). Ou bien quand on ne peut encore placer le centre de sa conscience au delà de la psyché individuelle, le mental est expérimenté comme une masse inerte et obscure où se produisent des décharges — on pourrait dire : des détonations. C’est d’une telle manière qu’on parviendra à connaître le manas comme tattva, et comme pouvoir, shakti, dans sa forme propre, et non emprisonné dans le cerveau.
◊ 2) “Dhâranâ”.
C’est la contrepartie positive du pratyâhâra, c’est-à-dire la fixation de l’esprit sur un objet, à l’exclusion de tout le reste. Le mot vient de la racine dhri, qui signifie tenir ensemble, tenir uni. Les textes décrivent plusieurs formes de Dhâranâ. Certaines ont pour but une sorte d’hypnose consciente, capable justement de neutraliser le mental et d’en libérer l’énergie qui, déliée des sens, peut se porter et agir ailleurs. Vyâsa indique certains points du corps sur lesquels opérer cette concentration “hypnogène” : le sommet de la tète, l’ombilic, l’extrémité du nez, le fond du palais. Parfois on utilise un objet extérieur comme dans la technique bouddhiste des kasinas. Dans d’autres cas, la base de la concentration consiste dans une image symbolique (mandala, yantra) ou dans une formule chantée, qui pourront être en même temps le moyen d’un approfondissement spirituel. Dans un tel cas, on ne se préoccupe pas de neutraliser au préalable la conscience liée au cerveau; on juge que ce dépassement et cette maîtrise se feront d’eux-mêmes avec l’absorption totale du moi dans l’objet intellectuel (3).
◊ 3) “Dhyâna”.
Dans le dhyâna, cette absorption devient pénétration de l’objet, sa véritable intériorisation. Le commentaire de Nyâsa souligne l’absolue continuité, la Constance que doit revêtir ici l’action mentale : selon une image que nous avons déjà rencontrée, elle doit devenir semblable au faisceau des rayons solaires durement concentre par une lentille en un seul point, sans interruption, à bonne distance, jusqu’à ce que l’objet placé au foyer s’embrase. Il ne s’agit donc plus ici d’une fixation “hypnogène” — qui, du reste, n’avait été qu’un moyen auxiliaire entièrement subordonné —, mais bien, au delà de la raison, d’une démarche essentiellement “intellective” : l’objet est pénétré dans tous ses éléments, on développe toutes ses significations, on l’expose à tous les points de vue, on le laisse exprimer tout ce qu’il recèle, pour enfin l’assumer en son unité absolue, dans une synthèse qui fait transparaître son essence.
◊ 4) “Bhâva”, “samâdhi”.
À ce degré, l’aspect idam (autre) de l’objet se consume, et son essence se révèle sur un plan suprasensible. L’acte et l’objet de la connaissance cessent alors d’être distincts, de même qu’entre l’image de la chose et son essence il n’y a plus de différence. On se trouve au delà aussi bien du monde sensible des phénomènes que de l’univers subjectif du rationnel et de l’imaginaire. La “forme” comme extériorité s’efface. Subsiste seulement l’essence, artha, ou la puissance, shakti, de la chose, de la figure ou du Symbole.
Le Jňana-Yoga, ici, emploie le terme de samâdhi ; le tantrisme préfère celui de bhâva. Bhâva est donc la clé qui ouvre la connaissance de la shakti, puisque c’est à travers bhâva que toute extériorité se révèle transparence. « Si je veux acquérir la puissance et la lumière du feu — dit le Tantratattva (II, 326-327) —, je dois me faire moi-même feu : ceci est bhâva». Et le Rudrayâmala (VI, 9) affirme que quiconque peut réaliser pleinement bhâva n’a besoin de rien chercher d’autre, car il possède désormais l’instrument d’une réelle connaissance de la shakti. De toute évidence, des états de ce genre sont incompréhensibles pour qui n’en a pas, si peu que ce soit, le pressentiment : « Comment exprimer par des mots la vraie nature de bhâva ? On ne peut que se taire. Les paroles peuvent seulement montrer la direction où elle se trouve » (Kaulâvali-Tantra, XXI, 1-3).
Ce chemin a plusieurs étapes. Si l’on part d’un objet sensible, on doit, pour atteindre bhâva, exécuter une double démarche d’“abstraction”. Dans une première phase, les sens physiques bien obturés et toute autre perception exclue, le mental se concentre sur l’image de l’objet. Lorsqu’on s’est saturé de celle-ci, il faut la supprimer comme on avait d’abord supprimé la perception psychophysique ; on obtient alors une espèce de reflet au second degré qui, dépourvu de forme, dématérialisé, permet l’éclosion de bhâva. Ce reflet correspond au plan “sans forme”, arûpa, ou “causal”, kârana, proprement spirituel, tandis que l’image du dhyâna correspondait au plan “subtil”.
Quand le point de départ est un “objet intérieur” — image, symbole, sentiment, etc. —, il faut d’abord neutraliser la sensibilité périphérique; viennent alors deux phases semblables à celles que nous avons décrites.
Les commentateurs [des Yoga-sûtra] de Pataňjali distinguent plusieurs degrés de samâdhi. Le plus bas, tout en éliminant l’extériorité, laisse subsister le concept et le nom, liés l’un et l’autre à une certaine condition d’existence, à la vision du monde d’une civilisation, d’une langue, d’une époque — autant de voiles par conséquent pour la réalité ultime de l’objet. Au contraire, dans la forme supérieure de samâdhi nommée nirvitarka, le feu mental intensifié dépouille la res de toute association avec des concepts et des noms, de tout ce qui serait médiation avec le “moi” ou n’importe quel être particulier. L’objet livre la nudité essentielle de sa nature propre, de son unicité (svarûpa). Alors la vision humaine participe à celle de Shiva dont l’œil frontal symbolique, tel celui du Cyclope, consume l’enveloppe de “mensonge” de la création : tout à fait comme au regard “olympien” du νοῦς [noûs] transparaît, à travers le monde sensible, la réalité supérieure du κόσμος νοητός [kósmos noétos] [monde intelligible]. Un terme technique, dans le Yoga, connote l’ensemble de de cette catharsis intellectuelle — à la fois dhârana, dhyâna et samâdhi (ou bhâva) : c’est celui de sanyama.
Même lorsqu’il porte sur le monde sensible, le sanyama met l’homme en contact avec les archétypes qui transcendent les sens et leurs objets — les tanmâtras ou mahâbhûtas. Ces contacts correspondent à autant de formes d’une connaissance-illumination et actualisent des “sens spirituels” qui ne sont plus conditionnés par le corps. Le sage, désormais, peut connaître et agir sans passer par les instruments du corps animal : il voit sans yeux, touche sans mains, entend sans oreilles, se déplace sans marcher…
Le Sanyama permet non seulement la connaissance des essences et des forces qui se manifestent dans le monde extérieur, mais aussi de celles qui président à la vie des sentiments, des passions et des émotions; il peut enfin prendre pour objet des réalités qui n’ont pas de correspondance directe dans l’expérience humaine habituelle. Dans ce dernier cas, le “matériel” employé pour l’éveil illuminateur consistera en figures, sons et signes, tout un ensemble de symboles et de rites que fournit la tradition et que vivifie un enseignement de maître à disciple.
Il faut s’entraîner au sanyama aux heures de solitude et de silence, en partant de réalités intérieures. Mais il est très important, une fois cette faculté obtenue dans une certaine mesure, de l’appliquer de temps à autre à la vie normale en dépassant peu à peu la perception pauvrement psycho-physique pour diriger la ferveur de l’intellect unifié sur un paysage ou un visage…
III. — La conscience du corps
Pour qui entend suivre la voie tantrique et spécialement celle du Hatha-Yoga, un des premiers objets sur lesquels projeter le pouvoir de perception spirituelle doit être le corps lui-même. Ce point est de toute importance pour l’Occidental moderne, car celui-ci, à la différence de l’Hindou, se trouve à la fois passif et étranger devant son corps — un corps noué par des automatismes. C’est pour avoir ignoré cette différence qu’on a accumulé tant d’équivoques à propos du Hatha-Yoga. En bref, on a cru qu’il y avait, pour la réalisation spirituelle, des méthodes “physiques”, alors que les textes hindous, lorsqu’ils parlent du “physique”, entendent par là une réalité indissolublement matérielle et spirituelle, “sacramentelle” en quelque sorte, donc radicalement opposée à celle que recouvre le même mot pour l’Européen moyen d’aujourd’hui. La première tâche de l’Occidental, s’il veut tirer quelque profit des pratiques du Hatha-Yoga, sera donc de prendre une conscience croissante de son corps, et de réveiller de plus en plus celui-ci de l’inertie et de l’automatisme.
Dans ce but, il convient d’appliquer le sanyama aux diverses régions, aux diverses fonctions du corps. Par exemple, une fois prise la “posture” la plus commode, faire silence et se concentrer sur une main — jusqu’à ne plus sentir qu’elle, jusqu’à “percevoir son bruit”, disent les textes.
On prend généralement pour objet de cet exercice la fonction respiratoire, dans le but de “connaître” le souffle, le prâna. Dématérialiser la sensation ordinaire de la respiration, percevoir sa réalité “subtile”, intérieure, tel est le présupposé nécessaire du pranâyâma qui constitue la méthode centrale du Hatha-Yoga. Dans des exercices préliminaires, qui impliquent une entière relaxation, on attend que la respiration, paisiblement abandonnée à elle-même, prenne un rythme régulier, “comme chez un enfant qui dort”. Alors, peu à peu, on la pénètre par les démarches du sanyama. Selon les textes, l’état “subtil” du souffle, le prâna, se révélera par une sensation lumineuse qui pourra se transformer en une sensation de chaleur dans une phase ultérieure, quand la prise de conscience de la fonction respiratoire permettra celle de la circulation, qui lui est liée (4).
Ainsi peut-on rentrer dans le corps et s’unir à sa vie, jusqu’à acquérir un sentiment de l’existence transfigure, à la fois paisible et royal, en comparaison duquel l’existence ordinaire semble celle d’un esclave précaire et usurpateur. Ce “détachement”, tout le monde en fait l’expérience spontanée avec le sommeil. Mais la plupart des hommes sont trop faiblement conscients pour suivre, à la jointure de la veille et du sommeil, le changement d’état qui intervient On ne peut lever cet interdit que lorsqu’on commence à développer la faculté d’abstraction et de concentration qui caractérise le sanyama. À ce stade, voici un exercice qui peut être utile :
◊ a) Le soir, avant de s’endormir, faire “silence”. “Visualiser” un soleil qui, lentement, se lève jusqu’à parvenir au zénith d’un ciel totalement pur. L’image doit être vécue fortement, comme une élévation, une ouverture et une illumination de tout l’être. En même temps, il faut sentir qu’elle symbolise les événements secrets de la nuit, lorsque, dans la profondeur, flamboiera ce “soleil de minuit” dont parlaient les mystères de l’antiquité occidentale. Au zénith du soleil nocturne, s’accomplira, pour l’homme, l’union libératrice avec la vraie lumière. Tout de suite après avoir vivifié ces images, il faut tenter de s’endormir, avant que d’autres pensées ne s’interposent. Habituellement d’ailleurs, quand l’exercice est fait avec quelque intensité, il conduit de lui-même au sommeil, sans même qu’on s’en rende compte, tout au moins pour les débutants.
◊ b) Le matin, au réveil, réaliser à nouveau le “silence”. Retrouver le soleil qu’on avait vu la veille à son zénith et le suivre dans sa course jusqu’à son coucher. Ce qu’il faut sentir alors, c’est que cette lumière intérieure avait jailli du profond de nous, et que sa splendeur réside en nous. Ainsi s’affirme la certitude d’une autre lumière, supérieure à celle qui éclaire la nature physique et les yeux charnels.
Cette pratique contribue efficacement à éveiller la connaissance “subtile” du corps et de la vie. Elle donne une sensation de fraîcheur et de légèreté, elle renforce ce sentiment de calme noblesse, de dignité et, pour ainsi dire, de royale “solarité”, qui marque la prédominance chez un homme du gûna supérieur, le pur et lumineux sattva-gûna.
La contemplation du soleil nocturne se retrouve dans certains textes tibétains ; ils la mettent en rapport avec la “lumière claire” (höd-gsal) qui correspond à “l’état subtil”, et dont la perception doit intervenir à la faveur de « l’intervalle qui séparé la fin de l’état de veille et le début de l’état de sommeil ». On s’allonge sur le coté droit dans la “posture du lion” que le bouddhisme primitif recommandait déjà pour le sommeil. On se concentre calmement dans le cœur. Il y a “ignition” quand le sommeil survient et “accomplissement” lorsqu’il devient profond. Si la conscience peut suivre ces phases, elle expérimente alors, non plus seulement la “lumière claire” de l’état “subtil”, mais une lumière primordiale et spirituelle, celle-là même qui se présentera après la mort.
Une pratique moins complexe — car celle qui précède est liée à la “visualisation” précise de certaines lettres tibétaines — consiste à identifier son propre corps à celui du Bouddha Vajrasattva (c’est-à-dire dont la substance est vajra, le “diamant-foudre”), quand on est sur le point de s’endormir. Mais l’important ici est surtout le contrepoint du réveil : on doit évoquer le “double tambour de Shiva” qui résonne au milieu des cieux, et proclamer les “paroles de puissance” des 24 Héros, figures divines du panthéon tibétain. Quand on s’éveille “dans cet état de corps divin”, les êtres et les choses doivent apparaître comme autant de symboles de la divinité (5).
Une espèce de sentiment cosmique de force calme peut résulter de ces pratiques dans la mesure où elles commencent à réintégrer la conscience de veille dans la conscience supra-individuelle qui se trouvait enveloppée par l’état de sommeil profond. Un texte parie justement de « mêler pendant le jour la lumière claire au sentiment du monde ». Ce “mélange” permet d’introduire la lumineuse conscience nocturne dans la trame de la quotidienneté. Il peut alors arriver que le flux des formations mentales s’arrête par instants pour faire place à une intuition essentielle : « L’intellect libéré de l’obscurité, primordial, brille dans l’intervalle qui séparé la cessation d’une formation mentale de la naissance de la suivante » (6).
Toujours pour dépasser la tonalité “tamasique” [déficiente d'énergie] qui imprègne la perception commune du corps, le tantrisme connaît une technique de transmutation des états négatifs. Il utilise essentiellement le jeûne. Il ne s’agit pas d’un jeûne masochiste tourné vers une “mortification” sentimentale, mais d’un jeûne raisonné, employé comme un instrument auxiliaire durant certaines étapes de la purification spirituelle. La sensation négative de langueur que le jeûne entraîne d’habitude est alors transmutée pour affiner la sensibilité spirituelle, pour renforcer aussi la conscience et la maîtrise des forces subtiles qui président aux processus psycho-physiologiques. Certains états fébriles, même liés à la maladie, sont utilisés dans le même sens.
Nous donnerons, pour finir, quelques indications sur les âsanas, ces “postures” que le tantrisme impose au corps pendant les exercices de l’ascèse. Ce ne sont pas des positions arbitraires. D’un point de vue purement extérieur, elles assurent au corps le maximum d’aise dans la stabilité et permettent une longue immobilité. Des mudrâs, signes par gestes ayant valeur de sceaux (c’est le sens littéral du terme), leur sont souvent associés. Dans certains textes, mudrâ est synonyme d’âsana. On distingue alors les mudrâs grossiers (sthûlas), subtils (sûkshmas) et suprêmes (paras). Les premiers s’exécutent seulement avec les mains et le corps. Dans les seconds, un “verbe de force” (mantra) se lie au geste. Les troisièmes exigent la conscience du sens spirituel du “sceau” qu’ils incarnent (7).
Cependant, la signification véritable des âsanas et surtout des mudrâs est d’ordre rituel et théurgique.
Certes, les âsanas permettent une discipline préliminaire de grande importance : la destruction des mouvements inutiles et irréfléchis, le contrôle complet des nerfs et des muscles. Ils immobilisent et “isolent” le corps. Mais s’il faut un maître spirituel pour les enseigner dans leur forme véritable, c’est que leur véritable efficacité est intérieure : ce qui, réellement, compte en eux est le sens du geste, cette incorporation rituelle du Symbole qui transforme l’homme en statue — une statue qui répète un geste divin et devient le réceptacle d’une présence. De ce point de vue, les âsanas se relient à la coutume tantrique d’identifier son corps à celui d’un devatâ, d’une divinité donnée, au commencement de tout exercice. Leur point de départ est donc une image vivifiée et, d’une certaine manière, “magique”, que l’attitude humaine entière essaie rituellement de reproduire. L’immobilité même du corps est théurgique, et chaque position particulière établit un rapport précis entre tel courant du souffle corporel et l’aspect correspondant du souffle qui anime les mondes (8).
► Julius Evola, extrait de Lo Yoga della Potenza (Fratelli Bocca, édit., Milan, nouv. édit., 1949), in : Yoga, science de l'homme intégral, Jacques Masui (dir.), Les Cahiers du Sud, 1953.
Nota bene : Traduction de Maurice Aniane. Une version moins ramassée de ce texte se trouve au chapitre 6 de la traduction de 1971.
Notes :
• 1 David Neel relève que le terme tibétain pour “imaginer” est migspa, qui signifie « une concentration de la pensée capable de produire l’objectivation réelle de l’image subjective. C’est un état de “transe” dans lequel les faits et les lieux imaginés se substituent complement à ceux que l’on perçoit dans l’état normal de conscience ».
• 2. De fait, l’expression vrittis ne veut pas proprement dire modification, non plus qu’états ou formes du mental, mais bien tourbillons. — Dans les textes tibétains, on caractérise souvent les pensées par le mouvement d’un météore, d’une flèche ou d’un éclair.
• 3. Sur l’emploi du son, cf. Hatha yoga pradîpikâ, IV, 66-67, 84-88. Le but ici est le samadhi. C’est pourquoi on conseille d’employer le shanmukkî-mudrâ, qui entraîne la fermeture des ouvertures de la tête avec les doigts (les oreilles avec les pouces, les yeux avec les index, les narines avec les majeurs, les commissures des lèvres avec les autres doigts) et semble s’accompagner de la rétention du souffle. Alors se font entendre des sons dans la région du cœur. D’abord forts et complexes, comme les tintements des cloches, le battement de la mer, le grondement du tonnerre, le grésillement de la pluie — ils se font de plus en plus subtils et un. L’attention doit rester rigoureusement concentrée jusqu’à l’intuition d’une limite où le “moi” disparaît. « Semblable à un chasseur, le son d’abord capture et lie le mental, puis le tue ; il met fin à son instabilité naturelle et l’absorbe… Quand l’organe interne, tel un daim, s’immobilise fasciné par le son, un chasseur habile peut le tuer » (ibid., IV, 92, 94, 99).
• 4. La Cabbale parle du sang comme d’une “lampe de vie” ; dans l’hermétisme, le “mercure” est à la fois la “dame secrète”, la “vie subtile” et la “lumière”.
• 5. Shri-chakra-sambhāra-tantra, p. 263.
• 6. Texte dans Evans-Wentz, Tibetan Yoga, pp. 225-226
• 7. En Occident, Agrippa de Nettesheim (De occulta philosophia, II, 16) fait allusion à la représentation de nombres sacrés au moyen de gestes qui, dit-il, symbolisent des « noms de vertus inexprimables, qu’il n’est pas permis de prononcer à haute voix ».
• 8. Cette théorie des âsanas converge avec le sens général de l’immobilité hiératique, jusque dans les traditions de l’antiquité occidentale. Dans la théorie de l’ancienne royauté égyptienne par ex., la stabilité et l’immobilité (exprimées par le hiéroglyphe ded) étaient censées permettre la saturation du roi par une réalité surnaturelle (et. A. Moret, Du caractère religieux de la royauté pharaonique, Paris, 1902). Dans les Mystères classiques, le thronismos, c’est-à-dire le rite qui consistait à s’asseoir immobile sur un trône, avait une extrême importance : il se liait directement à l’initiation, à l’union du dieu (cf. V. Macchioro, Zagreus, Florence, 1929, pp. 40-42).

◘ LA PUISSANCE, ESSENCE DE L'HOMME ET DU MONDE

a) Puissance évolienne et “volonté de puissance” nietzschéenne
La puissance est pour Evola, l'ultima ratio de l'ordre du monde en même temps que la justification de ce que rien d'extérieur à elle-même ne saurait justifier. Elle lui apparaît tout à la fois comme « le principe de l'absolu », « l'arbitraire causalité inconditionnée », « l'agir qui se justifie de lui-même et non en fonction de telle ou telle calamité », c'est-à-dire comme le nom qui désigne l'autonomie dans le déploiement effectif de son essence (1). On comprend donc que rien ne puisse exister, ni même seulement se concevoir, en dehors d'un libre acte de puissance, y compris la vérité : « Plus la puissance est complète, plus ses manifestations auront une cohérence, une forme absolue, une loi — une “rationalité”, sur tous les plans. Ainsi, même la “vérité” est un reflet de la puissance » (2).
Déjà présente chez le jeune Evola, à l'époque où celui-ci se livre à des spéculations plus philosophiques que métaphysiques (3) avec le thème de « l'homme comme puissance » (4), cette conception ne sera par la suite jamais remise en cause. Elle prend sa source dans le concept nietzschéen de « volonté de puissance », à la condition de ne pas entendre l'expression dans le sens borné d'exaltation d'une force brutale (Evola dirait « titanique »), analyse que beaucoup partagent aujourd'hui, ce qui ne l'empêche nullement d'être erronée (5). L'éloge de la puissance auquel se livre Evola ne peut en effet se comprendre en dehors de cette référence obligée à l'œuvre du philosophe allemand, et doit être lu en liaison avec l'exposé que fait F. Nietzsche de ce qu'il nomme la « morale des maîtres » (6). Si la puissance évolienne apparaît comme instance normative, c'est-à-dire liée à un vouloir originellement libre, c'est avant tout parce qu'Evola, de son propre aveu, a été impressionné dès son jeune âge par « l'affirmation des principes d'une morale aristocratique et des valeurs de l'être qui se libère de tout lien et est à lui-même sa propre loi » (Chemin…), affirmation qu'il a découverte dans l'œuvre de Nietzsche.
Sensible au thème de la puissance, Evola ne pouvait pas ne pas se sentir attiré par le tantrisme, voie dans laquelle, nous dit-il, « le point de départ consiste à poser que le principe et la mesure de tout être et de toute forme sont une énergie, une puissance agissante qui s'exprime d'une façon ou d'une autre » (Le yoga tantrique). Mais, fidèle à sa conception volontariste de la réalisation, il ne pouvait pas non plus ne pas s'intéresser au bouddhisme, dans la mesure où : « Le Bouddha lui-même s'était présenté comme un homme s'étant ouvert la voie par lui-même, avec ses seules forces, comme “ascète combattant”, même si, par ailleurs, il devait être le point de départ d'une chaîne de maîtres et d'influences spirituelles liées à eux » (Chemin…), ce qui ne pouvait manquer de faire de lui, pour l'auteur italien, un exemple d'« initiation prométhéenne » réussie (7).
b) Tantrisme et bouddhisme
Peu de doctrines paraissent aussi immédiatement en accord avec les conceptions évoliennes que le tantrisme lequel, avec « sa vision du monde comme puissance » et son « expérimentalisme qui ne se limite pas à l'expérience sensible et empirique » (Chemin…), se présente comme une voie essentiellement active, étrangère à toute idée d'évasion du monde et hostile aux démarches purement spéculatives, trait qui, d'après J. Evola, le rapproche du bouddhisme (8). Dans le tantrisme, en effet, la Libération s'obtient ici et maintenant, avec pour point de départ un travail sur le corps, ce dernier étant conçu d'une manière totalement différente du simple système organique auquel prétend le réduire la science moderne. « Bien qu'un entraînement psychique et mental adéquat soit présupposé, écrit à ce sujet J. Evola, il s'agit avec lui [le yoga tantrique] de prendre le corps comme base et instrument : non pas le corps tel qu'il est connu par l'anatomie et la physiologie occidentales, mais bien le corps en fonction, également, de ses énergies les plus profondes, transbiologiques, habituellement non perçues par la conscience ordinaire, spécialement par celle de l'homme d'aujourd'hui, énergies qui correspondent aux éléments et aux puissances de l'univers, étudiées par la millénaire physiologie hyperphysique qui, en Orient, a connu un développement non moins systématique que l'étude occidentale de l'organisme humain » (9).
Ce caractère avant tout pratique s'explique par le fait que le système des tantras (10) se considère lui-même comme l'adaptation de l'enseignement Traditionnel aux nécessités de l'Âge sombre, ce Kali-Yuga dans lequel nous vivons à en croire les traditionnistes (11). Il est évident que les possibilités d'obtenir la Libération offertes à l'Humanité des derniers temps, ne peuvent être celles que connaissaient les hommes vivant à des époques moins éloignées de l'origine. Le tantrisme se donne donc pour but de proposer des techniques adaptées à l'époque présente (12). Mais leur usage n'en reste pas moins réservé à une élite, ce qu'Evola ne se fait pas faute de souligner en affirmant que « si l'homme occidental qui est, sinon intellectuellement, du moins existentiellement, le moins qualifié pour cela, assumait directement, non pas comme de simples théories, des doctrines de ce genre, l'effet pratiquement inévitable serait un court-circuit destructeur, la folie ou le suicide » (Chemin…). Car dans la vision du monde tantrique, tous les hommes ne sont pas appelés également à être libres (13).
Différent du tantrisme par ses modalités, mais identique à lui quant à son essence et à sa finalité selon J. Evola (14), le bouddhisme apparaît également au métaphysicien italien comme une voie authentique, au point que celui-ci n'hésita pas à en faire des années durant « un usage quotidien, pratique et de réalisation » (15). Contrairement à ce qu'une opinion trop répandue laisse généralement croire, estime notre auteur, « le renoncement bouddhique est viril et aristocratique, dicté par la force, non imposé par le besoin, voulu au contraire pour surmonter le besoin et recouvrer une vie parfaite » (Révolte…). C'est pourquoi les qualités exigées de l'adepte novice sont des « qualités de combattant » (16), caractéristique dans laquelle Evola voit la preuve décisive que le bouddhisme constitue bien : « une ascèse aristocratique tournée vers une fin authentiquement transcendante » (Révolte…), et non une tentative désespérée d'échapper à un monde trop rude pour pouvoir être supporté (17).
Peu inquiet à l'idée de déplaire à ceux qu'il nomme dédaigneusement « les amis occidentaux du bouddhisme », Evola rejette toutes les interprétations qui font de ce dernier « une doctrine sentimentale d'amour et de compassion universelle, que l'on doit admirer aussi pour sa liberté vis-à-vis des dogmes, des rites, des sacrements ; presque une sorte de religion séculaire » (18). Tout au contraire, affirme-t-il, « la doctrine de l'éveil et de l'illumination, le noyau essentiel du Bouddhisme, n'a rien d'une “religion”, parce qu'elle est par essence de caractère “initiatique” et ésotérique, et seulement accessible en tant que telle à quelques élus. Elle ne représente pas une “voie large” ouverte à tous (comme le fut par plus d'un de ses aspects, à commencer presque par son nom, le Mahâyâna), mais un “sentier droit et étroit”, réservé à une minorité » (19). Nécessairement élitiste, dans la mesure où elle « se présente comme un pur système de techniques » (Révolte…), ce qui la rend inaccessible tant aux spéculations intellectuelles (20) qu'aux impératifs catégoriques de la morale (21), la « Doctrine de l'Éveil » telle que nous la présente J. Evola se veut ainsi une voie héroïque qui s'enracine dans « un fond de grandeur et de virilité spirituelle qu'il serait difficile de trouver dans aucune autre tradition, à côté de laquelle les valeurs religieuses de la “sainteté” elle-même sont pâles et faibles » (22).
S'il légitime le volontarisme de la réalisation, l'éloge de la virilité spirituelle auquel se livre Evola sous-tend également l'affirmation de la prééminence de la « Lumière du Nord ». Cette affirmation constitue la troisième idiosyncrasie évolienne, même si, comme le fait remarquer l'auteur italien : « L'idée d'une origine nordique, hyperboréenne, de la tradition primordiale faisait partie du savoir interne auquel Guénon avait été initié » (23).
► Julius Evola, métaphysicien et penseur politique : essai d'analyse, structurale, Jean-Paul Lippi, L'Âge d'Homme, 1998, p. 67-69.
• Notes :
• 1) Cette autonomie, signature métaphysique du masculin pour Evola, trouve sa traduction politique dans l'autarcie, laquelle se voit ainsi dotée d'une valeur éthique (cf. Essais politiques, Pardès, p. 189-194).
• 2) Le chemin du Cinabre. Cette perception de la vérité comme simple incidence de la puissance est bien entendu pensée comme inaccessible à la plupart des hommes. Elle n'est possible, selon Evola, qu'au « Moi intégré » (lequel est identique à l'Éveillé ou à l'Initié) seul à même de comprendre et surtout d'admettre qu'« on ne veut pas quelque chose parce qu'on la reconnait juste, rationnelle ou vraie, mais elle apparait juste, rationnelle ou vraie simplement parce qu'on la veut » (ibidem). L'influence de la pensée de Nietzsche est ici des plus évidentes (sur cette question, cf. J. Granier, Le problème de la Vérité dans la philosophie de Nietzsche, Seuil, 1966).
• 3) Sur la distinction entre philosophie et métaphysique dans la perspective évolienne, cf la note 22 de notre introduction. La période proprement philosophique dans l'élaboration et l'exposition de la pensée évolienne s'étend de 1923 à 1927, certains écrits ayant cependant été publiés plus tardivement (jusqu'en 1930 !). C'est l'époque où J. Evola s'intéresse à l'Idéalisme transcendantal, qualifié plus tard par de « courant au fond problématique et suspect » (Chemin du Cinabre) et qu'il rectifie d'emblée dans le sens d'un « Idéalisme magique » (Essai sur l'idéalisme magique, 1925). C'est aussi celle où est décrit l'« Individu Absolu » (avec les deux ouvrages Théorie de l'individu absolu, 1927 et Phénoménologie de l'individu absolu, 1930), personnage encore plus stirnérien que nietzscheen, « sans lois, destructeur de tout lien » (Chemin…), dont Evola soutiendra toujours qu'il n'est nullement incompatible avec la vision Traditionnelle du Monde, la conciliation des deux perspectives dépendant « seulement d'une descente de l'Individu Absolu des hauteurs solitaires, abstraites et réifiées, dans tout ce que l'hisloire implique de concret, avec une évolution correspondante en ce qui concerne le concept de puissance », descente qui permettrait un « passage du “surhumain” en marge d'un individualisme exaspéré, au “non-humain”, c'est-à-dire au plan d'une impersonnalité supérieure liée à la possession réelle d'une dignité transcendante et à une fonction d'en haut ». S'il abandonna rapidement le style philosophique, Evola ne renia jamais cette période de sa vie, préférant considérer que « les œuvres philosophiques écrites [par lui] se présentaient comme une sorte de propédeutique pour l'accès éventuel à un domaine qui n'était plus celui de la pensée discursive et de la spéculation, mais bien celui de l'action intérieure réalisatrice, destinée à dépasser la limite humaine », tout en déconseillant la lecture à ceux qui auraient pu vouloir le suivre dans sa démarche existentielle. Sur cette question, cf. R. Melchionda, « Evola et la philosophie », in Dossiers H : Julius Evola, (dir.) A. Guyot-Jeannin, Âge d'Homme, pp. 19-32.
• 4) L'uomo com potenza : I Tantra nella loro metafisica e nei loro metodi di autorealizzazione magica [L'homme comme puissance : Les Tantras dans leur métaphysique et dans leurs méthodes d'auto-réalisation magique], Atanor, Todi-Roma, 1926. Une seconde édition (totalememt remaniée) de l'ouvrage paraîtra en 1949 aux Éd. Bocca, Milan, sous le titre Lo Yoga della potenza : Saggio sui Tantra [Le yoga de la puissance : Essai sur la Tantras]. C'est cette dernière qui est disponible en langue française aux Éd. Fayard dans la traduction de Gabrielle Robinet sous le titre Le yoga tantrique : Sa métaphysique, ses pratiques. Sur cet ouvrage, cf. l'analyse de M. Yourcenar, « Approches du tantrisme », in Le temps, ce grand sculpteur (Gal., 1983, pp. 197-205).
• 5) « Voilà ce qu'est la volonté de puissance, écrit Gilles Deleuze : l'élément généalogique de la force, à la fois différentiel et génétique. La volonté de puissance est l'élément dont découlent à la fois la différence de quantité de forces mises en rapport et la qualité qui, dans ce rapport, revient à chaque force (…). La volonté de puissance s'ajoute donc à la force, mais comme l'élément différentiel et génétique, comme l'élément interne de sa production » (Nietzsche et la philosophie, PUF, 1962). Si l'on se souvient de la précision, apportée par Nietzsche lui-même, selon laquelle « Un quantum de puissance se définit par l'effet qu'il produit et auquel il résiste » (Fragments posthumes, in OC, XIV, Gal., p. 56), il devient clair que la volonté de puissance ne peut ni s'épuiser comme envie d'un surplus de force, ni se confondre avec une quelconque libido dominandi. Elle n'est pas un désir de dominer ou de posséder, ce qui la qualifierait comme manque, et par conséquent la nierait, mais le jeu, libre parce qu'éternel et sans finalité extérieure à lui-même, de la puissance auto-suffisante voulant au travers de la volonté qu'en dernière instance elle détermine. C'est pourquoi G. Deleuze peut affirmer qu'elle « ne consiste pas à convoiter ni même à prendre, mais à créer et à donner » (Nietzsche, PUF, 1965). Nous sommes donc loin des lectures hâtives et/ou partiales qui veulent absolument voir dans l'œuvre de Nietzsche une justification avant l'heure de la violence de certains régimes totalitaires, quand bien même la récupération des thèses du Solitaire de Sils-Maria serait ici ou là repérable.
• 6) La « morale des maîtres », c'est pour Nietzsche toute éthique qui procède de la puissance, caractéristique qui la rend immédiatement affirmative parce que libre. À cette « morale des maîtres » s'oppose la « morale des esclaves », sous-tendue par le ressentiment parce que procédant de la faiblesse, et par conséquent productrice de négation. « Tandis que toute morale aristocratique, écrit Nietzsche, naît d'une triomphale affirmation d'elle-méme, la morale des esclaves oppose dès l'abord un “non” à ce qui ne fait pas partie d'elle-méme, à ce qui est “différent” d'elle, à ce qui est son “non moi” : et ce non est son acte créateur » (Généalogie de la morale, Ière dissertation). Il va de soi que les termes « maîtres » et « esclaves » doivent être pris ici dans un sens métaphorique, même si des incidences politiques demeurent toujours possibles.
• 7) L'analyse guénonienne des origines du bouddhisme n'est guère éloignée de celle à laquelle se livre Evola, même si, comme l'on pouvait s'y attendre, R. Guénon porte un jugement sévère sur ce qui apparaît à l'auteur italien comme un trait digne d'éloges. Selon le Français, le bouddhisme primordial, en raison de son caractère individualiste, est une simple « déviation de l'esprit oriental » (Orient et Occident, 1924), voire « une doctrine antitraditionnelle, et véritablement anarchique au point de vue social » (Intro. gén. à l'étude des doctrines hindoues, 1921). L'opinion originelle de Guénon évoluera sensiblement avec les années, en particulier sous l'influence d'Ananda K. Coomaraswamy, mais sans jamais aller jusqu'à approuver la doctrine du Bouddha (sur les positions de Guénon concernant les rapports du bouddhisme et de l'hindouisme et leur évolution, cf. P. Sérant, René Guenon, Courrier du livre, 1977, p. 81-83 ; de Coomaraswamy, cf. Hindouisme et bouddhisme, Gal., 1949).
• 8) « Encore que bien éloigné de rejeter l'ancienne sagesse, affirme Evola, le tantrisme réagit pourtant contre le ritualisme stéréotypé et vide, contre la spéculation ou la contemplations pures et contre tout ascétisme de caractère unilatéral, fait de mortifications et de pénitences. On peut même dire qu'à la voie de la contemplation il oppose la voie de l'action, de la réalisation pratique, de l'expérience directe. La pratique — sâdhanâ, abhyâsa — c'est là son mot d'ordre (selon la voie qu'on pourrait appeler la “voie sèche”), et nous pouvons trouver là une ressemblance avec la position qui fut adoptée à l'origine par le bouddhisme, par la “doctrine de l'éveil”, dans sa réaction au même brahmanisme dégénéré et son aversion pour les spéculations et le ritualisme vide » (YT). R. Guénon est loin de partager cette vision d'un tantrisme en rupture avec un brahmanisme devenu lettre morte. Pour lui, « les livres tantriques se rattachent en effet directement à la grande tradition indhoue, qui est essentiellement une depuis l'origine, quoi qu'en puisse dire Evola » (Lettre du 12 janvier 1929 à Guido de Giorgio, reproduite in : G. de Giorgio, L'instant et l'éternité, Archè, Milan, p. 287).
• 9) Chemin…, p. 63. Pour les adeptes du tantrisme, le corps est essentiellement « un vaste réservoir de Puissance (Shakti) [et] l'objet des rites tantriques est de conduire ces différentes formes de puissance à leur pleine expression. C'est l'œuvre de la Sadhânâ » (Sir John Woodroffe [Arthur Avalon], La puissante du serpent, 1918). Le siège de cette Puissance est affirmé se trouver dans la région du périnée (« Mûlâdhâra-Chakra »), où repose une énergie appelée Kundalinî, laquelle « semble être recroquevillée, repliée sur elle-même, cachant sa véritable nature et ses pouvoirs. Elle se terre, elle se love dans la matière comme un serpent endormi. Et elle demeure là, endormie, oublieuse, tassée en spirale, bloquant par son inertie la voie de la remontée vers le Principe suprême » (Tara Michaël, Corps subtil et corps causal, Les six çakras et la Kundalini yoga, Courrier du Livre, 1979). L'éveil de cette énergie serait rendu possible par un certain nombre de pratiques physiques, telles que le contrôle de la respiration allié à la contraction rythmique du sphincter anal, pratiques qui choquèrent Arthur Koestler lors du voyage que celui-ci effectua en Inde, l'amenant à écrire : « L'ascension de Kundalinî, de lotus en lotus, de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la tête, sa métamorphose de force biologique en force spirituelle, est une très belle parabole ; mais l'esprit humain tend constamment à avilir, par de pseudo-rationalisations, ce qui devrait rester symbole ; et c'est ainsi que le mystique indien apprend à cligner de l'anus afin de parvenir à l'Union avec Brahma » (Le lotus et le robot, 1961). Le tantrisme propose également des techniques de Libération fondées sur un usage codifié de la sexualité, lesquelles lui ont parfois valu le qualificatif exagérément réducteur de « yoga sexuel » (cf. JL Bernard, Le tantrisme, yoga sexuel, Belfond, 1975), quand elle ne lui ont pas attiré l'hostilité des moralistes (« Combien d'erreurs ont encore cours en Occident à ce sujet ! déplore Marcel Rivière. Qui n'a lu les qualificatifs “honteux et répugnants” associés au culte soit du lingam, soit des Shaktis divines », Le yoga tantrique hindou et tibétain, Archè, Milan, 4ème édition revue et augmentée, 1979). En fait, s'il est indéniable que « la caractéristique fondamentale du tantrisme est la valorisation de l'acte sexuel et de ce qui l'entoure : non seulement le choix des partenaires et les recettes pour l'exécution correcte de la chose, mais aussi exaltation du “décor” (chambre, vêtements, etc.) et des organes mis en jeu à cette occasion (phallus, vagin, etc.) » (L'enseignement secret de la Divine Shakti, anthologie de textes tantriques traduits du sanskrit et commentés par J. Varenne, « Introduction générale », Grasset, 1995), on ne saurait comprendre le sens véritable de la « métaphysique du sexe » à l'œuvre dans cette école si l'on oublie que, ainsi que l'expliquent Ajit Mookerjee et Madhu Khanna : « Dans les rituels tantriques, chaque femme est vue comme une émanation du principe féminin et devient une réincarnation de l'Énergie cosmique, symbolisant l'essence ultime de la réalité » (La voie du Tantra : Art-science-rituel, Seuil, 1979, p. 16). Pour une analyse évolienne de ces techniques, cf. Le Yoga tantrique, p. 178-214, ainsi que Métaphysique du sexe, p. 303-323.
• 10) Un abus de langage courant donne au mot « tantra » le sens d'adepte tantrique. En réalité, les « tantras » sont les ouvrages dans lesquels est consigné l'enseignement tantrique, ceux qui mettent en pratique cet enseignement se nommant des « tantrikas ». Selon Pierre Feuga : « Le terme sanskrit tantra (…) évoque le symbolisme du tissage ; il signifie “tissu”, “fil” ou ensemble des fils parallèles tendus sur un métier dans le sens de la longueur (la chaîne par opposition à la trame). On le dit dérivé de la racine tan (étendre, étirer, prolonger, amplifier), le suffixe tra pouvant suggérer l'idée de salut. Du sens de “texture” on passe à celui de “texte”, d'un livre — pas nécessairement didactique ni sacré — possédant une certaine "étendue", à l'opposé des Sutras qui ne sont composés que de noms “enfilés”, de phrases brèves destinées à être apprises par cœur avant d'être explicitées par un maître » (Tantrisme : Doctrine, pratique, art, rituel, Dangles, 1994, pp.19-20).
• 11) « L'une des caractéristiques de la doctrine hindoue à laquelle on peut donner le nom générique de Tantrisme, souligne Evola, consiste en ce qu'elle prétend offrir une formulation de la doctrine traditionnelle, qui soit seulement appropriée à la dernière époque du cycle actuel, c'est-à-dire au Kali-Yuga (« Ce que le tantrisme signifie pour la civilisation occidentale moderne », 1950, in Orient et Occident, Archè, Milan, 1982). [Cf. aussi Mét. du sexe, ch. 6, § 53].
• 12) « À la suite d'un changement profond, dans cette époque, écrit Evola, les conditions existentielles générales sont différentes de celles des origines, pour lesquelles la sagesse des Védas avait été formulée. Désormais, les forces élémentaires prédominent, l'homme se trouve uni à elles et ne peut plus reculer ; il doit les affronter, les dominer et les transformer s’il désire la libération, et même la liberté. Pour beaucoup, la voie ne peut être la voie purement intellectuelle, ascétique et contemplative, ou rituelle. La pure connaissance doit donner lieu à l’action, si bien que le tantrisme s'est lui-méme défini comme un Sâdhana-çastra, c'est-à-dire un système basé sur les techniques et sur l'effort réalisateur. Selon son point de vue, la connaissanse doit servir d'instrument pour la réalisation et la transformation réelle de l'être » (Chemin…). Evola rejoint ici Alain Daniélou pour lequel « La voie shivaïte est la voie tantrique, tamasique, qui utilise les fonctions physiques et les aspects apparemment négatifs, destructifs, sensuels de l'animal humain comme point de départ, alors que la voie sattvique emploie l'ascétisme, la vertu, l'intellect comme instruments. La voie sattvique est considérée comme inefficace dans le Kali Yuga (…). Seules les méthodes du Yoga tantrique sont efficaces dans cet Âge où les valeurs se confondent et les rites, l'ascétisme et les vertus des autres Âges sont sans effet » (Shiva et Dionysos, Arthème Fayard, 1979).
• 13) Ainsi que le rappelle Giuseppe Tucci : « On peut donc voir que les écoles shivaïstes [c'est-à-dire celles qui se réclament du dieu Shiva, personnification de la force destructrice de l'univers, et dont font partie les écoles tantriques] divisent les hommes en 3 groupes : d'abord celui des personnes du commun qui vivent à la manière du bétail et pour lesquelles il faut des lois précises et des interdits, car elles n'ont pas encore une conscience qui peut se régler d'elle-même : elles sont surtout animalité. Puis vient le groupe des héros, ceux qui tendent à sortir de la nuit. Mais c'est une capacité qui leur demande de grands efforts : ils suivent leur propre conscience, ils font leurs propres lois, hommes seuls, qui vont à contre-courant, qui se mettent courageusement en contact avec Dieu, en se dérobant à l'uniformité de la vie en société. Enfin, il y a le groupe des divya, les Âmes saintes, celles qui sont déjà hors du plan samsarique, pleinement réalisées » (Théorie et pratique du mandala, Fayard, 1974). On remarquera la conformité de cette tripartition avec la doctrine des gunas, ainsi que son étroite parenté avec les conceptions gnostiques, en particulier valentiniennes, divisant les hommes en "hyliques", "psychiques" et "pneumatiques" (sur la vision du monde gnostique, cf. H. Cornélis et A. Léonard, La gnose éternelle, Fayard, 1961, ainsi que J. Lacarriére, Les gnostiques, Gal., 1973 ; sur Valentin [? — 161] cf. F. Sagnard, La gnose valentinienne et le témoignage de Saint Irénée, Vrin, 1947 ; Evola cite Valentin in Mét. du sexe, p. 152, note infropaginale n° 100).
• 14) « Au fond, le principe “Çiva” dans lequel, pour les Tantras, la "Çakti" doit trouver son seigneur, pour s'unir à lui indissolublement, est le même principe “extra-samsarique” que celui que l'ascète bouddhiste vise a dégager et à renforcer » (Chemin…).
• 15) Chemin… C'est le bouddhisme qui permit à Evola de dépasser « la crise intérieure qu'il [lui] fallut traverser tout de suite après la Première Guerre mondiale » (ibid.), le sauvant ainsi du suicide. Quand parut La Doctrine de l'Éveil, son auteur estima avoir enfin « payé une dette qu'[il] avai[t] contractée à l'égard de la doctrine du Bouddha » (ibid.).
• 16) Cf. « Les qualités du combattant et le “départ” », in La Doctrine de l'Éveil. Ces qualités sont au nombre de 5. Ce sont : la confiance, le savoir, la loyauté, l'énergie virile et l'équilibre physique. Il est à noter que le terme "combattant" peut s'entendre tout aussi bien ici dans un sens pratique que métaphorique, Evola rejetant comme « une dénaturation » ce qu'il dépeint sous les traits de « la figurine humanitaire, finaliste, végétarienne du Bouddhisme », pour affirmer : « Un Samouraï et un Kamikaze peuvent également très bien être bouddhistes » (« La virilité spirituelle dans le bouddhisme », article paru en langue anglaise in East and West, janv. 1957, et reproduit in : Orient et Occident, 1982).
• 17) J. Evola se sépare totalement sur ce point de F. Nietzsche, d'après lequel « le bouddhisme est une religion pour hommes tardifs, pour des races débonnaires, douces, devenues hypercérébrales, qui ressentent trop aisément la souffrance (…), une religion faite pour l'aboutissement, la lassitude de la civilisation » (L'Antéchrist). Ces traits rapprochent pour Nietzsche le bouddhisme du christianisme, les deux étant « des religions de décadence », même si le rapport entre processus décadentiel et spiritualité y est inversé, le bouddhisme apparaissant comme une réponse à ce processus alors que le christianisme en constituerait la cause, lui dont la méthode de conquête a consisté, selon l'analyse que fait Nietzsche, à « rendre malades » les vieilles aristocraties. L'influence des conceptions de Schopenhauer sur la genèse de la pensée nietzschéenne est ici manifeste, l'auteur du Monde comme volonté et comme représentation (1819) voyant dans « l'ascétisme bouddhique [un] renoncement plus grandiose encore [que celui du christianisme] puisqu'il mène à l'espoir du néant » (J. Bourdeau, « Vie et opinions d'Arthur Schopenhauer », in Schopenhauer, Pensées et fragments, Slatkine, 1979). R. Guénon se montrera sévère sur ce point à l'encontre de Schopenhauer, lequel a selon lui « une bonne part de responsabilité dans la façon dont l'Orient (en Allemagne) y est interprété » ; « et combien de gens, écrit Guénon, même en dehors d'Allemagne, s'en vont répétant, après lui et son disciple von Hartmann, des phrases toutes faites sur le “pessimisme bouddhique”, qu'ils supposent même volontiers faire le fond des doctrines hindoues ! », pour refuser finalement de voir dans les analyses de Schopenhauer autre chose qu'un symptôme du « sentimentalisme occidental » (Orient et Occident, 1924). Pour une étude des causes de l'incompréhension du bouddhisme par les philosophes occidentaux lors de sa réception, cf. R-P. Droit, Le culte du néant : Les philosophes et le Bouddha, Seuil, 1997 (en part. les pp. 205-212 pour Nietzsche et pp. 135-152 pour Schopenhauer).
• 18) In : « La virilité spirituelle dans le bouddhisme ». Evola a toujours nié formellement l'idée selon laquelle le bouddhisme pourrait être légitimement assimilé à une religion, fût-elle « séculaire ». « Le bouddhisme n'est pas une religion, affirme-t-il, de la même façon que toute doctrine initiatique ou ésotérique ne peut être appelée “religion” » (Chemin…). Par rapport au « plan religieux », « il transcende un tel plan, le laisse derrière lui ». « Quant aux formes dans lesquelles le Bouddhisme est devenu une religion sui generis, et, encore pire, quant à ces formes ou il est conçu et apprécié comme une morale démocratique humanitaire, précise-t-il, on doit les considérer derechef comme une souillure sans égale de la verité » (in : « La virilité spirituelle dans le bouddhisme »). On imagine sans peine la réaction de l'auteur italien aux thèses de l'actuel Dalaï-lama, lequel déclare : « Je ne pense pas qu'il y ait des contradictions entre démocratie et bouddhisme. Je dirai même que le bouddhisme mâhâyâniste est la religion de la démocratie » (« Réflexions sur la société actuelle et l'avenir du monde », conférence prononcée le 7 novembre 1993 au Palais des Sports de Toulouse et reproduite in Au-delà des dogmes, Albin Michel, 1994).
• 19) In : « La virilité spirituelle dans le bouddhisme ». Le Mâhâyâna constitue dans le bouddhisme le courant dit du « Grand Véhicule », par opposition au Hînayâna ou « Petit Véhicule ». La distinction des deux courants provient d'une scission qui trouve son origine dans l'opposition entre « Araht » (ou « Anciens ») et « Mahâsanghika » (littéralement « les Membres de la Grande Assemblée »). Ainsi que l'explique Edward Conze : « Vers le temps d'Asoka (soit au IIIe s. av. l'ère chrétienne), les dissensions dans l'Ordre paraissent avoir conduit à un premier schisme. Le Sthavira-vâda se sépara des Mahâsanghika, ou vice versa. Le Sthavira-vâda était l'élément conservateur qui "suivait la doctrine des Anciens", alors que les Mahâ-sanghika, les Grands Assemblages, adhéraient à la Grande Assemblée, qui englobait des moines de moindres réalisations et des maîtres de maison [grihastha], en opposition à l'Assemblée des Arhat, exclusive et démocratique. (…) Les Mahâsanghika devinrent le point de départ du développement du Mâhâyâna par leur attitude plus libérale et par quelques unes de leurs théories particulières » (Le bouddhisme, Payot, 1978, pp. 137-138). Le schisme trouve donc son origine dans la volonté d'actualiser le message du Bouddha en le rendent plus accessible aux masses indiennes, volonté rejetée par les « Anciens ». Selon Michel Coquet : « Les premiers bouddhistes appelés les Anciens représentent le pur Bouddhisme ou plutôt la pensée originelle du Bouddha qui, dans cette forme, repousse toute spéculation théologique ou ésotérique, accordant moins d'importance à l'esprit qu'à la lettre. De ce fait, les hînayânistes se sont fortement attachés aux Sutras du canon Palia et n'acceptent aucune autre écriture bouddhique. En ce sens, ils n'admettent une croyance que si celle-ci est fondée sur un fait historique, conception opposée à celle des mâhâyânistes qui considèrent leurs antagonistes comme des conservateurs cristallisés, incapables d'adaptation nouvelle au courant moderne de la pensée bouddhiste » (Le bouddhisme ésotérique japonais, Vestiges, 1986, p. 25 ; selon Coquet, « le Mâhâyâna est sans doute issu des écoles du brahmanisme ancien »). On pourrait s'attendre à voir Evola prendre position en faveur du « Petit Véhicule », mais il n'en est rien. Si le Mâhâyâna, « à la métaphysique foisonnante et se complaisant dans un symbolisme abstrus », lui paraît condamnable, le Hînayâna, « plus sévère et plus dépouillé dans ses enseignements, mais trop préoccupé de la simple morale comprise dans une perspective plus ou moins monastique », lui semble finalement ne valoir guère mieux. Dans les deux cas, « le noyau essentiel et originel, à savoir la doctrine ésotérique de l'Éveil, fut pratiquement perdu » (« Sens et atmosphère du zen », in : Explorations). Ce « noyau essentiel », seul le zen l’aurait repris, ce qui fait de lui « une réaction contre tout ceci, aussi énergique que celle qui fut la propre réaction, en son temps, du bouddhisme des artifices » (La Doctrine de l'Éveil ; sur les rapport de J. Evola et du zen, cf. C. Levalois, « Julius Evola et le zen », L'Âge d'Or n°4, Pardès, 1985 ; sur le zen, cf. E. Herrigel, La voie du zen, suivi de Pratique du bouddhisme, Maisonneuve & Larose, 1976).
• 20) « À cet égard, affirme Evola, le bouddhisme se caractérise aussi par sa manière d'opposer à ce qui est simple doctrine ou dialectique et qui en Grèce deviendra "pensée philosophique", un esprit pragmatique et réaliste » (Révolte…). D'une manière générale, l'enseignement du Bouddha paraît effectivement peu compatible avec la démarche spéculative, quel que soit l'objet de celle-ci. « Le bouddhisme, constate Jacques de Maquette, prévient ses disciples contre un intérêt trop poussé pour la nature et le devenir d'un monde transcendant. Pour lui, l'étude de toutes les sciences matérielles et pratiques n'a aucune valeur pour l'Âme assoiffée de libération, car elles traitent exclusivement des conséquences du Karma asservissant » (Introduction à la mystique comparée Hindouisme- Bouddhisme- Grèce- Israël- Christianisme- Islam, Duncan, Paris, 1948).
• 21) Selon Julius Evola, « la réduction du Bouddhisme à de simples enseignements moraux apparaît comme le comble de l'absurdité » (« La virilité spirituelle dans le bouddhisme »), dans la mesure où « chez peu d'autres systèmes comme chez le bouddhisme, se trouvent évitées les collusions entre ascèse et moralité, et l’on est ainsi conscient de la valeur purement instrumentale que la seconde a pour la première » (La Doctrine de l'Éveil).
• 22) In : « La virilité spirituelle dans le bouddhisme ». « Elle est à part et reste un sommet, précise Evola, portant témoignage de ce qu'une humanité supérieure pouvait concevoir » (ibid.).
• 23) Chemin… R. Guénon semble bien abonder dans le sens d'Evola quand il écrit : « On trouve partout l'affirmation formelle que la tradition primordiale du cycle actuel est venue des régions hyperboréennes ; il y eut ensuite plusieurs courants secondaires, correspondant à des périodes diverses, et dont un des plus importants, tout au moins parmi ceux dont les vestiges sont encore discernables, alla incontestablement de l'Occident vers l'Orient » (La crise du monde moderne, 1927), ce qui l'amène à attester « l'origine des traditions comme nordique, et même plus exactement comme polaire » (« Atlantide et Hyperborée », in : Formes traditionnelles et cycles cosmiques, recueil posthume d’articles, Gal., 1970, p. 37).
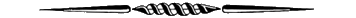
C'est en 1952 que j'achetai par hasard dans une librairie de Florence, et dans son original italien, Lo Yoga della Potenza (Le Yoga de la puissance) traduit plus sagement en français, des années plus lard, sous le titre du Yoga tantrique [Fayard, 1971]. De l'auteur, Julius Evola, j'ignorais alors même le nom. Sauf pour quelques réserves, que je ferai plus tard, j'avais acquis là un de ces ouvrages qui pendant des années vous alimentent, et, jusqu'à un certain point, vous transforment.
Comme beaucoup de monde en France, j'avais d'abord entrevu le Tantrisme à travers Mystiques et magiciens du Tibet, par Alexandra David-Neel. Beaucoup plus tard, l'helléniste et orientalisant Gabriel Germain, dans cette sorte de mémoires de sa vie mentale, Le Regard intérieur [Seuil, 1968], ce document trop peu lu, a signalé ce qu'il devait à ce livre, abordé très jeune. Une femme intelligente et hardie mêlait à ses récits de voyages un travelogue concernant d'étranges confins. Qu'on la crût ou non sur tous les points, elle nous menait comme par la main sur le rebord de cavernes dont nous sentions bien que, eussions-nous osé les explorer, nous les aurions aussi découvertes en nous-mêmes. Entre temps, j'avais lu un certain nombre d'ouvrages savants sur le sujet. J'avais appris ce qui différencie Tantrisme çivaite et Tantrisme bouddhique (les ressemblances prévalent sur les différences) ; je savais à peu près ce que c'est qu'une mandala, une mantra et une modra, et quelques équivalences entre les noms des divinités hindoues et des divinités tibétaines. L'ouvrage d'Evola, si récusable qu'il me parût sous certains rapports, m'apportait davantage encore : l'exposé d'une méthode.
D'autres, plus qualifiés que moi, réexamineront dans son ensemble le bouddhisme tantrique. Disons très en gros qu'il s'agit d'une méthode de gymnastique spirituelle, que sous-tend une psychologie qui mérite à bon droit d'être qualifiée de psychologie des profondeurs, et que celle-ci, comme c'est toujours le cas, sciemment ou non, prend elle-même appui sur une métaphysique.
Une des erreurs irréparables de l'Occident a été probablement de conceptualiser la complexe substance humaine sous la forme antithétique âme-corps, et de ne sortir ensuite de cette antithèse qu'en niant l'âme. Une autre, non moins déplorable, et qui va s'aggravant, consiste à n'imaginer de travail de perfectionnement ou de libération intérieurs qu'en faveur du développement de l'individu, ou de la personne, et non de l'effacement de ces 2 notions au profit de celle de l'être ou de ce qui va plus loin que l'être. Bien plus, pour l'Occidental, il semble que perfectionnement et libération s'opposent brutalement l'un à l'autre, au lieu de représenter les 2 aspects d'un même phénomène. L'étude du yoga tantrique tend à corriger ces erreurs, et c'est dire l'immense profit qu'un lecteur réceptif peut tirer d'une somme comme celle d'Evola.
Contrairement à ce qui se passe dans le Zen, où le réveil correspond à un choc ressenti comme soudain, bien que préparé par une plus ou moins longue attente, le réveil tantrique est progressif et dù à d'incessantes disciplines. Il s'agit pour l'adepte d'atteindre à un maximum d'attention, impossible elle-même sans un maximum de sérénité : une surface agitée ne réfléchit pas.
Les recettes transmises par Evola, et la complexe casuistique de causes et d'effets dont il les accompagne, me paraissent d'une telle importance, non seulement pour la vie spirituelle, mais pour l'utilisation de toutes les facultés, que je ne connais pas de condition humaine qu'elles ne puissent améliorer, que ce soit celle de l'homme d'action, de l'écrivain ou simplement de l'homme livré à la vie. Les personnes qui savent peu de chose du Tantrisme se préoccupent d'ordinaire surtout de son érotique : l'analyse détaillée d'Evola montre à quel point celle-ci fait partie intégrante d'un système où il s'agit de mobiliser et de discipliner toutes les forces. Nous sommes dans le domaine du sacré et de l'opposé des sex-shops.
Les procédés érotiques du Tantrisme ne tendent pas, comme ceux du Tao, à assurer à l'homme vigueur et longévité, et ne représentent pas non plus, comme ceux du Kama-Sutra, une hygiène de la jouissance ; ils s'efforcent plutôt à une sacralisation de l'union charnelle que l'Occident n'a jamais connue ou voulu accepter. Il s'agit, par une série d'interdits et de libérations successives, d'assimiler le plaisir à une hiérogamie qu'il est en effet, mais seulement à condition que les amants en aient pris conscience. La lente et graduelle familiarité obtenue par les moyens du regard, de la voix, du toucher, et finalement de la cohabitation physique, précédant la culmination charnelle, n'est guère chez nous réalisable que par une suite de hasards fortunés, et entre 2 êtres capables d'apprécier ces temps d'arrêt comme des étapes et non comme des obstacles. Dans un monde où la libération des mœurs sexuelles ne s'est pas accompagnée d'une revalorisation de la sensualité, tout au contraire, du moins à en juger par le film, la publicité des media, et la littérature de notre temps, le Maithurma, le coït sacré, n'est pas près de tomber dans le domaine public.
Il faudrait aussi, pour dissiper certains malentendus, parler des phonèmes (presque tous, sinon tous, sont des mantras sanscrites courantes dans les différentes sectes de l'hindouisme et du bouddhisme), dont les maîtres tantriques préconisent l'usage. Et tâcher d'expliquer, à plus forte raison, l'emploi des phonèmes non prononcés, gravés sur des pierres aux frais de pèlerins, ou moulés sur les bandes de moulins à prières. Pour une Europe sevrée de ses anciennes pratiques religieuses, de tels usages semblent superstition pure. Ils le sont pour une part, mais notre époque où la propagande politique et la vente de produits commerciaux s'imposent aux foules à l'aide de slogans quasi hypnotiques aurait tort de méconnaître que le rassérénement, la concentration, la libération physique et mentale peuvent aussi bénéficier de formules qui saturent l'àme. Une vieille marmonneuse égrenant un chapelet ne nous fait pas éprouver à un très haut degré le sentiment du sacré ; songeons pourtant que la poésie elle aussi est faite, ou le fut aux temps où elle se souvenait davantage de ses origines magiques, de répétitions quasi incantatoires de sons et de rythmes. L'interjection pure et simple, le juron ou l'obscénité, souvent si usés que le sens n'en est même plus perçu, soulagent ou calment à la façon de mantras celui qui les émet. Nous savons par ailleurs qu'au premier stade au moins du contrôle de soi, la répétition attentive d'une formule peut arrêter le flot désordonné des images qui emportent l'esprit, mais ne le portent nulle part.
Qui a entendu énoncer par un officiant une mantra sanscrite sait à quel point celle-ci se répand sur la foule à la façon d'ondes concentriques, enfermant l'auditeur dans le mystère du son. Il en allait de même naguère des prières en latin d'église, dont le phénomène sonore semblait agir ex opere operato. Ce n'est pas à notre époque, où la physique a fait des vibrations une science et une technique, de nier le pouvoir de la parole prononcée pour elle-même, cette notion où la mantra rejoint le Verbe selon saint Jean.
En présence de techniques qui se sont développées dans un riche terreau spirituel différent du nôtre, la première attitude est de tout rejeter, par mépris et par méfiance envers l'exotisme. La seconde, aussi néfaste, est d'être attirée précisément par cet exotisme. C'est l'un des très grands mérites d'Evola de joindre à une prodigieuse richesse du détail érudit le don d'isoler de leurs conditionnements locaux des idées ou des disciplines qui valent pour nous tous, et d'abolir même la notion d'exotisme. Comme la préface de Jung au Bardo Thodöl, qui survole de très haut un sujet analogue, l'ouvrage d'Evola sur Le Yoga tantrique et celui, presque aussi riche, qu'il a consacré à la tradition hermétique médiévale s'orientent, au moins superficiellement, dans le même sens que la psychologie moderne, mais avec quelques différences essentielles que Jung a notées et qu'Evola eût volontiers criées tout haut.
Du fait de son insistance sur les disciplines mentales, l'étude du Yoga tantrique est particulièrement salubre, à une époque où toute discipline est naïvement discréditée. D'autre part, grâce à la lucide analyse du contenu vivant d'un rituel, et des mythes auxquels ce rituel se réfère (je pense en particulier à la visualisation de divinités secondaires et aux visions d'outretombe), ce livre et quelques autres émanant d'érudits ayant travaillé dans le même domaine nous rendent la possibilité, que le rationalisme étroit du début du siècle semblait avoir éliminée à jamais, de comprendre, et jusqu'à un certain point, d'adhérer à nos propres rituels et à nos propres mythes.
Mon étude du Tantrisme m'a rapprochée, et non éloignée, de la pensée chrétienne. Elle ne m'a pas non plus éloignée de ce qu'aujourd'hui on appelle plus ou moins confusément l'humanisme, non seulement parce que la précision et la logique discriminative des recettes tantriques sont essentiellement intellectuelles, mais parce que ce ne sera, jamais contrarier la notion d'humanisme que d'essayer de connaître et de contrôler les forces qui sont en nous.
La méthode tantrique est psychologique et non éthique : il s'agit de capter des forces et non d'acquérir des vertus. C'est là l'occasion de graves malentendus.
En fait, et Proust, avec son acuité habituelle, avait noté ce phénomène, presque toutes les vertus, fût-ce la bonté, sont d'abord de l'énergie. Reste qu'il en est de ces forces ainsi libérées comme de l'électricité, qui peut électrocuter quelqu'un ou éclairer sa chambre. Le yoga tantrique est une pointe avancée du yoga hindou, avec, en plus, au Tibet, certains éléments chamaniques. Dans tous les cas, sa métaphysique relève soit de l'hindouisme non dualiste, soit du bouddhisme qui prêche le détachement et la compassion envers les êtres. Tout détournement de forces acquises par des disciplines mentales au profit de l'avidité, de l'orgueil et de la volonté de puissance n'annule pas ces forces, qu'elles soient normales, ou, d'une façon ou d'une autre, supra-normales, mais les fait retomber ipso facto dans un monde où toute action enchaîne et où tout excès de force se retourne contre le détenteur de celle-ci. Loi à laquelle rien n'échappe, et que nous avons vu s'exercer dans le domaine des forces technologiques, en elles-mêmes indifférentes au bien comme au mal, mais destructrices dès qu'elles sont mises entre les mains de l'avidité humaine. À l'intérieur des disciplines mentales du bouddhisme, comme d'ailleurs dans la mystique chrétienne, l'état de détachement et de clarté obtenu rend presque impensable toute utilisation des pouvoirs dans un but d'égoïsme néfaste.
Et c'est sur ce point que l'œuvre d'Evola, passionné de pouvoir pur, appelle certaines réserves. Qu'était cet homme qui nous a transmis l'essentiel de l'expérience tantrique tibétaine, peu d'années avant que des cataclysmes politiques réduisent cette tradition à l'état précaire de dissidence et d'exil ? Les quelques détails que je tiens de personnes qui l'ont connu sont invérifiables, bien qu'ils aillent dans le sens de traits de caractère que laissent çà et là entrevoir ses livres.
Evola, comme Malaparte, semble avoir appartenu à ce type d'Italiens germanisés en qui survivent encore on ne sait quelles obsessions gibelines. Il est de ceux que la Révolte contre le monde moderne (c'est le titre d'un de ses autres livres), si justifiée qu'elle soit en partie, a entraînés dans des parages plus périlleux encore que ceux qu'ils croyaient quitter.
Comme dans les œuvres de Stefan George, comme dans le Frédéric II de Cantorowitz [transcription italienne chez Evola du nom Kantorowicz], on rencontre de bonne heure dans ses livres un rêve de domination aristocratique et sacerdotal dont on n'a pas la preuve qu'il ait jamais correspondu à un âge d'or du passé, et dont nous n'avons vu de nos jours que des caricatures grotesques et atroces. Il s'y mêle, dans les moins pondérés des ouvrages d'Evola, outre un concept de la race élue, qui en pratique mène au racisme, une avidité quasi maladive à l'égard des pouvoirs supranormaux qui lui fait accepter sans contrôle les aspects les plus matériels de l'aventure spirituelle.
Ce passage regrettable de la notion de pouvoirs intellectuels et mystiques à la notion de pouvoir tout court entache quelque peu certaines pages, et surtout certaines conclusions, de son grand livre sur Le Yoga tantrique (*). Ce biais singulier d'un érudit de génie ne diminue nullement ses étonnants pouvoirs à lui, qui étaient de l'ordre du transmetteur et du commentateur. Mais il est évident que le baron Julius Evola, qui n'ignorait rien de la grande tradition tantrique, n'avait jamais songé à se munir de l'arme secrète des lamas tibétains, le poignard-à-tuer-le-Moi.
► Marguerite Yourcenar, 1972. (texte repris dans Le temps, ce grand sculpteur, Gallimard, 1983)
* : Le titre original, Lo Yoga della potenza, marque bien cette tendance intime de l'auteur, toujours plus près du sorcier que du mystique.


 Tags : bouddhisme, Inde
Tags : bouddhisme, Inde