-
Défis PM
 La lecture de Spengler du devenir des civilisations utilise la méthode des analogies fondée sur l’idée platonicienne du phénomène primaire et permettant de le saisir dans ses manifestations temporelles. Toute apparition du phénomène primaire parcourt divers stades comparables à des saisons ou des âges : éclosion, maturité, sénilité et extinction. L’analogie morphologique consiste dans la description et la comparaison des stades correspondants pour toutes les cultures observées. Bien évidemment, une civilisation ne représente pas une entière synchronie comme une vie, elle est traversée de diachronies. L'extériorité de l'histoire ne se confond pas avec l'intériorité inconsciente ni ne coïncide avec un mouvement qui, du dehors, enveloppe le dedans du psychisme. Si elle affecte l'individu, elle constitue aussi ce par quoi il décide de lui-même et de son destin : « on doit échapper à l'alternative du dehors et du dedans ; il faut être aux frontières » (Michel Foucault in Magazine littéraire n° 309, avr. 1993, p. 70, repris in Dits et écrits, Quarto/Gal., 2002).
La lecture de Spengler du devenir des civilisations utilise la méthode des analogies fondée sur l’idée platonicienne du phénomène primaire et permettant de le saisir dans ses manifestations temporelles. Toute apparition du phénomène primaire parcourt divers stades comparables à des saisons ou des âges : éclosion, maturité, sénilité et extinction. L’analogie morphologique consiste dans la description et la comparaison des stades correspondants pour toutes les cultures observées. Bien évidemment, une civilisation ne représente pas une entière synchronie comme une vie, elle est traversée de diachronies. L'extériorité de l'histoire ne se confond pas avec l'intériorité inconsciente ni ne coïncide avec un mouvement qui, du dehors, enveloppe le dedans du psychisme. Si elle affecte l'individu, elle constitue aussi ce par quoi il décide de lui-même et de son destin : « on doit échapper à l'alternative du dehors et du dedans ; il faut être aux frontières » (Michel Foucault in Magazine littéraire n° 309, avr. 1993, p. 70, repris in Dits et écrits, Quarto/Gal., 2002).Ce que nous retenons avant tout comme intempestif chez Spengler, c’est que les qualités psychiques d’une civilisation trouvent leur expression essentielle dans l’idée de temps. Ni la civilisation antique ni la civilisation indoue ni la chinoise ne connurent l’orientation organique du temps qui entraîne tout. Le temps mouvant est une conception entièrement “faustienne”, de même que l’idée d’un progrès illimité, symbole de notre âme ardente : « L’histoire de l’Europe est destinée voulue » nous rappelle Spengler. Même la rébellion contre cet aspect faustien du sens historique le présuppose déjà : celui qui lutte contre le “progrès” estime son action comme un progrès. Le pluralisme de valeurs n’est-il dès lors fatalement que déclin de l’âme ? Bien au contraire, assumer un scepticisme physionomique envers l’histoire comme expression passagère de notre époque et non comme loi fatale masquant un byzantinisme de civilisations fatiguées, voilà vraiment ce qui nous permet de faire acte de notre destinalité :
« C'est le destin d'une époque de culture qui a goûté l'arbre de connaissance de savoir que nous ne pouvons pas lire le sens du devenir mondial dans le résultat, si parfait soit-il, de l'exploration que nous en faisons, mais que nous devons être capables de le créer nous-mêmes, que les “conceptions du monde” ne peuvent jamais être le produit d'un savoir empirique et que, par conséquent, les idéaux suprêmes qui agissent le plus fortement sur nous ne s'actualisent en tout temps que dans la lutte avec d'autres idéaux qui sont aussi sacrés pour les autres que les nôtres le sont pour nous » (Max Weber, Essais sur la théorie de la science).
Pour nous, aveugle est l’être d’une période, européen signifie avant tout enracinement transhistorique et volonté de destin. Aussi proposons-nous ici en exemple de lecture féconde du corpus spenglérien une étude prospective de Robert Steuckers. Par un retour à la notion spenglérienne de pseudomorphose, elle entend montrer que celle-ci donnerait une profondeur au débat sur l’identité européenne, tout comme la définition spenglérienne du paysan comme “être anhistorique” éviterait de sombrer dans un pastoralisme écolo où ne s’est jamais enlisé un Jünger malgré sa vision du “recours aux forêts”. La mise en perspective de l’historiographie de Spengler ne peut-elle que nous aider à comprendre le monde sous un symbolisme historique ou bien ne nous permet-elle pas d’avoir recours à des images porteuses de sens brisant tout fatalisme envers l’individualisme de masse ? La question reste ouverte. Pour nous autres Européens de l'avenir en tout cas, Vision de la Mission et Mission de la Vision ne font qu’un.

Défis postmodernes : entre Faust et Narcisse

Notre culture européenne est le produit d'une pseudomorphose, disait Spengler. D'une pseudomorphose, c'est-à-dire d'un télescopage entre un mental autochtone, initial, inné, et un mental greffé, chronologiquement postérieur, acquis. L'inné, pour Spengler, c'est le mental “faustien”.
L'affrontement de l'inné et de l'acquis
L'acquis, c'est le mental “magique”, théocentrique, né au Proche-Orient. Pour la pensée magique, le moi s'incline respectueusement devant la substance divine, comme l'esclave se courbe devant son maître. Dans le cadre de cette religiosité, l'individu se laisse guider par la force divine, incluse en lui par le baptême ou l'initiation. Rien de tel pour l'esprit faustien vieil-européen, selon Spengler. L'homo europeanus, lui, malgré le vernis magique/chrétien qui recouvre sa pensée, déploie une religiosité volontariste et anthropocentrique. Le bien pour lui, ce n'est pas de se laisser guider passivement par Dieu, c'est bien plutôt affirmer et réaliser sa volonté. “Pouvoir vouloir”, tel est le fondement ultime de la religiosité autochtone européenne. Dans le christianisme médiéval, cette religiosité volontariste transparaît, perce la croûte du “magisme” importé du Proche-Orient.
Dès l'an mille, dans l'art et les épopées littéraires, ce volontarisme dynamique apparaît progressivement, couplé à un sens de l'espace infini, vers lequel peut et veut se déployer le moi faustien. À la notion d'un espace clos, où le moi se trouve enfermé, s'oppose donc une notion d'espace infini, vers lequel se projette un moi aventureux.
Du monde “clos” à l'univers infini
Pour le philosophe américain Benjamin Nelson (1), le sens vieil-hellénique de la phusis, avec tout le dynamisme qu'il implique, triomphe dès la fin du XIIIe siècle, grâce à l’averroïsme, détenteur de la sagesse empirique des Grecs (et d'Aristote en particulier). Progressivement, l'Europe passera du “monde clos” à l'univers infini. L'empirisme et le nominalisme prennent le relais d'une scolastique strictement discursive, répétitive et enfermante. La renaissance, avec Copernic et Bruno (le martyr tragique du Campo dei Fiori), renonce au géocentrisme sécurisant pour proclamer que l'univers est infini, intuition essentiellement faustienne selon les critères énoncés par Spengler.
Dans le second volume de son Histoire de la Pensée Occidentale, JF Revel (2), qui officiait naguère au Point et y illustrait malheureusement l'idéologie occidentaliste américanocentrée, écrit avec beaucoup de pertinence : « On conçoit sans peine que l'éternité et l'infinité de l'univers énoncées par Bruno aient pu faire aux hommes cultivés d'alors l'effet traumatisant d'un passage de la vie intra-utérine au vaste et cruel courant d'air d'un tourbillon glacial et sans limite ».
La peur “magique”, l'angoisse suscitée par l'effondrement d'une certitude dorlotante, celle du géocentrisme, provoquera la mort cruelle de Bruno, mais sera, en somme, une épouvantable apothéose… Rien ne réfutera plus l’héliocentrisme, ni la théorie de l'infinitude des espaces sidéraux. Blaise Pascal dira, résigné, avec l'accent du regret : « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ».
Du logos théocratique à la raison figée
Pour remplacer le “logos théocratique” de la pensée magique, la pensée bourgeoise naissante et triomphante va élaborer une pensée centrée sur la raison, une raison abstraite devant laquelle il faudra s'incliner comme le Proche-Oriental s'inclinait devant son dieu. L'adepte “bourgeois” de cette “petite raison étriquée”, vertueux et calculateur, soucieux de juguler les élans de son âme ou de son esprit, retrouve ainsi une finitude confortable, un espace clos et sécurisant. Le rationalisme de ce type humain vertueux n'est pas le rationalisme aventureux, audacieux, ascétique et créateur décrit par Max Weber (3) qui éduque l'intériorité à affronter précisément cette infinitude affirmée par Giordano Bruno (4).
Dès la fin de la Renaissance, deux Modernités se juxtaposent
Le rationalisme étriqué dénoncé par Sombart (5) va régenter les cités en rigidifiant les pensées politiques, en corsetant les pulsions activistes constructives. Le rationalisme proprement faustien et conquérant, décrit par Max Weber, va propulser l'humanité européenne hors de ses limites territoriales initiales, va donner l'impulsion majeure à toutes les sciences du concret.
Dès la fin de la Renaissance, nous découvrons donc, d'une part, une Modernité rigide et moraliste, sans élan, et, d'autre part, une Modernité aventureuse, conquérante, créatrice, tout comme nous aujourd'hui, au seuil d'une post-modernité molle ou d'une post-modernité fulgurante, impavide et potentiellement innovante. En posant ce constat de l’ambiguïté des termes “rationalisme”, “rationalité”, “Modernité” et “post-Modernité”, nous entrons de plain-pied dans le domaine des idéologies politiques voire des Weltanschauungen militantes.
La rationalisation pleine de morgue vertueuse, celle décrite par Sombart dans son célèbre portrait du “bourgeois”, engendre les messianismes mous et mièvres, les grands récits tranquillisants des idéologies contemporaines La rationalisation conquérante décrite par Max Weber, elle, suscite les grandes découvertes scientifiques et l'esprit méthodique, raffinement ingénieux de la conduite de la vie et maîtrise croissante du monde extérieur.
Cette option conquérante possède également son revers : elle désenchante le monde, l’assèche, le schématise à outrance. En se spécialisant dans l'un ou l'autre domaine de la technique, de la science ou de l'esprit, en s'y investissant totalement, les “faustiens” d'Europe et d'Amérique du Nord aboutissent souvent à un nivellement des valeurs, à un relativisme qui tend à la médiocrité parce qu'il nous fait perdre le sens du sublime, de la mystique tellurique et qu'il isole de plus en plus les individus. En notre siècle, la rationalité mise en exergue par Weber, si positive au départ, a culbuté dans l'américanisme quantitativiste et machiniste qui, instinctivement, cherchera, en compensation, un supplément d'âme dans le charlatanisme religieux alliant le prosélytisme le plus délirant et les bondieuseries les plus larmoyantes.
Tel est le sort du “faustisme” quand il est coupé de ses mythes fondateurs, de sa mémoire la plus ancienne, de son humus le plus profond et le plus fécond. Cette césure, c'est indéniablement le résultat de la pseudomorphose, de la greffe “magique” sur le corps faustien/européen, greffe qui a échoué. Le “magisme” n'a pu immobiliser le perpétuel élan faustien ; il l'a — et c'est plus dangereux — amputé de ses mythes et de sa mémoire, le condamnant à la stérilité par assèchement, comme l'ont constaté Valéry, Rilke, Duhamel, Céline, Drieu, Morand, Maurois, Heidegger ou encore Abellio.
Rationalité conquérante, rationalité moralisante, dialectique des Lumières, “grands récits” de Lyotard
La rationalité conquérante, si elle est arrachée à ses mythes fondateurs, à son humus ethno-identitaire, à son indo-européanité matricielle, retombe, même après les assauts les plus impétueux, inerte, vidée de sa substance, dans les rets du petit rationalisme calculateur et dans l'idéologie terne des “Grands Récits”. Pour Jean-François Lyotard (6), la Modernité”, en Europe, c'est essentiellement le “Grand Récit” des Lumières, dans lequel le héros du savoir travaille paisiblement et moralement à une bonne fin éthico-politique : la paix universelle, où plus aucun antagonisme ne subsistera. La “Modernité” de Lyotard correspond à la fameuse “Dialectique de l'Aufklärung” ou “Dialectique des Lumières” de Horkheimer et Adorno (7), figures de proue de la célèbre “École de Francfort”. Dans leur optique, le travail de l'homme de science ou l'action de l'homme politique, doivent se soumettre à une raison raisonnable, à un corpus éthique, à une instance morale fixe et immuable, à un catéchisme qui freine leurs élans, qui limite leur fougue faustienne. Pour Lyotard, la fin de la Modernité, donc l’avènement de la “post-Modernité”, c'est l'incrédulité progressive, sournoise, fataliste, ironique, persiflante à l'égard de ce métarécit. Incrédulité qui signifie soit un possible retour du Dionysiaque, de l'irrationnel, du charnel, des zones troubles et troublantes de l'âme humaine révélées par Bataille ou Caillois, comme l'envisagent et l’espèrent le professeur Maffesoli (8), de l'Université de Strasbourg, et l'Allemand Bergfleth (9), jeune philosophe non-conformiste ; soit un retour tout aussi possible du Faustien, d’un esprit comparable à celui qui nous a légué le gothique flamboyant, d’une rationalité conquérante qui aurait récupéré sa mythologie dynamique vieille-européenne, comme nous l’explique G. Faye dans Europe et Modernité (10).
Le métarécit s'enkyste…
Avec l'installation, l'enkystement, dans nos mentalités du “métarécit” des Lumières, apparaissent progressivement les grandes idéologies laïques occidentales, le libéralisme idolâtrant la “main invisible” (11) ou le marxisme avec son déterminisme pesant et sa métaphysique de l’histoire, contestés dès l'aube de ce siècle par les figures les plus sublimes du socialisme militant européen, dont Georges Sorel (12). Avec Giorgio Locchi (13), qui appelle le “métarécit” tantôt “idéologue” tantôt “science”, nous pensons que ce complexe “métarécit / idéologie / science” ne suscite plus de consensus que par contrainte, puisqu'il y a des résistances sourdes (not. en art, en musique par ex. [14]) ou une désuétude générale du dispositif métanarratif de légitimation dans son ensemble.
Le métarécit libéral-lliuministe résiste encore et toujours aujourd'hui par la contrainte ou par le matraquage médiatique. Mais dans la sphère de la pensée immédiate, des poésies, de la musique, de l'art ou des lettres, ce métarécit ne dit plus rien, ne suscite plus rien, ne mobilise plus aucun grand esprit depuis 100 ou 150 ans. Déjà le modernisme littéraire de la fin du XIXe s. exprime une diversité de langages, une hétérogénéité d’éléments, une sorte de chaos désordonné qu'analyse le “physiologue” Nietzsche (15) et que Hugo von Hoffmannstahl appelle die Welt der Bezuge (le monde des relations). Ces interrelations omniprésentes et surdéterminantes nous signalent que le monde ne s'explique pas par un simple récit tout propret ni ne se laisse régenter par une instance morale désincarnée.
Mieux : elles nous signalent que nos Cités, nos peuples, ne peuvent exprimer toutes leurs potentialités vitales dans le cadre d'une idéologie déterminée et instituée une fois pour toutes pour toute ni conserver indéfiniment les institutions issues (les corpus doctrinaux dérives du “métarécit des Lumières”. La présence anachronique du métarécit constitue un frein au développement de notre continent dans tous les domaines : scientifique (informatique et biotechnologie [16]), économique (maintien des dogmes libéraux au sein de la CEE), militaire (fétichisme d’un monde bipolaire et servilité à l'égard des USA, paradoxalement ennemis économiques), culturel (matraquage médiatique en faveur d'un cosmopolitisme qui élimine la spécificité faustienne et vise à l’avènement d'un grand village convivial à l'échelle du globe, régenté par les principes des “sociétés froides” à la manière des Bororos chers à Lévi-Strauss [17]).
Refuser le néo-ruralisme, le néo-pastoralisme…
Le désordre confus du modernisme littéraire de la fin du XIXe siècle a eu son aspect positif, son rôle : celui de constituer ce magma qui, petit à petit, deviendra producteur d'un nouvel assaut faustien (18). C'est Weimar, le Weimar-arène où se déroulait l'affrontement créateur et fécond de l'expressionnisme (19), du néo-marxisme et de la Révolution conservatrice (20), qui nous léguera, avec Ernst Jünger, une idée de la Modernité post-métanarrative (ou post-Modernité, si l'on appelle “Modernité” la Dialectique des Lumières, théorisée postérieurement par l'École de Francfort). Le modernisme, avec la confusion qu'il inaugure, due à l'abandon progressif de la pseudo-scientificité des Lumières, correspond quelque peu au nihilisme constaté par Nietzsche. Nihilisme qui doit être surmonté, dépassé, mais non par un retour sentimental, voire niais, au passé révolu. Le nihilisme ne se dépasse pas par le wagnérisme théâtral, fulminait Nietzsche, comme aujourd'hui, l'effondrement du “grand récit” marxiste ne se dépasse pas par un néo-primitivisme pseudo-rustique (21).
Chez Jünger, le Jünger des Orages d'Acier, du Travailleur et d'Eumeswil, on ne trouve nulle référence au mysticisme du terroir : rien qu'une admiration sobre pour la pérennité paysanne, indifférente aux bouleversements historiques. Jünger nous signale la nécessité d'un équilibre : s'il y a refus total du rural, du terroir, de la dimension stabilisante de la Heimat, le futurisme constructiviste faustien n'aura plus de socle, de base de départ, de zone de repli. En revanche, si l'accent est trop placé sur le socle initial, le socle-tremplin, sur la niche écologique originaire du peuple faustien, celui-ci, en s’encroûtant dans sphère-cocon, se prive d'un rayonnement universel, se rend aveugle à l'appel du monde, refuse de s’élancer vers le réel dans toute sa plénitude, “exotique” compris. Le repli frileux sur le territoire premier confisque au faustisme sa force de diffusion et relègue son “peuple porteur” au niveau de celui du “paysan éternel anhistorique” décrit par Spengler et par Eliade (22). L'équilibre consiste à puiser (dans le fond du terroir premier) et à diffuser (vers le monde extérieur).
En dépit de toutes les nostalgies “organiques”, ruralistes ou pastoralistes, en dépit de leur beauté esthétique, sereine, idyllique, qui nous rappelle Horace ou Virgile, la Technique et le Travail sont désormais les essences de notre monde post-nihiliste. Rien n'échappe plus à la technique, à la technicité, à la mécanique ou à la machine : ni le paysan qui ouvre avec son tracteur ni le prêtre qui branche un micro pour donner plus d'impact à son homélie.
L’ère de la “Technique”
La Technique mobilise totalement (Totale Mobilmachung) et projette les individus dans une infinitude inquiétante, où ils ne sont plus que petits rouages interchangeables (les mitrailleuses, constate le guerrier E. Jünger, fauchent les vaillants et les peureux dans la plus pure égalité). Comme dans la guerre totale de matériel, annoncée dès les batailles de char de 1917, sur le front de France. Le “Moi” faustien perd son intraversion pour se noyer dans un tourbillon d’agir incessant. Ce moi, après avoir façonné les flèches en dentelles de pierre du gothique flamboyant, a soit basculé dans le quantitativisme américain soit hésité, désorienté, pris dans le magma informatif, dans l’avalanche de faits concrets du XXe s. Ce fut son nihilisme, son blocage, son indécision due à un subjectivisme exacerbé, un patinage dans la boue désordonnée des faits. En franchissant la “ligne”, disent Heidegger et Jünger (23), la monade faustienne (celle dont nous parlait Leibniz [24]) annule son subjectivisme et retrouve la puissance pure, le dynamisme pur, dans l’univers de la Technique. Avec l’approche jüngérienne, la boucle se referme : à l’univers clos du “magisme” se substitue le petit monde inauthentique du bourgeois, sécuritaire, frileux, confit dans sa sphère d’utilitarisme et à l’univers dynamique du “faustisme” se substitue un stade Technique, dépouillé cette fois de tout subjectivisme.
La Technique jüngérienne balaye la Modernité factice du métarécit des Lumières, l’hésitation des littératures modernistes de la fin du XIXe siècle et le trompe-l’œil du wagnérisme et du néo-pastoralisme. Mais cette Modernité jüngérienne, toujours incomprise depuis la parution de Der Arbeiter en 1932, est demeurée lettre morte.
De Babbit au paradoxe sartrien
En 1945, le débat idéologique est remis au diapason des idéologies victorieuses : le libéralisme à l’américaine (l'idéologie de M. Babitt [25]) ou le marxisme sous la forme d’un métarécit soi-disant désembourgeoisé. Les grands récits reviennent à la charge, traquent toute philosophie ou démarche “irrationaliste” (26), instaurent une police des pensées et provoquent, finalement, en agitant l’épouvantail d’une barbarie rampante, une ère du vide.
Sartre, avec sa vogue existentialiste parisienne, doit être analysé à la lumière de cette restauration. Sartre, fidèle à son “athéisme”, à son refus de privilégier une valeur, ne croit pas aux fondements du libéralisme ou du marxisme, il n’institue pas, au fond, le métarécit (dans sa variante la plus récente : le marxisme vulgaire des partis communistes [27]) comme une vérité mais comme un impératif catégorique “indépassable” pour lequel il convient de militer, si l’on ne veut pas être un “salaud”, c'est-à-dire un de ces êtres abjects qui vénèrent des « ordres pétrifiés » (28). C'est là tout le paradoxe du sartrisme : d'un côte, il nous exhorte à ne pas adorer d'“ordres pétrifiés”, ce qui est proprement faustien, et, d'un autre côté, il nous ordonne d'adorer “magiquement” un “ordre pétrifié”, celui du marxisme vulgaire, déjà démonté par Sombart ou De Man. Le consensus, dans les années 50, âge d'or du sartrisme, est donc bel et bien une contrainte morale, une obligation dictée par une pensée de plus en plus médiatisée. Mais un consensus par contrainte, par obligation de croire sans discuter, n'est pas un consensus éternel : d’où l'oubli contemporain du message sartrien, avec ses outrances et ses exagérations.
L'anti-humanisme révolutionnaire de mai 68
Avec Mai 68, phénomène de génération, l'humanisme, label du métarécit, est battu en brèche par les interprétations françaises de Nietzsche, Marx et Heidegger (29). L'humanisme est une illusion “petite-bourgeoise”, proclament universitaires et vulgarisateurs agissant dans le sillage de la révolte étudiante. Contre l'Occident, réceptacle géopolitique du métarécit des Lumières, le soixante-huitard joue à monter sur les barricades, prend parti, parfois avec un romantisme naïf, pour toutes les luttes des années 70 : celle du Vietnam spartiate en lutte contre l'impérialisme américain, celle des combattants latino-américain (“Che”), du Basque, de l'Irlandais patriote ou encore du Palestinien.
Le faustisme combatif, ne pouvant plus s'exprimer à travers des modèles autochtones se transpose dans l'exotisme : il s'asiatise, s'arabise, s'africanise ou s'indianise. Mai 68, en soi, par son ancrage résolu dans la grande politique, par son éthos du guérillero, par son option combattante, revêt malgré tout une dimension autrement plus importante que le blocage crispé du sartrisme ou que la grande régression néo-libérale actuelle. À droite, Jean Cau, en écrivant son beau livre sur Che Guevara (30) a parfaitement saisi cette problématique, que la droite, tout aussi crispée sur ses dogmes et ses souvenirs que la gauche, n'avait pas voulu apercevoir.
Avec ce soixante-huitardisme-là, combattant et politisé, conscient des grands enjeux économiques et géopolitiques de la planète, ont brûlé, dans l'esprit public français, les derniers feux de l'histoire, avant la grande assomption dans la posthistoire et le postpolitique que représente le narcissisme néo-libéral contemporain.
La traduction des écrits de “l’École de Francfort annonce l’avènement du narcissisme néo-libéral
La première phase de l'assaut néo-libéral contre l'anti-humanisme politique de Mai 68, ce fut la redécouverte des écrits de l’École de Francfort, née en en Allemagne avant l’avènement du national-socialisme, arrivée à maturité pendant l'exil californien d'Adorno, d'Horkheimer et de Marcuse et érigée en objet de vénération dans l’après-guerre ouest-allemand (31).
Dans un petit ouvrage, concis et fondamental pour comprendre la dynamique de notre de notre temps, Dialektik der Aufklärung, Horkheimer et Adorno nous signalent l'existence, dans la pensée occidentale, de 2 “raisons”, que, dans le sillage de Spengler et de Sombart, nous serions tenté de nommer “raison faustienne” et “raison magique”. La première est, pour les 2 anciens exilés en Californie, le pôle négatif du “complexe raison” dans la civilisation occidentale : cette raison-là est purement “instrumentale”, elle sert à accroître la puissance personnelle de celui qui s'en sert. Elle est la raison scientifique, la raison qui dompte les forces de l’univers et les met au service d’un chef ou d’un peuple, d’un parti ou d’un État. Elle est prométhéenne et non point narcissique / orphique, disait, dans cette optique, Herbert Marcuse (32). Pour Horkheimer, Adorno et Marcuse, c’est ce type des rationalité qu'avait théorisé Max Weber…
La “raison magique”, selon notre terminologie généalogique spenglérienne, en revanche, c’est, pour en brosser vite l’aspect général, celle du métarécit découvert par Lyotard. Elle est une instance morale qui dicte une conduite éthique, allergique à toute expression de puissance. Donc, à toute manifestation de l’essence du politique (33). En France, la redécouverte de cette théorie horkheimerienne et adornorienne de la raison, vers la fin des années 70, a inauguré l’ère de dépolitisation, ce qui, par déconnexion généralisée à l'endroit de l'histoire concrète et tangible, aboutira à “l’ère du vide” si bien décrite par le professeur grenoblois Gilles Lipovetsky (34).
À la suite de l'effervescence militante de mai 68, G. Lipovetsky perçoit, avec beaucoup de pertinence, les nouvelles attitudes mentales du post-soixante-huitardisme : apathie, indifférence (également au métarécit dans sa forme brute), désertion (des partis politiques, surtout des PC), désyndicalisation, narcissisme, etc. Pour Lipovetsky, cette démission et cette résignation généralisées constituent une aubaine. C'est la garantie, explique-t-il, que la violence reculera, donc qu'aucun “totalitarisme”, rouge, noir ou brun, ne prendra le pouvoir. Cette convivialité psy, doublée d'une indifférence narcissique aux autres, constitue le propre de l'âge “post-moderne”.
Il y a plusieurs définitions possibles de la “post-Modernité”
En revanche, si nous percevons — convention de vocabulaire inverse à celle de Lipovetsky — la “Modernité” ou le “modernisme” comme expressions du métarécit, donc comme freins à l'élan faustien, la post-Modernité sera nécessairement un retour au politique, un rejet du fixisme para-magique et du soupçon anti-politique, surgis après mai 68, dans le sillage des spéculations sur la “raison instrumentale” et la “raison objective” décrites par Horkheimer et Adorno.
La complexité de la problématique “post-moderne” ne permet pas de donner une et une seule définition de la “post-Modernité”. Il n’existe pas UNE post-Modernité, qui, toute seule, pourrait revendiquer l'exclusivité. Au seuil du XXIe siècle, se juxtaposent, en jachère, DIVERSES post-Modernités, divers modèles sociaux post-modernes potentiels, chacun basé sur des valeurs foncièrement antagonistes, prêtes à s’affronter. Les post-Modernités diffèrent, dans leur langage ou dans leur “look”, des idéologies qui les ont précédées ; elles renouent néanmoins avec les valeurs éternelles, immémoriales, qui leur sont sous-jacentes. Comme le politique entre dans la sphère historique par des affrontements binaires, opposant des clans adverses avec exclusion des tiers minoritaires, osons évoquer la possible dichotomie de l’avenir : une post-Modernité néo-libérale, occidentale et américaine et américanomorphe contre une post-Modernité fulgurante, faustienne et nietzschéenne.
“Génération morale” et “ère du vide”
La post-Modernité néo-libérale, c'est celle qu’annonce, triomphant et follement messianique, un Laurent Joffrin dans son bilan de la révolte étudiante de décembre 1986 (cf. Un coup de jeune, Arlea, 1987). Pour Joffrin, qui avait pronostiqué il y a 2 ou 3 ans (35) la mort de la gauche hard, du prolétarisme militant, décembre 86 est le signe avant-coureur d'une “génération morale”, alliant, dans ses cerveaux, le gauchisme mou, un peu collectiviste par paresse intellectuelle, et l’égoïsme néo-libéral, narcissique et postpolitique. Le modèle social de cette société hédoniste, axée sur la praxis marchande, que Lipovetsky a décrit dans L'ére du vide. Vide politique, vide intellectuel, et désert posthistorique : telles sont les caractéristiques de l'espace bloqué, de l'horizon bouché, bouche, propre au néo-libéralisme contemporain. Cette post-Modernité-là constitue, pour le grand espace européen, qui doit advenir pour que nous ayons un avenir viable, un blocage inquiétant, où le lent pourrissement annoncé par le chômage de masse et la démographie déclinante exerceront leurs ravages, sous les lumignons blafards des illusions consuméristes, du gigantesque fictionnisme publicitaire, sous les néons des enseignes vantant les mérites d'un photographe d’un photocopieur japonais ou d'une compagnie aérienne américaine.
En revanche, la post-Modernité qui refusera le vieux métarécit anti-politique des Lumières, avec ses avatars et ses métastases, renouera avec l'insolence nietzschéenne ou l'idéal métallique d’un Jünger, qui franchira la “ligne” comme nous l'exhorte Heidegger qui sortira du dandysme stériles des périodes de nihilisme, la post-Modernité qui recourrera à l'aventureux, en déployant concrètement un programme politique audacieux impliquant le rejet des blocs, la construction d’une économie auto-centrée en Europe, en luttant farouchement et sans concessions contre toutes les vieilleries religieuses et idéologiques, en développant les grands axes d'une diplomatie indépendante de l’avis de Washington, la post-modernité, qui réalisera ce programme volontaire et négateur des négations de la posthistoire, celle-ci aura notre pleine adhésion.
Par cette allocution, j'ai voulu prouver qu'il y avait une continuité dans l’affrontement entre “faustisme” et que cette continuité antagonistique se répercute dans le débat actuel sur les post-Modernités. L'Occident américano-centré centre est le havre des “magismes”, avec son cosmopolitisme et ses sectes moonistes ou autres qui exigent l'obéissance aveugle (36). L’Europe, héritière d’un faustisme maintes fois tarabusté par la pensée “magique”, se réaffirmera par une post-Modernité qui récapitulera les thèmes indicibles, récurrents mais toujours neufs, de la fausticité intrinsèque de la psyché européenne.
► Robert Steuckers, Orientations n°10, 1988.
◘ NOTES :
- Benjamin Nelson, Der Ursprung der Moderne, Vergleichende Studien zum Zivilisationsprozess, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.
- Jean-François Revel, Histoire de la pensée occidentale, tome II : La philosophie pendant la science (XVe, XVIe et XVIIe siècles), Stock, 1970. Cf. également le maître-ouvrage d'Alexandre Koyré : Du monde clos à l'univers infini, Gal., 1973.
- Cf. Julien Freund, Max Weber, PUF, 1969.
- Paul-Henri Michel, La cosmologie de Giordano Bruno, Hermann, 1962.
- Cf. not. : W. Sombart, Le Bourgeois : Contribution à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique moderne, Payot, 1966.
- JF Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Minuit, 1979.
- Max Horkheimer, Theodor Adomo, Diaektik der Aufklârung. Philosophische Fragmente, Fischer, Frankfurt a.M., 1969-1980. Cf. également : Pierre Zima, L'école de Francfort. Dialectique de la particularité, éd. Universitaires, 1974. Michel Crozon, Interroger Horkheimer et Arno Victor Nielsen, « Adorno, le travail artistique de la raison » in : Esprit, mai 1978.
- Cf. principalement : M. Maffesoli, L'ombre de Dionysos : Contribution à une sociologie de l'orgie, Méridiens, 1982. Pierre Brader, « Michel Maffesoli : saluons le grand retour de Dionysos » in Magazine-Hebdo n°54 (21 sept. 1984).
- Cf. Gerd Bergfleth et al., Zur Kritik der Palavernden Aujklärung, Matthes & Seitz, München, 1984. Bergfleth publie dans cette remarquable petite anthologie 4 textes assassins pour le ronron “moderno-francfortiste” : 1) Zehn Thesen zur Vernunftkritik ; 2) Der geschundene Marsyas ; 3) Über linke Ironie ; 4) Die zynische Aufklärung. Cf. également R. Steuckers, « G. Bergfleth : enfant terrible de la scène philosophique allemande » in Vouloir n°27, mars 1986. Dans ce même numéro, lire aussi : M. Kamp, « Bergfleth : critique de la raison palabrante » et « Une apologie de la révolte contre les programmes insipides de la révolution conformiste ». Voir encore : M. Froissard, « Révolte, irrationnel, cosmicité et… pseudo-antisémitisme » in Vouloir n°40-42, juil-août 1987.
- G. Faye, Europe et Modernité, Eurograf, Méry/Liège, 1985.
- Sur le fondement théologique de la doctrine de la “main invisible” : cf. Hans Albert, Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer Beleuchtung in Ernst Topitsch (Hrsg.), Logik der Sozialwissenschaften, Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1971.
- La bibliographie française sur Georges Sorel est abondante. Néanmoins, on déplorera qu'une biographie et une analyse aussi précieuse que celle de Michael Freund n'ait jamais été traduite : M. Freund, G. Sorel, Der revolutionäre Konservatismus, V. Klostermann, Frankfurt/M., 1972.
- Cf. G. Locchi : « Histoire et société : critique de Lévi-Strauss » in Nouvelle École n°17, 1972 ; « L'histoire » in Nouvelle École n°27-28, 1975.
- Cf. G. Locchi, « L'“idée de la musique” et le temps de l'histoire » in Nouvelle École n°30, nov. 1978, Vincent Samson, « Musique, métaphysique et destin » in Orientations n°9, sept. 1987.
- Cf. Helmut Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie. Nietzsches äesthetische Theorie und literarische Produktion, J.B. Metzler, Stuttgart, 1985. Cf. à propos de ce livre : R. Steuckers, « Regards nouveaux sur Nietzsche » in Orientations n°9.
- Les bio-technologies et les innovations les plus récentes de la bio-cybernétique, appliquées au fonctionnement des sociétés humaines, remettent fondamentalement en question les assises théoriques mécanicistes du “Grand Récit” des Lumières. Des législations moins rigides, souples parce qu'adaptées aux ressorts profonds de la psychologie et de la physiologie humaines, redonneraient un dynamisme à nos sociétés et les mettraient au diapason des innovations technologiques. Le Grand Récit, toujours présent malgré son anachronisme, bloque l'évolution de nos sociétés ; la pensée de Habermas, qui refuse catégoriquement d'inclure dans sa démarche les découvertes épistémologiques d'un Konrad Lorenz par ex., illustre parfaitement la rigidité proprement réactionnaire du néo-Aufklärung francfortiste et de la dérivation néo-libérale actuelle. Pour se rendre compte du glissement qui s’opère malgré la réaction libérale-francfortiste, on lira les travaux du bio-cybernéticien allemand Frédéric Vester : 1) Unsere Welt - ein vernetztes System, dtv, n° 10118, München, 1983 (2e éd.) ; 2) Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter, DVA, Stuttgart, 1980. La rénovation de la pensée sociale holiste (ganzheitlich) par la biologie moderne, nous la trouvons not. chez Gilbert Probst, Selbst-Organisation, Ordnungsprozesse in sozialen Systemen aus ganzheitlicher Sicht, Paul Parey, Berlin, 1987.
- G. Locchi, art. cit., voir note (13).
- Pour aborder la question du modernisme littéraire au XIXe s., se référer à : M. Bradbury, J. McFarlane (ed.), Modernism 1890-1930, Penguin, 1976.
- Cf. Paul Raabe, Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung. Utile anthologie des principaux manifestes expressionnistes.
- Armin Mohler, La Révolution Conservatrice en Allemagne 1918-1932, Pardès. Se référer principalement au texte A3 intitulé Leitbilder (images directrices).
- Cf. Gérard Raulet, Mantism and the Post-Modern Conditions et Claude Karnoouh, The Lost Paradise of Regionalism : The Crisis of Post-Modernity in France in Telos n°67, mars 1986.
- Cf. O. Spengler, Le déclin de l'Occident : Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, Gal., 1948. Pour la définition du “paysan anhistorique”, voir t. 2, p. 90. Cf. M. Eliade, Le sacré et le profane, Gal., 1965 ; voir surtout le chap. III, « La sacralité de la nature et la religion cosmique », p. 98 sq. Pour l'agencement de cette vision du “paysan” dans la querelle contemporaine du néo-paganisme, voir : Richard Faber, Einleitung : “Pagan” und Neo-Paganismus. Versuch einer Begriffsklärung in : Richard Faber & Renate Schlesier, Die Restauration der Gôtter : Antike Religion und Neo-Paganismus, Königshausen & Neumann, Würzburg, 1986, pp. 10 à 25. Ce texte a été recensé en français par R. Steuckers, « Le paganisme vu de Berlin » in Vouloir n°28/29, avr. 1986, pp. 5-7.
- Sur la question de la “ligne” chez Jünger et Heidegger, cf. W. Kaempfer, Ernst Jünger, Metzler, Sammlung Metzler, Band 201, Stuttgart, 1981, p. 119 à 129. [Cf. aussi J. Evola, « Devant le “mur du temps” » in Explorations. Hommes et problèmes, p. 183-194, Pardès. Profitons aussi de cette note pour rappeler que, contrairement à une idée reçue, Heidegger ne rejette pas la technique de manière réactionnaire, ne la considérant même pas comme dangereuse en elle-même. Le danger tient au mystère de son essence non pensée, empêchant l’homme de revenir à un dévoilement plus originel et d’entendre l’appel d’une vérité plus initiale. Si l’âge de la technique apparaît comme la figure achevée de l’Oubli de l’Être, où la détresse propre à la pensée se manifeste comme absence de détresse dans la sécurisation et l’objectivation de l’étant, il est aussi cet extrême péril à partir duquel est pensable le relèvement comme possibilité d’un autre commencement une fois la métaphysique de la subjectivité achevée.]
- Pour juger de l’importance de Leibniz dans le développement de la pensée organique allemande, cf. FM Barnard, Herder's Social and Political Thought : From Enlightenment to Nationalism, Clarendon Press, Oxford 1965, p. 10-12.
- Sinclair Lewis, Babbit, Livre de Poche, 1984.
- Le classique des classiques dans la condamnation de “l’irrationalisme”, c’est la somme de Georg Lukàcs, La Destruction de la Raison, éd. de l’Arche (2 vol.), 1958. [Ce livre se veut une sorte de discours de la méthode de la dialectique Aufklärung-Gegenaufklärung, rationalisme-irrationalisme. La technique de l’amalgame, propre à ce qui apparaît avec le recul bel et bien comme un pamphlet stalinien, cherche à compromettre de larges secteurs de la culture allemande et européenne, de Schelling au néo-thomisme, accusés d‘avoir préparé et favorisé le phénomène nazi. Il s’agit là d’une vision paranoïaque de la culture.] Pour le traquage systématique de “l'irrationalisme”, on se référera également à Bergfleth [voir note 9].
- Pour saisir l’irrationalité foncière de l’adhésion de Sartre au communisme, on lira Thomas Molnar, Sartre, philosophie de la contestation, La Table Ronde, 1969.
- Cf. R.-M. Alberes, Jean-Paul Sartre, éd. Universitaires, 1964, p. 54 à 71.
- En France, la polémique visant un rejet définitif de l’anti-humanisme soixante-huitard et de ses assises philosophiques nietzschéennes, marxiennes et heideggeriennes, se retrouve dans Ferry & Renaut, La pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain (1985), et son pendant 68-86. Itinéraires de l’individu (1987). Contrairement aux thèses défendues dans le premier de ces 2 ouvrages, l’essayiste Guy Hocquenghem dans Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary Club (Albin Michel, 1986) déplorait l'assimilation de l’hyperpolitisme soixante-huitard dans la vague néo-libérale contemporaine. Dans une optique nettement moins polémique et dans le souci de restituer le débat tel qu'il est sur le plan de l'abstraction philosophique, on lira : Eddy Borms, Humanisme -kritiek in het hedendaagse Franse denken, Sun, Nijmegen, 1986.
- Jean Cau, ancien secrétaire de Jean-Paul Sartre, polémiste classé à “droite”, polisson qui prend régulièrement à partie les manies et giries des conformistes bien-pensants, n'avait pas hésite à rendre hommage à Che Guevara et à lui consacrer un livre. Les “rigides” de la gauche bourgeoise avaient alors parlé d'un “détournement de cadavre” ! Les admirateurs rigido-droitistes de Cau, eux, n'ont pas davantage retenu la leçon : le Nicaragua sandiniste, qu'admiraient pourtant Abel Bonnard et le “fasciste” américain Lawrence Dennis, reste pour ces messieurs-dames une émanation du Malin.
- Cf. dans ce n° l'article de HC Kraus, « Habermas sur la défensive ».
- Cf. A. Vergez, Marcuse, PUF, 1970.
- Julien Freund, Qu'est-ce que la politique ?, Seuil, 1967. Cf G. Faye, La problématique moderne de la raison ou la querelle de la rationalité in Nouvelle École n°41, nov. 1984.
- G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Gal., 1983. Peu après le colloque de Bruxelles, au cours duquel le texte ci-dessus a servi d'allocution, G. Lipovetsky publiait un second ouvrage qui renforçait son option : L'Empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes(Gal, 1987). Contre cette option “narcissique”, protestaient presque simultanément François-Bernard Huyghe et Pierre Barbés dans La soft-idéologie, Laffont, 1987. Inutile de préciser que mes propos rejoignent, en gros, ceux de ces 2 derniers essayistes. [L'essai fit en effet date à sa sortie en 1983. Non que sa thématique, la condition post-moderne, fusse si nouvelle mais elle brassait si bien l'air du temps, celui que nous respirons tous, sans le plus souvent nous en rendre compte, qu'elle ne pouvait que “séduire”, sorte de miroir tendu à ses contemporains. Néanmoins ce livre de manieur d'idées est de bonne facture, relevant du genre didactique de la culture générale : cet essai informe, il ne forme pas. En résumé, l'auteur analyse la montée du nouvel individualisme hédoniste, les obligations transformées en options. Les nouveaux comportements dépassent les clivages traditionnels. L'idéal des années fin 80 est l'efficacité mais sans se prendre au sérieux. Le rire populaire et traditionnel, les réactions véhémentes ont laissé la place à la décontraction sceptique, à la “convivialité”, à l'ironie, à l'allusion qui dispense du face-à-face, dans une société désenchantée. On ne se contredit plus. Le constat n'a rien de bien exceptionnel. Les sociologues avaient pointé déjà l'évolution des comportements sociaux, par ex. la tendance au néo-individualisme “autiste” : nouvelles technologies domestiques, sports de glisse, dispositifs sécuritaires multiples, indifférence à autrui, vie publique dévitalisée, dissolution de la mémoire collective, relativisme des valeurs, narcissisme des valeurs (référence de l'auteur au Complexe de Narcisse de Lasch), cocooning des jeunes (antithèse de l'émancipation des années 60). On a aussi alors beaucoup parlé de post-Modernité : fin de l'âge industriel, du “productivisme”, de la morale du travail et tendances nouvelles (réduction de la politique à la morale humanitaire (“soft-idéologie”, recherches de nouvelles appartenances en “réseau” du type tribalisation, déclin de l'espace public). La question de l'essayiste est juste : cet individualisme de masse ne représente-il pas une nouvelle liberté ? En effet, la politique polémique, figure du pouvoir “excessif”, ne ferait plus recette. On ne contraint plus, on explique (même à l'armée, on parle de “nouveau commandement”). Le pouvoir se veut séducteur et se réclame de la transparence. Pour cet auteur, cet individualisme contemporain serait une “chance démocratique”. Nous sommes là pour sûr aux antipodes de Marcuse dénonçant un conditionnement passif ou bien de la société du spectacle de Debord qui sauve les apparences pour mieux endormir. En somme, conseillons “l'ère du vide” pour s'en vacciner. L'actuel n'est pas le présent…]
- Cf. L. Joffrin, La gauche en voie de disparition. Comment changer sans trahir ?, Seuil, 1984.
-
Cf. Furio Colombo, Il dio d’America. Religione, ribellione e nuova destra, A. Mondadori, Milano, 1983.

 ◘ Mai 68 : du col Mao au Rotary ?
◘ Mai 68 : du col Mao au Rotary ?On n'a pas fini de parler de Mai 68, même s'il ne reste plus grand'chose de l'effervescence des campus de Berkeley, Berlin ou Paris. Le soixante-huitardisme s'est enlisé dans ses contradictions, s'est épuisé en discours stériles, malgré les fantastiques potentialités qu'il recelait. Examinons le phénomène de plus près, de concert avec quelques analystes français : d'une part Luc Ferry et Alain Renaut, auteurs de La pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gal., 1986) et, d'autre part, Guy Hocquenghem, qui vient de sortir un petit bijou de satire : sa Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary (Albin Michel, 1986).
Pour Renaut et Ferry, la pensée 68 comportait 2 orientations possibles : la première était “humaniste” ; la seconde était “anti-humaniste”. L'humanisme soixante-huitard était anti-techniciste, anti-totalitaire, pour l'autonomie de l'individu, pour l'Éros marcusien contre la civilisation, pour le pansexualisme, pour l'effacement du politique, etc. Pour Ferry et Renaut, ces valeurs-là sont positives ; elles forment le meilleur de l'aventure soixante-huitarde. Pour nous, ce sont au contraire ces idéologèmes-là qui ont conduit aux farces actuelles des “nouveaux philosophes”, à leur valorisation infra-philosophique des “droits de l'homme”, au retour du fétichisme du “sujet”, à la régression du discours philosophique, à l'intérêt porté aux scandaleuses niaiseries d'un Yves Montand qui se prend pour un oracle parce qu'il est bon acteur…
Ces farces, ces amusements stériles, ces assertions pareilles à des slogans publicitaires pour margarine ou yaourts ont permis le retour d'une praxis libérale, le néo-libéralisme, auquel ne croyait plus qu'une poignée d'aimables plaisantins presqu'octogénaires. Ou encore, Madame Thatcher qui, selon les paroles officieuses de la Reine Elizabeth II, serait bel et bien restée “fille d'épicier” malgré son fard oxfordien. Ipso facto, le petit gauchisme de la pansexualité éroto-marcusienne, le baba-coolisme à la Club Med', le néo-obscurantisme talmudiste de BHL, les éloges tonitruants du cosmopolitisme à la Scarpetta ou à la Konopnicki acquièrent une dimension “géopolitique” : ils renforcent la mainmise américaine sur l'Europe occidentale et avalisent, avec une bienveillance très suspecte, les crimes de la machine de guerre sioniste. Décadentistes d'hier et traîneurs de sabre sans cervelle, illuminés moonistes et vieux défenseurs d'un “Occident chrétien”, se retrouvent curieusement derrière les mêmes micros, prêchent les mêmes guerres : il n'y a que le vocabulaire de base qui change.
L'effondrement du soixante-huitardisme dans ce que Renaut et Ferry appellent “l'humanisme” s'est également exprimé à l'intérieur des partis de gauche : de l'Eurocommunisme à la trahison atlantiste du PSOE, au révisionnisme du PCI et au mittérandisme atlantiste : le cercle des rénégats est bouclé. Hocquenghem trouve les mots durs qu'il faut : Montand ? Un « loufiat râleur géostratège mégalo » (p. 73) ; Simone Veil ? Un « tas de suif » (p. 73) ; Serge July ? Un « parvenu » (pp. 108 et 109) ; Jack Lang ? Il a la « futilité des girouettes » (p. 134) ; Régis Debray ? Un « ex-tiers-mondiste à revolver à bouchons » (p. 129) ; BHL, alias, sous la plume d'Hocquenghem, Sa Transcendance Béachelle ? Un « aimable Torquemada d'une inquisition de théâtre » (p. 159) qui ne tient qu'à l'applaudimètre (p. 164) ; Glucksmann ? « Tortueux » (p. 179), « Sophiste et fier de l'être » (p. 185), etc.
Hocquenghem fustige avec une délectable méchanceté et une adorable insolence tous les gourous mielleux, à fureurs atlantistes récurrentes, pourfendeurs de “pacifistes allemands gauchistes”, que l'ère Mitterand a vomis sur nos écrans et dans les colonnes de nos gazettes. Hocquenghem, comme presque personne en France, défend le pacifisme allemand que BHL et Glucksmann abreuvent de leurs insultes de néo-théocrates et de leurs sarcasmes fielleux, parce que ce pacifisme exprime la volonté d'un peuple de se maintenir hors de la tutelle yankee, de s'épanouir en dehors de l'hollywoodisme cher à Scarpetta et à Konopnicki, parce que ce pacifisme est, malgré ses insuffisances, la seule idéologie d'Europe puissamment hostile au duopole yaltaïque.
Voilà où mène l'humanisme post-soixante-huitard : aux reniements successifs, au vedettariat sans scrupules, comme si l'humanisme devait nécessairement mener à cette indulgence vis-à-vis des histrions, des pitres et bateleurs de la rive gauche. L'humanisme ainsi (mal) compris ne serait que tolérance à l'égard de ces ouistitis débraillés alors qu'un humanisme sainement compris exigerait la rigueur des autorités morales et politiques (mais où sont-elles ?) à l'encontre de ce ramassis d'incorrigibles saltimbanques.
Heureusement pour la postérité, Mai 68 a aussi été autre chose : un anti-humanisme conséquent, une rénovation d'un héritage philosophique, un esprit pionnier dont on n'a pas fini d'exploiter les potentialités. Renaut et Ferry, qui chantent le retour du “sujet” donc de la farce prétendument humaniste, signalent les œuvres d'Althusser, de Foucault, de Lacan et de Derrida. Ils voient en eux les géniaux mais “dangereux” continuateurs des traditions hegelienne (Althusser) et nietzschéo-heidegerienne (Foucault, Derrida). Pour ces philosophes français dans la tradition allemande, le “sujet” est vidé, dépouillé de son autonomie. Cette autonomie est illusion, mystification. L'homme est “agi”, disent-ils. Par quoi ? Par les structures socio-économiques, diront les marxistes. Par des “appartenances” diverses, dont l'appartenance au peuple historique qui l'a produit, dirions-nous. L'homme est ainsi “agi” par l'histoire de sa communauté et par les institutions que cette histoire a généré spontanément (il y a alors “harmonie”) ou imposé par la force (il y alors “disharmonie”).
Certes le langage de la “pensée 68” a été assez hermétique. C'est ce qui explique son isolement dans quelques cénacles universitaires, sa non-pénétration dans le peuple et aussi son échec politique, échec qui explique le retour d'un humanisme à slogans faciles qui détient la force redoutable de se faire comprendre par un assez large public, fatigué des discours compliqués.
Si l'avénement du fétiche “sujet” est récent (le XIXe dit Foucault), il est contemporain de l'avènement du libéralisme économique dont les tares et les erreurs n'ont cessé d'être dénoncées. Et si la “pensée 68” s'est heurtée au “sujet”, elle a également rejeté, au nom des spéculations sur l'aliénation, la massification des collectivismes. La juxtaposition de ces 2 rejets ne signifie par nécessairement l'existence de 2 traditions, l'une “humaniste” et l'autre “anti-humaniste”. Une voie médiane était possible : celle de la valorisation des peuples, valorisation qui aurait respecté simultanément la critique fondée des dangers représentés par le “sujet” (l'individu atomisé, isolé, improductif sur le plan historique) et les personnalités populaires.Aux “grands récits” abstraits, comme celui de la raison (dénoncé par Foucault) à prétention universaliste, se seraient substitués une multitude de récits, exprimant chacun des potentialités particulières, des façons d'être originales. Quand les étudiants berlinois ou parisiens prenaient fait et cause pour le peuple viet-namien, ils étaient très conséquents : cette lutte titanesque qui se jouait au Vietnam était la lutte d'un peuple particulier (cela aurait pu être un autre peuple) contre la puissance qui incarnait précisément l'idolâtrie du sujet, le christianisme stérilisant, la non-productivité philosophique, le vide libéral, la vulgarité de l'ignorance et des loisirs de masse.
La “pensée 68” a oscillé entre le libéralisme à visage gauchiste (ce que Renaut et Ferry appellent “l'humanisme”) et l'innovation révolutionnaire (ce qu'ils appellent “l'anti-humanisme”). Elle a oublié un grand penseur de la fin du XVIIIe : Herder. L'humanisme de ce dernier est un humanisme des peuples, non des individus. Le vocable “humanisme” est trop souvent utilisé pour désigner l'individualisme non pour désigner les créativités collectives et populaires. Or tous les anthropologues sérieux seront d'accord pour nous dire que l'homme n'est jamais seul, qu'il s'inscrit toujours dans une communauté familiale, villageoise, clanique, ethnique, etc.La “pensée 68”, notamment celle de Foucault, et la pensée d'un Lévy-Strauss nous ont dévoilé une “autre histoire”, une histoire qui n'est plus celle du “grand récit de la raison”. La raison, en tant qu'instance universelle, est une apostasie du réel. Le réel se déploie au départ d'instances multiples, sans ordre rationnel. Foucault et Lévy-Strauss s'inscrivent ipso facto dans le sillage de Herder qui estimait que l'historicité de l'homme se déployait au départ de sa faculté de parler une langue bien précise (Sprachlichkeit), donc au départ d'une spécificité inaliénable. Au “grand récit” abstrait de la raison, se substituait dès lors les merveilleux “petits récits” des peuples poètes. Ce sont ces récits-là que la “pensée 68”, pour son malheur, n'a pas su redécouvrir ; pourtant, avec Mircea Eliade, Gilbert Durand, Louis Dumont, etc. les occasions ne manquaient pas.
Le philosophe allemand contemporain Walter Falk (Université de Marburg) a résolu le problème, sans encore avoir acquis la réputation qu'il mérite : si le “grand récit” rationaliste n'est plus crédible, si le structuralisme d'un Lévy-Strauss nous conduit à désespérer de l'histoire, parce que nous serions involontairement “agis” par des “structures fixes et immobiles”, le modèle de l'histoire ne sera plus “téléologique” (comme le christiano-rationalisme occidental et son dérivé marxiste) ni “structuralo-fixiste” (comme lorsque Lévy-Strauss chantait les vertus des « sociétés froides »).Le modèle de l'histoire sera “potentialiste”, au-delà du néo-fixisme du “réarmement théologique” de BHL et au-delà des résidus de téléologie progressiste. Pour Falk, le potentialisme équivaut, en somme, à 2 pensées, que l'on ne met jamais en parallèle : celle des fulgurations phylogénétiques de Konrad Lorenz et celle de la pensée anticipative d'Ernst Bloch. Comme chez Foucault, les structures qui agissent les hommes ne sont plus simplement stables mais aussi variables. Falk développe là une vision réellement tragique de l'histoire : l'humanité ne marche pas vers un telos paradisiaque ni ne vit au jour le jour, bercée par l'éternel retour du même, agie sans cesse par les mêmes structures échappant à son contrôle.
L'histoire est le théâtre où font irruption des potentialités diverses que le poète interprète selon ses sensibilités propres. Là réside ses libertés, ses libertés d'ajouter quelques chose au capital de créativité de son peuple. La “pensée 68” est entrée dans une double impasse : celle d'un “anti-humanisme”, très riche en potentialités, enlisée dans un vocabulaire inaccessible au public cultivé moyen et celle d'un “humanisme” sans teneur philosophique. Le potentialisme de Falk et le retour des récits historiques des peuples ainsi que des récits mythologiques constitueront les axes d'une “troisième voie” politique, impliquant la libération de notre continent.► Vincent Goethals, Vouloir n°31, 1986.

pièces-jointes :
[« De toutes les occupations intellectuelles, la plus utile est l'histoire », Salluste, Jugurtha. Ci-contre La roue de la Fortune, 1883, Edward Burne-Jones, Orsay]
Chacun s'interroge aujourd'hui sur le « sens de l'histoire », c'est-à-dire à la fois sur le but et sur la signication des phénomènes historiques. L'objet de cet article est d'examiner les réponses que notre époque donne à cette double interrogation, en tentant de les ramener, en dépit de leur multitude apparente, à 2 types fondamentaux, rigoureusement antagonistes et contradictoires.
Mais il est d'abord nécessaire de mettre en lumière la signification que, dès l'abord, nous allons donner ici au mot « histoire ». Cette question de vocabulaire a son importance. Nous parlons parfois d'« histoire naturelle », d'« histoire du cosmos », d'« histoire de la vie ». Il s'agit là, bien sûr, d'images analogiques. Mais toute analogie, en même temps qu'elle souligne poétiquement une ressemblance, implique aussi logiquement une diversité fondamentale. L'univers macrophysique, en réalité, n'a pas d'histoire : tel que nous le percevons, tel que nous pouvons nous le représenter, il ne fait que changer de configuration à travers le temps. La vie non plus n'a pas d'histoire : son devenir consiste en une évolution ; elle évolue.
On s'aperçoit en fait que l'histoire est la façon de devenir de l'homme (et de l'homme seul) en tant que tel : seul l'homme devienl historiquement. Par conséquent, se poser la question de savoir si l'histoire a un sens, c'est-à-dire une signification et un but, revient au fond à se demander si l'homme qui est dans l'histoire et qui (volontairement ou non) fait l'histoire, si cet homme a lui-même un sens, si sa participation à l'histoire est ou non une attitude rationnelle.
trois périodes successives
De toutes parts, aujourd'hui, l'histoire est en accusation. Il s'agit, comme nous le verrons, d'un phénomène ancien. Mais aujourd'hui, l'accusation se fait plus véhémente, plus explicite que jamais. C'est une condamnation totale et sans appel de l'histoire que l'on nous demande de prononcer. L'histoire, nous dit-on, est la conséquence de l'aliénation de l'humanité. On invoque, on propose, on projette la fin de l'histoire. On prêche le retour à une sorte d'état de nature enrichi, l'arrêt de la croissance, la fin des tensions, le retour à l'équilibre tranquille et serein, au bonheur modeste mais assure qui serait celui de toute espèce vivante. Les noms de quelques théoriciens viennent ici à l'esprit, et d'abord ceux de Herbert Marcuse et de Claude Lévi-Strauss, dont les doctrines sont bien connues.
L'idée d'une fin de l'histoire peut apparaître comme on ne peut plus moderne. En réalité, il n'en est rien. Il suffit en effet d'examiner les choses de plus près pour s'apercevoir que cette idée n'est que l'aboutissement logique d'un courant de pensée vieux d'au moins 2.000 ans et qui, depuis 2.000 ans, domine et conforme ce que nous appelons aujourd'hui la “civilisation occidentale”. Ce courant de pensée est celui de la pensée égalitaire. Il exprime une volonté égalitaire, qui fut instinctive et comme aveugle à ses débuts, mais qui, à notre époque, est devenue parfaitement consciente de ses aspirations et de son objectif final. Or, cet objectif final de l'entreprise égalitaire est précisément la fin de l'histoire, la sortie de l'histoire.
La pensée égalitaire a traversé au fil des siècles 3 périodes successives. Dans la première, qui correspond à la naissance et au développement du christianisme, elle s'est constituée sous la forme d'un mythe. Ce terme, soulignons-le, ne sous-entend rien de négatif. Nous appelons “mythe” tout discours qui, en se développant par lui-même, crée en même temps son langage, donnant ainsi aux, mots un sens nouveau, et fait appel, en ayant recours à des symboles, à l'imagination de ceux auxquels il s'adresse. Les éléments structurels d'un mythe s'appellent les mythèmes. Ils constituent une unité de contraires, mais ces contraires, n'étant pas encore séparés, restent d'abord cachés, pour ainsi dire invisibles.
Dans le processus du développement historique, l'unité de ces mythèmes éclate, donnant alors naissance à des idéologies concurrentes. Il en a été ainsi avec le christianisme, dont les mythèmes ont fini par engendrer des églises, puis des théologies et enfin des idéologies concurrentes (comme celles de la Révolution américaine et de la Révolution française). L'éclosion et la diffusion de ces idéologies correspond à la seconde période de l'égalitarisme. Par rapport au mythe, les idéologies proclament déjà des principes d'action, mais elles n'en tirent pas encore toutes leurs conséquences, ce qui fait que leur pratique est soit hypocrite, soit sceptique, soit naïvement optimiste. On arrive enfin à la troisième période, dans laquelle les idées contradictoires engendrées par les mythèmes originels se résorbent dans une unité, qui est celle du concept synthétique. La pensée égalitaire, animée désormais par une volonté devenue pleinement consciente, s'exprime sous une forme qu'elle décrète “scientifique”. Elle prétend être une science. Dans le développement qui nous intéresse, ce stade correspond à l'apparition du marxisme et de ses dérivés.
Le mythe, les idéologies, la prétendue science égalitaire expriment donc, si l'on peut dire, les niveaux successifs de conscience d'une même volonté. Œuvre d'une même mentalité, ils présentent toujours la même structure fondamentale. Il en va de même, naturellement, pour les conceptions de l'histoire qui en dérivent, et qui ne diffèrent entre elles que par la forme et le langage utilisé dans le discours. Quelle que soit sa forme historique, la vision égalitaire de l'histoire est une vision eschatologique, qui attribue à l'histoire une valeur négative et ne lui reconnaît un sens que dans la mesure où le mouvement historique tend, de par son propre mouvement, à sa négation et à sa fin.
restitution d'un moment donné
Si l'on examine l'Antiquité païenne, on s'aperçoit qu'elle a oscillé entre deux visions de l'histoire, dont l'une n'était d'ailleurs que l'antithèse relative de l'autre : toutes deux concevaient le devenir historique comme une succession d'instants dans laquelle chaque instant présent délimite toujours, d'un côté le passé, et de l'autre l'avenir. La première de ces visions propose une image cyclique du devenir historique. Elle implique la répétition éternelle d'instants, de phases ou de périodes donnés. C'est ce qu'exprime la formule Nihil sub sole novi (rien de nouveau sous le soleil). La seconde, qui finira d'ailleurs par se résorber dans la première, propose l'image d'une droite ayant un commencement, mais n'ayant pas de fin, du moins pas de fin imaginable et prévisible.
Le christianisme a opéré en quelque sorte une synthèse de ces deux visions antiques de l'histoire, en leur substituant une conception de l'histoire que l'on a appelée “linéaire”, et qui est en réalité segmentaire. Dans cette vision, l'histoire a bien un commencement, mais elle doit aussi avoir une fin. Elle n'est qu'un épisode, un accident dans l'être de l'humanité. Le véritable être de l'homme est extérieur à l'histoire. Et c'est la fin de l'histoire qui est censée le restituer, en le sublimant, tel qu'il était avant le commencement. Comme dans la vision cyclique, il y a donc dans la vision fragmentaire conclusion par restitution d'un moment donné, mais, contrairement à ce qui se passe avec le cycle, ce moment est situé désormais hors de l'histoire, hors du devenir historique : à peine restitué, il se figera dans une immuable éternité : le mouvement historique, étant achevé, ne se reproduira plus. De même, comme dans la vision qui implique une droite en progression perpétuelle, il y a, dans la vision segmentaire, un commencement de l'histoire, mais à ce commencement s'ajoute une fin, si bien que la véritable éternité humaine n'est plus celle du devenir, mais celle de l'être.
Cet épisode qu'est l'histoire est perçu, dans la perspective chrétienne, comme une véritable malédiction. L'histoire résulte d'une condamnation de l'homme par Dieu, condamnation au malheur, au travail, à la sueur et au sang, qui sanctionne une faute commise par l'homme. L'humanité, qui vivait dans la bienheureuse innocence du jardin d'Éden, a été condamnée à l'histoire parce qu'Adam, son ancêtre, a transgressé le commandement divin, a goûté le fruit de l'arbre de science, et s'est voulu pareil à Dieu. Cette faute d'Adam, en tant que péché originel, pèse sur tout individu venant au monde. Elle est par définition inexpiable, puisque l'offensé est Dieu lui-même.
Mais Dieu, dans son infinie bonté, accepte de se charger lui-même de l'expiation : il se fait homme en s'incarnant dans la personne de Jésus. Le sacrifice du Fils de Dieu introduit dans le devenir historique le fait essentiel de la Rédemption. Sans doute celle-ci ne concerne-t-elle que les seuls individus touchés par la Grâce. Mais elle rend désormais possible le lent cheminement vers la fin de l'histoire, à laquelle la communauté des saints devra désormais préparer l'humanité. Enfin, un jour viendra où les forces du Bien et du Mal se livreront une dernière bataille, laquelle aboutira à un Jugement dernier et, par-delà ce Jugement, à l'instauration d'un Royaume des cieux ayant son pendant dialectique dans l'abîme de l'Enfer.
Éden d'avant le commencement de l'histoire, péché originel, expulsion du jardin d'Éden, traversée de cette vallée de larmes qu'est le monde, lieu du devenir historique, Rédemption, communauté des saints, bataille apocalyptique et Jugement dernier, fin de l'histoire et instauration d'un Royaume des cieux : tels sont les mythèmes qui structurent la vision mythique de l'histoire proposée par le christianisme, vision dans laquelle le devenir historique de l'homme a une valeur purement négative et le sens d'une expiation.
la vision marxiste
Les mêmes mythèmes se retrouvent sous une forme laïcisée et prétendument scientifique dans la vision marxiste de l'histoire. (En employant ce mot, de “marxiste”, nous n'entendons pas participer au débat, très à la mode aujourd'hui, sur ce que serait la “véritable pensée” de Marx. Au cours de son existence, Kart Marx a pensé des choses assez différentes et l'on pourrait discuter pendant des heures pour savoir quel est le “vrai” Marx. Nous nous référerons donc ici à ce marxisme reçu qui a été très longtemps, et qui reste en fin de compte la doctrine des partis communistes et des États se réclamant de l'interprétation de Lénine). Dans cette doctrine, l'histoire est présentée comme le résultat d'une lutte de classes, c'est-à-dire d'une lutte entre groupes humains se définissant par rapport à leurs conditions économiques respectives.
Le jardin d'Éden de la préhistoire se retrouve dans cette vision avec le “communisme primitif” pratiqué par une humanité encore plongée dans l'état de nature et purement prédatrice. Tandis que dans l'Éden, l'homme subissait les contraintes résultant des commandements de Dieu, les sociétés communistes préhistoriques vivaient sous la pression de la misère. Cette pression a conduit à l'invention des moyens de production agricoles, mais cette invention s'est aussi révélée une malédiction. Elle implique en effet, non seulement l'exploitation de la nature par l'homme, niais aussi la division du travail, l'exploitation de l'homme par l'homme et, par conséquent, l'aliénation de tout homme à lui-même. La lutte des classes est la conséquence implicite de cette exploitation de l'homme par l'homme. Son résultat est l'histoire.
Comme on le voit, ici, ce sont les conditions économiques qui déterminent les comportements humains. Par enchaînement logique, ces derniers aboutissent à la création de systèmes de production toujours nouveaux, lesquels entraînent à leur tour des conditions économiques nouvelles, et surtout une misère grandissante des exploités. Cependant, là aussi, une rédemption intervient. Avec l'avènement du système capitaliste, la misère des exploités atteint en effet son comble : elle devient insupportable. Les prolétaires prennent alors conscience de leur condition, et cette prise de conscience rédemptrice a pour effet l'organisation des partis communistes, exactement comme la Rédemption de Jésus avait abouti à la fondation d'une communauté des saints.
Les partis communistes entreprendront une lutte apocalyptique contre les exploitants. Celle-ci pourra être difficile, mais elle sera nécessairement victorieuse (c'est le “sens de l'histoire”). Elle aboutira à l'abolition des classes, mettre fin à l'aliénation de l'homme, permettra l'instauration d'une société communiste immuable et sans classes. Et comme l'histoire est le résultat de la lutte des classes, il n'y aura évidemment plus d'histoire. Le communisme préhistorique se trouvera restitué, tel le jardin d'Éden par le Royaume des cieux, mais d'une façon sublimée : alors que la société communiste primitive était affligée par la misère matérielle, la société communiste post-historique jouira d'une satisfaction parfaitement équilibrée de ses besoins.
Ainsi, dans la vision marxiste, l'histoire reçoit également une valeur négative. Née de l'aliénation originelle de l'homme, elle n'a de sens que dans la mesure où, en augmentant sans cesse la misère des exploités, elle contribue finalement à créer les conditions dans lesquelles cette misère disparaîtra, et “travaille” en quelque sorte à sa propre fin.
une détermination de l'histoire
Ces 2 visions égalitaires de l'histoire, la vision religieuse chrétienne et la vision laïque marxiste, toutes les 2 segmentaires, toutes les 2 eschatologiques, impliquent logiquement l'une et l'autre une détermination de l'histoire qui n'est pas le fait de l'homme, mais de quelque chose qui le transcende. Christianisme et marxisme ne s'en efforcent pas moins de le nier. Le christianisme attribue à l'homme un libre arbitre, ce qui lui permet d'affirmer qu'Adam, ayant librement “choisi” de pécher, est seul responsable de sa faute, c'est-à-dire de son imperfection. Il reste pourtant que c'est Dieu qui a fait (et a donc voulu) qu'Adam soit imparfait.
De leur côté, les marxistes affirment parfois que c'est l'homme qui fait l'histoire, ou plus exactement les hommes en tant qu'ils appartiennent à une classe sociale. Il reste pourtant que les classes sociales sont définies et déterminées par les conditions économiques. Il reste aussi que c'est la misère originelle qui a contraint les hommes à entrer dans le sanglant enchaînement de la lutte des classes. L'homme n'est donc finalement agi que par sa condition économique. Il est le jouet d'une situation qui trouve son origine dans la nature elle-même en tant que jeu de forces matérielles. D'où il résulte que lorsque l'homme joue un rôle dans les visions égalitaires de l'histoire, c'est un rôle d'une pièce qu'il n'a pas écrite, qu'il ne saurait avoir écrite ; et cette pièce est une farce tragique, honteuse et douloureuse. La dignité comme la vérité authentique de l'homme se situent hors de l'histoire, avant l'histoire et après l'histoire.
Toute chose possède en elle-même sa propre antithèse relative. La vision eschatologique de l'histoire possède son antithèse relative, égalitaire elle aussi, qui est la théorie du progrès indéfini. Dans cette théorie, le mouvement historique est représenté comme tendant constamment vers un point zéro qui n'est jamais atteint. Ce “progrès” peut aller dans le sens d'un “toujours mieux”, excluant cependant l'idée d'un bien parfait et absolu : c'est un peu la vision naïve de l'idéologie américaine, liée à l'american way of life, et aussi celle d'un certain marxisme désabusé. Il peut aller aussi dans le sens d'un « toujours pire », sans que la mesure du mal n’atteigne jamais son comble : c'est un peu la vision pessimiste de Freud, qui ne voyait pas comment ce “malheur” qu'est la civilisation pourrait cesser un jour de se reproduire. (À noter d'ailleurs que cette vision pessimiste du freudisme est en passe actuellement d'être résorbée, notamment par Marcuse et les freudo-marxistes, dans la thèse eschatologique du marxisme, après avoir joué le rôle que joue toute antithèse depuis l'invention du diable, c'est-à-dire le rôle de faire-valoir).
animer une autre volonté
Comme chacun le sait, c'est à Friedrich Nietzsche que remonte la réduction du christianisme, de l'idéologie démocratique et du communisme au commun dénominateur de l'égalitarisme. Mais c'est aussi à Nietzsche que remonte le deuxième type de vision de l'histoire, qui, à l'époque actuelle, s'oppose (souterrainement parfois, mais avec d'autant plus de ténacité) à la vision eschatologique et segmentaire de l'égalitarisme. Nietzsche, en effet, n'a pas seulement voulu analyser, mais aussi combattre l'égalitarisme. Il a voulu inspirer, susciter un projet opposé au projet égalitaire, animer une autre volonté, conforter un jugement de valeur diamétralement différent.
De ce fait, son œuvre présente 2 aspects, tous 2 complémentaires. Le premier aspect est proprement critique ; on pourrait même dire scientifique. Son but est de mettre en lumière la relativité de tout jugement de valeurs, de toute morale et, aussi, de toute vérité prétendument absolue. De la sorte, il dévoile la relativité des principes absolus proclamés par l'égalitarisme. Mais à côté de cet aspect critique, il en existe un autre, que nous pourrions appeler poétique, puisque ce mot vient du grec poïein, qui signifie “faire, créer”. Par ce travail poétique, Nietzsche s'efforce de donner naissance à un nouveau type d'homme, attaché à de nouvelles valeurs et tirant ses principes d'action d'une éthique qui n'est pas celle du Bien et du Mal, d'une éthique qu'il est légitime d'appeler surhumaniste.
Pour nous donner une image de ce que pourrait être une société humaine fondée sur les valeurs qu'il propose, Nietzsche a presque toujours recours à l'exemple de la société grecque archaïque, à la plus ancienne société romaine, voire aux sociétés ancestrales du « fauve blond » indo-européen, aristocrate et conquérant. Cela, presque tout le monde le sait. En revanche, on ne prête pas suffisamment attention au fait que Nietzsche, dans le même temps, met en garde contre l'illusion consistant à croire qu'il serait possible de « ramener les Grecs », c'est-à-dire de ressusciter le monde antique préchrétien. Or, ce détail est d'une importance extrême, car il nous offre une clef nécessaire pour bien comprendre la vision nietzschéenne de l'histoire. Nietzsche a volontairement caché, “codé” pourrait-on dire, le système organisateur de sa pensée. Il l'a fait, comme il le dit lui-même expressément, conformément à un certain sentiment aristocratique : il entend interdire aux importuns l'accès de sa maison. C'est la raison pour laquelle il se contente de nous livrer tous les éléments de sa conception de l'histoire, sans jamais nous révéler comment il faut les relier ensemble.
En outre, le langage adopté par F. Nietzsche est le langage du mythe, ce qui ne fait qu'ajouter aux difficultés de l'interprétation. La thèse qui est exposée ici n'est donc rien de plus qu'une interprétation possible du mythe nietzschéen de l'histoire ; mais il s'agit d'une interprétation qui a son poids historique, puisqu'elle a inspiré tout un mouvement métapolitique aux prolongements puissants, celui de la Révolution conservatrice, et qu'elle est aussi l'interprétation de ceux qui, se réclamant de Nietzsche, adhèrent le plus intimement à ses intentions anti-égalitaires déclarées.
Les éléments, les mythèmes qui se rattachent à la vision nietzschéenne de l'histoire sont principalement au nombre de 3 : le mythème du dernier homme, celui de l'avènement du surhomme, enfin celui de l'Éternel retour de l'Identique.
l'Éternel retour
Aux yeux de Nietzsche, le dernier homme représente le plus grand danger pour l'humanité. Ce dernier homme est de la race inextinguible des pucerons. Il aspire à un petit bonheur qui serait égal pour tout le monde. Il veut la fin de l'histoire, car l'histoire est génératrice d'événements, c'est-à-dire de conflits et de tensions qui menacent ce « petit bonheur ». Il se moque de Zarathoustra, qui prêche, lui, l'avènement du surhomme. Pour Nietzsche, en effet, l'homme n'est qu'un « pont entre la bête et le surhomme », ce qui signifie que l'homme et l'histoire n'ont de sens que dans la mesure où ils tendent à un dépassement et, pour ce faire, n'hésitent pas à accepter leur propre disparition. Le surhomme correspond à un but, un but donné à tout moment et qu'il est peut-être impossible d'atteindre ; mieux, un but qui, à l'instant même qu'il est atteint, se repropose sur un nouvel horizon. Dans une telle perspective, l'histoire se présente donc comme un perpétuel dépassement de l'homme par l'homme.
Cependant, dans la vision de Nietzsche, il est un dernier élément qui parait à première vue contradictoire par rapport au mythème du surhomme, c'est celui de l'Éternel retour. Nietzsche affirme en effet que l'Éternel retour de l'Identique commande lui aussi le devenir historique, ce qui à première vue semble indiquer que rien de nouveau ne peut se produire, et que tout dépassement est exclu. Le fait est, d'ailleurs, que ce thème de l'Éternel retour a souvent été interprété dans le sens d’une conception cyclique de l'histoire, conception qui rappelle fortement celle de l'Antiquité païenne. Il s'agit là, à notre avis, d'une sérieuse erreur, contre laquelle Friedrich Nietzsche lui-même a mis en garde. Lorsque, sous le Portique qui porte le nom d'Instant, Zarathoustra interroge l'Esprit de Pesanteur sur la portée des 2 chemins éternels qui, venant de directions opposées, se rejoignent à cet endroit précis, l'Esprit de Pesanteur répond : « Tout ce qui est droit est mensonger, la vérité est courbe, le temps aussi est un cercle ». Alors Zarathoustra réplique avec violence : « Ne te rends pas, ô nain, les choses plus faciles qu'elles ne le sont ».
Dans la vision nietzschéenne de l'histoire, contrairement à ce qui était le cas dans l'Antiquité païenne, les instants ne sont donc pas vus comme des points se succédant sur une ligne, que celle-ci soit droite ou circulaire. Pour comprendre sur quoi repose la conception nietzschéenne du temps historique, il faut plutôt mettre celle-ci en parallèle avec la conception relativiste de l'univers physique quadridimensionnel. Comme ou le sait, l'univers einsteinien ne peut être représenté “sensiblement”, puisque notre sensibilité, étant d'ordre biologique, ne peut avoir que des représentations tridimensionnelles. De même, dans l'univers historique nietzschéen, le devenir de l'homme est conçu comme un ensemble de moments dont chacun forme une sphère à l'intérieur d'une « supersphère » quadridimensionnelle, où chaque moment peut, par conséquent, occuper le centre par rapport aux autres. Dans cette perspective, l'actualité de chaque moment ne s'appelle plus « présent ». Bien au contraire, présent, passé et avenir coexistent dans tout moment : ils sont les 3 dimensions de tout moment historique. Les oiseaux de Zarathoustra ne chantent-ils pas à leur Maître : « En tout moment, commence l'Être. Autour de tout Ici s'enroule la sphère Là. Partout est le centre. Courbe est le sentier de l'Éternité ».
le choix offert à notre époque
 Tout cela peut paraître compliqué, tout comme la théorie de la relativité est elle-même “compliquée”. Pour nous aider, ayons recours à quelques images. Le passé, pour Nietzsche, ne correspond nullement à ce qui a été une fois pour toutes, élément figé à jamais que le présent laisserait derrière lui. De même, l'avenir n'est plus l'effet obligatoire de toutes les causes qui l'ont précédé dans le temps et qui le déterminent, comme dans les visions linéaires de l'histoire. À tout moment de l'histoire, dans toute “actualité”, passé et avenir sont pour ainsi dire remis en cause, se configurent selon une perspective nouvelle, conforment une autre vérité. On pourrait dire, pour user d'une autre image, que le passé n'est rien d'autre que le projet auquel l'homme conforme son action historique, projet qu'il cherche à réaliser en fonction de l'image qu'il se fait de lui-même et qu'il s'efforce d'incarner. Le passé apparaît alors comme une préfiguration de l'avenir. Il est, au sens propre, “l'imagination” de l'avenir : telle est l'une des significations véhiculées par le mythème de l'Éternel retour.
Tout cela peut paraître compliqué, tout comme la théorie de la relativité est elle-même “compliquée”. Pour nous aider, ayons recours à quelques images. Le passé, pour Nietzsche, ne correspond nullement à ce qui a été une fois pour toutes, élément figé à jamais que le présent laisserait derrière lui. De même, l'avenir n'est plus l'effet obligatoire de toutes les causes qui l'ont précédé dans le temps et qui le déterminent, comme dans les visions linéaires de l'histoire. À tout moment de l'histoire, dans toute “actualité”, passé et avenir sont pour ainsi dire remis en cause, se configurent selon une perspective nouvelle, conforment une autre vérité. On pourrait dire, pour user d'une autre image, que le passé n'est rien d'autre que le projet auquel l'homme conforme son action historique, projet qu'il cherche à réaliser en fonction de l'image qu'il se fait de lui-même et qu'il s'efforce d'incarner. Le passé apparaît alors comme une préfiguration de l'avenir. Il est, au sens propre, “l'imagination” de l'avenir : telle est l'une des significations véhiculées par le mythème de l'Éternel retour.Par voie de conséquence, il est clair que dans la vision que nous propose Nietzsche, l'homme porte l'entière responsabilité du devenir historique. L'histoire est son fait. Ce qui revient à dire qu'il porte aussi l'entière responsabilité de lui-même, qu'il est véritablement et totalement libre : faber suae fortunae. Cette liberté là est une liberté authentique, non une “liberté” conditionnée par la Grâce divine ou par les contraintes d'une situation matérielle économique. C'est aussi une liberté réelle, c'est-à-dire une liberté consistant en la possibilité de choisir entre 2 options opposées, options données à tout moment de l'histoire et qui, toujours, remettent en cause la totalité de l'être et du devenir de l'homme. (Si ces options n'étaient pas toujours réalisables, le choix ne serait qu'un faux choix, la liberté, une fausse liberté, l'autonomie de l'homme, un faux-semblant).
Or, quel est le choix offert aux hommes de notre époque ? Nietzsche nous dit que ce choix est à faire entre le « dernier homme », c'est-à-dire l'homme de la fin de l'histoire, et l'élan vers le surhomme, c'est-à-dire la régénération de l'histoire. Nietzsche considère que ces 2 options sont aussi réelles que fondamentales. Il affirme que la fin de l'histoire est possible, qu'elle doit être sérieusement envisagée, exactement comme est possible son contraire : la régénération de l'histoire. En dernier ressort, l'issue dépendra donc des hommes, du choix qu'ils opéreront entre les 2 camps, celui du mouvement égalitaire, que Nietzsche appelle le mouvement du dernier homme, et l'autre mouvement, que Nietzsche s'est efforcé de susciter, qu'il a déjà suscité et qu'il appelle son mouvement.
deux sensibilités
Vision linéaire, vision sphérique de l'histoire : nous nous trouvons confrontés ici à 2 sensibilités différentes qui n'ont cessé de s'opposer, qui s'opposent et qui continueront de s'opposer. Ces 2 sensibilités coexistent à l'époque actuelle. Dans un spectacle tel que celui des Pyramides, par ex., la sensibilité égalitaire verra, du point de vue moral, un symbole exécrable, puisque seuls l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme, ont permis de concevoir et de réaliser ces monuments. L'autre sensibilité, au contraire, sera d'abord frappée par l'unicité de cette expression artistique et architecturale, par tout ce qu'elle suppose de grand et d'effroyable dans l'homme qui ose faire l'histoire et désire égaler son destin.
Prenons un autre exemple. Oswald Spengler, dans une page fameuse, a rappelé le souvenir de cette sentinelle romaine qui, à Pompéi, s'était laissée ensevelir sous les cendres parce qu'aucun supérieur ne lui avait donné l'ordre d'abandonner son poste. Pour une sensibilité égalitaire, liée à une vision segmentaire de l'histoire, un tel geste est totalement dépourvu de sens. En dernière analyse, elle ne peut que le condamner, en même temps qu'elle condamne l'histoire, car à ses yeux, ce soldat a été victime d'une illusion ou d'une erreur “inutile”. Au contraire, le même geste deviendra immédiatement exemplaire du point de vue de la sensibilité tragique et surhumaniste, qui comprend, intuitivement pourrait-on dire, que ce soldat romain n'est véritablement devenu un homme qu'en se conformant à l'image qu'il se faisait de lui-même, c'est-à-dire à l'image d'une sentinelle de la Ville impériale.
Nous venons de citer Spengler. Cela nous amène à poser, après lui, le problème du destin de l'Occident. Spengler, comme on le sait, était pessimiste. Selon lui, la fin de l'Occident est proche, et l'homme européen ne peut plus, tel le soldat de Pompéi, que tenir son rôle jusqu'au bout, avant de périr en héros tragique dans l'embrasement de son monde et de sa civilisation. Mais en 1975, c'est à la fin de toute histoire que tend l'Occident. C'est le retour au bonheur immobile de l'espèce qu'il appelle de ses vœux, sans rien voir de tragique dans cette perspective, bien au contraire. L'Occident égalitaire et universaliste a honte de son passé. Il a horreur de cette spécificité qui a fait sa supériorité pendant des siècles, tandis que dans son subconscient cheminait la morale qu'il s'était donnée.
Car cet Occident bimillénaire est aussi un Occident judéo-chrétien qui a fini par se découvrir tel, et qui en tire aujourd'hui les conséquences. Certes, cet Occident a aussi véhiculé pendant longtemps un héritage grec, celtique, romain, germanique, et il en a fait sa force. Mais les masses occidentales, privées de véritables maîtres, renient cet héritage indo-européen. Seules les petites minorités, éparses çà et là, regardent avec nostalgie les réalisations de leurs plus lointains ancêtres, s'inspirent des valeurs qui étaient les leurs, et rêvent de les ressusciter. De telles minorités peuvent sembler dérisoires, et peut-être le sont-elles effectivement. Et pourtant, une minorité, fût-elle infime, peut toujours arriver à valoir une masse. Telle est la raison pour laquelle l'Occident moderne, cet Occident né du compromis constantinien et de l'in hoc signo vinces, est devenu schizophrène. Dans son immense majorité, il veut la fin de l'histoire et aspire au bonheur dans la régression. Et en même temps, de petites minorités cherchent à fonder une nouvelle aristocratie et espèrent un Retour qui, en tant que tel, ne pourra jamais se produire (« on ne ramène pas les Grecs »), mais qui peut se muer en régénération de l'histoire.
vers une régénération du temps
 Ceux qui ont adopté une vision linéaire ou segmentaire de l'histoire ont la certitude d'être du côté de Dieu, comme le disent les uns, d'aller dans le sens de l'histoire, comme le disent les autres. Leurs adversaires, eux, ne peuvent avoir nulle certitude. Croyant que l'histoire est faite par l'homme et par l'homme seul, que l'homme est libre et que c'est librement qu'il forge son destin, il leur faut admettre du même coup que cette liberté peut, à la limite, remettre en cause et peut-être abolir l'historicité de l'homme. Il leur faut, répétons-le, considérer que la fin de l'histoire est possible, même si c'est une éventualité qu'ils repoussent et contre laquelle ils se battent. Mais si la fin de l'histoire est possible, la régénération de l'histoire l'est aussi, à tout moment. Car l'histoire n'est ni le reflet d'une volonté divine, ni le résultat d'une lutte de classes prédéterminée par la logique de l'économie, mais bien la lutte que se livrent entre eux les hommes au nom des images qu'ils se font respectivement d'eux-mêmes et auxquelles ils entendent s'égaler en les réalisant.
Ceux qui ont adopté une vision linéaire ou segmentaire de l'histoire ont la certitude d'être du côté de Dieu, comme le disent les uns, d'aller dans le sens de l'histoire, comme le disent les autres. Leurs adversaires, eux, ne peuvent avoir nulle certitude. Croyant que l'histoire est faite par l'homme et par l'homme seul, que l'homme est libre et que c'est librement qu'il forge son destin, il leur faut admettre du même coup que cette liberté peut, à la limite, remettre en cause et peut-être abolir l'historicité de l'homme. Il leur faut, répétons-le, considérer que la fin de l'histoire est possible, même si c'est une éventualité qu'ils repoussent et contre laquelle ils se battent. Mais si la fin de l'histoire est possible, la régénération de l'histoire l'est aussi, à tout moment. Car l'histoire n'est ni le reflet d'une volonté divine, ni le résultat d'une lutte de classes prédéterminée par la logique de l'économie, mais bien la lutte que se livrent entre eux les hommes au nom des images qu'ils se font respectivement d'eux-mêmes et auxquelles ils entendent s'égaler en les réalisant.À l'époque où nous vivons, certains ne trouvent de sens à l'histoire que dans la mesure où celle-ci tend à la négation de la condition historique de l'homme. Pour d'autres, au contraire, le sens de l'histoire n'est autre que le sens d'une certaine image de l'homme, une image usée et consumée par la marche du temps historique. Une image donnée dans le passé, mais qui conforme toujours leur actualité. Une image qu'ils ne peuvent donc réaliser que par une régénération du temps historique. Ceux-là savent que l'Occident n'est plus qu'un amoncellement de ruines. Mais avec Nietzsche, ils savent aussi qu'une étoile, si elle doit naître, ne peut jamais jaillir que d'un chaos de poussières obscures.
► Giorgio Locchi, Nouvelle École n°27/28, 1975.
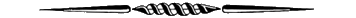
DEVANT L'HISTOIRE
QUELQUES REMARQUES NON SYSTÉMATIQUES
L'histoire : un no man's land ?
De l'homme qui attache une importance particulière à l'histoire, on dit volontiers qu'il se sent mal à l'aise dans le présent et qu'il cherche à se reporter par le rêve aux époques qu'il préfère ; et, pour cette raison, qu'il est “conservateur”. Pour décrire ce comportement, qui prend aujourd'hui l'allure d'une épidémie, on a créé le terme de « nostalgie ». La nostalgie constitue un phénomène aux aspects multiples et sur lequel il n'est pas facile de porter un jugement. Mais elle ne semble pas dépendre d'attitudes intellectuelles fondamentales. Il existe des conservateurs nostalgiques et des conservateurs qui ne le sont pas, tandis que d'innombrables non-conservateurs éprouvent d'intenses nostalgies. De toute façon, la nostalgie n'est pas un élément constitutif du conservatisme ; et le fait qu'il soit ou non nostalgique ne permet pas de dire de quelqu'un qu'il est ou n'est pas conservateur.
◘ 1. L'hisloire est proche
La plupart des malentendus au sujet de l'histoire tiennent au fait que l'on considère celle-ci comme éloignée dans le temps. Certes, l'histoire n'est pas immédiatement perceptible. Mais elle ne s'en inscrit pas moins dans le présent. Notre rapport avec elle peut se concevoir selon le modèle de l'holographie, qui a été exposé en 1948 par Dennis Gabor. Il s'agit d'une nouvelle sorte de “photographie” capable de fixer aussi bien les contours que l'envers d'un objet, bien que notre œil ne puisse en percevoir que l'endroit. L'homme qui n'a pas le sens de l'histoire est semblable à quelqu'un qui regarde dans un miroir : il s'y voit comme posé à la surface, avec tes déformations et les lacunes que cela comporte. Avoir le sens de l'histoire, cela signifie ne pas se contenter de cette unique dimension. Et — pour rester sur l'image que nous avons prise comme exemple — se pencher sur l'histoire, cela veut dire tenir derrière sa tête un second miroir ou tout un système de miroirs, afin de se voir de tous côtés – et prendre ainsi de la distance par rapport à soi-même.
◘ 2. L'histoire n'est pas un centre d'éducation
Le profit que l'on retire de l'histoire est généralement d'ordre moral. On en vante les exemples, que l'on pourrait chercher à égaler. On prétend qu'elle aiderait à éviter des erreurs que les autres ont commises. Et ainsi de suite. Les historiens n'ont pas ménagé leurs railleries quant à ces prétendus effets immédiatement éducateurs de l'histoire. Les successeurs des grands hommes sont généralement peu nombreux ; et les erreurs se renouvellent de façon lassante. Si l'histoire a un effet éducateur, le moins que l'on puisse dire est que cet effet se manifeste moins directement.
◘ 3. L'histoire permet des constatations vérifiables
L'histoire possède un pouvoir disciplinaire parce que sa fonction est la même que celle de l'expérimentation dans le domaine des sciences naturelles : l'histoire offre la seule possibilité d'effectuer des constatations vérifiables au niveau humain, tout comme l'expérimentation l'offre au niveau de la nature. Cette observation est plus facile à faire depuis que la philosophie s'est volontairement repliée dans le rôle modeste d'une secrétaire au cours de conversations interdisciplinaires. La logique, certes, dispose de ses inductions, mais seulement dans l'abstrait. Ce que nous essayons de distinguer, dans le domaine humain, en tant que “nature”, “âme” (Seele) et “esprit” (Geist), est si intimement confondu que la logique peut à peine l'appréhender. Que puis-je dire de véritablement vérifiable sur une chose, une personne, un événement humain ? Je peux dire ce que cela a été, ce que cela est devenu avec le temps et quel changement est intervenu. Sur le détail, il peut y avoir des divergences d'appréciation : dans les grandes lignes, un consensus est possible.
◘ 4. La vérifiabilité n'est pas tout
Quiconque fait remarquer les étroites limites des constatations vérifiables, s'expose en général à être soupçonné de vouloir dévaloriser toutes les constatations qui vont au-delà. Mais il serait insensé d'agir de la sorte : cela voudrait dire que toute tentative de remonter aux sources, tout projet de grande portée devrait être réduit d'autant, et qu'il faudrait laisser s'étioler la force créatrice qui est en l'homme. Dans la sphère des actions humaines, l'histoire possède une fonction particulière : la “vérifiabilité” ne signifie rien de plus. Et ce serait minimiser cette fonction que de l'appeler “compensatrice”, car l'expérience de l'histoire peut avoir 2 effets contraires et radicalement opposés.
◘ 5. Par l'histoire, nous faisons l'expérience du complexe
Ce serait encore une de ces simplifications inadmissibles que de dire, comme dans le cas de la nostalgie, que le « conservateur » éprouve l'histoire comme une absurdité. Certains auteurs ont utilisé cette métaphore de “l'in-signifiant” pour désigner quelque chose qui apparaît effectivement à travers chaque événement historique : à savoir le fait d'expérience que l'histoire représente toujours un plus par rapport aux grilles interprétatives que nous essayons de lui attribuer par la pensée. L'expérience fondamentale selon laquelle « le monde n'est pas divisible », c'est-à-dire que la pensée de l'homme et la réalité ne peuvent jamais coïncider, atteint dans la dimension historique une intensification qu'on pourrait comparer à “l'effet stéréo”. L'histoire est une école d'humilité : toutes les tentatives d'explications monocausales (aussi bien que bi- et tricausales) se brisent contre elle, et nous font prendre conscience du caractère complexe de toute réalité. Cela ne doit pas forcément nous troubler ni même nous écraser — au contraire : d'une manière difficilement définissable (et pour des motifs rationnels non explicables), cela peut en réalité nous pousser à une plus forte approbation. En réalisant à quel point le monde est complexe, nous vivons, en quelque sorte, une seconde naissance.
◘ 6. Par l'histoire, nous faisons l'expérience de la forme
“Donner du sens à ce qui n'a pas de sens” est également une des formules dont nous devons nous méfier. Elle dissimule une psychologie un peu courte. Il est vrai que le monde n'a pas de sens, et que, comme l'homme ne peut pas vivre sans un sens, eh bien, il lui en invente un. Mais le rapport que nous devons avoir avec l'histoire est encore plus essentiel. Cette “seconde naissance” ne consiste pas seulement dans l'expérience de la complexité du monde — elle réside tout autant dans notre impulsion à opposer au complexe (Benn ou Montherlant diraient « au chaos ») une forme, une configuration. Ce qui nous émeut profondément dans l'histoire, c'est que l'homme cherche toujours, précisément sur le fond de cette expérience d'une réalité complexe, et même dans les situations les plus désespérées, à laisser encore une trace derrière lui. Même s'il ne s'agit que d'une égratignure de la si compacte réalité — comme Malraux le dit quelque part avec cette géniale nonchalance qui lui est propre.
◘ 7.
L'homme de l'Aufklärung dira : ce n'est pas beaucoup. Notre réponse ne peut être que : mais cela est.
► Armin MOHLER, Nouvelle École n°27/28, 1975.
(trad. : Paul Kornsprobst, article extrait d'un recueil collectif dirigé par M. Gerd-Klaus Kaltenbrunner : Die Zukunft der Vergangenheit : Lebendige Geschichte, klagende Historiker, Herder, München, 1975)

Contre la fin de l’histoire ou comment ne pas en sortir
Le sens de l’histoire est une idée aussi vieille que l’humanité mais est surtout le fruit d’une mentalité particulière. Deux conceptions s’affrontent : celle de l’Europe antique et celle des judéo-chrétiens. Avec Marx, le mythe retombe sur terre : le prolétariat, messie collectif ; la société sans classes, paradis postindustriel. Nietzsche jette alors les bases d’un projet diamétralement opposé à la conception égalitaire et segmentaire de l’histoire : l’univers est quadridimensionnel. La fin du monde n’est pas une nécessité, mais une possibilité parmi d’autres. C’est à l’homme de choisir.
 L’idée de la fin des temps revient à l’ordre du jour. Depuis quelques années, le catastrophisme et l’apocalyptisme sont à la mode. Le messianisme écologique et le malthusianisme économique fournissent de nouveaux arguments. Et tandis qu’un nouveau millenium se prépare, de singuliers prophètes, tantôt revêtus de la blouse blanche, tantôt, plus simplement, de la soutane ou de la gandoura, nous annoncent que le monde va bientôt finir, que de formidables catastrophes se préparent et que le meilleur moyen de parer aux défis qui nous sont lancés est de mettre un terme à l’histoire. Autrement dit : arrêtons la croissance, refusons le progrès, stoppons l’expansion. Rebroussons chemin.
L’idée de la fin des temps revient à l’ordre du jour. Depuis quelques années, le catastrophisme et l’apocalyptisme sont à la mode. Le messianisme écologique et le malthusianisme économique fournissent de nouveaux arguments. Et tandis qu’un nouveau millenium se prépare, de singuliers prophètes, tantôt revêtus de la blouse blanche, tantôt, plus simplement, de la soutane ou de la gandoura, nous annoncent que le monde va bientôt finir, que de formidables catastrophes se préparent et que le meilleur moyen de parer aux défis qui nous sont lancés est de mettre un terme à l’histoire. Autrement dit : arrêtons la croissance, refusons le progrès, stoppons l’expansion. Rebroussons chemin.Le sens de l’histoire, la fin de l’histoire : double ambiguïté. Le sens : à la fois la direction que prend l’histoire et la signification que revêt son déroulement. La fin : à la fois l’aboutissement de l’histoire et le but vers lequel elle est censée se diriger.
Cette idée de la fin de l’histoire semble à certains une « nouveauté ». Elle est, en fait, aussi vieille que l’humanité — aussi vieille, du moins, qu’une partie de l’humanité. La conjoncture peut la rendre plus ou moins palpitante, mais elle ne la crée pas. La science n’a rien à voir non plus à l’affaire. La question de la fin du monde, comme celle de ses origines, n’est malheureusement pas de celles que la science nous permet de résoudre. Les théories actuelles — le big bang et les autres — relèvent de la spéculation philosophique plus que d’une véritable théorie de la connaissance ; elles sont d’ailleurs discutées et démenties dès l’instant qu’elles sont émises. En fait, l’idée d’une fin de l’histoire, liée à celle d’un début du monde, est le fruit d’une mentalité particulière ; d’une mentalité qui a besoin, pour accepter le monde, de le doter d’une finalité et d’une nécessité interne à lui-même : il faut que le monde ait un début et une fin, faute de quoi — pensée “insupportable” — il n’aurait pas de sens.
« Il suffit d’examiner les choses d’un peu plus près, écrit M. Giorgio Locchi, pour s’apercevoir que l’idée de la fin du monde n’est que l’aboutissement logique d’un courant de pensée, vieux d’au moins deux mille ans, et qui, depuis deux mille ans, domine et conforme ce que nous appelons aujourd’hui la “civilisation occidentale”. Ce courant de pensée est celui de la pensée égalitaire. Il exprime une volonté égalitaire, qui fut instinctive et comme aveugle à ses débuts (égalité devant Dieu), mais qui, à notre époque, est devenue parfaitement consciente de ses aspirations et de son but final. Or, cet objectif final de l’entreprise égalitaire est précisément la fin de l’histoire, la sortie de l’histoire » (1).
Si l’on examine l’Europe païenne de l’Antiquité, on s’aperçoit qu’elle a essentiellement vu l’histoire comme “in-finie”, soit sous la forme d’un cycle du devenir historique (“rien de nouveau sous le soleil”), soit sous la forme d’une simple succession d’instants qu’a priori rien ne doit jamais venir terminer. Cette idée de l’éternité du monde se retrouve aussi bien chez les Celtes, les Germains et les Indiens védiques, que chez les Gréco-romains. Elle affecte tous les milieux, s’exprime dans toutes les écoles. Selon les présocratiques, l’histoire se coule dans l’éternel flux du temps. Annonçant déjà la physique moderne, Lucrèce remarque : « Rien ne se perd, rien ne se crée ». Celse, dans le Discours vrai, écrit :
« La nature de l’univers est une et toujours identique à elle-même, et la somme des maux reste constante. Quant à leur origine, il n’est pas aisé de la discerner quand on n’est pas philosophe : qu’il suffise au commun de savoir qu’ils ne viennent pas de Dieu mais de la matière, et qu’ils sont le lot des choses mortelles : que les choses roulent sempiternellement dans le même cercle, et, partant, qu’il est nécessaire que, suivant l’ordre immuable des cycles, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, soit toujours de même ».
Les pythagoriciens, les platoniciens, les péripatéticiens, les stoïciens, les néo-platoniciens, tous admettent un éternel retour des choses, celles-ci formant un cercle qui met une Grande Année à se fermer. Conviction qui amène Héraclite à dire que « tout coule » (panta rhei), et les physiologues de l’Ionie à formuler la loi d’invariance universelle, devenu depuis le principe de conservation de l’énergie.
Cette conception cyclique de l’histoire n’implique que des fins relatives. Après le Kali-Yugâ des Indiens, un nouveau cycle recommence. Après le Ragnarök, le crépuscule des dieux germaniques, un nouveau monde renaît, gouverné par de nouveaux dieux. Il en est ainsi de toute vie : après la mort d’une culture, une autre culture lui succède, de même que les existences succèdent aux existences, les générations aux générations et les saisons aux saisons.
Pour les Anciens, la fin du monde est une impiété
Pour les Anciens, la divinité est inséparable du monde. C’est parce qu’il y a de la divinité que le monde existe. C’est son existence, son arrangement, son apparente harmonie qui donnent à penser qu’il existe des déesses et des dieux. Le monde est à l’image des dieux parce qu’ils sont eux-mêmes à l’image du monde. Pour les Anciens, le monde n’est donc rien d’autre que le vivant visage de Dieu. Selon eux, remarque M. Louis Rougier, admettre que le monde doive finir, c’est « commettre une impiété majeure, en renversant la preuve de l’existence de Dieu tirée de la stabilité du système du monde » (2).
L’idée judéo-chrétienne d’une création ex nihilo, présente dans la Genèse, et celle d’une eschatologie finale, présente dans les apocalypses, étaient donc en contradiction directe avec les croyances traditionnelles produites par l’esprit européen. D’où les objections élevées par les philosophes païens à l’endroit de la propagande chrétienne, que M. Rougier, citant Proclus, résume en ces termes :
« L’idée même de la création intemporelle est incompréhensible. Dire que le monde a commencé, implique qu’il fut un temps où il n’était pas ; dire que le monde finira, implique qu’il y aura un temps où le monde cessera d’être. Mais le temps n’existe que par les révolutions des sphères célestes qu’il mesure. On ne peut donc imaginer un temps où le monde ne sera pas, car ce serait imaginer un temps où le temps ne serait pas, ce qui est contradictoire. L’idée d’une fin du monde n’est pas moins insoutenable. Pourquoi Dieu détruirait-il le monde ? Car de deux choses l’une : ou le monde est bon ou il est mauvais ; s’il est bon, il faudrait devenir mauvais pour le détruire, et, s’il est mauvais et appelle la destruction, c’est donc que Dieu qui l’a créé est mauvais, ce qui est impossible » (3).
On retombe ici sur la question posée plus tard par Leibniz : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » Si Dieu seul a créé le monde, qu’y avait-il avant le monde ? Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Ne se suffisait-il pas à lui-même ? Pourquoi n’a-t-il pu se faire obéir de l’homme qu’il a créé ? Si la création est un effet de la bonté de Dieu et que, par ailleurs, elle doit finir, cette bonté n’est donc pas infinie. Si le monde n’est pas bon et que Dieu n’a pu en empêcher l’existence, c’est qu’il n’est pas tout-puissant. Et d’où venait le Mal au paradis terrestre ? Comment le Mal peut-il naître du Souverain Bien ? Comment expliquer que le moins sorte du plus, l’imparfait du parfait, l’être contingent de l’être nécessaire, la créature du créateur ? (4)
L’affrontement de deux conceptions : l’antique – la judéo-chrétienne
À l’aube de notre ère, 2 mentalités se trouvent ainsi en présence. Pour l’une, le monde existe de toute éternité ; il est aussi divin que Dieu, aussi harmonieux que l’Harmonie. L’homme également est éternel : il ne “progresse” ni ne “diminue”. Le temps est devenir : le monde s’écoule. Mais en même temps, le conflit est la loi du monde. Et, loin d’être en contradiction avec l’harmonie générale, il est l’agent par lequel cette harmonie s’établit. Il est un bien, il exerce une sélection. Héraclite déclare : « Il faut savoir qu’il y a une guerre universelle, que la discorde remplit la fonction de la justice, et que c’est selon ses lois que toutes choses naissent et périssent ». Il s’ensuit que l’histoire a raison : ce qui advient est juste. Le droit ne se réduit pas à la force, mais la force précède le droit ; elle est l’essence du politique.
La conception judéo-chrétienne du monde pose les choses tout à l’inverse. Pour elle, le monde, marqué par le péché, donne essentiellement le spectacle d’une injustice. Il faut donc que cette injustice ait sa compensation. Il faut que notre présence dans cette triste vallée de larmes ait sa raison d’être. Et, dès lors, tout le système se met en place. Si dans ce triste monde les justes sont souvent bafoués, si les méchants occupent le faîte de la puissance, c’est que nous sommes coupables, que nous subissons la conséquence du péché originel de l’humanité. Mais par un effet de la bonté de Dieu, nous pouvons encore nous racheter et assurer notre salut. Et l’histoire n’est rien d’autre que cette parenthèse dans le temps durant laquelle nous pouvons nous sauver. Un jour, la justice régnera — et, puisque ce monde est injuste, le monde finira.
À l’ancienne conception européenne de l’histoire, le judéo-christianisme substitue donc une conception de type linéaire ou, plus exactement, segmentaire. Dans cette vision, l’histoire est un segment. Elle a un début et une fin. Elle est un épisode de l’être de l’humanité, être dont la véritable essence est extérieure à l’histoire, à la fois antérieure et postérieure : antérieure en ce qu’elle a été donnée dans l’état paradisiaque pré-historique, postérieure en ce qu’elle sera restituée, à la fin de l’histoire, par l’avènement du Règne de Dieu.
La conception chrétienne de l’histoire
L’épisode qu’est l’histoire est donc perçu ici comme un malheur. Il résulte d’une faute. L’homme est tombé dans l’histoire parce qu’il a désobéi. C’est parce que Adam, poussé par Ève, a transgressé les commandements de Dieu — en goûtant les fruits de l’Arbre du savoir — qu’il a été condamné à l’histoire et, du même coup, à la “discorde” et au travail. Après avoir été chassé du paradis terrestre, l’homme doit “gagner son pain à la sueur de son front” ; il ne lui est possible de vivre en simple prédateur sur une nature supposée accueillante ; il devient un être de culture. L’épisode où Caïn tue Abel est significatif : le représentant d’une humanité nouvelle, celle des producteurs, née de la révolution néolithique, élimine le représentant de l’humanité antérieure, pré-historique, celle des prédateurs. La même condamnation qui a frappé Adam pèse sur tout individu naissant en ce monde.
Mais Dieu a voulu sauver cette humanité. Il a accepté de se charger lui-même de l’expiation de la faute. Il s’est fait homme en s’incarnant dans Jésus. Ce sacrifice par Dieu de son propre Fils introduit dans le devenir historique le fait essentiel de la Rédemption. Celle-ci est proposée à tout homme, mais il appartient à chacun de se perdre ou de faire son salut. Néanmoins, quel que soit le choix opéré par les hommes, l’histoire s’achèvera nécessairement dans le sens voulu par Dieu. Ainsi, grâce à la Rédemption, l’histoire se trouve dotée de sens — et ce sens est inséparable de sa fin : l’humanité chemine vers la fin de l’histoire.
Un jour viendra où les forces du Bien et du Mal se livreront une ultime bataille, laquelle aboutira au Jugement dernier et, par-delà celui-ci, à l’instauration d’un Royaume des Cieux ayant son pendant dialectique dans l’Enfer. Ce Royaume des Cieux restituera l’Éden primitif, mais de façon sublimée, car l’homme y sera désormais pour toujours à l’abri de la tentation et du péché. En d’autres termes, la post-histoire restituera la préhistoire. Et une fois cette restitution opérée, le mouvement historique s’achèvera. La paix universelle triomphera de la « discorde ». Les hommes retrouveront la plénitude de leur être. L’être se figera dans une immuable éternité. Et tout sera achevé.
Quand l’histoire du monde se réduit à l’histoire de la Rédemption
 D’Augustin et Irénée jusqu’aux auteurs modernes, la théologie chrétienne de l’histoire (décomposée en étiologie, kérygmatique, anamnèse ou immanence réciproque du passé et du futur de l’histoire du salut, herméneutique des énoncés eschatologiques, apocalyptique, etc.) se ramène ainsi à l’histoire de son présupposé, la perte de l’édénisme originel. Par suite, l’histoire du monde se réduit à l’histoire de la Rédemption. L’Incarnation est le centre, la norme, la condition même de l’histoire. L’histoire des hommes et l’histoire du Christ sont dans le rapport d’une promesse à un accomplissement. « La vie du Christ, écrit Hans Urs von Balthasar, devient la norme de toute vie historique, et par conséquent de toute histoire » (5).
D’Augustin et Irénée jusqu’aux auteurs modernes, la théologie chrétienne de l’histoire (décomposée en étiologie, kérygmatique, anamnèse ou immanence réciproque du passé et du futur de l’histoire du salut, herméneutique des énoncés eschatologiques, apocalyptique, etc.) se ramène ainsi à l’histoire de son présupposé, la perte de l’édénisme originel. Par suite, l’histoire du monde se réduit à l’histoire de la Rédemption. L’Incarnation est le centre, la norme, la condition même de l’histoire. L’histoire des hommes et l’histoire du Christ sont dans le rapport d’une promesse à un accomplissement. « La vie du Christ, écrit Hans Urs von Balthasar, devient la norme de toute vie historique, et par conséquent de toute histoire » (5).Dans le protestantisme moderne, l’Incarnation est plus encore détachée de son rapport à l’histoire. « On ne voit pas, observe Karl Löwith, pourquoi le christianisme ne pourrait pas être positivement indifférent à l’égard des différences tenant à l’histoire du monde » (6). Il en résulte que le monde n’existe qu’en tant qu’il accomplit un projet divin. C’est de cette réalisation progressive dont il est le théâtre qu’il tire son statut d’existence. Et l’histoire est ce stade transitoire durant lequel le dessein de Dieu se dévoile peu à peu.
Selon la théologie de l’histoire, qui est une compréhension et une interprétation théologiques de l’histoire, la fin de l’histoire est impliquée par le fait même de sa finalité. Le Règne de Dieu exige la résorption totalisante en un « être-avec- (et en)-Dieu » de tout ce qui s’est fait dans l’histoire. « L’accomplissement de l’histoire, ajoute Hans Urs von Balthasar, dit nécessairement sa suppression et son élévation en faveur d’un englobant qui était, dans cette première histoire, le terme toujours déjà visé, poursuivi et intérieurement dirigeant ». Cette fin de l’histoire se définit comme le moment où « l’humanité tout entière est devenue Corps du Christ » (7) ; comme « le moment où l’être acquiert et atteint des possibilités qui étaient déjà données dans la cause de son commencement » (8). En se conformant aux prescriptions du dogme, l’homme, par son action, hâte donc cette fin de l’histoire qui est l’heureux accomplissement de la Bonne Nouvelle.
Une telle conception va de pair avec une anthropologie égalitaire, fondée sur l’universalisme et la croyance révolutionnaire en l’unicité absolue du genre humain. Pour la première fois, il est affirmé que les hommes, indépendamment de leurs caractéristiques apparentes, de leurs actions, de leurs qualités et de leurs défauts, sont tous égaux devant Dieu.
La conception marxiste de l’histoire
Éden d’avant le commencement de l’histoire, faute originelle, “chute” dans cette vallée de larmes qu’est le monde, rédemption, communauté des saints, lutte du Bien et du Mal, Apocalypse, Jugement dernier, instauration d’un Royaume restituant le paradis perdu des origines : tous ces thèmes se retrouvent, “ramenés sur terre”, “laïcisés”, dans la conception marxiste de l’histoire.
Avec Marx, le mythe retombe en effet sur terre. Le paradis redevient, au sens propre, un paradis terrestre. Vision plus absurde encore, plus séduisante aussi. Julien Cheverny écrit : « Le marxisme ne se vante pas d’être une hérésie chrétienne, mais il ne se fait pas faute de s’emparer des principaux mythes évangéliques ou vétéro-testamentaires pour les réutiliser dans le sens d’un humanisme athée » (9).
La perspective que Marx institue sur l’histoire est, elle aussi, segmentaire. Elle aussi résulte d’une faute qui remonte aux origines. Le jardin d’Éden se retrouve dans la vision d’un “communisme primitif”, correspondant à la période prénéolithique, pratiqué par une humanité vivant à l’état de nature et purement prédatrice. La “faute” est survenue lorsque l’homme, lors de la révolution néolithique, est devenu producteur. Sous la pression du besoin — qui fut sa “tentation” —, il a inventé les moyens de production. Mais cette libération, due aux fruits de la connaissance (“l’Arbre du savoir”), s’est révélée une malédiction, qui trouve sa source dans le travail et dans sa division. Du fait de la division du travail, il est résulté l’aliénation du travail, le salaire, la propriété privée. L’exploitation rationnelle de la nature par l’homme a abouti à l’exploitation de l’homme par l’homme : le rapport du travailleur au maître du travail. En raison de ce péché des structures, le travailleur s’est trouvé aliéné dans le produit de son travail et dans l’acte même de la production. Il est ainsi devenu étranger à lui-même, étranger à sa véritable nature, à l’essence de son être véritable. Et de cette aliénation du travail, Marx déduit l’aliénation originelle du genre humain : c’est depuis qu’il est entré dans l’histoire que l’homme est devenu étranger à lui-même. Malheureusement, une rédemption est possible. De même que la “libération” par le travail organisé s’est révélée une malédiction, de même cette “malédiction” va s’inverser dialectiquement en une possibilité de libération.
La lutte des classes, moteur de l’histoire
La même aliénation originelle qui a produit l’entrée dans l’histoire a produit, de façon indissociable, le conflit, générateur d’injustices. Le conflit s’explique en effet par la lutte des classes, qui découle de l’aliénation du travail et de la définition de l’homme comme “producteur conscient” — la production “idéologique” étant à placer à côté de l’autre. C’est parce qu’il y a lutte des classes qu’il y a conflit ; et c’est parce qu’il y a conflit qu’il y a histoire, que l’homme devient historiquement. Pour Marx, la lutte des classes est le moteur et la cause de l’histoire. « Selon notre conception, écrit-il dans l’Idéologie allemande, toutes les collisions de l’histoire ont leur origine dans la contradiction entre les forces productives et les formes de relations. » Or, cette lutte des classes ne cesse de s’aggraver jusqu’à provoquer une prise de conscience équivalant au fait de l’Incarnation.
Grâce à cette prise de conscience rédemptrice, l’homme va pouvoir racheter sa condition et assurer son salut. Tout comme la Rédemption de Jésus avait abouti à l’organisation d’une Église et à l’institution d’une communauté des saints, la rédemption par le prolétariat va aboutir à son organisation au sein des partis communistes. Devenu conscient et organisé, le prolétariat va pouvoir lutter contre les forces mauvaises. Cette lutte s’intensifiera jusqu’à devenir apocalyptique. Mais en dépit des obstacles qu’elle rencontrera sur sa route, elle finira nécessairement par la défaite des forces mauvaises. Et après la lutte finale, les exploiteurs et les exploités seront définitivement séparés. La terre sera purgée des méchants. L’aliénation sera supprimée. Il n’y aura plus de classes — et comme les classes sont le moteur et la cause de l’histoire, il n’y aura plus d’histoire. Le communisme préhistorique sera restitué par la société sans classes, tel le jardin d’Éden par le Royaume des Cieux, de façon sublimée : tandis que la société communiste primitive était affligée par la misère matérielle, la société communiste post-historique jouira d’une satisfaction parfaitement équilibrée de ses besoins.
Le prolétariat apparaît ici comme une sorte de Messie collectif. Marx ne cesse de décrire la première histoire de l’humanité comme la lente montée vers sa conscience du sentiment de sa « mission historique » (La sainte famille). À l’enseigne du principe logico-métaphysique de l’identité, Marx le conçoit comme un « universel » scolastique, ce qui implique une conception unitaire du temps. Élément rédempteur, le prolétariat n’est en effet défini que par rapport au Mal. Il est à la fois le produit de l’aliénation du travail et la base de sa destruction future. C’est ce rapport dialectique de « négation de l’antinomie » qui fonde sa mission historique et toute l’eschatologie qui en découle. Son but n’est pas extérieur à lui-même ; à peine est-il le fruit de sa volonté : il est dans son existence, dans son être même. Destiné à restituer à l’homme son essence perdue, il n’existe qu’en tant qu’il n’a pas encore rempli sa tâche.
L’aliénation, ferment de la libération
Chez Marx, l’histoire a donc un caractère finaliste, téléologique évident. Le temps historique devient chez lui un “temps pur”, à caractère métaphysique. Par ailleurs, sa thèse se résume en la croyance que l’essence de l’homme est radicalement distincte de tout ce qui, depuis la révolution néolithique, a fondé l’histoire de l’homme. Il y a enfin inversion de la polarité positive et négative du fait de l’aliénation, dans un sens purement messianique. De même que, dans la conception chrétienne, le péché, tout en étant le produit d’une faute, est en même temps nécessaire au rachat, chez Marx, l’aliénation du travail, produit du « péché des structures », était nécessaire au surgissement de l’élément rédempteur. Dans une certaine mesure, l’homme se réalise donc par l’aliénation jusqu’au moment où, reconnaissant son essence aliénée, il prend conscience de son “humanité” et peut ainsi œuvrer à se défaire de son aliénation.
C’est pourquoi le passage à la société sans classes doit objectivement sortir du maximum d’aliénation, de même que l’avènement du Royaume des Cieux doit logiquement succéder à la venue de l’Antéchrist et à l’Armageddon final. C’est pourquoi aussi Marx estime que la bourgeoisie, en tant que « force de progrès », a joué un rôle objectivement positif, dans la mesure où, en réduisant les rapports humains à des rapports d’argent, elle a hâté la prise de conscience du prolétariat. D’où cette remarque des Manuscrits de 1844 : « La vie humaine avait besoin de la propriété privée pour se réaliser […]. Ce n’est que par l’industrie développée, c’est-à-dire par le moyen terme de la propriété privée que l’essence ontologique de la passion humaine atteint et sa totalité et son humanité ».
La fin du divorce entre l’homme et sa propre nature
En quoi consistera la révolution communiste ? Marx répond : en l’appropriation par l’homme de son propre être. Dans la société sans classes, l’homme opérera un retour à son être antérieur — mais un retour qui conservera toute la richesse née du développement historique. Il redeviendra une « unité sociale », où l’être et sa pensée seront réconciliés. L’homme total s’appropriera la totalité de l’homme ; ses sens seront « humanisés », ses organes physiques et mentaux seront transformés. La science de l’homme et celle de la nature, ce sera tout un.
La révolution mettra fin à l’« histoire naturelle de l’humanité », c’est-à-dire à la période durant laquelle l’homme aura lutté contre la nature, sans d’ailleurs se détacher d’elle. Elle permettra la reconquête de l’identité perdue du fait de l’aliénation, par-delà la négativité prolétarienne vécue comme contradiction. Ce qui signifie que le communisme, restituant à l’homme son essence, réalisera la « négation de la négation », la fin du divorce entre l’homme et sa propre nature. Le prolétariat, voyant de ce fait sa mission achevée, du même coup disparaîtra : il se « re-niera » en tant que négatif de la société bourgeoise, sa victoire impliquant, avec celle de son contraire, sa propre suppression.
Étant une société non productrice d’historicité, la société sans classes verra la disparition de tout ce qui aura fondé l’homme au cours de son histoire : la philosophie, la religion, les idéologies, l’économie politique, l’État. En fait, l’avènement de la totalité entraînera la fin de tout.
« Pour Marx, précise M. Henri Lefebvre, le sens de l’histoire coïncide avec sa fin, dans la substitution d’un autre genre de société aux sociétés historiques (nées de l’histoire, au cours de l’histoire) […]. Que ceci soit clair : selon Marx, la fin de l’histoire, c’est bien la fin de tout (de l’existant tout entier) pour la réalisation du total » (10).
Le rêve d’une société sans classes
Si les communistes se montrent aujourd’hui allusifs, voire discrets, pour décrire concrètement la société sans classes, les pères fondateurs de leur théorie se sont faits plus explicites. Dans leur Critique du programme de Gotha, Marx et Engels déclarent « inéluctables le dépérissement de l’État et la fin des antagonismes de classes. Dans la société sans classes, dit Karl Marx (Manuscrits de 1844), le besoin d’argent sera remplacé par le « besoin d’amour ». Il n’y aura plus de « médiateur » entre l’homme et la nature : tout sera dans tout, et vice versa. Ce sera le règne magique de l’abondance : « Tous les produits seront abondants, toutes les plaies seront depuis longtemps fermées et chacun pourra prendre autant qu’il lui faudra » (11). Égaux parce que fondamentalement identiques, les individus deviendront interchangeables. Dans la production comme dans la conjugalité, rôles sociaux et rôles sexuels seront remplis pareillement par chacun. Alors, subsidiairement, se réaliseront les paroles de Paul : il n’y aura plus « ni hommes ni femmes, ni maîtres ni esclaves, ni Grecs ni Juifs ».
Nicolas Boukharine, à qui l’on doit de belles envolées lyriques, indique que, dans la société communiste, il n’y aura plus de parasites, l’homme sera meilleur, « la culture humaine s’élèvera à une hauteur jamais atteinte », « le joug de la nature sur l’homme disparaîtra », « l’humanité mènera, pour la première fois, une vie vraiment raisonnable ».
« Dans le régime communiste, écrit-il, il n’y aura pas de directeurs perpétuels, d’usines, où des gens passent toute leur vie sur le même travail. Aujourd’hui, il en est ainsi […]. Rien de pareil dans la société communiste ! Là, tous les hommes jouissent d’une large culture et sont au courant de toutes les branches de la production ; aujourd’hui, j’administre, je calcule combien il faudra fabriquer, pour le mois prochain, de pantoufles ou de petits pains ; demain, je travaille dans une savonnerie, la semaine suivante, peut-être, dans une serre de la ville, et trois jours après, dans une station électrique […]. (Ainsi), dans le régime communiste, il n’y a ni prolétaires, ni capitalistes, ni ouvriers salariés : il n’y a que de simples humains, des camarades. Il n’y a pas de classes, pas non plus de lutte de classes, pas d’organisation de classe. Par conséquent, il n’y a pas d’État non plus » (12).
Le caractère métaphysique de la conception marxiste de l’histoire est ainsi amplement établi. Cette inscription de la doctrine de Marx dans l’espace de la métaphysique se lit à plusieurs niveaux : dans sa distinction du sujet et de l’objet, dans sa croyance dogmatique en une réalité « chosiste », dans son eschatologie. Ce penchant métaphysique est particulièrement net chez le jeune Marx, le Marx « feuerbachien » des Manuscrits de 1844, qui cultive l’utopisme évangélique, voit dans la révolution communiste la (re)création de l’« homme total », appelle de ses vœux l’instauration du « règne de l’amour », etc. Après 1845-46, à l’occasion de sa lutte contre Kriege, Marx récuse le « socialisme chrétien » et se défend de confondre les « prolétaires » avec les « pauvres ». Il prend aussi de la distance vis-à-vis du concept d’« aliénation » et, plus prudemment, définit surtout la révolution par le bouleversement du salariat. Dans L’idéologie allemande, la transformation de l’homme est ainsi subordonnée à la transformation pratique du monde.
Il reste que le jeune Marx — celui d’avant la “coupure épistémologique”, que de plus en plus de néo-marxistes redécouvrent aujourd’hui — est aussi le plus authentique et le plus direct. Cette opinion est celle d’auteurs aussi différents que Jean-Yves Calvez et Louis Althusser (13). « La conception marxiste de l’histoire, souligne M. Jean-Marie Benoist, demeure sinon unitaire, du moins unifiable, c’est-à-dire toujours logée chez Aristote et Platon, et, à travers eux, chez Parménide » (14).
Le Christ et le prolétaire : deux martyrs de l’histoire
Nombreux sont les auteurs, depuis Gustave Le Bon et Bertrand Russell jusqu’à Pierre Fougeyrollas, Jules Monnerot et René Sédillot (15), qui ont constaté l’évidente parenté structurale des conceptions marxiste et judéo-chrétienne de l’histoire. Julien Cheverny, pour ne citer que lui, écrit :
« À la ressemblance du Christ, le plus humilié des dieux, le prolétariat, la plus humiliée des classes, sera le médiateur d’une rédemption et l’operateur du salut. La Révolution tiendra lieu d’Esprit-Saint et l’Histoire, de Vierge-Mère qui accouche dans la violence et le sang. Le Parti sera la nouvelle communauté ecclésiale ou le nouvel ordre monastique, il sera la nouvelle Église, avec ses théologiens et ses docteurs, ses martyrs et ses inquisiteurs. Capitalisme et bourgeoisie appelleront les mêmes revanches et les mêmes vengeances que la Babylone biblique et la Grande Prostituée de l’Apocalypse. La cité sans classes réalisera la Jérusalem céleste dès lors que le travail, de malédiction, se changera en dignité, et le sexe, de faute, se transformera en bonheur et en paix » (16).
Dans les 2 systèmes, l’explication de départ repose sur un acte de foi : Marx ne démontre aucun de ses postulats, tandis que l’anthropologie moderne dément radicalement l’idée d’un homme “originellement bon” ; Albert le Grand et saint Thomas, renonçant à prouver la création ex nihilo, admettent que la raison, réduite à ses propres ressources, est impuissante à démontrer la nouveauté du monde, et affirment que celle-ci doit être crue sur la foi des Écritures.
Dans les 2 systèmes, l’histoire, conçue de façon segmentaire, avec un début et une fin, se voit attribuer une valeur négative. Dans les 2 cas, le monde est dévalué au profit d’un arrière-monde : l’au-delà dans la conception chrétienne, l’en deçà dans la conception marxiste. Dans les 2 cas, l’humanité actuelle est « vouée à l’extermination » (17) et le monde doit finir nécessairement. Dans les 2 cas, l’aboutissement de l’histoire, identifié au triomphe d’une Vérité absolue, entraîne la résorption du devenir de l’humanité et la restitution sublimée d’un état antérieur “paradisiaque”. Dans les 2 cas, la détermination de l’histoire n’est pas le fait de l’homme, mais de quelque chose qui le transcende : il a beau jouir, ici, de son “libre arbitre”, là, de la possibilité de faire l’histoire au sein de sa classe, sa “liberté” se borne à accepter ou à ne pas accepter un sens de l’histoire qui, de toute façon, s’accomplira indépendamment de ses choix ; dans les 2 cas, l’homme est l’acteur d’une pièce qu’il n’a pas écrite. Dans les 2 cas, enfin, la fin des temps, toujours décrite comme prochaine, est perpétuellement repoussée à “plus tard”. Jésus avait dit à ses disciples que le “siècle” ne passerait pas sans qu’ils assistent à son Retour en Gloire. Mais la Parousie s’est fait attendre, et l’Église s’est accoutumée à répéter : « L’an prochain, dans la Jérusalem des Cieux ». De même tandis que Boukharine annonçait l’instauration de la société sans classes au bout de « deux ou trois générations », les théoriciens communistes ont pris le parti d’affirmer que le « stade de transition » sera, selon le mot de Marx, le « produit d’un long et douloureux développement ». Et c’est à ce « stade de transition » — dont les pays socialistes ne voient toujours pas l’aboutissement — que correspond, chez saint Thomas, le « troisième état », entre le temps et la synagogue et celui de la Parousie, état dans lequel le principe de salut est déjà donné et agissant, mais n’a pas encore libéré toute son efficacité.
Nietzsche et l’éternel retour
C’est à Friedrich Nietzsche (1844-1900) que l’on doit, d’une part, la réduction du christianisme et de toutes les variétés idéologiques de socialisme au dénominateur commun de la pensée égalitaire, et, d’autre part, la restitution, sous une forme sublimée, de la conception de l’histoire qui fut celle de l’Europe antique. Au travers de son œuvre, Nietzsche jette en effet les bases d’un projet diamétralement opposé à la conception égalitaire et segmentaire de l’histoire. Il le fait à sa manière, non d’une façon conceptuelle, mais d’une façon imagée, en ayant recours à la poésie et au mythe. Affirmant que le devenir historique est commandé par l’Éternel Retour de l’Identique, il écrit : « Tout vient et se tend la main, et rit, et s’enfuit — et revient. Tout va, tout revient : la roue de l’existence tourne éternellement. Tout meurt, tout refleurit ; le cycle de l’existence se poursuit éternellement. Tout se brise, tout s’assemble à nouveau, éternellement se bâtit le même édifice de l’existence. Tout se sépare, tout se salue de nouveau, l’anneau de l’existence reste éternellement fidèle à lui-même. À chaque moment, commence l’existence ; autour de chaque Ici se déploie la sphère Là. Le centre est partout. Le sentier de l’éternité est tortueux ».
« La vérité est courbe, le temps aussi est un cercle »
On a beaucoup écrit sur l’Éternel Retour. On en a déduit que “rien de nouveau” ne peut se présenter, que tout dépassement est exclu — ce qui paraît contradictoire par rapport à l’idée du Surhumain, qui fut également développée par Nietzsche. D’une façon plus générale, on y a vu une simple redite de la conception cyclique de l’histoire qui avait été celle de l’Antiquité. Or, Nietzsche nous a lui-même mis en garde contre une pareille illusion. Lorsque, sous le Portique qui porte le nom d’Instant, Zarathoustra interroge l’Esprit de Pesanteur sur la portée des 2 chemins éternels qui, venant de directions opposées, se rejoignent en ce lieu et à cet endroit précis, celui-ci répond : « Tout ce qui est droit est mensonger, la vérité est courbe, le temps aussi est un cercle ». Alors Zarathoustra réplique avec violence : « Ne te rends pas, ô nain, les choses plus faciles qu’elles ne le sont ! », Dans un autre passage, Nietzsche écrit aussi : « On ne ramène pas les Grecs. » Que veut-il donc dire avec l’image du Retour ?
Une autre conception du temps
Pour comprendre la conception de l’histoire que nous propose Nietzsche, il faut la mettre en parallèle avec l’idée d’une perspective quadridimensionnelle — dont nous sommes redevables à la conception relativiste de l’univers physique. Alors que, dans l’Antiquité, les instants étaient encore vus comme des points se succédant sur une ligne, chez Nietzsche, le devenir est conçu comme un ensemble de moments dont chacun forme comme une sphère à l’intérieur d’une « supersphère quadridimensionnelle » (une dimension spatiale, 3 dimensions temporelles), en sorte que chaque moment occupe le centre par rapport aux autres. Dans cette perspective, non seulement l’univers n’a ni début ni fin, mais l’image la plus appropriée pour exprimer l’idée du temps n’est plus le cercle (comme dans la conception cyclique des Anciens), mais la sphère. Le temps est une sphère : le centre est partout. Et la « position totale » de l’ensemble des forces revient toujours, parce que chaque combinaison conditionne une infinité d’autres combinaisons.
Les conséquences d’une telle vision sont considérables. Pour Nietzsche, le passé ne correspond nullement à ce qui a été une fois pour toutes. De même, l’avenir n’est plus l’effet obligatoire de tout ce qui l’a précédé dans le temps — ainsi qu’il en va, pour l’essentiel, dans la conception linéaire et segmentaire de l’histoire. À tout moment présent, l’actuel, le passé et l’avenir coïncident dans un même lieu/ instant. Nietzsche reconnaît que passé et futur ne sont perçus comme tels que pour autant qu’ils s’inscrivent dans notre présent, mais il définit ces 3 “temps” (passé, actuel et futur) comme les 3 dimensions de chaque lieu/instant, en précisant que ces 3 dimensions se trouvent remises en cause à chaque fois, qu’elles se configurent diversement selon les perspectives en fonction desquelles on les ordonne. De cette façon se trouve restituée la tridimensionnalité du temps : pour chaque événement (historique), il y a tridimensionnalité temporelle et unidimensionnalité spatiale, de même que, pour chaque élément (macrophysique), il y a unidimensionnalité temporelle et tridimensionnalité spatiale. En d’autres termes, le passé, l’actuel et le futur correspondent, pour le temps historique, à ce que sont la hauteur, la largeur et la profondeur dans la conception classique de l’espace macrophysique.
L’homme reste libre du passé comme de l’avenir
Dans cette nouvelle perspective, l’homme n’est plus un point sur une ligne, dont le chemin (irréversiblement) parcouru s’appellerait le “passé”, et dont le chemin restant (irréversiblement) à parcourir s’appellerait “l’avenir”. Il est, à chaque instant de l’histoire, le vivant carrefour où s’entrecroisent les 3 dimensions du passé, de l’actuel et du futur, dimensions dont il lui suffit de déplacer la perspective pour modifier la configuration. À tout endroit où l’homme se situe, il y a une infinité de futurs possibles correspondant à l’infinité de perspectives qu’il peut instituer dans le temps. Dès lors, le passé n’est rien d’autre que le projet auquel l’homme cherche à conformer son action sur le temps historique, projet conçu en fonction de l’image qu’il se fait de lui-même et qu’il s’efforce d’incarner. Au sens propre, le passé devient “l’ imagination”, la préfiguration de l’avenir. Et c’est parce qu’il est situé à une intersection, où tout, perpétuellement, peut être remis en jeu, que l’homme, que chaque homme — et de même, chaque peuple, chaque culture, chaque époque — se fait de l’histoire une conception à nulle autre pareille, institue sur l’histoire une perspective qui lui est propre, en même temps qu’il est lui-même, dans l’histoire, une perspective entre une infinité d’autres possibles.
Évacuant le finalisme et le providentialisme de l’histoire, l’Éternel Retour n’assujettit l’homme à aucun déterminisme. Il n’implique pas que tout ce qui est pareil se répète, mais que tout ce qui diffère se répète pareillement. L’idée qu’il développe est que seul l’impossible n’est pas possible, que seul est possible ce qui a été et qui sera encore, qu’une force déterminée ne peut pas être autre chose précisément que cette force déterminée, que, sur une quantité de résistance donnée, elle ne se manifeste pas autrement que dans une mesure conforme à sa force, qu’« arriver » est nécessairement une tautologie, etc. Ce qui veut dire que la variété que l’on constate dans le monde — ici, Nietzsche anticipe brillamment sur le structuralisme moderne — provient de la variété de ses agencements : la nouveauté provient eu fait que toute modification particulière de l’arrangement des choses entraîne une modification générale de tout l’arrangement des choses.
Au contraire de Marx, Nietzsche, dans le Crépuscule des faux dieux, ne parle pas seulement en termes de société, mais en termes de civilisation. Contre le socratisme et le judéo-christianisme, il prêche les droits de l’homme vivant contre l’homme théorique. Dans le socialisme, il décèle une redite de cet « évangile des petits » qui rend petit, une résurgence de ce « poison de la doctrine des droits égaux pour tous » par quoi « le christianisme a détruit notre bonheur sur terre ». À l’inéluctabilité de la société des égaux, il oppose la possibilité permanente d’une société aristocratique, rendant à chacun selon ses mérites, où l’homme serait la mesure de toutes choses, où la vie se justifierait par elle-même, et qui enrichirait le monde au lieu de l’appauvrir.
L’histoire, une façon pour l’homme de devenir
Par suite, l’histoire n’est nullement à définir comme une suite d’événements ou de faits sans enchaînements, comme la simple succession des générations ; elle n’est pas non plus un “spectacle” ou un “objet de culte”. Elle est la perpétuelle transformation des sociétés par cette conscience historique qui est un spécifique de l’homme. L’histoire est la façon de devenir de l’homme : l’homme en tant qu’homme devient historiquement — et ce devenir ne dépend que de lui seul. Le “sens de l’histoire” n’est pas indépendant de sa volonté. Se demander quel est le sens de l’histoire, c’est se demander si l’homme lui-même a un sens : l’histoire prend un sens par rapport à la perspective la plus forte que l’homme institue sur elle. Dans cette conception qui nous est proposée par Nietzsche, l’homme est le seul qui fasse l’histoire — non en tant qu’il s’inclut dans une classe ou qu’il satisfait aux prescriptions d’une dogmatique, mais en tant qu’homme totalement libre, non déterminé, trouvant en lui-même seulement la possibilité d’être plus que lui-même.
L’histoire est totalement son fait : faber suae fortunae. Sa liberté consiste à pouvoir toujours choisir entre toutes les perspectives possibles, seule situation dans laquelle cette liberté n’est pas un faux-semblant. Grâce à son action dans (et sur) le temps, l’homme dépasse l’objet par tout ce qui ne se laisse pas réduire à lui. Le chaos n’est pas ce qui était “avant” — toutes choses étant à la fois devenues et non encore devenues —, mais ce qui risque d’être informe : c’est le “chaos de tout”, un chaos éternel lui aussi, excluant la finalité et l’ordonnancement univoque des événements, qui est la condition même du mouvement “sphérique” des choses au sein du devenir. Étant librement créateur, l’homme est aussi créateur de lui-même ; il se suffit à lui-même. Et ce qui vaut des personnes vaut aussi des cultures et des peuples.
Vision segmentaire, vision sphérique de l’histoire : on ne peut imaginer 2 conceptions de l’histoire plus fondamentalement opposées. Instituant des perspectives contradictoires sur le monde, elles mettent en jeu 2 mentalités, 2 sensibilités radicalement différentes. Dans la première, l’homme n’a que la “liberté” d’accepter et au besoin de hâter l’avènement du Royaume des Cieux ou de la société sans classes — ce qui implique la fin de l’histoire. Dans la seconde, il reste à tout moment, s’il le veut, libre d’imposer sa volonté au devenir historique, de le modeler conformément au projet dont il se représente à lui-même l’image. Cette liberté est essentiellement tragique. La volonté de l’homme peut se révéler assez forte pour lui permettre de continuer l’histoire, mais elle peut aussi se révéler insuffisante. L’homme peut sortir ou ne pas sortir de l’histoire. Il peut atteindre au surhumain ou retomber à l’état de nature, au sous-humain. Le mot “fin” de l’histoire n’est pas le fin mot de l’histoire. La fin du monde est une possibilité, parmi d’autres ; elle n’est en rien une nécessité. (Et même, à cette possibilité, l’univers reste froid, muet et indifférent.)
Le choix offert aux hommes de notre époque, à des hommes qui ne sont hommes que parce qu’ils sont devenus historiquement, se ramène, en fin de compte, à savoir s’ils veulent ou non se continuer eux-mêmes. Quel est ce choix ?
« Nietzsche, écrit M. Giorgio Locchi, nous dit qu’il est à faire entre le “dernier homme”, c’est-à-dire l’homme de la fin de l’histoire, et l’élan vers le surhomme, c’est la régénération de l’histoire. Nietzsche considère que ces deux options sont aussi réelles que fondamentales. Il affirme que la fin de l’histoire est possible, qu’elle doit être sérieusement envisagée, exactement comme est possible son contraire : la régénération du temps historique. En dernier ressort, l’issue dépendra des hommes, du choix qu’ils opéreront entre les deux camps, celui du mouvement égalitaire, que Nietzsche appelle le mouvement du dernier homme, et l’autre mouvement, que Nietzsche s’est efforcé de susciter, qu’il a déjà suscité et qu’il appelle son mouvement ».
► Alain de Benoist, Question de n°16, 1977.
• Notes :
- 1) G. Locchi : « L’histoire », in Nouvelle École n°27-28, 1975
- 2) L. Rougier : Celse ou le Conflit de la civilisation antique et du christianisme primitif (Éd. du Siècle, 1925-1926).
- 3) L. Rougier, op. cit.
- 4) À la question de l’origine du Mal, Nietzsche a donné, dans Par-delà le Bien et le Mal, une réponse qui en vaut bien une autre : « Écoutez-moi bien, car c’est rare que je parle en théologien : ce fut Dieu lui-même qui, au terme de sa journée de travail, se mit sous l’Arbre de la connaissance, prenant la forme du Serpent : il se reposait ainsi d’être Dieu [...]. Le démon n’est rien d’autre que l’oisiveté de Dieu chaque septième jour ».
- 5) H. Urs von Balthasar : Théologie de l’histoire (Fayard, 1970).
- 6) K. Löwith : Weltgeschichte und Heilsgeschehen.
- 7) M.-J. Nicolas : Évolution et christianisme (Fayard, 1973).
- 8) K. Rahner et H. Vorgrimler : Dictionnaire de théologie catholique (Seuil, 1970).
- 9) J. Cheverny: Sexologie de l’Occident (Hachette, 1976).
- 10) H. Lefebvre : La fin de l’histoire (Minuit, 1972).
- 11) N. Boukharine : ABC du communisme (Libr. de l’Humanité, 1925).
- 12) N. Boukharine : op. cit.
- 13) La pensée de Karl Marx (Seuil, 1956) et Louis Althusser : Pour Marx (Maspero, 1965).
- 14) J.-M. Benoist : Marx est mort (Gallimard, 1970).
- 15) P. Fougeyrollas : le Marxisme en question (Seuil, 1959) ; J. Monnerot : Sociologie du communisme (Gallimard, 1963) ; R. Sédillot : L’histoire n’a pas de sens (Fayard, 1965).
- 16) J. Cheverny, op. cit.
- 17) Sag. 18, 15.
habillage musical = Klaus Nomi : Samson & Delilah (St-Saëns) / Death / Wayward sisters / Cold Song (Air du Génie du froid, Purcell) / After The Fall / I feel love (live 1979) / Total Eclipse / Keys of Life (live, 1979) / From beyond / Return / Nomi Song / Rubberband Lazer



