-
Spengleriana
« Je traduisis de l’allemand, à la demande de l’éditeur Longanesi (…) le volumineux et célèbre ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident. Cela me donna l’occasion de préciser, dans une introduction, le sens et les limites de cette œuvre qui, en son temps, avait connu une renommée mondiale ». C’est par ces mots que commence la série de paragraphes critiques à l’égard de Spengler, qu’Evola a écrit dans Le Chemin du Cinabre (p. 177).
Evola rend hommage au philosophe allemand parce qu’il a repoussé les « lubies progressistes et historicistes », en montrant que le stade atteint par notre civilisation au lendemain de la Première Guerre mondiale n’était pas un sommet, mais, au contraire, était de nature « crépusculaire ». D’où Evola reconnaît que Spengler, surtout grâce au succès de son livre, a permis de dépasser la conception linéaire et évolutive de l’histoire. Spengler décrit l’opposition entre Kultur et Zivilisation, « le premier terme désignant, pour lui, les formes ou phases d’une civilisation de caractère qualitatif, organique, différencié et vivant, le second les formes d’une civilisation de caractère rationaliste, urbain, mécaniciste, informe, sans âme » (p. 178).
Evola admire la description négative que donne Spengler de la Zivilisation, mais critique l’absence d’une définition cohérente de la Kultur, parce que, dit-il, le philosophe allemand demeure prisonnier de certains schèmes intellectuels propres à la modernité. « Le sens de la dimension métaphysique ou de la transcendance, qui représente l’essentiel dans toute vraie Kultur, lui a fait défaut totalement » (p. 179). Evola reproche également à Spengler son pluralisme ; pour l’auteur du Déclin de l’Occident, les civilisations sont nombreuses, distinctes et discontinues les unes par rapport aux autres, constituant chacune une unité fermée. Pour Evola, cette conception ne vaut que pour les aspects extérieurs et épisodiques des différentes civilisations. Au contraire, poursuit-il, il faut reconnaître, au-delà de la pluralité des formes de civilisation, des civilisations (ou phases de civilisation) de type “moderne”, opposées à des civilisations (ou phases de civilisation) de type “traditionnel”. Il n’y a pluralité qu’en surface ; au fond, il y a l’opposition fondamentale entre modernité et Tradition.
Ensuite, Evola reproche à Spengler d’être influencé par le vitalisme post-romantique allemand et par les écoles “irrationalistes”, qui trouveront en Klages leur exposant le plus radical et le plus complet. La valorisation du vécu ne sert à rien, explique Evola, si ce vécu n’est pas éclairé par une compréhension authentique du monde des origines. Donc le plongeon dans l’existentialité, dans la Vie, exigé par Klages, Bäumler ou Krieck, peut se révéler dangereux et enclencher un processus régressif (on constatera que la critique évolienne se démarque des interprétations allemandes, exactement selon les mêmes critères que nous avons mis en exergue en parlant de la réception de l’œuvre de Bachofen).
Ce vitalisme conduit Spengler, pense Evola, à énoncer « des choses à faire blêmir » sur le bouddhisme, le taoïsme et le stoïcisme, sur la civilisation gréco-romaine (qui, pour Spengler, ne serait qu’une civilisation de la « corporéité »). Enfin, Evola n’admet pas la valorisation spenglérienne de l’« homme faustien », figure née au moment des grandes découvertes, de la Renaissance et de l’humanisme ; par cette détermination temporelle, l’homme faustien est porté vers l’horizontalité plutôt que vers la verticalité. Sur le césarisme, phénomène politique de l’ère des masses, Evola partage le même jugement négatif que Spengler.
Les pages consacrées à Spengler dans Le chemin du Cinabre sont donc très critiques ; Evola conclut même que l’influence de Spengler sur sa pensée a été nulle. Tel n’est pas l’avis d’un analyste des œuvres de Spengler et d’Evola, Attilio Cucchi (in : « Evola, la Tradizione e Spengler », Orion n°89, 1992). Pour Cucchi, Spengler a influencé Evola, notamment dans sa critique de la notion d’« Occident » : en affirmant que la civilisation occidentale n’est pas la civilisation, la seule civilisation qui soit, Spengler la relativise, comme Guénon la condamne. Evola, lecteur attentif de Spengler et de Guénon, va combiner éléments de critique spenglériens et éléments de critique guénoniens. Spengler affirme que la culture occidentale faustienne, qui a commencé au Xe siècle, décline, bascule dans la Zivilisation, ce qui contribue à figer, assécher et tuer son énergie intérieure. L’Amérique connaît déjà ce stade final de Zivilisation technicienne et dé-ruralisée.
C’est sur cette critique spenglérienne de la Zivilisation qu’Evola développera plus tard sa critique du bolchévisme et de l’américanisme : si la Zivilisation est crépusculaire chez Spengler, l’Amérique est l’extrême-Occident pour Guénon, c’est-à-dire l’irreligion poussée jusqu’à ses conséquences ultimes. Chez Evola, indubitablement, les arguments spenglériens et guénoniens se combinent, même si, en bout de course, c’est l’option guénonienne qui prend le dessus, surtout en 1957, quand paraît l’édition du Déclin de l’Occident chez Longanesi, avec une préface d’Evola. En revanche, la critique spenglérienne du césarisme politique se retrouve, parfois mot pour mot, dans Le fascisme vu de droite et Les Hommes au milieu des ruines.
Le préfacier de l’édition allemande de ce dernier livre (Menschen inmitten von Ruinen, Hohenrain, Tübingen, 1991), le Dr. H.T. Hansen, confirme les vues de Cucchi : plusieurs idées de Spengler se retrouvent en filigrane dans Les Hommes au milieu des ruines, not. l’idée que l’État est la forme intérieure, l’« être-en-forme » de la nation ; l’idée que le déclin se mesure au fait que l’homme faustien est devenu l’esclave de sa création ; la machine le pousse sur une voie, où il ne connaîtra plus jamais le repos et d’où il ne pourra jamais plus rebrousser chemin. Fébrilité et fuite en avant sont des caractéristiques du monde moderne (”faustien” pour Spengler) que condamnent avec la même vigueur Guénon et Evola.
Dans les Années décisives (1933), Spengler critique le césarisme (en clair : le national-socialisme hitlérien), comme issu du titanisme démocratique. Evola préfacera la traduction italienne de cet ouvrage, après une lecture très attentive. Enfin, le « style prussien », exalté par Spengler, correspond, dit le Dr. H.T. Hansen, à l’idée évolienne de l’« ordre aristocratique de la vie, hiérarchisé selon les prestations ». Quant à la prééminence nécessaire de la grande politique sur l’économie, l’idée se retrouve chez les deux auteurs. L’influence de Spengler sur Evola n’a pas été nulle, contrairement à ce que ce dernier affirme dans Le chemin du Cinabre.
► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies européennes n°21, 1996.
[version anglaise] [habillage musical : Mantra, Karlheinz Stockhausen, 1970]
♦♦♦
◘ Plan de la page : Document (articles d’Evola sur Spengler) // Études sur Spengler // Textes de Spengler.

♦ Document ♦
◘ Présentation de l’opuscule : L’Europe ou le déclin de l’Occident, Julius Evola, traduit par Rémi Perrin, Perrin & Perrin, 1997.
Publié en Allemagne au sortir de la guerre (1918-22), Le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler fit grand bruit tant en Europe qu’aux États-Unis. Il compte parmi les livres les plus marquants du XXe siècle. Aujourd’hui encore, il reste plus que jamais d’actualité, comme nous l’explique Julius Evola dans un petit ouvrage [L’Europe ou le déclin de l’Occident, Perrin & Perrin, 45 p.] récemment publié par un jeune et courageux éditeur.
L’Europe ou le déclin de l’Occident rassemble trois textes : Spengler, publié dans Vita italiana (1936), Le déclin de l’Occident, préface à l’édition italienne de l’ouvrage (1957), et L’Europe ou la conjuration du déclin ?, paru dans Europa Nazione (1951). Dans les deux premiers articles, Evola analyse la somme spenglerienne en montrant que la « morphologie de l’histoire mondiale » se fonde sur « l’analogie organique ». Pour lui, le phénomène primaire de l’histoire, l’Urphänomen de Goethe, « est constitué de cultures conçues comme des organismes qui, bien que d’ordre supérieur et de caractère supra-individuel, ont une durée de vie finie et présentent des phases bien déterminées de développement : comme les organismes proprement dits, les cultures ont une jeunesse, une période de maturité, de floraison, puis une vieillesse suivie d’un déclin et d’une fin ».
Il y a chez Spengler une nette distinction et opposition entre Kultur et Zivilisation. La première renvoie à un enracinement spirituel-culturel que les peuples traduisent historiquement par une qualité de vie organique ; la seconde, dans la phase crépusculaire de chaque fin de cycle, se définit aujourd’hui par la technicisation et la commercialisation des rapports humains dont le « symbole est la métropole, la ville cosmopolite tentaculaire » (Evola). À la verticalité de la Culture d’hier et de demain s’oppose l’horizontalité de la Civilisation d’aujourd’hui. Après avoir rendu hommage au grand penseur allemand, Evola reste cependant insatisfait de cette conception, trop prisonnière à ses yeux d’un vitalisme faustien laïc autant que moderne et d’un pessimisme biologico-historique incapacitant. Le déterminisme “naturaliste” de Spengler se trouve contredit, selon Evola, par les « éléments spirituels et transcendants qui sont à la base de toute grande culture ». La cyclologie traditionnelle, notamment issue de la matrice indo-européenne, satisfait mieux sa conception à la fois métaphysique et historique.
 Le troisième article du recueil se réfère à l’ouvrage d’Ulick Varange (1917-1960), alias Francis Parker Yockey, intitulé Imperium et paru en 1948. Pour Evola, Varange, en s’inspirant du concept spenglerien de culture, a justement montré la nécessité de l’unité européenne. Au-delà des organisations mondiales (ONU), des pseudo-fédérations technomarchandes (CE), des démocraties libérales (menées par les États-Unis), du communisme (alors dirigé par l’Union soviétique) et du nationalisme, un nouveau principe d’autorité doit naître : l’Empire. Il s’agit pour Evola de concilier autorité et liberté, unité politico-spirituelle et diversité populaire :
Le troisième article du recueil se réfère à l’ouvrage d’Ulick Varange (1917-1960), alias Francis Parker Yockey, intitulé Imperium et paru en 1948. Pour Evola, Varange, en s’inspirant du concept spenglerien de culture, a justement montré la nécessité de l’unité européenne. Au-delà des organisations mondiales (ONU), des pseudo-fédérations technomarchandes (CE), des démocraties libérales (menées par les États-Unis), du communisme (alors dirigé par l’Union soviétique) et du nationalisme, un nouveau principe d’autorité doit naître : l’Empire. Il s’agit pour Evola de concilier autorité et liberté, unité politico-spirituelle et diversité populaire : « Une véritable unité ne peut être que de type organique et pour elle, le schéma est bien connu : il est celui qui se réalisa dans l’espace européen médiéval. Il reprend aussi bien l’unité que la multiplicité et se concrétise dans un système de participations hiérarchiques. Il faut dépasser le nationalisme, absolutisation schismatique du particulier, pour passer au concept naturel de nationalité. À l’intérieur de chaque espace national devra avoir lieu ensuite un processus d’intégration qui coordonne les forces dans une structure hiérarchique et stabilise l’ordre fondé sur un principe central de souveraineté et d’autorité ».
Fédérer plutôt qu’unifier, différencier plutôt que centraliser, telle est la tâche que nous recommande Evola afin de renouer avec la Grande Politique : celle qui intègre le Devenir dans l’Être.
► Arnaud Guyot-Jeannin, éléments n°90, 1997.

Celui qui, maintenant que Oswald Spengler est mort, voudrait établir un consciencieux bilan de son œuvre et examiner la signification que cette œuvre a eu dans la période contemporaine, devrait se trouver un peu perplexe.
Si cet embarras n’a pu être évité et si, aussi bien en Italie qu’en Allemagne, est déjà sortie une série d’articles pleins de l’habituelle morgue des journalistes militants, il faut en chercher la raison dans le fait que personne, ou presque, ne dispose aujourd’hui du point de vue apte à déduire objectivement le positif et le négatif des positions de Spengler, articulés autour d’un solide système de pensée. Face à Spengler, on prend encore cette attitude, aussi néfaste aujourd’hui, qui consiste à interpréter tout système d’idées à la manière d’une création personnelle, d’une construction philosophique due au talent plus ou moins habile, illuminé et original, d’un seul. Il ne fait pas de doute que pour la grande majorité des penseurs modernes, une telle attitude, au fond, mérite d’être adoptée, puisque tout se réduit chez eux à une pure construction individuelle sous un habillage logique, dialectique et pseudo-scientifique. Cependant Oswald Spengler est un des rares auteurs actuels pour qui ce jugement ne vaut pas entièrement.
L’œuvre de Spengler offre un intérêt effectif en tant qu’elle exprime assez souvent, même dans les mélanges et transpositions en tout genre, la sensation de quelque chose de réel, l’intuition confuse d’un état de chose qui ne doit rien aux interprétations d’un seul. On peut dire avec une quasi certitude pourtant que Spengler a été le dernier à s’en rendre compte (tel qu’il résulte de ses déclarations sur les sources d’inspiration de ses principales idées). Mais ceci ne retire rien à la vérité de la chose : trop nombreux sont les cas où l’œil expert reconnaît l’auteur qui entendait développer un ordre autonome et personnel de réflexions et qui, en réalité, éveille par sa pensée les résonances majeures d’une époque et obéit à des suggestions confuses ou tire son impulsion première de la perception semi-consciente de principes et de règles supérieures.
Spengler a contribué énergiquement à la destruction du mythe progressiste et évolutionniste, de cette fiction de la mentalité rationaliste et démocratique moderne. La civilisation ne se déroule pas selon un rythme de progression continue vers le mieux ; elle n’est même pas quelque chose d’homogène. La civilisation n’existe pas, il existe des cultures, organismes distincts, autonomes, ayant chacune sa propre aurore, son propre développement et son propre déclin. Entre les cultures, on peut discerner des rapports d’analogie mais non de continuité. Il n’existe pas de passerelle qui conduise linéairement de l’une à l’autre d’entre elles. En particulier, la culture occidentale n’est en rien, comme on le croyait, la civilisation, c’est-à-dire la dernière avancée présumée de la marche en avant de l’histoire de l’humanité, mais bien une culture. Ses caractères sont ceux d’une culture crépusculaire qui court vers sa décomposition : après elle, jaillira un cycle absolument nouveau, avec de nouvelles races, de nouvelles sciences et une vérité nouvelle.
Ceci est, comme on le sait, l’idée centrale de l’ouvrage de Spengler [Le Déclin de l’Occident] : une idée qui, en ce qu’elle a de vrai, ne se réduit en rien à une position philosophique personnelle. Sous une forme ou une autre, le monde antique a toujours reconnu que des lois cycliques régissent le développement des peuples et des cultures : il avait entendu parler des grandes civilisations disparues, dont souvent il ne restait même pas le nom et que, pour rien au monde, il aurait considéré comme les degrés évolutifs transmis jusqu’à lui par l’humanité d’alors ; il ignorait le mythe progressiste mais reconnaissait, en revanche, que le sens effectif de l’histoire traduit, pour ce qui est de son aspect essentiel, une involution, c’est-à-dire une « chute ». Il est inutile de reproduire ici, même brièvement, tout ce qu’ailleurs, en fait de sources et de témoignages de toute sorte, nous avons recueilli pour démontrer le caractère traditionnel de ces idées, présentes aux détails près, par une impersonnelle et énigmatique concordance, dans les enseignements des différents peuples antiques. Et si, dans ces enseignements, le monde qui vient fut conçu comme un âge obscur (Inde), un âge de fer (Grèce) ou l’âge de boue mêlée de fer (Iran), il s’agit de l’équivalent exact du fameux déclin de l’Occident dont parle Spengler et dans lequel beaucoup ont préféré voir plutôt qu’un fait, le reflet chez un seul, de la crise spirituelle contemporaine.
La différence avec les enseignements antiques, qui correspond aussi à la faiblesse fondamentale de la conception de Spengler, réside dans le fait qu’il n’a pas un instant soupçonné la nature métaphysique des lois cycliques des cultures : il a conçu de telles lois comme des données naturalistes et déterministes, comme une reproduction à large échelle de ce sombre destin par lequel les animaux et les plantes, sans participation d’une véritable volonté, naissent, grandissent et fatalement trépassent. En liaison avec ceci, Spengler n’avait aucune compréhension vraie des éléments spirituels et transcendants qui sont à la base de toute grande culture : il reste au fond prisonnier d’une conception laïque qui se ressent fortement de ces idées purement modernes que sont la philosophie de la vie, l’activisme faustien et l’élitisme aristocratique de Nietzsche. Pour cela, sa morphologie de la culture apparaît défectueuse ou, mieux, elle prend déjà le sens d’une interprétation et d’une construction à laquelle pourraient s’opposer beaucoup d’autres : de tels caractères ont différents degrés de développement, analogiquement correspondants, que Spengler s’efforce de retrouver par d’ingénieux rapprochements dans chacun des cycles de culture, dans le cycle indien, grec, romain, arabe et ainsi de suite jusqu’à celui qu’il nomme occidental ou faustien. Pour en venir au point essentiel, Spengler n’a pas compris qu’au delà de la pluralité des cultures et de leurs phases de développement, règne un dualisme de formes de cultures. Il a effleuré ce concept lorsqu’il a opposé les cultures de l’aurore aux cultures crépusculaires, et la culture à la civilisation : mais il n’a pas réussi au fond à comprendre l’essence véritable de celles-là. Ce qu’il décrit comme originaire est quelque chose d’assez rétréci et départagé déjà par le vrai principe créatif et spirituel des grandes phases ascendantes des cultures.
La conception spenglérienne de la culture aristocratique, dite de l’aurore, inspirée de Nietzsche — l’idéal de l’homme vu comme un magnifique animal de proie et implacable dominateur — est restée la profession de foi de Spengler, les allusions à un cycle spirituel étant chez lui sporadiques, imparfaites et invalidées par ses préjugés protestants. Adhésion à la terre et dévotion pour la classe des serfs, fiefs et châteaux, intimité des traditions et des communautés corporatives, État articulé organiquement, droit suprême conféré à la race, comprise non au sens biologique mais au sens du comportement profond, d’une profonde virilité, au sens d’une indomptabilité de l’âme, tout ceci est le fondement sur lequel Spengler voit se développer la vie des peuples en phase de Kultur encore loin des formes séniles de la barbarité plébéienne, rationaliste, anti-qualitative, cosmopolite de celle qui ne sera que Zivilisation.
Mais tout ceci est encore trop peu. Au cours de l’histoire, un tel monde s’est toujours présenté comme le résultat d’une première chute — si on nous permet une analogie physique, d’une première baisse de régime. C’est le cycle de la « civilisation des guerriers », le traditionnel âge de bronze qui prend forme alors que les contacts avec une réalité transcendante, interrompus, cessent d’être la force créatrice civilisatrice, alors qu’une prévarication humaniste s’est déjà réalisée, alors que toute loi venue d’en haut s’est perdue et que s’est substituée à elle un succédané héroïque fondé sur les possibilités d’une virilité matérialiste non exempte, parfois, de quelques traits de grandeur et de gloire.
Par conséquent, Spengler, quand il décrit le monde actuel comme décadent, loin d’exagérer et de tout ramener à son pessimisme naturel, révèle qu’il n’a pas les points de référence en fonction desquels la réalité et l’extension effective d’une telle décadence pourraient être comprises à fond. Spengler nous apparaît comme l’épigone du conservatisme de la meilleure Europe traditionnelle d’hier, de celle qui a subi son agonie lors de la guerre mondiale et de l’effondrement des derniers empires.
C’est déjà quelque chose, sans aucun doute, et même si ce point de référence relatif ne permet pas de saisir les premiers anneaux de la chaîne des causes, il suffit pourtant à dénoncer les principaux aspects de la décadence moderne et à sonner l’alarme autour du futur qui se prépare.
La face critique et destructrice, développée sur cette base par Spengler, recueillant des motifs plus ou moins originaux, est d’une valeur indubitable, démontre une radicalité pleine de courage et conduit tout droit non aux opinions mais aux faits ; des faits que seuls ceux qui se mentent à eux-mêmes ou aux autres peuvent méconnaître ou travestir par des interprétations subversives. Inutile de rappeler Ici la description spenglérienne de la civilisation crépusculaire, de la culture de masse, anti-qualitative, inorganique, urbaniste et nivellatrice, profondément anarchique, démagogique et anti-traditionnelle. Depuis qu’est sortie l’œuvre capitale de Spengler, tout ceci est devenu lieu commun. Il vaut mieux relever que, jusqu’à sa mort, il est resté ferme sur ses positions, ne s’est laissé séduire par aucune nouvelle étiquette, n’a condescendu à aucun compromis comme tant d’autres, a gardé la nécessaire réserve face à tant de courants qui finissent trop souvent par contracter le mal qu’ils prétendaient surmonter. Spengler est resté jusqu’au bout un anti-socialiste implacable. La mystique de la révolution hitlérienne n’a pas suffi à lui voiler tout ce qui devait être encore combattu et qui même se propageait avec elle, comme l’annonce de crises effrayantes et finales.
Le dernier livre de Spengler, Années décisives, a éveillé dans le monde les échos les plus divers et a valu à son auteur plus d’une attaque en Allemagne. Peu de lecteurs se sont penchés pour étudier la relation exacte entre les idées exposées dans ce livre et celles de son livre principal pour qui, à la rigueur, Années décisives, ne devraient être que l’appendice. C’est une objection facile, avancée par beaucoup, que si la loi cyclique est vérifiée dans son caractère naturel et déterministe, le problème même de la décision, de l’appel aux hommes capables de dominer la force des masses impétueuses et de conjurer ainsi la débâcle définitive de la culture des races blanches occidentales, devient alors absurde et contradictoire. Ce qui doit arriver, arrivera. Il est possible, comme pour l’homme, de retarder l’échéance mais pas d’aller contre son destin, qui est de mourir. Cette contradiction s’efface pourtant à l’examen, puisqu’au fond, même dans le meilleur des cas prospectés par Spengler — dans lequel on a voulu voir pour des motifs superficiels un revirement de son pessimisme vers un optimisme héroïque — on est loin de dépasser le cycle de la civilisation (au sens négatif d’anti-culture).
La situation actuelle de l’Occident blanc selon Spengler est caractérisé par deux révolutions mondiales, l’une interne, l’autre externe. La première, sous une forme ou une autre, s’est déjà réalisée ; elle est la révolution sociale, l’affleurement de l’élément de masse qui, envahissant toutes les formes et valeurs de la vie moderne, évoluant sous l’espèce d’un capitalisme et d’un bien-être standardisé, se fait le principe de tensions et de crises économiques sans précédent. La seconde révolution est celle qui se prépare parmi les races de couleur. S’européanisant, élaborant pour elles-mêmes la civilisation et les instruments de puissance de la race blanche, elles s’agitent, menaçantes, pressées de secouer le joug et de s’émanciper afin d’arracher définitivement à l’Occident son ancienne hégémonie. Les deux révolutions convergeront peut-être, et alors on assistera à l’écroulement final de la culture occidentale.
Face à d’aussi menaçantes perspectives, Spengler ne sait évoquer que l’idéal de la belle bête, l’éternel instinct guerrier de l’homme-animal de proie, latent en période de débâcle mais prêt à bondir là où les peuples se sentent menacés de destruction dans leur substance vitale. Pareil instinct devrait se manifester dans la race blanche à ces heures décisives et, s’affirmant, devrait conduire à une nouvelle époque césarienne. Les Nouveaux Césars devront enchaîner et guider les masses pour les guerres futures qui ne se déclareront plus de nation à nation, mais de continent à continent, et dont l’enjeu sera la domination du monde, l’imperium mundi. Cette vision correspond en tout et pour tout à cette âme tragique faustienne, assoiffée d’infini, que Spengler considère comme le principe du cycle occidental et comme quelque chose de positif, là où pour nous, et donc d’un point de vue traditionnel, il s’agit des facteurs principaux de la décadence occidentale. Mais, au delà des évolutions, l’idée allusive de Spengler pourrait bien être lue comme un voile des choses réelles qui mûrissent dans l’ombre et face auxquelles il faut se tenir prêts. Tout compte fait, cette route qui mène à une résurrection et qui favorise le retour aux formes d’une civilisation traditionnelle, si elle est droite par l’esprit, n’en reste pas moins opaque. Les grands empires eux-mêmes, qui ne connaissent que le binôme masses-Césars, ne représentent qu’une montée en puissance du cancer du métropolisme dévastateur, du caractère démoniaque des masses et ressortissent aux symptômes de la culture de décadence, même si dans ces empires les masses devaient être à nouveau enchaînées, contraintes à une nouvelle ascèse par le travail au nom de la volonté absolue des entreprises supranationales auxquelles elles appartiennent. Ni la qualité des hommes à la poigne de fer ou des animaux de proie dominateurs ne sont celles de véritables chefs. Les Césars de Spengler ont déjà bien peu à voir avec le César de l’histoire, qui a su dire : Dans la lignée, il y a la majesté des rois qui excellent par leur puissance entre les hommes, et la sacralité des dieux qui ont la puissance des rois dans leurs mains. La tâche véritable consisterait non pas à conduire et à galvaniser les masses, mais à les détruire en tant que masses, créant en elles de nouvelles articulations, classes, castes, des façons différentes de sentir, d’agir, de vouloir et enfin un climat vraiment spirituel, un orgueil commun dans l’obéissance hiérarchique aux porteurs d’une véritable autorité d’en haut. À cette seule condition, les lueurs du crépuscule pourraient basculer vers une aurore première, et le point mort de la fin d’un cycle être ainsi dépassé. Mais ceci nous dit bien peu sur Spengler.
Alors que la plupart, ignorant les vraies lignes de crête et sacrifiant aux fantasmes de cette ère ultime, voit dans ses dernières œuvres un nouveau soulèvement héroïco-optimiste par rapport au Déclin de l’Occident, celui qui a un regard plus long est amené à se demander s’il ne s’agirait pas plutôt d’une idée du désespoir. Y compris dans Années décisives, Spengler apparaît comme celui qui a la sensation confuse, bien que réelle, d’événements en train de mûrir, et non pas comme le porteur de ces principes de nature à dominer la contingence du moment et à suggérer une véritable orientation des forces de reconstruction.
L’unique point d’ancrage de Spengler, à ce propos, est son idéal prussien (pour Spengler, prussien n’est pas un caractère national mais le terme générique qui désigne une façon d’être : « n’est pas prussien celui qui est né en Prusse, ce type humain est possible partout dans le monde blanc et on le trouve encore, bien que rarement »). Le prussianisme est signe de race, de dévouement discipliné, de liberté intérieure dans l’accomplissement du devoir, d’auto-discipline, de domination de soi en vue d’un grand destin, d’un « ordre aristocratique de la vie selon le rang des différentes activités ». Même s’il reste dans le simple domaine des disciplines, Spengler a une solide référence traditionnelle, anti-socialiste et antidémocratique, qui peut constituer un point de départ pour ceux qui, encore, veulent résister.
[Vita Italiana, 1936]

[Ci-contre : soldat allemand au milieu des ruines de Berlin après l'entrée de l’Armée rouge le 24 avril 1945. Au fond le Reichstag en flammes. Ph. : Mark Redkin]
La conception de Spengler se fonde sur l’analogie organique. Pour lui, le phénomène primaire de l’histoire, l’Urphänomen de Goethe, est constitué de cultures conçues par des organismes qui, bien que d’ordre supérieur et de caractère supra-individuel, ont une durée de vie. finie et présentent des phases bien déterminées de développement : comme les organismes proprement dits, les cultures ont une jeunesse, une période de maturité, de floraison puis une vieillesse suivie d’un déclin et d’une fin. La morphologie de l’histoire mondiale se com prend en individuant, dans les différents cycles de culture, le recours à ces phases dans un système de correspondances et de synchronismes qui ne se limitent pas à la vie politique et sociale mais investit aussi le domaine des arts, de la pensée, de la science, de la religion, de l’éthique, du droit…
Une fois dissous un de ces organismes, il en émerge un autre dans un paysage nouveau qui répète le même cycle, sans continuité avec le précédent, selon une idée originale et irreproductible. Chaque cycle de culture exprime à travers ses guerres, ses arts, sa pensée, son architecture, son économie, ses sciences, une idée donnée ou une âme, laquelle donnera à toutes ces manifestations un caractère symbolique. D’une culture rien ne passe vraiment dans une autre : ce qu’une culture peut reprendre d’une autre remplit chez elle une nouvelle fonction qui dépend de l’idée spécifique de cette culture, et assume donc une signification, une qualité différente. Un exemple : le christianisme qui a été repris dans la culture euro-occidentale (catholique romain), malgré la communauté de thème, est une foi tout à fait différente de celle du christianisme des origines, lequel émergea et se développa dans le cadre de la culture dite magique. Selon Spengler, non seulement chaque culture procédant d’un symbole élémentaire, a une conception différente du monde et de la vie, mais aussi une science différente, une mathématique et une physique différente. Il n’existe pas une mathématique, une peinture, un droit, une économie au singulier ou universelle mais il existe différentes mathématiques, diverses lignes de peinture, différentes économies, différents droits, et ainsi de suite pour chaque culture qui a un esprit, un sens et une valeur symbolique propre.
On se trouve donc en face d’une conception pluraliste et relativiste où, d’évidence, le positif se mêle au négatif. S’il est juste de rompre le cercle magique par lequel on est porté à interpréter chaque culture en méconnaissant son originalité, il est clair qu’en insistant sur la discontinuité et en affirmant surtout, com me Spengler, que chaque vérité est historiquement conditionnée et subit la loi irrévocable de la culture à laquelle elle appartient, on aboutit à une impossibilité méthodologique. En toute rigueur, on serait condamné à comprendre uniquement sa propre culture. Dès le départ, l’assertion de Spengler, de cerner l’âme et l’idée directrice d’un groupe de cultures différentes de la notre, deviendrait absurde. Et, toujours en suivant Spengler, justement nous Occidentaux serions à cet égard dans une situation particulièrement défavorable, car la particularité de notre culture est son caractère historique, le fait qu’elle voit tout en terme d’histoire et donc, fatalement, en termes de relativité prospective. Dans ce cas, les prévisions seraient inversées. Pour accomplir le devoir que Spengler indique, l’homme d’une culture qu’il nomme anhistorique ou atemporelle et qu’on peut définir comme l’homme traditionnel serait le mieux qualifié : en grande partie libre, objectif, apte à saisir l’autre sans le déformer. Du reste, on doit à l’homme traditionnel des visions et des mythes historiques d’une ampleur sans équivalent dans les philosophies modernes de l’histoire (si on excepte Guénon qui a justement repris ces traditions ). Nous entendons par exemple la doctrine des quatre âges, au caractère universel pour avoir été formulée par les cultures les plus variées, la doctrine de la « grande année », la doctrine des kalpa, et ainsi de suite. En revanche, le destin des modernes, qui est d’être conditionné historiquement, est réel. Il est illustré par le cas même de Spengler. À la base de tout son traité, on trouve une philosophie irrationnelle de la vie qui est un produit ou un sous-produit de l’ultime culture : la dernière de celles qui peuvent nous faire comprendre l’esprit d’autres cultures ou phases de cultures.
Pour décrire le développement cyclique des cultures, Spengler a introduit une distinction et une terminologie correspondante de valeur incontestable : culture (Kultur) contre civilisation (Zivilisation). Dans chaque cycle, la phase de culture est celle, qualitative et différenciée, liée aux symboles élémentaires du château et du temple, centrée autour des deux castes primordiales, noblesse et clergé, relevée des valeurs de la race, de la tradition, des coutumes vivantes, du sens du destin et de l’intuition artistique. Une fois dépassé le point apical de chaque cycle, et essentiellement avec le développement des villes, l’avènement du Tiers-État et enfin le régime des masses, toutes ces valeurs se perdent, et de la culture on passe à la civilisation, inévitable phase crépusculaire et finale de chaque cycle. Dans la civilisation prédomine l’intellect abstrait, le pur être éveillé, arraché à l’instinct, à la race, au substrat cosmique. À l’organique, succède l’inorganique, à l’expérience vécue la causalité mécanique, au monde comme histoire, le monde comme nature, à la forme l’informe. La civilisation voit la venue de la machine, l’omnipotence de l’argent et de la finance, le régime des masses et de l’anti-caste. Son symbole est la métropole, la ville cosmopolite tentaculaire qui absorbe et dévore la campagne et ses énergies. Socialement et politiquement, la civilisation se résout dans le bonapartisme et le césarisme : c’est le pouvoir informe entre les mains d’individus isolés qui contrôlent en despotes les forces et les hommes de ce monde crépusculaire et intérieurement dissous. De plus, il n’y a plus d’histoire au sens supérieur, rien n’a plus ni signification ni puissance de symbole, il se fait un retour aux formes primitives, anhistoriques, éternelles, purement biologiques, des origines.
Nous vivons, selon Spengler, dans la phase de civilisation du cycle euro-occidental (ou faustien), initié vers l’an mille. L’expression « déclin de l’Occident » exprime simplement ce fait, notre destin. Même l’Occident vivra la fin de son cycle dans les formes qu’ont déjà connu d’autres cultures et qui peuvent ainsi être prévues. Spengler peut repousser l’accusation de pessimisme, car pour lui, il s’agit de la simple constatation d’un phénomène naturel et inévitable : prédire les formes d’extinction d’une culture serait aussi peu pessimiste que de décrire le déclin, la vieillesse et la mort de tout autre organisme. Mais la question alors devrait être déplacée : on peut accuser Spengler de pessimisme non en raison de son regard sur l’avènement de la civilisation mais parce que toute sa doctrine est soumise à un fatalisme biologique indûment étendu à la philosophie de l’histoire.
De même que les vies de différents individus qui se succèdent dans le temps, tout en restant des cycles clos pourvus de bases biologiques similaires, peuvent dans leur ensemble exprimer une continuité de plan supérieur (par exemple, comme histoire), de même la théorie des cultures comme cycles plus ou moins parallèles n’exclue pas nécessairement une vision d’ordre plus vaste. Celui qui, pour avoir un guide plus sûr, assumerait les anciennes idées traditionnelles déjà évoquées, en particulier la doctrine des quatre âges, pourrait facilement voir que si chaque culture peut avoir eu une couleur particulière et avoir suivi le parcours évoqué qui se termine par une phase de civilisation. pour l’ensemble d’entre elles, s’est développé à partir de la lointaine antiquité, le même rythme, de telle sorte que la civilisation apparaît être le terme, le terminus ad quem auquel l’ensemble des précédentes cultures semble être lié et à travers laquelle un processus involutif complet se conclut : dans les formes isolées des précédentes civilisations on peut presque desceller les formes partielles, essais ou préfigurations qui dans la civilisation occidentale seule devaient trouver leur plus complète, radicale et universelle réalisation. Réalisation universelle, disons-nous, puisque la civilisation de l’ultime Occident n’est plus l’épisode d’une culture donnée, limitée à un paysage particulier, mais le phénomène qui investit peu à peu toute la terre, ne laissant plus un seul espace où puisse naître quelque chose de nouveau et initier un nouveau cycle. Du reste, Spengler le reconnaît quand il parle du caractère planétaire que présente la culture faustienne, à la différence de toutes les autres.
On reconnaît la valeur qu’a, pour une morphologie de l’histoire, la distinction entre culture et civilisation. Une telle distinction aurait dû être scindée sous la forme de deux catégories kantiennes et de deux types généraux d’organisation de la vie humaine ; ainsi aurions nous eu une dualité comme fil conducteur, précieuse pour découvrir au-delà d’un apparent pluralisme, l’esprit singulier, antithétique, présenté par les arts, la science, le culte, les coutumes, … de manière que, justement, ils redeviennent une culture ou une civilisation. Si Spengler met assez bien en lumière les caractères de chaque civilisation, il y aurait beaucoup à dire sur ce qui, pour lui, constitue son opposé, la culture ; on pourrait en outre se demander s’il a été donné à Spengler de saisir l’esprit des formes supérieures traditionnelles de culture, car on a le sentiment qu’il a juste su valoriser les expressions d’une existence assez primitive, liée à la campagne et aux petits centres d’activité, aux formes qualitatives, guerrières, sacerdotales et symboliques, mettant en relief les arts de petit format et de souffle court, privés de relation avec quelque chose de transcendant et de spirituel au sens supérieur. Spengler, d’après sa philosophie de la vie, accepte pour seule valeur ce qui est communément vital, irrationnellement et quasi inconsciemment vécu. Il rattache déjà aux phases de dégénérescence urbaine, de détachement des origines, de la tyrannie que l’être intellectualisé exerce sur le substrat maternel de la vie et de l’être, toutes les formes de conscience supérieure et de transcendance détachée de la vie — ordonnant et dominant celle-ci — qui existeraient au centre de toutes les grandes cultures traditionnelles.
Si Spengler donne tant d’importance au monde des symboles et des mythes, cela ne va pas dans le sens de la tendance traditionaliste qui renvoie ce monde à des contenus métaphysiques. Pour Spengler, les symboles et les mythes ont plus ou moins la même signification vitale, confuse et dégradée que celle qu’on attribue aux irrationalistes et aux psychanalystes : manifestations de l’inconscient, substrat de la vie, quelque chose situé non au-delà mais de ce côté du monde de toute personne normale éveillée.
Il est singulier de ne pas trouver chez Spengler la moindre référence au philosophe Vico : ou il l’a totalement ignoré ou il a jugé bon de passer sous silence ce penseur dont la théorie des cycles historiques a une analogie avec celle de Spengler et qui, si l’on écarte différentes imperfections et divagations, comporte sur elle un avantage en terme de définition des catégories historiques. La supériorité de Vico vient aussi du fait qu’il tire son inspiration d’une des formulations de l’ancienne doctrine déjà évoquée de la suite involutive de phases de culture. Comme on le sait, Vico distingue au cours d’un cycle la période sacrée de celle héroïque, qui s’évanouit à son tour dans la période humaine et rationaliste (la barbarie de la réflexion). Celle-ci est plus ou moins équivalente à la phase de civilisation de Spengler, Vico ayant noté le même phénomène final de monarchie, au sens péjoratif de césarisme. Le schéma de Spengler est plus incomplet car chez lui, la confuse, irrationnelle interprétation de la spiritualité des origines, la façon qu’il a de considérer opposés dans la coexistence, noblesse et clergé, interdisent de dissocier les phases sacrées et héroïco-guerrières. Du reste, alors qu’il manque à l’historiographie de Spengler la dimension métaphysique des cultures (on n’y parle toujours de l’âme, jamais de l’esprit des cultures), le domaine des arts prend en revanche un relief excessif : des arts pris plutôt au sens humaniste. Et dans l’ensemble, on a le sentiment d’une morphologie presque réduite à une « psychologie » des cultures (d’où le recours au terme physiognomonique) au lieu d’être au service d’une véritable métaphysique de l’histoire.
Il faut évoquer encore le phénomène de césarisme tel que le conçoit Spengler. Les choses se passent de telle sorte qu’au cours de la phase de civilisation de chaque cycle (Spengler a ici clairement en vue l’Occident), après que la culture technique, le règne de la machine, ont triomphé sur tout le reste, les puissances de la finance viendront à dominer (essentiellement sous le règne de la démocratie) et à la fin éclatera une lutte à mort entre les hommes d’argent et les hommes de l’Empire, s’identifiant à la lutte entre économie et politique pure. Les hommes de l’Empire détruiront la tyrannie de l’Or pour instaurer l’époque de la politique absolue. Ici on bute sur une curieuse, contradictoire interférence de causes : pourquoi, arrivé à ce point, devraient ressurgir par miracle des valeurs éthiques, de race et de tradition — des valeurs dont on se demande comment elles ont pu survivre aux destructions qui caractérisent toute la phase de civilisation — puisqu’elles renvoient à une période éteinte de culture. On ne voit pas comment chez ces grands hommes pourraient naître un sens des responsabilités, de l’honneur, une sollicitude pour tout ce qu’ils auront soustrait, avec leur pouvoir absolu, au domaine de l’or et soumis à la souveraineté du pur principe politique. Le césarisme de Spengler se définit essentiellement comme le pouvoir informe d’individus isolés, sur toile de fond de cette philosophie qui affirme le primat de la réalité et des faits sur la vérité, de la puissance sur les principes, de la vie sur toute forme d’existence supérieure. On baigne dans un pur climat de machiavélisme et le pronostic, prophétique au moment où il fut formulé, une fois arrachés ses oripeaux, nous place simplement face au totalitarisme, vu avec raison comme le phénomène inévitable des temps de civilisation. Ce qu’ajoute Spengler en fait de valeurs aristocratiques et traditionnelles est un non-sens : il ne saurait s’agir dans un tel cas de l’individu impérial (à vouloir toujours suivre l’interprétation abusive du César de Spengler) ni même bonapartiste, mais bien plutôt du chef ou souverain légitime, dont le lieu ou l’atmosphère historique n’est pas la civilisation mais la culture.
Il est vrai, pourtant, qu’à suivre Spengler, il n’y aurait qu’une éthique, un seul impératif, l’impératif biologique : réaliser ce qui correspond à la phase cyclique dans laquelle on vit. En fait, l’alternative serait : ou n’être rien, ou être ce que la période historique exige qu’on soit, dans chaque domaine, sous la forme du destin. Et dans un climat de civilisation seraient seules up to date les formes politiques sus-mentionnées.
Dans l’Allemagne national-socialiste, l’attitude de Spengler fut un cas très spécial. Devant le césarisme hitlérien, plus poussé et en soi plus plébéien que le mussolinien, Spengler vit sa théorie mise au banc d’essai, mais l’homme Spengler loin du philosophe déjà exalté par Cecil Rhodes, ne se sentit pas l’âme de le suivre. Comme Jünger, von Salomon, Blüher et différents penseurs de la Révolution conservatrice qui avaient préparé à plus d’un titre le national-socialisme, Spengler se tint à l’écart. Et la méfiance fut réciproque : les nazis tinrent Spengler dans un certain soupçon non pas tant à cause de sa théorie du césarisme, de l’irrationalisme biologique et de la volonté de puissance, que pour tout ce qui, selon l’incohérence déjà évoquée, le faisait apparaître comme le chantre du prussianisme conservateur, aristocratique, réactionnaire et à leurs yeux suspect.
[préface au Déclin de l’Occident, 1957]

 L’Europe ou la conjuration du déclin ?
L’Europe ou la conjuration du déclin ?L'exigence d'une unité européenne se fait aujourd'hui vive sur notre continent. Jusqu’à présent, ce sont des facteurs négatifs qui l'ont surtout alimentée : on veut s'unir pour se défendre, et cela pas tant pour un motif issu de quelque chose de positif et de préexistant, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix face à la pression menaçante d’intérêts non européens. Vu les circonstances, on ne voit pas très bien quelle serait la forme interne d'une véritable unité européenne. Pour l'instant, il semble que l'on n'aille pas au-delà d'un projet de coalition ou de fédération, qui en tant que telle aura toujours un caractère extrinsèque, hybride plutôt qu'organique et donc aussi contingent. Une unité vraiment organique pourrait se concevoir sur la base d'une force venant de l'intérieur et d'en haut, propre à une vision, une culture et une tradition commune. Voulant affronter le problème européen en ces termes, il apparaît à chacun combien la situation est difficile et combien de facteurs problématiques nous interdisent de nous raccrocher à un facile optimisme.
Beaucoup se sont déjà penchés sur ces aspects du problème européen. À cet égard, l'œuvre de Ulrik Varange (1917-1960), intitulée Imperium (Westpress, 1948) est significative. C'est d'elle que nous pouvons partir pour un examen approfondi des difficultés évoquées.
Varange ne défend pas la thèse de l'unité européenne en termes purement politiques. Il part d'une philosophie générale de l'histoire et de la culture se référant à O. Spengler. On connaît la conception de Spengler. Varange s'en inspire quand il considère le monde européen à la manière d'un organisme de culture muni d'une vie autonome, développant son idée selon un destin propre. En outre, il le suit quand il constate que la phase cyclique dans laquelle se trouve l'Europe est désormais celle de la civilisation. Mais à la différence de Spengler qui, au moins en un premier temps, et par référence à elle, avait lancé l’expression déclin de l'Occident, Varange cherche à permuter le négatif en positif, à voir le bon côté des choses et évoque ces forces nouvelles qui obéiraient à un impératif de renaissance et à des valeurs irréductibles au matérialisme et au rationalisme. Le développement cyclique, au-delà des ruines du monde d'hier et de la culture du XIXe siècle, conduirait l'Europe vers une ère nouvelle de politique absolue, de supranationalité, d'autorité, et donc aussi d'Imperium. Suivre cet impératif biologique hors de l'époque de civilisation ou bien mourir serait l'alternative pour l'Europe.
Suivant cet ordre d'idées, appartiendraient à l'idéologie du passé non seulement la conception scientiste et matérialiste de l'univers, mais aussi le libéralisme et la démocratie, le communisme et l'ONU, les États pluralistes et le particularisme national. L'impératif historique consisterait à réaliser l'Europe comme une unité de nation-culture-race-État, selon un principe rajeuni d'autorité et de nouvelles discriminations précises entre amis et ennemis, entre monde familier et monde barbare.
Il est bon d'évoquer ce que Varange entend par pathologie de la culture. Une culture peut voir son organisme entravé dans ses lois naturelles par un processus de distorsion quand des éléments extérieurs en détournent les énergies de l'intérieur, visant des actions et des fins sans relation avec son exigence vitale mais qui font le jeu de ces forces externes. Ceci trouve une application directe dans le domaine des guerres, la véritable alternative n'étant pas, d’après Varange, entre guerre et paix, mais entre les guerres utiles et nécessaires à une culture et celles qui altèrent, voire désagrègent cette culture.
Le second cas est celui où l'on ne se bat plus contre un ennemi réel qui menace biologiquement l'organisme matériel et spirituel de sa culture mais quand la guerre éclate à l'intérieur d'une culture, comme il est advenu en Occident lors des deux conflagrations mondiales. Des chefs d'État ont alors préféré la ruine de l'Europe et l’assujettissement fatal de leurs patries à des peuples barbares d'Orient et d'Occident plutôt que de coopérer à une Europe neuve qui tendait à dépasser le monde du XIXe siècle et à se réorganiser sous de nouveaux symboles d'autorité et de société. L'effet fatal est désormais bien visible : la victoire n'a pas été celle d'un pays européen sur un autre, mais bien celle de l'anti-Europe d'Asie et d'Amérique sur l'Europe elle-même.
Cette accusation atteint spécifiquement l'Angleterre mais Varange l'étend aussi aux États-Unis, retenant que leur politique interventionniste, développée sous l'effet d'une distorsion de culture, poursuivait des buts sans lien organique avec les nécessités vitales des nations.
Les choses allant s'accélérant pour l'Occident, il s'agit de reconnaître l'impératif biologique qui correspond à la phase de son cycle : dépasser l'émiettement des États et faire naître l'unité d'une nation-État européenne, formant un bloc contre l'anti-Europe.
Le devoir est, dans un premier temps, interne et spirituel. L'Europe doit se débarrasser des traîtres, des parasites, des déviationnistes. Il faut que la culture européenne se désintoxique des résidus de conceptions matérialistes, économistes, égalitaires et rationalistes du XIXe siècle. Dans un second temps, l'unité culturelle de l'Europe devra trouver son expression dans une unité politique correspondante, quitte à entamer des guerres civiles ou des luttes contre les puissances qui veulent tenir l'Europe sous leur contrôle. Fédérations, unions douanières et autres mesures économiques ne peuvent constituer des solutions ; c'est d'un impératif interne que viendra l'unité et qui doit être réalisé quand bien même il pourrait apparaître désavantageux économiquement, le critère économique n'étant plus la dernière instance dans l’ère nouvelle. Dans un troisième temps, pourra se poser le problème de l'espace nécessaire à la surpopulation de la nation européenne, dont Varange voit la meilleure solution dans une percée vers l'Orient, où, sous le masque communiste, se concentre et s'organise la puissance de races séculairement hostiles à la culture occidentale.
Pour nos objectifs, en ce qui concerne Varange, cela peut suffire. Le symbole fondamental invoqué par lui est celui de l'Imperium et d'un nouveau principe d'autorité. Toutefois, nous ne pensons pas qu'il voie clairement ce qu'un tel symbole implique, s'il est assumé comme il doit l’être. Il n'aperçoit pas le décalage qu'il y a entre ce symbole et tout ce qui appartient à la phase poussée de civilisation d'une culture, dans notre cas de la civilisation européenne.
Varange doit être suivi quand il accuse d'insuffisance les solutions fédéralistes et simplement économiques du problème européen. Comme nous l'avons déjà dit, une véritable unité ne peut être que de type organique, et pour elle le schéma est bien connu, il est celui qui se réalisa déjà dans l’espace européen médiéval. Il reprend aussi bien l'unité que la multiplicité et se concrétise dans un système de participations hiérarchiques. Il faut dépasser le nationalisme, absolutisation schismatique du particulier, pour passer au concept naturel de nationalité. À l'intérieur de chaque espace national devra avoir lieu ensuite un processus d'intégration qui coordonne les forces dans une structure hiérarchique et stabilise l'ordre fondé sur un principe central de souveraineté et d'autorité. La même chose devra ensuite se répéter dans l'espace européen général : les nations, unités partielles organiques, graviterons selon un unum quod non est pars (Dante), c'est-à-dire selon un principe d'autorité hiérarchiquement supérieur à chacune d'entre elles. Ce principe, pour être viable, devra nécessairement dépasser le milieu politique au sens étroit, se fonder et se légitimer sur une idée, une tradition et même un pouvoir spirituel. Alors adviendra l'Imperium, l'unité organique virile et libre de toutes les idéologies niveleuses, libérales, démocratiques, chauvines, collectivistes, de telle sorte qu'elle puisse se détacher aussi bien de l'Orient que de l'Occident, c'est-à-dire de deux blocs, qui, comme les branches d'une seule tenaille, se referment sur nous.
Ainsi la prémisse d'un développement de ce genre n'est pas la dissolution des nations dans une nation unique, en une espèce de substance sociale européenne homogène, mais bien l'intégration hiérarchique de chaque nation. La véritable unité, non pas mixte mais organique, se réalise non pas par la base, mais au sommet. Détruite l'hybris nationaliste qui accompagne toujours les moments démagogiques, collectivistes et schismatiques, une unification virtuelle pourra se continuer au-delà de nations hiérarchisées, laissant à celles-ci leur individualité naturelle et leur forme.
Et ainsi tout serait en ordre. Le mal est pourtant que le cadre naturel d'une pareille réalisation est celui d'un monde qui se trouve en phase de culture et non de civilisation. Des écrivains comme Varange mélangent les choses qui appartiennent à des plans distincts, tombant dans l'équivoque qu'encourut en son temps Mussolini lui-même. Mussolini, sans connaître l'œuvre capitale de Spengler, avait lu de lui Années décisives et fut marqué par les pronostics d'un nouveau césarisme. Dans ce livre, il ne se rendit pas compte du lieu qui, selon Spengler, se prête à des formes de ce genre dans le cycle des cultures : c'est quand s'effondre le monde des traditions, quand la Kultur a disparu au profit de la Zivilisation, quand les valeurs qualitatives sont tombées et que l'élément informe des masses prend le dessus et seulement alors, dans la phase automnale ou crépusculaire d'un cycle, que les nations aussi disparaissent au profit de grands agrégats supranationaux sous le signe d'un pseudo-césarisme, d'un pouvoir personnel centralisé, en soi informe, sans approbation supérieure. Ceci n'est qu'une image déformée et inversée de l'Imperium au sens traditionnel et original ; il ne s'agit pas d'empire, tout au plus de cet impérialisme qui représente chez Spengler le dernier soubresaut d'une culture mourante, à la suite de quoi une autre émergera, différente, sans lien de continuité avec la précédente.
Maintenant, quand Varange parle de l'époque nouvelle de la politique absolue et des blocs qui, une fois absorbées les nations d'une même culture dans un seul organisme, devraient avoir comme ultimes critères la discrimination existentielle amis-ennemis (reprise par Carl Schmitt, qui avait défini en ces termes l'essence moderne de l'unité purement politique) et l'impératif biologique, il reste prisonnier de la civilisation et des processus totalitaires plutôt subnationaux que supranationaux, dont la réalisation la plus récente et cohérente fut le stalinisme. Il est clair que si l'unité européenne devait se réaliser de cette manière, par sa seule vertu l’Europe pourrait résister et se réaffirmer biologiquement contre les puissances impérialistes extra-européennes, mais au même moment elle abdiquerait intérieurement, il en serait fini de l'Europe proprement dite, de la tradition européenne, elle serait devenue un fac-similé de ses adversaires, ramenée sur le terrain d'une lutte dictée par cette vile volonté d'existence et de puissance, en attendant que les facteurs généraux de désintégration propres à la culture techno-mécaniste se fassent sentir. C'est plus ou moins le pronostic que fait Burnham quand il considère les issues possibles de ce qu'il nomme la révolution managériale en cours (The managerial Revolution, New York, 1941).
Quelles sont les autres prospectives ouvertes ? Difficile à dire. Quant aux nations, chacune d'elles peut maintenir sa propre individualité et la dignité d'un tout partiel organique, ou bien se soumettre à un ordre supérieur, seulement dans les deux conjonctures évoquées : celle, extrinsèque et non contraignante, qui se définit en termes d'utilité matérielle et de nécessité externe, ou celle où sera reconnue par la nation une autorité réellement supérieure et que ne peut s'accaparer par hégémonie aucune nation particulière. Où trouver un point de référence à tout cela ? On parle volontiers de tradition, de culture européenne, d'Europe comme organisme autonome, mais à bien considérer les choses aujourd'hui et à les mesurer à l'échelle des valeurs absolues, on voit bien qu'il ne s'agit rien de plus que de slogans et de belles phrases.
Au plan supérieur, l'âme de l'Europe supranationale devra être religieuse : non pas abstraitement, mais par référence à une autorité spirituelle précise et positive. Aujourd'hui, même en faisant abstraction de la sécularisation et de la laïcisation générale de l'Europe, il n'existe sur notre continent rien de semblable. Le catholicisme n'est pas la confession de toutes les nations européennes. Partir du christianisme générique serait trop peu, trop incorporel et uniforme, non exclusivement européen et donc non monopolisable par la culture européenne. De plus, on peut douter de la possibilité de concilier christianisme et métaphysique de l'Empire : le conflit médiéval entre les deux pouvoirs, compris dans ses véritables termes, nous le montre.
Laissons-là ce registre et passons au plan culturel. Peut-on parler aujourd'hui d'une culture artistique européenne différenciée qui se maintiendrait dans ses expressions variées et syntones comme une culture des seules nations européennes ? De nouveau, il serait hasardeux de répondre affirmativement et la raison en a été montrée par Steding dans Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur. Cette raison réside en ce qu'il nomme la neutralisation de la culture : une culture divergente de l'idée politique commune, une culture privée, transitoire et pourtant cosmopolite, désaxée, suggestive, anti-architecturale, neutre et anonyme dans ses aspects scientistes et positivistes. Mettre cela sur le compte d'une pathologie de la culture, d'une action externe et porteuse de distorsions, comme le veut Varange, signifie penser de façon simpliste. En général, où peut-on trouver aujourd'hui, en phase de civilisation, une base culturelle suffisamment différenciée pour pouvoir sérieusement nous opposer à l'autre, le barbare, comme on a pu le faire par le passé dans le cas de précédents espaces impériaux ? Il faudrait pousser très loin, pour en venir là, le travail de désintoxication et de réintégration, car si nous pouvons juger à juste titre barbares et anti-européens certains aspects de la culture nord-américaine, il ne faut pas perdre de vue tout ce qui, en elle, représente le développement extrême de tendances et de maux qui se firent d'abord jour en Europe. C'est là que réside justement la raison de la faible immunité de l'Europe par rapport à elle.
Aujourd'hui, nous en sommes réduits à un tel point que, quand on parle de tradition, on tombe dans l'équivoque. Depuis longtemps déjà, l’Occident ne sait plus ce qu'est la tradition au sens le plus haut, l'esprit anti-traditionnel et l'esprit occidental ne faisant qu'un depuis la Renaissance. La tradition au sens intégral est une catégorie qui appartient à une époque que Vico appellerait l'âge héroïque, où une seule force ayant des racines métaphysiques se manifeste dans les coutumes comme dans le culte, dans le droit, le mythe, la création artistique et dans chaque domaine particulier de l'existence. Où peut-on constater aujourd'hui une survivance de la tradition prise en ce sens ? Et en particulier de la tradition européenne, grande, unanime et non pas paysanne et folklorique ? C'est seulement dans le totalitarisme niveleur que l'on a pu, à la rigueur, lire des tendances à l'unité politico-culturelle absolue. Concrètement, la tradition européenne a pour contenu aujourd'hui les seules interprétations privées et plus ou moins divergentes d'intellectuels à la mode.
De cela et d'autres considérations du même genre, on arrive à une conclusion fondamentale : l'unité supranationale aux traits positifs et organiques est impossible en période de civilisation. Dans une telle période, on peut concevoir, au maximum, la fusion des nations dans un bloc informe de puissances, dans lequel le principe politique est l'ultime instance et subordonne tout facteur moral et spirituel : monde tellurique de la révolution mondiale (Keyserling) ou monde de la politique absolue sous le signe d'un impératif biologique (Varange), ou nouveaux complexes totalitaires entre les mains des managers (Burnham), selon ce qui sera pressenti par une majorité d'États. Une unité construite sur la tradition serait quelque chose de bien différent.
Devrons-nous conclure négativement notre bilan et nous contenter d'une idée plus modeste, fédéraliste, sociale ou sociétale ? Cela n'est pas sûr car une fois constatée l’antithèse, il suffirait de s'orienter en conséquence. S'il est absurde de vouloir poursuivre notre idéal dans le cadre d'une civilisation (il en sortirait déformé et inversé) le dépassement de tout ce qui est civilisation doit être le point de départ de toute initiative de reconstruction. Civilisation équivaut à monde moderne et sans se faire d'illusion, on doit reconnaître que du monde moderne, de son matérialisme, de son économisme, de son rationalisme et d'autres facteurs involutifs et dissolvants, l'Europe est éminemment responsable. Premièrement, devrait avoir lieu un renouveau spirituel, éveillant de nouvelles formes de sensibilité et d’intérêt, un nouveau style interne et une nouvelle orientation fondamentale et homogène de l'esprit. À cet égard, on doit se rendre compte qu'il ne suffit pas comme le préconise Varange, de dépasser la vision de la vie du XIXe siècle dans ses différents aspects, car cette vision n'était elle-même que le résultat de causes plus lointaines. Ensuite, sur l'interprétation biologisante de Spengler, on doit émettre des réserves précises, surtout quand Varange prédit une remontée fatale, annoncée par les symptômes les plus variés. D'un autre côté, on ne peut pas non plus s'appuyer sur les mouvements révolutionnaires et rénovateurs d'hier, car les tendances contrastées qu'ils renfermaient et qui auraient pu aboutir positivement ont été étouffées par les défaites militaires.
Cependant la crise du principe d'autorité me semble être la difficulté la plus grave car seule une telle autorité peut conduire, à l'intérieur d'une nation, à dépasser individualisme et socialisme, et dans un espace européen, à réduire l’hybris nationaliste, les orgueils sacrés et la crispation des souverainetés étatiques par des voies différentes que celles de la nécessité et des intérêts conjoncturels. Si quelque chose est propre à la tradition occidentale, c'est l'union spontanée d'hommes libres et fiers de servir un chef digne de ce nom. Pour une unité européenne vraie, nous ne saurons concevoir que la répétition en grand de quelque chose d’héroïque, et non l'inauguration d'un “parlement” ou d'un fac-similé de société par actions. De tout cela résulte clairement l'erreur de l'agnostique en politique qui admet une idée européenne se réduisant à une sorte de commun dénominateur informe : il faudrait un centre de cristallisation et la forme du tout ne peut pas ne pas se refléter dans les parties. Sur un fond qui soit non de civilisation mais de tradition, une institution bien faite ne peut être qu'organique et hiérarchique. À l'unité supranationale, nous nous rapprocherons d'autant plus dans les unités partielles, nationales, que l'on procédera à une intégration en ce sens.
Le fait qu'à l'extérieur, de multiples facteurs nous font désormais sentir que pour l'Europe faire bloc est désormais une question de vie ou de mort, doit nous conduire à reconnaître le double problème à résoudre pour donner à cette Europe nouvelle une base solide : d'un côté dépasser graduellement tout ce qui nous relie à la civilisation, de l'autre, trouver une espèce de métaphysique qui puisse justifier une idée qu'elle soit nationale ou supranationale et européenne, de pure autorité.
Le double problème appelle un double impératif. Il est à voir combien d'hommes seront encore debout au milieu des ruines pour comprendre et assumer cette tâche.
[Europa Nazione, 1951]

♦ Études ♦
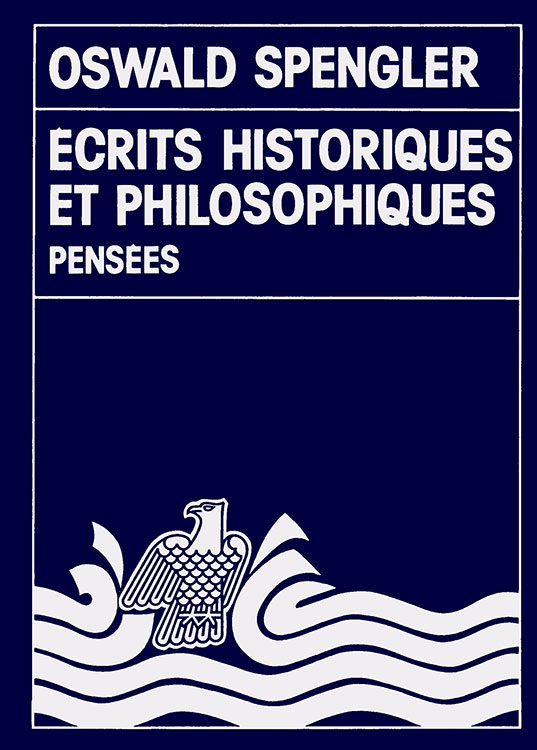 Préface aux “Écrits historiques et philosophiques”
Préface aux “Écrits historiques et philosophiques”En 1925, André Fauconnet pouvait écrire : « Depuis la fin de la guerre mondiale, aucune œuvre philosophique n’a eu, dans l’Europe centrale, un retentissement comparable à celle de Spengler » (Oswald Spengler, le prophète du “Déclin de l’Occident”, Félix Alcan, 1925, p. V). On sait, depuis lors, l’influence considérable qu’a exercée Spengler sur des historiens comme Arnold J. Toynbee — appelé lui-même parfois le “Spengler de la Seconde Guerre mondiale” (1) — ou des sociologues comme Pitirim Sorokin (2). Les historiens français, traditionnellement réservés à son endroit, ne l’en ont pas moins lu attentivement et l’ont abondamment commenté (3). Plus récemment, l’œuvre de Spengler a inspiré divers théoriciens occidentaux (4). Sa fécondité pour l’analyse des cultures arabes a été reconnue par Hichem Djaït (L’Europe et l’Islam, Seuil, 1978 ; « Oswald Spengler », pp. 92-108). Des auteurs comme Julien Freund ou Gilbert Durand ont repris à leur compte certains éléments de sa politologie. Et dans son Plaidoyer pour une Europe décadente (Laffont, 1977), Raymond Aron ne manque pas d’évoquer, à propos de Spengler et de Pareto, la persistance de cette pensée à laquelle il s’oppose : « En marge de l’idéologie dominante, celle du progrès, une autre philosophie de l’histoire survit dans l’ombre, chargée d’opprobre, parfois maudite, celle qui dénonce les idoles modernes, annonciatrices de la décadence… »
Chargée d’opprobre, la pensée spenglérienne l’a d’abord été, en Allemagne, sous le régime national-socialiste (5). Elle s’est ensuite heurtée tantôt à l’hostilité des auteurs marxistes, tantôt à celle des rationalistes libéraux, tantôt à celle des chrétiens. On concèdera que cela fait beaucoup. Dès 1949, cependant, Spengler était de nouveau publié en Allemagne, tandis que, par les soins de Hildegard Kornhardt, Anton Mirko Koktanek et Manfred Schröter, les études spenglériennes s’apprêtaient à prendre leur essor. En France, la traduction du Déclin de l’Occident due à M. Tazerout (6), parue originellement en 1931, est rééditée chez Gallimard en 1948. Marcel Brion en fera, dans Le Monde (11 octobre 1949), un élogieux compte-rendu. Le public français non germanophone n’a pourtant, aujourd’hui encore, qu’une connaissance très incomplète de l’œuvre de Spengler. Seuls en effet trois ouvrages de ce dernier ont été traduits à ce jour : Le déclin de l’Occident (Gallimard, 1931 et 1948), Années décisives (Mercure de France, 1934 et 1943 ; Copernic, 1980) et L’homme et la technique (Gallimard, 1958) — à l’exclusion de tous les recueils d’articles, de tous les textes politiques (Preussentum und Sozialismus, 1919, Neubau des deutschen Reiches, 1924, Politische Pflichten der deutschen Jugend, 1924), sans oublier les ouvrages posthumes (Urfragen, 1965, et Frühzeit der Weltgeschichte, 1966), la correspondance (Briefe, 1913-1936) et, bien entendu, les inédits. C’est pour suppléer — partiellement — à cette carence que nous publions, en cette année marquée notamment par le 100e anniversaire de la naissance du philosophe, un certain nombre de textes de Spengler encore inconnus du public français, dans une belle traduction de Henri Plard qui leur conserve toute la richesse et la vigueur de l’original. Les dix essais dont se compose la première partie du présent ouvrage sont tous extraits d’un volume intitulé Reden und Aufsätze (C.H. Beck, München), qui fut publié un an après la mort de Spengler, à la fin de l’année 1937, par les soins de Hildegard Kornhardt, sœur de l’auteur (à qui l’on doit également la préface) [7]. Ce recueil comprend dix-huit textes s’échelonnant de 1920 à 1936, à l’exception de la thèse de doctorat sur Héraclite (1904), qui ouvre le volume, et d’un bref article (Der Sieger : Eine Skizze) daté de 1910. Certains ont par la suite été traduits en espagnol ou en américain (8). […]
Le texte le plus intéressant de ce recueil est sans doute celui qui s’intitule Pessimisme ? (9). Publié en 1921, peu de temps avant la parution — le 20 mai 1922 — du second volume du Déclin de l’Occident, il répond à l’une des critiques les plus communément adressées à son auteur après la sortie du premier tome. D’emblée, Spengler rejette l’accusation de pessimisme, « injure dont les éternels vieillards poursuivent toute pensée qui ne se destine qu’aux pionniers de demain ». Un vrai pessimisme impliquerait qu’il n’y ait plus de buts à atteindre. Spengler pense au contraire que l’homme occidental en a tellement encore que c’est bien plutôt le temps qui risque de lui faire défaut. L’idée d’un “déclin” de l’Occident, précise-t-il, ne doit pas être interprétée comme le naufrage d’un navire. À la place de ce terme d’Untergang (déclin, chute, submersion), il aurait d’ailleurs aussi bien pu employer celui de Vollendung (maturation, accomplissement). Même si elle correspond au stade final de notre culture, la phase que nous vivons aujourd’hui reste grandiose : c’est « celle que le monde antique a connue dans l’intervalle entre Cannes et Actium ». C’est l’époque de l’empire germano-européen. Il n’y a donc pas lieu de désespérer ; or, si l’optimisme est lâcheté, le pessimisme est désespoir (10). Il faut seulement qu’il y ait concordance entre les efforts que l’on déploie, les buts que l’on se fixe et les possibilités du temps. Certes, les possibilités architectoniques de l’Europe sont épuisées. Il n’y aura plus de Goethe, plus de Shakespeare, plus de Botticelli, plus de Wagner. Mais il y aura de nouveaux Césars — qui sont les figures correspondant au stade impérial des cultures. Spengler, autrement dit, annonce ce qu’un auteur français méconnu du siècle dernier appelait « l’ère des Césars » (11). Pour lui, le seul véritable remède au déclin de l’Occident, c’est le « césarisme technocratique » — ce césarisme dont il se refusera à voir l’expression dans le national-socialisme. Quel sera son rôle ? Spengler le disait déjà dans Le Déclin de l’Occident. Ce sera d’abord de mettre un terme à la politique partisane [partitocratique], de mettre un terme, du même coup, à la “dictature de l’argent” : « L’épée vaincra l’argent, la volonté du seigneur s’assujettira à nouveau la volonté du pirate ». Ce qui implique de refaire de la politique un rapport de forces : « Une puissance ne peut être détruite que par une autre, non par un principe, et il n’y en a point d’autre contre l’argent ». On retrouve une idée analogue dans la conclusion de L’homme et la technique : « La fuite du chef-né devant la machine commence ».
Spengler ne prône donc nullement le renoncement, l’ascèse négative devant l’inéluctable kali-yuga. Il ne se contente pas non plus, comme Evola, de vouloir “chevaucher le tigre”. Il ne professe pas le désespoir romantique d’un Gobineau. Son raisonnement s’apparente plutôt à celui du stoïcisme : même si tout est joué par avance, il faut rechercher le salut par les œuvres. Être “pessimiste” sous le prétexte que notre culture approche de sa fin revient à ne plus vouloir vivre sous le prétexte qu’un jour nous mourrons. Spengler souligne par ailleurs que s’il y a un déterminisme global qui pèse sur la culture, il n’y a pas de déterminisme individuel. L’homme a toujours la possibilité de rester fidèle à l’idée qu’il se fait de lui-même. Un « parti pris vital » est toujours possible. C’est ce que Spengler a appelé le « choix d’Achille » : mieux « vaut une vie brève, pleine d’action et d’éclat, plutôt qu’une existence prolongée, mais vide » (L’homme et la technique). Pourquoi dans ces conditions faudrait-il espérer avant d’entreprendre ? L’espoir aussi est une lâcheté. L’homme de qualité n’entreprend pas parce qu’il peut réussir. Il entreprend parce qu’il doit entreprendre. On connaît la maxime du Taciturne et aussi la belle devise hanséatique : Navigare necesse est, vivere non est necesse. On connaît enfin l’exemple cité par Spengler, sur quoi s’achève L’homme et la technique : « Nous devons poursuivre avec vaillance, jusqu’au terme fatal, le chemin qui nous est tracé. Il n’y a pas d’alternative Notre devoir est de nous incruster dans cette position intenable, sans espoir, sans possibilité de renfort. Tenir, tenir à l’exemple de ce soldat romain dont le squelette a été retrouvé devant une porte de Pompéi et qui, durant l’éruption du Vésuve, mourut à son poste parce qu’on avait omis de venir le relever. Voilà qui est noble. Voilà qui est grand. Une fin honorable est la seule chose dont on ne puisse pas frustrer un homme ». En fin de compte, l’éthique aura le dernier mot : « Celui qui est digne de quelque chose finira par triompher ». Jusque dans son apparente rigidité, le système spenglérien est donc, du moins pour les âmes fortes, un remède au pessimisme. C’est ce que constate Keyserling en disant de cette rigidité que, « satisfaisant pleinement la partie de l’être qui réclame la prédestination et l’irrationalité, elle ne fait que stimuler d’autant plus son désir de liberté à se déployer dans l’action » (Figures symboliques, Stock, 1928).
La deuxième partie de ce livre est constituée par une anthologie des “pensées” de Spengler. Il s’agit d’un recueil publié en 1941, à Munich (12) par Hildegard Kornhardt, dont il n’existait à ce jour qu’une seule traduction étrangère, sortie aux États-Unis en 1967 (13). La sœur de Spengler y a réuni, sous une forme systématique, un certain nombre d’aphorismes et d’extraits choisis parmi les plus significatifs, tant parmi les ouvrages alors déjà publiés que parmi les notes posthumes (dont un grand nombre restent encore aujourd’hui inédites). Les pensées sont classées par thèmes (14). La traduction est également due à Henri Plard. Comme on le verra, ces aphorismes mettent surtout l’accent sur les aspects éthiques de la pensée de Spengler, plutôt que sur ses aspects proprement philosophiques ou historiques. Cela correspond à un choix de Hildegard Kornhardt, qui assure avoir ainsi répondu à la demande d’un jeune soldat. Mais il est également incontestable que l’éthique constitue la clé de voûte de toute l’œuvre de Spengler. On a vu plus haut ce qu’il en est à propos du pessimisme et des exemples auxquels Spengler se réfère. On sait par ailleurs que, tant dans Le déclin de l’Occident que dans les Années décisives, Spengler, récusant toute forme de racisme, et même toute définition biologique de la race, fait de cette dernière une entité purement spirituelle et élective, qui, en dernière instance, se ramène à la morale. De même, lorsqu’il prône le “prussianisme” (Preussentum und Sozialismus, 1919), c’est d’abord à un style qu’il se réfère — l’éthique du devoir, à base d’impersonnalité active et de sens de l’honneur —, et non à une appartenance historique ou à un lieu de naissance. Il s’agit, pour les individus comme pour les peuples, de se mettre “en forme” par le biais d’un principe — exactement de la même façon qu’un sportif est “en forme”. Et c’est en ce sens également que Spengler peut opposer le « socialisme éthique », de caractère « romain-prussien » (romisch-preussisch), au « socialisme économique », c’est-à-dire au marxisme, qui n’est qu’un « capitalisme d’en bas » (Kapitalismus von unten).
On peut adresser un certain nombre de reproches à la conception de l’homme posée par Spengler, et à sa philosophie de l’histoire. L’usage, notamment, qu’il fait des analogies biologiques appelle quelques réserves. Lorsque Spengler dit que les cultures « appartiennent comme les plantes et les animaux à la nature vivante de Goethe, et non à la nature morte de Newton », il a raison : les cultures sont des « formes organiques », l’homme lui-même est une « forme organique », et en ce sens la compréhension organique du monde vivant sera toujours plus féconde que la compréhension mécanique qui inspire les grandes physiques sociales, telles que le libéralisme et le marxisme. Néanmoins, la “nature” de l’homme ne se réduit pas à sa constitution organique. L’homme est un animal, mais il n’est pas que cela. Il n’est pas agi par son appartenance à l’espèce. Il n’est pas seulement libre, mais il est entièrement libre ; sa liberté se confond avec sa conscience, avec les choix constitutifs de sens qui président à ses actes. Sur ce point, l’analyse de Spengler reste très en-deçà de celle de l’anthropologie philosophique (Arnold Gehlen) et même de la tradition existentialiste (Heidegger). Elle retombe souvent dans un déterminisme biologique excessif, qui privilégie chez l’homme la “bête de proie” — der Mensch ist ein Raubtier, écrit Spengler dans les Années décisives (ce qui n’est pas sans évoquer la blonde Bestie dont parle Nietzsche) — et ignore ce qu’il y a de spécifique chez l’homme, c’est-à-dire ce qui fonde l’homme-en-tant-qu’homme comme irréductible à tout autre vivant. En d’autres termes, Spengler, qui a pourtant bien montré l’opposition entre le monde comme nature et le monde comme histoire, sous-estime paradoxalement l’historicité de l’homme. Il reste à cet égard un homme du XIXe siècle. D’où la remarque de Keyserling, qui lui reproche de se borner souvent à « reprendre de façon excessive le point de vue de l’embryologiste, et, notons-le bien, de l’embryologiste de tendance mécaniste ». De même, alors que Spengler conteste formellement le modèle historiographique judéo-chrétien, alors qu’il rejette la théorie unitaire et monolinéaire des “âges de l’humanité”, il reprend cette même théorie, de façon subreptice, en se contentant de la relativiser. Si l’humanité, en effet, ne passe pas dans son système par une unique succession de stades obligés, les cultures, elles, sont toutes censées passer par les mêmes stades de développement. Ainsi la nécessité historique n’est-elle pas fondamentalement remise en question, mais seulement fragmentée. Spengler, ici, est en retrait par rapport à Nietzsche. Sa conception quelque peu réductionniste de la “nature” de l’homme le conduit à interpréter le rapport de l’homme à l’histoire sous l’angle d’une rigidité excessive. Et toute sa philosophie de l’histoire repose sur cette interprétation, puisque c’est la connaissance des stades par lesquels passent nécessairement les cultures qui permet d’en prévoir l’avenir. Là encore, à notre avis, Spengler sous-estime largement la liberté existentielle de l’homme et sa capacité de créer des nouveautés radicales. Dans son système, le cercle succède à la ligne — mais le cercle n’est jamais qu’une ligne à laquelle on a donné une forme. Spengler s’abstient, depuis le cercle, de “sauter” jusqu’à la sphère.
À côté de cela, les apports positifs de Spengler sont immenses. Son intuition fondamentale de la discontinuité du temps historique et de l’irréductibilité, de l’incommensurabilité des cultures humaines, s’est révélée d’une fécondité prodigieuse, — et peut-être même peut-on partager l’opinion de Tazerout, selon laquelle ce « postulat de non-continuité » constitue « la seule hypothèse viable pour une connaissance scientifique des phénomènes de l’histoire ». Le plus grand mérite de Spengler, en effet, est d’avoir radicalement dénoncé le mythe d’une histoire linéaire unique, le mythe d’une « histoire au singulier » (Evola) qui se déroulerait, selon un processus gouverné par l’idée de “progrès”, d’un début nécessaire à une fin obligée, en fonction d’un sens (dans la double acception de ce terme) globalement irréversible. Spengler montre le caractère objectivement absurde des notions de “progrès de l’humanité”, de passé “périmé” radicalement coupé du présent, de futur “radieux”, etc. Il remet en cause, du même coup, la conception judéo-chrétienne du temps historique. Par suite, dans la mesure où il récuse l’historiographie classique, qui, d’une part, réduit l’histoire occidentale au vieux schéma Antiquité-Moyen Âge-Temps modernes, d’autre part, tend à faire de ce schéma un principe valable pour n’importe quelle culture, il pose les bases d’une analyse historique ouverte, impliquant, avec la fin de l’universalisme et du linéarisme historique, la fin de l’ethnocentrisme (15). Il n’est plus question désormais de juger toutes les cultures selon les critères de l’Occident. Il n’est plus question de faire tourner toute l’histoire du monde autour d’un unique pivot dont le point focal, la naissance supposée de Ieschoua (Jésus) de Nazareth, créerait une distinction radicale entre “l’avant” et “l’après”. Spengler réhabilite les cultures asiatiques et orientales. Il célèbre la civilisation arabe, constamment calomniée par une Église en mal de reconquista. Il souligne l’importance et la grandeur des cultures de l’Amérique précolombienne assassinées par le catholicisme hispanique. Répudiant tout européocentrisme, il rompt définitivement avec la pensée “ptolémaïque” et s’affirme “copernicien”. Mettant par ailleurs avec bonheur l’accent sur “l’âme des peuples”, sur la permanence des esprits nationaux et des mentalités (et aussi sur leurs avatars), faisant apparaître l’importance des “résidus psychologiques”, des sentiments et des passions comme déterminants des actes et des croyances, insistant sur le style qui « met en forme les peuples, les nations et les cultures », sur l’aspect synchronique de l’histoire plus encore que sur son aspect diachronique, Splengler apparaît comme un précurseur de l’étude moderne des structures et des mentalités.
Théoricien du mouvement national allemand, représentant exemplaire de la Révolution conservatrice, il annonce enfin des inquiétudes qui s’expriment en les points les plus divers de l’échiquier politique. Sa critique de la “civilisation” comme phase terminale de la culture, notamment, trouve aujourd’hui une résonance révélatrice, avec son opposition — dans la ligne de Tönnies — entre la communauté et la « ville mondiale », ses diatribes contre l’« esprit mercantile » (Krämergeist), sa réflexion sur le système capitalisme-marxisme conçu comme un ensemble homogène, sa dénonciation du “feuilletonisme” — la sous-culture journalistique — et de la dictature des media, son opposition résolue à l’avènement d’une société gouvernée par la consommation et le spectacle, l’hypertrophie urbaine, le quantitativisme, la croissance sauvage, la prédominance des valeurs marchandes, et par une rationalité sans âme qui, devenant à elle-même sa propre fin, s’institue progressivement en rationalité du monde. L’avenir de l’Occident, dit Spengler, c’est la pensée organisatrice dévorant la réalité organique, l’obsession du rendement dévorant le monde, la dégradation de la volonté de dépassement de soi en productivisme effréné, l’extension du nivellement égalitaire et de la dictature de l’argent — pour Spengler, « toute démocratie est une ploutocratie » (Demokratie und Plutokratie gleichbedeutend sind) —, le triomphe de l’utilitarisme et de l’égoïsme individuel, enfin l’asservissement de l’opinion et l’aliénation des consciences par la diffusion de standards de référence uniques tirant toujours plus les esprits vers l’extravagant, le spectaculaire, le superficiel et le méprisable. Bref, l’avenir de l’Occident, c’est la décadence — lorsque, comme il est dit dans L’homme et la technique, « toutes les choses vivantes agonisent dans l’étau de l’organisation », qu’« un monde artificiel pénètre le monde naturel et l’empoisonne », que « la civilisation elle-même est devenue une machine faisant ou essayant de tout faire mécaniquement ». Mais ne restera-t-il pas toujours des soldats de Rome ?
► Alain de Benoist, 1980. [version pdf]
- 01. Sur les rapports entre Spengler et Toynbee, cf. notamment : Lucien Febvre, « De Spengler à Toynbee : Deux philosophies opportunistes de l’histoire », in : Revue de métaphysique et de morale, XLIII, 1936, 537-662 (repris dans Combats pour l’histoire, Armand Colin, 1953, 119-143) ; Owen Lattimore, « Spengler and Toynbee », in : The Atlantic Monthly, CLXXXI, 1948, 4, 104-105 ; Arnold J. Toynbee, « Wie ich zu Oswald Spengler kam », suivi de « Worin ich mich von Spengler unterscheide », in : Hamburger akademische Rundschau, 1949, 309-313 ; Erich Rothacker, « Toynbee und Spengler », in : Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft, XXIV, 1950, 3, 389-402 ; Helmut Werner, « Spengler und Toynbee », in : Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft, XXIX, 1955, 4, 528-554.
- 02. Sur les rapports entre Spengler et Sorokin, cf. Gert Müller, « Sorokin und Spengler : Die Kritik Pitirim Sorokins am Werke Oswald Spenglers », in : Zeitschrift für philosophische Forschung, XIX, 1, 110-134.
- 21. Cf. notamment les jugements de Henri-Irénée Marrou, à la démarche typiquement réductionniste, selon qui Spengler est un « maître d’erreurs sombres » (De la connaissance historique, Seuil, 1975, p. 65), et de Fernand Braudel (L’histoire des civilisations : le passé explique le présent, chap. V de l’Encyclopédie française, vol. 20, Larousse, 1959 ; repris dans Écrits sur l’histoire, Flammarion, 1969, pp. 255-314).
- 04. Nous pensons ici au jeune essayiste italien Adriano Romualdi, tragiquement décédé voici quelques années, et surtout à l’Américain Francis Parker Yockey (Ulick Varange), dont l’ouvrage le plus connu, Imperium : The Philosophy of History and Politics (Truth Seeker Co., New York, 1962 ; Noontide Press, Sausalito, 1969), s’articule tout entier autour des notions de destin, de « vitalisme culturel » et de morphologie des civilisations.
- 05. Cf. notre préface à la nouvelle édition des Années décisives, Copernic, 1980.
- 06. Traduction non exempte de quelques contre-sens mémorables, et même assez surréalistes, comme celui qui conduit Tazerout à traduire par “acte” le mot allemand Akt ([qui signifie aussi] nu [artistique]), sur toute la longueur d’un chapitre.
- 07. Née en 1885, Hildegard Spengler épousa Fritz Kornhardt (1879-1918) le 10 juillet 1908. Après la mort de son mari, elle se consacra entièrement à l’œuvre de son frère. Elle mourut en 1942. Sa fille, également prénommée Hildegard, fut après elle l’exécutrice testamentaire et l’héritière du Nachlass spenglérien. Philologiste, elle naquit le 9 mars 1910 et mourut en 1959. Le Nachlass revint alors à Anton Mirko Koktanek, directeur du Spengler-Archiv auprès des éditions Beck.
- 08. Reden und Aufsätze a été traduit deux fois à l’étranger, mais chaque fois de façon partielle. En 1947, les éditions Espasa-Calpe, de Madrid, ont publié sous le titre El hombre y la técnica y otros ensayos (2e éd. : 1947 ; 3e éd. : coll. Austral 721, 1967, 138 p.) une traduction, par L. Martinez Hernàndez, de L’homme et la technique et de six essais de Spengler : cinq extraits de Reden und Aufsätze (La antigüedad de las culturas americanas / El carro de combate y su significación / Nietzsche y su siglo / ¿ Pesimismo ? / Pensamientos acerca de la poesía lírica), plus un autre, daté de septembre 1924 (La relación entre economía y política fiscal desde 1750), repris des Politische Schriften de 1932 (Das Verhältnis von Wirtschaft und Steuerpolitik seit 1750, pp. 297-310). De leur côté, les éditions Gateway-Henry Regnery Co., de Chicago, ont publié en 1967 un recueil intitulé Selected Essays (traduction et introduction de Donald O. White, 207 p.), comprenant deux extraits des Politische Schriften : Prussianism and Socialism (Preussentum und Sozialismus, pp. 1-105) et The Two Faces of Russia and Germany’s Eastern Problems (Das Doppelantlitz Russlands und die deutschen Ostprobleme, pp. 107-126), ainsi que quatre essais tirés des Reden und Aufsätze (Pessimism ? / Nietzsche and His Century / On the German National Character / Is World Peace Possible ?). Dans notre texte, l’abréviation EE renverra à l’édition espagnole ; l’abréviation EA, à l’édition américaine.
- 09. Pessimisme ? [lire plus bas]. Titre original : Pessimismus ? Texte d’abord paru dans les Preussischer Jahrbücher (CLXXXIV, 1921, 73-84) dirigés par le jeune-conservateur Walter Schotte. Il fit ensuite l’objet d’une édition séparée sous forme de brochure (Pessimismus ?, Georg Stilke, Berlin, 1921, Schriftenreihe der Preussischen Jahrbücher 4, 19 p.), avant d’être repris dans les RA (pp. 63-79). EE : Pesimismo ?, pp. 101-116. EA : Pessimism ?, pp. 133-154.
- 10. Dans le pessimisme et l’optimisme, Francis Parker Yockey (op. cit.) verra deux « maladies jumelles de l’âme » (twin soul-diseases).
- 11. François-Auguste Romieu, L’ère des Césars, 2e éd., Ledoyen, 1850
- 12. Gedanken, C.H. Beck, München, 1941, 130 p.
- 13. Oswald Spengler, Aphorisms, Gateway-Henry Regnery Co., Chicago, 1967, préface de William Debbins, traduction de Gisela Koch et Weser O’Brien. Cette édition ne fait pas, en ce qui concerne la numérotation, la distinction graphique entre les pensées inédites et les autres.
- 14. Les “pensées sur le destin” (aphorismes 1-31) et les “pensées sur l’âme humaine” (aphorismes 68-120) ont déjà paru dans la revue Nouvelle école n°33, été 1979, 31-40 [lire plus bas], précédées d’une traduction, par nous-même, de la préface de William Debbins à l’édition américaine [lire sur entrée Spengler].
- 15. Cf. la préface de Julius Evola à l’édition italienne du Déclin de l’Occident (Il tramonto dell’Occidente, Mirnano, 1957).

[Ci-contre : Oswald Spengler en 1917]
Le 8 mai 1936, mourait à Munich l’un des hommes qui ont le plus fait, dans la crise profonde de la défaite allemande, pour maintenir intact le moral de son pays et rendre possible un redressement : celui que nous voyons se développer sous nos yeux. Cet homme est en outre un cerveau de premier ordre, un de ces savants gigantesques — comme il en apparaît quelques-uns au cours de l’histoire de l’Europe, depuis Roger Bacon jusqu’à Vinci, Descartes, Newton, … — sorte de Titan spirituel, sur les découvertes duquel repose, avouée ou non, une grande partie de l’orientation de la pensée contemporaine.
Ce philosophe — puisque les travaux historiques d’Oswald Spengler sont en quelque sorte “enveloppés” dans une philosophie — a été cependant assez peu remarqué en France, dans la période qui a suivi immédiatement la Première Guerre mondiale (1). En Allemagne, son Déclin de l’Occident (Untergang des Abendlandes) a connu un succès sans précédent pour un ouvrage aussi sévère, puisqu’il dépasse aujourd’hui le 110e mille — succès d’actualité, mais également succès de profondeur. Le livre venait “à son heure”, au moment où la défaite semblait contredire les aspirations de la grande majorité des Allemands et les livrer au désespoir ; il leur démontrait, par l’alliance d’une immense érudition et d’une pensée rigoureuse, l’inanité de la philosophie du progrès généralement admise et les voies qu’ils devaient adopter désormais, s’ils voulaient se relever.
Aujourd’hui, les idées de Spengler ont disparu au second plan, dépassées qu’elles sont par la poussée plus apparente des sentiments de race, des mystiques de l’ordre, voire même de la pure apologie de la force. Elles n’en subsistent pas moins dans le domaine intellectuel — face à l’expansion véritablement angoissante du raisonnement matérialiste dans la masse des peuples blancs — comme l’expression profonde et authentique de tous les jeunes mouvements révolutionnaires, de ceux qui ne veulent pas subir la “mécanisation” envahissante, et qui ne la subiront pas. Il serait temps qu’en France, et particulièrement en Bretagne, cet ensemble de découvertes de l’ordre psychologique soit pris à sa juste valeur, que l’âme celtique soit mise désormais, et maintenue irrémédiablement, en face d’un système qui lui est si intimement apparenté et qui, convenablement appliqué, peut faire jaillir son renouveau.
Oswald Spengler est né en 1880, dans la petite ville de Blankenburg-en-Harz. De confession luthérienne, comme un grand nombre de ses compatriotes, il fit des études littéraires et scientifiques très complètes aux grandes Universités de Halle, Munich, Berlin, et il fut reçu docteur en philosophie en 1904 avec une thèse sur l’ancien penseur grec Héraclite d’Éphèse. Il nous raconte lui-même, dans l’Introduction de son grand ouvrage (paragr. 16), comment il fut amené, dans les années qui précédèrent la guerre de 1914, à concevoir toute l’étendue de son système de l’histoire (2). Les approches d’un grand conflit européen ne lui ont pas échappé ; cette marche fatale des événements l’inquiète : « En 1911, étudiant certains événements politiques du temps présent, et les conséquences qu’on en pouvait tirer pour l’avenir, je m’étais proposé de rassembler quelques éléments tirés d’un horizon plus large ». En historien, il tente de comprendre sans parti-pris, de s’expliquer les tendances actuelles à l’aide de son expérience des faits anciens : « Au cours de ce travail, d’abord restreint, la conviction s’était faite en moi que, pour comprendre réellement notre époque, il fallait une documentation beaucoup plus vaste. […] Je vis clairement qu’un problème politique ne pouvait pas se comprendre par la politique même et que des éléments essentiels, qui y jouent un rôle très profond, ne se manifestent souvent d’une manière concrète que dans le domaine de l’art, souvent même uniquement dans la forme des idées. […] Ainsi, le thème primitif prit des proportions considérables ».
L’histoire de l’Europe lui apparaît dès lors sous un jour tout nouveau : « Je compris qu’un fragment d’histoire ne pouvait être réellement éclairci avant que le mystère de l’histoire universelle en général ne fût lui-même tiré au clair. […] Je vis le présent (la guerre mondiale imminente) sous un jour tout différent. Ce n’était plus une figure exceptionnelle, qui n’a lieu qu’une fois, mais le type d’un tournant de l’histoire qui avait depuis des siècles sa place prédéterminée ». Un système s’est fait en son esprit, qui ne lui laisse plus de doutes sur la marche générale de l’histoire — et point seulement celle de notre civilisation européenne : « Plus de doute : l’identité d’abord bizarre, puis évidente, entre la perspective de la peinture à l’huile, l’imprimerie, le système de crédit, les armes à feu, la musique contrapuntique et, d’autre part, la statue nue, la polis, la monnaie grecque d’argent, en tant qu’expressions diverses d’un seul et même principe psychique ». Chaque civilisation suit un cours qui lui est propre, avec une rigueur entière et véritablement impressionnante. Du même coup, il a saisi le sens profond de l’inquiétude de l’homme moderne et il en ressent comme une assurance, délivré qu’il est de ses manifestations multiples et contradictoires :
« Une foule de questions et de réponses très passionnées, paraissant aujourd’hui dans des milliers de livres et de brochures, mais éparpillées, isolées, ne dépassant pas l’horizon d’une spécialité, et qui par conséquent enthousiasment, oppressent, embrouillent, mais sans libérer, marquent cette grande crise. […] Citons la décadence de l’art, le doute croissant sur la valeur de la science ; les problèmes ardus nés de la victoire de la ville mondiale sur la campagne : dénatalité, exode rural, rang social du prolétariat en fluctuation ; la crise du matérialisme, du socialisme, du parlementarisme, l’attitude de l’individu envers l’État ; le problème de la propriété et celui du mariage, qui en dépend. […] Chacun y avait deviné quelque chose, personne n’a trouvé, de son point de vue étroit, la solution unique générale qui planait dans l’air depuis Nietzsche. […] La solution se présenta nettement à mes yeux, en traits gigantesques, avec une entière nécessité intérieure, reposant sur un principe unique qui restait à trouver, qui m’avait hanté et passionné depuis ma jeunesse et qui m’affligeait, parce que j’en sentais l’existence sans pouvoir l’embrasser. C’est ainsi que naquit, d’une occasion quelque peu fortuite, ce livre… Le thème restreint est donc une analyse du déclin de la culture européenne d’Occident, répandue aujourd’hui sur toute la surface du globe ».
Tout l’essentiel de la théorie spenglérienne de l’histoire est exposé en trois tableaux synoptiques, au début du premier tome de son Déclin de l’Occident (3) : on y suit une comparaison systématique du développement, sur 1.000 années environ, des deux civilisations gréco-romaine (Antiquité) et européenne (Occident), du triple point de vue de la pensée abstraite, de l’art et des formes du gouvernement. Il en ressort la notion de l’âge des civilisations : une phase de jeunesse, notre Gothique (Moyen Âge), à laquelle succède la maturité, notre Baroque (Époque Moderne), puis la vieillesse au milieu de laquelle nous vivons (Époque Contemporaine). C’est la même succession des formes doriennes, puis ioniennes, puis « romaines » dans le monde méditerranéen depuis les temps homériques jusqu’à l’avènement d’Auguste. Des parallèles avec ce que nous savons des philosophies hindoues, de l’art égyptien ou des révolutions de l’ancienne Chine confirment cette impression du « cyclisme » de l’histoire humaine.
Le corps même de l’ouvrage n’est qu’une longue et savante justification de ce qui vient d’être avancé : justification métaphysique, en un premier tome, de divers problèmes logiques soulevés par un pareil système ; en particulier celui de la continuité de la notion de Nombre à travers les diverses civilisations ; d’autre part, la définition de l’idée historique du Destin face à la Causalité scientifique… Un second tome renferme la justification érudite de plusieurs des assertions historiques du système : en particulier, l’existence d’une civilisation « arabe » durant le premier millénaire de notre ère, qui est en effet l’époque de floraison des grandes religions universelles de souche « sémitique » (christianisme, manichéisme, islam, judaïsme talmudique) (4). Spengler ne distingue pas moins de huit grandes civilisations qui se sont succédé en divers points du globe jusqu’à nos jours : civilisations égyptienne, mésopotamienne, chinoise, hindoue, gréco-romaine, orientale-arabe, mexicaine et occidentale-européenne, celle que nous vivons encore. Il tend à réserver le nom de « culture » à la période première de ces civilisations, pleine encore de sève et d’invention, pour laisser plus spécialement le nom de « civilisation » à leur phase de dissolution, quand disparaît, dans l’impuissance, tout ce que des ancêtres vigoureux ont créé.
Il ne convient pas de surestimer l’originalité du système : pareil sentiment du cycle, de la fatalité, se retrouve à travers toute la spéculation germanique, voire même européenne, depuis la foi calviniste en la prédestination jusqu’au mythe nietzschéen du « retour éternel ». Et l’ancienne littérature des Celtes d’Irlande n’est-elle pas l’expression la plus absolue de ce sens du destin, héroïquement accepté ? C’est Spengler lui-même qui nous avertit de ce qu’il doit à Nietzsche, dont il a seulement, dit-il, « changé les échappées en aperçus ». De façon plus générale, cette pensée d’historien se rattache à tout le mouvement de spéculation sur le temps, sur la durée, aux diverses “philosophies de la vie” fort en honneur depuis le début du siècle et dont H. Bergson serait, en France, le plus illustre représentant (L’Évolution créatrice). W. Dilthey, en Allemagne, s’était engagé dans des voies similaires dès 1883, par sa curieuse Introduction aux sciences morales. Nombreux ont été les historiens, les ethnologues allemands qui, dans le même temps, se sont efforcés de rechercher les lois de l’histoire universelle d’accord avec les résultats les plus poussés des sciences d’érudition : notons le grand explorateur africain Leo Frobenius, auteur d’un ouvrage fort remarqué (5). À Spengler était réservé, semble-t-il, de les trouver et de les exprimer, pour la première fois, avec une netteté irréfutable (6).
Là réside la nouveauté absolue de l’œuvre, comme sa valeur immense dans le domaine de la pensée non moins que de la pratique. Avant lui, bien des penseurs, depuis Montesquieu, Herder… jusqu’à Hegel et Auguste Comte plus près de nous, s’étaient bien hasardés à esquisser une “philosophie de l’histoire”, très littéraire encore. Karl Marx s’était approché le plus près d’une rigueur scientifique, dans son Capital, lorsqu’il avait bâti toute une interprétation de l’histoire moderne sur la loi du « matérialisme historique ». Heinrich Rickert, voici quelques années, avait, d’autre part, parfaitement défini en logique les conditions et les limites de toute interprétation de l’Histoire. De là au système d’idées absolument clos et, de plus, parfaitement concret, tangible, expérimentable, que forme l’intuition spenglérienne, il y a un monde ! C’est une forme nouvelle de pensée, un instrument nouveau que Spengler met entre les mains des peuples blancs, une exploration dans le domaine du temps : non pas une quelconque magie, il s’agit de possibilités psychologiques nouvelles que dégage aussitôt en nous la conscience de la fin pressante de la civilisation que nous subissons, en particulier celle d’envisager de sang-froid les rapports des diverses nations et races de la planète… La possession de l’histoire entière est mise au service de notre avenir.
Il ne faut voir là rien d’autre que la réplique, à trois siècles de distance, à l’exploration tentée dans les espaces sidéraux par les premiers astronomes munis d’instruments à longue portée. « Une découverte copernicienne sur le terrain de l’Histoire », a-t-on pu dire (voir le § 6 de l’Introduction). Spengler doit ce sens aigu de la relativité des événements à l’intérêt qu’il porte aux civilisations exotiques, non classiques, si souvent négligées par les historiens. Pour lui, une création en vaut une autre : l’architecture de l’ancienne Égypte n’est pas inférieure en subtilité à notre calcul infinitésimal, la vieille morale de Confucius pas moins positive que toute la sophistique rationnelle des socratiques… Il ne craint pas de mettre en parallèle, pour leur rôle moral, le bouddhisme primitif, le stoïcisme antique et notre socialisme contemporain, ni de distinguer soigneusement, dans notre système juridique, l’apport de la « jurisprudence » antique, celui des « codes » impériaux romano-byzantins et le « droit coutumier » de type anglo-normand. Le coup d’œil est devenu sans parti-pris, mais combien plus pénétrant !
Ce n’est pas aujourd’hui encore que sera saisie dans son ampleur la répercussion révolutionnaire de pareilles nouveautés dans le monde des idées, ou — pour parler métaphysique — la possibilité d’ériger désormais en un système viable le monde intuitif des poètes, « l’univers-histoire », en face de « l’univers-nature », du règne de la science, si exclusivement tyrannique encore à l’heure actuelle (l’opposition est esquissée au chapitre 2 du tome I). Mais, au simple contact de ces doctrines, des sentiments confus se réveillent en nous, un monde mystique tend à reparaître, qui dut exister dans la foi du Moyen-Âge et que l’éducation classique de la Renaissance avait peu à peu enfoui. Car enfin, est-ce bien le livre qui a bouleversé le monde d’après-guerre ? Ou n’est-il pas seulement le premier éclat, la première et insolite traduction littéraire de cette résurrection de l’âme du vieux Nord « gothique », voire même païen, qui tend à se faire jour avec la violence d’un élément ? (7).
Le tome I du Déclin de l’Occident parut en 1918 et Spengler en dédiait alors la préface aux armées allemandes, espérant que le livre ne serait pas « tout à fait indigne des sacrifices militaires ». Après l’écroulement, parmi « la misère et le dégoût de ce temps », l’édition de l’ouvrage tout entier (1922) apparut d’abord comme un instrument de combat.
Et une comparaison s’impose ici avec 1806 : comme à cette époque de l’histoire allemande, au milieu de la débâcle et du désarroi des autorités, les intellectuels et les professeurs d’Université restèrent seuls à leur poste de combat, hormis la Reichswehr, dont l’action secrète de redressement s’apparente de près, d’ailleurs, à l’œuvre de Scharnhorst ! Coup sur coup, de 1919 à 1926, développant dans un esprit pratique et immédiat ses perspectives historiques, Spengler donnait une série de brochures d’actualité, réunies par la suite dans le volume de ses Écrits politiques (8). Il y a là, en moins romantique et avec l’assurance d’une expérience mûrie, comme un nouveau Discours à la nation allemande (9).
L’époque est dure, les causes de déclin analysées précédemment commencent à produire des effets alarmants, et non seulement en Allemagne : exemple, la révolution bolchevique. Il est temps que les générations nouvelles soient élevées en rapport avec les vues nouvelles sur le destin de leur nation, c’est-à-dire en soldats, comme furent élevés les Romains en face des Grecs devenus jouisseurs et lettrés.
« Je ne suis pas de cet avis. […] Nous avons à compter avec les faits durs et sévères d’une vie tardive, qui n’a pas son pendant dans Athènes de Périclès, mais dans Rome des Césars. Pour l’Européen occidental, il ne sera plus question d’une grande peinture ou d’une grande musique. Ses possibilités architectoniques sont épuisées depuis cent ans. Il ne lui reste plus que des possibilités extensives. Mais alors, je ne vois pas quel inconvénient il y aurait à informer à temps une génération, active et gonflée d’espérances sans borne, qu’une partie de ses espérances la mènerait à un échec certain. Quand bien même ses espérances lui seraient très chères, celui qui est digne de quelque chose finira par triompher. […] Je considère donc ma doctrine comme une grâce pour les générations futures, car elle leur montre ce qui est possible, et donc nécessaire, et ce qui n’appartient pas aux possibilités du temps. Jusqu’ici, l’on a gaspillé sur de fausses voies une somme inouïe d’esprit et de force. […] Si, sous l’impression de ce livre, les hommes de la génération nouvelle se tournent vers la technique au lieu de la poésie lyrique, vers la marine au lieu de la peinture, vers la politique au lieu de la philosophie, ils auront accompli mon désir » (10).
Ces pages nous mettent dans l’orientation essentielle de la politique spenglérienne, telle qu’on la trouve développée dans ses essais Prussianisme et Socialisme (Preussentum und Sozialismus, 1919), Devoirs politiques de la jeunesse allemande (Politische Pflichten der Deutschen Jugend, 1924), Reconstruction de l’Empire allemand (Neubau des Deutschen Reiches, 1924) : premièrement, faire des hommes, former des caractères trempés qui soient capables d’envisager et de surmonter les difficultés inouïes que l’Histoire annonce. Comme la République, un jour, n’eut plus besoin de savants, l’Allemagne n’a plus besoin de ses poètes, qui pourtant firent son charme et sa célébrité. Car, devant le danger de décomposition qui la menace, et avec elle tous les peuples blancs, l’Allemagne doit montrer l’exemple, serrer les rangs et se raidir dans une attitude militaire, sa seule sauvegarde !
Voilà une brève analyse de conseils beaucoup plus nuancés non moins que solidement établis, et qui vont jusqu’à envisager d’utiliser la solidarité ouvrière, le « socialisme », pour renforcer la discipline prussienne défaillante ! Ne trouve-t-on pas dans ces écrits, quinze ans à l’avance, comme une prévision de l’œuvre entière d’éducation à laquelle s’adonne aujourd’hui le Troisième Reich et qui commença d’être appliquée dès avant, dans l’armée, dans l’industrie ? On ne peut dire qu’elle soit issue entière du cerveau de Spengler : d’autres penseurs, d’autres réformateurs ont travaillé dans le silence à forger la masse idéologique de la nouvelle Allemagne, un Moeller van den Bruck, par exemple, dont le livre Le Troisième Reich a donné sa formule au NSDAP, sans omettre les “racistes”, dont Spengler n’était pas (11). Mais il est certain que, durant cette période de la République de Weimar, notre philosophe, désormais célèbre, se dépensa en conférences, eut des contacts avec de nombreuses personnalités dirigeantes et, s’il n’adhéra jamais à aucun des partis nationalistes, il mit toute son autorité au service de leurs idées.
On retrouvera sa pensée politique, plus nette encore, sinon plus, durement exprimée, dans un dernier ouvrage, paru en juillet 1933 : Les années décisives (Jahre der Entscheidung, 1933). Nouveau livre « occasionnel », nouveau succès de librairie, qui dépasse aujourd’hui le 160e mille. Pour Spengler, l’Allemagne est « en danger » (in Gefahr), elle n’a pas cessé de l’être, même après l’avènement du gouvernement national-socialiste, cependant désiré par lui de toutes ses forces. Et tout le livre — qui attend un deuxième tome — est bâti en forme de conseils d’un « ancien » à ses jeunes héritiers, de l’inexpérience desquels il se méfie. Spengler craint de n’avoir pas été compris dans le fond de sa pensée d’historien, de ne l’avoir été que superficiellement, et il le dit à plusieurs reprises : « Voilà ce que j’ai dit et ce que j’ai écrit, non pour l’instant présent, mais pour l’avenir. Je vois plus nettement que d’autres parce que je pense de façon indépendante, libre des partis, des tendances et des intérêts » (préface des Écrits politiques). Toute la préface de l’édition française sera à lire pour bien comprendre la rigueur de son sens politique, nourri des enseignements des anciennes classes dirigeantes (12). Livre passionnant, non moins par la violence calculée de la forme que par la vue pénétrante, prophétique, et « sans rémission », de l’évolution des vingt ou cinquante années à venir (13).
On ne peut songer, dans cet article, à donner même un aperçu de l’ouvrage. Les jugements émis sur la France sont particulièrement impitoyables et caricaturaux, sur les hommes politiques allemands aussi. Qu’il nous soit permis de noter ici que Spengler se fonde sur les postulats dégagés au cours de ses précédents essais : distinction de deux types psychologiques de l’homme du Nord, l’un tourné vers le commerce, de sens pratique, d’esprit démocrate, « anglais » de préférence et qui a dominé jusqu’ici, l’autre que l’on peut appeler « continental », « prussien », qui est plus rustique, d’âme essentiellement militaire et chevaleresque. Autre postulat : la Russie ne doit pas être considérée comme faisant partie de l’Europe, elle est même probablement l’amorce d’une nouvelle grande civilisation à venir, non européenne celle-ci, qui s’étendra sur les plaines du nord de l’Eurasie ; malgré les apparences ultra-modernes, rien de ce qui s’y élabore ne doit être jugé avec nos habitudes d’esprit occidentales ; songez plutôt à Dostoïevski (14). La crise économique enfin : l’étude des causes de la catastrophe de l’économie libérale, comme aussi de la révolution prolétarienne, forme le corps principal de l’ouvrage et elle est menée sans le désir de plaire spécialement aux idées reçues sur « le rôle de l’ouvrier dans la société moderne » !
Nous retiendrons pour nous les conclusions : « L’Allemagne est le foyer du monde, non seulement à cause de sa situation géographique, mais encore parce que les Allemands sont assez jeunes pour se sentir profondément touchés par les problèmes du devenir mondial, pour les formuler et les trancher ; tandis que les autres peuples sont devenus trop vieux et trop raides pour leur opposer autre chose qu’une vague résistance ». Mais comment cette nation, en perpétuel chaos, sera-t-elle à même de « devenir l’éducatrice du monde blanc » ? Sans doute une riposte s’est-elle dessinée déjà pour surmonter la révolution grandissante ; elle a nom le fascisme : celui-ci est tout entier la création personnelle d’un l’homme, Mussolini, le seul grand chef politique de l’Europe actuelle (15).
Mais il faut voir plus à fond et plus loin. Les faits de l’Histoire marchent vite. Et il ne faut point se laisser prendre aux apparences, aux mœurs et habitudes démocratiques qui survivent, même à l’intérieur du fascisme.
« Voilà pourquoi ce seront les armées et non les partis qui constitueront la forme du pouvoir à l’avenir, armées d’un dévouement sans bornes, telles que Napoléon n’en avait plus depuis Wagram ». Seul compte, en définitive, et comptera de plus en plus, l’esprit guerrier, le dévouement inébranlable à un chef reconnu et suivi. Suit une définitive reprise et plutôt heurtée de I’esprit prussien, considéré comme « abnégation par décision libre ; c’est la soumission d’un Moi fort à un grand devoir ou à une grande mission ; c’est un acte de la maîtrise de soi. […] L’esprit prussien est un esprit très aristocratique, dirigé contre toute sorte de majorité et contre le règne de la plèbe, et surtout contre les qualités grégaires : parler peu, travailler beaucoup, être plus que paraître ».
Il faut aux peuples blancs « une éducation que j’appelle prussienne, une éducation qui réveille la force endormie par un exemple vivant, non pas une école, ni le savoir, ni l’instruction, mais une discipline morale qui fasse remonter à la surface ce qui existe encore, qui le fortifie et le mène à un épanouissement nouveau. Nous ne pouvons nous permettre d’être fatigués ». Et quoi donc fait en définitive le fond de cet esprit prussien, en lequel Spengler ne voit d’ailleurs pas le privilège exclusif du peuple allemand ? Ce fond, c’est l’individualisme, la solitude grandiose des âmes fortes devant le monde. « Il existe un sentiment nordique du monde, plein de joie justement à propos de l’amertume de la destinée humaine. […] La race celte-germanique est la race la plus volontaire que le monde ait jamais connue. Mais ce “je veux” — je veux — qui remplit l’âme faustienne jusqu’aux bords, a éveillé la conscience de la solitude complète du Moi dans l’espace infini. Volonté et solitude sont, au fond, une seule et même chose ». L’âme des grands féodaux de jadis n’est pas morte, et elle peut être ranimée. « L’homme politique du Nord en a conçu un immense dépit envers la réalité. "Tu as confiance en ton épée plus qu’en Thor", lit-on dans une saga islandaise. Si quelque chose dans le monde peut s’appeler individualisme, c’est bien ce dépit d’un seul contre le monde entier, cette conscience de sa propre volonté inflexible, la joie des décisions ultimes et l’amour du destin, même à l’instant où l’on est brisé par lui. Et prussienne est la soumission par volonté libre ». Pour terminer, l’appel classique de l’Allemagne à la victoire militaire : « Le césarisme de l’avenir ne persuadera point, il vaincra par les armes ».
On saisit toute la différence entre cette âme froissée, mais restée conquérante, et notre barbarie proprement celtique. D’ailleurs, le rôle latent des populations de race celtique à travers l’Europe est laissé dans l’ombre, la possibilité du réveil d’un sentiment religieux propre aux peuples du Nord est volontairement négligé, si ce n’est quelques allusions voilées au christianisme, au renoncement à l’idéal batailleur (16).
Ne nous bornons point là. Laissant les écrits politiques de Spengler, il nous faut reprendre l’élaboration de son travail philosophique à partir de l’ouvrage initial. Les critiques n’avaient pas manqué, d’ailleurs, surtout de la part des historiens, et ce n’est pas dans l’unanimité que fut reçue l’hypothèse du « déclin de l’Occident », faute d’avoir été exactement saisie, voire surtout ressentie, par des hommes d’une formation purement académique. D’autre part, Spengler, développant sa découverte, fut amené à concevoir le plan d’une grande Histoire de l’Homme depuis ses origines qui fut en réalité une gigantesque histoire de l’âme humaine, du développement psychologique à partir de l’animalité, en même temps qu’une réplique aux vues plus ou moins matérialistes de ses détracteurs. C’est de cette œuvre en chantier que plusieurs fragments ont été détachés par l’auteur, dans la fièvre d’événements de ces dernières années.
D’abord, un opuscule intitulé : L’Homme et la technique, contribution à une philosophie de la vie et paru en 1931 (17). C’est le plan même de l’ouvrage ; l’histoire de l’espèce n’y est plus considérée des hauteurs un peu dédaigneuses de l’éducation humaniste comme histoire du développement intellectuel et moral ; elle serait plutôt dégagée à même les processus inférieurs de la vie, plante, animal, etc. : quelle est la signification profonde de la technique — outil primitif aussi bien que machine moderne — entre les mains de l’espèce Homme ? Question jamais envisagée sous cet angle, ni surtout dans ses conséquences dernières, quoique la philosophie bergsonienne l’ait déjà soulevée et traitée en plusieurs de ses aspects, par exemple le problème de l’outil (18).
L’ensemble du livre est bâti sur ce thème. La qualité du style, la précision des formules y rachètent ce qu’il y a d’excessivement bref dans l’exposé. Pour résumer — et quelque peu simplifier — disons que l’ensemble de l’histoire humaine, surtout de l’homme civilisé, forme un grand cycle : sur un fond de primates encore carnassiers, les premiers chasseurs néandertaliens, l’Homme apparaît brusquement au Néolithique, capable d’entreprises et de constructions, et ceci par le fait d’une véritable découverte. C’est l’invention du langage, cette liaison auditive dont la nature n’a jamais été élucidée puisqu’elle est inséparable du fait de la vie en société ; de là le sens religieux qui reste lié à son acquisition, à sa diffusion, le problème de ses origines. […] C’est le temps des débuts de la monarchie thinite (Égypte) et de Sumer (Chaldée), vers 3000 avant Jésus-Christ. Depuis, le rythme de la grande histoire se précipite : après une sorte de culmen, période harmonieuse de la civilisation « raisonnable » (Antiquité gréco-romaine) et des grandes religions « spiritualistes » (bouddhisme, christianisme, islam), voici surgir une nouvelle culture, combien plus gigantesque mais fragile également. Dépassant la sagesse des rationalistes, c’est une nouvelle espèce d’hommes que l’on voit, dès les cloîtres du Haut Moyen-Âge, s’attaquer à l’exploration du monde de la nature dans le but dernier de se l’assujettir ; ces hommes peuvent être dits des « pirates de l’esprit » (Wikinger des Geistes) ! « Penser non pas dans l’intention d’obtenir une simple théorie, une image de ce que l’on ne connaît pas, mais rendre les secrets du monde extérieur soumis à des buts définis ». Non plus le simple pillage de la matière anorganique, mais son jugulement intime, dans ses forces, afin de s’en servir. Comme critérium unique : l’expérience. « Déjà, Roger Bacon et Albert le Grand ont médité sur les machines à vapeur et les aéronefs. Et beaucoup s’ingéniaient dans leurs cellules de moines autour de l’idée du mouvement perpétuel » (19).
Spengler affirme que nous vivons actuellement la fin de cette culture. Il aperçoit une série de faits alarmants : l’homme d’Occident est dépassé par son invention propre, la mécanique. Il ne la contrôle plus. Il y a des symptômes très nets d’une mécanisation excessive de l’existence en même temps qu’une fêlure fondamentale dans le gigantesque édifice de la civilisation industrielle. Même la lassitude est venue de la machine, chez ceux qui seraient, par contre, supérieurement doués. L’espèce sera-t-elle assez puissante pour se créer, ailleurs, une autre forme de vie, une dernière culture ? Spengler n’ose en être sûr.
De toute façon, nous, Occidentaux, devons vivre notre destin tel qu’il est — il est lâche de chercher à ne pas voir, et cela reste d’ailleurs entièrement sans effet —, nous devons le vivre, héroïquement : « Nous sommes nés en ce temps et devons courageusement achever le parcours qui nous est destiné. Il n’y en a pas d’autre. Persévérer aux avant-postes, sans espoir de salut, c’est le devoir. Tenir, comme ce soldat romain dont les ossements ont été trouvés devant une porte à Pompéi, lequel mourut parce que, lors de l’éruption du Vésuve, on avait oublié de le relever de sa garde. Cela est la grandeur, cela s’appelle avoir de la race. Cette fin honorable est l’unique chose qui ne puisse être enlevée à l’homme » (20).
Et ce n’est point tout. Il n’y a pas lieu de rester sur ces visions d’Apocalypse. Nous sommes en 1934. Dans l’Allemagne, désormais redressée, le philosophe s’est remis à ses travaux historiques. Nous indiquerons ici un long article d’érudition intitulé : Tartessos et Alaschia, traitant de l’histoire du deuxième millénaire avant notre ère, principalement de la Crète de Minos (21). Il est l’aboutissement d’un essai projeté sur les « Pré-cultures », sur la phase d’origine des grandes civilisations… Comme Bretons, il nous intéresse particulièrement par ce qu’il nous apprend des recherches de Spengler sur la préhistoire de l’Europe.
Fidèle à sa méthode d’histoire psychologique, l’auteur esquisse deux attitudes de vie qu’il estime fondamentales chez les « Barbares hyperboréens » : d’une part, le sentiment qu’il appelle « occidental », qui est celui des constructeurs des mégalithes et qui se caractérise par le culte des morts. Les affinités sont indéniables avec l’Égypte pharaonique. Malgré leur âme pacifique, ces gens nous ont légué plusieurs inventions audacieuses, en particulier le navire de haute mer. D’un autre côté, le sentiment « nordique », ou « continental » : c’est celui des peuples nomades des grandes plaines eurasiatiques, monteurs de chars. C’est une morale de guerriers, qui ne connaissent que la mort brutale sur le champ de bataille. Par contre, ils ont développé l’abstraction, qui s’exprime déjà dans l’ornementation toute spiralique et géométrique de leur matériel. Ce fond psychologique est très ancien, bien antérieur à toutes les connaissances proprement historiques sur les Celtes et sur les Germains. On remarquera qu’un des sentiments est voisin de celui de l’Église catholique, tandis que l’autre serait plus conforme à l’esprit de la Réforme protestante. Spengler gardait en notes un essai de Métaphysique. Cependant, le sentiment de son éloignement d’avec les jeunes générations le minait, comme aussi la somme d’efforts dépensée depuis des années. Il est mort solitairement, méconnu par beaucoup, presque oublié par d’autres, à l’âge de 56 ans… Fin attristante pour un homme de ce renom, mais très en rapport aussi avec la conduite d’une existence tout entière marquée d’un caractère tragique.
► Article de Roger Hervé paru sous le pseudonyme R. Glémarec dans la revue Stur n°11, oct. 1937, pp. 15-30 (partie 1 - partie 2). Repris dans la brochure : Actualité de Spengler, CEF, 1983.
 ♦ Sur l’auteur : Roger Hervé, agrégé de l’Université, ancien assistant au Musée ethnographique du Trocadéro, conservateur honoraire à la Bibliothèque nationale, est décédé fin novembre 1997 à Paris, à l'âge de 93 ans. Il appartenait depuis de longues années au comité de patronage de Nouvelle École. Il était né en 1904 au Havre, de père breton et de mère flamande, dans une famille de fonctionnaires des finances. Il avait fait ses études à la faculté des lettres de Rennes à partir de 1921, et avait passé son agrégation d'histoire et géographie en 1926. Il fut successivement professeur aux lycées de Brest, Amiens, Saint-Brieuc, ainsi qu’à Pontivy, où il se lia avec l’écrivain normand Fernand Lechanteur. Proche d’Olier Mordrel, Franz Debauvais et Yann Poupinot, il participa dans les années 30 aux activités du mouvement breton, sur lequel il exerça une forte influence d'ordre culturel à partir de 1937. Il publia notamment, sous les pseudonymes de Glémarec et Katuvolkos, plusieurs articles de fond dans les revues Stur et Nemeton. Nommé en 1969 conservateur à la Bibliothèque nationale, il y joua un rôle particulièrement important au département des cartes et plans. Il publia notamment plusieurs études sur des cartographes anciens, dont Nicolas de Nicolay, et sur les plans des forêts de Colbert. On lui doit aussi le Catalogue des cartes géographiques sur parchemin conservées au département des cartes et plans (Bibliothèque nationale, 1974), ainsi qu'un travail faisant suite à l'étude critique des cartes dieppoises et apparentées, Découverte fortuite de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande par des navigateurs portugais et espagnols entre 1521 et 1528 (éd. du CTHS, 1982), ouvrage dont une traduction anglaise a paru en Nouvelle-Zélande en 1983. Il fut également le coauteur, avec Yann Poupinot, de l’Atlas historique de la Bretagne, dont la plus récente édition a paru chez J.M. Willamson en 1995. Devenu presque aveugle à la fin de sa vie, Roger Hervé avait travaillé pendant près d’un demi-siècle à un vaste projet de livre consacré à l’œuvre d’Oswald Spengler, dont il se proposait d’actualiser les vues concernant la morphologie des grandes cultures historiques. L'ouvrage devait s’intituler L’histoire et les théories cycliques et comprendre deux volumes (Oswald Spengler et la pensée contemporaine, Quelques précisions de temps et de lieux). Ce projet n'a malheureusement jamais pu être mené à bien. Roger Hervé en avait esquissé les grandes lignes dans une brochure intitulée Actualité de Spengler, publiée en 1983 par le Cercle d’études fédéralistes. (Alain de Benoist, Nouvelle École n°51, 2000)
♦ Sur l’auteur : Roger Hervé, agrégé de l’Université, ancien assistant au Musée ethnographique du Trocadéro, conservateur honoraire à la Bibliothèque nationale, est décédé fin novembre 1997 à Paris, à l'âge de 93 ans. Il appartenait depuis de longues années au comité de patronage de Nouvelle École. Il était né en 1904 au Havre, de père breton et de mère flamande, dans une famille de fonctionnaires des finances. Il avait fait ses études à la faculté des lettres de Rennes à partir de 1921, et avait passé son agrégation d'histoire et géographie en 1926. Il fut successivement professeur aux lycées de Brest, Amiens, Saint-Brieuc, ainsi qu’à Pontivy, où il se lia avec l’écrivain normand Fernand Lechanteur. Proche d’Olier Mordrel, Franz Debauvais et Yann Poupinot, il participa dans les années 30 aux activités du mouvement breton, sur lequel il exerça une forte influence d'ordre culturel à partir de 1937. Il publia notamment, sous les pseudonymes de Glémarec et Katuvolkos, plusieurs articles de fond dans les revues Stur et Nemeton. Nommé en 1969 conservateur à la Bibliothèque nationale, il y joua un rôle particulièrement important au département des cartes et plans. Il publia notamment plusieurs études sur des cartographes anciens, dont Nicolas de Nicolay, et sur les plans des forêts de Colbert. On lui doit aussi le Catalogue des cartes géographiques sur parchemin conservées au département des cartes et plans (Bibliothèque nationale, 1974), ainsi qu'un travail faisant suite à l'étude critique des cartes dieppoises et apparentées, Découverte fortuite de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande par des navigateurs portugais et espagnols entre 1521 et 1528 (éd. du CTHS, 1982), ouvrage dont une traduction anglaise a paru en Nouvelle-Zélande en 1983. Il fut également le coauteur, avec Yann Poupinot, de l’Atlas historique de la Bretagne, dont la plus récente édition a paru chez J.M. Willamson en 1995. Devenu presque aveugle à la fin de sa vie, Roger Hervé avait travaillé pendant près d’un demi-siècle à un vaste projet de livre consacré à l’œuvre d’Oswald Spengler, dont il se proposait d’actualiser les vues concernant la morphologie des grandes cultures historiques. L'ouvrage devait s’intituler L’histoire et les théories cycliques et comprendre deux volumes (Oswald Spengler et la pensée contemporaine, Quelques précisions de temps et de lieux). Ce projet n'a malheureusement jamais pu être mené à bien. Roger Hervé en avait esquissé les grandes lignes dans une brochure intitulée Actualité de Spengler, publiée en 1983 par le Cercle d’études fédéralistes. (Alain de Benoist, Nouvelle École n°51, 2000)- 01. On lira cependant l’excellent ouvrage d’André Fauconnet : Un philosophe allemand contemporain : Oswald Spengler, le prophète du “déclin de l’Occident”, Paris, Alcan, 1925 [recension]. Il analyse clairement la première série des écrits du philosophe et est fort apprécié jusqu’en Allemagne. De même : E. Vermeil, Doctrinaires de la révolution allemande, 1918- 1938, Paris, Sorlot, 1939, livre 1, chap. 2, pages 81-126 : la construction d’Oswald Spengler.
- 02. Voir pages 89-95 du tome 1 de l’édition française.
- 03. Traduction française de M. Tazerout : Le déclin de l’Occident : Esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, Paris, Nouvelle revue française, Bibliothèque des idées, 1931-1933, 2 tomes en 5 volumes.
- 04. Tome 1 : Forme et réalité, 665 p. Tome II : Perspectives de l’histoire universelle, 771 p.
- 05. Paideuma (1921). C’est une démonstration savante de la réalité de I’« âme collective » des civilisations, même actuelles.
- 06. On trouvera une critique de la théorie spenglérienne du cycle, critique qui ne dépasse pas des objections très superficielles, du point de vue rationaliste, par H. Sée : Science et philosophie de l’Histoire, Paris, Alcan, 1928, p. 172 ; du point de vue catholique, par Ch. Dawson : Progrès et religion, Paris, Plon, 1935, pages 29 et suivantes.
- 07. Spengler avoue lui-même le caractère profondément nécessaire de sa doctrine et de son livre : « Car il ne s’agit pas d’une philosophie possible à côté d’autres, mais de la philosophie, en quelque sorte naturelle, obscurément pressentie par tous. Cela soit dit sans vantardise. Une pensée d’une nécessité historique, par conséquent qui ne tombe pas dans une époque, mais qui fait époque, n’est que dans une mesure restreinte la propriété de celui à qui échoit son droit d’auteur. Elle appartient au temps tout entier » (préface de la première édition).
- 8. En allemand : Politische Schriften, publié à Munich, chez C.H. Beck, 1933.
- 09. Le manifeste lancé en 1810 par le philosophe Fichte, alors professeur à l’Université de Berlin, a grandement contribué à soulever les esprits contre la domination napoléonienne.
- 10. Conseil s’appliquant à l’Allemagne ; il serait moins juste à propos de la Bretagne, qui n’a pas encore donné sa grande floraison, qu’elle soit littéraire-artistique, voire mystique-religieuse.
- 11. Sur le mouvement intellectuel qui a soutenu le Troisième Reich, se reporter à l’ouvrage de A. Decléene : Le règne de la race , Éditions Fernand Sorlot, Paris, 1936, et au compte rendu qui en est donné dans Stur n° 7-8, p. 108.
- 12. Traduction française de R. Hadekel : Années décisives : L’Allemagne et le développement historique du monde, Paris, au Mercure de France, 1934 (rééd. par A. de Benoist, Paris, Copernic, 1980).
- 13. Voir, page 39, le paragraphe Grandeur de l’époque : « Car nous vivons dans une grandiose époque. Toute la civilisation de l’Occident n’en a jamais connu, ni n’en connaîtra de pareille : c’est celle que le monde antique a connue dans l’intervalle entre Cannes et Actium. […] La forme du monde sera de nouveau bouleversée de fond en comble, comme jadis au début de l’Empire romain. […] L’époque est immense, mais les hommes n’en sont que plus petits ».
- 14. Sur le monde russe, voir pages 95-98.
- 15. Sur la nature du fascisme, voir pages 249-256.
- 16. Voir surtout pages 41-42. On lira à ce sujet mon essai complémentaire : R. Glémarec, « Le mythe celtique enchanté », dans Stur n°14, Quimper, t. V, juil.-sept. 1938, pp. 19-43 (version allemande : « Vom Keltischen Mythos », dans Germanien, n°9, t. XIV, sept. 1942, pp. 301-312).
- 17. En allemand : publié à Munich, chez C.H. Beck, 1931. Traduction française par A. Petrowski, Gallimard, 1958.
- 18. Cf. Évolution créatrice (1908), opposition de Homo Faber et de Homo Sapiens.
- 19. Voir paragraphe 11, dans le chapitre : « Essor et chute de la culture mécanique ».
- 20. Paragraphe final du livre.
- 21. Paru en allemand dans le recueil de ses Discours et articles (Reden und Aufsatze), Munich, C.H. Beck, 1938, qui renferme aussi le texte de sa dissertation sur Héraclite. Consulter pages 163-166, 179-182, 216-220 (traduction française partielle comme Écrits politiques et philosophiques, publiée par A. de Benoist, Paris, Copernic, 1980).
[Habillage musical : Oda-Relicta - Ave Ploughman Lauriferi, 2007]
Crise ou déclin de l'Occident ?
 Le Déclin de l'Occident d’Oswald Spengler publié en Allemagne en 1918 et 1922 (la traduction française date de 1931), y remporta « le plus grand succès qu'un livre de philosophie historique ait connu (…) depuis Gibbon » (1). L'histoire y était, en effet, traditionnellement confinée dans les universités, où elle faisait l'objet de monographies savantes dont l’érudition, le pédantisme et la technicité ne pouvaient que rebuter le grand public. Très critique à l’égard des méthodes universitaires, Spengler présentait au contraire à celui-ci une vaste fresque historique, écrite avec talent par un poète et un visionnaire, capable de mettre à sa portée son immense culture et de lui faire partager sa passion pour l'Histoire ; et qui, de plus, traitant de thèmes en vogue dans les années 20, répondait admirablement à ses préoccupations.
Le Déclin de l'Occident d’Oswald Spengler publié en Allemagne en 1918 et 1922 (la traduction française date de 1931), y remporta « le plus grand succès qu'un livre de philosophie historique ait connu (…) depuis Gibbon » (1). L'histoire y était, en effet, traditionnellement confinée dans les universités, où elle faisait l'objet de monographies savantes dont l’érudition, le pédantisme et la technicité ne pouvaient que rebuter le grand public. Très critique à l’égard des méthodes universitaires, Spengler présentait au contraire à celui-ci une vaste fresque historique, écrite avec talent par un poète et un visionnaire, capable de mettre à sa portée son immense culture et de lui faire partager sa passion pour l'Histoire ; et qui, de plus, traitant de thèmes en vogue dans les années 20, répondait admirablement à ses préoccupations.Les historiens de profession, en revanche, non seulement en Allemagne mais également à l'étranger — et plus particulièrement en France (2) — se montrèrent scandalisés par le non-conformisme et le manque de sérieux d’un auteur qui avait l'audace de traiter d'un sujet aussi ambitieux, sans faire partie du sérail (Spengler avait fait des études de sciences naturelles), et, qui plus est, en se moquant des méthodes et des conventions universitaires. Les libéraux et les marxistes (qui n'admettaient pas sa critique de l'idée de progrès et son mépris pour la démocratie et/ou l’économie), ainsi que les chrétiens (hostiles à une philosophie déterministe méconnaissant la primauté et la liberté de la personne) se rangèrent également du côté des détracteurs de Spengler.
Les nazis (3) qui, dans les années 20, avaient partagé l'engouement de leurs compatriotes pour Le Déclin de l'Occident, dans lequel ils retrouvaient des thèmes qui leur étaient chers — nous y reviendrons plus loin — se montrèrent beaucoup plus réservés au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient du pouvoir, le fatalisme et le pessimisme de l'auteur se révélant difficilement compatibles avec l'idéologie d'un parti qui prétendait changer l'Allemagne et le monde et s'efforçait pour cela d'obtenir l'adhésion et la collaboration enthousiastes des masses. La rupture intervint peu après la prise du pouvoir, les vainqueurs ne pouvant pardonner à Spengler les critiques acerbes qu'il leur avait adressées dans son dernier ouvrage, Les Années décisives (1933), où il écrivait notamment : « Ce qui promettait au début de grandes choses, finit dans la tragédie ou la comédie » (4).
Malgré les réticences ou l'hostilité de ces différents milieux, Le Déclin de l'Occident eut un grand retentissement sur l'intelligentsia européenne de l'entre-deux-guerres, inspirant notamment à P. Valéry sa fameuse apostrophe : « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles » (5). Le redressement et l'essor spectaculaires des pays occidentaux, au cours des Trente Glorieuses, ainsi que le discrédit des philosophies de l'histoire héritées du XIXe siècle, ont contribué à détourner le public de cette œuvre pourtant importante. Aussi nous a-t-il semblé opportun de lui consacrer un article, dans la mesure où la crise actuelle révèle rétrospectivement la pertinence, voire le caractère prophétique du diagnostic effectué au début du siècle par Spengler.
Pour en convaincre nos lecteurs, nous n'insisterons pas sur sa philosophie déterministe et organiciste, qui apparaît aujourd'hui comme l'aspect le plus contestable de sa pensée, préférant centrer notre exposé sur sa description des symptômes du déclin de la culture occidentale, afin de les confronter à l'analyse fédéraliste de la crise. Cependant, il nous paraît nécessaire, au préalable, de définir les grandes lignes de la méthode qu'il utilise pour ses recherches, ainsi que les concepts-clés sur lesquels elle s'appuie.
I. Prolégomènes méthodologiques
◘ 1. Une “morphologie de l'histoire universelle”
Le Déclin de l'Occident a pour sous-titre : Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle (6). Spengler insiste sur l'originalité d'une telle entreprise. Jusque-là, sous le couvert d'histoire universelle, on brossait une fresque « ptolémaïque » de l'univers : des « millénaires d'histoire la plus grandiose et des cultures gigantesques » gravitaient autour de l'axe immobile de l'Europe occidentale, éclairés par la lumière de ce « soleil central » ; aussi expédiait-on l'étude de ces cultures satellites en quelques pages ou chapitres, pour se consacrer à la seule qui soit vraiment importante, la nôtre. Cette conception européocentriste s'articulait sur un schéma temporel à la fois simpliste et faux : “Antiquité — Moyen-Âge — Temps modernes”, schéma inspiré par la croyance au progrès, à l'unité et à la continuité des cultures, et qui tendait à prouver la suprématie de la civilisation occidentale (I, 28, 216).
Ayant consacré lui-même des années de son existence à étudier les grandes cultures (gréco-latine, égyptienne, chinoise, indienne, arabe, mexicaine et occidentale), Spengler affirme leur hétérogénéité fondamentale et la discontinuité de l'histoire (I, 176 ; II, 7). Il lui semble pourtant que celle-ci comporte « un nombre de formes phénoménales limité, que les âges, les époques, les situations se renouvellent par type » (I, 16). C'est à partir de cette intuition qu'il conçoit son projet ambitieux. Accordant à chaque culture sa spécificité et une importance égale, renonçant à l'histoire linéaire et chronologique, qui débouche sur une juxtaposition de monographies, il choisit une méthode comparative, de caractère symchro-diachronique, afin d'étudier les cultures les unes par rapport aux autres, en confrontant perpétuellement les différentes étapes de leur développement et leurs réalisations caractéristiques (artistiques, philosophiques, politiques, etc.).
Dans une première partie, intitulée Forme et réalité, il se penche sur le « langage formel des grandes cultures » (système des nombres, conception de l'histoire et du cosmos, production artistique, philosophique et scientifique) pour en dégager « les fondements d'une symbolique ». Celle-ci est recherchée à la fois dans les rapports existant entre ces différents langages à l'intérieur d'une même culture (par ex. entre le système des nombres, l'organisation économique et les rites mortuaires de l'ancienne Égypte) et les rapports qui peuvent être établis entre chacun de ces langages et les cultures qui l'ont utilisé (par ex. entre le drame antique et la tragédie classique, ou entre l'architecture des pyramides et celle des églises gothiques). Dans une 2ème partie intitulée Perspectives sur l'histoire universelle, il part « des faits de la vie réelle » (tels que les villes, les peuples, l'État, les classes sociales, l'argent et la machine) afin de tirer de l'étude des pratiques humaines des enseignements permettant de mieux assumer l'avenir qui nous est réservé (I, 62).
◘ 2. Définition des concepts : culture et civilisation
Se réclamant de la conception organiciste de l'Univers des romantiques allemands, notamment de Goethe (I, 37, 60), Spengler définit la culture comme « la langue par laquelle une âme peut dire ce qu'elle ressent », comme le « corps mortel et périssable de cette âme, rendue sensible dans les faits et les œuvres » (I, 178). On peut donc dire que, grosso modo, il appelle culture ce qu'on désigne en français par le terme de civilisation, c’est-à-dire la société envisagée dans ses différents aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. C'est le sens que nous donnons nous-mêmes à ce terme, considérant la culture comme l'un des secteurs constitutifs d'une civilisation. Les cultures étant assimilées par Spengler à des organismes (I, 112), leur évolution parcourt les mêmes phases que celle de l’être humain : « chacune a son enfance, sa jeunesse, sa maturité et sa vieillesse » (I, 115) ; phases qui équivalent également aux quatre saisons de la nature.
De plus, chaque culture et chacune des étapes de son développement « a une durée déterminée, toujours la même » : sa longévité est approximativement de mille ans ; celle-ci se décompose à son tour en périodes tricentenaires (c'est le temps que durent le baroque et l'ionique, la plastique attique, la mécanique galiléenne ou le contrepoint), qui comportent elles-mêmes des cycles de 50 ans — la durée de deux générations — correspondant au « rythme du devenir politique, social, artistique » (I, 117). Spengler se rallie autrement dit à la théorie des cycles, formulée à la même époque par les économistes, mais dont il étend la validité à la société toute entière. Les cultures comportent toutes un nombre limité d'expressions nouvelles : quand « la quantité totale des possibilités intérieures s'est réalisée au dehors, la culture se fige brusquement (…). Ses forces se brisent — elle devient civilisation » (I, 114). Si bien que « chaque culture a sa propre civilisation » qui représente son « destin inévitable ».
Envisagée dans cette perspective, « la civilisation pure, en tant que fait historique, consiste dans une exploitation graduelle des formes devenues anorganiques et mortes ». Elle constitue autrement dit l'expression ultime et pétrifiée d'une culture. Spengler précise, à titre d'exemple, que « le passage de la culture à la civilisation s'accomplit dans l'antiquité au IVe siècle, en Occident au XIXe siècle » (I, 43-44). De plus, il souligne incidemment le fait trop souvent négligé par ses critiques, que le déclin de l'Occident, dont les « premiers symptômes » sont d’ores et déjà perceptibles, ne se produira qu'« aux premiers siècles du prochain millénaire » (I, 114).
Il est donc beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la pertinence de ses prévisions. Nous verrons d'ailleurs qu'il semble parfois les oublier lui-même quand il analyse les manifestations actuelles de ce déclin futur. L’ambiguïté provient du fait qu'il existe logiquement pour lui deux déclins, bien qu'il n'ait pas formulé clairement cette idée : d'abord celui des cultures puis celui des civilisations qui leur succèdent. Or, ce qu'il prétend lui-même étudier, ce n'est pas le déclin de l'Occident (comme le suggère malencontreusement le titre de son ouvrage), mais le « déclin de la culture européenne d'Occident, répandue aujourd'hui sur toute la surface du globe » (I, 62), déclin achevé au XIXe siècle ; ainsi que les caractéristiques de la civilisation établie sur ses décombres. Il y a donc lieu de regretter le manque de rigueur dont Spengler fait preuve dans la définition des concepts et des postulats utilisés pour ses recherches. Les termes de crise et de déclin prêtent également à confusion.
Crise et déclin
Spengler ne distingue pas, comme nous le faisons, crise et décadence ; deux allusions à la « grande crise du présent » (I, 46, 60) permettent toutefois de penser que, tout en faisant implicitement cette distinction, il a négligé de la formuler. Le déclin étant pour lui la « fin qui menace toutes les cultures vivantes », et à laquelle elles ne sauraient échapper, lui apparaît comme un accomplissement plutôt que comme un naufrage ou une catastrophe (7) ; en tant que tel, il doit être accueilli avec lucidité et courage, ou mieux encore avec l'enthousiasme que devrait susciter l'amor fati (I, 114).
Contrairement à Spengler, nous estimons nécessaire d'éviter la confusion, fréquente de nos jours, entre crise et déclin. Pour faire comprendre ce que signifie le terme de crise, appliqué à une société, nous partirons des postulats suivants.
Toute société constitue un système, c'est-à-dire un ensemble de structures (i), fonctions (ii), normes (iii) et forces (iv) liées par des rapports complexes d'interdépendance assurant, en temps normal, son « équilibre ». Équilibre qui n'est pas statique mais dynamique, dans la mesure où les systèmes sociaux sont dotés des propriétés de tous les organes vivants, c'est-à-dire des facultés d'auto-conservation (i), d'auto-apprentissage (ii), d'auto-régulation (iii) et d'auto-transformation (iv) (8). L'équilibre, par-là même, est nécessairement précaire, de même d'ailleurs que le déséquilibre : ils représentent des tendances plutôt que des États. En vérité, le seul « équilibre » positif, souhaitable, fécond, est un déséquilibre maîtrisé.
Les réflexions qui précédent, notamment la dernière, sont d'une importance décisive, car elles révèlent la nature essentiellement conflictuelle de toute société : les heurts (i), les antagonismes (ii), les conflits (iii), voire les conflits maîtrisés (iv), constituent la trame de l'histoire et le moteur de l'évolution. De sorte que le déséquilibre — d'aucuns disent le “chaos” (9) — est la condition de tout progrès, dans la mesure où il peut être contrôlé et dominé. L'équilibre n'est rien d'autre que la maîtrise du déséquilibre antérieur, et son orientation positive.
Une crise se manifeste lorsqu'un système qui tendait vers l'équilibre, commence à tendre vers le déséquilibre, parce qu'il se trouve confronté à un problème important, d'origine interne ou externe et de nature diverse (religieux, culturel, économique, géo-climatique ou autre) qu'il ne parvient pas à résoudre. Il convient néanmoins de distinguer entre crises mineures, provoquées par des difficultés localisées qui peuvent être résolues par des réformes permettant de rétablir et améliorer l'équilibre compromis ; et crises majeures qui atteignent la société dans son ensemble. Une crise majeure met celle-ci en demeure de choisir entre deux solutions extrêmes : l'une négative, consistant à subir avec résignation les maux qui l'accablent, à s'abandonner aux déterminismes qui, tôt ou tard, entraîneront son éclatement et sa disparition ; l'autre positive, qui implique une transformation globale des structures existantes, autrement dit, une révolution.
Le déclin ou la décadence ne s'installent que lorsqu'une crise majeure se prolonge et s'aggrave, et qu'on persiste à vouloir en venir à bout par des réformes localisées, qui s’avèrent insuffisantes et inefficaces, au lieu d'adopter les mesures révolutionnaires qui s'imposent. Ils ne présentent pas un caractère nécessaire et ne deviennent irréversibles qu'en raison du manque de lucidité, de compétence et de courage des élites. C'est ainsi que, dans les années 80, les États-Unis ayant pris conscience du déclin qui les menaçait (10), ont réussi à opérer, en une dizaine d'années, un redressement spectaculaire, auquel personne ne s'attendait, du moins sur le plan économique. Il reste à espérer qu’après avoir renoué avec la croissance, ils ne négligeront pas la réforme des autres secteurs (not. celle de l'enseignement public, qui conditionne l'avenir d'un pays) ; faute de quoi, les risques de déclin ne manqueront pas de resurgir.
La crise de la civilisation occidentale — et non son déclin — commence, nous semble-t-il, aux alentours du XIVe siècle, et s'oriente aujourd'hui seulement vers son paroxysme (11).
Âmes apollinienne, magique et faustienne
Tout en affirmant l'hétérogénéité des cultures et leur originalité foncière, Spengler admet, nous l'avons dit, l'existence de certaines constantes (dans les formes, les époques, les situations) sur lesquelles il se fonde pour distinguer trois types fondamentaux, dont la parenté procède d'une communauté d'âme : l'âme apollinienne caractérise la culture antique (gréco-romaine) ; l'âme magique, la culture arabe ; l'âme faustienne, la culture occidentale depuis le Xe siècle Cette dernière apparaît diamétralement opposée à l'âme apollinienne qu'il définit par le sens de la mesure et de la finitude, la tendance à préférer la contemplation à l'action, à subir le destin plutôt qu'à prétendre en modifier le cours, et à vivre hors de soi-même dans un éternel présent.
L'âme faustienne, au contraire, implique le refus des limites et l'aspiration à l'infini, la démesure et la volonté de puissance, le goût de l'action conjugué à celui de l'introspection, la conscience du temps, de l'histoire et de la valeur irremplaçable de la personne. À l'idéal antique du désintérêt à l'égard du monde, de l'ataraxie et de la tolérance, l'Occident oppose l'ambition de conquérir, dominer et changer l'homme et le monde, « la propension à ériger sa morale personnelle en vérité générale » et à « l'imposer à l'humanité », propension qui conduit au fanatisme et à l'inquisition. Prenant le contre-pied de la sagesse épicurienne du carpe diem, il exalte « l’être agissant, luttant, triomphant » de ses imperfections et des difficultés extérieures. Ces différentes composantes de l'âme faustienne ont incité les Occidentaux à étendre leur civilisation sur toute la surface du globe, ce qui ne s'est produit pour aucune autre culture (I, 179 sq., 295, 302, 322-326, 345, 393).
◘ 3. Une méthode comparative et synchro-diachronique
Condamnant l'histoire chronologique, linéaire et européocentrique, ainsi que la philosophie du progrès qui la sous-tend, convaincu de l'hétérogénéité, de la discontinuité et de l'équivalence des grandes cultures, Spengler professe un relativisme généralisé. Il affirme sans ambages que « les vérités immuables » et les « connaissances éternelles » n'existent pas, que « pour des hommes différents, il y a des vérités différentes » (I, 37). Partout et toujours, en effet, les penseurs ont tendance à considérer les vérités qu'ils découvrent comme seules et universellement valables, sans s'aviser du fait que « toute idée vit dans un univers historique, dont elle partage par conséquent le destin général de la caducité » (I, 53).
Aussi conteste-t-il la thèse du formalisme kantien, que Lévi-Strauss reprendra à son compte un demi-siècle plus tard : « la constance de la structure de l'esprit, (…), est une illusion », l'histoire visible offrant « plus d'un style du connaître » ; prenant donc par avance le contre-pied de la méthode structuraliste, il n'hésite pas à affirmer que « la nature dernière des choses ne peut être déduite de leur constance, mais uniquement de leur variété » (I, 70). Formule contestable, d'une part, parce qu'elle contredit le relativisme de l'auteur lui-même (la « nature dernière des choses » n'est-elle pas, d’après lui, inaccessible ?) et sa propre pratique (il ne s'interdit pas, nous l'avons vu, de procéder à des généralisations) ; d'autre part, parce qu'elle oppose dés termes qui sont en réalité interdépendants.
Le relativisme affiche par Spengler l'incite à dénoncer la prétention de l'Histoire à constituer une science. Elle se distingue en effet fondamentalement des sciences de la nature qui traitent du mécanique et de l'étendue — et dont l'objectif est de découvrir des lois et des rapports de causalité, de caractère quantitatif. À ce savoir qu'il appelle « systématique », il oppose la connaissance « de l'organique, de l'histoire et de la vie », connaissance d'ordre qualitatif, qu'il désigne par le terme de « physionomique » (I, 108). L'histoire doit donc abandonner la recherche des causes aux sciences de la nature, et se contenter de « laisser parler les choses, (…) de sentir le destin qui les dirige et d'en observer les métamorphoses, le fondement de ce destin ne ressortissant pas à l'intelligence de l'homme » qui ne peut accéder, dans le meilleur des cas, qu'à « des formes sans cause ni fin, des formes d’être pur, qui servent de fondement à l'image changeante de la nature » (II, 35). La recherche historique représente à la rigueur une « pré-science », dans la mesure où elle commence par « rassembler, classer, éclaircir les matériaux ». Elle s'apparente ensuite à la poésie plutôt qu'à la science, étant donné qu'elle n'implique pas seulement « un travail », mais « une création » (I, 104-109) qui requière des aptitudes et une méthode foncièrement différentes de celles de la science.
Rejetant tout esprit de système (12), toute prétention scientifique, Spengler opte donc délibérément pour une recréation poétique du passé qui, prenant appui sur les documents et les données disponibles, s'efforce de mettre en lumière les « formes » dans lesquelles s'incarnent l'âme et le destin des sociétés. Bien qu'il ne précise pas ses sources, il est probable qu'il a emprunté ce concept à l'école allemande de la Gestalt — ou psychologie de la Forme — qui prend son essor dans les premières années du XXe siècle et considère les faits psychiques comme des unités organiques dont les éléments sont interdépendants.
La « morphologie de l'histoire », inaugurée par Spengler, suppose « une sorte de sensibilité intérieure, difficile à décrire » et « innée », un « regard perspectif », un « tact physionomique » capable de percevoir « la forme et la logique intérieures » du vivant, « d'extraire d'un visage une vie entière, de l'image d'une époque la destinée de peuples entiers, sans arbitraire, sans “système” » ; et de découvrir les « affinités » qui peuvent exister « entre les formes d'art plastique et guerrières ou administratives » ou « entre les figures politiques et mathématiques » au sein d'une même culture (I, 59, 109-111, 122, 161). Ainsi conçue, l'histoire exige une méthode nouvelle, fondée sur la comparaison et la capacité à conjuguer synchronie et diachronie.
Les historiens ont toujours eu recours à des comparaisons, mais celles-ci restaient fragmentaires et arbitraires, fondées sur l'intuition plutôt que sur des principes cohérents (I, 16-17), et sur la ressemblance extérieure qui se révèle souvent trompeuse (I, 39). Il y a, en effet, « dans l'histoire des hommes, comme en zoologie et botanique, des phénomènes qui se ressemblent à s'y tromper sans avoir la moindre parenté intérieure (…) et d'autres qui en dépit de leur très grande différence extérieure expriment des choses identiques ». On compare souvent, par ex., des conquérants comme Alexandre, César et Napoléon. La comparaison entre Alexandre et Napoléon, est seule pertinente : tous deux sont inspirés par un grand projet politique et opèrent le passage de la culture à la civilisation, alors que César incarne le triomphe de la force et des instincts primaires, qui caractérise la fin des civilisations (I, 50).
Spengler emprunte à la biologie le concept d'homologie des organes qui désigne leur « équivalence morphologique » et celui d'analogie « qui concerne l'équivalence des fonctions ». Sont créations homologues, par ex., le bouddhisme hindou et le stoïcisme romain, « voix séniles » de vieux univers, ayant en commun le mépris de l'action et de l'énergie organisatrice (I, 139) ; analogues en revanche sont le mouvement dionysien et la Réforme, considérés tous deux comme une « insurrection ethnique collective contre les grandes formes du passé » (I, 119). Le traducteur de Spengler insiste dans son Introduction sur le fait que l'étude de 8 cultures lui a montré partout « une évolution parallèle, homologue et non analogue » (II, 8).
L'homologie des phénomènes historiques incite Spengler à considérer comme simultanés (I, 38) ou “contemporains” « deux faits historiques qui, chacun dans sa culture, se manifestent exactement dans la même situation — relative — et ont par conséquent un sens exactement correspondant (…). L'ionique et le baroque sont nés en même temps (…). La Réforme, le puritanisme et surtout le passage à la civilisation apparaissent dans toutes les cultures à la même époque. Cette époque porte dans l'antiquité les noms de Philippe et d'Alexandre ; en Occident, l'événement correspondant apparaît sous la forme de la Révolution ou de Napoléon » (I, 119). Pour résumer et illustrer les résultats de ces considérations, Spengler a élaboré un tableau synoptique qui présente horizontalement les époques spirituelles, esthétiques et politiques “contemporaines” des cultures étudiées, et verticalement les étapes (printemps, été, automne, hiver) de leur évolution (I, 63).
La méthode suivie — qu'il compare lui-même à celle de la paléontologie —, doit permettre non seulement d'éclairer le passé, mais aussi de reconstituer des époques ou des cultures inconnues, éteintes depuis longtemps, et de prévoir l'avenir, les grandes cultures dont nous connaissons l'histoire intégrale, nous indiquant la ou les phases ultérieures de notre propre évolution étant donné l'homologie qui caractérise le développement des sociétés (I, 120).
Conscient, bien avant Michel Foucault, du fait que le discours historique appartient lui-même à l'histoire, Spengler en déduit l'impossibilité d'une histoire objective. Mais loin de s'en plaindre, il estime au contraire que la subjectivité de l'historien est un facteur positif : « la connaissance experte des hommes n'exclut pas, elle exige même que nos jugements portent une nuance très marquée d'équation personnelle » (I, 30). L'histoire étant en effet proche de la poésie, ce sont les dons de l'historien qui conditionnent avant tout la qualité de ses travaux. La science elle-même n'allait lias tarder à découvrir que la prétendue objectivité n'existe pas dans les sciences de la nature, ni même dans les sciences dites exactes, la personnalité de l'observateur et les conditions dans lesquelles il effectue ses expériences intervenant nécessairement sur les résultats qu'il obtient.
Si bien que Spengler, après avoir été considéré avec suspicion par ses pairs pour son interprétation subjective et romantique de l'histoire, fait aujourd'hui figure de précurseur, et pas seulement sur ce chapitre ! En effet, certaines de ses intuitions ont révélé leur fécondité un demi-siècle plus tard. Son intérêt pour les “formes” qui révèlent la structure logique des phénomènes étudiés, a frayé la voie au structuralisme ; son refus de l'esprit de système, incapable d'appréhender la logique du vivant, et sa quête d'une méthode adaptée à cet objectif, font de lui l'un des promoteurs de l'analyse systémique ; enfin, en affirmant la discontinuité de l'histoire et l'hétérogénéité fondamentale des cultures, il a inspiré tout un courant de la pensée contemporaine, dont le sociologue G. Gurvitch se fait l’interprète quand il dénonce « l'illusion de la continuité et de la comparabilité entre les types de structures globales [autrement dit les civilisation] qui restent, en réalité, irréductibles » (13).
On peut certes reprocher à Spengler sa conception naïve de l'homologie et de l'analogie, fondée sur le postulat erroné d'une similitude entre la société et l'organisme biologique. Il n'en a pas moins senti la nécessité de dépasser la ressemblance apparente pour découvrir les affinités structurelles qui peuvent exister entre des civilisations dont il reconnaît par ailleurs l'hétérogénéité fondamentale. La science de son époque n'ayant pas encore élaboré les instruments qui permettent de réaliser cet objectif, il a dû en définitive s'en remettre à son intuition, à ce « tact physionomique » indéfinissable, qu'il possédait à coup sûr, mais qui ne saurait garantir la validité des conclusions. La méthode structurale et l'analyse systémique permettent aujourd'hui de procéder de manière plus rigoureuse, en opérant non sur des faits, en soi incommensurables, mais sur les structures de ces faits, c-à-d. sur les rapports plus ou moins invariants qu'il est possible d'établir entre eux, en recourant à différents procédés (analyse conceptuelle, construction de modèles, formalisation, etc.) (14).
La théorie fédéraliste des crises, bien qu'elle ne doive rien à la pensée de Spengler et récuse sa philosophie de l'Histoire, recoupe néanmoins certaines des thèses du Déclin de l'Occident, non seulement dans l'analyse des symptômes, mais également sur le plan méthodologique, la méthode analectique et synchro-diachronique qu'elle utilise (15) présentant des points communs avec sa « morphologie historique comparée », bien qu'elle exploite les découvertes récentes de l'analyse systémique que Spengler ne pouvait connaître, mais qu'il a brillamment anticipées. Nous n'insisterons pas sur ce sujet qui risque de rebuter le lecteur, afin d'examiner dans les pages qui suivent les symptômes qui lui paraissent caractériser le déclin des sociétés.
II. Les symptômes essentiels du déclin
Soucieux de respecter l'économie de la pensée de Spengler, nous commencerons par les symptômes culturels du déclin auxquels il consacre les plus longs développements (les 6 chapitres de son premier volume et deux chapitres du second), pour aborder ensuite, comme il le fait, ses aspects politiques, sociaux et économiques qui sont traités plus rapidement dans trois chapitres du second volume.
◘ 1. Secteur culturel
A – manque de créativité
Pour Spengler, chaque culture est caractérisée par un style original, et un seul, « qu'il s'agisse de celui des arts, des religions, des idées, ou du style de la vie même ». « Les styles ne se succèdent pas comme des vagues ou des pulsations » : le roman, le gothique, le baroque, le rococo, sont autant de phases d'un même style, autant d'expressions différentes de la jeunesse et de la maturité du monde occidental (I, 201).
• A – 1) Fin du “grand style”
Le passage de la culture à la civilisation se signale par l'extinction du « grand style », qui fait place à la mode et au goût. La mode commande désormais la succession et l'alternance des genres de peinture, des procédés littéraires, des formes anciennes ou modernes, indigènes ou exotiques : « la nécessité intérieure manque (…) L'art s'industrialise dans toute son étendue, en architecture et en musique, dans la poésie comme au théâtre ». Il devient « décoratif » (I, 193, 284).
« L'art vivant » étant défini comme « harmonie parfaite entre le vouloir, le devoir et le pouvoir, évidence du but et inconscience des moyens de réalisation, unité de l'art et de la culture », l'art décadent présente les caractéristiques inverses : les artistes contemporains « sont obligés de vouloir ce qu'ils ne peuvent plus, de travailler, de calculer, de combiner avec l'intellect, là où l'instinct discipliné est mort » (I, 280-281). N'étant plus capables de créer, ils sont condamnés à imiter indéfiniment les œuvres de leurs prédécesseurs ou à s'adonner laborieusement à toutes sortes d'expérimentations (I, 203, 278).
Cependant, quand il s'agit de déterminer à quelle époque les arts dégénèrent, Spengler affirme tantôt que « les possibilités architectoniques » de la peinture et de la musique « sont épuisées depuis cent ans » (I, 52), c'est-à-dire depuis le début du XIXe siècle ; tantôt que « la peinture à l'huile s'est éteinte à la fin du XVIIe siècle » (I, 276) et que la musique finit avec le Tristan de Wagner (I, 279), autrement dit en 1859. De plus, après avoir critiqué sévèrement l'impressionnisme, il hésite ensuite à l'inclure dans sa condamnation de l'art moderne et conclut prudemment : « ce qui se fabrique aujourd'hui en art est de l'impuissance et du mensonge, aussi bien dans la musique post-wagnérienne que dans la peinture postérieure à Manet, à Cézanne, à Leibl et à Menzl » (I, 282).
Des jugements aussi péremptoires prouvent le conservatisme de Spengler, son manque d’ouverture aux formes d’expression nouvelles, l'époque où il écrit étant particulièrement féconde, not. sur le plan artistique où les courants les plus divers — symbolisme, expressionnisme, pointillisme, fauvisme, art nouveau —, fleurissent et se succèdent à un rythme sans précédent. L'erreur qu'il commet en condamnant sans appel toute tentative d'innovation, de nombreux intellectuels, avant lui et après lui, s'en sont rendus coupables. La polémique engagée récemment par Mare Fumaroli, Jean Clair, Jean Baudrillard et Kostas Mavrakis au sujet de l'art contemporain, dans différentes publications (Le Figaro, l’Événement du Jeudi, Libération, la revue Krisis), témoigne d'une imprudence similaire (16). Le temps se chargeant généralement de distinguer, dans la production d'une époque, le bon grain de l'ivraie, il vaut mieux s'abstenir de vouer aux gémonies ce qu'on ne comprend pas ou n'apprécie pas. Il nous semble en tout cas que notre siècle ne manifeste guère, dans ce domaine, les symptômes caractéristiques des périodes de décadence, où tradition et conservation tendent à l'emporter sur la création et où triomphent l'académisme, le formalisme et l'éclectisme, même si certaines de ces tendances se font jour. Aucune époque antérieure n'a fait preuve d'une telle fièvre d'innovation ; si celle-ci fléchit dans les dernières décennies, il semble prématuré d'en déduire que l'art est dans une impasse et d’une totale nullité.
• A – 2 ) Épuisement de la philosophie
Dans le domaine philosophique, Spengler déplore également l'épuisement de la métaphysique et de l'éthique (comme dans l'antiquité entre 350 et 250) après Wagner et Nietzsche. Depuis leur disparition, il n'y a plus qu'« une philosophie professorale des professeurs de philosophie » (expression empruntée à Schopenhauer), qui étant « sans prise ni emprise sur la réalité, ne sera jamais une philosophie de premier rang ». Le « socialisme éthique » (que Spengler distingue du « socialisme économique », c-à-d. du marxisme) (17), après une période de « grandeur passionnée », vers le milieu du XIXe siècle, s'est dégradé à son tour en « pratique des questions économiques du jour » (I, 53, 337, 351-357). Pour Spengler, en effet, les grands philosophes ont toujours cherché à conjuguer la pensée et l'action, en assumant des responsabilités dans la société dans laquelle ils vivaient si bien que leur démission récente, le fait qu'ils renoncent à se battre pour leurs idées, témoigne du peu d'importance qu'ils accordent eux-mêmes à celles-ci.
Aussi prévoit-il qu'« on finira par abandonner (…) la croyance aux théories en général » (II, 418). N'est-ce pas ce qui se passe à notre époque, où le discrédit des idéologies et — il faut bien le reconnaître — l'absence de maître à penser d'envergure, incitent nos dirigeants à se réfugier dans un pragmatisme borné et inefficace ?
Nous ne pouvons que lui donner raison sur ce chapitre ; en revanche, l'idéal du philosophe engagé, s'il tend effectivement à disparaître au XIXe siècle, s'affirme à nouveau dans la seconde moitié du XXe siècle, avec les philosophies personnaliste et existentialiste. De plus, la métaphysique et l'éthique, dont Spengler annonçait la disparition, bien que battues en brèche par le néopositivisme logique des écoles de Cambridge et de Vienne et par le structuralisme, continuent à inspirer les recherches des penseurs contemporains, not. de ceux qui se réclament peu ou prou de l'existentialisme heideggerien ou du personnalisme, comme E. Lévinas, Ph. Cormier, Ch. Taylor, H. Jonas, J. Rawls ou J. Habermas, malgré la tendance de la plupart d'entre eux à privilégier les problèmes politiques ou socioculturels (ce qui prouve qu'ils n'ont pas renoncé à agir sur la société, comme Spengler le reprochait aux philosophes de la fin du XIXe siècle).
• A – 3 ) La science cède le pas à la technique
Dans toutes les cultures déclinantes, « la passion épistémologique cède le pas au besoin pratique » (I, 337), ce qui veut dire que la recherche scientifique tend à reculer au profit du développement technique. Phénomène que Spengler croit discerner à l'époque où il écrit : « dans la physique comme dans la chimie, en biologie comme en mathématique, les grands maîtres sont morts et nous vivons aujourd'hui le decrescendo des brillants imitateurs qui classent, collectionnent et achèvent, comme les Alexandrins de l'époque romaine » (I, 407). Et pourtant, dans les premières décennies du XXe siècle, la science connaît un renouveau remarquable, notamment dans le domaine des mathématiques, de la physique et de la chimie où la théorie de la relativité d'Einstein (1905-1919), les recherches sur l'atome et la radioactivité de Rutherford et la théorie des quanta formulée par M. Plank en 1900, puis développée par N. Bohr (1913) et par W. Heisenberg, bouleversent les conceptions et les méthodes scientifiques (18).
Cependant, comme dans le domaine de l'art, Spengler, moins sensible au renouveau extraordinaire qui s'esquisse qu'à l'effondrement de toutes les certitudes antérieures et à la fragilité des théories multiples et contradictoires qui fleurissent sur leurs décombres, n'hésite pas à affirmer que « le grand style de la représentation a fait place à une sorte d'industrie de la fabrication des hypothèses » (I, 402). Poète visionnaire, plutôt qu'esprit scientifique, c'est la fin du monde, « le crépuscule des dieux », « symbole de l'âme faustienne », qu'il voit se profiler derrière la doctrine de l'entropie, « conception dernière et irréligieuse du mythe » (I, 406).
La technique et le machinisme inspirent à Spengler des sentiments contradictoires. Il ne peut s’empêcher d'éprouver une certaine admiration devant leurs réalisations, reconnaissant que la « passion faustienne » de dominer le monde « a changé l'image de la surface du globe », qui offre désormais un « spectacle d'une telle grandeur », que l'humanité future y verra probablement la caractéristique la plus frappante de notre civilisation. Il va même jusqu'à reconnaître qu'elle est loin d'avoir exploité toutes les possibilités dont la technologie est porteuse (19). Néanmoins, influencé conjointement par la fable de l'apprenti sorcier imaginée par Goethe, il déplore le fait que l'homme soit devenu « l'esclave de ses œuvres » et ait saccagé la nature jusqu'à l'épuisement de ses ressources. Aussi n'hésite-t-il pas à qualifier la machine de « diabolique », dans la mesure où son inventeur, grisé par ses succès, se prend désormais pour un dieu et prétend régir le monde à la place de son Créateur (II, 461-464). Spengler entame ainsi le procès de la technique, que poursuivront avec le même aveuglement Heidegger, Ellul et les adeptes de la deep ecology.
L'art, la philosophie et la science étant moribonds dans une civilisation en proie au scepticisme, le seul domaine dans lequel l'Occident puisse encore s'illustrer (il bénéficie en effet d'un sens de l'histoire dont les cultures antérieures étaient dépourvues) est, si l'on en croit Spengler, celui de la « morphologie historique comparée », dont il a lui-même frayé la voie, et qui représente « le dernier grand œuvre » réservé à la pensée faustienne (II, 34 ; I, 57, 70, 160).
On doit donc reconnaître qu'il n'a pas été capable de percevoir le renouveau extraordinaire qui s'effectuait à son époque dans le domaine des arts, des lettres (dont il ne dit pas grand-chose), des idées et des sciences. Les jugements sévères qu'il prononce nous paraissent s'appliquer avec plus de pertinence aux dernières décennies du XXe siècle qu'à ses débuts. On peut en effet constater de nos jours un certain fléchissement de la créativité — plus ou moins marqué selon les pays — dans le domaine de la culture des élites ; mais il est difficile de savoir s'il sera temporaire ou définitif, et s'il s'explique par la concurrence des média audiovisuels et de la culture de masse ou par l'épuisement des genres et des styles traditionnels. Cependant, les sciences et les techniques semblent échapper jusque-là à ce déclin, bien que les restrictions budgétaires imposées par la crise économique, et les craintes inspirées par les dangers d'un progrès incontrôlé, risquent désormais d'entraver leur essor (20).
Faut-il en conclure que Spengler a été un piètre observateur de la société dans laquelle il vivait, soit que son conservatisme lui donne des œillères, soit que ses dons de visionnaire le rendent plus sensible aux évolutions de longue durée qu'aux réalités présentes ? Ce fut le cas, semble-t-il, pour Custine dont on a pu dire qu'il avait admirablement décrit, un siècle à l'avance, la société soviétique, plutôt que la société tsariste du XIXe siècle. On peut dire néanmoins, à la décharge de Spengler, qu'il manquait du recul nécessaire pour pouvoir juger avec pertinence de la fécondité d'innovations et de découvertes dont l’intérêt et la validité restaient à prouver.
B. Recul de la foi, puis “seconde religiosité”
« La religion étant l'essence de chaque culture, l'irréligion est celle de toute civilisation » (I, 341), caractérisée par les progrès de l'athéisme. Celui-ci conduit tôt ou tard au nihilisme (I, 334), la foi dans la science et les idéologies qui remplace la religion des premiers âges, finissant par s'effondrer à son tour.
Quand la civilisation s'installe dans sa forme définitive, on voit apparaître sur les décombres des idéaux rationalistes, « une religiosité nouvelle et résignée, qui s’élève de la misère de l'âme et du tourment de la conscience, qui renonce à fonder un nouvel au-delà, qui cherche le mystère au lieu des concepts tranchés » (II, 419). Cette « seconde religiosité », expression de la foi naïve et spontanée des masses tend à ranimer d'anciennes croyances populaires, à en emprunter d'autres à l'étranger et à les amalgamer dans des cultes syncrétiques, reposant sur des structures fixes (communautés de tous ordres, sectes, églises) « qui sont toujours des répétitions figées des formes vivantes du passé ». C'est le cas des religions à mystères hellénistiques, des sectes taoïstes de la Chine des Han, des couvents du Studion et d'Athos, à la fin de l'empire byzantin. Cette seconde religiosité trouve son expression ultime dans les « religions de fellah », « primitives de part en part, tels les cultes animaux de la 26ème dynastie égyptienne » ; figées dans un dogmatisme et un ritualisme qui entravent leur évolution, elles se perpétuent pendant des siècles, comme le montrent les exemples de la religion d'État en Chine ou de l'Islam dans l'Orient actuel (II, 285-290).
C. Crise des valeurs
L'athéisme provoquant un « bouleversement de toutes les valeurs », comme l'avait bien vu Nietzsche, la morale instinctive et indiscutée qui prévalait jusque-là « se mue en problème » et revêt une importance d'autant plus grande que la métaphysique dépérit. Le besoin se fait sentir d'une « morale pratique destinée à régler la vie, parce que celle-ci ne peut plus se régler elle-même ». Si bien qu'à la « morale tragique » de la culture, succède la « morale plébéienne » de la civilisation, fondée sur la « saine raison humaine » et une morne résignation. La morale tragique « connaît et comprend le poids de l’être, mais elle en tire le sentiment d'orgueil pour le supporter. Ainsi sentaient Eschyle, Shakespeare et les penseurs de la philosophie brahmanique, ainsi Dante et le catholicisme germanique (…). La morale plébéienne d'Épicure et de la Stoa, des sectes bouddhistes du XIXe siècle en Occident, prépare un plan de bataille pour esquiver le destin, par la prévoyance, l'humanité, la paix universelle, le bonheur du plus grand nombre » (I, 337-338).
Bien que certaines propositions ou formules de Spengler soient contestables, son analyse se trouve dans l'ensemble confirmée par l'évolution actuelle de la civilisation occidentale : remise en question et recul de la foi et de la morale chrétiennes, qui orientaient le comportement des générations passées et donnaient un sens à leur vie ; déclin du positivisme scientiste et des idéologies qui, depuis le XVIIIe siècle, jouaient le rôle de croyances de substitution ; progression de pseudo-valeurs matérialistes et hédonistes (le bien-être et le bonheur par la consommation et la possession, le sexe et le loisir) et prolifération de cultes et de mythes compensateurs : idolâtrie de la nature ou du cosmos, mythologie des “olympiens” (stars de cinéma, champions, famille royales, explorateurs, artistes célèbres, etc.), culte du “moi” (importance accordée à l'apparence et aux performances physiques, ainsi qu'à la réussite professionnelle et sociale), vogue croissante des sectes et des sagesses et morales orientales, alors qu'en Extrême-Orient, c'est au contraire le christianisme qui progresse.
Si bien que nos contemporains, lassés du laxisme effréné et de ses conséquences désastreuses (développement de la criminalité, de la délinquance, de l'usage des drogues et des troubles psychiques de tous ordres), ressentent désormais la nécessité de restaurer les anciennes valeurs, en rétablissant les cours de morale, de savoir-vivre et d'instruction civique, dans les écoles, voire dans les entreprises. Bref, on assiste à un retour de la morale plébéienne (qualifiée généralement de bourgeoise !), qui, procédant d'un christianisme sclérosé et sécularisé, apparaît effectivement formaliste, conformiste et mesquine en regard des enseignements des grandes figures du catholicisme (“Aime et fais ce que tu voudras”), mais qui s’avère néanmoins préférable à la loi de la jungle à laquelle on est en train de revenir.
◘ 2. Secteur politique
A. Du féodalisme au “Césarisme”
« L'histoire de grand style commence dans chaque culture par l'État féodal, qui n’est pas l’État au sens futur du mot, mais l’organisation de la vie totale par rapport à un ordre » (II, 340-341) — la noblesse —, qui représente « l'ordre proprement dit, la quintessence de la race (21) et du sang » (II, 308). Aussi Spengler considère-t-il que « l'État le plus solide est celui où la noblesse, ou la tradition créée par elle, sont entièrement mises au service de la chose publique générale » (II, 338). La réalité coïncidant rarement avec cet idéal, l'État féodal n'a qu'une existence éphémère : il est rapidement miné par les conflits intérieurs (entre la noblesse et le clergé, la couronne et ses vassaux, etc.) ou extérieurs (not. guerre de Cent ans), ainsi que par l'émergence des nations qui vont promouvoir « l'idée d'État proprement dit » en faisant perdre à celui-ci le caractère organique qu'il avait à l'origine (II, 342). Le concept de nation finissant par l'emporter sur celui d'ordre, on assiste à la formation de l'État absolu, qui permet d'atteindre « à une hauteur de la forme politique, qui ne pouvait plus dés lors être dépassée » (II, 355, 360) mais qui n'a réussi à s'imposer que pendant un siècle et demi, l'État parvenant à « dompter le sang des premiers ordres » (noblesse et clergé) pour les mettre entièrement à son service (II, 369-370).
Le Tiers-État, qui constitue un « non-ordre » — il conteste en effet la légitimité de tous les ordres — (II, 306), réussit progressivement à imposer son idéal d'égalité — « dissolvant, socialement niveleur » — et de liberté — tout aussi négatif, dans la mesure où il implique le refus de la tradition et des « grands symboles contraignants de la culture » (II, 326-329, 414). La bourgeoisie qui accède au pouvoir et représente les « puissances de l'esprit et de l'argent » opposées à celles du sang et de la tradition, substitue l'organisé à l'organique et le parti à l'ordre : c'est le moment où la culture devient civilisation, où les révolutions bourgeoises remplacent la « tradition vivante », incarnée par la noblesse, ainsi que les symboles et les valeurs transcendantes qui informaient et guidaient la société, par de vulgaires intérêts matériels ; « la grande politique » qui visait à « rendre la guerre presque superflue » grâce à une diplomatie active, intelligente et efficace (II, 311, 367, 401, 405), disparaît à son tour. Le régime parlementaire et pseudo-démocratique qui succède à l'État absolu, est en réalité dirigé, manipulé et exploité par les partis politiques, mus par la volonté de puissance et l'appât du gain ; sombrant dans la ploutocratie et discrédité, il s'engage, depuis la Première Guerre mondiale, « sur la voie du déclin complet » (II, 371, 417).
L'épopée napoléonienne ouvre l’ère des « États batailleurs » (par analogie avec celle des “royaumes combattants” que la Chine a connue de - 480 à 230) et de l'impérialisme qui, par ses « combats gigantesques », va frayer la voie au « césarisme » (III, 385, 396). Celui-ci, mettant fin à la « politique de l'esprit et de l'argent » marque « le retour d'un monde, achevé dans sa forme, au primitif, au cosmique anhistorique » : « les puissances du sang, les instincts primaires végétatifs de toute vie, la force corporelle non interrompue, rentrent dans leur ancien pouvoir. La race réapparaît, pure et irrésistible : succès du plus fort et le reste comme butin. Elle s'empare du gouvernement du monde, et l'empire des livres et des problèmes se dessèche et tombe dans l'oubli. Dorénavant, les destins héroïques de style préhistorique redeviennent possibles » (II, 399-400).
Pour parvenir à cette fin, l'argent représente une arme décisive, permettant d'acheter la presse, qui constitue un formidable moyen de propagande et de pression. Qu'est-ce en effet que la vérité ? « Pour la foule, c'est ce qu'elle lit et entend constamment » ; quant à la « vérité publique du moment, qui seule importe dans le monde réel des actions et des succès, (elle) est aujourd'hui un produit de la presse » (II, 426). Parmi les droits essentiels que les sociétés dites démocratiques se targuent d'instaurer, la liberté de pensée est un des plus prisés ; mais il s’avère aussi illusoire que le droit de libre disposition du peuple : « Jadis, on n'avait pas le droit de penser librement ; aujourd'hui on a ce droit, mais on ne peut plus l'exercer ». Bien qu'il soit permis à chacun de penser ou de dire ce qu'il veut, la presse peut refuser de divulguer les opinions qu'elle ne juge pas opportun de faire connaître à ses lecteurs. Or cette « effrayante censure du silence » s’avère plus redoutable que les autodafés allumés par certains dictateurs pour y brûler les livres jugés dangereux, dans la mesure où la population qui la subit en ignore l'existence (II, 427).
« La dictature des chefs de partis » prenant appui sur « la dictature de la presse », les élections apparaissent désormais comme une vaste « comédie », organisée par l'argent « dans l’intérêt de ceux qui le possèdent ». Les Parlements eux-mêmes, jouent un rôle fictif, étant destinés à faire oublier que le pouvoir réel est détenu par des groupes de pression plus ou moins occultes : « Comme la royauté anglaise au XIXe siècle, [ils] deviendront peu à peu au XXe siècle un spectacle féerique et vide » (II, 385, 428-429). Aussi Spengler prévoit-il que « la démocratie de demain passera sous la puissance de ceux auxquels obéit la parole imprimée et qui disposeront absolument des peuples », une « campagne de presse » leur permettant de « continuer (ou préparer) la guerre » sans en avoir l'air et sans coup férir (II, 425, 427). Mais il prévoit également que tôt ou tard, cette démocratie fictive et corrompue deviendra insupportable et sera balayée par le césarisme qui fera à nouveau appel aux « moyens originaires de la force sanglante » (II, 429).
La critique du système partisan et électoral, du parlementarisme et de la corruption des régimes démocratiques représente presque un lieu commun jusqu'à la Seconde Guerre mondiale : formulée par Proudhon, dès le milieu du XIXe siècle, elle est reprise par Roberto Michels (dans son livre sur les Partis politiques publié en 1911), par Péguy, puis par les “non-conformistes des années 30”, et notamment par les fédéralistes personnalistes qui, depuis, la poursuivent inlassablement dans les colonnes de cette revue et ne se contentent pas de déplorer comme Spengler le caractère inorganique du suffrage universel, mais proposent un certain nombres de mesures susceptibles d'y remédier (22). Les régimes fascistes qui prennent leur essor dans les années 20 et 30, ont profité du discrédit dont la démocratie faisait l'objet pour la liquider, comme l'avait prévu Spengler. Mais ces régimes n'ont eu qu'une durée éphémère, du moins en Occident, et la démocratie, malgré tous ses défauts a fini par s'imposer et par faire l'objet d'un large consensus, dans la mesure où elle bénéficie d'une supériorité incontestable par rapport aux modes de gouvernement autoritaires et totalitaires qui prétendaient la remplacer.
Par ailleurs, Spengler a tendance à surestimer le pouvoir de la presse et à sous estimer les capacités de résistance de ses lecteurs aux tentatives d'endoctrinement qu'ils subissent. Les études récentes faites sur les media audiovisuels (qui n'existaient pas à son époque et dont l'impact sur les masses a pu paraître encore plus puissant que celui de la presse) prouvent en effet que leur influence sur le public n'est pas aussi décisive qu'on pouvait l'imaginer, même sous les régimes totalitaires dont la propagande, omniprésente, n'est pas contrebalancée par d'autres sources d'informations. Cependant Spengler a justement dénoncé le caractère pernicieux de la « censure du silence » qui sévit de manière occulte dans les démocraties dites libérales, empêchant systématiquement les courants de pensée marginaux ou oppositionnels de s'exprimer (les fédéralistes, notamment, n'ont pas cessé d'en être victimes) (23).
C. Impérialisme, pacifisme
Spengler voit dans l'impérialisme une caractéristique essentielle des civilisations qui cherchent à compenser leur manque de créativité, de foi et de vie intérieure par une « activité extensive pure », « l'homme cultivé » ayant « son énergie dirigée en dedans, le civilisé en dehors » : « Impérialisme est civilisation pure (…). La tendance expansive est une fatalité, quelque chose de démoniaque et de fantastique, empoignant l'homme tardif » (I, 49, 56). Quelques décennies plus tard, Schumpeter proposera la définition suivante de l'impérialisme : « disposition, dépourvue d'objectifs, que manifeste un État à l'expansion par la force, au-delà de toute limite définissable » (24). Définition qui paraît proche de celle de Spengler : en soulignant le caractère irrationnel et compulsif des guerres de conquête, ils prennent tous deux le contre-pied de la théorie marxiste qui voit dans l'impérialisme “le stade suprême du capitalisme” en quête de nouveaux marchés. Cependant, ce qui les sépare, c'est que Spengler impute la responsabilité de l'impérialisme à la psychologie de l'homme tardif, alors que Schumpeter a compris qu'il est inhérent à l'État.
L'impérialisme apparaît comme le « symbole typique de la fin ». Spengler précise toutefois que l'Occident est loin d’être parvenu à ce stade ultime : Cecil Rhodes n'est-il pas « le premier précurseur d'un type césarique occidental dont l'heure n'a pas encore sonné » (I, 49) ? Il s'oppose ainsi à la thèse défendue par la plupart des historiens qui situent l'apogée de l'impérialisme à la fin du XIXe siècle, sans se donner pour autant la peine d'expliquer son point de vue. On peut le justifier a posteriori en supposant qu'il pressentait, plus ou moins confusément, que l'Europe deviendrait bientôt le champ de bataille et d'affrontement de grandes puissances impérialistes qui tenteraient de lui imposer leur hégémonie ; et que l'échec du IIIe Reich permettrait à l'Union Soviétique de constituer un nouvel empire beaucoup plus redoutable que les anciens et lointains empires coloniaux, et de faire peser sur la planète la menace d'une conflagration mondiale. Spengler prévoyait en effet que le socialisme, tout en condamnant l'impérialisme, y succomberait à son tour un jour ou l'autre, n'étant pas, en dépit des apparences, « un système de la compassion, de l'humanité, de la paix et de la sollicitude, mais de la volonté de puissance » (I, 49, 344).
S'appuyant sur l'exemple de l'Empire romain, il souligne le caractère négatif de l'impérialisme « dû non à une surmesure de puissance (…) mais à un manque de résistance » chez ses adversaires, l'Orient renonçant progressivement à son ancienne liberté (I, 48). De plus, la pax romana qui succède à la période impérialiste, ne lui paraît pas aussi bénéfique qu'on l'affirme habituellement, exposant « une population informe, de centaines de millions d'habitants » à devenir l'enjeu de la volonté de puissance de quelques petites bandes de guerriers. Si bien que « cette paix a coûté aux pacifiques des sacrifices qui éclipsent ceux de la bataille de Cannes » (II, 171). D'autre part, pour obtenir la soumission des populations assujetties et sans ressources, la politique dégradante du panem et circenses a été pratiquée à grande échelle dans les villes, habituant ses bénéficiaires à la dépendance, à la passivité et à l'irresponsabilité. N'est-ce pas la preuve la plus convaincante de la dégénérescence des civilisations, qu'elles finissent par préférer l'esclavage à la mort ? (II, 170-171)
Aussi Spengler dénonce-t-il vigoureusement les dangers du pacifisme qui fleurit en Occident, sur les décombres de la Première Guerre mondiale : « la paix du monde (…) implique le renoncement privé de la très grande majorité à la guerre, mais par-là même aussi le consentement inavoué de cette majorité à devenir la proie des autres qui, eux, n'ont pas renoncé » (II, 403) ; en réalité, elle « n'a jamais été autre chose que l'esclavage de toute une humanité sous le règne d'un petit nombre de natures fortes résolues à dominer » (II, 406). De plus, « les guerres à l'époque de la paix mondiale » loin de disparaître, deviennent « des guerres privées plus terribles que toutes les guerres d'États, parce qu'elles sont informes » (II, 402-403). C'est ce que l'on constate de nos jours, où les guerres étatiques sont remplacées par des guerres civiles (religieuses, inter-ethniques, d'indépendance, etc.) qui, faisant fi des règles et des usages que les États étaient tenus de respecter, prennent les populations en otage et multiplient impunément les massacres et les atrocités ?
Sur ce chapitre également, les fédéralistes partagent le point de vue de Spengler, proclamant dès les années 30 : « Ni le mensonge impérialiste, ni la démission pacifiste » (25). Mais contrairement à lui, ils ont compris que le développement hypertrophique de l'État et de la bureaucratie qui le sert — phénomène dont l'auteur du Déclin de l'Occident ne s'est pas avisé — constitue l'un des facteurs décisifs de la crise de la civilisation occidentale, étant à l'origine de cette crise (qui s'est déclenchée et a progressé en même temps que lui) et notamment de l'impérialisme.
Envisagé dans cette perspective, le « césarisme » — si tant est qu'on puisse l'identifier au fascisme, voire au totalitarisme — ne représente pas un retour aux vertus et à la politique des temps barbares, comme le suggère Spengler, mais l'aboutissement logique du processus séculaire de croissance et de renforcement de l'État et de son emprise sur la société.
◘ 3. Secteur social
A. Déstructuration de l'espace sociologique, massification et prolétarisation
Le passage de la culture à la civilisation se caractérise par l'effacement des ordres traditionnels au profit des castes et des masses. Les premières se constituent dès la période tardive des cultures : castes sacerdotales de Thèbes, guerrières de Libye, brahmanes ou mandarins de l'Inde ou de la Chine, qui représentent une expression caricaturale et figée des ordres, dont elles perpétuent les privilèges, tout en affichant un souverain mépris pour le reste de la société. Ce phénomène précède et accompagne l’avènement des « peuples de fellahs » (« dont les Égyptiens de l'époque romaine sont l'exemple le plus célèbre ») (II, 155, 305). Spengler n'ayant pas pris la peine de s'expliquer plus amplement sur ce sujet, on en est réduit à des conjectures : il désigne probablement par le terme de castes les anciennes élites (notamment les fonctionnaires des bureaucraties étatiques) qui, perdant progressivement leur dynamisme et leur créativité, réussissent à préserver leur pouvoir, leurs prérogatives et leur statut. Quant au « fellahisme définitif » qui caractérise la phase terminale des civilisations, on verra plus loin qu'il est lié à la « non-prolificité » des couches supérieures de la population.
Les masses déracinées rassemblent des membres déchus de « tous les ordres et de toutes les classes » (II, 369), qui, privés de revenus et d'emploi et rompant tous liens sociaux sont condamnés au « nomadisme des villes mondiales » et à la prolétarisation. Elles représentent « l'informe absolu, qui poursuit avec haine chaque espèce de forme, toutes les différences de rang, la propriété constituée, le savoir constitué » ; dépossédées de leur passé et dépourvues d'avenir, elles incarnent la « non-histoire », « la fin, le radical néant » (II, 330-331). Leur intervention donne aux événements « le pouvoir destructeur qui distingue, par ex., la Révolution française de la Révolution anglaise » (II, 369).
Spengler est un des premiers à développer ce thème qui sera ensuite repris et exploité avec le succès que l'on sait par Ortega y Gasset (La révolte des masses, 1930), Toynbee et H. Arendt, sans oublier les “non-conformistes des années 30”. Thème qui resurgit de nos jours, avec une acuité particulière, mais que l'on désigne désormais par le terme d'exclusion.
B. Triomphe de la ville cosmopolite
Le symbole par excellence des civilisations, c'est la « ville mondiale », ville « géante », « abstraite » et « artificielle » conjuguant une forme en échiquier et un « entassement anorganique, donc illimité » — à la fois horizontal et vertical — qui témoignent de la substitution de l’intelligence à « l'expérience inconsciente de la vie », de la privation d'âme provoquée par l'irréligion, de la méconnaissance des traditions, de la primauté des valeurs matérielles et de l'argent — l'abstraction par excellence — et du triomphe du cosmopolitisme sur le patriotisme. Dans le monde antique, ce type d'habitat est inauguré en 441 par Hippodamos de Milet ; en Occident, le plan de Washington datant de 1791, en offre le premier exemple. Les mégapoles représentent un pôle d'attraction pour les masses déracinées de toutes origines, qui espèrent y trouver des moyens de subsistance ; pour les commerçants et les hommes d'affaires, attirés par les possibilités de profit sans précédent offertes par un aussi vaste marché ; ainsi que pour les intellectuels et les esthètes qui ont besoin de stimulations extérieures pour compenser leur manque de créativité.
Le cadre de vie inhumain des grandes cités sécrète l'ennui de vivre et un besoin effréné de distractions, guère plus relevées que les jeux du cirque, et qui sont l’antithèse du « jeu authentique » et de la « joie de vivre ». Il s'agit là, pour Spengler, d'une évolution fatale et irréversible : « Le paysannat a enfanté un jour le marché, la ville rurale et les a nourris du meilleur de son sang. Maintenant, la ville géante, insatiable, suce la campagne, lui réclame sans cesse de nouveaux flots d'hommes qu'elle dévore, jusqu'à mourir elle-même exsangue dans un désert inhabité », tandis que le cœur du citadin s'étant déprit de la campagne, n'est plus capable de s'y intéresser à nouveau (I, 45 ; II, 93-96). L'auteur de ces lignes ne prévoyait donc pas le mouvement de retour à la nature qui, depuis des décennies, pousse de plus en plus les citadins, excédés par les désagréments de la vie urbaine, à s'évader, aussi souvent que possible, dans leurs résidences secondaires et à y passer leurs vacances puis leurs années de retraite ; non plus que les politiques récentes qui visent à repeupler les campagnes en y développant des activités nouvelles (artisanales, touristiques, écologiques, etc.).
C. Chute démographique
« L'homme-cerveau des villes cosmopolites » ayant perdu sa créativité, est voué à la stérilité ; stérilité qui se manifeste sur le plan physiologique par une moindre prolificité. Alors que la fécondité est naturelle et spontanée dans les cultures en expansion, la restriction des naissances devient systématique dans les mégapoles où sévissent l'individualisme, l’égoïsme et le refus des traditions et des contraintes. Le phénomène peut s'observer dans toutes les civilisations déclinantes du passé, comme dans la nôtre. Il va de pair avec l'émancipation des femmes, qui refusent les servitudes de la maternité, pour devenir indépendantes et développer leur personnalité si bien qu'elles ont désormais des “conflits psychiques” au lieu d’enfants. Progressivement, le fléau de la dépopulation gagne la province et la campagne, où seuls « le sang primitif (…), mais dépouillé de ses éléments prometteurs et sains » continue à se reproduire. Ainsi apparaît « le type du fellah », caractéristique des fins de civilisation (I, 342 ; 11, 97, 100).
Le phénomène de dénatalité dénoncé par Spengler est incontestable, du moins dans le monde occidental ; en effet, les pays du Tiers et du Quart monde souffrent au contraire d'une natalité excessive qui compromet leur développement, bien qu'un certain nombre d'entre eux réussissent progressivement à la réduire. Aussi n'a-t-il pas tort d'attirer l'attention sur le fait que les peuple “civilisés” risquent d’être supplantés, tôt ou tard par les « peuples de fellah », en raison du déséquilibre de leurs taux respectifs de reproduction. N'est-ce pas ce qui s'est passé sous le Bas-Empire romain ? Il commet cependant l'erreur, comme pour les autres symptômes qu'il diagnostique avec pertinence, de considérer ce risque comme inéluctable, alors qu'il peut être évité par des efforts conjugués des uns et des autres pour corriger ce déséquilibre. Les démographes et les historiens contemporains, not. A. Sauvy et P. Chaunu, n'ont pas manqué d'en souligner la gravité et de tirer la sonnette d'alarme pour inciter leurs contemporains à assumer leurs responsabilités, avant qu'il ne soit trop tard.
Néanmoins, l'analyse que fait Spengler de ce phénomène nous paraît trop succincte. Il oublie de mentionner le rôle joué par le recul de la pratique religieuse et par la crise des valeurs, ainsi que par le manque de confiance dans l'avenir, qui pouvaient déjà être observés à son époque ; en revanche, il pouvait difficilement prévoir, au début du siècle, que la diminution des naissances se trouverait aggravée, après la Seconde Guerre mondiale, par la généralisation du travail féminin et par l'élévation spectaculaire du niveau de vie, et par-là même des exigences relatives à l'éducation des enfants. Il n'en a pas moins été l'un des premiers à mettre en lumière un des symptômes les plus inquiétants pour l'avenir de notre civilisation.
◘ 4. Secteur économique
Les considérations de Spengler sur l'économie, qui n'occupent que 30 pages à la fin de son ouvrage, représentent sa partie la plus faible. Ce que n'ont pas manqué de lui reprocher les “nouveaux historiens” — comme L. Fèbvre et F. Braudel — qui, sous l'influence du marxisme, se sont efforcés de développer l'histoire économique et sociale, longtemps sacrifiée à l'histoire politique.
A. Mondialisation de l'économie et dictature de l'argent
Les grandes cultures, affirme Spengler, donnent la primauté au « vouloir politique et religieux ». Ce n'est qu'avec l’avènement des civilisations que l'économie, se substituant à la grande politique, tend à occuper la première place : « le bonheur du plus grand nombre, le plaisir et la commodité, le panem et circenses remplacent désormais les objectifs transcendants qui donnaient un sens à la vie ». Hostile à la fois au libéralisme et au marxisme, comme les “non-conformistes des années 30”, il prétend exposer « une conception économique nouvelle, allemande, au delà du capitalisme et du socialisme » (II, 432-434) ; formule que les nazis reprendront à leur compte, mais qui reste pour eux un thème de propagande, auquel ils renonceront d'ailleurs rapidement, leur politique de réarmement les incitant à rechercher l'appui et la collaboration de la haute finance et de la grande industrie. Justifiant son manque d’intérêt pour l'économie par le caractère encore rudimentaire d'une science promise à un brillant avenir — en quoi il ne s'est pas trompé — Spengler se contente d'esquisser les grandes lignes de l'évolution économiques des sociétés, au lieu du programme qu'il avait annoncé.
Les civilisation donnant une place prépondérante aux grandes villes et au commerce, tendent à instaurer une économie mondiale, fondée sur une organisation de plus en plus poussée et méthodique de la production et des échanges et un développement sans précédent de la haute finance, des banques et des bourses, celles-ci s'efforcent de promouvoir une “économie conquérante” en menant une lutte acharnée contre “l'économie productive” afin de lui imposer leur hégémonie. Les détenteurs de capitaux, corrompant, comme déjà dit, les institutions démocratiques et la presse, instaurent le règne de la ploutocratie. Cependant, tôt ou tard, le césarisme y mettre fin et rétablira la primauté du politique sur l'économique (II, 431-467).
Le pouvoir occulte, abusif et pernicieux de l'argent dans la société actuelle avait été dénoncé, avant Spengler, par les moralistes, les marxistes et les socialistes, Péguy notamment avait consacré deux cahiers à ce thème en 1913 (26). En l'exploitant à son tour, Spengler n'innove donc pas ; mais il a le mérite de le traiter avec vigueur et de lui donner la place importante qu'il mérite. Serait-il plus original quand il fait allusion à la “mondialisation” de l'économie, dont on nous rebat les oreilles depuis quelques temps ? Il ne fallait pas être grand clerc pour s'en aviser, comme il le souligne lui-même, le phénomène étant engagé « depuis 150 ans » au moins (II, 431) et n'ayant fait que s'accélérer et s'amplifier récemment. Ce que nombre de nos contemporains ont tendance à oublier — comme ils négligent le fait que les pays européens, effectuant la majorité de leurs échanges au sein de la Communauté, ne subissent pas de plein fouet la concurrence internationale — : il semble donc qu'en imputant à la "mondialisation" la responsabilité de la crise économique actuelle, ils évitent par-là même de s'interroger plus avant sur ses causes. En revanche Spengler fait preuve d'une clairvoyance indéniable quand il prévoit le rôle décisif joué actuellement par la spéculation financière au détriment de l'économie productive. Mais il s'est trompé en imaginant que les régimes fascistes mettraient fin à « la dictature de l'argent », qui n'a fait que s'aggraver tandis qu'ils n'ont eu eux-mêmes qu'une durée éphémère.
CONCLUSIONS
Parvenus au terme de notre investigation, il convient d'en faire le bilan. La plus grave erreur commise par Spengler, est de n'avoir pas su prévoir le renouveau culturel qui s'effectuait à l'époque où il écrivait, et de n'avoir pas compris que le refus de la tradition, des certitudes acquises et des modes de pensée et de création artistique et musicale, qui avaient prévalu pendant des siècles, loin de signifier que la philosophie, les sciences, l'art et la musique avaient épuisé leurs possibilités d'expression, témoignait au contraire de leur vitalité et de capacités de renouvellement remarquables.
Cependant, si on applique son jugement aux dernières décennies du siècle, il gagne en pertinence, si bien qu'il semble avoir été doté d'une plus grande perspicacité pour prévoir l'avenir que pour observer la réalité contemporaine. Pourtant, il n'a pas su anticiper les aspects les importants de la crise actuelle de la culture : inadaptation croissante de l'enseignement public, dictature de l'idéologie dominante, éclatement de la culture en deux courants hétérogènes — une culture traditionnelle élitaire et une culture de masse, nouvel “opium du peuple” qui, loin de démocratiser la culture, la dégrade en loisir. Mais on ne saurait le lui reprocher, étant donné que ces phénomènes ne sont apparus qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Plus sensible aux inconvénients et aux dangers de la technique qu'à ses apports positifs, il a méconnu les progrès extraordinaires qui devaient en résulter, progrès qui prouvent que la créativité des occidentaux n'est pas atteinte, et permettent par conséquent d'espérer qu'ils sauront résoudre les difficultés dans lesquelles ils se débattent et conjurer le déclin qui les menace. En revanche, Spengler a bien saisi l'importance de la crise de la foi et des valeurs qui affecte notre civilisation et compromet sa survie, dans la mesure où elle atteint les raisons de vivre et d'espérer de nos contemporains.
Accordant lui-même un rôle capital au politique, il a fait preuve d'une clairvoyance indéniable sur ce chapitre, comprenant que l'impérialisme n'avait pas encore atteint son apogée, que le pacifisme des démocraties occidentales ne pouvait qu'encourager les visées expansionnistes et le bellicisme de leurs adversaires, et que la corruption et le discrédit des régimes parlementaires, prétendus démocratiques, feraient le lit du fascisme. Il s'est néanmoins illusionné sur la nature des régimes, qui relèvent de cette catégorie, comme sur les dates de leur apparition et sur leur durée, ayant tendance à leur prêter toutes les vertus dont il déplorait la disparition et une longévité qui leur a été heureusement refusée. Mais les démocraties occidentales n'ont-elles pas commis la même erreur à l'égard du communisme soviétique, dont personne, semble-t-il, n'avait prévu qu'il s'effondrerait aussi rapidement ?
Sur le plan social, Spengler insiste surtout sur l'urbanisation accélérée, la désertification des campagnes et la croissance anarchique des mégapoles, sans envisager pour autant que cette tendance puisse un jour ou l'autre s'inverser, à cause de désagréments croissants de la vie urbaine et des conséquences catastrophiques d'une telle politique sur l'environnement. Il a eu également raison d'attirer l'attention sur le fait que la diminution des naissances n'assurant plus le renouvellement de la population, la civilisation occidentale risquait de s'éteindre et d’être balayée par les peuples plus prolifiques.
Si Spengler évoque les problèmes de déracinement et de nomadisme, de massification et de prolétarisation, il n'a pas poussé l'analyse jusqu'à ses conséquences ultimes qu'étudiera Toynbee : affaiblissement du consensus (le prolétariat intérieur contestant le pouvoir abusif des élites dirigeantes), puis schisme social (révolte et sécession de classes sociales et de communautés jusque-là solidaires, qui n'hésitent pas à s'unir au prolétariat extérieur pour renverser un régime qui leur est devenu odieux). La théorie fédéraliste des crises accorde elle-même une importance primordiale à ces symptômes.
N'ayant fait qu'esquisser l'étude des transformations économiques qui s’opèrent dans les civilisations, Spengler se contente de dénoncer la dictature de l'argent qui mine progressivement les institutions (politiques, culturelles et judiciaires), ainsi que la progression inquiétante de l'économie spéculative au détriment de l'économie productive. Mais il ne dit rien des crises qui Jalonnent le développement du capitalisme — ni (les troubles qui les qui accompagnent (inflation, chômage, récession, etc.) — bien qu'ils n'aient pas épargné ses contemporains.
Force est donc de reconnaître que, dans l'ensemble, Spengler a envisagé avec clairvoyance l'évolution de la société occidentale et les dangers qui la guettaient, ses intuitions prophétiques compensant en quelque sorte les lacunes et les erreurs que nous avons relevées, et témoignant a posteriori de la pertinence de la méthode comparative qu'il inaugure. On peut toutefois regretter qu'en raison de son anti-intellectualisme et de son anti-scientisme, il ne se soit guère préoccupé de la doter de moyens d'investigations rigoureux, estimant à tort qu'une vaste culture, une longue familiarité avec l'histoire et ses dons de visionnaire suffisaient à garantir la validité de sa pratique.
Quant à la thèse qu'il défend, nous ne la partageons pas, estimant qu'il est encore trop tôt pour parler de déclin — en raison not. des progrès considérables que l'on continue d'observer dans le domaine des sciences et des techniques —, mais que la crise majeure à laquelle notre civilisation se trouve confrontée, atteignant aujourd'hui son paroxysme, celle-ci risque de s'engager sur la voie du déclin, si elle ne se décide pas à opérer les changements révolutionnaires qui peuvent seuls la tirer du mauvais pas dans lequel elle se trouve.
Nous n'en reconnaissons pas moins à Spengler le mérite d'avoir frayé la voie, avec J. Burckhardt (27), à l'histoire comparée des civilisations qui sera ensuite brillamment illustrée par A. Toynbee, J. Pirenne, G. Dumézil, P. Sorokin et N. Elias ; entreprise difficile et semée d’embûches (28), mais riche d'enseignements et qui devrait aider nos contemporains à affronter le présent et l'avenir avec une conscience plus claire de leurs responsabilités. Malheureusement les travaux des historiens et sociologues que nous avons cités, outre qu'ils sont souvent d'un accès difficile, ne portent pas tous sur la crise de la société occidentale, ne débouchent pas nécessairement sur une théorie des crises et ne proposent généralement aucune solution aux maux qu'ils décrivent. De plus, ceux qui traitent explicitement des crises ou du déclin des civilisations, s'inspirent d'une philosophie de l'histoire et de postulats tout aussi contestables que ceux de Spengler.
Sorokin, par ex., se réclame comme lui d'une vision cyclique de l'histoire, qui privilégie les facteurs culturels : réduisant la diversité des cultures à trois types de base — sensualiste, spiritualiste, idéaliste —, dont l'ordre de succession est immuable, il soutient que la civilisation occidentale, entrée pour la troisième fois dans l'Histoire, dans une phase “sensualiste”, depuis le XVe siècle, souffre désormais d'une crise très grave, dont elle ne pourra sortir qu'en revenant aux valeurs spiritualistes, dont elle s'est détachée (29). Quant à Toynbee qui est pourtant le plus proche de nos thèses, il établit un rapport nécessaire entre l'effondrement des civilisations et la naissance des religions universalistes (30). Ne voyant l'un et l'autre pas d'autre issue que dans un renouveau spirituel, on comprend qu'ils ne se soient pas préoccupés de chercher des solutions aux maux de ce bas-monde.
Le personnalime-fédéralisme prétend remédier à ces insuffisances et à ces lacunes. Conscients, des les années trente, que les sociétés occidentales subissaient une crise grave et de longue durée, et soucieux de leur épargner les épreuves douloureuses dont ils pressentaient l'approche, les penseurs de L'Ordre Nouveau se sont rendus compte que pour prouver la pertinence de leur diagnostic, il était nécessaire d'étudier les épisodes similaires auxquels plusieurs grandes civilisations du passé avaient succombé. Cette réflexion approfondie sur l'histoire devait leur permettre de construire une théorie générale des crises, à la lumière de laquelle il soit possible d'identifier leurs symptômes et de chercher les moyens d'y remédier. Depuis plus d'un demi-siècle, contre vents et marées, les fédéralistes poursuivent cette enquête, s'étant donnés pour objectif d'aider l'humanité à surmonter la crise, désormais planétaire, à laquelle elle se trouve confrontée. Aussi sont-ils les seuls, à notre connaissance, à proposer une doctrine et un programme d'action global et cohérent, conçus en fonction de cet objectif et d'une théorie des crises qui garantisse à la fois la pertinence du diagnostic et l'efficacité des solutions envisagées.
L'expérience prouve, malheureusement, que les hommes ont une fâcheuse tendance à ignorer ou supprimer les prophètes de malheur qui troublent leur quiétude, et à reproduire avec obstination les erreurs des générations précédentes. Mais, convaincus que l’espèce humaine est perfectible, nous gardons l'espoir que nos contemporains finiront par entendre la voix de la raison et par comprendre la nécessité de se mobiliser avant qu'il ne soit trop tard, au lieu de confier leur destin à des dirigeants inconscients dont la politique à courte vue et à court terme les entraîne, tête baissée, vers l'abîme.
► Mireille Marc-Lipiansky, L’Europe en formation n°306-307, 1997.
• Notes :
- L. Fèbvre, Deux philosophies opportunistes de l'histoire : de Spengler à Toynbee, article paru dans la Revue de Métaphysique et de Morale en 1936 ; figure dans Combats pour l'Histoire, A. Colin, 1992, pp. 120-126. Nous empruntons à cet article certaines précisions concernant l'accueil réservé au Déclin de l'Occident ; cf. également la préface d'A. de Benoist aux Écrits historiques et philosophiques de Spengler (Copernic, 1980).
- L’article cité de L. Fèbvre et celui de F. Braudel (dans Écrits sur l'Histoire, Flam., 1969, pp. 262-273) témoignent de la méfiance et de l'hostilité des historiens français, non seulement à l'égard de Spengler, mais aussi de Toynbee qui s’était engagé dans une entreprise similaire.
- L. Fèbvre laisse entendre dans l'article déjà cité (p. 124) que Spengler aurait été un des premiers adhérents du national-socialisme (sic).
- Cité par J. Freund dans La Décadence, Sirey, 1984, p.218.
- P. Valéry, La Crise de l'Esprit in Variétés I, Gal., 1919. L'influence du Déclin de l'Occident est particulièrement évidente dans A Study of History d'A. Toynbee (Londres, 1934) ainsi que dans La fin de la Renaissance (1919) et Le Nouveau Moyen-Âge (1924) de N. Berdiaev (Yncapress, Paris, 1924 ; L'Âge d'homme, 1985)
- Nous nous référons à l'édition française du Déclin de l'Occident, 2 vol, Gal., coll. Bibliothèque des idées, 1948, 1976 ; les chiffres romains entre parenthèses renvoient aux tomes I ou II et les chiffres arabes qui suivent aux pages de l'édition de 1976.
- cf. O. Spengler, Écrits historiques et philosophiques, p. 30.
- cf J. Piaget, Le structuralisme, PUF, coll. Que sais-je ?, 1968, pp. 6-16.
- cf. Stuart A. Kauffman, The Origins of Order – Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, 1993.
- Deux ouvrages ont joué un rôle essentiel dans cette prise de conscience salutaire : Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers, Random House, New-York, 1987 ; Allan Bloom, The Closing of the American mind. How Higher Education has failed Democracy and impoverished the souls of today's students, Simon and Schuster, New-York, 1987.
- cf. M. Marc-Lipiansky, Crises et Crise, Presse d'Europe, Nice, 1997.
- cf. Écrits …, p. 31.
- Cité par P. Braudel (dans Écrits sur l'histoire, p. 301) qui laisse entendre qu'il partage lui-même ce point de vue.
- cf. M. Marc-Lipiansky, Le structuralisme de Lévi-Strauss, Pavot, Paris, 1973 ; La théorie des systèmes à la lumière du fédéralisme in L'Europe en formation n° 263, print. 1986.
- cf. M. Marc-Lipiansky, La méthodologie fédéraliste, pp. 7-10, Presses d'Europe, Paris-Nice, 1980.
- L’édition du Monde du 15/02/1997 rend compte de cette polémique à laquelle est consacrée une page entière.
- cf. Écrits …, p. 13.
- cf A. Marc, « Dialogue avec la science » in L'Europe en formation n°273, autom-hiv. 1988.
- cf. Écrits …, p. 39.
- Cf M. Marc-Lipiansky, La révolution technologique in L'Europe en formation n° 302, hiv. 1996.
- Spengler précise qu'il n'emploie pas le terme de race au sens physiologique que lui donne la science et que, pour lui, l'expression “avoir de la race” désigne « quelque chose de cosmique et de dirigé, une harmonie sentie du destin, une marche et une allure égale dans l’être historique » (II, 150-151).
- Cf. A. Marc, Civilisation en sursis (La Colombe, 1955), pp. 170-187 ; La démocratie contre le peuple in L'Europe en formation, mai-juin 1981 ; F. Kinsky, Crise de la démocratie in L'Europe en formation n°271, print. 1988 ; M Marc-Lipiansky, Esquisse d'une économie fédéraliste, Presses d'Europe, 1993 ; Crises et Crise, Presse d'Europe, 1997, pp 28-29 : Faillite de la “stato-démocratie”.
- J'ai moi-même dénoncé ce phénomène dans mon article sur le totalitarisme in L'Europe en formation, n°280, hiv. 1990, pp. 90-94.
- Impérialisme et classes sociales, Flam., 1984, p. 44.
- L’Ordre Nouveau, n°9, mars 1934, p. 27.
- cf. L'Argent et L'Argent (suite), où il dénonce le triomphe de “l'Argent-Roi”.
- Considérations sur l'Histoire universelle (1905).
- Elle exige en effet une vaste culture, un labeur acharné et expose ceux qui ont le courage de s’y engager aux critiques acerbes des spécialistes qui ne leur pardonnent pas d’oser s’immiscer sur le territoire exigu qu’ils ont défriché toute leur vie !
- Cf. P. Sorokin, Social and Cultural Dynamics (1941) ; ouvrage partiellement traduit en fr. in Comment la civilisation se transforme, Librairie M. Rivière, 1964.
-
cf A. Toynbee, L'Histoire, Elsevier-Séquoia, Paris-Brux., 1975 (version revue, corrigée et illustrée de la 1ère éd. abrégée, publiée chez Gal. en 1951). L’A. a commencé à écrire A Study of History en 1920 et à le publier en 1923. Nous en rendons compte dans Crises et Crise, pp. 15-24.

Théories de l’espace et géopolitique du libéralisme
À propos de quelques affinités entre Spengler et Schmitt
À Enrico B.
 Le libéralisme et le socialisme, à l’instar de leurs innombrables déclinaisons, seraient-ils désormais les deux seuls systèmes de pensée déterminants en Occident ? Cela est sans doute vrai si l’on se réfère à l’Occident sécularisé. On identifie souvent l’origine de ces pensées de la modernité avec la fracture scientifique et artistique opérée à la Renaissance, et leur triomphe avec le cinquantenaire révolutionnaire 1789-1848, l’essor formidable de la classe ouvrière permettant la propagation de théories d’inspiration sociale très marginales jusqu’alors, qui restaient en état d’incubation dans les milieux éclairés (les utopies sociales, par ex.). Qu’est-ce qui explique qu’en deux cents ans à peine on soit passé d’une conception traditionnelle de la société, basée sur une interaction ou une opposition entre les plans temporel et spirituel, voire sur une confusion de ces deux ordres, lesquels fusionnaient parfois, en prenant tour à tour la forme de la théocratie ou d’une sacralisation du monarque (qu’il s’agisse du roi d’une nation ou d’un empereur à vocation plus universelle), à une conception moderne du corps social démocratiquement représenté ? Les réponses sont multiples. Là aussi, on prendra garde de ne pas sacrifier à une interprétation trop réductrice procédant d’une lecture de l’histoire politique et des idées reposant sur des systèmes clos et simplificateurs, visant par ex. à amalgamer tous les “anciens régimes” occidentaux, indistinctement étiquetés comme États réactionnaires, obscurantistes et ennemis des Lumières.
Le libéralisme et le socialisme, à l’instar de leurs innombrables déclinaisons, seraient-ils désormais les deux seuls systèmes de pensée déterminants en Occident ? Cela est sans doute vrai si l’on se réfère à l’Occident sécularisé. On identifie souvent l’origine de ces pensées de la modernité avec la fracture scientifique et artistique opérée à la Renaissance, et leur triomphe avec le cinquantenaire révolutionnaire 1789-1848, l’essor formidable de la classe ouvrière permettant la propagation de théories d’inspiration sociale très marginales jusqu’alors, qui restaient en état d’incubation dans les milieux éclairés (les utopies sociales, par ex.). Qu’est-ce qui explique qu’en deux cents ans à peine on soit passé d’une conception traditionnelle de la société, basée sur une interaction ou une opposition entre les plans temporel et spirituel, voire sur une confusion de ces deux ordres, lesquels fusionnaient parfois, en prenant tour à tour la forme de la théocratie ou d’une sacralisation du monarque (qu’il s’agisse du roi d’une nation ou d’un empereur à vocation plus universelle), à une conception moderne du corps social démocratiquement représenté ? Les réponses sont multiples. Là aussi, on prendra garde de ne pas sacrifier à une interprétation trop réductrice procédant d’une lecture de l’histoire politique et des idées reposant sur des systèmes clos et simplificateurs, visant par ex. à amalgamer tous les “anciens régimes” occidentaux, indistinctement étiquetés comme États réactionnaires, obscurantistes et ennemis des Lumières.Pour en revenir à la dyade libéralisme-socialisme, deux modes de pensée souvent assimilés par les auteurs qui seront étudiés dans les prochaines pages, on peut dire que depuis la chute de l’Union soviétique, on assiste à une révision des stéréotypes idéologiques anti-libéraux ou anti-socialistes. Concernant le socialisme, il est courant de le séparer de l’expérience maximaliste, marxiste puis léniniste, et de tous ses avatars : tout en associant sa naissance à la diffusion européenne de la révolution industrielle, on le déclare soluble dans la démocratie libérale, cette idéologie se dégageant de son essence révolutionnaire initiale pour gagner une maturité réformiste, cette maturité calquant en quelque sorte le mouvement ascendant du progrès (1). On passerait ainsi de la préhistoire du socialisme à son ère de plein épanouissement, à une réconciliation du travail et du capital dans un environnement économique aux relations globalisées. À l’heure de la mondialisation du modèle démocratique, on disserte donc sur les perspectives de la social-démocratie.
Ce pourrait être là un artifice de la pensée capable de nier la survivance et même le redéploiement d’un axe socialiste d’ancien style, sur le modèle des républiques socialistes qui ont survécu à l’effondrement de l’URSS. Les modifications constitutionnelles du Venezuela dirigé par Hugo Chávez et ses tentations castristes n’en sont qu’un exemple récent. La lutte antilibérale et altermondialiste apparaît aujourd’hui comme un ultime viatique pour les mouvements issus du marxisme ou des divers fronts libertaires ; c'est même peut-être leur dernière raison d'être. Paradoxalement, je tenterai d’expliquer pourquoi des auteurs provenant d'un front politiquement opposé à cet axe dit “gauchiste” en sont très proches lorsqu'ils affrontent le libéralisme, l'ennemi commun.
De même, la fin de la guerre froide ne signifie aucunement l'interruption du conflit entre États-Unis d'Amérique, Russie et Chine : celui-ci reste actuel dans le domaine stratégique et énergétique, bien que, en parallèle, se multiplient les échanges commerciaux et les partenariats conformément à la logique de l’ouverture libérale des marchés et de la circulation des personnes. L’ère multipolaire a aussi permis une réflexion plus apaisée et salutaire sur l’essence du libéralisme et ses fins, par-delà les clichés hérités de la vulgate marxiste. De plus, de nombreux penseurs (2) s’efforcent aujourd’hui de distinguer le libéralisme du capitalisme prédateur à un moment de notre histoire où la mondialisation est souvent perçue comme la phase ultime du capitalisme, caractérisée par la dérégulation des marchés et par la libération des flux financiers et humains ; on pressent qu’un développement non maîtrisé du processus de libéralisation mondial des marchés entraînerait des bouleversements structurels marquant une régression à l’état de nature hobbesien. D’où l’urgence, chez ces auteurs, de redéfinir un libéralisme humaniste et éthique. L’exercice est périlleux dans la mesure où l’on tente de distinguer l’idéologie de son application pratique, l’idée de sa forme ; certes, la tentation est grande, d’autant plus grande que l’on peut accuser les pratiques libérales actuelles de déviance, en s’appuyant sur maints penseurs libéraux classiques qui condamnent les excès de l’individualisme et de la concurrence sauvage. Comme dans le cas d’une révision du socialisme, il s’agit là de séparer la doctrine, bonne en soi, de son application dans le temps et l’espace. Cette dernière ne serait qu’un détournement, qu’une falsification du libéralisme authentique, de même que les totalitarismes issus du socialisme révolutionnaire ne seraient que des mises en œuvre partielles ou détournées des doctrines marxistes. Par-là, je ne veux aucunement signifier que ces entreprises de révision interprétative équivalent aux exercices oiseux d’intellectuels engagés dans l’un ou l’autre camp et qui souhaiteraient redorer le blason de leur fief idéologique.
Récemment, donc, se multiplient les essais consacrés au libéralisme et visant à débarrasser cette idéologie de tout a priori qui la confondrait avec un individualisme forcené. Elle serait donc bien une philosophie individualiste, mais il s’agirait d’un individu respectant la liberté d’autrui, conformément à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme (3). Au contraire, les prochaines pages seront consacrées à des penseurs issus de la contre-révolution, lesquels, tout en distinguant la liberté des échanges et le libéralisme comme l’on distingue un simple état de fait d’ordre économique (l’échange commercial) de sa justification idéologique (les doctrines libérales), ont tenté de mettre en lumière les dégâts occasionnés par certaines pratiques libérales sur l’État et la nation. Nous toucherons ici à des concepts difficilement définissables, puisque de l’ordre de la valeur : l’âme d’un peuple ou l’interrelation entre un individu et son environnement géographique, éléments fondamentaux pour comprendre le développement dans les années 20 et 30 d’un mouvement protéiforme antilibéral, antidémocratique et anti-marxiste, fréquemment désigné comme “fasciste”, en ignorant que ce mouvement — ou plus exactement ces mouvements, souvent fort différents et aux intérêts divergents — revendiquaient des idées socialistes ou une pratique raisonnée du libéralisme économique.
Plus spécifiquement, au-delà de l’analyse de la critique antilibérale, il s’agira d’approfondir la filiation existant entre la pensée d’Oswald Spengler et celle de Carl Schmitt, deux intellectuels allemands hâtivement affiliés à la protéiforme Révolution conservatrice (4) européenne, qui comptera dans ses rangs, sans les confondre, des personnalités aussi différentes qu’Ernst Jünger (5), Carl Schmitt, Ernst Niekisch (6) ou Thomas Mann (7). En partant des écrits de Spengler publiés à la fin de la Première Guerre mondiale, je voudrais démontrer que la critique culturelle et anti-moderne du libéralisme se double à cette époque, en Allemagne, d’une revendication géopolitique pangermaniste. Bien plus tard, dans les années 40 et 50, ces idées semblent avoir influencé partiellement les méditations schmittiennes sur l’espace et le nouvel ordre planétaire. La corrélation entre espace, culture et droit, qui est inhérente à leur critique de l’idéologie libérale et de son corollaire, l’idéologie de la machine, fait l’originalité de cette “réaction”, certes issue de la contre-révolution mais qui a des qualités propres et se défie de tout passéisme.
La lecture comparée approfondie entre Schmitt et Spengler, ainsi que l’étendue d’un sujet portant sur l’antilibéralisme conservateur, m’ont obligé à limiter notre étude à ces deux penseurs ; toutefois, par des renvois ponctuels, je m’efforcerai de situer leurs analyses dans le contexte plus vaste de la Révolution conservatrice européenne, au plus fort de ce que d’aucuns ont appelé — en se fondant sur des catégories essentiellement schmittiennes — la guerre civile européenne (8). Au terme de la présente recherche, je proposerai l’hypothèse suivante : le court essai Terre et mer de Carl Schmitt viendrait en quelque sorte compléter et préciser la réflexion spenglerienne sur l’essor mondial du capitalisme moderne.
La place de l’économie dans l’œuvre de Spengler (1918-1920)
Dans le premier tome du Déclin de l’Occident (1918), œuvre qui le rendit mondialement célèbre, Oswald Spengler consacre peu d’espace à la pensée économique qui, à l’instar de la politique, ne serait qu’un « aspect de l’être historique » (9) et donc des grandes civilisations plurimillénaires ; mais il ne reconnaît guère qu’à l’Égypte une civilisation proprement économico-technique de grand style, véritable hapax dans l’Antiquité, dont les civilisations vivaient leur temps en dehors de l’histoire, ce qui ne leur interdisait pas certaines pratiques financières rudimentaires (10). De fait, l’économie ou, mieux, le triomphe de la mentalité économique, est typique avant tout de la pensée bourgeoise anglo-saxonne, et en cela symptôme d’une fin de cycle, d’un irréversible « déclin ».
Concernant l’Europe occidentale, terreau du capitalisme et du devenir historique, il souligne, à travers un de ces raccourcis foudroyants dont il avait l’art, que son « économie commença par les cultures exemplaires des ordres religieux et atteignit son sommet dans une science propre, l’économie politique, qui fut dès l’origine une hypothèse technique, enseignant proprement non ce qui est arrivé, mais ce qui devait arriver » (DO, t. 1, p. 139). L’économie n’est au fond qu’une conséquence de l’âme faustienne, toute tendue vers un devenir, un destin ; ainsi, lorsqu’il établit des analogies morphologiques entre art et économie, par ex. entre l’art impressionniste et le travail de l’ouvrier à l’ère des grandes révolutions industrielles, le parallèle n’est là au fond que pour illustrer la signification intérieure de ces deux épiphénomènes, artistique et économique, à savoir la poussée faustienne vers un monde froid, écrasé par la technique (11), elle-même menacée par la pensée financière, tout à fait dématérialisée. Le discours spenglerien sur la technique est bien connu et il semble inutile qu’on l’approfondisse, le texte se suffit à lui-même ; on soulignera toutefois que ce n’est pas l’économie en soi qui est condamnée (12) — les échanges de biens et de valeurs étant constitutifs de l’histoire mondiale, spécifiquement de l’Occident — mais son hypertrophie, accélérée par le machinisme depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle (13).
Il n’est donc pas surprenant que l’élément économique devienne pour Spengler un trait essentiel du césarisme, dont il fut le prophète et qu’il appela de ses vœux en misant sur un rôle catalyseur de l’Imperium allemand et de ses élites. Il est clair que les échanges économiques et les progrès techniques qui en résultent contribuent à une unification, une simplification du monde, à laquelle correspond la figure impériale dans sa version sécularisée (le césarisme et son corrélatif, l’impérialisme, sur lequel nous reviendrons). Intuitivement, Spengler pressent que la mondialisation subit une accélération sans précédent au XXe siècle, en particulier lorsqu’il s’interroge sur la physionomie des futurs « États-Unis d’Europe » qui, peut-être, seraient réalisés au XXIe siècle « par un homme d’affaires césarique en organisme économique » (DO, t. 1, p. 152) ; nous ne sommes guère éloignés de l’actuelle configuration de l’Union européenne dans sa dimension technocratique.
Spengler se refuse de proposer une lecture technique de l’économie, toute tendue vers la croissance continue de la production, ce qui est le propre, selon lui, des penseurs libéraux ou marxistes. Il insiste en revanche sur la nécessité de recourir au symbolique pour interpréter le fait économique : comme il le faisait remarquer dans l’introduction à son monumental essai sur la morphologie historique, par-delà l’apparence des formes, même les événements banaux du politique « prennent un caractère symbolique et franchement métaphysique » (14). De même, l’économie (la figure des échanges, « die Gestalt […] des Verkehrs ») (15) possède indirectement sa symbolique, a fortiori à l’ère du triomphe de la technique. Cette vision physionomique, intuitive et surnaturelle, qu’il partage notamment avec Ernst Jünger, nous sera précieuse pour bien appréhender le conflit géopolitique et spirituel avec l’Angleterre, génitrice du modèle libéral. Nous avons ici affaire à un topos de l’antilibéralisme propre à la majeure partie des intellectuels rattachés à la Révolution conservatrice.
L’économie pour Spengler reste soumise au relativisme intrinsèque et revendiqué de sa méthode d’analyse historique ; le passage de la Culture à la Civilisation suit le mouvement naturel de la naissance, de l’évolution et de la mort biologique (16), ce qui l’amène à minimiser la portée de la révolution technique occidentale : pour ne citer qu’un exemple devenu célèbre, l’explosion démographique et l’essor des villes (« les villes mondiales anorganiques ») (17), qui connurent une accélération sans précédent au XIXe siècle, conséquences logiques d’un processus économique technicien au détriment d’une économie agricole traditionnelle, sont certes une révolution (un « destin »), mais ils ne sont au fond que la répétition, à une échelle bien supérieure, d’un processus similaire qui affecta la cité antique au IVe s. ap. JC (DO, t.1, p. 43 sq). Malgré ce relativisme méthodologique, Spengler insiste sur la fracture véritable opérée par la révolution industrielle britannique et l’essor du capitalisme mondial :
La situation insulaire de l’Angleterre a déterminé, dans toutes les théories économiques, la conception de la politique et de ses rapports avec l’économie. Les fondateurs de cette image économique sont David Hume et Adam Smith. Tout ce qui s’est écrit depuis, sur ou contre eux, pour les dépasser, suppose toujours inconsciemment la base critique et les méthodes de leurs systèmes. C’est le cas de Carey et de List, aussi bien que de Fourrier et de Lassalle. […] Ce dont il s’agit depuis Smith jusqu’à Marx, c’est simplement d’analyser soi-même la pensée économique d’une seule culture et dans une seule de ses phases. Analyse rationaliste d’un bout à l’autre, et qui part donc de la matière et de ses conditions, les nécessités et les besoins, au lieu de partir de l’âme des générations, des ordres, des peuples et de leur force plastique. Elle considère l’homme comme un accessoire de la situation et ignore tout de la grande personnalité et de la volonté plastique historique des groupes particuliers et généraux, qui voient, dans les réalités économiques, des moyens et non des fins (18).
En somme, pour Spengler, la vie économique est d’abord « l’expression d’une vie psychique » (DO, t. 2, p. 432). Les moyens auxquels il fait allusion à la fin de la citation sont de l’ordre de l’économie, alors que les fins n’appartiennent qu’à la haute politique. L’inversion de la fin et du moyen est symptôme de déclin. On se souviendra aussi, au début de la longue citation, de la référence à un certain déterminisme géographique, l’insularité anglaise orientant l’élan capitaliste mondial. Cet aspect est peut-être le point de départ de la réflexion spenglerienne sur le libéralisme dans sa relation à l’esprit faustien et nous y reviendrons longuement.
Avant de décrire et d’expliquer l’importance de la notion d’espace dans la l’explication spenglerienne de la genèse du capitalisme mondial (19), il reste à préciser la place que le penseur assigne à l’argent dans le système moderne du libre-échange. La notion même d’„argent’, sur laquelle s’exercèrent dès le Moyen Âge, saint Thomas et toute l’école franciscaine (20), en la reliant à des notions de temps et d’espace, et, spirituellement, de justice et de communion fraternelle, n’est envisagée par Spengler que négativement (21) : l’argent, au IVe ou au XIXe et XXe siècle — lorsqu’il n’est plus perçu comme « biens qui doivent leur valeur à leur rareté et à leur résistance » (DO, t. 2, p. 445) mais comme valeur pure, valeur en soi —, ne peut au fond que conduire aux excès du capitaliste et „tuer’ la Culture ; l’argent n’est plus alors qu’une « grandeur anorganique, abstraite, dépouillée de tout rapport avec le sens du sol fertile [« Sinn des fruchtbaren Bodens », UA, p. 46] et les valeurs d’une économie domestique primitive » (DO, t. 1, p. 45). À ce stade de l’étude, il faut signaler l’importance des données spatiales (l’insularité versus le sol fertile) dans sa réflexion sur l’économie libérale. Cela l’amène à établir un parallèle entre la décadence romaine (panem et circenses) et la décadence occidentale (22) (idéologie du sport comme fin en soi, lutte pour les salaires etc.). Ailleurs, il écrit :
Ainsi le concept d’argent touche à l’abstraction complète. Il ne sert plus à comprendre les relations économiques, il assujettit le cours des denrées à sa propre évolution. Il n’apprécie plus les objets entre eux, mais par rapport à lui. Son rapport au sol, et à l’homme né du sol, est si complètement effacé que la pensée économique des villes dirigeantes, „les places d’argent’, n’en tiennent plus aucun compte. Aujourd’hui, chez l’être éveillé de l’élite économique active, l’argent est devenu une pure puissance spirituelle dont le métal n’est qu’une simple représentation, et qui tient sous sa tutelle le financier comme la terre d’autrefois le paysan (23).
En amont de cette fracture entre le sol et l’argent apatride, il y a la pensée spenglerienne du « Raum ». L’espace a une valeur autant économique que symbolique, il est donc créateur ; à l’inverse, le paysage urbain est négateur de cette interrelation entre l’individu et son environnement naturel :
Aux temps les plus reculés, l’image rurale seule domine la vue de l’homme. Elle pétrit l’âme humaine et s’envole avec elle. Un même tact régit les modes de sentir de l’homme et le bruit des forêts. Le visage, la démarche, le costume même de l’homme sont rivés aux prairies et aux buissons. Avec ses toits muets semblables à des collines, avec ses fumées vespérales, ses fontaines, ses enclos, son bétail, le village est complètement perdu, alité, dans le paysage. […] La silhouette de la ville contredit les lignes de la nature. Elle nie toute nature. Elle veut s’en distinguer, la dépasser (24).
La fracture polémique et systématique entre ville et campagne est une des thématiques les plus célèbres du Déclin de l’Occident, sans doute parce que ce sont des pages parmi les plus limpides, aux accents fortement littéraires. On ne devrait pas, cependant, croire que Spengler, pourfendeur des zones urbaines, idéalise la campagne ; certes, il reste l’héritier d’une culture völkisch séculaire (25), qui projette une image noble et vivante des cultivateurs, en lutte à la fois contre la nature sauvage et la ville déshumanisante, et il ne fait nul doute que pour lui les valeurs de la paysannerie sont authentiques et propres à la « Kultur » mais, non sans un certain désenchantement, il décèle dans la ville mondiale, fourmillante et laborieuse, l’aboutissement d’un processus inéluctable, caractéristique de ce qu’il nomme « l’histoire supérieure », par contraste avec le monde paysan anhistorique ; cela le porte même à conclure que « l’histoire universelle est l’histoire des cités » (26).
Par opposition à l’attachement à la terre (« Boden », chez Spengler), qui unit esprit et corps dans la Patrie (traduction très imparfaite du « Heimat » spenglerien, et allemand en général), il y a chez l’homme faustien, chez l’homo œconomicus des temps modernes une tension vers l’extérieur (vers l’infini) que Spengler associe globalement avec l’impérialisme (27) (dont le césarisme est la figure contemporaine) (28) :
J’enseigne ici l’impérialisme, dont l’Égypte, la Chine, le monde romain, indou, islamique, sont les formes pétrifiées qui subsistent encore durant des siècles et des millénaires et qui sont susceptibles de passer de la poigne d’un conquérant à l’autre — […] l’impérialisme comme symbole typique de la fin. Impérialisme est civilisation pure. Le destin de l’Occident est dans ce phénomène irrévocable. L’homme cultivé a son énergie dirigée au-dedans, le civilisé en dehors (29).
Quoique adversaire de la décadence, Spengler se résigne ici à l’impérialisme des États imposé par la fin de cycle de la Civilisation, et ce en conformité avec le fatalisme implicite de sa physionomie historique, dominée dans les temps modernes par la susdite « tension » ivre vers l’avant, vers l’avenir. Cette tension, caractéristique du passage de la Culture à la Civilisation, s’inscrit dans un continuum héraclitéen ; Spengler en précise les formes en recourant à la distinction conceptuelle opérée par Goethe entre “devenir” et “devenu” (« das Werden und das Gewordene », UA, p. 71), entre vie et mort. Dans le chapitre consacré au « Problème de l’histoire universelle » (DO, t. 1, chap. II), Spengler formule spatialement cette distinction, en détaillant l’opposition — devenue célèbre — entre nature et histoire : la représentation naturelle et lyrique du monde se nomme : « étendue » (Ausdehnung), et sa représentation géométrique et “matérialiste” : « direction » (Richtung). Ces deux formes de représentation du monde se réalisent immédiatement par la vue, qui est ce lien entre l’homme (qui observe) et la nature (qui est observée). Concrètement, suivant les modalités de la morphologie historique énoncées par Spengler, ces deux types de représentation vont se heurter et laisser leur empreinte sur les conceptions modernes de l’économie. Dans ce duel, les deux acteurs principaux seront l’Angleterre et l’Allemagne, l’esprit libéral contre l’esprit prussien ; pour anticiper la réflexion géopolitique de Schmitt, la mer contre la terre.
Aussi l’ouverture spatiale sur les océans, due à l’insularité de l’Angleterre, stimule-t-elle l’élan capitaliste et conquérant : pour reprendre la distinction fondamentale entre nature et histoire et traduire en termes spengleriens cette lutte entre deux âmes, on passe ainsi de l’« impression cosmique naturelle » des Vikings ou des premiers corsaires britanniques, impression stimulant le désir d’aventure et l’exploration de l’« étendue », à l’« impression cosmique historique » (30) du capitalisme triomphant, celles des flottes marchandes et militaires occidentales, dont la « direction » des flux, financiers et humains, est rationalisée par les échanges économiques, dans le but de faire de la planète le terrain d’une prédation globale, organisée par ces figures titaniques (pour emprunter une analogie jüngerienne) (31) que sont les hommes d’affaires modernes : Cecil B. Rhodes, par ex., qui annonce — prophétisait Spengler il y a près d’un siècle — « un type d’homme très symptomatique du XXIe siècle », est maintes fois cités comme figure emblématique du césarisme à venir (DO, t. 1, p. 333).
Cette méthode, que Spengler désigne comme physionomique (« die Physiognomische Art ») et qui se veut une approche historique du cosmos, nous semble être une bonne clef de lecture de la géographie économique déployée dans Prussianité et socialisme.
“Dans ce sens-là le site est créateur” (32) : vers une géo-symbolique spenglerienne
Prussianité et socialisme est publié par Spengler en 1919. Cependant, le projet initial de ce livre semble avoir vu le jour avant même que l’Allemagne ne soit militairement vaincue. Spengler va jusqu’à indiquer — et ces informations sont des plus précieuses — que Prussianité et socialisme « est issu de notes destinées au Déclin de l’Occident, notamment au deuxième tome [paru en 1922], notes qui constituèrent même, partiellement, le germe à partir duquel toute cette philosophie s’est développée » (PS, p. 17). D’une part, dans cet essai assez court, Spengler prend acte de la défaite à plus ou moins long terme de la civilisation occidentale et énonce les valeurs du dernier imperium occidental, qui parachèverait ce cycle civilisationnel descendant (33) ; cela en conformité avec les théories morphologiques du Déclin de l’Occident, dont le premier tome a été publié, rappelons-le, en 1918 (34). Les deux courants dynamiques et contraires qui tentent d’informer le dernier acte du tragique déclin occidental sont bien connus : l’un et l’autre d’esprit faustien, tendus frénétiquement vers l’avenir, Spengler désigne d’une part le capitalisme anglo-saxon, mercantile, progressiste et maritime, et, de l’autre, le socialisme allemand, organique et enraciné dans le Boden national. Pour Spengler, il s’agit, par contraste, d’indiquer à ses contemporains le chemin devant conduire à un empire germanique ultime, un manuel pratique pour restaurer ce Reich décrit plus tard par Arthur Moeller van den Bruck (35) et fantasmé, dans sa vision la plus délirante et raciste, par le national-socialisme (36). La problématique du nationalisme et du “socialisme allemand” ne peut se réduire à sa version nationale-socialiste, nazie, celle-ci apparaissant comme la déclinaison la plus caricaturale et la plus odieuse d’une idéologie socialiste identitaire qui naît et se développe dans le contexte de l’Unité allemande, simultanément au sein et au-delà des partis et tendances politiques, soient-ils progressistes ou conservateurs (37).
Spengler publie donc Prussianité et socialisme dans l’intention d’agir politiquement sur la société allemande. En effet, Spengler n’écrit pas pour le simple plaisir de philosopher (de fait, il fait bien peu de cas de la philosophie « pratiquée pour l’amour d’elle-même ») (38), il entend bien proposer des règles éthiques et politiques à ses compatriotes défaits au terme de quatre années de combats, et cela afin qu’ils deviennent les acteurs authentiques de leur destin (39), qui doit conduire à la « maturité » (Vollendung), sous forme d’apothéose, du cycle historique occidental.
D’ailleurs, on remarquera que Spengler inscrit explicitement Prussianité et socialisme dans le cercle « de l’éthique » (40), alors que le Déclin de l’Occident ressortissait plutôt d’une approche fondée sur sa doctrine révolutionnaire (quoique ancrée dans une tradition ancienne, qui va d’Héraclite à Polybe, du Machiavel des Discorsi à Vico, pour ne pas citer les grands maîtres de la pensée allemande, à laquelle il se rattache plus volontiers) (41) de la morphologie historique. Cette éthique, quelle est-elle ? Il semble que Spengler, bien qu’il ait eu en horreur tout racisme biologique, n’en demeure pas moins un adversaire du métissage et crée une catégorie irrationnelle : l’âme des peuples (42) ; dans Prussianité et socialisme, il définit celles des deux dernières grandes civilisations occidentales, l’Allemagne et l’Angleterre (la France, patrie qu’il juge individualiste et anarchisante, ne méritant pas selon lui qu’on s’y attarde) (43). Ces catégories sont autant de stéréotypes qui auront la vie dure dans les milieux révolutionnaires-conservateurs et qui sont l’héritage d’une pensée antérieure à 1914 ; mais limiter l’attribution de stéréotypes à la seule Allemagne, ou aux seules pensées totalitaires, serait une erreur grossière ; en effet, à la même époque que Spengler, les travaillistes anglais n’hésitaient pas à enfermer leurs „frères’ du SPD dans des catégories étroites, à leur associer tous les stéréotypes les plus rebattus sur le prussianisme et le socialisme allemand (44).
On l’a dit, Prussianité et socialisme est de l’ordre de l’éthique et se veut indirectement comme un manuel pratique énonçant les valeurs devant guider l’Allemagne en plein cataclysme militaire. On se souvient aussi que les notes à l’origine de ce texte central semblent avoir été, de l’aveu même de Spengler comme on l’a rappelé, le terreau de son ambitieux traité sur Le déclin de l’Occident. Il est donc légitime de supposer que l’opposition d’âme entre Allemagne et Angleterre, étudiée aussi dans sa dimension économique, a été comme le déclencheur d’une réflexion plus profonde, plus large, puisqu’elle englobe l’histoire de l’humanité dans son entier.
La dimension économique de la dyade âme allemande / âme anglaise nous semble primordiale, puisque l’élément politique ne vient qu’en second lieu, comme conséquence de bouleversements économiques, eux-mêmes indissociables de motivations métaphysiques plus profondes et celées, ces « énergies » d’ascendance héraclitéenne, si chères à Spengler, qui meuvent les destinées des peuples. “L’être anglais” n’est pas, dans la perspective spenglerienne, lié au sang, c’est plutôt une façon de penser nocive qui peut corrompre les Allemands eux-mêmes ; cela l’amène à écrire qu’il existe, depuis Napoléon jusqu’aux jours funestes de 1918, une armée anglaise “allemande”, « une caricature allemande de la nature anglaise » (45).
Spengler livre une interprétation impitoyable de l’âme anglaise libérale, façonnée par l’insularité, métaphore symbolique et dynamique de son individualisme (46), entendu aussi comme isolement ; comme plus tard chez Schmitt, à l’origine de la géopolitique on trouve ce que je nommerais volontiers une géo-symbolique, amplement décrite, concernant l’Allemagne et l’Angleterre. En synthèse, Spengler écrit que « Pour l’instinct anglais, le pouvoir appartient à l’individu ; libre affrontement des uns contre les autres, triomphe du plus fort : libéralisme, inégalité. Plus d’État. Que chacun se batte pour soi-même, en dernière instance cela profite à tous. […] La Révolution anglaise qui a créé le type de l’homme privé, indépendant, responsable en son âme et conscience, ne se référait pas du tout aux ordres (Stände) mais à l’État. L’État a été aboli comme entité temporelle et spirituelle et remplacé par la situation, avantageuse, de l’insularité » (PS, p. 33). J’essaierai d’expliquer comment Carl Schmitt s’est emparé de ce diagnostic et l’a amplement développé.
La phrase de la précédente citation est soulignée en italiques par l’auteur lui-même et anticipe parfaitement les développements à venir : implicitement on comprend que l’État, orgueil du peuple allemand (l’un au service du tout, d’où l’idée d’un socialisme autoritaire), n’a plus guère de signification pour l’Anglais, qui lui substitue volontiers un autre Status, celui de l’insularité, pôle d’irradiation de l’esprit mercantile dans le monde, par opposition à l’Heimat allemand, terrien et lié au sang. On rejoint ici, me semble-t-il, le cœur même de la pensée spenglerienne, de sa distinction Kultur / Zivilisation : à l’origine, on trouve pour chaque Kultur « une race au sens de race de l’esprit » (par extension, une âme anglaise, française, allemande…), autonome ; les « influences historiques » sont secondaires par rapport à l’intériorité des cultures. Citant alors les contextes géographiques où s’épanouirent les « hautes cultures » (liées à un fleuve : Nil, Euphrate, Gange etc.), Spengler conclut que les peuples « ne sont pas créateurs mais créations de ces cultures » (PS, p. 42-43).
Un peu plus loin, on constate que si la culture et l’âme d’un peuple sont déterminantes, la configuration géographique peut s’avérer tout autant créatrice historiquement. Il faut pour cela se reporter au douzième chapitre, inclus dans la partie intitulée « Anglais et Prussiens ». Ces deux âmes, anglaise et prussienne, quoique de souche commune, ont chacune développé un destin propre, en partie conditionné par la géographie, leur extérieur naturel ou « site », pour reprendre la terminologie spenglerienne :
Ainsi prirent naissance le type anglais et le type prussien. C’est là la différence entre un peuple dont l’âme s’est formée dans la conscience de son insularité et un peuple qui a défendu une marche laquelle, sans frontière naturelle, était de toutes parts exposée à l’ennemi. En Angleterre ce fut l’île qui tint lieu d’État organisé. Un pays sans État n’était possible qu’à cette condition qui explique l’âme anglaise moderne telle qu’elle prit conscience d’elle-même au XVIIIe siècle, lorsque l’Anglais devint maître incontesté de l’île britannique. Dans ce sens-là, le site est créateur : le peuple anglais se forma lui-même (47).
Et Spengler de s’étendre sur les vertus créatrices du « site de la Marche » (Ibidem), qui fut le berceau du prussianisme des Hohenzollern ; originaires du Sud, leur éthique prussienne n’aurait pu naître et se développer, là aussi, que sous l’influence du « site ». Cette idée du site créateur, du paysage naturel comme activateur de symboles, est déjà présente dans le chapitre le plus métaphysique du Déclin de l’Occident, « Macrocosme » : au terme d’une longue juxtaposition de ces supports naturels aptes à déclencher l’imagination symbolique, Spengler parle de « Nähe und Ferne » (UA, p. 211), que l’on pourrait traduire par « ce qui est proche et ce qui est éloigné ». Tazerout, dans sa traduction en français, l’a rendu par « sites proches et lointains » (DO, t. 1, p. 162) : selon nous, cela réifie des concepts que Spengler veut proprement dynamiques, susceptibles — selon ses propres termes — de réveiller des « impressions symboliques du cosmique sur nous qui sommes éveillés et qui entendons bien ce langage aux heures du recueillement » (ibidem). On voit mieux alors se préciser ce qui unit le symbole à l’espace, notamment si on relie ces concepts à l’idée spenglerienne d’« étendue », qui fonde chez notre auteur ce que j’ai maladroitement désigné comme une géo-symbolique, très éloignée de tout déterminisme géographique — par ex. du conditionnement de l’espace pur chez Ratzel. Oswald Spengler postule donc l’influence du site sur la créativité humaine, mais réfute toute détermination mécanique de la géographie sur l’être pensant (48), même s’il est vrai que sa terminologie reste à ce sujet ambiguë.
Dans le chapitre fondamental « Macrocosme », le philosophe allemand prend même à tâche de démontrer que le problème de l’espace, en particulier l’interprétation occidentale et euclidienne de cet espace perçu comme infini pur, est Le problème principal de l’humanité, celui auquel chaque Culture tente d’apporter une réponse suivant sa propre « espèce d’étendue », comprise comme son « symbole primaire » (49).
Dans l’important essai L’homme et la technique, Spengler précise sa pensée de l’espace, et tout spécialement le lien unissant vision, prédation et domination du paysage, ces éléments caractérisant certes l’homme dans son destin unique d’être historique, mais portant en eux-mêmes tous les germes de l’esprit faustien (l’impérialisme) ; sa conception tragique d’une humanité issue de l’animal carnivore et d’un monde considéré à la fois comme champ de vision et champ de bataille, est ici parfaitement résumée :
Le fait même que chez les grands carnivores, comme chez l’homme, les deux yeux puissent être centrés sur un point de l’environnement, permet à l’animal de lier sa proie. […]. Et la faculté de fixer ainsi les choses à l’aide de deux yeux disposés en avant et parallèlement, équivaut à la conception même du monde, tel que l’homme le possède : à savoir un panorama, un monde visuel. Ce monde n’est pas simplement composé de lumières et de couleurs, mais encore de distances, d’espaces et de mouvements dans l’espace, ainsi que d’objets localisés en des points bien définis. Cette façon de voir, propre à tous les carnivores supérieurs […] contient déjà en soi la notion de domination. L’image du monde est l’environnement tel qu’il est ordonné par les yeux. Les yeux de l’animal de proie définissent les choses suivant leur position et leur éloignement. […]. Il y a un infini sentiment de puissance dans cette calme vision panoramique, une sensation de liberté prenant sa source dans la supériorité, fondée sur la conscience d’être le plus fort et de n’être une proie pour nul autre. C’est le monde qui est la proie et c’est à ce fait, en dernière analyse, que la culture humaine doit d’avoir vu le jour (50).
La citation est longue mais nous semble essentielle pour comprendre combien cruciale est l’attention portée par Spengler au paysage, envisagé comme objet et activateur d’une Weltanschauung (« passion de la troisième dimension ») (51), et cela dans les pages de L’homme et la technique comme autrefois dans celles du Déclin de l’Occident ou de Prussianité et socialisme. Mais dans ce dernier essai, écrit à la fin de sa vie, Spengler va beaucoup plus loin que dans ses autres écrits lorsqu’il ose affirmer qu’à l’origine des cultures se manifestent une volonté de puissance et de prédation, une tension carnivore vers l’environnement. Plus que jamais, sa théorie du Kulturpessimismus se rapproche de Hobbes (52) et, quoiqu’il en refuse la vision évolutionniste de l’humanité, de Darwin (53).
Le libéralisme à l’aune de l’espace et de l’histoire
Dans la conception que se fait Spengler de l’histoire récente, la Grande-Bretagne est d’abord porteuse d’un esprit, d’une « âme » libérale. Il ne fait guère de différence entre libéralisme et capitalisme, le second n’étant que l’émanation moderne de ce qui est d’abord perçu comme une philosophie pratique (54) ; dans Prussianité et socialisme (par ex. PS, p. 38-39), le capitalisme moderne est surtout synonyme des puissances d’argent anglaise, américaine et française, qui tentent d’asservir l’Allemagne en lui “infligeant” la République de Weimar (55). Ce qui distingue Spengler de bien des penseurs aisément qualifiés de “réactionnaires”, réside dans le fait qu’il ne critique pas en soi le libéralisme (il y trouve même une grandeur certaine quand il incarne le destin des anglo-saxons) ; il dénonce plutôt ses émanations externes, notamment en Allemagne (la social-démocratie), greffons inadaptés à l’esprit allemand, prussien et socialiste (PS, p. 57-58). Peu importe, au fond, le socialisme et « la version qu’on en donne », pourvu que la politique allemande ne cherche pas d’autre voie, puisqu’elles sont toutes inadaptées à son âme faustienne (56). Ce socialisme dans n’importe quelle “version”, pour reprendre la dernière citation, prouve combien Spengler était dépourvu de préjugés strictement idéologiques et aspirait d’abord à la conservation de la structure organique de l’État : cette ouverture, que l’on pourrait définir (au risque de la dénaturer) “à gauche”, explique sans doute pourquoi tant de penseurs de la Révolution conservatrice, dont Spengler est le socle, ont pu, à l’instar d’Ernst Niekisch, graviter dans la nébuleuse du national-bolchevisme ou rejoindre, quand ils n’en ont pas été exclus, le national-socialisme, lequel a su, à sa manière, détourner le concept socialiste de sa matrice ouvrière.
Par-delà son étude des systèmes idéologiques qui appuient la révolution économique faustienne, Spengler entend d’abord décrire les mécanismes intérieurs qui modèlent les âmes, qui les façonnent suivant les marques du faustianisme et les relient à l’antique instinct de prédation, qu’il plaçait — on l’a vu — à l’origine des cultures. Pour en revenir au particularisme anglais de l’insularité, Spengler insiste ainsi sur « l’ancien instinct nordique de brigandage et de commerce » (PS, p. 56). Plus avant, il précise les contours de ce « peuple insulaire », de son « instinct de pirate » qui le porte à « comprendre la vie économique » suivant la logique du « butin » (57).
Contrairement à Schmitt et à son essai Terre et mer, Spengler n’entame pas sa réflexion à partir du XVIe siècle, mais il fait remonter l’origine de l’expansion capitaliste et de la « comptabilité moderne » aux Normands, conquérants de l’île d’Angleterre. Ainsi, au fil des siècles, les Anglais apprennent le commerce, « forme cultivée de la rapine » (PS, p. 74). De cet attrait pour le brigandage et dans un contexte de défiance vis-à-vis de toute forme de contrôle supra-individuel et étatique, naîtraient selon Spengler le capitalisme et ses règles du jeu, l’économie de marché (58) (PS, p. 75). Suivant les axes de sa typologie antilibérale, Spengler décline de mille façons l’opposition prussianité / libéralisme, âme germanique / âme britannique (59).
D’après lui, l’instinct de prédation, qui s’exaspère dans le modèle de l’expansion capitaliste et de la guerre des marchés, n’est donc pas l’apanage des Européens, qu’ils soient marchands italiens, grands banquiers ou navigateurs britanniques. S’il est vrai que dans l’Antiquité le pillage est l’une des faces d’une proto-économie sauvage et balbutiante, la prédation prend un sens tout à fait nouveau à l’ère du capitalisme, elle devient pur produit faustien (60). Autrefois, l’homme s’en prenait à l’homme, lui dérobait ses biens, tuait les siens. On pouvait renverser des États, mais certes pas « L’ » État. En effet, la puissance faustienne du capitalisme moderne (« l’avoir comme butin », opposé à « l’avoir comme puissance ») est de renverser la notion juridique même de l’État comme Status :
À mesure que la culture croît, ces intrigues [les guerres nobiliaires entre nations] s’affirment et entrent en collision. Leur histoire est presque l’histoire universelle. Du sentiment de puissance sont nés la conquête, la politique et le droit, du sentiment du butin le commerce, l’économie, l’argent. Le droit est la propriété du puissant. Son droit est le droit de tous. L’argent est l’arme la plus forte de l’industriel. Grâce à lui, il s’assujettit le monde. L’économique veut un État faible et qui le serve, le politique exige l’intégration de la vie économique dans la compétence de l’État : Adam Smith et Friedrich List, Capitalisme et Socialisme. Il y dans toutes les cultures, au début une noblesse guerrière et une noblesse marchande, ensuite une noblesse terrienne et une noblesse d’argent, enfin une stratégie militaire et économique et un combat ininterrompu entre l’argent et le droit (61).
Ici, Spengler, contrairement à nombre de ses contemporains conservateurs, prend soin de ne pas idéaliser le passé et l’épopée, montrant que « l’avoir », la possession, sont ancrés de tout temps dans le cœur de l’homme (c’est sans doute là une constante du pessimisme spenglerien), même s’il y a une gradation involutive, un passage fatal de la Culture à la Civilisation, comme cela est parfaitement exprimé dans la citation à travers les deux aspirations contrastantes (mais non antinomiques) de la puissance. Au fond, dans son système, les formes demeurent : l’opposition / collaboration médiévale entre spirituel et temporel, entre clergé et noblesse, ne s’efface pas à l’époque faustienne, elle ne fait qu’involuer dans l’union / opposition moderne entre science et commerce (DO, t. 2, p. 317-320). Le passage qui suit nous semble fondamental pour saisir la profondeur de l’analyse spenglerienne du fait économique dans sa dimension culturelle ; le tableau qu’il dresse retrace les phases de l’aurore du capitalisme moderne, selon sa lecture personnelle de l’histoire, qui place le pillage et la conquête à la base de l’économie moderne, et non l’échange pacifique de biens :
À l’extrême opposée [des Anciens, qui redistribuaient les excédents économiques,] se trouvent les Wikings calculateurs du vieil Occident, dont l’administration financière de leurs États normands a posé les bases de l’économie financière faustienne, aujourd’hui répandue dans le monde entier. De la table disposée en échiquier dans la Chambre des Comptes de Robert le Diable de Normandie (1028-1035), on a tiré le nom du ministère des finances anglais (exchequer) et le mot chèque. De là sont nés aussi les mots compte, contrôle, quittance, record. De là en 1066 la mise à sac de l’Angleterre par l’asservissement impitoyable des Anglo-Saxons, et aussi l’État normand de Sicile que trouva déjà Frédéric II de Hohenstaufen […]. De la Sicile, les méthodes et les termes de la technique financière passèrent chez les marchands lombards qui les ont introduits dans toutes les villes commerciales et les administrations d’Occident (62).
Avant de confronter la pensée géopolitique et historique de Spengler avec celle de Carl Schmitt, il convient de préciser brièvement les sources pangermanistes de cette vision de l’histoire économique, et notamment du contraste entre Allemagne et Grande-Bretagne, sans nier pour autant la profonde originalité de la lecture qu’a donné Spengler de ce choc interne de la civilisation occidentale, dont les répercussions sont planétaires.
Pangermanisme et géopolitique : influences sur la notion spenglerienne de “Raum”
La question de la prussianité et du rôle de l’Allemagne dans le monde est, lors de la Grande Guerre, au cœur de la réflexion historique allemande, alors même que Spengler s’attelle à l’écriture de Prussianité et socialisme et du Déclin de l’Occident (63). Il reste à préciser les contours du bassin culturel complexe auquel Spengler aurait pu puiser pour élaborer ses théories, au confluent de la géographie, du mythe et de l’anthropologie. Vittorio Beonio-Brocchieri, dans un essai très éclairant sur le messianisme et la lutte des “civilisations” de Milton à Spengler, a apporté un éclairage intéressant sur l’émergence, bien antérieure au siècle du positivisme et du pangermanisme, d’une typologie des peuples, soient-ils anglais ou prussiens (64).
Au sujet de Spengler, il a bien montré l’influence sur lui (peut-être indirecte ?) des théories de Julius Langbehn et de son Rembrand als Erzieher [1890], auteur singulier qui, dans le sillage de Nietzsche, cristallisa l’affrontement culturel entre l’esprit prussien, ancré dans la terre, et l’esprit cosmopolite et mercantile, anticipant ainsi des théories dont s’emparera le national-socialisme. Certes, Langbehn et Spengler ont des vues contraires lorsque, pour le premier, le prussianisme apparaît comme une hypertrophie de l’État organique, alors que pour le second il est la forme authentique du socialisme et de l’âme allemande. Tous deux se rejoignent cependant dans leur rejet du capitalisme, du consumérisme et des métropoles modernes (dont l’antithèse reste, pour Langbehn, Venise ; il y a là une ignorance toute romantique de l’essence mercantile de la ville portuaire italienne). On pourrait encore établir des analogies entre l’avènement souhaité par Langbehn d’un mystérieux « Empereur Secret » (« der heimliche Kaiser ») devant guider les masses allemandes, et le César spenglerien (transnational cependant), qui doit achever le cycle de Civilisation. Chez l’un et l’autre, on note aussi un même intérêt pour les questions d’espace, de Grande Germanie (chez Langbehn) (65). Ce qui sépare le plus radicalement ces deux auteurs, c’est l’exaltation chez Langbehn d’une race germanique archaïque et pure, thèse influencée par Arthur de Gobineau (Beonio-Brocchieri y décèle justement l’anticipation des théories pseudo-culturelles d’Alfred Rosenberg) (66), alors que pour Spengler le prussianisme de Guillaume Ier et le socialisme de Bebel restent des modèles valables pour le pangermanisme moderne. Ce qui distingue encore Spengler des théoriciens nazis, c’est d’abord sa conviction qu’en matière de civilisation il n’existe que des lois relatives et, enfin, qu’une Culture crée un peuple, et non l’inverse. Beonio-Brocchieri insiste toutefois sur le fait que les différences de vues entre Spengler et Langbehn, son prédecesseur, ne sont que relatives : en effet, Langbehn ne critique le prussianisme que pour sa forme toute extérieure, son incomplétude, ses limites en tant que système bureaucratique, et il appelle de ses vœux la conscience d’une patrie (Heimatsgefühl), qui viendrait en quelque sorte „habiter’ l’État prussien.
Même les remarques de Spengler sur l’esprit prussien et l’esprit anglais ne sont pas si neuves en fait, elles ne font que reprendre et développer des idées déjà bien ancrées chez d’influents historiens et penseurs allemands de la « génération de ‘14 » : on pense par ex. à certains écrits d’Ernst Troeltsch et à l’ouvrage collectif Deutschland und der Weltkrieg, publié en 1915, qui tentait de justifier la guerre du côté allemand en donnant la parole exclusivement aux plus hautes autorités politiques et universitaires allemandes de l’époque (67) ; il fut traduit en plusieurs langues et connut même une édition américaine (68). Dans le domaine de l’historiographie, on pense d’abord, à l’époque de la guerre franco-prussienne, à Heinrich von Sybel et Heinrich von Treitschke, et surtout, à l’aube de la guerre mondiale, à Hermann Oncken (69), puis, dans celui de la sociologie, particulièrement à Werner Sombart (70) ; on ne peut passer sous silence, enfin, l’influence considérable qu’eut, en Allemagne et à l’étranger, Deutschland und der nächste Krieg du général Friedrich von Bernhardi (71).
Le cas de Sombart nous semble très éclairant et nous allons revenir sur son ouvrage peu connu Händler und Helden, opscule patriotique qui aurait bien pu inspirer l’opposition structurelle entre Allemagne et Angleterre qui est au cœur de Prussianité et socialisme. De même que Spengler, Sombart considère que l’esprit du capitalisme et la pensée libérale forment une ligne de démarcation nette entre Allemands et Anglais. Il faut souligner aussi qu’à l’instar de Spengler, qui écrivait le premier tome du Déclin de l’Occident et Prussianité et socialisme dans le contexte de la Grande Guerre, convaincu que l’Allemagne gagnerait la guerre, Sombart publie Händler und Helden dans le but d’offrir à la jeunesse allemande, dont le destin se joue alors dans les tranchées, une sorte de manuel du combattant, précisant en quoi leurs Ennemis du front sont différents du peuple allemand (« Diese Schrift will euch die Richtung, wo in aller Zukunft der Feind des deutschen Wesens zu suchen sein wird ») (72). Cette différence, cette dyade inhérente au schéma ami/ennemi — qui est selon nous l’un des moteurs structurel de la pensée politico-juridique du XXe siècle, du moins par sa théorisation — est centrale dans la pensée spenglerienne et nous reviendrons sur son sens profond. Comme dans Le Bourgeois (73) deux ans plus tôt, Sombart se fonde en partie sur des stéréotypes, sur une âme ou esprit dont les livres, surtout scientifiques, pourront difficilement démontrer l’existence. « Geist » : ce terme a pour Sombart plus ou moins le même sens que dans les textes de Spengler, Weber ou Schmitt (74), il est cette force mystérieuse qui imprime à un peuple son caractère, lui indique son destin (c’est le Volksgeist de Fichte, que l’on retrouve sous des formes variées dans l’ensemble des théories nationalistes du siècle des révolutions, 1789-1900) (75) :
Diese „Volksseele”, dieser „Volksgeist” — mögen wir ihn metaphysich oder rein empirisch fassen — ist jedenfalls ein Etwas, dessen Bestand nicht geleugnet werden kann, das ein selbständiges Dasein hat neben und über allen einzelnen Ungehörigen eines Volkes, das bleiben würde, obschon alle Menschen stürben, das bis zu einem gewissen Grabe sich gegen die lebendigen Einzelpersonen selbständig behaupten kann. Diese Volkseele spricht aus tausend Eigenheiten eines Volkes (und wird bei jedem Volke anders erkannt werden müssen) : aus Philosophie und Kunst, aus Staat und Politik, aus Sitten und Gewohneiten (76).
Manifestement, l’âme est constitutive de la nation et les sciences politiques modernes en tiennent peu compte, la reléguant aisément au rang de composant dangereux du patriotisme dans la mesure où ce dernier rentre dans la catégorie de l’irrationalisme énoncée par Lukács (77). Mais revenons au texte. Les Anglais sont les Händler (commerçants) et les Allemands les Helden (héros). Sombart se fonde principalement, comme dans Le Bourgeois, sur une analyse de psychologie typologique, voire sur de purs et simples stéréotypes ou encore sur du matériel essentiellement littéraire. Outre les portraits polémiques et caricaturaux, l’ouvrage se veut un authentique manuel à l’usage des jeunes combattants allemands. L’Anglais apparaît comme une personne pratique, avide ; il a soif de profiter individuellement de la vie, est tout empreint d’une morale utilitariste et eudémoniste dont le capitalisme, en tant que système économique, doit permettre le plein épanouissement : s’ensuit une critique acerbe de l’esprit sportif, des hobbies, du confort, typique de la satire antilibérale révolutionnaire conservatrice (« le confortisme », déjà stigmatisé par Sombart dans Le socialisme allemand). L’Angleterre est unorganisch (H&H, p. 36), elle se déploie comme État impérialiste et mondial, conduit Handels- oder Kapitalkriege (78), des guerres économiques dont les objectifs sont d’abord commerciaux, tout comme la liberté et la tolérance religieuses sont avant tout au service du commerce (H&H, p. 49), suivant la lecture en partie marxienne de l’histoire adoptée par le sociologue allemand.
La première partie du livre (« Englisches Händlertum ») détaille ainsi ces poncifs, et la seconde (« Deutsches Heldentum ») s’attache, par contraste, à chanter les mâles vertus des Allemands, la supériorité politique d’un État organique et fort (H&H, p. 72 sq.) — État organique dont Sombart fut, dans l’après-guerre, l’un des principaux théoriciens avec Othmar Spann —, alors que la troisième (« Die Sendung des deutschen Volkes ») s’inscrit dans l’actualité d’une guerre à gagner. Le titre même du dernier chapitre (« Die Andern und wir ») résume à lui seul l’esprit général schizomorphe de cet opuscule de circonstance.
De même que chez Sombart, on trouve dans la pensée spenglerienne une critique globale des idéologies modernes : selon Spengler, au fond, le capitalisme ne diffère guère du socialisme prolétarien et du pacifisme, tous tendent vers un monde cosmopolite où l’utopie se réalise par le progrès technique, où une ère de paix universelle succède au temps de l’histoire (79). Pareillement, Schmitt, dans une étude sur la Raumrevolution, fustigent tous ceux qui considèrent la terre comme un grand hôtel cosmopolite (80). Ce rejet de l’internationalisme et du monde unifié est typique des pensées contre-révolutionnaires, et de l’esthétique fasciste en particulier (81). Il repose notamment sur une forte opposition entre la communauté et les Autres, entre les stéréotypes de l’ami et de l’ennemi (en revanche, la distinction schmittienne ami / ennemi ne peut être sérieusement définie comme “stéréotypée” en cela qu’elle est d’abord une catégorie juridique fondatrice de la notion de politique).
La pensée stéréotypée obéit à des mécanismes psychologiques assez clairs : fondés sur des représentations bipolaires issues — selon les psychanalystes — du stade infantile, les stéréotypes adoptent une « structure en dyade » (82). On retrouve ce schéma chez Spengler dans la distinction dynamique bien connue entre Culture et Civilisation, qui se décline diversement en l’opposition campagne / ville, étendue / direction, prussianisme / libéralisme etc. Cependant, par-delà la psychologie, cette bipartition obéit à l’essence même de sa doctrine, de cette conception polémique de l’histoire humaine fondée sur des cycles de développement exigeant un alpha et un oméga, un âge d’or et un âge de fer, chacun possédant ses propres valeurs, en contradiction permanente.
C’est encore au pangermanisme (83) qu’il faut remonter pour comprendre l’émergence de ces théories typologiques (84). L’idéologie pangermaniste se développe surtout au lendemain de l’unité allemande (qui, comme dans le cas de l’Italie, n’est que formelle et exige encore un processus d’unification, et par là, une idéologie unifiante). Mouvement politique d’abord, il se développera en parallèle avec le racisme biologique, jusqu’à ce que les deux idéologies fusionnent avec le nazisme.
La géographie n’évite pas les écueils de la radicalisation du discours politique. Certains géographes allemands (Fischer, Deckert etc.) vont s’atteler à justifier les droits de l’Allemagne à participer au découpage colonial du monde, et cela en rupture avec les principales puissances européennes concurrentes, l’Angleterre et la France, dont ils s’attachent à mettre en relief les failles (85). Mais c’est surtout le développement de la géographie politique (issue de la biogéographie) sous l’impulsion de Friedrich Ratzel (1844-1904) qui va permettre véritablement l’essor d’une nouvelle discipline, la géopolitique. Nous avons démontré que chez Spengler l’idée centrale d’un lien entre peuple et paysage est maintes fois posée et qu’elle sous-tend sa réflexion, certes binaire, sur l’âme prussienne et l’âme anglaise ; toutefois, il est fort difficile de tracer un schéma clair du rapport entre sujet et paysage et nous avons pu conclure qu’il fallait écarter tout conditionnement géographique primordial et qu’à la base d’une Culture, Spengler plaçait l’homme et son intelligence, sa capacité à se penser comme individu unique dans un milieu géographique donné, ce qui n’excluait pas, cependant, que les paysages naturels ou, mieux, les perspectives plus ou moins proches ou lointaines pussent imprégner la forma mentis [structure psychique] des peuples (86) ; on en revient au lien entre insularité et capitalisme. Ces théories nous semblent proches de celles de Ratzel, avec qui Spengler partage d’abord une absence de dogmatisme, ce qui invite à lire leurs œuvres en veillant à tenir compte de toutes les fines nuances de leur pensée, comme l’a fait Michel Korinman concernant le premier (87). C’est des recherches de ce dernier que je tire principalement les brèves réflexions qui vont suivre.
Comme Ratzel, il ressort que Spengler adhérait à une certaine forme d’organicisme, croyait à la fois en une analogie fondamentale entre la vie des États et les processus d’évolution biologique, et en une interaction entre géographie physique et populations (88). Mais Korinman fait remarquer que chez Ratzel, non sans ambiguïté, les révolutions techniques de la Renaissance et le développement capitaliste des sociétés tendent progressivement à affranchir les peuples de cette origine biologique et organique et à imposer d’immenses empires (89). En revanche, face à cette croyance ratzelienne en un certain progressisme, dans la Weltanschauung spenglerienne la culture de la Renaissance (90) est envisagée comme signe de déclin et la répétition cyclique des formes culturelles interdit d’envisager tout progrès, toute possible maturation de l’organicisme vers une forme plus parfaite des États. C’est aussi sur cet anti-progressisme radical qu’est bâtie sa conception de l’homme comme éternel prédateur. Le rapprochement entre ces deux auteurs s’arrête là, étant donné que la morphologie de l’histoire universelle décrite par Spengler ne prend guère en compte la géographie physique ou l’anthropogéographie comme le fait Ratzel, lui-même étant peu attentif à l’« âme » des peuples.
En conclusion, l’œuvre de Spengler se développe dans le contexte d’un débat national ancien portant sur la notion d’espace, de Raum, et de la place de l’Allemagne dans le nouvel ordre géopolitique mondial. La notion d’espace est inhérente au désir de rédemption politique et patriotique de l’Allemagne vaincue en 1918 et peut prendre, comme le rappelle Murphy, une connotation quasi mystique, proche de la symbolique spenglerienne et völkisch que nous avons décrite précédemment :
The fundamental building block of the geopolitical understanding of the state was space, or Raum. Through the concept of Raum, geopolitical theory subordinated politics to geography. Geopoliticians insisted that under proper conditions the state grew naturally from its Raum. Translated into English as „space” or „area”, the word is deflated, losing the thick layers of nearly mystical connotations with wich it resounded for German geopoliticians. They invoked Raum as a supranatural and elemental force in human affairs. Raum framed the state, Raum composed the state, in the final analysis Raum actually created the state [c’est nous qui soulignons] (91).
Les réflexions de Spengler sur la force créatrice de l’espace sur les peuples ne sont guère éloignées de la géographie politique d’Otto Maull ; elles y ajoutent une dimension universelle et métahistorique, fruit de son relativisme méthodologique. En outre, dans les années 20 et 30, nombreux sont les géographes allemands qui procèdent à l’élaboration de Gruppentypologien, en appliquant par ex. leurs recherches aux “types” espagnol et italien (92). C’est aussi le printemps du Landschaftsideal, où l’on chante la douce harmonie des paysages allemands, organiques et purs, associée à l’éloge des paysans, de l’immobilité spatiale, de cet enracinement qui fonderait la « alte bodenständige Kultur » (93). Si les discussions savantes ou pseudo-savantes autour du Raum culminent dans les écrits de géopolitique et se trouvent au cœur des écrits de Karl Haushofer, elles se diffusent également dans les réflexions juridiques de Carl Schmitt ou de Manfred Langhans-Ratzeburg (94). Toutefois, malgré l’influence indirecte certaine que ces théories ont pu avoir sur la pensée de Spengler et de Schmitt, il n’en reste pas moins qu’elles se distinguent d’un étroit déterminisme géographique ou racial.
Carl Schmitt et la notion de “Raum” : une continuité avec le discours spenglerien de l’espace ?
Bien qu’il ne le mentionne pas dans Terre et Mer, on pressent l’influence de Spengler sur Schmitt (95) : l’encadrement schmittien est semblable à un fragment de la pensée spenglerienne telle qu’elle s’exprime au lendemain de la Grande Guerre, en particulier dans Prussianité et socialisme ; en effet, Schmitt partage avec Spengler la croyance en une influence des facteurs géographiques (l’insularité, l’ouverture sur les océans) et symboliques (la liquidité, les flux financiers du capitalisme) sur la physionomie du monde moderne, régi par les seules lois de l’économie.
Alors que Spengler reste fort nuancé quant à un puissant déterminisme géographique sur l’histoire des nations, considérant que ce sont d’abord le caractère, l’âme (Geist) d’un peuple et surtout les chocs interculturels qui façonnent son histoire, il pourrait sembler de prime abord que Schmitt, tout en lui empruntant certaines thèses quant au lien unissant l’homme à son milieu, avec une conception similaire, quasi sacrale, du sol (Boden, le sol comme centre et racine, répondant symboliquement à la fécondité intérieure, spirituelle), penche d’avantage pour un conditionnement de l’homme par son environnement géographique (96). Relisons les premières lignes de Terre et mer, si précieuses pour notre sujet :
L’homme est un être terrestre, un terrien. La terre ferme est le lieu où il vit, se meut, se déplace. Elle est son sol et son milieu. C’est elle qui fonde ses perspectives, détermine ses impressions, façonne le regard qu’il porte sur le monde. Né sur la terre, évoluant sur elle, l’homme en tire non seulement son horizon, mais son allure, sa démarche, ses mouvements, sa silhouette, sa stature. C’est pourquoi il appelle “terre” l’astre sur lequel il vit bien que la surface du globe soit constituée, on le sait, aux trois quarts d’eau et d’un quart seulement de terre ferme et que même les plus vastes continents ne sont que d’immenses îles flottantes (97) [c’est nous qui soulignons].
Il serait injuste de déceler dans ce passage une forme de déterminisme géographique excessif. Il s’agit en fait, comme chez Spengler, d’une relation entre la nature et l’homme perçue comme lien, et non d’un conditionnement de l’espace sur l’humain. La liberté de l’homme est préservée tant chez Spengler que chez Schmitt ; cela ne les empêche pas de prendre en compte la dynamique cognitive que le paysage stimule chez toute créature douée d’intelligence. Vouloir abstraire l’éducation de l’homme de son milieu leur apparaît simplement comme une monstruosité (98). D’où, peut-être, leur engagement direct ou indirect dans des mouvements conservateurs souvent très hétéroclites, dont les membres avaient à cœur de défendre, surtout au lendemain du Traité de Versailles, l’identité nationale. Certes, par-delà cette reconnaissance d’une liberté initiale et d’une relation forte entre êtres vivants et nature, tant Spengler que Schmitt sont sans illusion quant à une supposée harmonie rousseauiste primordiale, quant à la bonté naturelle de l’homme, conformément à la conception de l’État énoncée par Hobbes, auquel Schmitt a consacré l’un de ses travaux majeurs et qu’il tenait pour l’un des fondateurs des sciences politiques et juridiques modernes (99). Enfin, il ne faudrait pas s’en tenir à une définition du Boden comme simple espace physique incarnant physiquement et spirituellement la nation. En effet, pour Schmitt, le sol ou, mieux, la terre (par la « prise de terres ») est le fondement même du droit, en cela qu’elle matérialise la norme (localisation), par elle l’homme borne l’espace, le délimite, le cultive ; par elle naît le pouvoir et la propriété foncière ; elle est le contraire de la mer. Relisons cet extrait du tout début du Nomos de la terre (il faudrait relire les « Cinq corollaires introductifs ») qui fait véritablement écho à l’incipit de Terre et mer :
La terre est donc triplement liée au droit. Elle le porte en elle, comme rétribution du travail ; elle le manifeste à sa surface, comme limite établie ; et elle le porte sur elle, comme signe public de l’ordre. Le droit est terrien et se rapporte à la terre. C’est là ce qu’entend le poète lorsqu’il parle de la terre foncièrement juste et l’appelle justissima tellus (100).
Parmi les philosophes de l’histoire qui auraient pu lui inspirer cette thèse, Schmitt cite Vico ; mais pas Spengler. Il n’en reste pas moins que les passerelles entre Schmitt et Spengler, dans leur réflexion sur l’espace, les peuples et l’essor du libéralisme, sont nombreuses et nous incitent à lire Terre et mer comme un hommage personnel, sous forme de complément, rendu à l’auteur du Déclin de l’Occident. Avant de rentrer plus en profondeur dans l’esprit du texte, on notera encore ce parallèle entre les deux penseurs lorsqu’il s’agit, une nouvelle fois, de penser l’espace dans sa relation à l’homme, à son histoire, ce qui confirmerait bien leur refus d’une anthropologie excessivement conditionnée par l’environnement naturel :
L’homme a de son espace une conscience donnée qui subit, tout au long de l’histoire, de profonds bouleversements. À la multiplicité des formes d’existence correspondent des espaces également pluriels. Même à une époque donnée, la pluralité des professions induit, dans les actes de la vie quotidienne de chacun, un environnement différent. Un citadin des grandes villes se fait du monde une idée différente de celle d’un paysan (101).
Dans cet extrait, qui précise un peu plus l’incipit, l’espace n’est plus pensé comme déterminant sur l’homme, mais c’est bien l’homme qui le maîtrise en lui prêtant une signification, en projetant sa propre histoire dans les perspectives spatiales qui s’offrent à lui. Cela devrait suffire à balayer tout soupçon de déterminisme géographique et à réhabiliter Schmitt et Spengler en tant que penseurs de la primauté de l’histoire, vu comme onde de choc entre cultures diverses (102). Dans l’allusion à la façon différente et même opposée de sentir l’espace entre un citadin et un paysan, on songe infailliblement aux nombreuses pages du Déclin de l’Occident qui sont consacrées à cet affrontement entre deux mondes, deux espaces et deux façons de sentir ces espaces.
En achevant la lecture de Terre et mer, on ne peut qu’émettre l’hypothèse suivante : Spengler, dans Le Déclin de l’Occident et Prussianité et socialisme, fait une large place à l’étude des Vikings et à l’instinct de prédation (atteignant son paroxysme avec l’accélération du capitalisme à partir du XVIIIe siècle) ; or, il n’approfondit guère cette corrélation entre piraterie et passage au commerce moderne ; c’est bien ce vide dans le raisonnement spenglerien que vient combler, selon nous, la suggestive réflexion de Schmitt. De fait, celui-ci, après de brefs chapitres consacrés à la mythologie marine et aux grandes civilisations de la mer (TM, chap. 1-6), entame dans les chapitres suivants une analyse détaillée des nouveaux prédateurs que sont — après les vikings (103) — les pirates et flibustiers anglais du XVIe siècle ; qu’il tient précisément pour les ancêtres des grands commerçants britanniques, qu’un État « insularisé » encouragea et protégea en mettant au service du commerce et de la conquête territoriale sa puissante flotte, la plus crainte au monde jusqu’à 1945 (104). La figure du pirate (et de son équivalent régulier, le corsaire) est centrale dans la pensée schmittienne comme le sera plus tard celle du partisan. L’une et l’autre partagent un commun mépris pour le droit et renversent les catégories traditionnelles de la guerre régulière. Initialement, dans Le Nomos de la terre, Schmitt avait comparé les flibustiers à des partisans de la mer (105) ; pour qui connaît ses écrits sur les grands espaces, la terre et la mer des années 1939-1942, cette association entre le pirate, type (au sens jüngerien) du moderne capitaliste non bourgeois, et le partisan, dont le modèle universel est le révolutionnaire de 1789 et ses innombrables dérivés, jusqu’à Salan ou Ernesto Guevara, est révélatrice d’une pensée unitaire : que ces figures soient des ancêtres du capitalisme ou des combattants irréguliers luttant pour un idéal politique, tous renversent les catégories traditionnelles de la guerre régulière du droit des gens et, par leur lien de plus en plus manifeste avec la technique (106), se rapprochent du Travailleur décrit par Jünger au début des années 30.
Alors que Spengler reliait l’esprit viking à l’esprit capitaliste en omettant de préciser les mécanismes complexes qui avaient causé le passage de la prédation guerrière localisée à la prédation commerciale mondiale, il importe à Schmitt d’identifier et de décrire le chaînon manquant du raisonnement, à savoir la « cause initiale, originelle » du divorce entre terre et mer, et de la globalisation du modèle libéral : « la conquête britannique des mers et son contexte historique spécifique » (TM, p. 76). Il faudrait à présent reparcourir Terre et mer en relevant les grands axes géopolitiques dégagés par Schmitt et ayant quelque relation avec la pensée spenglerienne de l’espace.
Certes, selon Schmitt la République de Venise anticipe de près de sept siècles la puissance maritime, militaire et commerciale de l’Angleterre triomphante au XVIIIe siècle (TM, p. 26). Mais il observe que les Vénitiens ne recourent pas spécialement à des techniques de navigation innovantes. En revanche, les pirates et corsaires hollandais et anglais, entre 1550 et le début du XVIIIe siècle, ont mis la technique au service de leurs courses mondiales. L’ère de la reine Elisabeth marque l’avènement de l’île d’Angleterre comme grande puissance commerciale, grâce à ses raids contre l’Espagne catholique et ennemie (TM, p. 44-45). Cela marque pour Schmitt le développement des corsaires capitalistes et du « capitalisme pirate » (TM, p. 45). Dans Le Nomos de la terre, le pirate est un « brigand des mers », la mer étant ainsi définie : « un libre champ de pillage libre » (107).
Il est intéressant de noter que le juriste ne se contente pas d’analyser la lutte entre terre et mer en des termes géopolitiques ou mythologiques, la majeure partie de sa réflexion ayant pour pivot la naissance et le développement de la piraterie britannique et hollandaise, opposée à la continentalité des puissances française et espagnole (108). Si l’on est attentif à son analyse, on s’aperçoit qu’il est moins préoccupé par la tactique ou l’essor économique consenti par la piraterie que par l’interprétation de cet affrontement entre terre et mer, véritable « révolution de l’espace » (Raumrevolution), suivant une grille d’analyse religieuse et culturelle, affrontement entre les deux pôles de la chrétienté, catholicisme et protestantisme (109). La révolution de l’espace entraîne à la fois un choc entre éléments, tellurique et maritime, et une guerre de religion, catholicisme contre protestantisme, suivant la dynamique classique ami-ennemi. Au-delà de cette dimension spirituelle, “civilisationnelle” dirions-nous aujourd’hui, Schmitt, comme juriste, remarque que s’opère, surtout à partir de l’avènement de grande piraterie britannique, une modification de l’affrontement guerrier : de lutte régulière et exclusivement guerrière en rase campagne, sur mer l’affrontement devient fait économique (110) : il s’agit avant tout de porter un coup mortel au commerce même et aux finances de la puissance ennemie. Cette nouvelle cible commerciale, qui est aussi une dimension nouvelle de la guerre (111), intègre alors dans la notion d’ennemi tout ressortissant civil et non armé appartenant à cette même puissance (TM, p. 74-75). D’où le divorce géopolitique entre terre et mer, causé indirectement par la domination maritime anglaise (112). Mythiquement, cette fracture se traduit par l’opposition entre le Léviathan anglais et les notions terrestres de sol (Boden) et Heimat (113) (TM, p. 80). La rupture entre terre et mer a d’abord des répercussions sur l’Angleterre elle-même, qui peu à peu ne se pense plus comme forteresse protégée par la mer mais comme île à la dérive, île-poisson, Léviathan lancé à la conquête des terres et des océans : l’arrière-pays anglais devient alors terre reculée et sauvage, alors que la vraie noblesse anglaise devient maritime. Enfin, dans le sillage de l’analyse spenglerienne de l’essor capitaliste, Schmitt insiste sur la dimension technique de l’aventure maritime (comme plus tard celle inhérente à la conquête du ciel), qui peut avoir lieu uniquement grâce à l’innovation technologique, contrairement au déplacement terrestre, plus immédiatement accessible (TM, p. 98).
La leçon de géopolitique délivrée par Schmitt rejoint sur bien des points les théories spatiales de Spengler, mais il nous semble qu’elle se présente avant tout comme une précision apportée aux théories sur la genèse du capitalisme moderne développées par l’auteur du Déclin de l’Occident (ce que j’ai défini comme un chaînon manquant entre la préhistoire capitaliste basée sur l’instinct de rapine et la Révolution industrielle anglaise) et aussi comme une sorte de mise au point venant compléter du point de vue géopolitique les thèses weberiennes sur l’essence théologique de la pratique économique capitaliste, pratique en soi bien antérieure au calvinisme et d’ascendance catholique (comme l’a montré Luca Parisoli dans le présent ouvrage).
JL Schlegel soutient que ce qui distingue Schmitt de la majorité des intellectuels contre-révolutionnaires et conservateurs, serait son rejet des théories nostalgiques idéalisant l’ère pré-moderne, un âge d’or spirituel ayant précédé la sécularisation qui suivit la Renaissance, le souci essentiel de Carl Schmitt n’étant pas « de re-théologiser les concepts juridiques mais de souligner leur origine théologique, et notamment de tous les concepts qui définissent l’idée de souveraineté » (114). Il nous semble cependant que Schmitt reste fidèle, du moins dans les années 20, à cette école de pensée contre-révolutionnaire ou révolutionnaire conservatrice par sa nostalgie d’un ordre social traditionnel reposant sur les Stände (115) et sa critique implacable de la démocratie qui paralyse le politique entendu comme prise de décision, la souveraineté comme pouvoir de décider dans la situation dite exceptionnelle ; cette théorie, énoncée dans Théologie politique, n’est pas en soi schmittienne, le grand juriste ayant démontré dans un autre de ses essais de philosophie du droit que les grands penseurs du jusnaturalisme y avaient eu recours pour définir l’essence même politique, de Hobbes et Pufendorf à Rousseau (116). Le refus du politique, et donc le rejet du décisionnisme, est sans nul doute imputable, selon Schmitt, au relativisme issu du libéralisme marchand ; une telle vision est d’ailleurs partagée par Spengler (117). La théorie de Kelsen sur la souveraineté, réduisant l’État à une entité purement juridique productrice de droit, à une sorte de “corps” normatif désincarné, est longuement analysée et critiquée par Schmitt, qui l’interprète finalement comme un rejeton tardif de la pensée libérale (118). En somme, tant Kelsen que la plupart des penseurs libéraux ont beau jeu de saper la souveraineté étatique, ils n’en éludent pas moins le problème principiel de l’effectuation du droit, dont la norme est conséquente (119).
Ces idées que défendait Schmitt durant la République de Weimar, dont il ne cessa d’attaquer l’assise libérale, vont s’estomper dans sa pensée après 1945. Néanmoins, Le Nomos de la terre n’est pas totalement coupé de certaines analyses antilibérales telles qu’il les exprimait à la fin des années trente, lorsqu’il définissait le sens de la « révolution de l’espace » en marche à l’échelle planétaire, révolution qui allait de pair avec l’extension du modèle capitaliste protestant ; mais à la différence de ses écrits scientifiques, datés d’avant la défaite allemande, où il concevait l’Allemagne comme le futur noyau d’un bloc euro-continental, dernier rempart face à une hégémonie mondiale anglo-américaine (120) (déjà postulée par Alfred Mahan au début du XXe siècle), Terre et mer s’en tient essentiellement à des considérations mythologiques, historiques et géoéconomiques ; cela s’explique aisément par le fait que le livre est un texte synthétique et clair adressé à la fille de l’auteur, Anima. Aussi, on y décèlera en vain toute allusion polémique virulente, notamment au pangermanisme spenglerien dont les premiers articles traitant de la Raumrevolution étaient les héritiers (121). De même, Schmitt effacera toute référence à l’action occulte de la franc-maçonnerie dans la diffusion de l’idéologie libérale en Europe puis dans le monde (122) ou encore à l’influence des compagnies commerciales et de l’individualisme exacerbé dans la lutte contre les notions classiques d’État et d’organisation ; tout comme s’atténueront les charges de la fin des années trente contre l’impérialisme américain, travaillant à « la transformation abstraite de la Terre en marché mondial du capital, au mépris de la réalité des espaces » (123).
En conclusion, pour Spengler, le libéralisme est une idéologie liquéfiante, ou plutôt un état d’esprit qui outrepasse la simple théorie économique, et qu’il faut distinguer de la pratique économique libérale ; cette dernière n’est au fond qu’un type de rapport commercial entre contractants (principe du libre-échange). Le libéralisme, en revanche, est idéologie pure, faustianisme pur, il transcende tous les partis et toutes les classes. Cette conception est voisine de la description sociohistorique que Sombart donne du Bourgeois dans son œuvre éponyme : entendons le bourgeois capitaliste et avide du XIXe siècle, et non celui, fort abstrait, qui est principalement dépeint par le sociologue allemand, lequel se base essentiellement sur des chroniques italiennes médiévales et de la Renaissance, d’ailleurs sans réel souci d’objectivité puisqu’il crée ce portrait à partir de textes qui n’ont pas vocation à être universels. L’« être bourgeois », beaucoup plus métaphysique dans le discours spenglerien, est un refus anarchique de tout ordre organique, il investit tout sur son passage et n’est défini par Spengler que comme « la négation de tout ce qui ne peut être saisi rationnellement » (124).
En revanche, pour Schmitt, on note une évolution de sa pensée sur le libéralisme : s’il fut un farouche adversaire de l’idéologie libérale dans ses premiers écrits, après la Grande Guerre — notamment à travers sa distinction entre démocratie et libéralisme — il “rachète” le libéralisme en le distinguant du politique et, partant, de la forme démocratique (125). Libéralisme et politique conservatrice et autoritaire seraient donc compatibles dès lors que l’on distinguerait le pluralisme libéral du pluralisme démocratique, Schmitt considérant ce dernier comme proprement antipolitique.
► Emmanuel Mattiato, in : Collectanea franciscana n°23, Palerme, 2008.
[une version remaniée de cet article est paru dans Nouvelle École n°59-60, 2011, sous le titre « Carl Schmitt, lecteur de Spengler »]
◘ Notes :
- 1 Sur le progrès et son émanation idéologique, le progressisme, notions fondamentales pour une bonne compréhension de notre sujet : PA Taguieff, Du progrès : Biographie d’une utopie moderne, Librio, 2001 ; et du même auteur : Le Sens du progrès : Une approche historique et philosophique, Flammarion, 2004.
- 2 Voir en particulier V. Charolles, Le libéralisme contre le capitalisme, Fayard, 2007. Pour une approche plus philosophique : M. Canto-Sperber - N. Tenzer, Faut-il sauver le libéralisme ?, Grasset, 2006, not. la dissertation de M. Canto-Sperber, p. 13-88 ; pour une lecture psychanalytique et critique de l’individualisme libéral : JC Liaudet, L’impasse narcissique du libéralisme, Climats, 2007.
- 3 Jacques de Guénin, Logique du libéralisme : Morale – vie en société – Économie, Institut Charles Coquelin, 2006, p. 17.
- 4 L. Dupeux, Aspects du fondamentalisme national en Allemagne de 1890 à 1945, PU de Strasbourg, 2001.
- 5 Pour une vue d’ensemble de l’implication de Jünger dans les débats politiques des années 20 et la confluence surprenante de son nationalisme avec certaines formes du marxisme révolutionnaire (à rebours des critiques simplistes faisant de lui un banal fasciste) : JL Evrard, « Ernst Jünger dans la révolution conservatrice », in : La Révolution conservatrice et les élites intellectuelles européennes, dir. B. Koehn, PU de Rennes, 2003, p. 37 sq.
- 6 L. Dupeux, National bolchevisme : stratégie communiste et dynamique conservatrice dans l’Allemagne de Weimar (2 vol.), H. Champion, 1979.
- 7 Sur le rapport tourmenté entre Mann et Spengler : B. Beßlich, Faszination des Verfalls : T. Mann und O. Spengler, Berlin, Akademie Verlag, 2002.
- 8 E. Traverso, À feu et à sang : De la guerre civile européenne 1914-1945, Stock, 2007.
- 9 O. Spengler, Le déclin de l’Occident. Esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, vol. I : Forme et réalité (désormais abrégé comme suit : « DO, t. 1 »), trad. de M. Tazerout, Gallimard, 1976 [1918], p. 139.
- 10 Il détaillera ces affirmations dans le dernier chapitre du second tome (1922) du Déclin de l’Occident : « Le monde formel de la vie économique » : O. Spengler, Le déclin de l’Occident : Esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, vol. II : Perspectives de l’histoire universelle (dorénavant abrégée comme suit : « DO, t. 2 »), trad. de M. Tazerout, Gal., 1976 [1948]. Selon Spengler, l’Antiquité n’a guère connu que des échanges commerciaux reposant sur une conception de l’argent comme bien représenté, non comme valeur changeante, les biens eux-mêmes n’étant pas appréciés autrement que matériellement, à l’inverse de l’économie occidentale faustienne (dont le cours des monnaies varie vertigineusement) qui considère la matière comme force potentielle (le charbon, par ex., et toutes les matières premières conditionnées par ce qu’il désigne comme « la pensée faustienne énergétique », ibidem, p. 464) : « L’homme antique n’a jamais pensé à un accroissement méthodique de la vie économique, mais seulement au résultat momentané, au quantum accessible d’argent liquide ; sans la vieille Égypte, Rome impériale serait perdue : il y avait là par bonheur une civilisation qui depuis un millénaire n’avait pensé à rien d’autre qu’à l’organisation de son économie » (ibidem, p. 457).
- 11 DO, t. 1, p. 276 sq. Quant à l’art d’avant-garde de son époque (expressionnisme, etc.), Spengler le balaie comme le fruit d’« industriels de l’art » (ibidem, p 286), créateurs et galeristes, anticipant ainsi (négativement) les réflexions du Bauhaus ou du pop art.
- 12 Dans le dernier paragraphe de Politische Pflichten der deutschen Jugend (München, C. H. Beck, 1924), adressé à la jeunesse allemande, Spengler conclut son propos en conseillant aux futurs hommes d’État de se défier des slogans faciles et des partis, et surtout de lire et de relire les œuvres d’économistes tels Keynes et Helfferich, afin de mieux saisir la personnalité et l’action de ceux qui dirigent les nations. Suivant sa conception prussienne de la politique, les sciences économiques doivent être maîtrisées et mises au service de la nation.
- 13 E. Severino, Techne : Le radici della violenza, Milano, Rusconi, 1980. La critique spenglerienne de la technique et le machinisme anticipe maintes tentatives d’interprétation politique ou philosophique issues de la Révolution conservatrice allemande, qu’elles soient favorables ou défavorables à cet esprit du temps : on songe aux réflexions sur la technique des frères Jünger ou de Heidegger. On ne se lassera pas d’insister sur l’importance du dernier chapitre du Déclin de l’Occident « Le monde formel de la vie économique », tant il a influencé le traité Der Arbeiter (Le Travailleur) d’Ernst Jünger, à la fois dans ses intuitions, aux confins de l’ésotérisme, et dans son style littéraire même. Prenons par ex. cette citation de Spengler : « Travail devient le grand mot de la réflexion éthique. […]. Et la forme de ces machines ne cesse d’être plus inhumaine, ascétique, mystique et ésotérique. Elles entourent la terre d’un tissu infini de forces subtiles, de courants, de tensions. Leur corps est toujours de plus en plus spirituel, et dissimulé. Ces roues, ces cylindres, ces ressorts se sont amenuisés. Tout ce qui est important dans la machine se dissimule à l’intérieur [c’est nous qui soulignons ici]. On a senti le diable dans la machine et on n’a pas tort. Elle signifie, aux yeux d’un croyant, le Dieu détrôné. Elle livre à l’homme la sainte causalité et est mise en mouvement par lui silencieusement, irrésistiblement, avec une sorte d’omniscience prophétique » (DO, t. 2, p. 462-463) ; et comparons-la avec E. Jünger, Le Travailleur, trad. de J. Hervier, Bourgois, 1989 [1932], p. 100-101, 110-111, 283-284. Les analogies sont saisissantes. À la même époque, l’intellectuel marxiste Siegfried Kracauer est fasciné par l’esthétisation de la vie industrielle et des masses, tout en y décelant, sous l’influence de Georg Lukács, les effets de réification supposés du capitalisme. E. Traverso, Siegfried Kracauer : Itinéraire d’un intellectuel nomade, La Découverte, 2006 [1994], p. 81-82.
- 14 DO, t. 1, p. 19. Sa théorie du symbole est développée dans le chapitre III du t. 1 du Déclin de l’Occident : un symbole représente pour Spengler « un trait de la réalité qui, pour des hommes dont les sens sont éveillés, désigne avec une certitude intérieure immédiate quelque chose d’impossible à communiquer rationnellement » (ibidem, p. 162).
- 15 O. Spengler, Untergang des Abendlandes, München, C. H. Beck, 1990 [1923], p. 211. Lorsque la traduction en français du Déclin de l’Occident s’avère insatisfaisante et imprécise, ou qu’un terme important de la réflexion spenglerienne semble devoir être rappelé dans sa langue propre, je me référerai à cette édition allemande, désormais abrégée « UA ».
- 16 Quoique Spengler fût fort critique sur Darwin, sa célèbre conception de la naissance et de la mort des civilisations, comparable en cela au cycle biologique de la faune et de la flore, se développa dans un contexte influencé par le darwinisme social. Mais nous verrons qu’il est plus proche, en cela, de Friedrich von Bernhardi ou de la biogéographie de Friedrich Ratzel. Sur la question du darwinisme dans l’œuvre de Spengler, G. Merlio, « Oswald Spengler et la technique », in La Révolution conservatrice dans l’Allemagne de Weimar, sous la direction de L. Dupeux, Kimé, 1992, p. 154.
- 17 DO, t. 1, p. 149. Spengler développe magistralement cet aspect dans le chapitre « Villes et peuples » du second tome du Déclin de l’Occident (DO, t. 2, p. 84 sq. Pour notre sujet, il est fondamental de remarquer que Spengler pose le problème contrarié entre ville et campagne en des termes de “paysages” symboliques contraires, annonçant par là une réflexion sur l’archétype du paysan et son lien à l’« Heim[at] » ultérieurement développée par Heidegger et Jünger, pour taire certaines caricatures de la littérature dite völkisch : « L’agriculture a introduit, la première, une profonde révolution — car elle est art et, comme tel, absolument étrangère au chasseur et au pasteur : on bêche et laboure non pour détruire mais pour transformer la nature. Planter n’est pas prendre quelque chose, mais le produire. Mais ainsi, on devient soi-même plante, c’est-à-dire paysan. […]. L’âme humaine découvre une âme dans le paysage, un nouvel enchaînement de l’être à la terre s’annonce comme devant être un nouveau mode de sentir. D’hostile, la nature devient notre mère. […]. Et partout la forme parfaite de ce sentiment de la vie est la figure symbolique de la maison paysanne, dont la disposition des pièces et chaque détail de la forme extérieure parlent le langage du sang de ses habitants. La maison paysanne est le grand symbole de la sédentarité. Elle est plante elle-même, elle enfonce dans son „propre’ sol ses racines profondes. Elle est propriété au sens sacré » (ibidem, p. 84).
- 18 DO, t. 2, p. 431-432. C’est la même critique que développe Jünger contre l’économie comme fin en soi et seule grille de lecture du monde, en dénonçant à la fois le libéralisme et le marxisme : E. Jünger, Le Travailleur, op. cit., p. 56 sq.
- 19 Pour être plus précis, il vaudrait mieux dire : « la genèse de la mondialisation du modèle capitaliste ».
- 20 Dans Le déclin de l’Occident, Spengler constate que Franciscains et Dominicains furent les premiers ordres à bâtir à l’intérieur des villes, mais il n’établit pas de lien entre leur apport et la genèse du capitalisme. DO, t. 2, p. 86.
- 21 De fait, en se basant presque exclusivement sur le Decretum Gratiani, il ne propose qu’une vision réductrice de la vision chrétienne de l’économie, religieusement conçue comme source de péché. DO, t. 2, p. 435.
- 22 Les précurseurs de Spengler quant à la pensée de la décadence occidentale sont nombreux. On pense immédiatement à Nietzsche et à Gobineau. G. Merlio, « Gobineau als Vorlaüfer Spenglers », in : Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im Europa des 19. Jahrhunderts. Literatur-Kunst-Kulturgeschichte, dir. W. Drost, Heidelberg, C. Winter Universitätsverlag, 1986, p. 139-150.
- 23 DO, t. 2, p. 92. Plus avant, Spengler revient longuement sur ces concepts qui subvertissent l’État. L’« être libéral » signifie être « libéré des entraves de la vie liée au sol, soit que ces entraves s’appellent droits, formes ou sentiments. L’esprit est libre pour toutes sortes de critiques, l’argent est libre pour toutes sortes d’affaires. Mais tous deux aussi sont orientés inexorablement vers la direction d’un ordre qui ne reconnaît pas au-dessus de lui la souveraineté de l’État. L’esprit et l’argent, anorganiques comme ils sont, ne veulent pas de l’État comme forme organique d’une grande symbolique commandant le respect mais comme institution servant à une fin ». DO, t. 2, p. 373. Pareillement, dans sa pensée, dictature de l’économie et essor urbain restent intimement liés : « Avec l’apparition des villes qui gouvernent l’État commence l’économie citadine de l’argent, que l’éclosion de la civilisation élève à la dictature de l’argent, en même temps que le triomphe de la démocratie cosmopolitique » (DO, t. 2, p. 439).
- 24 DO, t. 2, p. 88. Cette hostilité envers la ville moderne et l’exaltation de la nature sont déjà bien présentes dans les fictions de Hans Grimm, qui ont profondément marqué la jeune génération allemande de 1914.
- 25 K. von See, Freiheit und Gemeinschaft : Völkisch-nationales Denken in Deutschland zwischen Französicher Revolution und Erstem Weltkrieg, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 2001, p. 29 sq. ; D. Conte, « Ceti rurali e salvezza della nazione : l’ideologia del “Bauerntum” nella Germania weimariana », Studi Storici, n. 28, 1987, p. 347-384. Il est difficile de traduire völkisch en français : est völkisch ce qui relie culturellement le peuple à son sol natal ; nous n’oserions traduire systématiquement cet adjectif par « raciste » comme le fait inconsidérément Enzo Traverso dans son dernier ouvrage (À feu et à sang, op. cit.), sous peine de nier la complexité de l’histoire en faisant de tous les auteurs völkisch des précurseurs de Richard Walther Darré et du nazisme.
- 26 DO, t. 2, p. 89.
- 27 Ce concept est très proche, par sa substance métaphysique et par sa récurrence dans la morphologie historique, de ce que Jünger nomme, dans Le Travailleur, « Domination » (Herrschaft), Domination d’une Figure (Gestalt) à un moment donné du cycle historique. Comme chez Spengler, dans la droite ligne de la réflexion géopolitique allemande, la Domination s’exerce aussi territorialement et est le prélude à une domination impériale (là aussi, on se rapproche du césarisme spenglerien). Toutefois, il n’y a pas de nostalgie nationaliste, Jünger prenant acte — à l’instar de Spengler — de la dissolution des frontières au sens de l’État nation du XIXe siècle. Dans les dernières pages de son traité, l’auteur s’explique « dans ce contexte la découverte contemporaine des communautés d’intérêts, des espaces géopolitiques et des possibilités fédératives qui représentent comme des offensives contre la structure par États-nations et comme une tentative de préparation constructive d’espaces impériaux ». E. Jünger, Le Travailleur, op. cit., p. 359.
- 28 Le césarisme auguré par Spengler, plus qu’un désir, est un phénomène inéluctable dans son schéma déterministe de l’histoire. Le traducteur italien de Spengler, Julius Evola, figure originale de la Révolution conservatrice italienne, lui a d’ailleurs reproché cette conception du césarisme, vu comme conséquence nécessaire d’une conception quasi biologique du flux historique. Evola reproche aussi au penseur allemand de n’avoir jamais cité l’œuvre de Vico, qui bien avant lui prédit l’avènement d’un monarque barbare. Spengler, conclut Evola, dans sa non-résistance à l’avènement d’un moderne César, se résigne au totalitarisme. J. Evola, préface à O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente : Lineamenti di una morfologia della storia mondiale, Milano, Longanesi, 1957. Voir aussi les autres textes consacrés par Evola à Spengler depuis 1926 : Oswald Spengler / Julius Evola, Roma, Fondazione Julius Evola, 2003.
- 29 DO, t. 1, p. 48. Il est clair que Spengler, personnellement, n’entendait pas simplement offrir à ses lecteurs une simple théorie de l’histoire universelle et qu’il entendait, par son œuvre, les inciter (ses compatriotes en particulier) à une action qui adhère au mouvement césarien et faustien de l’ère moderne. Cette pensée l’amenait à rejeter toute forme d’art, de politique ou d’économie qui ne tînt pas compte du faustianisme triomphant, auquel l’Allemagne — il en était convaincu — devrait imprimer sa marque. Ainsi, sa critique du droit occidental et romain obéit à cet impératif ; il appartient aux Allemands, soutient Spengler, de créer une science juridique nouvelle en osmose avec les temps nouveaux. Toujours au nom de la tension faustienne vers l’extérieur, il appelle de ses vœux la genèse d’un « droit des fonctions », opposé au « droit des corps » de l’Antiquité : « Les Romains ont créé une statique juridique, notre tâche est une dynamique juridique. Pour nous, la personne n’est pas un corps, mais une unité de force et de volonté, et la chose non un corps, mais un but, un instrument et une création de cette unité. Le rapport antique entre les corps était la position, le rapport entre les forces s’appelle action. […]. Mais pour nous, l’organisateur, l’inventeur, l’entrepreneur, sont des forces productives agissant sur d’autres forces exécutives en leur donnant une direction, une tâche et des moyens d’action propres. Les deux forces relèvent de la vie économique non comme possesseurs de choses, mais comme représentants d’énergies », DO, t. 2, p. 79-80. Cette conception du faustianisme comme tension, libération d’énergies, collision de forces contraires, relève de la métaphysique, voire de l’irrationnel, et on ne peut qu’être circonspect face à l’injection de cet esprit dans la matière juridique moderne. Schmitt sera beaucoup plus prudent à cet égard.
- 30 DO, t. 1, p. 107. « Impression cosmique naturelle » et « impression cosmique historique » ne sont étudiées ici que conceptuellement par Spengler, et c’est nous qui l’utilisons contextuellement, en référence à la naissance du modèle capitaliste britannique, puisque nous verrons que pour Spengler et, plus tard, pour Schmitt, l’esprit marchand ne se coupe jamais d’une forme géographique.
- 31 Le titanisme est synonyme chez Jünger de prométhéisme. Dans Le Travailleur (op. cit., p. 105) qui, plus qu’une apologie prolétarienne et totalitaire du Travailleur, est une description clinique de l’émergence d’une nouvelle Figure historique destructrice, Jünger se fonde théologiquement sur le verset de la Genèse « Eritis sicut Deus » pour indiquer l’essence satanique de ce nouvel homme. Deux ans plus tard, Werner Sombart reprend textuellement ce verset (et d’autres, il cite même l’Encyclique Quadragesimo anno, véritable tournant par rapport à ses critiques passées contre l’Église catholique) pour dénoncer la moderne « construction de la tour de Babel ». Mais là où Jünger et Spengler semblent accepter l’apparition de cette Figure parce qu’elle est conditionnée par un processus historique inéluctable, Sombart au contraire ne s’y résigne pas et y voit un satanisme authentique que seule une réforme de l’État, une domestication stricte de la technique et une révision radicale du capitalisme au profit de la paysannerie pourrait endiguer : « Il faut croire au pouvoir du Diable pour comprendre ce qui s’est passé, depuis un siècle et demi, en Europe occidentale et en Amérique. Car on ne saurait qualifier ce que nous avons vu autrement que d’œuvre diabolique ». W. Sombart, Le socialisme allemand, op. cit., p. 19. La critique contre Jünger se fait explicite p. 282.
- 32 O. Spengler, Prussianité et socialisme, trad. d’E. Gruber, Actes Sud, 1986, p. 55. Cette œuvre sera dorénavant abrégée comme suit : « PS ».
- 33 Il va sans dire que pour Spengler, tout comme pour l’ensemble de la jeune Révolution conservatrice allemande, l’Occident est l’Allemagne, celle-ci étant considérée comme le cœur même de l’Europe et, par là, du monde occidental. Cette théorie, qui remonte au nationalisme allemand du XIXe siècle et qui est structurée par Houston Stewart Chamberlain, engendre fatalement, lorsqu’elle se conjugue au militarisme d’avant 1914 puis des années 30, la crainte de l’encerclement (Einkreisung), tant spatial que culturel, dont est étudiée en ces pages l’une des émanations géopolitiques et philosophiques. On relira l’exemplaire chapitre « La mission historique de l’Allemagne » de F. von Bernhardi, L’Allemagne et la prochaine guerre, trad. de F. Feyler, Payot, 1916, p. 67 sq. (trad. de Deutschland und der nächste Krieg, Stuttgart, JG Cotta, 1912). Sur la notion d’encerclement, cf. S. Azzarà, Pensare la rivoluzione conservatrice : Critica della democrazia e « grande politica » nella Repubblica di Weimar, Napoli, La Città del Sole, 2000, p. 173 sq.
- 34 1918, soit un an avant Prussianité et socialisme, ouvrage qui résonne comme une claire provocation aux heures les plus sombres du Traité de Versailles. On sait aussi que Spengler achève le premier tome du Déclin de l’Occident encore habité par la conviction en une victoire allemande dans la guerre mondiale ; à son grand dépit, l’édition originale Braumüller est mise en vente en avril ‘18, au plus fort de la débâcle allemande.
- 35 Cette exaltation de la prussianité devient, à travers les écrits d’Arthur Moeller van den Bruck, l’un des pivots théoriques de la protéiforme Révolution conservatrice allemande. Bien plus, les idées exprimées dans Prussianité et socialisme serviront concrètement de programme politique pour les Jeunes Conservateurs allemands. D. Felken, Oswald Spengler : Konservativer Denker zwischen Kaiserreich und Diktatur, München, C. H. Beck, 1988, p. 96.
- 36 L’opposition de Spengler au national-socialisme est avérée ; il ne reconnaîtra jamais au nazisme le rôle césarien qui devait échoir au peuple allemand afin que soit instauré un empire germanique et prussien, socialiste et organique. Cela peut s’expliquer par ses conceptions personnelles, lesquelles sont, bien avant la naissance même du NSDAP, contraires à l’idéalisme nazi, à sa nostalgie romantique des origines, d’une race pure etc. Cf. O. Spengler, « Pessimisme ? », in : Écrits historiques et philosophiques, Pensées, trad. d’H. Plard, Copernic, 1980, p. 37 sq. « Pessimisme ? » [Pessimismus ?, 1921] est un court essai publié un an avant la parution du second tome du Déclin de l’Occident. Dans ces pages, Spengler répond à tous ceux qui l’accusent de pessimisme gratuit, et revendique un pessimisme actif, une sorte de réalisme des temps derniers devant permettre aux valeurs impériales germaniques de triompher des idées libérales. Sur les relations complexes entre Spengler et le national-socialisme, C. Vollnhals, « Oswald Spengler und der Nationalsozialismus : Das Dilemma eines konservativen Revolutionärs », Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte Tel Aviv n. 13, 1984, p. 263 sq.
- 37 Sombart en proposa une version à la fois personnelle et héritière aussi de cette tradition d’un socialisme national dans W. Sombart, Le socialisme allemand, Pardès, 1990 (trad. de G. Welter, Payot, 1938 [1934]), dont les thèses sont très proches de celles exprimées par Spengler et, dans une relative mesure, par Schmitt et Jünger. Dans sa préface de la réédition, Alain de Benoist dresse un cadre complet de l’émergence de ce concept d’un socialisme allemand au moment de l’Unité et de ses prolongements complexes à travers la sociale-démocratie, les partis révolutionnaires d’orientation marxiste ou conservatrice, voire le national-socialisme. Alain de Benoist est le principal intellectuel du mouvement métapolitique contemporain dit de la “Nouvelle droite”, proche héritière de la Révolution conservatrice et de ses contradictions (dans la mesure où cette dernière n’était pas un mouvement unitaire et affilié à un parti politique particulier). Sur la nouvelle droite, l’étude désormais classique de Pierre-André Taguieff nous apparaît encore aujourd’hui comme une somme inégalée : PA Taguieff, Sur la Nouvelle droite : Jalons d’une analyse critique, Descartes et Cie, 1994.
- 38 O. Spengler, « Pessimisme ? », op. cit., p. 30. Domenico Conte a relativisé cette opinion, souvent exprimée dans l’œuvre de Spengler, qui l’adressait avant tout au milieu universitaire, dont il n’était pas issu : D. Conte, Introduzione a Spengler, Bari-Roma, Laterza, 1997. Voir aussi du même auteur : D. Conte, Catene di civilità : studi su Spengler, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.
- 39 Le destin de la nation allemande est un topos de la littérature politique conservatrice de l’après-guerre, commun à Spengler, Moeller van den Bruck, Hans Schwartz, Jünger etc. ; « das Schicksal » apparaît en quelque sorte comme la conceptualisation idéale de l’aspiration pangermaniste à un grand espace national. Dans une de ses œuvres les plus personnelles, Moeller van den Bruck commence ainsi, avec une concision toute prussienne, le dernier chapitre, intitulé précisément « Das preußische Schicksal » : « Preußen mußte sein, damit Deutschland werden konnte » (A. Moeller van den Bruck, Der preußische Stil, Breslau, WG Korn Verlag, 1931 [1916], p. 196) ; tout cela pour signifier que l’Allemagne devait à son tour réaliser son destin dans le monde, comme la Prusse avait elle-même porté le sien à maturité à travers la création de l’Allemagne comme nation. Cette notion mythique de destinée rejoint les aspirations géopolitiques énoncées dès la fin du XIXe siècle, dont l’idée de « Großraum » sera l’aboutissement. À l’instar de Jünger, Moeller van den Bruck considère comme inévitable le passage du nationalisme à l’internationalisme, non pas suivant la Weltanschauung marxiste mais conformément à une conception de l’histoire qui, tout en prenant acte de la dilatation irrépressible de l’espace (ce que nous nommerions aujourd’hui la mondialisation), place l’Allemagne et son futur Reich au cœur de cette révolution, acteur central de sa propre destinée ; selon lui, Berlin symbolisait par excellence la Weltstadt en devenir et indiquait au pays tout entier le rôle qui lui incombait. Semblablement, Jünger constate en 1932 que la révolution mondiale est en marche, que la Domination s’exprime comme un mouvement unificateur de l’espace planétaire, mais qu’elle ne peut « réussir qu’en un seul point » (E. Jünger, Le Travailleur, op. cit., p. 113) ; à la lumière de l’œuvre jüngerienne, il faut entendre ce « point » géographiquement et mathématiquement, symbole de l’accomplissement de la domination technique (« la perfection de la technique », ibidem, p. 222) ; l’Allemagne apparaissait alors comme le centre souhaité de cette réalisation de la volonté de puissance. Après l’accession au pouvoir d’Hitler, Jünger renoncera à cette idée qu’il défendait depuis 1914. Comme chez Spengler, géopolitique et symbolisme sont connexes. Voir aussi ibidem, p. 212, 219-220.
- 40 O. Spengler, « Pessimisme ? », op. cit., p. 29.
- 41 Quoique Mircea Eliade le rattache à une conception linéaire et non cyclique de l’histoire, il faudrait aussi citer l’influence de Joachim de Flore, dont les thèses, à l’époque de Spengler, séduisait de nombreux penseurs allemands de droite. Pour une analyse récente, Antonella Doninelli, « In attesa della 'Terza Età dello Spirito'. Confluenza di temi gioachimiti e tradizione islamica tramite Jakob Böhme nel millenarismo esoterico tra '800 e '900 », in : Florensia n°18-19 (2004-2005), p. 59-68.
- 42 On ne peut que constater chez Spengler la distinction entre racisme biologique d’ascendance nazie et racisme « de l’esprit », comme le définit Spengler lui-même dans PS, p. 42 ; mais il serait vain de prouver que le second racisme, celui de l’âme, est moins dangereux que le racisme biologique sous le prétexte qu’il fut moins répandu dans les milieux les plus conservateurs et que le nazisme lui préféra un “contenant” prétendument plus scientifique. Sous le fascisme, cette question d’un racisme de l’esprit ou de l’âme fut longuement débattue en Italie, où elle fut présentée comme une alternative au racisme biologique allemand, bien que celui-ci connût aussi des développements dans la péninsule. Pour en revenir à Spengler, il faut remarquer qu’au-dessus des prétendues races, il y a l’État et la nation. En pleine montée de l’antisémitisme en Allemagne, il n’hésite pas à écrire dans la note 4 du premier chapitre de Neubau des deutschen Reiches (München, CH Beck, 1924, p. 18) que le slogan « Dehors les juifs ! » est un mot d’ordre grossier et indigne de l’Allemagne. Comme contre-modèle, il n’hésite pas à citer en exemple l’Angleterre (pourtant si souvent critiquée), par sa capacité à intégrer des peuples différents dès lors que ceux-ci se placent au service de l’État qui leur offre l’hospitalité et participent à sa grandeur ; principe qui sert aujourd’hui de référence dans la plupart des pays démocratiques pour l’acquisition de la nationalité.
- 43 Au fond, depuis la Révolution de 1789, la France n’est plus que le fourrier du libéralisme anglo-saxon en Europe (PS, p. 20) ; elle est par essence la nation “bourgeoise”, par opposition à l’Allemagne, patrie socialiste et ouvrière, non marxiste, disciplinée et hostile à l’esprit révolutionnaire (ibidem, p. 28)
- 44 S. Berger, « Between efficiency and “Prussianism” : stereotypes and the perception of the German Social Democrats by the British Labour Party, 1900-1920 », in : Stereotypes in Contemporary Anglo-German Relations, dir. R. Emig, London, Macmillan Press, 2000, p. 172-184. À l’époque de Spengler, et bien avant la guerre, le conflit latent entre Allemagne et Angleterre est déjà perçue comme une phase inéluctable de la lutte pour un empire mondial : à la fin du XIXe siècle, l’écrivain Hans Grimm — l’un des “pères” de la Révolution conservatrice — se montre sensible « aux arguments inspirés du darwinisme social qui présentent la rivalité anglo-germanique comme le premier combat que les espèces se livreront dans l’avenir ». J. Gandouly, « Hans Grimm et la Révolution conservatrice : les ambiguïtés du néoconservatisme agraire », in La Révolution conservatrice et les élites intellectuelles européennes, op. cit., p. 64. Sur la critique du libéralisme anglo-saxon par les révolutionnaires conservateurs et, plus généralement, sur la figure de l’ennemi de l’Allemagne : S. Breuer, Anatomie de la Révolution conservatrice, trad. d’O. Mannoni, MSH, 1996, p. 59 sq.
- 45 PS, p. 23. Schmitt citera ce passage de Spengler lorsqu’en 1928 il posera sa critique de l’État de droit bourgeois : C. Schmitt, « Der bürgerliche Rechtsstaat » (1928), in : Staat, Großraum, Nomos : Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, dir. G. Maschke, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, p 47.
- 46 Ce stéréotype de l’individualiste pragmatique et mercantile a mûri en Angleterre même, se reflétant d’abord dans la littérature britannique pour se répandre ensuite dans l’Europe entière. C’est du moins la thèse stimulante soutenue par Jean Paul Forster : J. P. Forster, « De la prise de conscience d’une identité à la constitution d’un type ou stéréotype : l’image de l’Anglo-Saxon au XVIIIe siècle », in : L’image de l’Anglo-Saxon : Types et stéréotypes - conformisme et subversion, dir. MC Hamard, Ann. Litt. de l’Univ. de Besançon, Belles Lettres, 1992, p. 9-27. Le rejet de l’Angleterre comme peuple mercantile, opportuniste et utilitariste est récurrent chez la majorité des penseurs de la Révolution conservatrice : on relira par ex. A. Moeller van den Bruck, Das Recht der jungen Völker, München, R. Piper, 1919. Sur la constance de ce thème chez Moeller : D. Goeldel, Moeller van den Bruck (1876-1925) : Un nationaliste contre la révolution - Contribution à l’étude de la «Révolution conservatrice» et du conservatisme allemand au XXe siècle, Frankfurt/Main - Bern - NY - Nancy, Peter Lang, 1984, p. 481-492.
- 47 PS, p. 55.
- 48 Il écrit très expressément : « Le caractère d’un peuple est la résultante des vicissitudes de son destin. Ce ne sont ni la terre, ni le climat, ni le ciel, ni la mer, ni non plus la race, le sang qui, en dernière analyse, le forment. Tout cela, ce n’est que la matière première à partir de laquelle les coups de la réalité historique forgent une forme ». O. Spengler, « Sur le caractère du peuple allemand » (1927), in O. Spengler, Écrits historiques et philosophiques - Pensées, op. cit., p. 97. Cette citation extraite d’un ouvrage publié près de dix ans après le premier tome du Déclin de l’Occident et Prussianité et socialisme infirme-t-elle les opinions passées de Spengler, qui semblaient déterministes à bien des égards ? En fait, nous verrons que dans L’homme et la technique, publié en 1931, l’influence du milieu géographique est réaffirmée. Il nous semble simplement que dans le passage précité, Spengler relativise, sans l’exclure, l’influence de l’espace, subordonnée à l’histoire (« la réalité historique »), qui façonne (donne « une forme ») hommes et choses au gré des cycles de Culture et de civilisation. Ici, selon moi, le penseur ne fait que réfuter un déterminisme (la géographie et la race biologique) pour en instaurer un autre, une sorte de tyrannie des morphologies historiques sur le destin de l’humanité.
- 49 De ces concepts fondamentaux de la dissertation spenglerienne, il est difficile de donner un résumé, tant les nuances sont fines et les corrélations innombrables. J’invite ici le lecteur à relire le quatrième chapitre de « Macrocosme », in DO, t. 1, p. 170 sq. Pour notre sujet, il faudrait au moins citer ce passage capital : « L’espace infini est l’idéal que l’âme occidentale n’a cessé de chercher dans son univers ambiant. Elle voulait le voir se réaliser immédiatement en elle, et cette nostalgie seule donne, par delà leurs prétendus résultats, aux innombrables théories de l’espace de ces derniers siècles leur signification profonde comme symptômes d’un sentiment cosmique. Dans quelle mesure l’étendue illimitée est-elle le fondement de toute chose ? ». Ibidem, p. 173. Ailleurs, proposant une nouvelle définition du couple Culture/civilisation, il parlait de la Culture comme « l’organisme né du paysage », par opposition à la Civilisation, « mécanisme résultant de son corps figé » ; ibidem, p. 335. Le paysage est donc vu comme espace créateur de l’âme d’un peuple ; on comprend que l’insularité soit porteuse d’une fracture, ce paysage participant au déploiement du “devenir” au détriment du “devenu” et donc de la Culture.
- 50 O. Spengler, L’homme et la technique, trad. A. Petrowsky, Gal., 1969 [1931], p. 63-65.
- 51 Ibidem, p. 137.
- 52 Pour Hobbes, rappelons-le, l’État de nature, anarchique et cruel, était géographiquement situé dans le « Nouveau Monde », que cette violence pré-étatique prît le visage des peuples sanguinaires autochtones ou celui des colons européens.
- 53 En conclusion, Spengler ne peut d’aucune façon concevoir l’économie comme échange pacifique de biens, il a une conception par trop polémique de l’histoire humaine, qui certes se veut, de son propre aveu, réaliste et non pessimiste, mais la violence endémique qui caractérise l’épopée humaine devient sous sa plume un déterminisme presque biologique. Certes, il ne souhaite pas cette violence, mais elle paraît irrésistible. Cette thématique occupe une place centrale dans l’essai tranchant L’homme et la technique, mais elle est une constante de son œuvre et prend souvent la forme d’un développement biologiste de la volonté de puissance. À la fin de son existence, il écrira : « La vie est un combat entre les plantes, les animaux et les hommes, un combat entre les individus, les classes de la société, les peuples et les États, qu’il se déroule sous des formes économiques, sociales, politiques ou militaires. C’est une lutte pour le pouvoir d’imposer sa volonté, son avantage, ou sa conception de l’utile et du juste, et quand d’autres moyens manquent leur but, on aura toujours et sans cesse recours au moyen ultime, la violence ». O. Spengler, « La paix mondiale est-elle possible ? », in Écrits historiques et philosophiques, op. cit., p. 113.
- 54 Parfois, ses idées rejoignent cependant les hypothèses de Weber quant à une interrelation entre pensée théologique et pensée économique. Spengler a en effet bien remarqué que la société anglaise, puritaine, partageait une conception du monde uniforme et « teintée de théologie » (PS, p. 62). Par ex., si le Prussien a le culte du devoir et du travail, au service de la communauté, en revanche l’Anglais recherche le « comfort », qu’il reçoit comme une grâce divine puisque le travail est une séquelle de la chute entraînée par le péché, suivant les principes calvinistes (PS, p. 65)
- 55 Pareillement, Jünger considère que c’est durant la République de Weimar que l’on tenta « d’élever au rang d’un ordre allemand les concepts les plus poussiéreux du libéralisme ». E. Jünger, Le Travailleur, op. cit., p. 54.
- 56 Les idées de Spengler en la matière influenceront particulièrement A. Moeller van den Bruck, Sozialismus und Aussenpolitik, Breslau, WG Korn, 1933.
- 57 PS, p. 73. Voir aussi DO, t. 2, p. 316-317.
- 58 PS, p. 75. Dans le second tome du Déclin de l’Occident (IV, 8), Spengler revient sur les formes primaires du paléo-capitalisme : la conquête du sol, entendu comme butin, fait du nouveau possesseur un authentique propriétaire au sens juridique, lequel s’attelle à développer ensuite tout un réseau de gestion comptable et administrative (d’où la distinction entre « économie originelle » et « histoire économique des hautes cultures », DO, t. 2, p. 439) : ce sont les idées reprises et approfondies par Schmitt dans les premières pages du Nomos de la terre ; j’y reviendrai. Le principal exemple choisi par Spengler est celui de Guillaume le Conquérant, premier “propriétaire” de l’île d’Angleterre, comparé à Ulysse ou aux gestionnaires de l’Égypte Ancienne, conformément à sa méthode analogique. L’Angleterre est donc encore assimilée à une Culture classique, mais il est certain qu’elle porte déjà en elle les stigmates de la Civilisation et de l’esprit faustien. DO, t. 2, p. 341. Dans les dernières pages du Déclin de l’Occident, il résume parfaitement cela en détournant la célèbre maxime de Clausewitz : « La politique et le commerce sous forme développée (art de réaliser sur l’adversaire des succès matériels au moyen d’une supériorité spirituelle) sont toutes deux un succédané de la guerre par d’autres moyens » (DO, t. 2, p. 437).
- 59 « Le Viking est devenu le défenseur du libre-échange, le chevalier, quant à lui, fonctionnaire dans l’administration. […]. L’économie mondiale doit-elle être une exploitation ou une organisation du monde ? ». PS, p. 77.
- 60 Le marxisme même n’échappe pas, selon Spengler, à la logique de la prédation. Là encore, la typologie sert à expliquer des concepts politico-philosophiques : l’exploitation bourgeoise du prolétariat ne serait qu’une mise à jour de l’instinct viking reposant sur la dyade « voleurs et volés » avec « partage du butin après la victoire » (PS, p. 101-102) ; ou encore : « le monde, non pas État ou Église, mais le monde devenu butin » (ibidem, p. 118) ; voir aussi DO, t. 2 p. 32).
- 61 DO, t. 2, p. 317. Plus avant, Spengler précise sa pensée. À la fin du cycle occidental, la politique elle-même se désagrège ; fondée sur une tradition transmisse par une élite, elle se décompose : « On arrive à un tournant dès qu’avec la grande ville le non-ordre, la bourgeoisie, prend le pouvoir. Maintenant, c’est au contraire la forme politique qui s’élève au rang d’objet de la lutte, de problème. Jusque-là, elle avait mûri, maintenant elle doit être fondée. La politique s’éveille, elle est non seulement conçue, mais réduite en concepts. Contre le sang et la tradition s’élèvent les puissances de l’esprit et de l’argent. Au lieu de l’organique vient l’organisé, au lieu de l’ordre le parti » (DO, t. 2, p. 413)
- 62 Ibidem, p. 342.
- 67 À propos de l’affrontement inéluctable entre différentes « cultures » européennes, des théories portant sur la décadence supposée de la France, sur la construction de la prussianité et sur l’influence de l’insularité sur le « caractère » de l’Angleterre (des thèmes très proches de ceux que développe Spengler à la même époque), cf. E. Troeltsch, « Der Geist der deutschen Kultur », in Deutschland und der Weltkrieg, sous la direction d’O. Hinke, F. Meinecke, H. Oncken et H. Schumacher, Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1915, p. 60 sq.
- 68 Modern Germany in Relation to the Great War, trad. de W. W. Whitelock, New York, Mitchell Kennerley 1916.
- 69 H. Oncken, Deutschlands Weltkrieg und die Deutschamerikaner : ein Gruss des Vaterlandes über den Ozean, Stuttgart, Deutsche Verlags-Abstalt, 1914.
- 70 W. Sombart, Händler und Helden : Patriotische Besinnungen, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1915. Cet ouvrage sera désormais abrégé comme suit : « H&H ».
- 71 F. von Bernhardi, Deutschland und der nächste Krieg, op. cit.
- 72 H&H, p. VI.
- 73 W. Sombart, Le Bourgeois : Contribution à l’histoire morale et intellectuelle de l’homme économique moderne, trad. de S. Jankélévitch, Payot, 1928 [1913].
- 74 C’est de Weber que prend sa source, en partie, la réflexion de Carl Schmitt sur la typologie juridique de l’âme (« Geist ») française : rationaliste et ennemi de l’ordre, le parlementarisme français aurait été élaboré et divulgué par la masse des avocats révolutionnaires ; en cela, les Français seraient fort proches des Anglais, ces deux peuples étant souvent frères dans l’âme (analyse d’ailleurs très répandue chez les penseurs révolutionnaires-conservateurs allemands et italiens, que l’on songe à Thomas Mann et ses Considérations d’un impolitique, trad. de L. Servicen et J. Naujac, Grasset, 2002) ; quoique le juriste allemand démontre aisément en quoi l’esprit centralisateur français — dont il situe la genèse avec l’œuvre de Guillaume de Nogaret — est bien antérieur à 1789. C. Schmitt, « Die Formung des französichen Geistes durch den Legisten » (1942), in : Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, op. cit., p. 190 sq.
- 75 En littérature même on s’est risqué, surtout au XIXe siècle, à classifier les textes en fonction de leur situation géographique et du génie national de leur auteur. Dans le sillage de Rousseau, Madame de Staël distingue les littératures du Midi et celles du Nord. Le célèbre critique Joseph Texte, qui a consacré un ouvrage complet à l’origine de la question, n’a pas manqué d’en reconstituer l’itinéraire intellectuel et lui-même s’interroge sur le fondement ou non d’une « ethnographie morale », d’un esprit national lié au génie de ses écrivains. Ce type d’interrogation sur l’« esprit » d’un peuple est véritablement dans l’air du temps à l’orée du siècle des totalitarismes. Voir en particulier l’introduction de J. Texte, Jean-Jacques Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire : Étude sur les relations littéraires de la France et de l’Angleterre au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine, 1970 [1895].
- 76 H&H, p. 6.
- 77 Il est surprenant qu’en France, à l’heure de la gouvernance post-nationale, les notions d’âme et de patrie réinvestissent le terrain de la réflexion philosophique et historique, que l’on songe récemment aux débats inaugurés par Max Gallo ou Alain Finkielkraut, deux intellectuels provenant de la gauche politique. M. Gallo, L’âme de la France : Une histoire de la nation des origines à nos jours, Fayard, 2007 ; A. Finkielkraut, Qu’est-ce que la France ?, Stock, 2007.
- 78 H&H, p. 42. Schmitt utilisera la même terminologie pour décrire les guerres navales et commerciales de ces proto-capitalistes que furent, à partir du XVIe siècle, les pirates et corsaires britanniques.
- 79 DO, t. 2, p. 295. Doctrinalement, la critique de Spengler est bien posée et rejoint sur bien des points les objections au capitalisme de la pensée socialiste mais aussi libérale. En ce sens, de nombreux libéraux ont pu délaisser le libéralisme économique extrême qui appauvrissait les masses pour repenser un libéralisme plus social, et cela dès le XIXe siècle : M. Canto-Sperber, « Le libéralisme social : l’ambition d’une société où la vie des plus démunis puisse faire l’expérience d’une vraie liberté », M. Canto-Sperber-N. Tenzer, Faut-il sauver le libéralisme ?, Grasset, 2006, p. 52 sq. D’ailleurs, dans ses écrits, Spengler prend bien soin de distinguer le capitalisme prédateur du libéralisme social, qu’il finit de toute façon par placer sur le même plan que le socialisme et le réformisme démocratique ; au fond, il ne montre que mépris pour ces rejetons de la philosophie des Lumières. Ultralibéralisme ou libéralisme social mettent tous deux en péril la souveraineté de l’État, soit par la guerre économique et individualiste que déclenchent les premiers, soit par le nivellement des valeurs et le désenchantement qu’imposent les seconds. Libéraux ou révolutionnaires, tous rêveraient d’une même société idéale et sécularisée, seuls différeraient les moyens d’y parvenir. C’est une opinion courante parmi les révolutionnaires conservateurs européens de l’époque. On se référera par ex. à J. Evola, « Americanismo e bolscevismo », Nuova Antologia n. 10, mai 1929 ; ou encore à un article prophétique de Carl Schmitt sur l’après-guerre froide, où il stigmatise les deux acteurs de la division bipolaire, lesquels sont l’un et l’autre prisonniers d’une même philosophie de l’histoire univoque et adepte du même culte du progrès rendu à la « religion techniciste » des masses. C. Schmitt, « Die Einheit der Welt », Merkur n. 1-VI, janv. 1952, p. 1-11 (C. Schmitt, « L’unité du monde », trad. JL Pesteil, in C. Schmitt, Du politique : « Légalité et légitimité » et autres essais, Pardès, 1990, p. 225-236).
- 80 C. Schmitt, « Die Raumrevolution. Durch den totalen Krieg zu einem totalen Frieden » (1940), in Staat, Großraum, Nomos, Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, op. cit., p. 388.
- 81 Sur ce point, dans le contexte de l’Allemagne : F. Stern, Politique et désespoir : Les ressentiments contre la modernité dans l’Allemagne préhitlérienne, A. Colin, 1990. Toutefois, il serait absurde de réduire la critique de l’utopie, de la reductio ad unum qu’elle implique et qu’elle réalise par la technique, aux seuls mouvements conservateurs d’Allemagne et d’ailleurs. De fait, la mise en garde de Schmitt, Jünger et Spengler contre l’utopie moderne a stimulé le philosophe italien Massimo Cacciari, dont on peut difficilement dire qu’il est un penseur réactionnaire : M. Cacciari, L’Arcipelago, Milano, Adelphi, 1997, p. 71-91. Ce même écrivain a été fortement influencé par la réflexion de Schmitt sur l’espace dans Geo-filosofia dell’Europa, Milano, Adelphi, 1994.
- 82 S. L. Gilman, L’Autre et le moi. Stéréotypes occidentaux de la Race, de la Sexualité et de la Maladie, trad. de C. Cantoni-Fort, PUF, 1996, p. 14. Ce schème polémique est propre à l’ensemble de la culture völkisch allemande et est bien évidemment antérieure aux écrits de Spengler : K. von See, Freiheit und Gemeinschaft : Völkisch-nationales Denken in Deutschland zwischen Französicher Revolution und Erstem Weltkrieg, op. cit.
- 83 De l’avis de Masaryk, opposant tchèque au nationalisme et fervent tenant du démembrement de l’Empire austro-hongrois dès les négociations de paix, le pangermanisme fut l’une des causes les plus sous-estimées (notamment par la France et l’Angleterre) de la Première Guerre mondiale. T. G. Masaryk, La Nouvelle Europe, texte établi par A. Soubigou, Harmattan, 2002. À quoi j’ajouterais que le démembrement du dernier Empire catholique et les sanctions contre l’Allemagne en 1919 ont été l’une des principales causes de la Seconde Guerre mondiale.
- 84 Paradoxalement, le pangermanisme va générer chez les Français une véritable typologie de l’Allemand, forcément impérialiste et belliciste ; cf. l’introduction de M. Korinman, Deutschland über alles : Le pangermanisme. 1890-1945, Fayard, 1999.
- 85 M. Korinman, Continents perdus : Les précurseurs de la géopolitique allemande, Economica, 1991.
- 86 D’ailleurs, pour Spengler, ce qui fonde un peuple, ce n’est pas le sang de sa prétendue race, mais bien le paysage, le lieu physique où se multiplient les générations, qui va jusqu’à imprimer sa marque sur la physionomie des êtres : DO, t. 2, p. 114-121. Plus avant, il fustige encore le mythe du sang pur, ibidem, p. 151-152. On comprend mieux ce qui a toujours éloigné Spengler du nazisme.
- 87 M. Korinman, Quand l’Allemagne pensait le monde : Grandeur et décadence d’une géopolitique, Fayard, 1990, p. 33 sq.
- 88 « Ratzel pose donc un concours entre les propriétés du sol habité et les capacités de la population. Son territoire influe sur un peuple qui, à l’inverse, le modèle en fonction du potentiel spatial avéré dans une longue histoire », ibidem, p. 42.
- 89 Ibidem, p. 43, 47.
- 90 Sous le prétexte d’un rejet de la Renaissance et de l’humanisme comme bénéfice pour l’humanité — opinion largement partagée par l’ensemble de la pensée contre-révolutionnaire et/ou nietzschéenne —, Spengler ne s’attarde pas (et c’est là sans doute une des grandes limites de sa physionomie historique universelle) sur les apports de l’Italie (notamment grâce à ses cités portuaires et à son système bancaire) à l’essor du capitalisme, contrairement à Sombart, qui s’en servira pour différencier et valoriser sa théorie du socialisme allemand. Pour Spengler, le peuple italien — aussi « anarchiste » que les Français — est le fossoyeur de l’âme gothique et faustienne qui modela le Moyen Âge occidental (PS, p. 47 sq.), toute tendue vers l’infinie et qui ne pouvait que succomber devant la renaissance de la perspective dans l’art, perçue comme limitation arbitraire du champ visuel, pour renaître brièvement grâce à l’alliance de deux peuples « gothiques », l’espagnol et le germanique. L’art gothique, pour Spengler, est art du mouvement et de la profondeur et est en cela proche, dans sa relation à la vue, de l’ouverture, de la dilatation des perspectives spatiales caractéristique de l’âme faustienne ; cette âme qui triompha, selon lui, avec la poussée des croisés vers le Proche-Orient et des chevaliers teutoniques vers le Nord, préludes à la révolution spatiale opérée par Colomb. Nous reviendrons sur les affinités entre Spengler et Carl Schmitt, mais il est frappant de remarquer que Schmitt lui emprunte les éléments de morphologie historique précités et en fait même le pilier de sa « révolution de l’espace ». C. Schmitt, Terre et mer : Un point de vue sur l’histoire mondiale, intro. et postface de J. Freund, Labyrinthe, 1985 [1942], p. 57. L’ouvrage sera désormais abrégé comme suit : « TM ».
- 91 DT Murphy, The Heroic Hearth : Geopolitical Thought in Weimar Germany, 1918-1933, Kent, The Kent State University Press, 1997, p. 26.
- 92 HA Heinrich, Politische Affinität zwischen geographischer Forschung und dem Faschismus im Spiegel der Fachzeitschriften, Giessener Geographischen Schriften, 1991, p. 77, 319. Les liens entre « Landschaft » et « Volkstum » sont aussi au coeur des travaux du géographe Hans Schrepfer dans les années 20 et 30 ; ibidem, p. 114-115.
- 93 Ibidem, p. 155.
- 94 Ibidem, p. 110 sq.
- 95 Je détaillerai les modalités de cette affinité et donnerai ma propre interprétation du dialogue entre ces deux penseurs du Kulturpessimismus. Il existe un bref opuscule qui examine cette relation mais, contrairement à notre approche, il attache moins d’importance à l’influence de l’espace sur la pensée économique contemporaine telle que l’envisagent Spengler et Schmitt : M. Corselli, Lo spazio della vita e la terra del tramonto, Palermo, Herbita Editrice, 1996.
- 96 En 1940, il porte à maturation ses réflexions sur le « Großraum » en citant tout spécialement Ratzel, prophète de la révolution de l’espace parce que, selon Schmitt, ce dernier avait annoncé qu’au fil du temps l’histoire se ferait de plus en plus géographique et territoriale. C. Schmitt, « Raum und Großraum im Völkerrecht » (1940), in C. Schmitt, Staat, Großraum, Nomos, op. cit., p. 237. Sur les liens de Schmitt avec la pensée géopolitique, cf. les notes explicatives de Günter Maschke p. 321 sq.,
- 97 TM, p. 17.
- 98 Alors, écrit Schmitt, la « vie et la destinée humaine seraient entièrement programmées par la nature, comme celles d’un animal ou d’une plante, et l’on ne pourrait que constater que les uns dévorent les autres, tandis que d’autres vivent dans une sorte de symbiose mutuelle. Il n’y aurait pas d’histoire humaine en tant qu’histoire des actes et des décisions de l’homme », ibidem, p. 22. Ce qui prouve que le décisionnisme schmittien, non réservé au seul état d’exception, est bien fondé sur le libre arbitre, en parfait accord avec l’anthropologie chrétienne.
- 99 C. Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes : sens et échec d’un symbole politique, trad. de D. Trierweiler, Seuil, 2002 [1938].
- 100 C. Schmitt, Le Nomos de la terre, PUF, 2001, p. 48.
- 101 Ibidem, p. 51.
- 102 C’est bien ainsi que Schmitt définit les « révolutions spatiales ». Cf. ibidem, p. 52.
- 103 Il n’est sans doute pas dû au hasard que Schmitt cite comme premier authentique pirate moderne Jean Fleury, qu’il définit comme un « viking français » (ibidem, p. 39). Par-delà cette facétie, il nous semble que l’allusion au viking soit avant tout indicative d’une âme avide de butin, cette « âme » viking maintes fois décrite par Spengler dans sa dimension spirituelle et économique.
- 104 Cela est aujourd’hui bien établi et récemment confirmé à l’appui de sa thèse par le sociologue Rodney Stark. R. Stark, Le triomphe de la raison : Pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme, trad. de G. Hocmard, Presses de la Renaissance, 2007 [2005], p. 250-257.
- 105 Plus tard, dans sa Théorie du partisan, il corrigera cette formule, désormais inadaptée. Somme toute, le partisan reste lié à l’élément « tellurique », contrairement au pirate il est lié à la terre, même si l’irrégularité juridique de leurs modes d’action les rapproche. C. Schmitt, Théorie du partisan, in : La notion de politique - Théorie du partisan, Flammarion, 1992 [1963], p. 234. L’« aspect spatial », terrien, est fondamental pour comprendre l’émergence de ce nouveau type, en résistance passive contre la puissance grandissante de l’élément marin en droit international. Volens nolens, les types politico-juridiques nouveaux qui font leur apparition dans l’histoire restent soumis à un certain contexte spatial élémentaire, à un « paysage » pour employer la terminologie de Spengler. On ne comprend pas la pensée de Schmitt si l’on coupe sa réflexion juridique ou politique de sa „situation’ dans l’espace élémentaire.
- 106 Ibidem, p. 224. Citons encore ce passage fondamental, où Schmitt stigmatise la tyrannie de la technique, qu’il avait déjà indiquée (dans « L’unité du monde », art. cit.) comme le révélateur d’une tentative de fusion de l’espace planétaire sous l’action des systèmes libéral et communiste, et, plus largement, de toute pensée progressiste issue des diverses « philosophies de l’histoire » échafaudées par les Lumières : « Le contraste élémentaire entre la mer et la terre ferme demeure bien trop grand. Il se peut que les différences traditionnelles concernant la guerre, l’ennemi, les prises de guerre, sur lesquelles s’appuie jusqu’à ce jour l’opposition entre terre et mer dans le droit international, se fondent un jour au creuset du progrès industriel et technique. Pour l’instant, le partisan représente encore une parcelle de vrai sol ; il est l’un des derniers à monter la garde sur la terre ferme, cet élément de l’histoire universelle dont la destruction n’est pas encore parachevée ». C. Schmitt, Théorie du partisan, op. cit., p. 278.
- 107 C. Schmitt, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 48.
- 108 La principale source historique de Schmitt est Ph. Gosse, The History of Piracy, NY, 1932. Elle est citée par G. Maschke dans ses notes explicatives pour « Das Meer gegen das Land » (1941), in : Staat, Großraum, Nomos, op. cit., p. 399.
- 109 Cela est patent dans TM, p. 68-69.
- 110 Ce n’est pas l’affrontement entre terre et mer qui est neuf — Schmitt montre au contraire que cet antagonisme est plurimillénaire — mais le fait que l’empire des mers se mue, sous l’action de l’Angleterre, en un empire financier mondial englobant la terre et la mer, tous deux n’étant plus de simples éléments mais devenant « Großraum », pur espace planétaire, à l’instar de l’élément aérien. C’est pour cette raison que dans Terre et mer comme dans les articles préparatoires pour cet essai, Schmitt insiste tant sur la révolution historique opérée par la flibuste anglaise sous le règne de la reine Elisabeth, événement sans précédent qui est d’abord une révolution de l’espace (Raumrevolution) : comme pour Spengler, ce n’est pas tant le capitalisme en soi qui est révolutionnaire, mais bien la conquête de l’espace mondial par l’âme financière. C. Schmitt, « Das Meer gegen das Land », art. cit., p. 396-397.
- 111 C’est une résurgence de l’opposition spenglerienne entre « vikings du sang » et « vikings de l’esprit », ces derniers étant selon lui aussi bien les penseurs nordiques inaugurant la domination de la nature par la technique (Grosseteste, Roger Bacon, Albert le Grand, Witelo) que les explorateurs de la Renaissance, tous prophètes du même esprit faustien, fait unique dans l’histoire de l’humanité. O. Spengler, L’homme et la technique, op. cit., p. 139 sq.
- 112 Cf. C. Schmitt, Le Nomos de la terre, op. cit., p. 172 sq.
- 113 « patrie » ; mais le sens profond de “refuge” est intraduisible.
- 114 JL Schlegel, introduction à C. Schmitt, Théologie politique, 1922, 1969, trad. de JL Schlegel, Gallimard, 1988 [1922, 1969], p. XII-XIII. On trouve une première référence à la sécularisation entendue comme « théologie politique » dans C. Schmitt, « Romantisme politique » [1919], in : Du politique, op. cit., p. 14-15.
- 115 Ce serait, selon la magistrale étude d’Alberto Predieri, ce qui le distingue le plus radicalement de Jünger. A. Predieri, La guerra, il nemico, l’amico, il partigiano : Ernst Jünger et Carl Schmitt, Firenze, La Nuova Italia, 1999, p. 91.
- 116 C. Schmitt, La dictature, trad. de M. Köller et D. Séglard, Seuil, 2000 [1921].
- 117 Dans le dernier chapitre du tome 2 du Déclin… (« Le monde formel de la vie économique »), Spengler s’interroge sur les liens entre le politique et l’économique, et son étude de ces deux notions, à la lumière de la dictature de la pensée économique sur le politique, le conduit à des conclusions fort proches de celles que Schmitt formule à la même époque, au lendemain de la Première Guerre mondiale. On songe spécialement à la complémentarité des notions politique et économique, comprises comme des opposés en tension permanente, le politique étant avant tout un « idéal » qui atteint son apogée dans la guerre (DO, t. 2, p. 433 sq.), le conflit étant ici implicitement compris comme l’être même du politique ; et nous ne sommes guère éloignés ici du décisionnisme schmittien, du politique comme désignation de l’ennemi, à cette différence fondamentale cependant que Schmitt n’idéalise ni le politique, ni la guerre.
- 118 C. Schmitt, Théologie politique, op. cit., p. 32.
- 119 « On n’évalue pas à l’aide d’une norme, au contraire : c’est seulement à partir d’un point de référence (Zurechnungspunkt) qu’on définit ce qu’est la justesse normative. La norme ne livre aucun point de référence, mais seulement une qualité de contenu ». C. Schmitt, La dictature, op. cit., p. 42.
- 120 C. Schmitt, « Grand espace contre universalisme » [1939], trad. de R. Kirchhof, in C. Schmitt, Du politique, op. cit., p. 135-136.
- 121 « Neue Kräfte und Energien tragen die neue Raumrevolution, und dieses Mal ist es das deutsche Volk, dem die Führung zukommt. Ab integro nascitur ordo ». C. Schmitt, « Staatliche Souveränität und freies Meer » (1941), Staat, Großraum, Nomos, op. cit., p. 422.
- 122 Ibidem, p. 420. Schmitt se fonde sur les thèses de Bernard Faÿ.
- 123 C. Schmitt, « Grand espace contre universalisme », art. cit., p. 129. L’article est un réquisitoire implacable contre les détournements de la doctrine Monroe à des fins impérialistes.
- 124 DO, t. 2, p. 414 ; pour être tout à fait précis, il faudrait relire l’ensemble de l’argumentation du t. 2, IV, 17.
- 125 Je partage en cela l’analyse complète et nuancée que propose Renato Cristi dans Le libéralisme conservateur : Trois essais sur Schmitt, Hayek et Hegel, Kimé, 1993. Au contraire, à la même époque, Jünger ne distingue guère démocratie et libéralisme, ce dernier n’étant que le « prédicat dialectique » de la démocratie. E. Jünger, Le Travailleur, op. cit., p. 133.
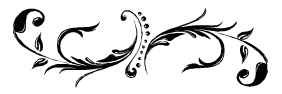
♦ Textes ♦
PENSÉES SUR LE DESTIN
1
La vie a un but. C'est l'accomplissement de ce qui a été posé lorsqu'elle fut engendrée.
2
Le premier fait auquel est confronté l'homme, comme à un destin inéluctable, et ce que nulle pensée ne peut comprendre, ni nul ne peut vouloir modifier, c'est le temps et le lieu de sa naissance : chacun est, lorsqu'il vient au monde, inséré dans un peuple, une religion, un état, un temps, une culture. Mais ce fait implique déjà la presque totalité des décisions.
3
Nous sommes hommes d'un siècle, d'une nation, d'un cercle, d'un type. Telles sont les conditions nécessaires à l'intérieur desquelles nous pouvons conférer à l'existence un sens et une profondeur, être des agissants, fût-ce même agissant par le verbe. Plus nous remplissons ces limites qui nous sont données, et plus notre action s'étend au loin. Platon était Athénien, César était Romain, Goethe était Allemand : ils l'étaient entièrement et avant tout ; telle fut la condition même de leur empreinte dans l'histoire universelle.
4
De par sa naissance, l'individu reçoit sa nature et un cercle de tâches possibles, à l'intérieur duquel le libre-arbitre existe légitimement. Ce que peut ou veut sa nature, ce que lui permet ou lui interdit sa naissance, c'est cela qui trace, pour tout homme, un cercle de bonheur ou de détresse, de grandeur ou de lâcheté, de tragique ou de grotesque, qui seul donne un contenu à sa vie et, entre autres choses, tranche la question de savoir si elle a, en rapport avec l'ensemble de la vie, et par conséquent pour quelque aspect de l'histoire, une signification, ou si elle n'en a pas.
5
Le destin, c'est déjà : où, quand, sous quelle forme on vient au monde, en quelle année, dans quel peuple, dans laquelle de ses couches ; mais aussi, avec quel corps et quelle âme : malade, traînant une lourde hérédité, infirme, avec quelles dispositions innées.
Les tragédies des individus résultent de la contradiction entre ces destins internes et les destins extérieurs. C'est la manière dont chacun en vient à bout qui marque son rang : fièrement, lâchement, de manière vile, avec grandeur, à soi-même sa propre loi, ou sans loi.
6
La jeunesse seule a un avenir et est avenir… Quiconque s'élance, emporté par le débordement de ses forces, vers un quelque chose, celui-là n'a pas besoin de se référer à quelque fin ni quelque utilité pratique. Il sent qu'il est lui-même le sens de ce qui doit advenir. Telle était la croyance en l'étoile qui n'a jamais abandonné César ni Napoléon ni non plus aucun des grands actifs d'autre nature, et, malgré toute la mélancolie des jeunes années, c'est ce qu'il y a au plus profond de toute enfance, dans toutes les générations, tous les peuples, toutes les cultures doués de jeunesse.
7
Ce que nous faisons, il faut que nous le fassions. Notre volonté libre, c'est là le destin.
8
Le libre-arbitre n'est pas un fait, mais un sentiment.
9
Tout acte est un destin qui se déguise en un vouloir.
10
Peu importe, pour l'être vivant, qu'il croie ou non au libre-arbitre. Les conséquences qu'il en tire, c'est cela qui compte — car c'est à cela qu'on reconnaît s'il est ou non une âme faible. Tout est prédestiné : donc, cette grande tâche m'est prédestinée.
11
L'individu est libre. Il fait ce qu'il veut. Mais justement : le grand individu veut ce que veut le temps — à savoir : le temps qui vient.
12
L'homme qui importe vit de telle manière que son existence soit un sacrifice à son idée.
Le sens que l'on donne à sa propre vie est un témoignage de respect envers soi-même.
13
Le créateur se sent libre. En tout acte est contenue la liberté. Tout acte, même celui qui échoue, est, de par son essence, une victoire de la volonté libre.
14
Lorsqu'une grande situation historique est donnée, le premier venu occupe la place ; qu'elle ne le soit pas, et le plus grand des hommes lui-même ne peut trouver sa place.
Les grands hommes sont donc autre chose que les personnalités historiques.
15
Parmi les personnalités qui meuvent le monde, il ne se trouve que très peu de génies, et parmi les génies, rares sont ceux qui ont mû le monde : le plus souvent, c'étaient des personnalités de rang bien inférieur que le hasard a mises à leur place.
16
L'amertume la plus profonde, dans la vie, c'est de devoir dire qu'on n'est pas à la hauteur d'une tâche, qu'on n'est pas un grand savant, un grand soldat, un grand artiste. Mais la dignité intérieure exige cet aveu.
17
C'est la souffrance seule qui révèle le rang d'un être humain : sous les coups du destin, dans la détresse, sur les ruines de ses plans et de ses espoirs.
18
Il est des hommes indignes d'une grande souffrance.
19
Le caractère d'un peuple est la résultante de ses destins. Ce n'est ni le pays, ni le climat, ni le ciel et la mer, ni non plus la race et le sang qui, en dernière analyse, le font naître. Tout cela n'est que la matière que les coups de la réalité historique forgent en forme.
Dans l'histoire, ce sont les souffrances, plus que les réussites, qui modèlent le caractère.
20
On n'échappe pas au destin en fermant les yeux, en le niant, en luttant contre lui, en le fuyant. Ce ne sont là que d'autres manières de l'accomplir. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
21
Ce que tout événement a d'unique, d'irrévocable, de définitif, telle est la forme sous laquelle le destin apparaît à l'œil de l'homme.
22
Le hasard, c'est l'épiphanie du destin qui semble absurde à la pensée humaine, qui ne rentre pas dans « des systèmes ».
23
« Tout est hasard » et « tout est nécessité », ces deux maximes ont le même sens. L'histoire entière, et tout en elle, est hasard et est nécessaire.
24
L'existence éphémère, le surgissement et l'effacement, telle est la forme de toute réalité, des étoiles, dont le destin échappe à nos calculs, jusqu'au grouillement passager qui couvre notre planète.
25
L'évolution implique l'achèvement — toute évolution a son début, tout achèvement est une fin —, la jeunesse implique la sénilité, le surgissement contient l'effacement, comme la vie fait de la mort.
26
Une fois qu'un être humain a une grande tâche à remplir, nul malheur ne peut l'atteindre, tant qu'il n'a pas accompli ce à quoi il est destiné.
27
Je ne crois pas qu'un homme vraiment important, au cours de sa vie, se signale jamais par quelque hasard grossier, par exemple en gagnant le gros lot. Cela n'a lieu que dans une existence qui, de toute manière, est fondée sur le vide. Le destin ne commet pas de telles méprises, et du reste, tout grand homme en a le sentiment. Il est « à l'épreuve des balles », aussi longtemps qu'il est, lui et son œuvre, indispensable. Nietzsche devenue millionnaire au casino de Monte-Carlo, ou Goethe paralysé par un accident de voiture — c'est impossible.
28
Rien de ce qui fut jamais un fait ne peut se révoquer. Après une mutation politique décisive, tous sont contraints de progresser dans cette direction, qu'ils l'aient ou non voulu. Ce serait lâcheté et courte vue que de dire non. Ce que l'individu ne veut pas faire, l'histoire le fera au moyen de lui.
29
L'éthique est la forme intérieure de l'être en acte. On ne la choisit pas, on n'en a même pas conscience, on l'exécute seulement. Cela vaut déjà des animaux. Là où, chez l'être vivant, est une volonté, là est aussi un éthos.
Quant à l'éthique de sa vie, on ne la choisit pas. On est, en tant qu'individu, et du seul fait de sa naissance, intégré à elle. On l'accomplit ou on ne l'accomplit pas. Dans l'un de ces cas, on est représentant de sa manière d'être intime ; dans l'autre, un hasard sans valeur.
30
Cette vie qui nous est donnée, cette réalité ambiante en laquelle nous place le destin, les remplir du plus haut contenu possible, vivre de manière à pouvoir être fiers de nous-mêmes, agir de manière telle qu'il survive quelque chose de nous, dans cette réalité qui marche vers son terme, telle est notre tâche.
31
Lorsqu'un immense malheur fond sur un homme, c'est alors que se montre ce qu'il y avait en lui de fort et de bon. Lorsque le destin écrase un peuple, c'est alors qu'il manifeste la grandeur ou la petitesse de son âme. Seul, l'extrême péril exclut toute erreur quant au rang historique d'une nation.
PENSÉES SUR L'ÂME HUMAINE
68
Il n'existe pas d'« homme en soi », comme le prétendent les bavardages des philosophes, mais rien que des hommes d'un certain temps, en un certain lieu, d'une certaine race, pourvus d'une autre nature personnelle qui s'impose ou bien succombe dans son combat contre un monde donné, tandis que l'univers, dans sa divine insouciance, subsiste immuable à l'entour. Cette lutte, c'est la vie.
69
L'image qu'on se fait aujourd'hui de l'homme primitif est une caricature. L'homme des villes, dans son arrogance, considère l'intelligence comme le suprême trésor — et non l'astuce paysanne, mais l'intelligence des hommes de lettres — et se figure l'homme primitif sous l'aspect d'un crétin, velu (parce que de nos jours, on est rasé), balourd, grossier, à la démarche pesante. Lui étant objet de dégoût, le singe lui apparaît comme un modèle approprié pour cette image de l'homme, si bien que le premier imbécile venu sent combien il s'est développé depuis lors.
70
L'homme n'est pas un simple d'esprit, « naturellement bon » et bête, ni un demi-primate pourvu de tendances à la technique, tel que l'a décrit Haeckel et que Gabriel Max l'a peint… Au contraire, la tactique de son existence est celle d'une superbe, courageuse et astucieuse bête de proie. Il vit en attaquant, en tuant et en détruisant. Il veut être maître depuis qu'il existe.
71
Le fauve est la forme la plus haute de l'existence qui se meut librement. Cela représente un maximum de liberté à l'égard des autres et pour soi-même, de responsabilité envers soi-même, de solitude, un degré extrême de contrainte à s'affirmer par le combat, la victoire, la destruction. Ce qui confère au type humain son haut rang, c'est qu'il est un fauve.
72
Je ne « rabaisse pas l'homme au niveau de la bête » ; j'abolis le mépris du regard que l'homme jette sur la bête. Plantes et bêtes sont aussi nobles que l'homme. C'est à partir de son éthos propre — celui d'un fauve orgueilleux — que l'homme estime ou méprise d'autres êtres et les qualifie de supérieurs ou d'inférieurs, de vils, de nobles, d'orgueilleux, d'ennemis, de parasites, de vermine. Toute une symbolique s'est épanouie à partir de l'âme humaine. Toute espèce animale reflète un trait secret de cette âme.
73
Le rang de la vie est fonction de sa force, de la « volonté » ou de quelque nom qu'on l'appelle. L'expression de la volonté, c'est l'acte.
74
La volonté est l'instinct de vie, pénétré de spiritualité.
75
Pour l'essentiel, la volonté est identique à la force vitale. Les hommes sans race sont sans volonté.
76
Plus on a de « race », et plus on a de soi-même un sentiment résolu. On peut sacrifier son moi à une cause, mais volontairement. C'est la contrainte qui tue l'être noble et qui plaît à l'être vil, parce qu'il cherche à échapper au moi.
77
Qu'est-ce que le contraire de l'âme d'un lion ? L'âme d'une vache. Les herbivores substituent à la force de l'âme individuelle le grand nombre, le troupeau, le sentiment et l'acte communs aux masses.
78
C'est la peur qui agglomère les « mois » en « nous », qui produit la suppression de l'individualité. L'homme supérieur, de race robuste, veut, quant à lui, être « moi » et non pas « nous ».
79
Moins on a besoin d'autrui, plus on a de puissance.
80
La vie des animaux qui se meuvent librement est lutte, et rien d'autre, et la tactique de la vie, sa supériorité ou son infériorité à l'égard d'« autrui », que ce soit la nature vivante ou inanimée, est ce qui décide de l'histoire de cette vie, du point de savoir si son destin est de souffrir l'histoire imposée par d'autres, ou d'être soi-même histoire pour d'autres.
81
L'homme fait l'histoire, la femme est histoire.
Féminine, cette première histoire, éternelle, maternelle, végétale… cette histoire sans culture de la suite des générations, qui jamais ne se modifie, qui s'étend à travers l'existence de toutes les espèces animales et humaines, à travers toutes les cultures isolées et éphémères, d'un cours paisible et régulier. Si l'on s'y reporte en esprit, elle signifie la même chose que la vie elle-même.
82
Quoi qu'il puisse être d'autre — l'héritier de générations — l'homme n'en est pas moins un produit et une expression de sa contrée, s'adaptant à elle, s'affirmant contre elle ; car il se nourrit de la terre à laquelle il fait retour… Le destin de la terre — mourir sous la neige et la glace, se réveiller au printemps, fouettée par la pluie et la tempête, inondée, dévastée — se reflète aussi dans l'être propre de l'homme, qui en souffre et s'y oppose. C'est la dureté de ce destin d'être né ici qui a modelé la force de l'âme.
83
Fouir et labourer, c'est vouloir, non piller la nature, mais la modifier. Planter, ce n'est pas dérober quelque chose, mais l'engendrer. Mais on devient soi-même plante, ce faisant, autrement dit : paysan. On s'enracine dans le sol qu'on cultive.
84
L'histoire universelle a été faite par dès ethnies mobiles ; non par une paysannerie sédentaire, mais contre elle. La liberté de la plaine, la liberté de la mer ont produit les créateurs des peuples et des États et les grands hommes d'action. La paysannerie subit l'histoire, qui passe au-dessus d'elle ; ce sont le cavalier et le navigateur qui la font.
85
Tout ce que font les animaux demeure dans le cadre de l'action de leur espèce, sans en enrichir la vie. Mais l'homme, l'animal créateur, a étalé à travers le monde une richesse de pensée et d'acte ingénieux qui lui donnent le droit d'appeler sa brève histoire l'« histoire universelle » et de considérer ce qui l'entoure comme l'« humanité », avec tout le reste de la nature pour arrière-plan, pour objet et pour moyen.
86
Il n'y a rien qui caractérise mieux la différence entre l'activité animale et l'acte humain que l'allumage du feu. On voit — cause et effet — comment naît la flamme. Bien des animaux, eux aussi, le voient. Mais l'homme est seul à concevoir un procédé capable de la produire. Nul autre acte ne donne une telle impression de vertu créatrice. C'est l'acte même de Prométhée.
87
Qu'est-ce que l'âme ? Question déjà trop abstraite. Qu'est-ce que l'âme d'un fauve ? C'est ainsi qu'il faut poser la question. Car la plupart des esprits voient l'« âme » en l'examinant à part du caractère de l'être vivant, de ses instincts et de ses pulsions quotidiens, « en soi ».
88
Séparer le corps et l'âme, c'est montrer qu'on n'a ni l'un, ni l'autre.
89
Une âme, tout le monde l'a. Mais la personnalité — l'âme véritablement importante — est rare.
90
La compréhension se manifeste dans le fait que les choses quotidiennes et toutes simples prennent tout d'un coup une allure mystérieuse et vous oppressent. Ainsi la mort, quand on comprend qu'un jour viendra où elle se saisira de vous-même. Donc, comprendre la nécessité de sa propre mort ; c'est là plus que l'angoisse des bêtes à l'agonie, qui voient bien le danger, mais non la conséquence qu'il entraîne pour la vie.
91
Qu'on ait une âme, on ne le remarque qu'au moment où elle vous fait souffrir. Chacun devrait s'en souvenir, en repensant à son enfance.
C'est seulement cette expérience, et avec elle le fait d'observation qu'à la mort d'autrui, « la vie s'en va », qui a créé la croyance à l'âme.
92
C'est de la rencontre avec le Toi que naît l'éveil de la conscience d'un Moi. Le mot « Moi » est donc la notation du fait qu'il existe un pont jeté vers un autre être.
93
Le langage ne lie pas seulement deux êtres éveillés — l'éveil de deux êtres humains — mais maintient aussi la distance entre eux.
94
En compagnie d'un feu, l'homme ne se sent jamais seul. La flamme peut être une compagnie.
95
« Conscience » et remords sont des formes de l'angoisse. L'homme courageux a « bonne conscience ». Ce qu'il fait est bon.
96
L'animal, lui aussi, pose des questions. On n'interroge pas qu'en paroles, mais aussi en actes. Un animal examine l'objet, le roule, appuie dessus, le déchiquète — telle est la nature de l'interrogation que l'homme, être tardif, se borne à traduire en mots. Mais il est des questions pratiques et des questions théoriques. C'est seulement de l'interrogation théorique que relève le mot.
97
Vivre, c'est agir et souffrir. Plus un homme sait de choses, et plus profonde est la peine de son âme.
98
La souffrance est la grande éducatrice, la bienfaitrice de l'humanité. C'est par elle qu'elle a mûri. C'est d'elle qu'elle a appris l'orgueil, la gloire, la bravoure, le respect. Venir à bout du malheur, ou fuir devant lui — c'est ce choix qui sépare les natures nobles des natures viles. Car ce qui suit immédiatement la souffrance — la souffrance esquivée —, c'est le vide.
99
Le bonheur, c'est l'inespéré, le rare, l'invraisemblable, l'éphémère, ce dont on jouit à l'aveuglette. Il y a eu, parmi les hommes, d'autant plus de bonheur qu'ils ont moins médité sur son essence et le droit au bonheur.
100
Pour l'homme, ce qui suit l'espérance réalisée, c'est l'ennui. Pour l'animal, qui n'espère point, mais désire, il n'en est pas ainsi. Car l'espoir implique la représentation d'un but.
101
Oisif, l'animal s'endort ; oisif, l'homme médite.
102
On peut définir l'intelligence pratique comme celle de l'attaque — puisqu'on s'attaque aussi aux situations difficiles : éclaireur, marin, tireur.
103
La tension intellectuelle ne connaît qu'une forme de repos, celle qui caractérise les métropoles : la détente, la « distraction ». Le jeu véritable, la joie de vivre, le plaisir, l'ivresse ne sont plus du tout saisis selon leur essence. Mais la relève d'un travail intellectuel pratique d'extrême intensité par son contraire, la niaiserie consciemment recherchée, la relève de la tension de l'esprit par celle, physique, du sport, de la tension physique par celle, sensuelle, du « plaisir » et celle, intellectuelle, de l'« excitant » que sont le jeu et le pari, la substitution, à la logique pure du travail quotidien, d'une mystique consciemment savourée — tout cela se répète, dans toutes les métropoles de toutes les civilisations.
104
L'humour pardonne. La satire méprise. L'esprit n'est que jeu intellectuel.
105
Il n'y a de cruauté qu'entre êtres de culture : c'est la souffrance consciemment infligée.
106
L'homme de culture seul est cruel. Il faut, pour cela, l'âme imprégnée d'esprit, consciente de la souffrance d'autrui, et qui l'accroît pour son propre plaisir, ou la partage. Cruauté et pitié sont liées entre elles. Un animal n'est pas cruel, ne comprenant pas, ne vivant pas la souffrance d'autrui.
107
Les animaux et les hommes de nature ne sont ni pervers, ni ne débrident leurs instincts. Leur éros est en harmonie rythmique avec le cosmos… C'est seulement la culture, l'artificiel, qui a fait de l'érotisme un problème, un déchaînement de la concupiscence.
108
La haine suppose que l'on estime l'adversaire. Elle comporte un certain aveu d'égalité de rang spirituel. Quant aux êtres inférieurs à vous, on les méprise. Les êtres qui ont eux-mêmes l'âme basse sont envieux.
109
Le respect de l'adversaire est orgueilleux. L'envie veut le ravaler au niveau de votre propre petitesse.
110
Le contraire de noble, ce n'est pas pauvre, mais vil.
111
La conscience de la communauté et la conscience du troupeau sont choses bien différentes — l'une sacrifie le moi, tandis que l'autre recherche, faute de moi, la chaleur du contact.
112
La proximité, si elle n'est nécessaire, engendre la haine.
113
Toutes les grandes inventions, toutes les grandes entreprises proviennent du plaisir de vaincre que recherchent les âmes fortes. Elles sont expression de la personnalité, non du goût de l'utile.
114
Les passions asservissent.
115
La lâcheté aveugle.
116
L'héroïsme n'affronte pas seulement des ennemis concrets, mais aussi des états de l'âme.
117
L'amour et la passion exigent le visage, en tant que centre de la personnalité. On n'aime que quelqu'un dont le visage est ineffaçable.
118
L'adolescent sait tout. L'homme fait doute de tout. Seul, le vieillard parvient à cette certitude qu'il ne sait rien.
119
Tout acte modifie l'âme de celui qui agit.
120
Pour s'enthousiasmer, il suffit d'être humain ; pour se résigner, il faut être viril.
► Oswald Spengler, Nouvelle École n°33, 1979. (tr. fr. : Henri Plard)
[Textes repris dans : Écrits historiques et philosophiques, Copernic, 1980]
Note : Les aphorismes ci-dessus sont extraits des ouvrages suivants : Le Déclin de l'Occident (aphorismes 1, 6, 50, 80, 83, 92, 103, 119), Années décisives (28, 110, 115), L'homme et la technique (24, 25, 68, 70, 71, 77, 79, 81, 85, 86, 108, 113), Preussentum und Sozialismus (3, 20, 30), Pessimismus ? (2, 4, 21), Politische Pflichten der deutschen Jugend (114), Neubau des deutschen Reiches (31), Vom deutschen Volkscharakter (19), avant-propos aux Politische Schriften (20), Zum weltgeschichtliche des 2. vorchristlichen Jahrtausends (84), écrits posthumes (5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 120).

Pessimisme ?
La méprise quasi générale qu’a, jusqu’à présent, suscitée mon livre [Le Déclin de l’Occident] est, en partie, le corollaire inévitable de toute méthode de pensée qui s’en prend, non seulement par ses résultats, mais déjà par sa méthode, et avant même celle-ci, par le regard tout nouveau porté sur les choses qui fait naître cette méthode, à la structure intellectuelle d’un présent quelconque. Les malentendus vont s’accumuler lorsqu’un tel livre devient l’objet d’une mode et qu’en conséquence, des gens dont la pensée ne peut suffisamment être préparée à le recevoir qu’après des années et par l’intermédiaire d’une littérature vulgarisatrice se voient soudainement confrontés à une doctrine de laquelle, provisoirement, le seul côté négatif leur est accessible. On a en général négligé le fait qu’avec le premier volume de cet ouvrage, n’était présenté qu’un fragment de la doctrine, fragment à partir duquel, comme je ne tardai pas à le constater, il est impossible de tirer des conclusions sûres quant à son ensemble. La publication imminente du second volume parachèvera l’exposé de la morphologie de l’histoire universelle, et, par conséquent, l’étude d’au moins un cercle de questions. Un autre cercle, celui de l’éthique, a été à tout le moins frôlé, comme l’ont certainement remarqué les lecteurs attentifs, dans Esprit prussien et Socialisme. Enfin, un autre obstacle à la compréhension a été le titre déroutant de l’ouvrage, bien que j’eusse expressément souligné qu’il avait été choisi voici bien des années, et qu’il s’agit là d’un terme strictement objectif pour un fait historique dont les analogues se trouvent parmi les phénomènes les plus connus de l’histoire. Mais il y a des gens pour confondre le déclin de l’Antiquité avec le naufrage d’un transatlantique. La notion de catastrophe n’est pas impliquée par ce terme. Si l’on dit, au lieu de déclin, “achèvement”, notion liée, dans la pensée de Goethe, à un sens bien précis, on aura provisoirement exclu son aspect “pessimiste”, sans avoir le moins du monde modifié le sens exact de ce concept.
Or, l’ouvrage s’adressait, dès sa première partie, et totalement, aux hommes d’action et non de critique. Une image du monde où l’on pût vivre, et non un système de l’univers au sein duquel l’on pût ratiociner, telle était la fin véritable de mon œuvre. Je n’en ai pas pris conscience en ce temps-là ; mais ce fait n’en exclut pas moins de la compréhension totale un vaste cercle de lecteurs.
L’homme d’action vit dans et avec les choses. Il n’a pas besoin de preuves : souvent, il ne les comprend même pas. Le tact physionomiste — l’un des termes que personne, ou peut s’en faut, n’a saisis selon leur acception véritable — le mène à des profondeurs que n’atteindrait jamais une quelconque méthode démonstrative. Ce que j’affirme ici, ce qui est apparu à des esprits scientifiques comme un complet paradoxe, voici longtemps que les hommes appelés à agir le sentaient sans l’exprimer ; et bien souvent, ils n’en avaient même pas conscience. Ils rejettent lorsqu’ils lisent, et par conséquent sous une forme théorique, ce “relativisme historique” qui, pour eux, va de soi lorsqu’ils agissent, et lorsqu’ils observent leurs semblables, pour tirer de ces vues un profit immédiat dans l’action. Mais l’esprit contemplatif est, intérieurement, bien éloigné de la vie. Il porte son regard sur elle, et le fait avec une certaine aversion envers ce domaine qui lui est étranger et lui répugne, qui le dérange, dès qu’il prétend être plus qu’un objet de pur examen. Les contemplatifs collectionnent, analysent et classent, non en vue d’un but pratique, mais parce qu’ils trouvent plaisir à cette occupation ; ils exigent des preuves et s’entendent à les juger. Pour eux, un tel livre restera toujours un égarement. Car, je l’avoue, j’ai toujours méprisé du fond du cœur la “philosophie pratiquée pour l’amour d’elle-même”. Pour moi, il n’y a rien de plus ennuyeux que la logique pure, la psychologie scientifique, la morale et l’esthétique générales. La vie ne possède rien de général ni rien de scientifique. Toute ligne qui n’est pas écrite au service de la vie active me semble superflue. Si l’on veut ne pas prendre trop littéralement cette comparaison : ma manière d’envisager le monde s’oppose à l’esprit de système comme les mémoires d’un homme politique à l’État idéal d’un utopiste. L’un écrit ce qu’il a vécu, l’autre, ce que son esprit a concocté.
Or, il existe, et justement chez nous, en Allemagne, une manière en quelque sorte politique de participer à la vie du monde entier, une expérience du monde ni voulue, ni systématique, qui n’admet d’autre résultat qu’une sorte de mémoires métaphysiques. Il faut savoir à quelle lignée mon livre se rattache : si de grands noms sont cités, ce n’est pas là un jugement sur le niveau de mes vues, mais, exclusivement, sur leur nature.
Un puissant courant de pensée allemande va, depuis Leibniz, en passant par Goethe et Hegel, à la rencontre de l’avenir. Comme tout ce qui est allemand, il a subi ce destin de devoir couler pour ainsi dire souterrainement et sans qu’on prît garde à lui à travers les siècles, tandis que des modes étrangers de pensée dominaient la surface de la réflexion, chez ces esprits eux-mêmes. Leibniz a été le grand éducateur de Goethe, bien que Goethe n’ait jamais pris conscience de ce lien et qu’il ait toujours invoqué le nom de Spinoza, si totalement étranger à lui, toutes les fois que l’influence de Herder ou quelque affinité élective directe faisaient entrer une pensée authentiquement leibnizienne dans le cercle de ses réflexions propres. Le trait caractéristique de ce penseur est sa liaison constante aux grands événements de son époque. Si l’on biffe de son œuvre ce qu’il a écrit en rapport avec ses projets politiques, les efforts œcuméniques et ses recherches sur l’exploitation des mines, l’organisation de la science et les mathématiques, il n’en reste plus grand-chose. Goethe est semblable à lui en ce qu’il pensait toujours à partir des choses et en vue des choses, donc historiquement, et n’eût jamais été capable d’édifier un système abstrait. Hegel, ce colosse, a été le dernier dont la pensée, partant de réalités politiques, n’ait pas encore été entièrement étouffée par les abstractions. Puis survient Nietzsche, un dilettante, au meilleur sens du terme, totalement étranger à une philosophie académique tombée dans une stérilité définitive : il a eu beau succomber au darwinisme – il nous en a pas moins donné, bien au-delà de l’ère anglaise et darwinienne, le regard grâce auquel nous pouvons aujourd’hui assurer la victoire de cette tendance vivante et pratique de la pensée.
C’est ainsi que je vois aujourd’hui les postulats occultes sur lesquels ma pensée, sans le savoir, prenait appui. Nulle part ne s’y trouve un édifice fait de généralités. La réalité unique en son genre, avec toute sa psychologie, qui ne joue aucun rôle chez Kant ni Schopenhauer, domine aussi complètement les recueils historiques de Leibniz que les recherches d’histoire naturelle chez Goethe et les cours de Hegel sur l’histoire universelle. C’est pourquoi, ici, les faits ont un tout autre rapport à la pensée que chez tous les systématiciens. Pour ceux-ci, ils constituent une matière morte dont l’on extrait des lois. Chez moi, ce sont des exemples qui illustrent une pensée vécue, et, en fait, communicable sous cette seule forme. Mais, n’étant pas scientifique, cette démarche requiert une capacité de compréhension peu commune. En règle générale, comme je l’ai noté, le lecteur perd, en présence d’une pensée, la vue globale des autres et, par conséquent, interprète tout à contre-sens, car ici, tout est si intiment lié que l’isolement d’un détail équivaut déjà à l’erreur. Mais il faut aussi savoir lire entre les lignes. Bien des traits ne sont qu’esquissés, bien des choses ne peuvent même pas être exprimées sous une forme scientifique.
Le centre en est l’idée de destin. S’il est si difficile de la susciter chez le lecteur, c’est que la voie de la réflexion rationnelle ne mène qu’à son contraire, le concept de causalité. Car le destin et le hasard appartiennent absolument à un tout autre monde que la connaissance de la cause et de l’effet, de la raison et de la conséquence. Le danger est de prendre le destin pour le nom d’une autre chose : une succession causale qui existe sans être, pour l’instant, perçue. La pensée scientifique ne pourra jamais, arrivée à ce point, me suivre. La vision des faits de sentiment et d’expérience vécue s’efface sitôt que l’on pense analytiquement. Le destin est un mot dont on sent le contenu. Temps, aspiration, vie, sont des termes étroitement apparentés. Que personne ne s’imagine avoir saisi le noyau de ma méthode de pensée si le sens ultime de ces termes, tels que je les conçois, lui reste fermé. Une voie mène du destin à l’expérience intérieure, très difficile à saisir, que je qualifie d’expérience des profondeurs. Celle-ci est plus proche de la pensée rationnelle, mais seulement par les résultats obtenus, et non dans son origine. C’est ici que se heurtent deux des plus difficiles parmi les problèmes. Que signifie le terme de temps ? Question à laquelle il n’est pas de réponse scientifique. Que signifie le terme d’espace ? Tâche possible pour la réflexion théorique. Mais au temps est lié, à son tour, le destin, à l’espace la causalité. Donc, quel est le rapport qui existe entre le destin et la cause ? La réponse à cette question fonde l’expérience des profondeurs, mais élude toute espèce d’expérience de communication scientifiques. L’expérience des profondeurs est un fait, aussi indubitable qu’inexplicable. Vient enfin une troisième notion, très difficile, celle du tact physionomique. Ce qu’elle désigne, tout homme, en réalité, en est pourvu. Il vit avec lui, il s’en sert constamment dans la pratique. Même le savant abstrait du vieux modèle, dont le désarroi et la balourdise, dès qu’il intervient dans la vie publique, sont connus de tous et fondés sur l’atrophie de ce tact inné, et qui ne s’enseigne point — même ce savant en possède assez pour arriver tant bien que mal à vivre. Mais ce que je vise ici, c’est une forme très haute de ce tact, une méthode inconsciente par laquelle on perçoit instinctivement, non l’existence quotidienne, mais le cours du monde, et dont peu d’êtres humains possèdent la maîtrise véritable. C’est en vertu d’elle que l’homme d’État-né et l’historien authentique se rencontrent, en dépit de toutes les oppositions entre la pratique et la théorie. Nul doute que cette méthode soit, dans l’histoire comme dans la vie réelle, et de loin, la plus importante des deux. Quant à l’autre méthode, la systématique, elle ne sert qu’à découvrir des vérités, mais les faits ont plus d’importance que les vérités. Toute la marche de l’histoire politique, économique et, d’une manière générale, humaine, tout le cours de chacune des vies individuelles, sont fondés sur son application constante par les êtres humains qui mènent cette vie, des hommes sans importance qui subissent l’histoire aux hommes importants qui font l’histoire. Au prix de cette hégémonie effective de la méthode physionomique, tant pour les hommes d’action que pour les contemplateurs eux-mêmes, durant la plus grande partie de leur vie consciente, la méthode systématique, seule reconnue pour valable en philosophie, tombe presque au rang de facteur insignifiant de l’histoire universelle. Ma doctrine s’écarte des autres en ce qu’elle se fonde très consciemment sur cette méthode de la vie réelle. Ce qui lui confère, sans doute, une ordonnance interne, mais étrangère à tout système.
L’idée la moins comprise fut celle que caractérise, peut-être un peu maladroitement, le mot de relativisme. Elle n’a absolument rien à voir avec le relativisme de la physique, fondé simplement sur l’antithèse mathématique entre la constante et la fonction. Il passera encore bien des années avant qu’on ne l’ait assez assimilée pour vivre avec elle car il s’agit ici d’un regard absolument éthique porté sur le monde où se déroule la vie de chacun. Nul ne comprendra ce terme si l’idée de destin lui a échappé. Le relativisme en histoire, tel que je le vois, est un oui à l’idée du destin. L’unique, l’irrévocable, l’irréversible, telle est la forme sous laquelle le destin se présente aux yeux des hommes.
Ce relativisme, lui aussi, on l’a connu en tout temps, dans l’action comme dans la contemplation. Il va si bien de soi dans la vie réelle, il domine si complètement et si absolument le spectacle du quotidien qu’on n’en prend même pas conscience, ce qui fait qu’aux instants de réflexion théorique, donc généralisatrice, on le conteste, et, le plus souvent, avec conviction. En outre, cette idée, en tant que telle, n’est pas neuve. Il n’existe pas d’idée vraiment nouvelle à une époque aussi tardive que la nôtre. Dans tout le XIXe siècle, il n’y a pas une seule question que la scolastique n’ait déjà découverte, mise en problème, méditée et formulée brillamment. À ce point près que le relativisme est une donnée de la vie tellement immédiate, et, à cet égard, si étranger à la philosophie, qu’on ne l’a jamais admis, du moins dans les “systèmes”. La vieille règle paysanne : “à chacun son métier et les vaches seront bien gardées” est à peu près le contraire de toute philosophie académique, car celle-ci veut justement prouver que le même métier convient à tout le monde et qu’il consiste à pratiquer ce que l’auteur vient de démontrer dans son traité d’éthique. C’est en pleine conscience que j’ai “rejoint l’autre camp”, celui de la vie, et non de la pensée. Les deux points de vue naïfs consistent à affirmer, ou bien qu’il existe un quelque chose qui puisse servir de norme de toute éternité, donc sans dépendre du temps et du destin, ou bien qu’il n’existe rien de pareil.
Or, ce qu’on appelle ici relativisme n’est ni l’un ni l’autre. J’ai créé, sur ce point, quelque chose de nouveau : je montre, en m’appuyant sur le fait d’expérience que “l’histoire universelle” n’est pas une unité d’événements, mais bien un groupe de huit cultures supérieures, du moins jusqu’à présent, dont les biographies, totalement indépendantes l’une de l’autre, ne s’en présentent pas moins à nous articulées selon un rythme totalement identique — je montre donc que tout homme qui examine les faits, que ce soit en vue de la vie ou pour l’amour de la pensée, ne pense qu’en homme de son temps. C’est ainsi qu’est réfutée l’une des objections les plus niaises qu’on ait dressées contre ma conception : à savoir, que le relativisme se réfute lui-même. Car il résulte de cette conception que pour chaque culture, pour chacune de ses époques et pour chaque espèce d’hommes au sein d’une époque, il existe une seule vue d’ensemble, posée et imposée avec lui, et qui a, pour ce temps, quelque chose d’absolu. Elle ne l’est pas seulement par rapport à d’autres temps. Il y a, pour nous autres, hommes du présent, une vue des choses obligatoire, mais, bien entendu, autre que celle de l’ère goethéenne. Le vrai et le faux sont des notions qu’il est interdit d’employer ici. Seuls ont encore valeur les concepts de profond et de plat. En tout cas, penser autrement, c’est s’interdire de penser historiquement. Toute vue des choses vivantes, y compris celle que je propose, appartient à un temps bien défini. Elle s’est développée à partir d’une autre et doit évoluer en direction d’une autre. Dans tout le cours de l’histoire, il n’y a pas plus de doctrines éternellement vraies ou éternellement fausses qu’il n’y a, dans le développement d’une plante, de stades justes ni de stades faux. Toutes sont nécessaires, et tout ce qu’on peut dire de chacune d’elles, c’est que par rapport aux exigences du lieu et du moment, elle était réussie ou manquée. Mais on peut en dire tout autant de chacune des conceptions du monde qui se manifestent à un moment quelconque. Même l’adepte le plus strict des systèmes sent qu’il en est ainsi. Il qualifie les doctrines des autres d’actuelles, de dépassées, dit qu’elles sont en avance sur leur temps et reconnaît ainsi de lui-même que les notions de juste et de faux n’ont en quelque sorte de sens qu’à l’avant-plan de l’histoire, mais n’ont aucune importance quant à sa valeur vivante.
C’est ainsi que s’éclaire la différence entre les faits et les vérités. Un fait est quelque chose d’unique, qui a vraiment eu lieu ou aura vraiment lieu. Une vérité est quelque chose qui n’a jamais besoin d’être réalisé pour exister en tant que possibilité. Le destin se rapporte à des faits ; la connexion de la cause et de l’effet est une vérité. C’est ce qu’on a su de tout temps. Mais ce qu’on a négligé, c’est que, pour cette raison même, la vie n’est liée qu’aux faits, ne consiste que de faits et ne vise qu’à des faits. Les vérités sont des grandeurs de pensée, et ont leur valeur dans “l’empire des pensées”. Ce qui se trouve dans une thèse de doctorat en philosophie, ce sont des pensées. Que la thèse du candidat soit refusée, c’est là un fait. Là où commence la réalité, l’empire des pensées trouve sa fin. Il n’est personne, fût-ce le plus ingénu des systématiciens, qui puisse dans sa vie, fût-ce un seul instant, négliger ce fait. Au reste, il s’en garde bien, mais l’oublie dès qu’au lieu de vivre, il se contente de méditer sur la vie.
Si je puis prétendre à quelque mérite, c’est à celui-ci : on ne considérera plus l’avenir comme une page vierge où trouvera sa place tout ce qui plaira à l’individu. La décision : “voilà ce qui doit être”, sans limites ni contraintes, doit faire place à une vue des choses froide et claire, qui embrasse les faits possibles, et par là même nécessaires, de l’avenir et opère ensuite son choix. Le premier fait que rencontre l’homme, comme un destin inéluctable, c’est le temps et le lieu de sa naissance : chacun est intégré par sa naissance à un peuple, une religion, un état, un temps, une culture. Mais ce seul fait décide déjà de tout le reste. Le destin a fait naître un homme quelconque, non comme esclave à l’époque de Périclès ou comme chevalier au temps des Croisades, mais dans une maison ouvrière ou dans une villa du temps présent. S’il y a quelque chose qui soit destinée, coup du sort, fatalité, c’est bien ce fait. L’histoire implique que la vie ne cesse jamais de se modifier. Mais pour l’individu, elle est telle qu’elle est, et non autre. Sa naissance lui impose sa nature et un cercle de tâches possibles, au sein desquels subsiste légitimement sa liberté de choix. Ce que peut ou veut sa nature, et ce que sa naissance lui permet ou lui interdit, tout cela trace, pour tout individu, un cercle de bonheur ou de détresse, de grandeur ou de lâcheté, de tragique ou de grotesque, qui seul donne un contenu à sa vie et décide, entre autres, si elle aura de l’importance, en rapport avec la vie de l’ensemble, et par conséquent pour telle ou telle sorte d’histoire, ou si elle n’en aura pas. Au prix de ce fait, le premier de tous, toutes les ratiocinations sur “la” tâche de “l’”humanité et “l’”essence de “la” moralité ne sont que vain verbiage.
Et c’est de là que résulte la nouveauté absolue de mon style de pensée, ce qui devait être enfin exprimé et conquis au profit de la vie, après avoir été l’objet de la quête de tout le XIXe siècle : le rapport conscient de l’homme faustien à l’histoire. Une fois de plus, on n’a pas compris pourquoi j’ai supprimé le schéma Antiquité - Moyen Âge - Temps Modernes, qui depuis longtemps embarrassait les plus médiocres des savants eux-mêmes, et l’ai remplacé expressément par une image nouvelle : l’homme à l’esprit en éveil vit toujours “dans une image” ; celle-ci détermine ses décisions et modèle son esprit ; mais il ne se débarrasse pas réellement de l’image ancienne avant d’en avoir conquis pour lui-même une nouvelle et de se l’être totalement appropriée.
Le “regard historique” — c’est un quelque chose qui n’est accessible qu’à l’homme d’Europe occidentale, et ne lui est accessible qu’à partir de maintenant ; Nietzsche parlait encore de la maladie de l’histoire. Il entendait par là ce qu’il voyait, en son temps, partout autour de lui, le romantisme quiétiste des hommes de lettres, les rêvasseries qui emportaient les philologues vers quelque lointain passé, la pusillanimité des patriotes, qui devaient toujours aller voir ce qu’avaient fait leurs ancêtres avant de prendre une quelconque décision, la manie de comparer, par manque d’autonomie. Nous autres Allemands en avons plus souffert depuis 1870 que tout autre peuple. N’avons-nous pas été chercher partout des inspirations, chez les anciens Germains, chez les Croisés, chez les Hellènes de Hölderlin, quand nous voulions savoir ce qu’il y avait à faire dans l’ère de l’électricité ? L’Anglais avait plus de chance : il possédait la masse entière de ses institutions, transmises depuis l’époque des Normands : son droit, ses libertés, ses coutumes, et il pouvait toujours maintenir une tradition toute-puissante à la hauteur de son époque sans la détruire. Il ignorait, et ignore encore, les regards nostalgiques qu’on jette sur un millénaire d’idéaux naufragés. La maladie de l’histoire est encore au cœur de l’idéalisme et de l’humanisme allemands de nos jours ; elle inspire nos projets radoteurs de progrès universel et produit jour après jour de nouveaux plans grâce auxquels tous les secteurs de l’existence doivent radicalement et définitivement recevoir leur forme juste : leur seule valeur pratique est qu’on gaspille des énergies essentielles dans des querelles verbales, qu’on ne perçoit pas les occasions réelles d’agir, et que finalement Londres et Paris se heurtent chez nous à une moindre résistance.
Le regard historique est tout le contraire de cette maladie. Il veut dire qu’on est celui qui connaît, le connaisseur supérieur, assuré et froid. Mille années de pensée et de recherche historiques ont étalé à nos yeux un trésor incommensurable, non de savoir — cela n’aurait guère d’importance — mais d’expériences. Ce sont là des expériences vitales, en un sens tout nouveau, à condition qu’on les conçoive comme telles dans une perspective pareille à celle que je viens d’esquisser. Jusqu’à présent, nous avons vu — et les Allemands plus encore que les autres nations — dans le passé des modèles qu’il s’agirait de reproduire dans la vie. Mais il n’y a pas de modèles. Il n’y a que des exemples et des exemples de la manière dont la vie de l’individu, de peuples entiers, de cultures entières se développe, atteint son achèvement, va sur son déclin, des relations du caractère et de la situation concrète, du rythme et de la durée. Nous ne voyons pas comment nous aussi, nous devons agir, mais bien comment s’est passé un quelque chose qui nous enseigne comment, à partir de nos conditions propres, naîtront nos propres résultats. Jusqu’à présent, bien des connaisseurs de l’âme humaine le savaient, mais ne le savaient qu’en rapport avec les disciples, les subordonnés, les collaborateurs, et bien des hommes d’État à l’esprit subtil, mais seulement par rapport à leur temps, ses personnalités et ses nations. Le grand art consistait à manipuler les forces de la vie, en démasquant leurs possibilités et en prévoyant leurs mutations. C’est ainsi qu’on dominait autrui. C’est ainsi qu’on devenait soi-même destin. Aujourd’hui, nous pouvons prévoir celui de la totalité de notre propre culture, à des siècles de distance, comme s’il s’agissait d’un être dont nous perçons à jour les profondeurs ultimes. Nous savons bien que tout fait est un hasard, imprévu et imprévisible, mais, avec devant nous l’image des autres cultures, nous savons de science tout aussi certaine que le cours et l’esprit de l’avenir ne sont pas un hasard, pas plus chez l’individu que dans la vie d’une culture, que, certes, la libre décision de l’homme agissant peut les mener, par une voie royale, jusqu’à l’achèvement, ou les mettre en péril, les faire avorter, les détruire, mais sans en pouvoir détourner le sens ni la direction. Ce qui permet de concevoir pour la première fois une éducation, au sens le plus vaste du terme, un discernement des possibilités internes et une fixation des tâches, un entraînement de l’individu et de générations entières en vue de ces tâches, circonscrites au moyen de la vue prospective de faits futurs et non en vertu de quelconques abstractions “idéales”. Pour la première fois, nous percevons, comme un fait, que toute la littérature des “vérités” idéales, toutes ces inspirations, ces projets, ces solutions nobles, bien intentionnés, imbéciles, tous ces livres, tous ces tracts et tous ces discours sont une manifestation inutile, telle que l’ont connue toutes les autres cultures aux époques correspondantes à la nôtre, pour l’oublier bientôt, et dont tout l’effet a consisté à permettre à de petits érudits, dans un coin quelconque, de composer ensuite un livre sur le sujet. Et c’est pourquoi, répétons-le : pour qui se contente de la contemplation, il peut bien y avoir des vérités ; pour la vie, il n’y a pas de vérités, rien que des faits.
Et c’est ainsi que je reviens à la question du pessimisme. Lorsque j’ai soudain découvert ma “philosophie”, en 1911, sous le coup de l’affaire d’Agadir, le plat optimisme de l’ère darwinienne pesait sur le monde européen et américain. C’est pour cela, dans un mouvement de refus convaincu, que j’ai, en donnant à mon livre son titre, mis sans le savoir le doigt sur l’aspect de l’évolution que personne, en ce temps-là, ne voulait percevoir. Si j’avais le choix, aujourd’hui, j’essaierais de lancer contre un pessimisme tout aussi plat une autre formule. Je suis le dernier à m’imaginer qu’on puisse concentrer en un slogan le bilan de l’histoire.
Mais il est vrai qu’en ce qui concerne le “but de l’humanité”, je suis profondément et catégoriquement pessimiste. L’humanité, pour moi, c’est une grandeur zoologique. Je ne vois ni progrès, ni but, ni voie de l’humanité, si ce n’est dans les cervelles des Homais progressistes de l’Occident. Je ne vois même pas un esprit, et bien moins encore une unité d’efforts, de sentiment ni de compréhension dans cette pure et simple masse de populations. Quant à l’orientation intelligente de la vie vers un but, une unité d’âme, de volonté et d’expérience, je ne la vois que dans l’histoire des diverses cultures, chacune à sa place. C’est là un domaine limité et factuel, mais qui, en compensation, comporte des volontés, des réalisations et, une fois encore, des tâches nouvelles, qui n’ont rien à voir avec les belles phrases ni les généralités de l’éthique, mais consistent en buts historiques tangibles.
Qualifier cette vue de pessimisme, c’est se borner aux platitudes quotidiennes de la flânerie d’idée en idée. C’est faire de l’histoire une grand-route où l’humanité trotte tout droit, toujours dans la même direction, toujours attirée par la carotte d’un lieu commun philosophique. Voici longtemps que les philosophes ont constaté, chacun différemment de l’autre, mais chacun en seul possesseur de la vérité, quels sont les mots sonores, nobles et abstraits qui constituent le but de notre existence terrestre et son essence propre ; mais l’optimisme exige en outre qu’on s’en rapproche sans cesse sans jamais les atteindre. Une fin prévisible serait en contradiction avec l’idéal. Et si quelqu’un se rebiffe, c’est un pessimiste.
J’aurais honte de me contenter d’idéaux aussi médiocres en guise de viatique sur le chemin de la vie. Ils ont en eux la lâcheté des pleutres et des rêveurs de naissance qui ne supportent pas de regarder la réalité en face et de définir un but réel en quelques mots froids. Il faut toujours que ce soient de grandes généralités dont la lumière leur parvient de loin. Ce qui apaise l’angoisse de ceux qui sont trop corrompus pour assumer les risques, les entreprises, tout ce qui exige l’énergie, l’initiative, la supériorité. Un tel livre peut avoir sur eux un effet écrasant, et je le sais. Des Allemands m’ont écrit d’Amérique qu’il agit comme un bain d’acier sur ceux qui sont résolus à être quelque chose dans la vie. Mais quand on n’est né que pour palabrer, fabuler et rêvasser, on trouve dans chaque livre son poison. Je connais ces “jouvenceaux” dont grouillent tous les quartiers d’hommes de lettres et d’artistes et toutes les universités ; ç’a d’abord été Schopenhauer, puis Nietzsche, qui ont dû servir de prétexte à les dispenser de l’obligation d’être énergique. Voici qu’ils ont découvert un nouveau libérateur.
Non, je ne suis pas un pessimiste. Le pessimisme, c’est l’incapacité à percevoir de nouvelles tâches. J’en vois tant, et qui ne sont pas encore accomplies, que je crains que le temps et les hommes ne nous manquent pour en venir à bout. L’aspect pratique de la physique et de la chimie est loin d’avoir atteint des limites de ses possibilités. Dans presque tous ses domaines, la technique tend encore vers son sommet. L’un des grands devoirs de l’archéologie moderne est de dessiner enfin, à partir d’innombrables résultats partiels, une image de l’Antiquité qui puisse chasser des conceptions de nos savants le tableau néo-classique, avec son invitation aux flâneries idéales. Nulle part on ne peut mieux apprendre comment tout se passe réellement dans le monde et comment, en tout temps, le romantisme et les idéaux abstraits se sont fracassés sur les écueils des faits. Nous n’en serions pas là si nous avions à l’école plus étudié de Thucydide qu’appris de vers d’Homère. Mais jusqu’à présent, pas un homme d’État n’a songé à rédiger pour la jeunesse un commentaire de Thucydide, de Polybe, de Salluste et de Tacite. Nous n’avons ni une histoire de l’économie antique, ni une histoire de la politique dans l’Antiquité. Nous n’avons pas, malgré les analogies surprenantes avec l’histoire d’Europe occidentale, une histoire politique de la Chine jusqu’à son Auguste, Hoang-ti [Huángdì]. Le droit, donné en même temps que la structure sociale et économique de notre civilisation, en est encore aux toutes premières ébauches de l’analyse. Jusqu’à présent, la science du droit n’est guère plus, à ce que disent ses meilleurs spécialistes, que philologie et scolastique de termes. L’économie politique n’est même pas encore une science. Je m’abstiendrai ici de parler des tâches politiques, économiques, structurelles de notre avenir. Mais ce que recherchent nos contemplatifs et nos idéalistes, c’est une conception du monde confortable, un système qui n’oblige qu’aux convictions, un prétexte moral à leur phobie de l’action. Ils palabrent assis dans les recoins de la vie, la place qui leur revient de naissances : qu’ils y restent.
Quelle est au fond la conséquence du fait qu’il ne s’agit pas du progrès millénaire de “l’humanité”, millénaires en vue desquels nous n’ébaucherons jamais un programme sans courir le risque que la réalité le corrige immédiatement, mais bien de la culture faustienne, durant les quelques siècles dont nous voyons les contours historiques ? L’orgueil puritain de l’Angleterre affirme : tout est prédestiné — donc c’est moi qui dois vaincre. Les autres disent : tout est prédestiné — prosaïquement et sans beaucoup d’idéalisme —, donc, il est inutile de rien entreprendre. Mais il en est ainsi des tâches qui nous sont encore imparties, à nous autres, hommes de l’Occident : pour les hommes d’action, elles sont illimitées ; pour les romantiques et les idéologues, incapables de s’imaginer le monde sans rimailler, peindre des tableaux, fabriquer des systèmes de morale ou vivre une philosophie pompeuse, les perspectives peuvent bien, en effet, être décourageantes.
Et je dirai ici franchement, sans me soucier des clameurs que je vais provoquer : on surestime l’art et la pensée abstraite, quant a leur importance historique. Si essentiels qu’ils aient été à les grandes époques, il y a toujours eu des faits plus essentiels. En histoire de l’art, on ne saurait placer trop haut l’importance de Grünewald et de Mozart. Dans l’histoire réelle de l’époque de Charles-Quint et de Louis XV, on ne songe même pas au fait qu’ils existent. Il se peut qu’un grand événement historique ait suscité un artiste. Mais le contraire ne s’est jamais produit. Or, ce qui se fait aujourd’hui dans ce domaine n’est même pas digne d’être pris en considération par l’histoire de l’art. Et quant à la philosophie spécialisée de nos jours, toutes ses écoles n’existent ni pour la vie, ni pour l’âme ; ses opinions, ni les esprits cultivés, ni les savants des autres domaines scientifiques n’en tiennent compte. Elles n’ont d’autre utilité que de permettre d’écrire à leur sujet des thèses, lesquelles sont citées dans d’autres thèses, qui, à leur tour, ne sont lues par personne, sinon les futurs professeurs de philosophie. La question de la valeur de la science a été soulevée par Nietzsche. Il commence à être temps de se demander aussi ce qu’est la valeur de l’art. Des époques sans art ni philosophie authentiques peuvent n’en être pas moins de grandes époques ; les Romains nous l’ont appris. Mais, pour les éternels traînards de l’histoire, c’est là le critère qui permet de juger de la valeur de la vie.
Soit : mais non pour nous. On m’a dit que sans art, la vie ne valait pas la peine d’être vécue ; je réponds : pour qui n’en vaut-elle pas la peine ? Je n’aurais pas voulu, parmi les Romains contemporains de Marius et de César, avoir mené la vie d’un sculpteur, d’un moraliste, d’un dramaturge, ou de membre de quelque secte à la manière de Stefan George, qui, derrière le forum, exprimait en gesticulations littéraires son mépris de la politique romaine. Personne ne pourrait entretenir des rapports plus étroits que je ne le fais avec le grand art de notre passé — car le présent n’en a pas ; je ne voudrais pas vivre sans Goethe, sans Shakespeare, sans les architectures d’autrefois ; tout exemple noble d’art de la Renaissance me bouleverse, mais justement parce que j’en perçois les limites. Je mets Bach et Mozart plus haut que tout ; mais il ne s’en suit nullement qu’on doive reconnaître aux milliers d’habitants de nos métropoles qui écrivent, peignent, méditent sur le monde la qualité d’artistes et de penseurs authentiques. En Allemagne, on peint, on écrit, on “projette” plus que dans tous les autres pays du monde réunis. Est-ce là culture ou absence de sens du réel ? Sommes-nous tellement riches de forces créatrices, ou tellement pauvres en énergie pratique ? Et les résultats répondent-ils, ne fût-ce que de loin, au vacarme généreusement entretenu autour de ces œuvres ? L’expressionnisme, mode d’hier, n’a laissé derrière lui ni une personnalité ni une œuvre de quelque valeur. Certes, j’ai été mille et mille fois réfuté lorsque j’ai mis en doute le sérieux de ce mouvement. Peintres, poètes, philosophes se sont efforcés de le démontrer, par les mots, non par les actes. Qu’ils me réfutent en plaçant à côté de Tristan, de la Sonate pour piano, du Roi Lear, des portraits de Hans von Marées un quelque chose de même niveau. C’est ici que nous courons le risque que tous ces “mouvements” sans nerf, efféminés, superflus soient considérés, non comme une nécessité, mais comme la nécessité de l’époque. C’est ce que j’appelle la philosophie style Arts décoratifs. Architecture, peinture et littérature : arts décoratifs ; religion : art décoratif ; politique : art décoratif, et l’interprétation du monde elle-même : art décoratif ; — tous ces “cercles” et ces “ligues”, ces cafés et ces salles de conférences, ces expositions, ces maisons d’édition et ces revues sont puants de prétention. Et ces gens-là ne demandent pas qu’on les supporte seulement — tout cela veut exercer le pouvoir ; tout cela se qualifie d’allemand ; tout cela veut disposer souverainement de l’avenir.
Même ici, je vois toujours des tâches qui s’offrent, mais il y manque les hommes — les hommes ! — qui soient à leur hauteur. Le roman allemand est parmi les exigences de ce siècle ; jusqu’à présent, nous n’avons que Goethe. Mais il exige des personnalités, d’une énergie et d’une intelligence du monde supérieures, formées dans de grands postes, grandes aussi par la noblesse de leurs vues et de leur tact. Nous n’avons pas encore de prose allemande, au sens où il existe une prose anglaise et française. Ce que nous possédons, jusqu’à présent, c’est le style d’écrivains isolés qui tranchent sur une moyenne exécrable et s’élèvent jusqu’à une maîtrise toute personnelle. Le roman pourrait en être l’occasion : mais de nos jours, des hommes de la réalité, industriels, officiers supérieurs, organisateurs, écrivent mieux, plus sérieusement, plus clairement, plus profondément que ces gens de lettres de dixième zone qui se sont fait du style un sport. Je ne trouve nulle part, dans le pays de Till Eulenspiegel (1), une farce de grand style, pleine de sommets et d’abîmes historiques, spirituelle et tragique, légère et subtile ; c’est presque la seule forme en vertu de laquelle on puisse être aujourd’hui à la fois philosophe et poète sans tomber dans l’inauthenticité. Je ne trouve toujours pas ce dont Nietzsche déplorait naguère l’absence : une musique allemande à la “Carmen”, racée et pleine d’esprit, étincelante de mélodies, de rythme et de feu, digne que Mozart et Johann Strauss, Bruckner et le jeune Schumann n’aient pas honte de passer pour ses ancêtres. Mais les acrobates actuels de l’orchestration sont des impuissants. Depuis la mort de Wagner, pas un seul grand mélodiste ne s’est fait connaître. Ce qu’était jadis, du temps où il existait un art vivant, la convention, le tact même de la vie, commun aux artistes, aux œuvres et aux connaisseurs, et qui contraignait chacun de créer et de voir comme il le devait et y était obligé, si bien que les grands artistes se distinguaient des petits, non par la rigueur de la forme, mais seulement par la profondeur des conceptions — ce tact a été remplacé par “l’ébauche”, le genre le plus méprisable qui soit. Tout ce qui ne vit plus est ébauché. On vous ébauche une culture personnelle, avec théosophie et adoration du Maître, on vous ébauche une religion personnelle, avec éditions de Bouddha sur papier vergé, on vous ébauche un État fondé sur l’Éros. Depuis la Révolution, on voudrait “ébaucher” une agriculture, un commerce, une industrie.
Il faut réduire ces idéaux en miettes ; plus le bris sonnera haut et clair, et plus nous serons contents. C’est la dureté, une dureté romaine, qui naît maintenant dans le monde entier. Bientôt, il n’y aura plus de place pour rien d’autre. L’art, soit, mais qu’il soit de béton et d’acier, la création poétique, soit, mais que ce soit l’œuvre d’hommes aux nerfs d’acier et à l’esprit d’une profondeur inexorable, la religion, soit — mais alors, prends ton livre de cantiques, et non Confucius sur papier vergé, et va-t’en à l’église. La politique, soit, mais faite par des hommes d’État et non des réformateurs du monde entier. Tout le reste est indigne qu’on le prenne en considération. Et on ne devrait jamais oublier ce que nous autres, hommes de ce siècle, avons derrière nous et devant nous. Quant à nous, les Allemands, nous ne produirons plus jamais un Goethe, mais bien un César.
► Oswald Spengler, in : Preussischer Jahrbücher, CLXXXIV, 1921. Traduction française : Henri Plard, in : Écrits historiques et philosophiques, Copernic, 1980.
1. Selon la tradition, Eulenspiegel était de l’Elm, une région de collines boisées à l’est de Brunswick, et est né à Kneitlingen (NdT).







